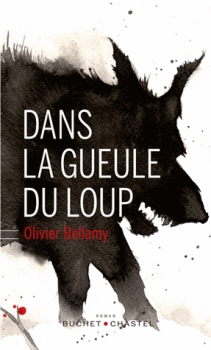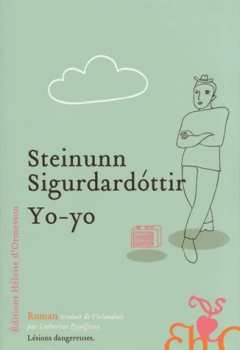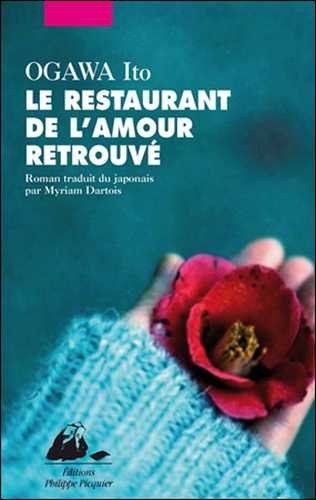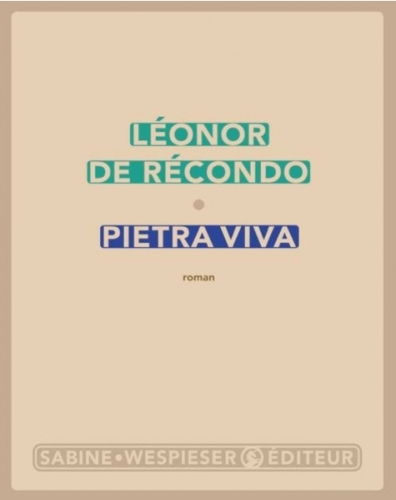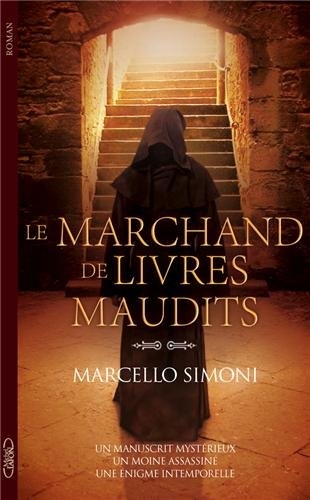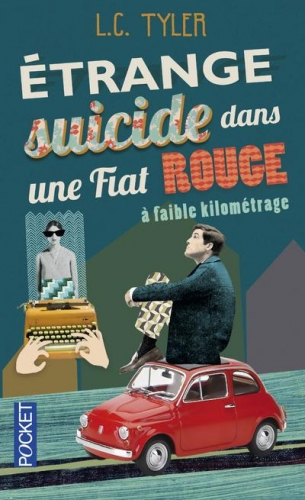Adria Ardèvol approche de la soixantaine quand il entreprend de rédiger ses mémoires. Ce professeur de l'université de Barcelone, grand intellectuel, plus grand érudit encore, polyglotte capable de parler plus d'une dizaine de langues et d'en comprendre plusieurs autres encore compte bien, à travers les feuillets qu'il noircit de sa petite écriture, de raconter son existence à Sara, la femme qu'il aime depuis qu'il a croisé son regard des décennies plus tôt...
Plus que des mémoires, ce sont des confessions que Adria choisit d'adresser à Sara. Le récit d'une existence, la sienne, et de tant d'autres, croisées directement ou indirectement, celles qui l'ont influencé et celles qu'il a influencées par chacun de ses gestes, chacune de ses décisions... Chacun de ses mensonges, aussi.
Pourquoi cette soudaine envie de mettre sa vie au clair, se livrer ainsi sans rien omettre ? Parce que la maladie gagne du terrain et Adria sait qu'il lui reste désormais peu de temps avant que sa mémoire ne l'abandonne, définitivement, à un rythme impossible à anticiper... Alors, il se lance dans ce récit, en espérant l'achever avant de ne plus en être capable...
Adria est né à Barcelone peu de temps après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. Il a donc grandi dans l'Espagne franquiste des années 50 au sein d'une famille bourgeoise. Son père tient un magasin d'antiquités semble-t-il assez prospère, et se passionne pour les manuscrits anciens. Sa mère ne travaille pas, sans pour autant s'occuper de son fils avec bienveillance.
Car, tout le problème du jeune Adria est là : il ne se sent pas aimé par ce père sévère et irascible et par cette mère d'abord effacée. Pourtant, chacun de ses parents nourrit pour l'enfant des ambitions qui passent outre les souhaits du garçon. Son père veut en faire un grand intellectuel, une sommité dans ce qu'on appelle les Humanités, en particulier les langues, vivantes ou mortes ; sa mère, elle, le voit déjà comme un violoniste prodige, jouant les plus grandes oeuvres musicales sur les plus grandes scènes du monde...
L'enfant ne rejette pas radicalement tout cela, on ne peut pas dire qu'il déteste apprendre des langues nouvelles, au contraire, il se découvre même un don pour cela, un certain don. Idem pour le violon, on le dit prometteur... Mais, il manque à Adria l'ambition... De cette enfance, va lui rester surtout des frustrations qu'il va essayer d'effacer une fois devenu adulte, pire, orphelin...
Son rejet des diktats parentaux va alors se manifester pleinement, à la fois dans ses comportements et dans ses actes. Il va devenir ce que son père attendait de lui, un intellectuel de haute volée, un homme à la curiosité insatiable, mais pas pour tirer une satisfaction matérielle de tout cela mais bel et bien intellectuelle... Il va rompre avec cette enfance qui l'a marqué...
Mais rompre avec ses parents, c'est rompre aussi avec leurs travers. Le père d'Adria a en effet un passé pour le moins sombre et peu reluisant, ayant bâti sa fortune sur des actes franchement peu honorables... Toute la vie de Felix Ardèvol est construite sur des mensonges, des trahisons lourdes, de la malhonnêteté, habilement déguisé en notabilité...
Quant à sa mère, sa frustration d'épouse malheureuse a rejailli sur l'enfant, sa vie sans amour, donné ou reçu, en a fait un homme qui a un besoin d'amour fondamental, tout en affichant une personnalité un peu froide, parfois hautaine, souvent lâche... En devenant adulte, Adria se veut l'antithèse de ces parents qui n'ont pas su l'aimer et se découvre d'autres défauts qu'il aura bien du mal à gommer...
Car, et je me rends compte que je vous parle plus d'Adria que de son histoire à proprement parler, tout va tourner autour de la personnalité d'Adria et de la manière dont elle s'est façonnée... Adria raconte une vie plongée dans les livres plus que dans la réalité. Car, l'ambition que le jeune homme s'est découverte est... de tout savoir !
Et en particulier en ce qui concerne l'Histoire, y compris les petites histoires qui s'agrègent pour former la grande Histoire. Or, dans cette quête de savoir, Adria va faire peu à peu apparaître une évidence : de tous temps, l'Homme est la proie du Mal. Oui, je mets des majuscules partout, mais ce n'est pas superflu. Le Mal, voilà l'un des grands thèmes de "Confiteor".
Adria a grandi sans religion, son père a banni Dieu de son existence. Pourtant, la religion est omniprésente dans tout le roman, à commencer par son titre, puisque le Confiteor est une prière catholique, une prière de contrition dans laquelle on confesse ses fautes... Voilà qui nous amène à l'autre grande problématique du roman : la culpabilité...
Je pourrais résumer en disant que, dans la famille Ardèvol, le père incarne le mal et le fils, la culpabilité, mais ce serait prendre des raccourcis, car le raisonnement, et c'est la grande force du roman de Jaume Cabré, c'est de proposer une fiction complète qui sert de base à une réflexion universelle...
Mais la question religieuse est posée à plus d'un titre. On pourrait reprendre l'une des fameuses pensées de Pascal, misère ou vanité de l'homme sans Dieu, mais non, car, ce qu'instaure Adria, c'est d'être le propre Dieu de son propre univers. Une scène étonnante assoit cette thèse : l'emménagement d'Adria dans l'appartement familial, transformé à son image, et mis en parallèle avec la création du monde telle que racontée dans le livre de la Genèse...
A travers son enfance, à travers ses études en Allemagne, dans la grande université de Tübingen, à travers sa vie d'universitaire à Barcelone, Adria cherche à comprendre la source du Mal qui semble aussi bien inspirer l'homme que le menacer en permanence. Et plus il y réfléchit, plus il a du mal à l'expliquer, plus il s'enfonce dans la culpabilité... "Confiteor", c'est un gigantesque cercle vicieux que seule une maladie dégénérative peu achever, tant la quête semble impossible à réaliser...
Et c'est là que nous allons parler de la forme de ce roman, autant que de son fond. Car le récit d'Adria n'est pas seulement un récit linéaire, chronologique. Oh, en principe, il l'est... Mais la maladie s'emmêle par moments, fait irruption dans le récit du professeur Ardèvol sous une forme particulière...
Sans prévenir, sans avertissement d'aucune sorte, même typographique, le récit d'Adria saute du coq à l'âne. En un changement de ligne, on quitte la deuxième moitié du XXème siècle pour le XIVème siècle et l'Inquisition espagnole, les XVIIème et XVIIIème siècles en Italie, à lé découverte des déboires d'un jeune homme qui a dû s'enfuir, laisser sa famille et son identité derrière lui et de reconstruire entièrement ou d'un luthier qui entend concurrencer Stradivarius, au début du XXème siècle, à la rencontre du père d'Adria dans sa jeunesse, enfin, pendant la Deuxième Guerre Mondiale, jusqu'à Auschwitz, au coeur de l'ignominie, du Mal absolu, de coup de grâce porté à l'idée d'un dieu de miséricorde et d'amour...
Adria, en plein coeur de sa confession, raconte des faits, présente des personnages, met en scène des actes, introduit dans le récit des objets... De prime abord, le lecteur est un peu surpris, puis, on comprend le principe même si aucun signe avant-coureur ne signale l'arrivée des digressions, parfois longues... Et, peu à peu, ces histoires parallèles s'agrègent et forment une incroyable toile d'araignée où tout est relié... L'Histoire ne devient alors qu'un jeu de causes et de conséquences où chaque acte, du plus anodin au plus grave, est le fruit d'histoires particulières et en engendrent d'autres...
Adria devient alors le centre de cette toile, entouré par des objets comme autant de madeleines de Proust puissance mille : des tableaux, un violon, une médaille, une serviette de table, une tombe... Tous ces objets ont une histoire propre que l'on découvre au fil du récit, histoire qui explique, comme l'indique la citation inscrite en titre de ce billet, leur situation présente, leur présence dans le vie d'Adria et leur état de conservation... Plus une charge émotionnelle incroyablement puissante !
C'est là qu'intervient ma subjectivité de lecteur... Que ce sont ces récits ? Une réalité factuelle, établie par l'historien Adria Ardèvol au cours de ses incessantes recherches ? Est-ce le symptôme de la maladie qui gagne du terrain et grignote sa mémoire, la remplaçant par d'autre récits que les souvenirs ? Est-ce l'outil fort habile utilisé par Jaume Cabré pour, à travers Adria et son obsession pour le Mal, proposer un constat déconcertant : et si le Mal était partout en tout temps, sans distinction, au point que les Inquisiteurs médiévaux et les SS des camps nazis en sont le même instrument ?
Chaque lecteur, je pense, se fera son avis sur cette question, choisira une de ses possibilités ou en verra d'autres. Mais, les digressions déroutantes du début du livre vont ensuite prendre une proportion narrative incroyable et j'était comme devant un roman animé, une fresque qui se complétait petit à petit sous mes yeux... Impressionnant...
Je vais essayer de ne pas faire trop long, promis, même si ce pari est déjà perdu... Il me faut parler de deux personnages que je n'ai pas encore évoquer jusqu'ici : Bernat et Sara. Pardonnez mon manque de galanterie, on commence avec Bernat, le meilleur (le seul ?) ami d'Adria, tout au long de sa vie. C'est le violon qui les a réunis. Ensuite, c'est une étrange complicité qui va les unir, comme si leurs différences les unissaient mieux que des points communs...
Bernat est l'un des rares liens véritables d'Adria à la réalité, celui qui le sort de sa solitude, meublée dans son enfance par deux jouets, l'indien Aigle-Noir et le shérif Carson, les seuls à qui Adria se confiait... Bernat, c'est un peu le négatif photographique d'Adria : il a l'ambition qui manque à Adria pour devenir virtuose et écrivain, mais il lui manque le talent que possède sans doute son ami... Ce qui en fait un être frustré en permanence, un être qui va, en vieillissant, se comporter de plus en plus comme le propre père d'Adria, en devenant autoritaire à l'excès...
Bernat est sans doute le seul homme à qui Adria fait confiance en ce bas monde. Voilà pourquoi, malgré leurs désaccords, leur relation parfois houleuse, la jalousie diffuse de Bernat et l'apparent désintérêt d'Adria, c'est à lui que le malade va confier son épais manuscrit pour que celui-ci le mette en forme afin d'en faire un recueil...
La confession d'Adria va lui ouvrir quelques perspectives et il va comprendre à quel point la culpabilité aura rongé son ami de son enfance à sa fin... Et on pourrait même mettre culpabilité au pluriel, car Adria a assumé la culpabilité née des comportements de ses parents, quelque part l'universelle culpabilité judéo-chrétienne et, peut-être plus violemment encore, sa propre culpabilité...
Car, dans son texte, Adria ne se ménage pas. Apparaît un personnage lâche et menteur qui a blessé bien des gens au cours de sa vie par sa façon d'être... Parfois, c'est la timidité de cet enfant introverti grandi dans le cocon qu'il s'est tissé lui-même qui provoque les malentendus, parfois, il est victime d'autres agissements, parfois, parce qu'il fuit la vérité et tout ce qu'elle pourrait remettre en cause dans sa vie...
C'est là qu'intervient Sara. Elle est la destinataire de la confession d'Adria. Elle est son amour, son seul amour, celui qui ne passera jamais. Elle est celle qui a longtemps incarné un amour impossible mais celle qui va révéler les défauts majeurs d'Adria, car celui-ci craint tellement de la perdre qu'il va s'enferrer dans ses mensonges, ses lâchetés...
Et le poids de cela va le pousser véritablement à se confesser à elle, à lui avouer tous les écarts qui ont jalonné sa vie, les siens, ceux de ses proches, ceux de toutes les personnes qui ont permis l'acheminement des objets jusqu'à lui... Adria confesse ses fautes, ses très grandes fautes, et toutes celles du monde, commises au fil des siècles...
Qu'attend-il de Sara avec cette confession exhaustive ? Un pardon ? Délicat, à plus d'un titre... Mais principalement parce que toute sa vie, Adria s'est heurté à un écueil qui jalonne ses mémoires : l'impossibilité du pardon. Tout mal est irréversible, la vengeance est inutile, elle n'efface rien. Pire encore, les conséquences de ces actes feront inexorablement taches d'huile...
Le seul baume qu'a pu trouver Adria, c'est l'art. Ce n'est pas un remède, l'art ne guérit pas mais il apaise. Il fait reculer le Mal... L'incroyable parcourt du violon que possède Adria le montre. L'art est une espèce de lampe-torche qui troue les ténèbres pendant un instant, les écartant provisoirement mais ne pouvant empêcher qu'elles se referment ensuite sur son passage...
Mais, à l'instar de Dieu, qui brille par son absence, l'art ne risque-t-il pas de plonger irrémédiablement le monde dans un enfer terrestre où le Mal n'aurait plus rien pour s'opposer à son hégémonie... Dans ce contexte, la propre existence d'Adria, vouée elle-même à s'éteindre petit à petit, comme dissoute par un acide, devient une sorte d'allégorie du monde dans lequel nous vivons...
Je réfléchis trop, dit-on, par-ci, par-là, je le concède... Confiteor, comme dirait Adria... Alors, je ne vais pas finir sans vous dire combien la lecture du roman de Jaume Cabré m'a donné d'émotions... L'histoire centrale, celle d'Adria, est à elle seule prolifique en moments forts, car la vie de cette homme est bouleversante par bien des aspects... Mais les destins particuliers que l'on suit en parallèle, au gré des digressions et des drames dont regorge notre Histoire, sont aussi particulièrement émouvantes...
"Confiteor" est une lecture exigeante, disons les choses sans fard. Ne vous attendez pas à une lecture facile, la densité du livre autant que ses 775 pages sont là pour vous rappeler qu'il va vous falloir passer pas mal de temps avant de pouvoir contempler la totalité de la mosaïque que réalise Cabré. Mais vous serez récompensés de votre persévérance, au final, en ayant la satisfaction d'avoir lu un grand et beau livre.