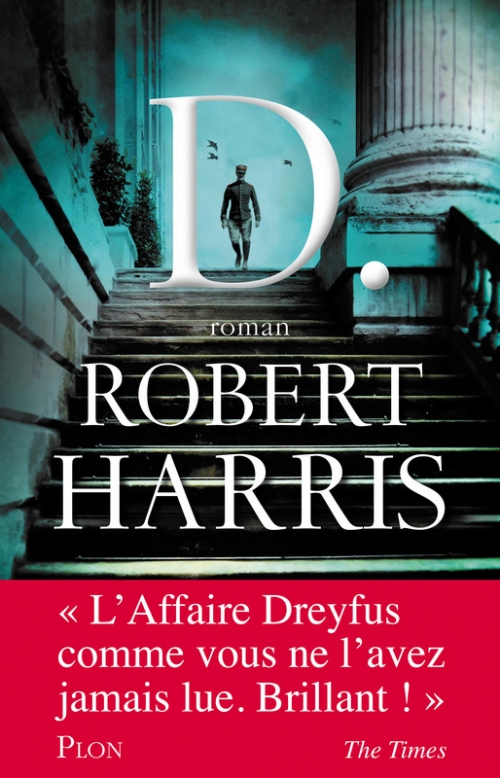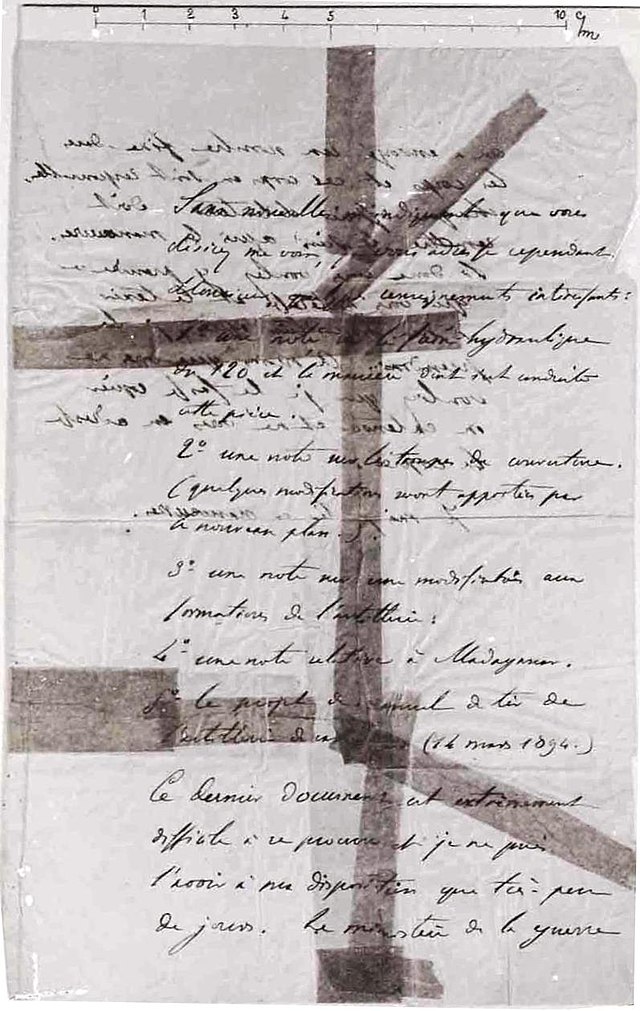On l'appelle Poil de Carotte. Rapport à sa tignasse rouquine. Pas d'une grande originalité, tout ça. Mais, à y regarder de plus près, la comparaison avec le personnage de Jules Renard pourrait aller plus loin... En effet, Poil de Carotte est un des souffre-douleur de son école. Tout ça parce qu'il traîne avec David, le P'tit Gros, que personne n'aime.
Mais Poil de Carotte ne rêve que d'une chose : être un élève populaire. Enfin, dans sa tête, ça ne se formule pas ainsi. Ce serait plutôt : faire partie de la bande des forts et des craints, aux côtés de Timmy. Devenir son bras droit, prendre la place de celui qu'on appelle le Putois et montrer à tous les autres que, tout rouquin qu'il est, il en impose.
En imposer... Aux garçons, mais aussi aux filles. A Méli, surtout, qui n'a d'yeux que pour Timmy, mais que Poil de Carotte mange du regard dès qu'il le peut. En fait, c'est surtout un garçon qui entre dans l'adolescence et se sent très seul. Peu d'ami, à part David, et une vie de famille pas franchement réjouissante. On comprend peu à peu qu'un drame a frappé Poil de Carotte et son père, irrémédiablement enfermé chez lui.
C'est l'enfant qui se coltine toutes les tâches ménagères, ce qu'il fait avec entrain. Aider son père, aussi bien dans la maison que dans la cour, où ils élèvent quelques animaux de basse-cour et la jument Baudruche, qui est grosse, c'est finalement là que le garçon s'épanouit le plus. Se rendre utile, enfin...
Oui, le Poil de Carotte de Morgane Caussarieu a pas mal de points communs avec le Poil de Carotte originel, celui de Jules Renard. Comme cette solitude, cette impression de n'être aimé de personne, le fait d'être souvent corrigé et humilié par ses "camarades" de classe, les animaux, les échappées belles pour ne plus penser à tout ça... Sans oublier une certaine propension au sadisme qui ne demande qu'à se déployer.
Ce Poil de Carotte-là vit en Gironde. Pas loin d'une ferme qui a récemment brûlé, un endroit maudit, dit-on, sur lequel courent des bruits et rumeurs qui tiennent de la légende urbaine en milieu rural. On dit tellement de choses sur ceux qui vivaient là quand l'incendie à eu lieu ! De vrais croquemitaines !
Il y a aussi, dans les environs, un blockhaus, évidemment abandonné depuis longtemps, qui menace ruine mais que Poil de Carotte et David se verrait bien transformer en un endroit à eux, rien qu'à eux, impossible à prendre pour leurs ennemis, ceux qui ont détruit la cabane qu'ils avaient construite. Ceux de la bande à Timmy. Encore et toujours...
Et puis, voilà que se produisent des choses étranges, dans la vie de Poil de Carotte. Un chat noir qui apparaît et disparaît. Bon, vous me direz, c'est le propre de bien des chats. Mais celui-là a une manière de le faire qui vous fait passer un frisson le long de la colonne vertébrale. Et en plus, c'est un chat... qui parle !
En tout cas, il parle à Poil de Carotte, il l'a même guidé jusqu'à la ferme détruite, là où plus personne ne va, parce qu'on a peur de ce qui s'est passé, de ce qui pourrait se passer. Surmontant sa peur, Poil de Carotte va y entrer, y fouiner, y sentir une présence, inquiétante. Avant d'en repartir, en courant, la peur aux tripes, et de s'enfuir sans demander son reste, commettant au passage une terrible bêtise, il a le temps d'attraper deux choses...
Une cassette audio et un carnet, léchés par le feu et la chaleur, mais restés miraculeusement intacts. Ces deux objets vont maintenant accompagner la vie de Poil de Carotte. Et les changements, nombreux, qui vont s'y produire. Car, en même temps que ces deux objets ou que le chat, d'autres personnages vont commencer à faire irruption dans la morne vie de l'enfant.
A commencer par un autre gamin, du même âge ou un peu plus jeune que Poil de Carotte. A peu près aussi bizarre que le chat. Mais Poil de Carotte l'aime bien. C'est peut-être ce qui ressemble le plus à un ami. Plus encore que David. Et ce garçon-là va lui en présenter deux autres. Des jumeaux, ce qui résonne fort dans l'esprit du gamin.
Ces frères sont les protagonistes du récit raconté dans le cahier. Un récit que ne comprend pas tout de suite Poil de Carotte : où cela se passe-t-il ? Quand ? En Louisiane, il ne sait pas où c'est, et, apparemment, il y a un bon moment... La preuve, on a encore des marquis, des esclaves, une région marécageuse à peine vivable, des Indiens... Etrange...
L'imagination de Poil de Carotte, qui tournait jusque-là au ralenti, s'enflamme subitement, et la lecture de ces pages devient une vraie drogue. Il veut comprendre, savoir qui sont ces jumeaux, découvrir ce qui leur arrive, des destins manifestement aussi compliqués que dramatiques. Et plus encore mystérieux...
Le décor est planté. Morgane Caussarieu fait parler son Poil de Carotte comme un Poulbot, se souciant comme de sa première barboteuse de la grammaire. Un style qui tranche avec celui, bien plus classique, du mystérieux carnet. Il faut dire qu'entre les deux, il n'y a pas que l'époque qui diffère : la temporalité, la géographie, le milieu social, les malheurs qui frappent ces enfants, le côté aventureux de la vie des jumeaux par rapport à la triste existence de Poil de Carotte.
Tout ce qui arrive aux jumeaux, Poil de Carotte y assiste sidéré, les yeux écarquillés, comme s'il y était. Oui, il vit littéralement ces événements, au point parfois d'entrer dans le carnet et de sentir la Louisiane, ses odeurs, sa moiteur, sa faune, ses dangers... Guidé par l'étrange gamin qui ne lui en dit pourtant qu'un minimum, l'enfant s'évade enfin, se trouve une passion...
Et se métamorphose.
Un changement palpable. Une prise de confiance en lui. Sauf que ce changement profond, soudain, va s'exprimer de terrible façon. Les instincts refoulés du gamin depuis le drame vont ressortir. Et si la culpabilité reste présente chez l'enfant, ce n'est jamais qu'en réaction de ses actes. Il commet, et ensuite, il regrette.
Mais c'est déjà trop tard, et il est engagé sur un chemin qu'on ne peut rebrousser. Un chemin qui va le mener vers le mal. Absolu, violent, intense... Jouissif, aussi. En faisant tomber ses inhibitions, Poil de Carotte fait tomber les tabous, et pas seulement les siens. Il devient enfin le petit caïd qu'il rêvait d'être, prend sa vie en main, contrôle tout, devient le centre de l'attention...
Même si l'on comprend d'emblée, sans vraiment savoir pourquoi, que ce bonhomme, qui inspire de prime abord, plutôt la commisération, voire la pitié, a un côté sombre, son épanouissement fait froid dans le dos. Une plante vénéneuse qui fleurit, nourrie par un engrais effrayant qui a maturé longuement, si longuement...
Sans proposer une suite à proprement parler à "Dans les veines", Morgane Caussarieu y apporte, avec "Je suis ton ombre", une espèce d'éclairage. Il y a complémentarité entre ces deux romans. Sans doute faut-il les lire dans l'ordre de parution, mais ce n'est pas obligatoire non plus, même si, bien sûr, certains éléments, dont j'ai pris soin de ne pas parler ici, apparaîtront plus clairement.
La partie du récit qui se déroule en Louisiane aurait pu faire l'objet d'un roman à elle toute seule. Elle est sombre, extrêmement violente et envoûtante, gore et il flotte au-dessus d'elle un fort parfum d'immoralité, qui sera bientôt remplacé par l'amoralité. Nuance aussi subtile que les fragrances... On y plonge, car tout y est liquide, jusqu'à l'air, si saturé d'humidité qu'on pourrait le couper au couteau.
Les protagonistes pourraient croiser Lestat et ses proches, s'ils ne se trouvaient pas loin de la Nouvelle-Orléans, déjà vu comme une nouvelle Sodome et Gomorrhe. On est à la campagne, si je puis dire, en pleine nature, hostile, sauvage, inconnue. Et cela ajoute au sentiment d'oppression que l'on ressent, mais aussi à la fascination.
J'en ressors avec la même impression qu'après avoir lu "Dans les veines" : on retrouve chez Morgane Caussarieu des thématiques proches de celles d'Anne Rice, mais la jeune Française les pousse au paroxysme quand l'illustre Américaine reste dans la suggestion. Sexe et corruption morale sont criants, montrés, ici. Même lorsqu'on ne s'y appesantit pas, il n'y a aucun doute sur les situations. Et elles sont bien souvent sordides.
Cette partie américaine est le coeur du livre, celle qui palpite et engorge tout le reste du roman. Sa vie, sa vigueur naissent de ce récit particulier sans lequel Poil de Carotte n'aurait certainement pas remis en cause son existence, aussi ordinaire et misérable soit-elle. Non, sans l'exotisme, le luxe et l'odeur d'interdits (oui, au pluriel) qui se dégage de ce cahier, pas d'histoire contemporaine.
A l'image de Poil de Carotte, on se demande quelle mécanique étrange on a enclenché avec ce mystérieux cahier. Le lecteur, de l'extérieur, voit l'enfant s'enfoncer dans cet univers comme dans ces bayous gluants d'où l'on ne ressort pas si on a posé le pied au mauvais endroit. Il y a quelque chose de faustien dans ce qui arrive à Poil de Carotte. Dans sa relation à cet autre enfant, qui pourrait être un alter ego, au sens strict : un "autre moi".
Poil de Carotte, c'est un peu Donnie Darko, version aquitaine. Un enfant qui se fabrique un ami imaginaire tellement puissant qu'il le fait dérailler. La marionnette devient le marionnettiste, en quelque sorte. L'imagination galopante de Poil de Carotte, si souvent bridée, est libérée, comme l'eau qui a brisé les digues et tout recouvert sur son passage à la Nouvelle-Orléans après Katrina...
Mal dans sa peau, comme beaucoup d'enfants de son âge (Timmy, le Putois, David le sont tous, d'ailleurs, manifestant la chose très différemment), malheureux, portant le poids sur ses épaules du drame qui a touché sa famille, cherchant désespérément une approbation, une amitié sincère, profonde, capable de servir de substitut à son absence d'amour, Poil de Carotte découvre dans ce cahier tout ce qui lui manque.
On se dit, et on le voit, qu'il est le seul à pouvoir vivre positivement ce qui vient chambouler sa vie. Le seul sur qui la peur n'a pas d'emprise. Le seul qu'elle dope. La curiosité est plus forte que la peur et l'impression d'entrer dans le livre, son attrait irrésistible, font qu'il est comme ensorcelé, gavé de la puissance de son imaginaire.
A un détail près : et si Poil de Carotte n'imaginait rien du tout ?
On pense évidemment à Jules Renard et à son roman autobiographique, parce que la référence est évidente. Mais il y en a une autre, bien plus frappante, dans "Je suis ton ombre". Poil de Carotte entre, à sa façon, dans son "pays des merveilles". A ses yeux, c'en est... Mais que se passera-t-il lorsqu'il sera passé de l'autre côté du miroir ?