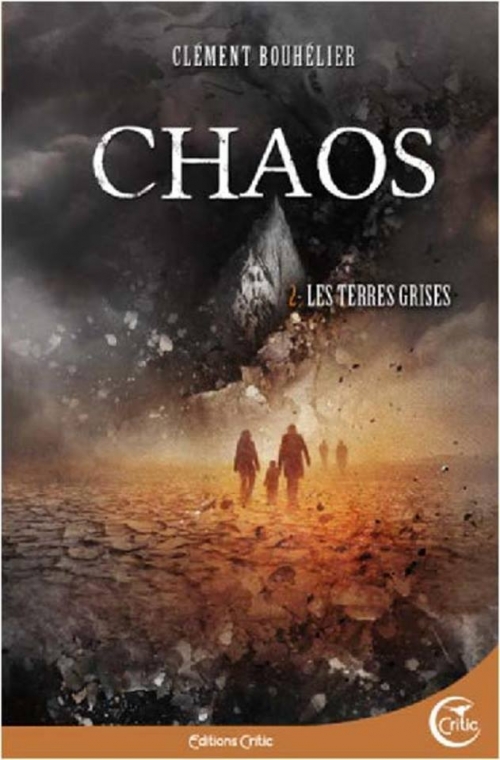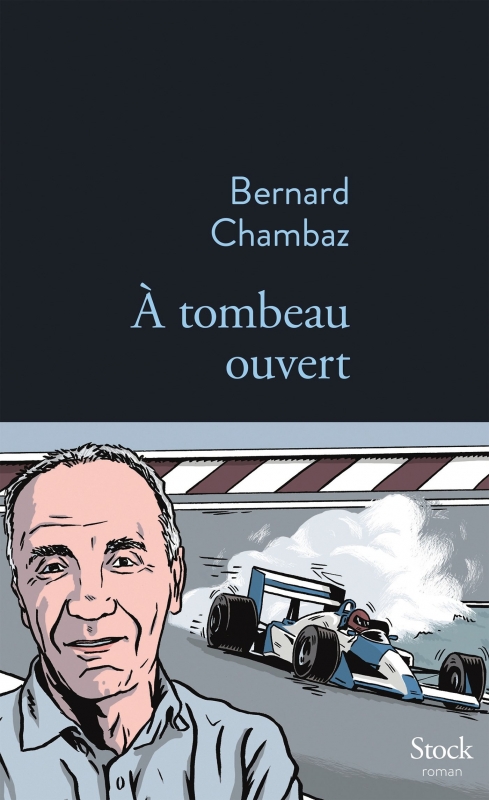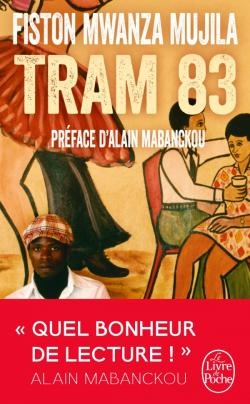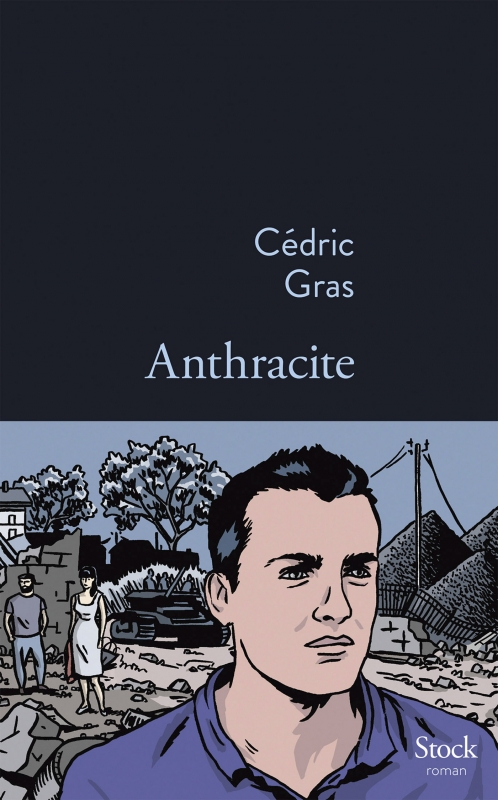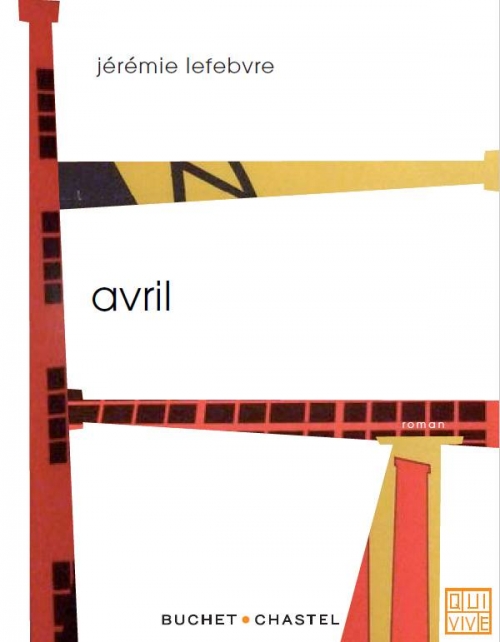ATTENTION, CE BILLET CONCERNE LE SECOND VOLET D'UN DIPTYQUE.
- Le billet sur le premier tome.
Au printemps dernier, nous avions évoqué le premier tome d'un diptyque qui semblait se présenter comme une histoire de zombies, une de plus parmi tant d'autres... Et puis, en lisant cette première partie, non seulement il y avait plein d'idées originales et intéressantes, mais surtout, on en sortait en se disant que, non, ce n'était pas un livre de zombies de plus. Et voilà que la deuxième partie est enfin disponible en cette fin août. Il fallait que je le lise, et vite, pour enfin éclaircir les points étranges qui restaient dans l'ombre et connaître le sort réservé aux personnages ayant survécu au cataclysme initial. Le tome 2 de "Chaos", de Clément Bouhélier (aux éditions Critic), s'intitule "les Terres grises" et, au moment où je tape ces lignes, je ne sais pas encore si je vous donnerai des explications le concernant... Mais on va parler de ce livre qui, soyez en sûr, n'a rien, mais alors rien du tout, d'un énième roman de zombies !
La maladie de l'oubli n'a cessé de se répandre et de faire de nouvelles victimes. La neige tombe sur la capitale, livrée aux rats qui se nourrissent des cadavres de ceux qui ont tout simplement oublié de vivre (et non, rien à voir avec la chanson de Johnny Hallyday). Quelques coups de feu claquent encore ici et là, mais les tireurs sont en sursis...
Et puis, il y a ceux qui n'oublient pas, pour reprendre le titre du premier volet. Phil, Claudy, Arthur et Chloé, qui est accompagnée par la petite Leslie, une enfant sourde qu'elle a pris sous son aile et qui semble également être immunisée contre la maladie. Pourquoi eux ? Ils l'ignorent encore, tout comme ils ne comprennent pas les messages qu'ils "entendent" de la part d'un mystérieux correspondant.
Ces survivants évoluent sous les yeux de deux mystérieux personnages : un homme en blanc, d'une part, et, de l'autre, un homme à l'étrange regard, avec ces yeux d'un vert qui rappelle une flaque d'eau polluée. Qui sont-ils ? Amis, ennemis ? Il n'y a guère qu'en allant à leur rencontre qu'ils en auront le coeur net. Et où aller, de toute manière, dans ce monde dévasté ?
Chloé compte sur Leslie, qui semble avoir capté les messages encore plus clairement qu'elle. Claudy et Arthur sont ensemble, mais le second, venu à Paris pour retrouver la femme qu'il aime, Noémie, veut d'abord mener à bien son projet. Quant à Phil, lui aussi est accompagné, mais il sait que la Dame en beige qui le suit a de très mauvaises intentions...
Alors, chacun fait avec, Claudy essaye de calmer Arthur, passablement énervé, prêt à se montrer violent et accepte de partir à la recherche de Noémie. En espérant qu'il ne sera pas trop tard... Phil voudrait bien semer son encombrante compagne, mais elle lit parfaitement dans ses pensées... Quant à Chloé, elle s'inquiète pour Leslie plus que pour elle...
Reste à savoir ce qu'on attend d'eux. Et si cette "étoile", ce mot qu'ils ont tous entendu malgré eux, c'était tout bêtement la place de l'Etoile, avec l'Arc de Triomphe en son centre ? Un peu simpliste, mais faute de mieux, les trois duos vont converger vers le lieu, ne sachant rien ce qui leur arrivera une fois là-bas...
Tous seront exacts au rendez-vous, mais, une fois au centre de la place habituellement encombrée et désormais totalement vide, les événements se précipitent et Phil, Claudy, Arthur, Chloé et Leslie se retrouvent dans un endroit qui n'a plus rien à voir avec le sommet des Champs-Elysées... Mais, le plus inquiétant, c'est qu'ils se retrouvent dans un endroit tout aussi désert.
Et, à première vue, les lieux sont encore moins accueillants que ne l'était Paris ravagée par la maladie de l'oubli... Un paysage lunaire, sombre, gris, mort... Au sol, une herbe qui tombe en poussière à peine on la touche... Et quelques autres surprises qui font officiellement de cet endroit un des pires qu'on puisse trouver (y compris en consultant TripAdvisor).
Désormais, il va falloir survivre, ce qui s'annonce coton dans ces territoires infertiles et obscurs, où le jour et la nuit se succèdent à un rythme rapide et où on ne sait pas sur quoi on risque de tomber au détour de... de rien, en fait, juste lorsqu'on perce la nuit... Survivre pour comprendre ce qu'on attend d'eux et pourquoi on les a envoyés là...
Bon, finalement, j'ai tranché et j'ai évoqué ces Terres Grises, qui donnent leur nom à ce deuxième volet. Mais je n'en dirai pas plus, ni sur l'endroit, ni sur ce que nos personnages, ceux qui n'ont pas oublié, font là... Mais, il va bien falloir parler de quelque chose, non ? Oui, évidemment, mais sans trop en dire sur cette histoire qui se poursuit sur un rythme de thriller et brouille les frontières des genres.
On part sur une épidémie qui transforme les gens en zombies et déjà, on dévie des archétypes puisque ces zombies-là ne sont pas agressifs mais dépérissent jusqu'à mourir sur place. Pour autant, on reste dans du fantastique, à moins qu'on soit dans de la SF, puisqu'il y a une cause définie à l'épidémie. Sans oublier (ouf, ça va, je ne suis pas contaminé) ces voix, qui s'incarnent dans des personnages qu'on pourrait croiser dans un récit de fantasy...
Et voilà que le tome 2 nous envoie dans un endroit qui n'a rien de la planète que nous connaissons pour vivre dessus. Ou alors, elle a très, très salement morflé et l'on se trouve dans un futur (ou un passé ?) lointain... Une terre façon Wells, dans "la machine à explorer le temps", mais sans Morlocks (enfin, ne jurons de rien...)...
Ou bien, et l'on s'aventure encore plus loin dans la thèse science-fictive, sur une autre planète... Quoi qu'il en soit, nos protagonistes, s'ils se sortent de ce mauvais pas, devront regarder l'univers et l'existence d'un autre oeil. Car, l'existence de ces Terres Grises dépassent l'entendement et la raison traditionnels...
C'est en tout cas un décor bien lugubre que nous propose Clément Bouhélier pour poursuivre son histoire. Ici, plus de zombies, qu'ils se montrent agressifs ou totalement passifs. Non, on passe complètement à autre chose et l'odyssée entamée par nos protagonistes dans Paris ravagée par une épidémie, prend une toute autre dimension.
Je vais vous donner une impression tout à fait personnelle. Je ne suis pas certain qu'elle sera partagée par quiconque, mais c'est une image qui m'a traversé l'esprit avant se s'y incruster et de ne plus en sortir... Allez, je me lance... "Les Terres grises", c'est "le Magicien d'Oz" revisité par Lovecraft... Je laisse quelques secondes, pour l'ébahissement, la réflexion, l'enthousiasme, les insultes (rayez les mentions inutiles).
Même moi j'ai dû marquer une pause avant de reprendre ce billet... Bon, pour le côté Lovecraft, le peu que j'ai dit de cet endroit me semble éloquent, et ce n'est pas la seule chose qui va dans ce sens, mais le reste, je ne peux l'évoquer ici... On pourrait ajouter un soupçon de Stephen King, dans les références littéraires et quelques clins d'oeil cinématographiques à "Alien" ou "Matrix".
Reste à expliquer comment le Magicien d'Oz s'est retrouvé dans ce billet... Pour moi, ces Terres Grises sont l'équivalent de la route de briques jaunes. Et puis, la manière dont les personnages se sont retrouvés là pourrait rappeler la tornade qui envoie Dorothy quelque part au-delà de l'arc-en-ciel : mais là, c'est une tornade d'un genre spécial qui propulse au-delà de l'Arc-de-Triomphe...
Et puis, il y a ce Maître de l'Orgue, qui a donné le titre de ce billet. Je ne vais rien dire de lui, mais c'est le propre du Magicien d'Oz qu'on ne sache rien de lui au départ, non ? Là encore, mon esprit tordu n'a pu se détacher de cette analogie, tordu, et têtu, en plus... D'autres aspects, comme ce groupe de personnages dont chacun a un rôle bien défini a dû jouer également...
Ah, ces personnages... Je relis le billet écrit en avril dernier sur le premier tome et je ne change rien à leur description. Sur les Terres Grises, chacun va remplir une fonction : Claudy le leader et l'intendant, Chloé la protectrice, Phil le discret et Arthur la forte tête, celui qui peine le plus à maîtriser ses émotions. Leslie est un peu à part, la pauvrette, mais elle n'est pas un poids mort...
Mais, dans cette situation extraordinaire, c'est de solidarité dont ont besoin ces êtres qui ne se connaissaient pas du tout quelques heures, quelques jours plus tôt, et ne savent quasiment rien les uns des autres... Sacré défi à relever, dans des conditions extrêmes, avec des réserves d'eau et de nourriture très limitées... Et absolument aucune idée du but de leur quête...
Ils n'ont toujours rien de héros, en tout cas en apparence. Le seront-ils un jour ? Pour cela, il va falloir échapper aux pièges des Terres Grises, comprendre ce qu'on attend exactement d'eux et, accessoirement, trouver le moyen de retourner d'où ils viennent. Un "d'où-ils-viennent" qui vient de subir l'apocalypse, je vous le rappelle... Un jeu d'enfant, quoi !
Toujours est-il qu'on les a choisis. La providence, le hasard, une quelconque divinité si l'on y croit, l'Homme en blanc ou l'autre avec ses yeux glauques, allez savoir lequel de ces deux ex-machina les a désignés pour remplir l'ingrate mission de survivre à la quasi-totalité de l'humanité à laquelle ils appartiennent, mais c'est un fait.
Alors, ils ne sont pas des héros, mais peut-être des pions, ce qui, à bien y réfléchir, est sans doute encore pire... Phil, Chloé, Claudy et Arthur ont-ils vraiment leur destin en main ? Peuvent-ils espérer en récupérer le contrôle ? Peuvent-ils changer de dimension en sauvant le peu qu'il reste à sauver d'une Terre dévastée ?
Le rythme de ce roman est un de ses points forts : malgré tout, malgré le changement de lieu et la perte de repères inhérente, il ne faiblit pas. Ces Terres Grises n'ont pas seulement l'air d'être inhospitalières, elles le sont réellement et notre club des 5 va devoir traverser bien des moments délicats avant de toucher du doigt le but de leur étrange quête.
D'autres thèmes forts, qu'il est complexe d'évoquer ici, même si on en a frôlé certains, discrètement, au fil de ce billet. C'est dense, ramassé, efficace et assez surprenant, jusqu'à un final qui répond à un bon nombre de questions posés ci-dessus. Et surtout, à la question essentielle : les protagonistes de "Chaos" sont-ils des héros ?