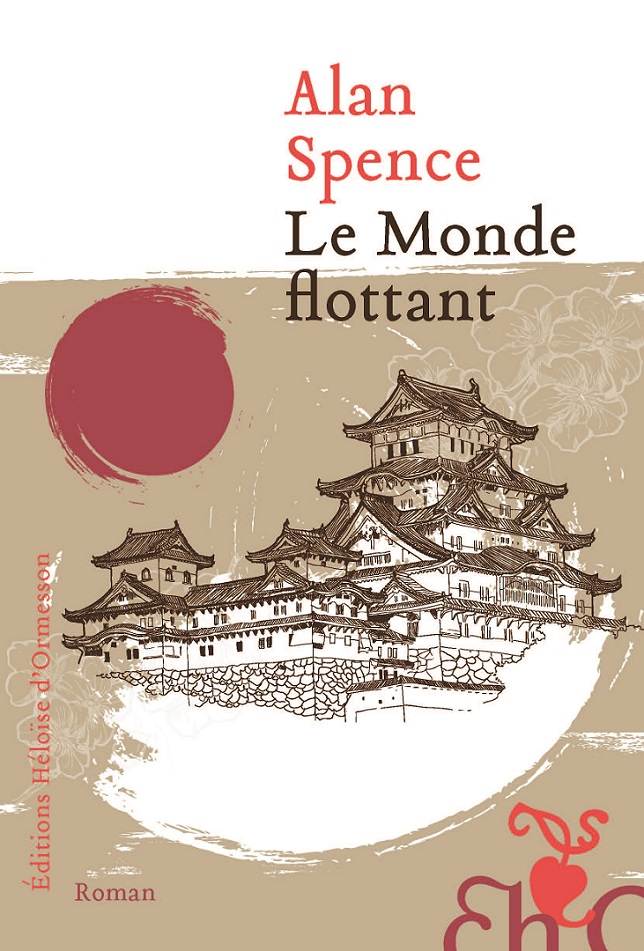Ce roman a dormi de longues années dans ma bibliothèque, depuis sa sortie en 2010. Il m'est arrivé de l'en sortir, mais sans jamais me lancer. Et puis, tout récemment, en lisant le "Capitaine" d'Adrien Bosc, dans lequel cette histoire est évoquée, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais (n'exagérons pas non plus) de se lancer. Mais, là où j'attendais un simple roman historique relatant un fait marquant d'une période douloureuse, je me suis plongé dans un véritable roman picaresque, drôle et dramatique à la fois, porté par un personnage qui se retrouve malgré lui dans une situation impossible et ne cesse de s'enfoncer un peu plus. "L'Odyssée du Winnipeg", de Ramon Chao (en grand format aux éditions Buchet-Chastel ; traduction d'André Gabastou), mêle histoire, en l'occurrence la période de la guerre d'Espagne, une tradition littéraire ancienne dans ce pays et un regard sur une situation politique délicate, avec une gauche divisée et irréconciliable...
Luis Gontan est un jeune Galicien que tout le monde dans son village surnomme Kilowatt, puisqu'il travaille comme électricien, comme son père avant lui. Tout le monde l'apprécie, d'autant que c'est aussi un petit filou qui permet aux villageois de profiter à l'oeil de la lumière et du téléphone. Un véritable altruiste.
Enfin, pas tout à fait, car Luis rêve de devenir riche, quitte pour cela à un tout petit peu escroquer ces mêmes villageois, ou leurs proches. Avec son amie Maruxa, il va monter une petite entreprise qui ne connaît pas la crise, profitant au contraire des moments difficiles que peuvent traverser les autres. Et ça fonctionne plutôt pas mal, merci !
Mais, la tranquillité du village va bientôt être remise en cause. Nous sommes dans les années 1930 et la situation politique de l'Espagne se transforme en poudrière. Les nationalistes gagnent du terrain et finissent par arriver dans le village de Kilowatt, l'obligeant à planquer son magot, puis à se cacher lui-même, jusqu'à ce que la situation devienne intenable.
Luis ne peut plus rester chez lui, le danger est trop grand, il laisse donc derrière lui sa mère gravement malade, son amie Maruxa enceinte et prend le maquis. Son idée première, c'est de survivre tant bien que mal, pas trop loin du nid, jusqu'à ce que les choses se tassent et qu'il puisse retrouver son village, ses proches, sa vie.
Mais rien ne va se passer comme il le prévoyait et, sans s'en douter, il va entamer un incroyable voyage, tel un Ulysse moderne, évitant les nombreux dangers que recèlent un pays qui a sombré dans la guerre civile, côtoyant un camp comme l'autre au gré des mouvements de troupe et de la ligne de front, une marée permanente qui l'éloigne chaque jour un peu plus de son village.
Tout commence par un quiproquo : dans sa fuite, il croise quelques personnes, dont une femme qui le prend pour Foucellas, personnage presque mythique en Galice, héros des Républicains et ennemi public n°1 pour les Nationalistes. Ainsi renommé, du nom de cet anarchiste insaisissable, lancé dans une guérilla sans merci contre les militants franquistes, Luis doit renoncer à rester en Galice...
En parallèle de cette fuite pas vraiment contrôlée, au cours de laquelle Luis, malin et magouilleur, mais certainement pas préparé à la violence, ni à la subir ni à l'infliger, va devoir braver bien des dangers, faire des rencontres inattendues et d'autres qu'il aurait mieux valu éviter, le lecteur suit une toute autre histoire.
Celle-là, c'est l'Histoire, avec un H majuscule, ou pour le dire autrement, la petite histoire dans la grande. Car, pendant que l'Espagne se déchire et que Luis se carapate, au-delà des frontières, on s'interroge, on négocie, on cherche des alliances, on essaye surtout de construire un front de gauche, un front antifasciste au sein d'une Europe où ces idées gagnent sans cesse du terrain.
Les Nationalistes ont déjà reçu le soutien des pays fascistes, l'Italie de Mussolini et surtout l'Allemagne de Hitler. Un soutien qui prend essentiellement la forme d'importantes livraisons d'armes... En face, les Républicains font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, et ils espèrent que, à Moscou, Staline acceptera à son tour de leur fournir de quoi se battre.
Ramon Chao alterne les chapitres, les uns mettant en scène le personnage de Luis dans sa fuite à travers l'Espagne, les autres racontant les difficultés rencontrées par les communistes espagnols et français en particulier pour trouver ce renfort tant souhaité chez l'immense pays-frère, ou de la part des démocraties (France et Angleterre en tête).
Ce second fil narratif est sans doute le récit de l'une des plus grandes trahisons de l'histoire. Car les Républicains espagnols vont être progressivement abandonnés par tous ceux qui auraient dû les aider et auraient pu changer la donne internationale. Il faut alors trouver d'autres solutions pour leur venir en aide, et l'une d'elle sera "le Winnipeg".
Je ne vais évidemment pas tout vous dire ici, puisque cette histoire est racontée dans le roman. Juste quelques précisions : cela concerne d'abord le titre français de ce roman. Lorsqu'on lit "l'Odyssée du Winnipeg", on s'imagine que le livre va se concentrer sur l'armement de ce navire et sur la traversée qu'il a effectuée à l'été 1939.
Or, ce n'est pas tout à fait le cas et le titre original est finalement plus proche de ce que raconte le roman de Ramon Chao : "las travesias de Luis Gontan" (pardon, j'ai zappé les accents toniques), autrement dit "les traversées de Luis Gontan". Car, c'est bien cela, le sujet du livre : une première traversée de l'Espagne depuis la Galice vers la Catalogne, puis vers Bordeaux, d'où part "le Winnipeg".
Cela donne un mélange très intéressant et même carrément passionnant : d'un côté, une trame de fiction autour du personnage de Luis, de l'autre, une trame certes romancée, mais reposant sur des faits et des personnages historiques, leur quête impossible, leur découragement, leur système D, leur courage, aussi, pour venir en aide à ceux qui ont préféré l'exil à la soumission.
La plupart de ces personnages, vous les connaissez, au moins de nom pour les Français que l'on croise. Idem pour les grands responsables politiques d'U.R.S.S. D'autres méritent qu'on s'intéressent d'un peu plus près à leur parcours, même si on a de bons éléments biographiques au fil du récit. J'ai un peu regretté qu'il n'y ait pas quelques annexes en fin d'ouvrage, avec quelques données biographiques.
En fait, c'est la quatrième de couverture qui remplit ce rôle, partiellement en tout cas, en nous présentant Foucellas, déjà évoqué dans ce billet, ou en donnant un élément qui n'est pas explicitement mentionné dans le livre : le fait que celui qui a affrété "le Winnipeg" est le poète Pablo Neruda, non pas sous cette casquette, mais sous sa véritable identité, Don Pablo Reyes (pour reprendre le texte), diplomate de son état.
Il y a donc un peu de travail à fournir pour le lecteur, afin de maîtriser parfaitement les acteurs de cette période historique très troublée, comme par exemple Ignacio Hidalgo de Cisneros, personnage important de ce roman, dont la vie et le parcours mériterait une biographie (romanesque ou non) à lui tout seul.
Et puis, il y a Luis, personnage absolument formidable à travers lequel Ramon Chao rend hommage à une grande tradition littéraire née en Espagne : le roman picaresque. Je ne vais pas vous faire un cours, je ne suis pas un professeur, mais si vous en ignorez la définition, je vous encourage vivement à creuser le sujets, avant même d'attaquer la lecture de "l'Odyssée du Winnipeg".
Avec quelques nuances : Luis est plus âgé que les personnages habituels du roman picaresque, qui sont souvent des enfants ou des ados. Il est aussi installé dans une vie sociale en tant qu'électricien, ce qui n'est pas le cas des "Picaros", qu'on croise dans ces romans, des misérables, au sens hugolien du terme, des parias et voués à une vie toute entière de misère.
Pourtant, Luis est un parfait antihéros, ce qui convient parfaitement au cadre du roman picaresque : rien ne le prédispose à un destin extraordinaire, à se retrouver au coeur de l'Histoire en mouvement. Il a aussi ce côté roublard, filou, qui sied parfaitement aux personnages picaresques, qui se jouent souvent des lois, même si, pour sa part, ce n'est pas sa survie qui en dépend.
En revanche, il va, au fil de son voyage, devenir malgré lui un Picaro plus vrai que nature, perdant jusqu'à son identité, connaissant des périodes de misère noire au cours desquelles il devient un vagabond. Même lorsqu'il se fait enrôler, il n'a rien d'un militaire d'exception, bien au contraire, et les quiproquos s'enchaînent. Il ne semble pas avoir son destin en main, mais s'en sort avec habileté.
Luis est également le narrateur des chapitres dans lesquels on le suit et, tout au long de son odyssée, là pour le coup, on peut reprendre le mot, quasiment au sens homérique du terme, il est amené à rencontrer des personnes appartenant à la plupart des composantes de la société espagnole déchirée par la guerre civile.
Et puis, Ramon Chao lui donne un vrai côté satirique, par sa maladresse, son talent pour tomber de Charybde en Scylla, mais aussi à se sortir de toutes les situations, même les plus improbables. A travers son parcours, on découvre l'Espagne en guerre sous ses côtés les plus absurdes (ce qui n'exclut pas la violence), qui s'enfonce dans l'horreur de la dictature. Et, clin d'oeil au roman picaresque, il lit "La Vie de Lazarillo de Tormes", considéré comme le livre fondateur du genre.
Luis grandit au fil de ses (més)aventures, il mûrit et perd sans doute beaucoup de son insouciance qui en faisait un personnage immature et provocateur. On abandonne un adulte, à la fin du livre, on le laisse devant une page blanche, un nouveau chapitre à écrire, une nouvelle vie à construire. Kilowatt est mort, vive Luis !
Je me suis posé mille questions à son sujet, dont l'une est d'ailleurs toute simple : reverra-t-il un jour son Espagne, sa Galice, ou bien est-ce définitivement le passé ? On a sans doute un début de réponse dans les dernières pages du livre, même si ce n'est pas aussi clairement exprimé que ça. Et puis, on retrouve un dernier élément picaresque : c'est un genre plutôt pessimiste, dans lequel le héros n'infléchit pas les éléments.
Un dernier mot sur Ramon Chao, l'auteur, père du chanteur Manu Chao, ça c'est fait. Cette lecture m'a d'abord permis de découvrir qu'il était décédé il y a quelques mois, le 20 mai de cette années, alors que les Imaginales allaient débuter... J'avais alors raté cette information, sans doute parce que j'avais le nez dans le guidon, et j'en ai été touché en attaquant ce livre.
Ecrivain, et pas seulement auteur de fiction, mais aussi journaliste, c'est d'ailleurs plus dans cette fonction que je le connaissais le mieux, homme de radio à RFI, homme de presse écrite au Monde et au Monde Diplomatique. Un homme de conviction, attaché à son Espagne natale, et particulièrement à la Galice, malgré l'exil, un homme de gauche fortement engagé.
Je mets cet élément en dernier, car c'est aussi ce qui frappe dans "L'Odyssée du Winnipeg" : c'est aussi le récit des divisions de la gauche espagnole en premier lieu, mais aussi au niveau internationale. On multiplie les courants, les obédiences, les étiquettes, on ne s'entend pas, on se déchire entre communistes, socialistes, anarchistes, etc.
Tous réunis sous la banderole républicaine, mais incapable de s'unir durablement, face à un adversaire, au contraire, en ordre de marche, porté par une discipline toute militaire, et avec l'expérience dans ce domaine qui va avec. Ramon Chao, dans les deux trames rassemblées dans "L'Odyssée du Winnipeg", montre ces dissensions permanentes, qui ne sont sans doute pas la seule cause de la défaite, mais n'ont rien arrangé.
Cela ajoute à la dimension dramatique de la guerre, car il y a un compte à rebours qui est lancé dans un premier temps, puis une traversée bien plus mouvementée qu'il n'y paraît, marquée par la méfiance, la défiance, même, les guerres de chapelle et les différends humains. C'est un nouvel échiquier sur lequel Luis doit apprendre à se déplacer, en évitant de se faire renverser.
Car Luis n'est d'aucun camp, la politique, il s'en fout, elle l'a rattrapé sans prévenir, l'a privé de la vie qu'il construisait patiemment, de ses proches, de ses racines, l'a propulsé sur les chemins de l'exil, un des thèmes forts aussi de ce livre, et même lorsqu'elle lui offre une porte de secours, c'est pour se retrouver dans une atmosphère de conflit permanent.
Derrière le côté picaresque de ce livre, on ressent le drame, la douleur jamais guérie, que représentent ces événements, la guerre d'Espagne, le franquisme, l'histoire des années 1930 en Europe, comme une course à la catastrophe et les idéologies qui attisent bien vite les incendies en oubliant au passage l'essentiel : l'intérêt général...
"Il va falloir un jour qu'enfin je me décide à lire les livres que, depuis trente ans, je conseille à mes amis de lire". (Sacha Guitry)
mercredi 29 août 2018
mardi 28 août 2018
"Il faut bien que les temps changent (...) Et un vrai gentleman se doit de changer avec eux".
Ce gentleman n'est pas cambrioleur, et pourtant, c'est bien l'histoire de sa détention qui est le sujet de notre livre du jour. Un roman historique qui est une espèce de paradoxe littéraire : un roman d'aventures en huis clos... Sacré challenge, relevé par un romancier américain, diplômé de Yale et de Stanford, rien que ça, qui possède manifestement un certain sens de l'ironie et a choisi l'Union Soviétique naissante comme cadre de son livre. "Un gentleman à Moscou", d'Amor Towles (en grand format chez Fayard ; traduction de Nathalie Cunnington), fait passer le lecteur par une grande palette d'émotions et joue avec lui, en le prenant sans cesse à contre-pied, jusqu'à une partie finale en forme de point d'orgue. Une jolie découverte, portée par un magnifique protagoniste, un dandy plein de panache, d'orgueil, mais aussi de courage, réservant son lot de surprises, et entouré par une galerie de personnages secondaires très réussie.
Alexandre Ilitch Rostov est l'un des derniers représentants d'une grande famille de la vieille aristocratie russe. En 1913, après avoir signé un poème s'en prenant à la politique du tsar, il avait dû s'exiler, mais il est rentré au pays en 1918, afin de porter secours à sa grand-mère, restée dans la propriété familiale de Nijni-Novgorod, et menacée par l'avancée des Soviets.
Une fois assuré que son aïeule a quitté le pays, direction Paris, Alexandre Ilitch a choisi de rester sur sa terre natale, sans se soucier de sa propre situation. Ayant reçu une éducation des plus raffinées, mais possédant un caractère légèrement indolent et même insolent, il est un personnage qu'on ne peut pas rater lorsqu'on le rencontre.
Mais, en 1922, lorsque le pouvoir soviétique s'est installé, il se retrouve dans le collimateur. En cette journée marquant le début de l'été, il est convoqué au Kremlin pour comparaître devant le Comité exceptionnel du Commissariat du Peuple aux Affaires intérieures pour y être jugé. La raison est simple : en tant qu'aristocrate, il est un ennemi du peuple.
Fidèle à lui-même, Alexandre Ilitch prend ce procès avec humour et flegme, répondant à ses juges sur ses noms, prénoms, titres et qualités. Son métier ? "Un vrai gentleman n'a pas de métier", répond-il. Aristocrate, et maintenant rentier, on ne peut donc pas dire qu'il cherche à se mettre ses juges dans la poche. On redoute même le pire, pour lui.
Mais, il y a ce fameux poème, écrit une dizaine d'années plus tôt. Un engagement anti-tsariste qui lui vaut, si ce n'est de la bienveillance, au moins des circonstances atténuantes. Sa peine s'en ressent : le voilà condamné à la résidence surveillée pour une durée indéterminée. Mais gare à lui : s'il essaye de sortir de son domicile, il sera une cible et il n'y aura pas de sommation.
Son domicile, justement, parlons-en : depuis 1918, lorsqu'il a choisi de rester en Russie quoi qu'il arrive, il loge dans la suite 217 de l'hôtel Métropole, un des palaces les plus luxueux de Moscou. On se dit, et Alexandre Ilitch sans doute aussi, qu'il y a pire peine dans l'existence... Mais, à son retour, surprise, il découvre qu'il devra loger ailleurs, dans un endroit nettement moins confortable...
Une espèce de grenier, sous les combles, exigu et assez sombre, où il n'a que peu de place pour évoluer. A lui de choisir ce qu'il emporte, le reste sera confisqué au nom du Peuple. Qu'à cela ne tienne, Alexandre Ilitch n'est pas (trop) du genre nostalgique, et il a surtout plus d'un tour dans son sac pour affronter cette peine.
Ainsi commence la détention la plus bizarre de l'histoire de l'Union Soviétique. Alexandre Ilitch peut organiser ses journées comme il l'entend, à la seule condition de ne jamais sortir de l'hôtel. Il vaque donc à ses occupations quotidiennes presque comme si de rien n'était et, déjà habitué des lieux, il tisse des liens un peu plus étroits encore avec le personnel.
Il devient un personnage incontournable du Métropole, un meuble parmi les meubles, presque, profitant des joies des excellentes tables des lieux, le très renommé Boyarski et ses menus gastronomiques, et une autre salle, au rez-de-chaussée, ouverte à tous mais servant une cuisine plus traditionnelle et non moins agréable, que le comte surnomme le Piazza.
Le reste du temps, il erre, approfondissant sa connaissance des lieux et du fonctionnement de la maison, ce qui, plus tard, sera loin de lui être inutile. A l'image du chat de l'hôtel, un bleu de Russie à qui il manque un oeil, et surnommé Koutouzov, comme le maréchal du même nom, qui fut le chef des armées d'Alexandre Ie.
Prisonnier d'une (grande) cage dorée, mais prisonnier tout de même. Malgré son côté dandy et son flegme, on sent bien que le principal danger qui guette Alexandre Ilitch, c'est l'ennui. Le train-train du quotidien, que seules les difficultés naissantes dues au régime politique installé à deux pas de là viennent finalement bousculer, est pire que tout...
Jusqu'à ce que le comte rencontre Nina...
Nina a 9 ans, elle est la fille d'un bureaucrate ukrainien venu travailler à Moscou et elle n'a pas vraiment de points communs avec cet homme d'une trentaine d'années, assigné à résidence par le pouvoir pour lequel travaille son père. Pourtant, elle va venir s'installer à sa table et, d'une visite à l'autre, une étonnante relation va s'installer entre ces deux personnages.
Je peux le dire sans rien révéler, cette rencontre va changer la vie d'Alexandre Ilitch. Je peux d'autant plus l'affirmer ici que les bouleversements à l'origine desquels va se trouver Nina ne sont absolument pas ce qu'on peut imaginer de prime abord. Mais là, je m'arrête, si vous voulez en savoir plus, il vous faudra lire "Un gentleman à Moscou" !
Nina n'est pas la seule que croise régulièrement Alexandre Ilitch au cours de sa détention. Au premier chef, les employés de l'hôtel, évidemment, avec en tête de liste Emile, le chef cuisinier du Boyarski, qui ne se sépare jamais de son grand couteau, et Andreï, le maître d'hôtel. Au fil du temps, ces trois-là vont devenir extrêmement complices et former ce qu'ils vont appeler le triumvirat.
Trois larrons en foire, agissant clandestinement au sein de l'hôtel pour améliorer un ordinaire de plus en plus ordinaire au fil des années. Ces trois-là, sous leurs airs de messieurs bien comme il faut, avec une légère irascibilité pour Emile et une certaine austérité pour Andreï, vont s'en donner à coeur joie, au nez et à la barbe des autorités. De vrais gamins faisant les quatre-cents coups.
Parmi les employés du Métropole, on peut aussi citer Marina, la couturière, témoin des frasques d'Alexandre Ilitch, et même complice par son travail de petite main. Eh oui, les bêtises laissent des traces sur les vêtements, ou encore Yaroslav, le barbier, qui sait parfaitement rectifier une coiffure ou tailler une moustache, enfin quand on ne le dérange pas au moment crucial...
Et puis, il y a Michka, l'artiste, l'ami de jeunesse, le dernier qui reste à Alexandre Ilitch. Michka, c'est l'écrivain russe dans toute sa splendeur, fiévreux et révolté, maudit ou en passe de le devenir, sans cesse sur ses gardes, famélique, soutenant le nouveau régime, mais y trouvant déjà de quoi nourrir ses éternelles désillusions.
Il y a Anna Urbanova, une star de cinéma muet, dont la carrière va connaître des hauts et des bas, au gré des changements politiques, mais aussi technologiques. Une beauté et une classe qui, même dans l'écrin luxueux de Métropole, ne passe pas inaperçues. Et une femme qui sait parfaitement l'effet qu'elle peut faire...
Il y a Abram, rencontré par hasard par Alexandre Ilitch sur les toits de l'hôtel Métropole. Que fait-il là, me direz-vous ? Tiens, j'ai bien envie de ne pas en dire plus à son sujet. S'il apporte sa part à l'histoire, il est tout de même un personnage très secondaire, mais certainement pas anodin. La preuve, il y a un indice sur son activité en couverture du roman !
Enfin, il y a ceux qui vont donner plus de fil à retordre à Alexandre Ilitch. A commencer par celui qu'on va connaître presque exclusivement sous le sobriquet sans appel : le Fou. L'exemple type de l'homme à qui la nouvelle organisation politique et sociale offre une carrière tout à fait inattendu. Un serviteur zélé, qui va grimper les échelons plus en raison de ce zèle que de quelconques compétences.
Terminons ce tour d'horizon succinct avec Ossip Ivanovitch Glebnikov, personnage mystérieux qui rend visite régulièrement à Alexandre Ilitch au Métropole. Il attend de lui quelque chose de très précis, et finalement assez paradoxal étant donnée la situation du comte : qu'il lui ouvre des horizons nouveaux qui lui permettront d'appréhender les cultures des pays étrangers, qui n'ont pas encore la chance de connaître les bienfaits du socialisme.
Entre Alexandre et lui, une étrange relation va se nouer. Je n'irai pas jusqu'à dire amicale, ce serait un peu trop, mais disons que la dimension conflictuelle du départ et la méfiance réciproque vont connaître quelques terrains propices à une entente, disons, cordiales... Et le talent d'observateur du comte va permettre quelques scènes finalement cocasses autour de ce personnage qui peut certainement se montrer fort menaçant.
J'essaye de planter le décor sans trop en dire, parce que c'est un livre qui réserve pas mal de surprises. C'est un livre sur le temps qui passe, ce qu'on n'imagine pas forcément en attaquant la lecture des premières pages. Il y a pourtant une certaine logique, mais j'envisageais les choses différemment, et j'avais tort.
Oui, le temps est une donnée centrale d' "Un gentleman à Moscou", une variable très importante, même. Parce que, malgré tout, c'est l'histoire d'une détention. Une réclusion certainement bien moins désagréable que beaucoup d'autres, à Moscou en 1922 comme ailleurs, mais une réclusion tout de même, avec les maux que cela peut engendrer.
J'ai évoquer l'ennui, je ne reviens pas dessus, avec une pensée pour ce pauvre Montaigne, maltraité dans ce roman et clairement bouc émissaire de cet ennui. Mais, ce n'est pas le seul domaine où le temps intervient : s'il reste une forme de liberté à Alexandre Ilitch, c'est la gestion de son temps. Or, en bon gentleman, en bon dandy, il aime prendre son temps et déteste qu'on le presse...
Cette liberté, elle est réglée sur un objet important (il y en a plusieurs, parmi ceux que le comte conserve avec lui dans son grenier), une pendule bien particulière. Elle rythme la vie du gentleman et c'est aussi elle qui concrétise les moments d'ennui ou d'excitation, lorsque le temps se met soudain, à passer plus lentement... Enfin, c'est ainsi qu'on le ressent...
Cette question du temps va encore plus loin : elle rejoint celle du changement, de la modernité. Et là, on retrouve la question de l'enfermement. Alexandre Ilitch est coupé du monde extérieur, de plus en plus quand la seule presse disponible est celle du pouvoir. Il ne voit pas comment le monde change, très concrètement.
Pour le comte, la vie s'est arrêtée en 1922. Au fil des chapitres, il ne bouge pas, il ne change pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'évolue pas, mais il devient peu à peu un homme du passé. Par son simple statut : un aristocrate dans un pays qui a abattu l'aristocratie, l'a effacée ; un dandy dans un monde devenu très matérialiste ; un homme du XIXe dans un monde entré de plain-pied dans le XXe.
En a-t-il conscience ? Sans doute, même si je crois qu'il prend bien soin de ne surtout pas y songer. Mais, face à lui, il y a des éléments très forts qui se chargent de le lui rappeler. L'âge, en premier lieu. Joue-t-il de ce personnage qu'il incarne, par moments jusqu'à risquer de se caricaturer lui-même ? De mon point de vue, c'est une question essentielle... Mais je n'y répondrai pas ici !
Un personnage dit à un moment à Alexandre Ilitch qu'il est "l'homme le plus verni de toute la Russie", alors que le stalinisme s'installe avec les conséquences que l'on connaît. La formule est belle et terrible à la fois. Elle synthétise parfaitement le paradoxe de la situation du comte Rostov : enfermé dans un hôtel de luxe. Comme si la réclusion le mettait, lui, le réprouvé, le condamné, à l'abri...
Il flotte sur ce roman quelque chose d'un peu picaresque. Au fil des chapitres, la vie d'Alexandre Ilitch évolue, son statut au Métropole change, sans pour autant qu'il perde son prestige et sa prestance. Cette lecture débute sur un air de comédie, certes pince-sans-rire, non sans noirceur, avec un côté Lubitsch ou Wilder : rire du drame pour ne pas en pleurer.
Mais ne vous y trompez pas, là aussi les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît et on comprend qu'il peut se passer des choses inattendues. La dernière partie du livre va entièrement dans ce sens, avec un changement imperceptible, d'abord, car dans un premier temps, il va dans le sens de la comédie dramatique.
Et puis, ce changement prend un cap parfaitement inattendu, ou est-ce simplement parce que je me suis laissé endormir ? Vous comprendrez, et sachez que ça me crève le coeur, que je ne développe pas ce sujet. Que je ne dise pas clairement quelle direction prend "Un gentleman à Moscou" dans sa partie finale.
Quand j'ai commencé à envisager la finalité, j'ai continué à sourire. Parce que j'ai trouvé qu'on jouait sur le côté malin et fantasque du personnage du comte. Mais aussi parce que m'est venu en tête un film très connu, au contexte très différent, c'est vrai, mais peut-être pas autant qu'on l'imagine. D'autres lecteurs, eux, songeront peut-être à une série télévisée...
Bref, n'en disons pas plus. J'ai souri, oui, Alexandre Ilitch sera facétieux et joueur jusqu'au bout. Et puis, soudainement, tout s'est mis en place et le lecteur qui vous parle est resté pantois. Je n'avais pas une seconde imaginé un tel final, qui vient faire vibrer d'autres cordes. Et déclenche de nouvelles émotions. Allez, je le dis : j'ai été bouleversé par cette fin.
Elle est très belle, pleine de ce panache que le personnage manifeste finalement tout au long de cette aventure pas comme les autres, circonscrite aux murs d'un palace. Elle incarne une sorte d'âme slave (mais je suis peut-être un peu dans le cliché, là), avec courage et folie, mais aussi une espèce de désespoir qui semble inscrit dans les gènes.
Amor Towles a trouvé une manière très originale d'évoquer la période stalinienne, à travers un prisme apparemment déformant, et pourtant finalement assez fidèle malgré tout. Alexandre Ilitch Rostov est un personnage formidable, certainement agaçant, et pourtant terriblement attachant. Un faux je-m'en-foutiste, une extravagance de façade, très travaillée, qui cachent un sentimentalisme puissant.
Alexandre Ilitch Rostov est l'un des derniers représentants d'une grande famille de la vieille aristocratie russe. En 1913, après avoir signé un poème s'en prenant à la politique du tsar, il avait dû s'exiler, mais il est rentré au pays en 1918, afin de porter secours à sa grand-mère, restée dans la propriété familiale de Nijni-Novgorod, et menacée par l'avancée des Soviets.
Une fois assuré que son aïeule a quitté le pays, direction Paris, Alexandre Ilitch a choisi de rester sur sa terre natale, sans se soucier de sa propre situation. Ayant reçu une éducation des plus raffinées, mais possédant un caractère légèrement indolent et même insolent, il est un personnage qu'on ne peut pas rater lorsqu'on le rencontre.
Mais, en 1922, lorsque le pouvoir soviétique s'est installé, il se retrouve dans le collimateur. En cette journée marquant le début de l'été, il est convoqué au Kremlin pour comparaître devant le Comité exceptionnel du Commissariat du Peuple aux Affaires intérieures pour y être jugé. La raison est simple : en tant qu'aristocrate, il est un ennemi du peuple.
Fidèle à lui-même, Alexandre Ilitch prend ce procès avec humour et flegme, répondant à ses juges sur ses noms, prénoms, titres et qualités. Son métier ? "Un vrai gentleman n'a pas de métier", répond-il. Aristocrate, et maintenant rentier, on ne peut donc pas dire qu'il cherche à se mettre ses juges dans la poche. On redoute même le pire, pour lui.
Mais, il y a ce fameux poème, écrit une dizaine d'années plus tôt. Un engagement anti-tsariste qui lui vaut, si ce n'est de la bienveillance, au moins des circonstances atténuantes. Sa peine s'en ressent : le voilà condamné à la résidence surveillée pour une durée indéterminée. Mais gare à lui : s'il essaye de sortir de son domicile, il sera une cible et il n'y aura pas de sommation.
Son domicile, justement, parlons-en : depuis 1918, lorsqu'il a choisi de rester en Russie quoi qu'il arrive, il loge dans la suite 217 de l'hôtel Métropole, un des palaces les plus luxueux de Moscou. On se dit, et Alexandre Ilitch sans doute aussi, qu'il y a pire peine dans l'existence... Mais, à son retour, surprise, il découvre qu'il devra loger ailleurs, dans un endroit nettement moins confortable...
Une espèce de grenier, sous les combles, exigu et assez sombre, où il n'a que peu de place pour évoluer. A lui de choisir ce qu'il emporte, le reste sera confisqué au nom du Peuple. Qu'à cela ne tienne, Alexandre Ilitch n'est pas (trop) du genre nostalgique, et il a surtout plus d'un tour dans son sac pour affronter cette peine.
Ainsi commence la détention la plus bizarre de l'histoire de l'Union Soviétique. Alexandre Ilitch peut organiser ses journées comme il l'entend, à la seule condition de ne jamais sortir de l'hôtel. Il vaque donc à ses occupations quotidiennes presque comme si de rien n'était et, déjà habitué des lieux, il tisse des liens un peu plus étroits encore avec le personnel.
Il devient un personnage incontournable du Métropole, un meuble parmi les meubles, presque, profitant des joies des excellentes tables des lieux, le très renommé Boyarski et ses menus gastronomiques, et une autre salle, au rez-de-chaussée, ouverte à tous mais servant une cuisine plus traditionnelle et non moins agréable, que le comte surnomme le Piazza.
Le reste du temps, il erre, approfondissant sa connaissance des lieux et du fonctionnement de la maison, ce qui, plus tard, sera loin de lui être inutile. A l'image du chat de l'hôtel, un bleu de Russie à qui il manque un oeil, et surnommé Koutouzov, comme le maréchal du même nom, qui fut le chef des armées d'Alexandre Ie.
Prisonnier d'une (grande) cage dorée, mais prisonnier tout de même. Malgré son côté dandy et son flegme, on sent bien que le principal danger qui guette Alexandre Ilitch, c'est l'ennui. Le train-train du quotidien, que seules les difficultés naissantes dues au régime politique installé à deux pas de là viennent finalement bousculer, est pire que tout...
Jusqu'à ce que le comte rencontre Nina...
Nina a 9 ans, elle est la fille d'un bureaucrate ukrainien venu travailler à Moscou et elle n'a pas vraiment de points communs avec cet homme d'une trentaine d'années, assigné à résidence par le pouvoir pour lequel travaille son père. Pourtant, elle va venir s'installer à sa table et, d'une visite à l'autre, une étonnante relation va s'installer entre ces deux personnages.
Je peux le dire sans rien révéler, cette rencontre va changer la vie d'Alexandre Ilitch. Je peux d'autant plus l'affirmer ici que les bouleversements à l'origine desquels va se trouver Nina ne sont absolument pas ce qu'on peut imaginer de prime abord. Mais là, je m'arrête, si vous voulez en savoir plus, il vous faudra lire "Un gentleman à Moscou" !
Nina n'est pas la seule que croise régulièrement Alexandre Ilitch au cours de sa détention. Au premier chef, les employés de l'hôtel, évidemment, avec en tête de liste Emile, le chef cuisinier du Boyarski, qui ne se sépare jamais de son grand couteau, et Andreï, le maître d'hôtel. Au fil du temps, ces trois-là vont devenir extrêmement complices et former ce qu'ils vont appeler le triumvirat.
Trois larrons en foire, agissant clandestinement au sein de l'hôtel pour améliorer un ordinaire de plus en plus ordinaire au fil des années. Ces trois-là, sous leurs airs de messieurs bien comme il faut, avec une légère irascibilité pour Emile et une certaine austérité pour Andreï, vont s'en donner à coeur joie, au nez et à la barbe des autorités. De vrais gamins faisant les quatre-cents coups.
Parmi les employés du Métropole, on peut aussi citer Marina, la couturière, témoin des frasques d'Alexandre Ilitch, et même complice par son travail de petite main. Eh oui, les bêtises laissent des traces sur les vêtements, ou encore Yaroslav, le barbier, qui sait parfaitement rectifier une coiffure ou tailler une moustache, enfin quand on ne le dérange pas au moment crucial...
Et puis, il y a Michka, l'artiste, l'ami de jeunesse, le dernier qui reste à Alexandre Ilitch. Michka, c'est l'écrivain russe dans toute sa splendeur, fiévreux et révolté, maudit ou en passe de le devenir, sans cesse sur ses gardes, famélique, soutenant le nouveau régime, mais y trouvant déjà de quoi nourrir ses éternelles désillusions.
Il y a Anna Urbanova, une star de cinéma muet, dont la carrière va connaître des hauts et des bas, au gré des changements politiques, mais aussi technologiques. Une beauté et une classe qui, même dans l'écrin luxueux de Métropole, ne passe pas inaperçues. Et une femme qui sait parfaitement l'effet qu'elle peut faire...
Il y a Abram, rencontré par hasard par Alexandre Ilitch sur les toits de l'hôtel Métropole. Que fait-il là, me direz-vous ? Tiens, j'ai bien envie de ne pas en dire plus à son sujet. S'il apporte sa part à l'histoire, il est tout de même un personnage très secondaire, mais certainement pas anodin. La preuve, il y a un indice sur son activité en couverture du roman !
Enfin, il y a ceux qui vont donner plus de fil à retordre à Alexandre Ilitch. A commencer par celui qu'on va connaître presque exclusivement sous le sobriquet sans appel : le Fou. L'exemple type de l'homme à qui la nouvelle organisation politique et sociale offre une carrière tout à fait inattendu. Un serviteur zélé, qui va grimper les échelons plus en raison de ce zèle que de quelconques compétences.
Terminons ce tour d'horizon succinct avec Ossip Ivanovitch Glebnikov, personnage mystérieux qui rend visite régulièrement à Alexandre Ilitch au Métropole. Il attend de lui quelque chose de très précis, et finalement assez paradoxal étant donnée la situation du comte : qu'il lui ouvre des horizons nouveaux qui lui permettront d'appréhender les cultures des pays étrangers, qui n'ont pas encore la chance de connaître les bienfaits du socialisme.
Entre Alexandre et lui, une étrange relation va se nouer. Je n'irai pas jusqu'à dire amicale, ce serait un peu trop, mais disons que la dimension conflictuelle du départ et la méfiance réciproque vont connaître quelques terrains propices à une entente, disons, cordiales... Et le talent d'observateur du comte va permettre quelques scènes finalement cocasses autour de ce personnage qui peut certainement se montrer fort menaçant.
J'essaye de planter le décor sans trop en dire, parce que c'est un livre qui réserve pas mal de surprises. C'est un livre sur le temps qui passe, ce qu'on n'imagine pas forcément en attaquant la lecture des premières pages. Il y a pourtant une certaine logique, mais j'envisageais les choses différemment, et j'avais tort.
Oui, le temps est une donnée centrale d' "Un gentleman à Moscou", une variable très importante, même. Parce que, malgré tout, c'est l'histoire d'une détention. Une réclusion certainement bien moins désagréable que beaucoup d'autres, à Moscou en 1922 comme ailleurs, mais une réclusion tout de même, avec les maux que cela peut engendrer.
J'ai évoquer l'ennui, je ne reviens pas dessus, avec une pensée pour ce pauvre Montaigne, maltraité dans ce roman et clairement bouc émissaire de cet ennui. Mais, ce n'est pas le seul domaine où le temps intervient : s'il reste une forme de liberté à Alexandre Ilitch, c'est la gestion de son temps. Or, en bon gentleman, en bon dandy, il aime prendre son temps et déteste qu'on le presse...
Cette liberté, elle est réglée sur un objet important (il y en a plusieurs, parmi ceux que le comte conserve avec lui dans son grenier), une pendule bien particulière. Elle rythme la vie du gentleman et c'est aussi elle qui concrétise les moments d'ennui ou d'excitation, lorsque le temps se met soudain, à passer plus lentement... Enfin, c'est ainsi qu'on le ressent...
Cette question du temps va encore plus loin : elle rejoint celle du changement, de la modernité. Et là, on retrouve la question de l'enfermement. Alexandre Ilitch est coupé du monde extérieur, de plus en plus quand la seule presse disponible est celle du pouvoir. Il ne voit pas comment le monde change, très concrètement.
Pour le comte, la vie s'est arrêtée en 1922. Au fil des chapitres, il ne bouge pas, il ne change pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'évolue pas, mais il devient peu à peu un homme du passé. Par son simple statut : un aristocrate dans un pays qui a abattu l'aristocratie, l'a effacée ; un dandy dans un monde devenu très matérialiste ; un homme du XIXe dans un monde entré de plain-pied dans le XXe.
En a-t-il conscience ? Sans doute, même si je crois qu'il prend bien soin de ne surtout pas y songer. Mais, face à lui, il y a des éléments très forts qui se chargent de le lui rappeler. L'âge, en premier lieu. Joue-t-il de ce personnage qu'il incarne, par moments jusqu'à risquer de se caricaturer lui-même ? De mon point de vue, c'est une question essentielle... Mais je n'y répondrai pas ici !
Un personnage dit à un moment à Alexandre Ilitch qu'il est "l'homme le plus verni de toute la Russie", alors que le stalinisme s'installe avec les conséquences que l'on connaît. La formule est belle et terrible à la fois. Elle synthétise parfaitement le paradoxe de la situation du comte Rostov : enfermé dans un hôtel de luxe. Comme si la réclusion le mettait, lui, le réprouvé, le condamné, à l'abri...
Il flotte sur ce roman quelque chose d'un peu picaresque. Au fil des chapitres, la vie d'Alexandre Ilitch évolue, son statut au Métropole change, sans pour autant qu'il perde son prestige et sa prestance. Cette lecture débute sur un air de comédie, certes pince-sans-rire, non sans noirceur, avec un côté Lubitsch ou Wilder : rire du drame pour ne pas en pleurer.
Mais ne vous y trompez pas, là aussi les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît et on comprend qu'il peut se passer des choses inattendues. La dernière partie du livre va entièrement dans ce sens, avec un changement imperceptible, d'abord, car dans un premier temps, il va dans le sens de la comédie dramatique.
Et puis, ce changement prend un cap parfaitement inattendu, ou est-ce simplement parce que je me suis laissé endormir ? Vous comprendrez, et sachez que ça me crève le coeur, que je ne développe pas ce sujet. Que je ne dise pas clairement quelle direction prend "Un gentleman à Moscou" dans sa partie finale.
Quand j'ai commencé à envisager la finalité, j'ai continué à sourire. Parce que j'ai trouvé qu'on jouait sur le côté malin et fantasque du personnage du comte. Mais aussi parce que m'est venu en tête un film très connu, au contexte très différent, c'est vrai, mais peut-être pas autant qu'on l'imagine. D'autres lecteurs, eux, songeront peut-être à une série télévisée...
Bref, n'en disons pas plus. J'ai souri, oui, Alexandre Ilitch sera facétieux et joueur jusqu'au bout. Et puis, soudainement, tout s'est mis en place et le lecteur qui vous parle est resté pantois. Je n'avais pas une seconde imaginé un tel final, qui vient faire vibrer d'autres cordes. Et déclenche de nouvelles émotions. Allez, je le dis : j'ai été bouleversé par cette fin.
Elle est très belle, pleine de ce panache que le personnage manifeste finalement tout au long de cette aventure pas comme les autres, circonscrite aux murs d'un palace. Elle incarne une sorte d'âme slave (mais je suis peut-être un peu dans le cliché, là), avec courage et folie, mais aussi une espèce de désespoir qui semble inscrit dans les gènes.
Amor Towles a trouvé une manière très originale d'évoquer la période stalinienne, à travers un prisme apparemment déformant, et pourtant finalement assez fidèle malgré tout. Alexandre Ilitch Rostov est un personnage formidable, certainement agaçant, et pourtant terriblement attachant. Un faux je-m'en-foutiste, une extravagance de façade, très travaillée, qui cachent un sentimentalisme puissant.
"Mais quand on donne l'impression d'être fou tout le temps, (...) alors là on fait peur, même à ses amis de guerre. Alors là on commence à ne plus être le frère courage, le trompe-la-mort, mais bien l'ami véritable de la mort, son complice, son plus que frère".
Voilà un titre de billet inquiétant, mais qui, je trouve, donne une bonne idée d'un des éléments importants de notre roman du jour, la question de la folie. Mais c'est un peu léger, tout de même, et il va nous falloir parler de ce roman de la rentrée littéraire avec quelques précautions, car il y a beaucoup à y découvrir, malgré sa brièveté (175 pages). "Frère d'âme", de David Diop (en grand format aux éditions du Seuil) est une histoire pleine de violence et de mort, et pas des plus belles, mais c'est aussi un livre plein d'un certain humour et d'une vraie poésie, dans sa seconde partie. Une histoire d'amitié, mais aussi une histoire de guerre. Un conflit dans lequel se retrouve plongés bien malgré eux les deux personnages centraux, deux "plus que frères", inséparables depuis toujours. Inséparables pour toujours...
A tout juste 20 ans, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux amis d'enfance inséparable, ont dû quitter leur village natal et même leur pays, le Sénégal, pour rejoindre la France. Mais, cela ne se passe pas au meilleur moment : en Europe, la Première Guerre mondiale fait rage, et les deux jeunes hommes ont été mobilisés au sein d'un régiment de tirailleurs sénégalais.
Les voilà dans les tranchées, soumis à cette vie très dure, rythmée par les assauts, les bombardements, la peur, l'inconfort. Et la mort, aussi. Car, à chaque sortie, à chaque charge, on tombe autour d'eux et on ne se relève pas. Des corps abandonnés dans le no man's land, profondément labouré par les obus qui s'abattent presque sans cesse.
Alfa Ndiaye et Mademba Diop font de leur mieux, inséparables jusque dans ces assauts suicidaires vers les tranchées adverses. Jusqu'à ce jour où Mademba est tué. Une mort sale, longue à venir, douloureuse, injuste... Alfa va demeurer à ses côtés jusqu'à la fin, allongé dans la boue et le sang, veillant son ami, son plus que frère jusqu'à ce qu'il rende l'âme.
Pour Alfa, plus rien ne compte, ni les ordres, ni le danger, il retourne dans sa tranchée bien après les survivants de son régiment, chargé du corps sans vie de Mademba, qu'il n'a pu se résoudre à laisser là où il est tombé. Alfa ne se résigne pas à cette inimaginable séparation, à cette rupture qui fait vaciller tout son être, et plus encore sa raison.
Alfa ne pense plus qu'à une chose : venger Mademba. Au milieu du carnage, ce grand jeune homme, costaud, impressionnant et poussé par une détermination extraordinaire, va entreprendre de régler ses comptes avec l'ennemi, d'une manière terrible, hors de tout cadre hiérarchique. Le voilà électron libre, sortant avec les autres des tranchées, mais menant sa guerre.
Aux yeux de ses camarades, mais aussi de ses officiers, il devient rapidement un héros, au courage extraordinaire. On le décore, on le félicité, on le congratule. Mais, au fil des jours, alors qu'il disparaît de plus en plus longtemps et que son rituel vengeur s'affirme, s'affine, l'ambiance change carrément : on le regarde avec peur, on le prend pour un monstre, un sorcier...
Il n'est plus un héros, mais un porte-malheur, quelqu'un qu'on ne veut plus approcher, côtoyer, parce qu'il est devenu le plus que frère de la mort... Une mort qui ne veut pas le prendre, contrairement à tous ceux qui continuent à tomber à chaque assaut. S'il disparaissait, tout le monde en serait soulagé, mais il semble invincible...
Alors, on cherche d'autres solutions, y compris lui ordonner de quitter la première ligne et de repartir à l'arrière, où il ne risquera plus de nuire au moral des troupes... Suffisant pour les autres, mais pour Alfa ? Dégagé de sa mission, mais toujours marqué par la mort de son ami, et ressentant une forte culpabilité, le voilà qui replonge dans le passé, loin des tranchées. Dans sa jeunesse sénégalaise...
Beaucoup de choses dites et à la fois très peu. J'ai évoqué des faits, mais pas leur déroulement détaillé ou leur contexte, et c'est fait exprès. On entre immédiatement au coeur de l'histoire, aucun contexte, il va venir petit à petit, et l'on se retrouve aux côtés des deux amis, alors que Mademba vient de mourir. Au moment où quelque chose se brise irrémédiablement chez Alfa...
Au moment où la culpabilité s'installe. Celle de ne pas avoir su protéger son ami (et l'on comprendra bien plus tard que ce n'est pas anodin), celle aussi de l'avoir laissé agoniser bien trop longuement, de ne pas avoir su se résoudre à abréger ses souffrances. Alors, la fureur prend le dessus, l'envie de se venger, aussi absurde cette idée peut-elle paraître dans ce chaos.
De la même manière qu'on découvre les conditions de la mort de Mademba, Alfa, narrateur du roman, va dévoiler sa manière de se venger. Sans doute n'a-t-il jamais entendu cette expression, mais elle a rarement été aussi juste : oeil pour oeil, dent pour dent. Une réaction qui change complètement la manière dont on reçoit le début de ce livre.
Oui, c'est extrêmement noir et violent. Oui, on est au coeur du massacre, on assiste à ces meurtres au coeur du carnage. Mais, la façon dont Alfa raconte cela instille dans ces horreurs une sorte d'humour teinté de désespoir et de folie qui aboutit à un curieux mélange. Je ne vais pas dire qu'on se marre comme des baleines, mais certains passages sont assez drôles.
Jusque dans l'absurde de la situation que décrit Alfa, héros devenu paria, "soldat-sorcier" attirant le malheur sur ceux qui se tiennent trop près de lui. Soudain, lui qui n'avait pas forcément perçu cela depuis son arrivée, il se retrouve considéré comme un sauvage (le mot est dans le roman, je précise), comme l'incarnation de toutes les idées reçues qu'on peut avoir à cette époque sur les Africains.
Alfa fait peur, à tout le monde. A ses ennemis, même si on n'a pas leur point de vue, si ce n'est celui de ses victimes, mais surtout à ses compagnons de galère, qui rigolait de ses exploits avant d'y voir là des manières qui choquent leur moralité, qui stimulent aussi leur imaginaire : mais que fait exactement Alfa Ndiaye de ses victimes ?
Quand je parle d'humour, soyons bien d'accord qu'il ne s'agit pas de gags, de situations conçues pour être drôles, mais bien de situations si paradoxales qu'elles en deviennent absurdes, de mots qui, d'un seul coup, se retrouvent utilisés dans des sens presque à l'opposé de ce qu'ils disent exactement. Attendez, si vous ne trouvez pas ça très clair, un exemple arrive...
David Diop a déjà joué avec l'idée du sauvage, qui dans le cas présent, n'a plus rien de bon, pour reprendre cette si atroce formule ; il a introduit la notion de "soldat-sorcier" ; mais il manque l'oxymore qui claque et révèle l'embarras dans lequel se trouve les officiers commandant Alfa. Et l'un d'entre eux va le sortir : "la guerre civilisée" !
Oui, monsieur Alfa Ndiaye, ici, on fait la guerre civilisée, sous-entendu entre gentlemen respectant des règles bien définies, et il n'y a pas la place pour ces excentricités, pour ces actes sordides, pour ces pratiques d'un monde qui ne peut pas être civilisé, lui... Que sait-il de l'Afrique, celui qui parle ainsi ? Et se rend-il compte du ridicule de son expression, "la guerre civilisée" ?
Alfa Ndiaye, dans sa folie, n'est pas non plus exempt de cette absurdité : il considère qu'il a été inhumain en laissant Mademba Diop, son ami, son plus que frère, souffrir inutilement, alors qu'il pouvait abréger ses souffrances ; et, lorsqu'il tue ses ennemis aux yeux bleus, à sa façon bien particulière, il ne fait pas la même erreur. Et retrouve ainsi son humanité...
Tout est sens dessus dessous, dans cette histoire, les esprits des hommes, mais aussi la terre fracassée par les incessants bombardements, une terre mère qui accouche de soldats qu'on pousse à se jeter sur son ennemi, sous la mitraille, cible parfaite, chair à canon à l'espérance de vie sérieusement érodée... Alors, qui donc est fou ?
Car, il faut être fou pour accepter ces conditions de vie, ces combats désespérés, la proximité de la mort, la peur, la saleté et tout ce qui fait le quotidien des poilus. Plus encore, pour Alfa Ndiaye, il faut être fou pour sortir des tranchées le fusil à la main, la baïonnette au bout du fusil, un cri guerrier aux lèvres. Une folie passagère, qui cesse quand on regagne son trou, ces tranchées comme un ventre maternel...
Et c'est là qu'il s'est démarqué des autres : sa folie semble permanente. Je reprends le titre de ce billet, évidemment, avec ces mots très forts, qui marquent lorsqu'on les lit, comme beaucoup d'autres, tout au long de ces pages. Avec une nuance, et de taille : Alfa dit bien qu'il "donne l'impression d'être fou tout le temps".
Donner l'impression... Pas "être fou". Pour lui, il fait semblant, comme une provocation, un bras d'honneur lancé au destin et à la folie, bien réelle, il suffit de regarder tout autour, des hommes. Certes, mais, n'est-ce pas le propre du fou d'affirmer qu'il ne l'est pas ? Oh, il ne s'agit pas de philosopher ou de diagnostiquer, non, juste de poser la question qui s'impose : Alfa est-il vraiment fou ?
C'est, pour moi, l'enjeu majeur de "Frère d'âme", auquel on ne peut apporter de réponse catégorique. Peut-être cette assertion vous surprend-elle, et pourtant, c'est vraiment mon impression (après ce que je viens d'écrire, je devrais plutôt utiliser le mot sentiment ?). D'un côté, Alfa affirme que tout cela n'est qu'une comédie ; de l'autre, le récit d'Alfa qui glace...
Je ne trancherai pas (c'est le cas de le dire) cette question dans ce billet. Parce que ce sera à chaque lecteur de se faire une opinion. Mais, il faut aussi dire que David Diop sème le doute, et de façon très habile, en glissant dans son livre un élément qui explique parfaitement le titre de ce livre, et qui offre au lecteur une ambiguïté très intéressante.
Cet élément, je vais le qualifier de fantastique (si l'on reste sur un plan littéraire) ou de surnaturel. Mais, je ne suis qu'un lecteur européen, matérialiste, sceptique de nature, qui classe vite ce qu'il ne comprend pas sous l'étiquette "Irrationnel". Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, à commencer par Alfa. Et par Mademba.
La construction du roman est intéressante : son ouverture in media res, comme on dit, puis un retour en arrière qui n'est pas juste un flashback, mais une vraie immersion. On aurait pu imaginer inverser ces deux parties, commencer, entre guillemets, par le début, mais David Diop a choisi de renverser tout cela, et l'on va comprendre pourquoi.
Je ne parle que très peu de cette partie se déroulant au Sénégal, peut-être même ne faudrait-il pas en parler du tout, car on est surpris de cette soudaine irruption des souvenirs. Alors, restons discrets, et contentons-nous de simplement dire que cette partie vient éclairer la relation entre les deux amis, les deux plus que frères.
Le dernier mot de ce billet concernera l'écriture de David Diop. On retrouve une caractéristique des littératures africaines : cette oralité que l'écrit transmet malgré tout. Alfa Ndiaye parle, nous parle, se confesse, déverse même son récit comme s'il nous livrait son histoire d'une traite, presque sans prendre le temps de respirer.
Et parce qu'il doit se dire que tout cela est trop incroyable pour être cru, il lui faut affirmer qu'il dit la vérité, qu'il relate bien ce qu'il a vécu. Alors, il jalonne son récit d'une expression qui revient sans cesse (je n'ai pas compté, mais ça doit être assez important) : "Par la vérité de Dieu". Un tic de langage affirmatif, péremptoire, et qui participe à sa façon à l'ambiguïté de ce récit.
La langue de David Diop est riche, vive, colorée, inventive, avec beaucoup de trouvailles, comme ce "plus que frère", qu'on retrouve là aussi un bon nombre de fois. Cette écriture, par sa vivacité et l'espèce de joie, de frénésie qui s'en dégage, tranche (c'est le cas de le dire) avec le contexte, en particulier celui de la première partie du roman, celle qui se situe sur le front.
Cette langue fait de "Frère d'âme" un bonheur de lecture, malgré la noirceur du contexte et la violence du propos (ou l'inverse), elle nous emmène dans la folie (ah oui, c'est mon avis, et le vôtre ?) d'Alfa Ndiaye, jeune homme qui n'avait rien demandé et s'est retrouvé au coeur de l'horreur, alors que tout cela ne le concernait finalement pas.
Ecrasé par cette machine à tuer qu'est cette guerre moderne, la première et malheureusement pas la dernière, la pire à ce jour, avant que l'homme n'imagine pire encore, Alfa Ndiaye refuse pourtant la résignation et l'abattement. Sa folie, sa colère, sa culpabilité sont autant d'éléments qui forment une sorte d'armure autour de lui.
Une armure qui semble protéger son corps, puisqu'il traverse le no man's land comme si c'était son territoire et que rien ne pouvait l'atteindre, mais surtout une armure qui vient protéger son âme, durement éprouvée par la mort de son plus que frère, la protéger de cette guerre et de ses traumatismes, oubliés lorsqu'il replonge dans sa vie d'avant. Dans leur vie d'avant.
A tout juste 20 ans, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux amis d'enfance inséparable, ont dû quitter leur village natal et même leur pays, le Sénégal, pour rejoindre la France. Mais, cela ne se passe pas au meilleur moment : en Europe, la Première Guerre mondiale fait rage, et les deux jeunes hommes ont été mobilisés au sein d'un régiment de tirailleurs sénégalais.
Les voilà dans les tranchées, soumis à cette vie très dure, rythmée par les assauts, les bombardements, la peur, l'inconfort. Et la mort, aussi. Car, à chaque sortie, à chaque charge, on tombe autour d'eux et on ne se relève pas. Des corps abandonnés dans le no man's land, profondément labouré par les obus qui s'abattent presque sans cesse.
Alfa Ndiaye et Mademba Diop font de leur mieux, inséparables jusque dans ces assauts suicidaires vers les tranchées adverses. Jusqu'à ce jour où Mademba est tué. Une mort sale, longue à venir, douloureuse, injuste... Alfa va demeurer à ses côtés jusqu'à la fin, allongé dans la boue et le sang, veillant son ami, son plus que frère jusqu'à ce qu'il rende l'âme.
Pour Alfa, plus rien ne compte, ni les ordres, ni le danger, il retourne dans sa tranchée bien après les survivants de son régiment, chargé du corps sans vie de Mademba, qu'il n'a pu se résoudre à laisser là où il est tombé. Alfa ne se résigne pas à cette inimaginable séparation, à cette rupture qui fait vaciller tout son être, et plus encore sa raison.
Alfa ne pense plus qu'à une chose : venger Mademba. Au milieu du carnage, ce grand jeune homme, costaud, impressionnant et poussé par une détermination extraordinaire, va entreprendre de régler ses comptes avec l'ennemi, d'une manière terrible, hors de tout cadre hiérarchique. Le voilà électron libre, sortant avec les autres des tranchées, mais menant sa guerre.
Aux yeux de ses camarades, mais aussi de ses officiers, il devient rapidement un héros, au courage extraordinaire. On le décore, on le félicité, on le congratule. Mais, au fil des jours, alors qu'il disparaît de plus en plus longtemps et que son rituel vengeur s'affirme, s'affine, l'ambiance change carrément : on le regarde avec peur, on le prend pour un monstre, un sorcier...
Il n'est plus un héros, mais un porte-malheur, quelqu'un qu'on ne veut plus approcher, côtoyer, parce qu'il est devenu le plus que frère de la mort... Une mort qui ne veut pas le prendre, contrairement à tous ceux qui continuent à tomber à chaque assaut. S'il disparaissait, tout le monde en serait soulagé, mais il semble invincible...
Alors, on cherche d'autres solutions, y compris lui ordonner de quitter la première ligne et de repartir à l'arrière, où il ne risquera plus de nuire au moral des troupes... Suffisant pour les autres, mais pour Alfa ? Dégagé de sa mission, mais toujours marqué par la mort de son ami, et ressentant une forte culpabilité, le voilà qui replonge dans le passé, loin des tranchées. Dans sa jeunesse sénégalaise...
Beaucoup de choses dites et à la fois très peu. J'ai évoqué des faits, mais pas leur déroulement détaillé ou leur contexte, et c'est fait exprès. On entre immédiatement au coeur de l'histoire, aucun contexte, il va venir petit à petit, et l'on se retrouve aux côtés des deux amis, alors que Mademba vient de mourir. Au moment où quelque chose se brise irrémédiablement chez Alfa...
Au moment où la culpabilité s'installe. Celle de ne pas avoir su protéger son ami (et l'on comprendra bien plus tard que ce n'est pas anodin), celle aussi de l'avoir laissé agoniser bien trop longuement, de ne pas avoir su se résoudre à abréger ses souffrances. Alors, la fureur prend le dessus, l'envie de se venger, aussi absurde cette idée peut-elle paraître dans ce chaos.
De la même manière qu'on découvre les conditions de la mort de Mademba, Alfa, narrateur du roman, va dévoiler sa manière de se venger. Sans doute n'a-t-il jamais entendu cette expression, mais elle a rarement été aussi juste : oeil pour oeil, dent pour dent. Une réaction qui change complètement la manière dont on reçoit le début de ce livre.
Oui, c'est extrêmement noir et violent. Oui, on est au coeur du massacre, on assiste à ces meurtres au coeur du carnage. Mais, la façon dont Alfa raconte cela instille dans ces horreurs une sorte d'humour teinté de désespoir et de folie qui aboutit à un curieux mélange. Je ne vais pas dire qu'on se marre comme des baleines, mais certains passages sont assez drôles.
Jusque dans l'absurde de la situation que décrit Alfa, héros devenu paria, "soldat-sorcier" attirant le malheur sur ceux qui se tiennent trop près de lui. Soudain, lui qui n'avait pas forcément perçu cela depuis son arrivée, il se retrouve considéré comme un sauvage (le mot est dans le roman, je précise), comme l'incarnation de toutes les idées reçues qu'on peut avoir à cette époque sur les Africains.
Alfa fait peur, à tout le monde. A ses ennemis, même si on n'a pas leur point de vue, si ce n'est celui de ses victimes, mais surtout à ses compagnons de galère, qui rigolait de ses exploits avant d'y voir là des manières qui choquent leur moralité, qui stimulent aussi leur imaginaire : mais que fait exactement Alfa Ndiaye de ses victimes ?
Quand je parle d'humour, soyons bien d'accord qu'il ne s'agit pas de gags, de situations conçues pour être drôles, mais bien de situations si paradoxales qu'elles en deviennent absurdes, de mots qui, d'un seul coup, se retrouvent utilisés dans des sens presque à l'opposé de ce qu'ils disent exactement. Attendez, si vous ne trouvez pas ça très clair, un exemple arrive...
David Diop a déjà joué avec l'idée du sauvage, qui dans le cas présent, n'a plus rien de bon, pour reprendre cette si atroce formule ; il a introduit la notion de "soldat-sorcier" ; mais il manque l'oxymore qui claque et révèle l'embarras dans lequel se trouve les officiers commandant Alfa. Et l'un d'entre eux va le sortir : "la guerre civilisée" !
Oui, monsieur Alfa Ndiaye, ici, on fait la guerre civilisée, sous-entendu entre gentlemen respectant des règles bien définies, et il n'y a pas la place pour ces excentricités, pour ces actes sordides, pour ces pratiques d'un monde qui ne peut pas être civilisé, lui... Que sait-il de l'Afrique, celui qui parle ainsi ? Et se rend-il compte du ridicule de son expression, "la guerre civilisée" ?
Alfa Ndiaye, dans sa folie, n'est pas non plus exempt de cette absurdité : il considère qu'il a été inhumain en laissant Mademba Diop, son ami, son plus que frère, souffrir inutilement, alors qu'il pouvait abréger ses souffrances ; et, lorsqu'il tue ses ennemis aux yeux bleus, à sa façon bien particulière, il ne fait pas la même erreur. Et retrouve ainsi son humanité...
Tout est sens dessus dessous, dans cette histoire, les esprits des hommes, mais aussi la terre fracassée par les incessants bombardements, une terre mère qui accouche de soldats qu'on pousse à se jeter sur son ennemi, sous la mitraille, cible parfaite, chair à canon à l'espérance de vie sérieusement érodée... Alors, qui donc est fou ?
Car, il faut être fou pour accepter ces conditions de vie, ces combats désespérés, la proximité de la mort, la peur, la saleté et tout ce qui fait le quotidien des poilus. Plus encore, pour Alfa Ndiaye, il faut être fou pour sortir des tranchées le fusil à la main, la baïonnette au bout du fusil, un cri guerrier aux lèvres. Une folie passagère, qui cesse quand on regagne son trou, ces tranchées comme un ventre maternel...
Et c'est là qu'il s'est démarqué des autres : sa folie semble permanente. Je reprends le titre de ce billet, évidemment, avec ces mots très forts, qui marquent lorsqu'on les lit, comme beaucoup d'autres, tout au long de ces pages. Avec une nuance, et de taille : Alfa dit bien qu'il "donne l'impression d'être fou tout le temps".
Donner l'impression... Pas "être fou". Pour lui, il fait semblant, comme une provocation, un bras d'honneur lancé au destin et à la folie, bien réelle, il suffit de regarder tout autour, des hommes. Certes, mais, n'est-ce pas le propre du fou d'affirmer qu'il ne l'est pas ? Oh, il ne s'agit pas de philosopher ou de diagnostiquer, non, juste de poser la question qui s'impose : Alfa est-il vraiment fou ?
C'est, pour moi, l'enjeu majeur de "Frère d'âme", auquel on ne peut apporter de réponse catégorique. Peut-être cette assertion vous surprend-elle, et pourtant, c'est vraiment mon impression (après ce que je viens d'écrire, je devrais plutôt utiliser le mot sentiment ?). D'un côté, Alfa affirme que tout cela n'est qu'une comédie ; de l'autre, le récit d'Alfa qui glace...
Je ne trancherai pas (c'est le cas de le dire) cette question dans ce billet. Parce que ce sera à chaque lecteur de se faire une opinion. Mais, il faut aussi dire que David Diop sème le doute, et de façon très habile, en glissant dans son livre un élément qui explique parfaitement le titre de ce livre, et qui offre au lecteur une ambiguïté très intéressante.
Cet élément, je vais le qualifier de fantastique (si l'on reste sur un plan littéraire) ou de surnaturel. Mais, je ne suis qu'un lecteur européen, matérialiste, sceptique de nature, qui classe vite ce qu'il ne comprend pas sous l'étiquette "Irrationnel". Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, à commencer par Alfa. Et par Mademba.
La construction du roman est intéressante : son ouverture in media res, comme on dit, puis un retour en arrière qui n'est pas juste un flashback, mais une vraie immersion. On aurait pu imaginer inverser ces deux parties, commencer, entre guillemets, par le début, mais David Diop a choisi de renverser tout cela, et l'on va comprendre pourquoi.
Je ne parle que très peu de cette partie se déroulant au Sénégal, peut-être même ne faudrait-il pas en parler du tout, car on est surpris de cette soudaine irruption des souvenirs. Alors, restons discrets, et contentons-nous de simplement dire que cette partie vient éclairer la relation entre les deux amis, les deux plus que frères.
Le dernier mot de ce billet concernera l'écriture de David Diop. On retrouve une caractéristique des littératures africaines : cette oralité que l'écrit transmet malgré tout. Alfa Ndiaye parle, nous parle, se confesse, déverse même son récit comme s'il nous livrait son histoire d'une traite, presque sans prendre le temps de respirer.
Et parce qu'il doit se dire que tout cela est trop incroyable pour être cru, il lui faut affirmer qu'il dit la vérité, qu'il relate bien ce qu'il a vécu. Alors, il jalonne son récit d'une expression qui revient sans cesse (je n'ai pas compté, mais ça doit être assez important) : "Par la vérité de Dieu". Un tic de langage affirmatif, péremptoire, et qui participe à sa façon à l'ambiguïté de ce récit.
La langue de David Diop est riche, vive, colorée, inventive, avec beaucoup de trouvailles, comme ce "plus que frère", qu'on retrouve là aussi un bon nombre de fois. Cette écriture, par sa vivacité et l'espèce de joie, de frénésie qui s'en dégage, tranche (c'est le cas de le dire) avec le contexte, en particulier celui de la première partie du roman, celle qui se situe sur le front.
Cette langue fait de "Frère d'âme" un bonheur de lecture, malgré la noirceur du contexte et la violence du propos (ou l'inverse), elle nous emmène dans la folie (ah oui, c'est mon avis, et le vôtre ?) d'Alfa Ndiaye, jeune homme qui n'avait rien demandé et s'est retrouvé au coeur de l'horreur, alors que tout cela ne le concernait finalement pas.
Ecrasé par cette machine à tuer qu'est cette guerre moderne, la première et malheureusement pas la dernière, la pire à ce jour, avant que l'homme n'imagine pire encore, Alfa Ndiaye refuse pourtant la résignation et l'abattement. Sa folie, sa colère, sa culpabilité sont autant d'éléments qui forment une sorte d'armure autour de lui.
Une armure qui semble protéger son corps, puisqu'il traverse le no man's land comme si c'était son territoire et que rien ne pouvait l'atteindre, mais surtout une armure qui vient protéger son âme, durement éprouvée par la mort de son plus que frère, la protéger de cette guerre et de ses traumatismes, oubliés lorsqu'il replonge dans sa vie d'avant. Dans leur vie d'avant.
lundi 27 août 2018
"Je me suis toujours sentie un peu comme une intruse, un intermédiaire entre les frères Van Gogh".
La personne qui dit ces mots est quelqu'un que le grand public connaît sans doute assez peu. Elle s'appelait Johanna et était l'épouse de Théo Van Gogh, frère cadet du peintre, mais aussi son confident. L'être le plus proche de Vincent, une relation fusionnelle assez exceptionnelle. Si l'on connaît l'histoire de celui qu'elle appelle Van Gogh, si l'on connaît sa fin tragique, on sait souvent moins ce qui s'est passé par la suite. Et encore moins le rôle fondamental que Johanna a joué pour que l'oeuvre de Van Gogh soit enfin reconnu. Dans "la Veuve des Van Gogh" (désormais disponible en poche dans la collection Piccolo des éditions Liana Levi ; traduction de Fanchita Gonzalez Batlle), le romancier argentin Camilo Sanchez met cette femme de tête sur le devant de la scène, alors qu'elle traverse certains des pires moments de son existence. Il dresse également en creux un portrait bouleversant de Vincent Van Gogh et permet de découvrir son oeuvre exceptionnellement abondante d'un nouvel oeil. Enfin, il évoque ce lien fraternel extrêmement fort entre les Van Gogh...
Le 29 juillet 1890, Vincent Van Gogh meurt à l'auberge Ravoux, à Auvers-sur-Oise, à l'âge de 37 ans. Deux jours plus tôt, il s'est tiré une balle de pistolet dans la poitrine, mais au lieu de se tuer sur le coup, il agonise pendant 48 heures. Prévenu, son frère cadet, Théo, accourt et passe à ses côtés les dernières heures de la vie du peintre, alors complètement inconnu.
Le lendemain, Théo rentre à Paris, où il vit dans un appartement au 8, rue Pigalle, dans le quartier de Montmartre. En le voyant arriver, Johanna, son épouse depuis avril 1889, le trouve vieilli de dix ans, alors qu'elle ne l'a pas vu depuis seulement trois jours. Elle l'a attendue, s'occupant de leur jeune enfant, un garçon né au début de cette année, et qu'ils ont prénommé... Vincent.
Johanna tient un journal depuis des années déjà et, ce jour-là, elle entame justement un nouveau cahier dans lequel elle va consigner ses impressions. Parmi les premières, donc, l'impression de Théo a vieilli brusquement à la mort de son frère, avec qui il était lié comme avec personne d'autre, pas même elle, son épouse, la mère de son fils.
Un relation fusionnelle, mais aussi complexe, tumultueuse, comme en témoignent les 652 lettres que le peintre lui a écrites et qu'il a conservées. Et ce n'est pas la seule chose que Théo possède de Vincent, pardon, de Van Gogh, comme l'appelle Johanna : dans l'appartement, des dizaines, des centaines de toiles peintes par l'artiste...
Johanna n'a que très peu connu Vincent, du moins directement. Le nombre de fois où elle l'a vu se compte sur les doigts d'une main. Pourtant, à travers Théo, elle a l'impression de le connaître comme si elle vivait presque avec lui. Elle sait que son mari envoyait de l'argent à son frère, chaque mois, avec une régularité de métronome.
Mais, maintenant que Van Gogh est mort, c'est à elle de prendre les choses en main, car Théo sombre dans une dépression dont il ne va plus sortir. Johanna garde la tête froide, règle les questions administratives, s'occupe du ménage et du bébé... Ce qu'elle ignore, c'est que Théo ne vas survivre que six mois à son frère aîné...
Comme si la mort de l'un avait entraîné la mort de l'autre... Et Johanna, jeune mère, se retrouve alors veuve. Avec la sensation d'avoir perdu non pas un mais deux hommes, tant Théo était indissociable de Van Gogh. Elle décide alors de rentrer dans son pays natal, les Pays-Bas, et n'emporte que la correspondance de Van Gogh et quelques toiles, parmi la multitude entassée dans l'appartement.
Elle s'installe près d'Amsterdam, ouvre une pension, vit de peu, mais s'intéresse surtout aux Van Gogh, à ces lettres du peintre qu'elle lit, dans l'ordre chronologique, après la mort de Théo. Et découvre alors un Vincent dont elle ignorait tout. Et elle décide alors de tout mettre en oeuvre pour que le peintre disparu connaisse enfin le succès qui l'a ignoré toute sa vie...
C'est un résumé qui plante le décor, en fait. Qui rappelle le contexte historique de cette histoire, sans entrer dans le détail. Le roman s'étend sur une période d'un an et demi, le temps pour Johanna de remplir le cahier ouvert au lendemain de la mort de Van Gogh. Une période clé de sa vie, la fin d'une époque (curieux d'écrire cela en parlant d'une jeune femme de 28 ans) et le début d'une autre.
Camilo Sanchez ne fait pas de Johanna la narratrice de son roman, en tout cas, pas directement. C'est un narrateur neutre qui prend les commandes, mais s'appuie sur le fameux journal de Johanna, dont on trouve régulièrement des citations au fil du livre. Et c'est ce qui donne la sensation que c'est bien Johanna qui dirige l'histoire comme elle l'entend.
La discrète mais indispensable Johanna, née Bonger, issue d'une famille calviniste néerlandaise où l'on ne devait guère apprécier les Van Gogh, et moins encore les frasques de ce peintre sans talent, incapable de vendre la moindre toile et vivant aux crochets de son frère sans avoir l'air de se soucier de cette situation, même pas après le mariage de son frère et la naissance de son neveu...
Johanna, capable d'accepter cette relation si étroite entre Théo et Van Gogh. Une relation pleine d'affection, mais également orageuse, tumultueuse. Une relation qui ne s'instaure pas sur un pied d'égalité : Van Gogh écrase complètement Théo qui cède à toutes les demandes de son aîné, semble incapable de vivre sans lui.
Et semble également vouloir le garder pour lui. C'est une des ambiguïtés, d'ailleurs, du lien entre eux : Théo est marchand d'art, il aime et admire son frère, l'encourage dans sa vocation tardive de peintre (on va y revenir), et pourtant, il ne vend pas ses oeuvres. Les toiles s'entassent dans l'appartement de Théo et Van Gogh, de son vivant, ne vendra qu'une oeuvre, n'exposera quasiment jamais nulle part...
Au contraire, Johanna entreprend de réparer ce qui n'a pas fonctionné du vivant des frères : elle veut faire découvrir l'extraordinaire talent de Van Gogh, qu'on l'expose, qu'on le découvre, qu'on le vende, qu'on le critique... Sans doute était-il trop en avance, il y a de nombreuses hypothèses autour de Van Gogh, des maux qui le faisaient souffrir, cette maladie mentale qui l'aurait pousser à se mutiler puis à se tuer...
A travers ses lettres, Johanna découvre un Van Gogh différent, extraordinaire. Un homme doué de multiples talents. Pour le dessin, bien sûr, mais aussi pour les mots. Elle voit en lui un poète, pas seulement parce que l'on trouve des poèmes dans le cours de la correspondance, mais parce qu'il parle de ses oeuvres comme personne d'autre ne pourrait le faire.
Un grand poète et un grand peintre, voilà ce que pense Johanna. Après Théo, elle est sans doute la première à prendre conscience de l'immense artiste qu'il était, au contraire de ceux qu'il a payé avec ses toiles (l'un d'entre eux utilisera son portrait pour boucher un trou dans son poulailler pendant 10 ans !) ou ceux qui décrièrent son travail lors de trop rares expositions.
A travers ce court roman (160 pages à peine), on découvre un Van Gogh méconnu, qui saura certainement vous toucher bien au-delà de ce qu'on peut ressentir en regardant ses toiles les plus célèbres. Camilo Sanchez jalonne son récit d'indication sur la vie, l'oeuvre de Van Gogh, et on en apprend énormément sur le peintre.
Dès les premières pages, on découvre cette tradition familiale qui veut que, à chaque génération, on prénomme l'aîné Vincent. Johanna a accepté de se plier à cette tradition, mais à la mort de Van Gogh, elle le regrette un peu... Son fils, le seul des Van Gogh qu'elle appellera Vincent, elle fera tout pour le protégé de ce qui ressemble à une malédiction familiale...
Dès les premières pages du livre, on apprend ainsi que, un an jour pour jour avant la naissance du peintre, ses parents avaient eu un autre enfant, mort-né. Prénommé Vincent. Enterré dans le cimetière jouxtant l'église dont son père est le pasteur. Enfant, on emmène Vincent sur la tombe de son frère... qui porte le même prénom...
Cette histoire m'a rappelé celle d'un autre peintre célèbre, Salvador Dali, qui a connu le même genre d'histoire... A chacun son traumatisme, et les deux l'ont vécu différemment. Mais avouez que d'emblée, le jeune Vincent Van Gogh se retrouve marqué profondément par un drame et l'image d'une tombe à son nom...
On en apprend aussi sur l'oeuvre du peintre. Son abondance, d'abord, on parle de centaines de toiles dans l'appartement, plus celles qu'il offrait en paiement, ce sont donc sans doute des milliers de tableaux que Van Gogh a peints, dont un bon nombre ont dû se perdre en route, être détruits par leurs propriétaires, persuadés d'avoir récupéré une croûte.
Des. Milliers. D'oeuvres. Le chiffre fait frissonner, mais quand on sait que Van Gogh n'est réellement devenu peintre qu'à 27 ans, soit moins de 8 ans avant sa mort. Et, non seulement il peint sans cesse, mais son oeuvre est multiple, aborde de très nombreux genres picturaux, et pas uniquement ceux que l'on connaît à travers ses portrait ou "les Tournesols".
Si l'on pense à Van Gogh, on pense souvent aux couleurs, à ces couleurs vives dont il fait usage, en particulier le jaune, qui est comme une signature. Et qui sera aussi, de son vivant, un des freins. Il est en avance de près d'une vingtaine d'années sur les Fauves, qu'il influencera incontestablement. Et pourtant, avant cela, il a peint, dessiné, de toute autre manière.
Dans le roman de Camilo Sanchez, on croise évidemment nombre de tableaux du peintre, mais l'un d'eux revient plusieurs fois : "les Mangeurs de pommes de terre". Il le peint en 1885, avant de s'installer en France, un tableau pour lequel il réalise de nombreuses études et qu'il tenait pour son tableau le plus réussi...
Il y a de très belles lignes dans "La Veuve des Van Gogh", sur "les Mangeurs de pomme de terre", qui donnent envie de le regarder sous toutes les coutures. Au-delà de la technique, le sujet, ces personnages, leurs expressions... Un tableau qui hantait Van Gogh et qui symbolise peut-être même l'insuccès du peintre...
Dans son cahier, Johanna consigne une phrase qu'elle a entendu de la part de l'épouse d'un marchand d'art qu'elle essaye de convaincre de promouvoir l'oeuvre de Van Gogh : "Si chaque style était une vie, Van Gogh aurait vécu au moins huit vies en une décennie". En quelques mots, elle résume l'extraordinaire talent de Van Gogh, pourtant méprisé de son vivant...
Mais je parle beaucoup du peintre, peu de son frère... De leur folie commune, de cette folie qui semble attachée aux pas des Van Gogh (Théo est en fait mort de la syphillis et a perdu l'esprit ; leur soeur Wil, pionnière du féminisme que l'on croise dans le roman, passa une grande partie de sa vie en institution psychiatrique...) et qui est au coeur de ce que l'on sait habituellement du peintre (ou croit savoir).
Au milieu de tout cela, il y a Johanna, si stable, si calme, si posée. Si discrète, mais si sûre d'elle. Sûre de son jugement sur l'oeuvre de Van Gogh, la première à croire en lui. Le roman est aussi l'histoire de ses premières démarches pour faire reconnaître et exposer ces toiles. En premier lieu, sur les murs de sa pension de famille, pour en faire profiter les gens de passage...
Si le livre s'arrête en 1892, il faut savoir qu'elle poursuivra ce travail sans relâche jusqu'à la Première Guerre mondiale. En effet, l'année 1914 sera marquée par deux décisions fortes de la part de Johanna, qu'on pourrait voir comme une parenthèse qu'on referme : d'abord, elle fait publier la correspondance qu'entretenaient Vincent et Théo ; puis elle réunit les deux frères à Auvers-sur-Oise...
Si le livre s'arrête en 1892, il faut savoir qu'elle poursuivra ce travail sans relâche jusqu'à la Première Guerre mondiale. En effet, l'année 1914 sera marquée par deux décisions fortes de la part de Johanna, qu'on pourrait voir comme une parenthèse qu'on referme : d'abord, elle fait publier la correspondance qu'entretenaient Vincent et Théo ; puis elle réunit les deux frères à Auvers-sur-Oise...
Pardon, je vais peut-être un peu loin, même si ces éléments sont postérieurs à la période du roman. Ces éléments, je les glane aussi à travers certaines notes de bas de page, très intéressantes pour comprendre les choses, avec le recul ou les connaissances que n'avait pas Johanna. Et ils permettent de compléter le portrait du peintre, de son frère et de l'épouse de ce dernier.
Johanna n'est pas une intruse dans ce roman, bien au contraire. Elle en est l'âme, et Camilo Sanchez trouve le juste équilibre pour que Van Gogh ne lui vole pas la vedette. Le titre de ce billet se trouve dans les toutes premières pages du roman, et donc sans doute dans les toutes premières pages de ce cahier qu'elle ouvre au lendemain de la mort du peintre.
Le mot "intruse" est terrible, "intermédiaire" à peine moins rude... Le second est d'ailleurs surprenant, puisqu'elle n'a quasiment pas eu de lien avec le peintre. Mais, c'est aussi à ce moment-là qu'elle entre en scène, qu'elle prend son destin en main, et celui de sa famille avec. Car, oui, dès cet instant, elle devient bel et bien une Van Gogh.
Son destin n'est pas extraordinaire, mais sa manière de mener désormais sa vie comme elle l'entend, sur les plans privé comme professionnel, est tout à fait remarquable en cette fin de XIXe siècle. Et sa fougue à obtenir justice pour son beau-frère force tout simplement le respect. Jamais elle ne s'est découragé, elle a insisté jusqu'à ce que la digue cède...
Dans le roman, ce ne sont que les premières fissures, le chemin sera encore long avant que le nom de Van Gogh soit reconnu, plus encore pour qu'il soit connu. Mais, je ne pense pas qu'elle ait imaginé une seule seconde que les toiles de Van Gogh atteindraient un jour des sommes records aux enchères... Car il est évident qu'à aucun moment, ce n'est l'argent qui la motive.
Camilo Sanchez sort de l'ombre ce personnage qui n'aspirait certainement pas à la lumière pour elle-même, mais qui a consacré une grande partie de son existence à changer le regard sur un artiste d'exception qu'elle n'avait pas rencontré 5 fois dans sa vie, mais qu'elle connaissait sans doute mieux que les propres parents du peintre.
Sur la couverture de l'édition en grand format, le visage de Johanna Van Gogh, née Bonger, apparaissait sur les trois-quarts de l'image, immortalisée dans le bleu de "la Nuit étoilée", éclairée par une lune d'un jaune solaire... Sur l'édition de poche, ne reste que la lune et ce trait caractéristique qui fait qu'on reconnait de suite une oeuvre de Van Gogh. Quel dommage !
Ce visage va clore ce billet, parce qu'elle est le personnage central de ce livre. La photo est datée d'avril 1889, le mois de son mariage avec Théo :
samedi 25 août 2018
"Ne contrariez pas les samouraïs. Ne vous mêlez pas de politique. Et faites attention de ne pas laisser traîner votre petit oiseau n'importe où !"
Inutile de vous dire que la plus grande partie du roman va voir le personnage principal s'évertuer à ne surtout pas respecter ces conseils... Le mot "samouraïs" vous indique vers quels rivages nous allons voguer dans ce billet, mais il reste encore beaucoup à découvrir du contexte, des personnages et de la trame de ce livre. "Le Monde flottant", d'Alan Spence, a été publié à l'origine aux éditions Héloïse d'Ormesson en 2010, avant d'être réédité à l'automne dernier par cette même maison. On se lance dans un roman historique dont le point de départ peut sembler assez classique : un Européen arrive dans le Japon féodal, avant l'ère Meiji. Oui, mais en regardant de plus près, on se rend compte que ce personnage a réellement existé et qu'il s'agit là d'une biographie romanesque. Comme moi, pas sûr que le nom de Tom Glover vous parle, eh bien voici l'occasion de découvrir une partie de la vie de ct Ecossais qui prit une part active dans les changements profonds qui vont toucher le Japon au milieu du XIXe et aboutir à la fin du féodalisme dans l'archipel...
Tom Glover est né à Aberdeen, en Ecosse. Son père est officier dans la gendarmerie maritime et, comme beaucoup d'habitants de cette ville portuaire, Tom a le regard tourné vers la mer. Il débute comme courtier, dans une petite société installée sur le port, mais très tôt, il a l'ambition de connaître autre chose. Un ailleurs...
Et plus particulièrement l'Asie, puisqu'il a postulé pour un emploi au sein d'un énorme conglomérat basé à Hong Kong, Jardine Matheson. Quand la réponse arrive, il est soufflé, mais n'hésite pas longtemps : on lui offre une place au sein de l'entreprise, une place au Japon ! Eh bien, c'est au Japon qu'il ira et qu'il deviendra riche !
Ses parents, ses amis, sont bien sûr bouleversés par cette annonce. Non seulement le Japon semble appartenir à un autre monde, mais pour tous, c'est un pays de barbares... Tom ne partage pas cette impression et bientôt, en cette année 1858, il prend la mer avec curiosité et envie, bien décidé à profiter au maximum de ce qui n'est encore, à ce moment, qu'un voyage...
C'est à Nagasaki qu'il débarque, logé dans un premier temps dans les baraquements de fortune construits sur l'île de Dejima, où à l'origine, on installait les négociants étrangers qui n'étaient pas les bienvenus sur le sol japonais. Les choses ont un peu changé, mais pas tant que ça, et la présence des Européens restent une question épineuse, moteur d'un fort mouvement nationaliste.
Très vite, Tom se met au boulot, faisant des affaires dans le cadre de son emploi au sein de la Jardines et engrange de quoi lancer sa propre affaire. Il décide de faire le commerce de tout ce qui peut se vendre, principalement la soie, le riz, mais surtout le thé, dont il va faire évoluer en profondeur les méthodes de production.
Et puis, parce que rien ne l'effraie, il va également négocier des produits plus risqués, comme l'opium ou les armes, mais en prenant les plus grandes précautions. Très vite, le nom de Tom Glover devient incontournable à Nagasaki et son affaire ne cesse de grandir, ce qui n'est pas forcément du goût de tout le monde. Mais Tom n'en a cure.
Il y a bien sûr cette dimension professionnelle, dans laquelle Tom Glover fait des merveilles, mais il lui faut aussi, dans sa vie quotidienne, découvrir la vie à la japonaise et apprendre à s'adapter à cette culture si différente de la sienne. Pour cela, il peut compter sur l'aide de certains européens installés depuis plus longtemps que lui, comme son compatriote Mackenzie.
C'est lui qui lui donne les fameux conseils qui servent de ce titre à ce billet. Pour les samouraïs, c'est compliqué, puisque dès son arrivée, il semble être dans le collimateur de l'un d'entre eux... Pour la politique, cela viendra plus tard, et dans ce billet aussi... Enfin, pour le petit oiseau, cela se passe dans un quartier de la ville où ses amis vont bien vite l'emmener et qu'on appelle le Monde flottant.
Le quartier chaud de Nagasaki, celui des bordels, pardons, des maisons de thé, et des prostituées. Et comme ce fichu écossais ne fait rien de ce qu'on lui recommande, il va tomber amoureux d'une des filles qu'il rencontre... La suite, il vous faudra la découvrir, elle est tragique et montre un côté assez dur de Tom Glover...
Bon, je ne vais pas aller par quatre chemins : même lui ne pensait sans doute pas en quittant Aberdeen qu'il s'installerait au Japon pour le restant de ses jours. Et pourtant, c'est ce qui va se passer, il ne reviendra d'ailleurs dans sa ville natale que très peu souvent. Et "le Monde flottant", c'est le récit de cette existence, plus exactement d'abord des douze premières années qui seront décisives.
Alan Spence évoque d'autres époques, l'une d'entre elle dès l'ouverture du roman, qui se déroule au moment du bombardement de Nagasaki par les forces américaines en 1945. Au moment de l'explosion de la bombe atomique et des jours qui vont suivre. Ces pages nous présentent un autre personnage important de ce roman : Tomisaburo, le fils de Tom Glover...
N'en disons pas trop, car il se passe beaucoup de choses dans ce roman, ces douze années vont s'avérer extrêmement mouvementées, tant sur le plan personnel pour Tom Glover, que pour tout l'archipel du Japon, soumis à des secousses politiques, idéologiques et institutionnelles très fortes, qui vont aboutir à une quasi guerre civile puis à l'avènement, en 1868, de l'ère Meiji.
Il faut se rendre compte en lisant ce roman que le contexte historique est tout aussi important que le personnage central. On est à une période décisive du Japon, la remise en cause des fondations de toute la société nippone, à commencer par son sommet : le shogun. Le pays est encore un empire féodal, mais l'empereur est cantonné à un rôle annexe. C'est le shogun qui a le pouvoir.
C'est encore un Japon tel qu'on l'imagine, avec les samouraïs, les daimyos, qui dirigent les provinces, les ronins, etc. On se croirait dans un film de Kurosawa. Et puis, petit à petit, le contexte politique se met en place autour de Tom Glover. Avec, en particulier, les membres du domaine de Choshu, des samouraïs qui ont adopté un slogan clair et net : Sonnôjôi !
Un mot d'ordre qui signifie : "Vénérez l'empereur ! Expulsez les étrangers !" La volonté affichée de rendre au Japon sa pureté originelle, quand l'empereur dirigeait le pays et qu'on n'y acceptait pas la moindre présence étrangère, pas même commerciale. Ce sont eux qui mènent la fronde en cours, et c'est avec eux que Tom Glover va s'allier...
En particulier, il va devenir l'ami très proche d'un personnage clé de la période, Ito Hirobumi, une relation qui va infléchir la trajectoire du jeune aristocrate nippon, qui deviendra l'une des figures politiques et gouvernementales de la première partie de la période Meiji. On découvre chez Alan Spence toute l'influence plus ou moins discrète de Tom Glover sur ceux qui vont renverser le Shogun.
A ce moment du billet, il nous faut parler d'un autre livre (ce n'est sûrement pas le seul, mais c'est celui qui m'est venu à l'esprit en cours de lecture) : "La Maison de l'Arbre joueur", de Lian Hearn, qui se déroule exactement à la même période, avec les mêmes personnages historiques, autour d'une trame de fiction mettant en scène des personnages imaginaires.
L'angle est différent du "Monde flottant", et même si Tom Glover y apparaît, ce sont surtout les Japonais qui sont au centre de l'histoire. En particulier Ito Hirobumi. Il y a, je pense, une vraie complémentarité entre ces deux livres qui, s'ils restent des romans, et donc des fictions, permettent de s'intéresser de près à cette période décisive de l'histoire japonaise.
Mais, "le Monde flottant", c'est aussi l'histoire d'un homme venu d'ailleurs et qui va finir par devenir un vrai citoyen japonais. En parallèle de sa vie d'homme d'affaires, on suit également sa vie sentimentale, puis familiale, qui n'est pas moins mouvementée, d'ailleurs, et cette partie-là n'est pas moins intéressante, en particulier à travers le personnage de Tomisaburo, qu'on sent écartelé entre ses racines européennes et nippones.
Tout cela dessine un personnage fascinant, au caractère très trempé, qui va défier tout le monde, Européens, Japonais, mais aussi Chinois et Américains, qui va se retrouver pris dans la tourmente de cette période (on vit certains événements majeurs de l'histoire japonaise à travers son regard, qu'on sent inquiet face à la violence qui se déchaîne).
Je ne savais rien de ce personnage, j'avais même oublié l'avoir croisé dans le roman de Lian Hearns et, pour être franc, je croyais lire un roman de pure fiction avant de me rendre compte que je lisais une biographie romanesque. La maison de Tom Glover à Nagasaki existe encore aujourd'hui, elle est entourée d'un jardin public et l'on peut la visiter lorsqu'on se trouve dans cette ville.
Alan Spence signe un vrai roman historique, assez épique, autour d'un personnage fort, ce qui ne veut pas dire qu'il n'apparaît que sous un jour positif, c'est aussi un homme autoritaire, parfois borné, quelquefois égoïste, mais on le voit infatigable, toujours en mouvement, plein d'idées nouvelles dans la plupart des domaines, vraiment impressionnant.
La petite histoire dit que Puccini s'est en partie inspiré de lui pour créer le personnage de l'officier amoureux de Madame Butterfly, bon, pourquoi pas ? Alan Spence s'amuse de cette légende et la met en scène dans la dernière partie du roman. C'est très anecdotique, même si la voix de la Callas, par exemple, peut accompagner agréablement cette lecture.
L'important, c'est plutôt la grande histoire, celle qui s'est accomplie avec la participation de Tom Glover (n'en faisons pas non plus LE moteur de cette révolution, ce serait faux), et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, en ouvrant le roman en 1945, le romancier ne permet pas d'introduire le personnage douloureux de Tomisaburo, mais montre aussi ce que la révolution des années 1860 a eu pour conséquence.
Car le Japon impérial qui a colonisé la Mandchourie dans le sang, qui a rejoint l'Axe, qui a combattu les Américains dans le Pacifique avec acharnement, ce Japon-là, mis à genoux par les deux bombes atomiques, est directement issu de ces événements... Et l'on comprend que les spécificités culturelles fortes ont largement survécu à l'ouverture du pays.
Autre conséquence, directement liée à Tom Glover, c'est la création des chantiers navals de Nagasaki qui, bien plus tard, deviendront une des places fortes mondiales de la construction de navires. On découvre comment le négociant écossais va permettre la création de cet immense complexe et comment cela va se dérouler sur le plan technique. Là encore, c'est impressionnant.
Un dernier mot qui concerne le titre français du roman. Pour être franc, je n'ai pas trop compris pourquoi ce choix. Le Monde flottant, c'est le surnom du quartier chaud de Nagasaki et si ce qui s'y passe dans le cours du roman est important, ce n'est pas l'essentiel. C'est peut-être plus joli et plus poétique que le titre en version original, mais ce dernier est plus pertinent.
En anglais, le roman s'intitule "The Pure Land", la terre pure. Alors, oui, bien sûr, en français, ça ne sonne peut-être pas très bien. Et pourtant, cette expression japonaise qui qualifie le Japon colle parfaitement à l'histoire du roman et à ses enjeux. D'autant que derrière elle, il y a un élément loin d'être anodin, qui résume bien les relations internationales entre l'archipel et le reste du monde.
En début de billet, je signalais cette remarque que ses amis font à Tom Glover en apprenant qu'il part pour le Japon : ce sont des barbares. Mais, dans le même temps, on comprend que les Japonais pensent exactement la même chose des non-Japonais, et particulièrement des Européens. Chacun est le barbare de l'autre, et c'est la pureté de la terre japonaise qui est en jeu...
Encore une fois, la magie du Japon opère. On le découvre dans le regard d'Européens, le romancier comme le personnage principal, mais on est dépaysé. Car, même si le Japon actuel, comme la plupart des pays asiatiques, conserve un attachement fort à ses traditions, le pays d'aujourd'hui est très différent de celui des années 1860, où la nature est un élément incontournable.
Mais c'est aussi un pays très violent que l'on découvre, où les sabres sortent bien souvent des fourreaux. Une violence à laquelle participe allègrement les pays européens, dont le rôle à cette période, est loin d'être des plus moraux... C'est l'un des autres éléments forts qui apparaît dans le parallèle entre les années 1850-60 et 1945 : la volonté de mettre le pays à genoux, à n'importe quel prix...
J'ai peu parlé des personnages féminins, alors qu'il y en a deux essentiels dans ce roman. Pardonnez-moi, c'est simplement parce que les évoquer dévoilerait certains aspects importants du livre. En arrivant au terme de ce billet, j'ai une pensé pour Maki, dont le destin m'a bouleversé, dès le début et jusqu'au final, où elle tient une place importante.
Tout cela donne un vrai bon moment de lecture, romanesque au possible tout en nous en apprenant beaucoup sur l'histoire du Japon (faites chauffer les moteurs de recherche !), plein de bruit et de fureur, mais aussi d'amour et de sensualité. Vous en saurez plus sur Tom Glover, un personnage historique méconnu, un homme imparfait, mais une vraie figure romanesque.
Tom Glover est né à Aberdeen, en Ecosse. Son père est officier dans la gendarmerie maritime et, comme beaucoup d'habitants de cette ville portuaire, Tom a le regard tourné vers la mer. Il débute comme courtier, dans une petite société installée sur le port, mais très tôt, il a l'ambition de connaître autre chose. Un ailleurs...
Et plus particulièrement l'Asie, puisqu'il a postulé pour un emploi au sein d'un énorme conglomérat basé à Hong Kong, Jardine Matheson. Quand la réponse arrive, il est soufflé, mais n'hésite pas longtemps : on lui offre une place au sein de l'entreprise, une place au Japon ! Eh bien, c'est au Japon qu'il ira et qu'il deviendra riche !
Ses parents, ses amis, sont bien sûr bouleversés par cette annonce. Non seulement le Japon semble appartenir à un autre monde, mais pour tous, c'est un pays de barbares... Tom ne partage pas cette impression et bientôt, en cette année 1858, il prend la mer avec curiosité et envie, bien décidé à profiter au maximum de ce qui n'est encore, à ce moment, qu'un voyage...
C'est à Nagasaki qu'il débarque, logé dans un premier temps dans les baraquements de fortune construits sur l'île de Dejima, où à l'origine, on installait les négociants étrangers qui n'étaient pas les bienvenus sur le sol japonais. Les choses ont un peu changé, mais pas tant que ça, et la présence des Européens restent une question épineuse, moteur d'un fort mouvement nationaliste.
Très vite, Tom se met au boulot, faisant des affaires dans le cadre de son emploi au sein de la Jardines et engrange de quoi lancer sa propre affaire. Il décide de faire le commerce de tout ce qui peut se vendre, principalement la soie, le riz, mais surtout le thé, dont il va faire évoluer en profondeur les méthodes de production.
Et puis, parce que rien ne l'effraie, il va également négocier des produits plus risqués, comme l'opium ou les armes, mais en prenant les plus grandes précautions. Très vite, le nom de Tom Glover devient incontournable à Nagasaki et son affaire ne cesse de grandir, ce qui n'est pas forcément du goût de tout le monde. Mais Tom n'en a cure.
Il y a bien sûr cette dimension professionnelle, dans laquelle Tom Glover fait des merveilles, mais il lui faut aussi, dans sa vie quotidienne, découvrir la vie à la japonaise et apprendre à s'adapter à cette culture si différente de la sienne. Pour cela, il peut compter sur l'aide de certains européens installés depuis plus longtemps que lui, comme son compatriote Mackenzie.
C'est lui qui lui donne les fameux conseils qui servent de ce titre à ce billet. Pour les samouraïs, c'est compliqué, puisque dès son arrivée, il semble être dans le collimateur de l'un d'entre eux... Pour la politique, cela viendra plus tard, et dans ce billet aussi... Enfin, pour le petit oiseau, cela se passe dans un quartier de la ville où ses amis vont bien vite l'emmener et qu'on appelle le Monde flottant.
Le quartier chaud de Nagasaki, celui des bordels, pardons, des maisons de thé, et des prostituées. Et comme ce fichu écossais ne fait rien de ce qu'on lui recommande, il va tomber amoureux d'une des filles qu'il rencontre... La suite, il vous faudra la découvrir, elle est tragique et montre un côté assez dur de Tom Glover...
Bon, je ne vais pas aller par quatre chemins : même lui ne pensait sans doute pas en quittant Aberdeen qu'il s'installerait au Japon pour le restant de ses jours. Et pourtant, c'est ce qui va se passer, il ne reviendra d'ailleurs dans sa ville natale que très peu souvent. Et "le Monde flottant", c'est le récit de cette existence, plus exactement d'abord des douze premières années qui seront décisives.
Alan Spence évoque d'autres époques, l'une d'entre elle dès l'ouverture du roman, qui se déroule au moment du bombardement de Nagasaki par les forces américaines en 1945. Au moment de l'explosion de la bombe atomique et des jours qui vont suivre. Ces pages nous présentent un autre personnage important de ce roman : Tomisaburo, le fils de Tom Glover...
N'en disons pas trop, car il se passe beaucoup de choses dans ce roman, ces douze années vont s'avérer extrêmement mouvementées, tant sur le plan personnel pour Tom Glover, que pour tout l'archipel du Japon, soumis à des secousses politiques, idéologiques et institutionnelles très fortes, qui vont aboutir à une quasi guerre civile puis à l'avènement, en 1868, de l'ère Meiji.
Il faut se rendre compte en lisant ce roman que le contexte historique est tout aussi important que le personnage central. On est à une période décisive du Japon, la remise en cause des fondations de toute la société nippone, à commencer par son sommet : le shogun. Le pays est encore un empire féodal, mais l'empereur est cantonné à un rôle annexe. C'est le shogun qui a le pouvoir.
C'est encore un Japon tel qu'on l'imagine, avec les samouraïs, les daimyos, qui dirigent les provinces, les ronins, etc. On se croirait dans un film de Kurosawa. Et puis, petit à petit, le contexte politique se met en place autour de Tom Glover. Avec, en particulier, les membres du domaine de Choshu, des samouraïs qui ont adopté un slogan clair et net : Sonnôjôi !
Un mot d'ordre qui signifie : "Vénérez l'empereur ! Expulsez les étrangers !" La volonté affichée de rendre au Japon sa pureté originelle, quand l'empereur dirigeait le pays et qu'on n'y acceptait pas la moindre présence étrangère, pas même commerciale. Ce sont eux qui mènent la fronde en cours, et c'est avec eux que Tom Glover va s'allier...
En particulier, il va devenir l'ami très proche d'un personnage clé de la période, Ito Hirobumi, une relation qui va infléchir la trajectoire du jeune aristocrate nippon, qui deviendra l'une des figures politiques et gouvernementales de la première partie de la période Meiji. On découvre chez Alan Spence toute l'influence plus ou moins discrète de Tom Glover sur ceux qui vont renverser le Shogun.
A ce moment du billet, il nous faut parler d'un autre livre (ce n'est sûrement pas le seul, mais c'est celui qui m'est venu à l'esprit en cours de lecture) : "La Maison de l'Arbre joueur", de Lian Hearn, qui se déroule exactement à la même période, avec les mêmes personnages historiques, autour d'une trame de fiction mettant en scène des personnages imaginaires.
L'angle est différent du "Monde flottant", et même si Tom Glover y apparaît, ce sont surtout les Japonais qui sont au centre de l'histoire. En particulier Ito Hirobumi. Il y a, je pense, une vraie complémentarité entre ces deux livres qui, s'ils restent des romans, et donc des fictions, permettent de s'intéresser de près à cette période décisive de l'histoire japonaise.
Mais, "le Monde flottant", c'est aussi l'histoire d'un homme venu d'ailleurs et qui va finir par devenir un vrai citoyen japonais. En parallèle de sa vie d'homme d'affaires, on suit également sa vie sentimentale, puis familiale, qui n'est pas moins mouvementée, d'ailleurs, et cette partie-là n'est pas moins intéressante, en particulier à travers le personnage de Tomisaburo, qu'on sent écartelé entre ses racines européennes et nippones.
Tout cela dessine un personnage fascinant, au caractère très trempé, qui va défier tout le monde, Européens, Japonais, mais aussi Chinois et Américains, qui va se retrouver pris dans la tourmente de cette période (on vit certains événements majeurs de l'histoire japonaise à travers son regard, qu'on sent inquiet face à la violence qui se déchaîne).
Je ne savais rien de ce personnage, j'avais même oublié l'avoir croisé dans le roman de Lian Hearns et, pour être franc, je croyais lire un roman de pure fiction avant de me rendre compte que je lisais une biographie romanesque. La maison de Tom Glover à Nagasaki existe encore aujourd'hui, elle est entourée d'un jardin public et l'on peut la visiter lorsqu'on se trouve dans cette ville.
Alan Spence signe un vrai roman historique, assez épique, autour d'un personnage fort, ce qui ne veut pas dire qu'il n'apparaît que sous un jour positif, c'est aussi un homme autoritaire, parfois borné, quelquefois égoïste, mais on le voit infatigable, toujours en mouvement, plein d'idées nouvelles dans la plupart des domaines, vraiment impressionnant.
La petite histoire dit que Puccini s'est en partie inspiré de lui pour créer le personnage de l'officier amoureux de Madame Butterfly, bon, pourquoi pas ? Alan Spence s'amuse de cette légende et la met en scène dans la dernière partie du roman. C'est très anecdotique, même si la voix de la Callas, par exemple, peut accompagner agréablement cette lecture.
L'important, c'est plutôt la grande histoire, celle qui s'est accomplie avec la participation de Tom Glover (n'en faisons pas non plus LE moteur de cette révolution, ce serait faux), et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, en ouvrant le roman en 1945, le romancier ne permet pas d'introduire le personnage douloureux de Tomisaburo, mais montre aussi ce que la révolution des années 1860 a eu pour conséquence.
Car le Japon impérial qui a colonisé la Mandchourie dans le sang, qui a rejoint l'Axe, qui a combattu les Américains dans le Pacifique avec acharnement, ce Japon-là, mis à genoux par les deux bombes atomiques, est directement issu de ces événements... Et l'on comprend que les spécificités culturelles fortes ont largement survécu à l'ouverture du pays.
Autre conséquence, directement liée à Tom Glover, c'est la création des chantiers navals de Nagasaki qui, bien plus tard, deviendront une des places fortes mondiales de la construction de navires. On découvre comment le négociant écossais va permettre la création de cet immense complexe et comment cela va se dérouler sur le plan technique. Là encore, c'est impressionnant.
Un dernier mot qui concerne le titre français du roman. Pour être franc, je n'ai pas trop compris pourquoi ce choix. Le Monde flottant, c'est le surnom du quartier chaud de Nagasaki et si ce qui s'y passe dans le cours du roman est important, ce n'est pas l'essentiel. C'est peut-être plus joli et plus poétique que le titre en version original, mais ce dernier est plus pertinent.
En anglais, le roman s'intitule "The Pure Land", la terre pure. Alors, oui, bien sûr, en français, ça ne sonne peut-être pas très bien. Et pourtant, cette expression japonaise qui qualifie le Japon colle parfaitement à l'histoire du roman et à ses enjeux. D'autant que derrière elle, il y a un élément loin d'être anodin, qui résume bien les relations internationales entre l'archipel et le reste du monde.
En début de billet, je signalais cette remarque que ses amis font à Tom Glover en apprenant qu'il part pour le Japon : ce sont des barbares. Mais, dans le même temps, on comprend que les Japonais pensent exactement la même chose des non-Japonais, et particulièrement des Européens. Chacun est le barbare de l'autre, et c'est la pureté de la terre japonaise qui est en jeu...
Encore une fois, la magie du Japon opère. On le découvre dans le regard d'Européens, le romancier comme le personnage principal, mais on est dépaysé. Car, même si le Japon actuel, comme la plupart des pays asiatiques, conserve un attachement fort à ses traditions, le pays d'aujourd'hui est très différent de celui des années 1860, où la nature est un élément incontournable.
Mais c'est aussi un pays très violent que l'on découvre, où les sabres sortent bien souvent des fourreaux. Une violence à laquelle participe allègrement les pays européens, dont le rôle à cette période, est loin d'être des plus moraux... C'est l'un des autres éléments forts qui apparaît dans le parallèle entre les années 1850-60 et 1945 : la volonté de mettre le pays à genoux, à n'importe quel prix...
J'ai peu parlé des personnages féminins, alors qu'il y en a deux essentiels dans ce roman. Pardonnez-moi, c'est simplement parce que les évoquer dévoilerait certains aspects importants du livre. En arrivant au terme de ce billet, j'ai une pensé pour Maki, dont le destin m'a bouleversé, dès le début et jusqu'au final, où elle tient une place importante.
Tout cela donne un vrai bon moment de lecture, romanesque au possible tout en nous en apprenant beaucoup sur l'histoire du Japon (faites chauffer les moteurs de recherche !), plein de bruit et de fureur, mais aussi d'amour et de sensualité. Vous en saurez plus sur Tom Glover, un personnage historique méconnu, un homme imparfait, mais une vraie figure romanesque.
"La femme qui veut enterrer Dieu".
J'imaginais au départ une phrase de titre plus longue, et puis c'est cette formule qui a fini par s'imposer, pas seulement parce qu'elle résume assez bien notre livre du jour, mais parce qu'elle offre également un clin d'oeil de l'auteur à ce qui est sans doute son livre le plus connu. Avec "L'Arche de Darwin" (en grand format au Diable Vauvert ; traduction de Sara Doke), James Morrow poursuit son oeuvre iconoclaste et sa dénonciation des extrémismes, en particulier religieux, mais pas seulement. Dans ce livre, à la fois roman historique et roman d'aventures, assaisonné par l'humour et l'esprit de provocation de Morrow, l'auteur de "En remorquant Jéhovah" pose une nouvelle foi la question de l'existence de Dieu (ou de sa non-existence, selon le point de vue) et embarque une comédienne pleine de détermination vers les îles Galapagos où pourrait se trouver la preuve essentielle mettant une fois pour toute fin à ce débat. Un voyage à la Jules Verne, mais aussi l'occasion pour James Morrow de rendre hommage aux scientifiques, et en particulier aux femmes scientifiques souvent oubliées, qui, avant Charles Darwin ou dans son sillage, ont contribué à élucider, petit à petit, le mystère de la vie.
Chloe Bathurst est comédienne dans un théâtre londonien de seconde zone, spécialisé dans la romance tragique (tout un programme), jusqu'au jour où elle se lance en pleine représentation dans un discours politique qui manque déclencher une émeute. Renvoyée aussitôt, elle se retrouve sans emploi et voit toutes les portes des théâtres se fermer devant elle.
Et ça tombe mal. Car cette envolée lyrique et révolutionnaire est la conséquence de la visite de son père, devenu indigent en raison de ses dettes et obligé d'effectuer des travaux forcés pour les rembourser. Chloé n'a plus qu'une idée en tête : aider son père à retrouver un peu de fierté. Mais comment trouver une telle somme ?
Puisqu'elle ne peut plus monter sur les planches, il lui faut trouver autre chose. Elle entend alors parler d'un certain Charles Darwin, qui vit à Downe, dans le Kent, et cherche quelqu'une gouvernante pour ses enfants. Hélas, Chloé arrive trop tard, et elle craque, devant cette étonnante famille... Charles Darwin lui offre alors de l'aider en l'embauchant pour tout autre chose.
Dans le jardin de Darwin House, se trouve un véritable petit zoo, où vivent des animaux exotiques que le scientifique a rapportés de ses différentes expéditions, et en particulier des reptiles. Darwin propose à Chloé de s'occuper de la ménagerie, de devenir son aide-gardienne de zoo, ce qui lui permettra de poursuivre ses recherches.
Tout se passe bien, non seulement Chloé finit par adorer les animaux qui l'avaient un peu surprise de prime abord, mais elle devient également très complice des enfants Darwin, Annie et William. Et puis, elle s'entend bien avec Darwin lui-même, qui apprécie que la jeune femme ne soit pas trop portée sur la religion, comme lui-même.
Un jour, lors d'un déjeuner où Darwin a convié plusieurs de ses collègues scientifiques, Chloé est témoin d'une conversation qui la frappe. Il est question d'un concours, organisé par une société d'étudiants d'Oxford, oisifs et provocateurs, dont le but est d'apporter la preuve de l'existence ou de la non-existence de Dieu, rien que ça. Avec à la clé, une récompense de 10 000£ à qui convaincra le jury.
Une telle somme serait la solution aux problèmes de Chloé, et plus encore de son père ! Or, Chloé sait que Darwin travaille sur une théorie qui a pour but de démontrer que les êtres vivants évoluent au fil du temps et qu'ils ne s'agit pas d'une création divine. Autrement dit, la théorie de Darwin pourrait tout à fait remporter le prix.
Mais, le scientifique ne veut surtout pas participer au concours. D'abord, parce qu'il juge que sa théorie doit encore être peaufinée, ensuite parce qu'il a promis à son épouse, très croyante, qu'elle ne serait publiée qu'après leur mort. Chloé est abattue, puis elle se reprend : puisque Darwin ne veut pas l'aider, alors, elle se débrouillera toute seule et remportera le prix !
Pour cela, elle a besoin de comprendre en quoi consiste la fameuse théorie de Darwin et trouver comment la démontrer. Elle met alors au point un projet fou : se rendre aux îles Galapagos et revenir avec des spécimens des mêmes espèces que celles que Darwin possède dans son zoo personnel, afin de montrer devant le jury du Grand concours de Dieu comment fonctionne l'évolution.
Mais, elle n'est pas la seule sur le coup. Une expédition a pris la mer pour les Galapagos avec une mission très clairement définie, parfaitement sordide, dont le but est d'empêcher, par tous les moyens, Chloé de pouvoir démontrer sa théorie. Et, pour la surveiller et éventuellement la dissuader, un prêtre est chargé de voyager aux côtés de la comédienne.
Et, en parallèle, une autre expédition menée par un jeune homme, fils du pasteur de la paroisse où vit Darwin, est également prête à s'élancer, mais dans une toute autre direction. Ces homme aussi participent au Grand concours de Dieu, mais entendent prouver l'existence de Dieu. Et, pour cela, elle entreprend des recherches pour découvrir les vestiges de l'Arche de Noé sur les pentes du mont Ararat...
Avant d'aller plus loin, il convient de resituer cette histoire dans son contexte historique : le roman débute en 1848, soit une dizaine d'années avant la publication du livre fondamental de Charles Darwin, "L'Origine des espèces". Le scientifique est encore alors complètement inconnu du grand public et, comme dit plus haut, il ne prévoit pas de publier son travail dans l'immédiat.
Et l'essentiel du roman va se dérouler avant 1859, année de publication de ce livre exposant une théorie révolutionnaire pour les uns, hérétique pour les autres. James Morrow joue d'ailleurs avec le contenu de cette théorie tout au long du livre, Chloé se confrontant à un texte qu'elle peine à comprendre, mais qu'elle ne cesse de potasser.
"L'Arche de Darwin" est donc un roman historique, qui nous plonge d'abord dans l'Angleterre du milieu du XIXe siècle, à une période où, dans toute l'Europe, des mouvements sociaux et politiques apparaissent, où les idées d'un autre personnage très important de cette époque, Karl Marx, commencent à émerger, où l'on dresse des barricades et remet l'ordre établi en question.
Comme il l'avait fait, par exemple, dans "le Dernier chasseur de sorcières", James Morrow joue avec ce contexte historique, y met son grain de sel et lui donne un aspect de conte philosophique, en accentuant le côté romanesque des choses. Ainsi, Chloé va vivre d'incroyables aventures dans son voyage jusqu'aux îles Galapagos, mais aussi une fois débarquée dans cet archipel.
C'est l'autre aspect très important de ce roman : on est dans un véritable roman d'aventures, plein de rebondissements, de surprises, d'événements forts et souvent dramatique, de retournements de situation et d'humour (souvent noir). Si vous trouvez que l'argument premier, démontrer la non-existence de Dieu à travers les écrits de Darwin, a l'air prise de tête, vous vous trompez carrément.
C'est captivant, enlevé, drôle, foutraque, bourré de clins d'oeil et de situations improbables, le tout porté par une galerie de personnages étonnante, au sein de laquelle Charles Darwin paraît d'un flegme tout à fait britannique. Un joueur invétéré, des marins avides, un ecclésiastique en proie au doute, une maquerelle complètement folle, des indiens d'Amazonie, un empereur fantoche et polygame, un pasteur interné, passionné de colombophilie et de peinture, et son fils accro au haschisch...
Si ce casting ne vous fait pas envie, je ne sais pas quoi vous dire de plus ! Mais si, ne vous inquiétez pas, j'ai encore quelques tours dans mon sac. Il y a, dans "L'Arche de Darwin", quelque chose d'un roman de Jules Verne. Chloé est une sorte de cousine de Philéas Fogg, elle aussi embarquée autour du monde, non pour battre un record, mais mener une quête semée d'embûches elle aussi.
C'est surtout un très beau personnage, parce qu'elle n'est pas monolithique : si elle ne va jamais perdre la détermination à sauver son père qui l'a poussée dans cette incroyable histoire, en revanche, au fil du voyage, on la voit osciller, hésiter, douter, se raccrocher à différentes choses, changer d'avis, évoluer (c'est le cas de le dire) de la foi à l'athéisme en passant par les étapes intermédiaires.
Cette quête, c'est aussi la sienne, une quête philosophique qui passe en revue nombre de postures que l'on rencontre couramment face à la question de l'existence de Dieu. Au départ, finalement, la réponse lui importe peu, ce qui compte, c'est de pouvoir réussir la démonstration la plus convaincante pour remporter les 10 000£.
Mais, au fil du voyage, des rencontres, de ses réflexions, des événements, elle ne peut s'empêcher de réfléchir elle aussi à tout cela, jusqu'à parfois se retrouver en porte-à-faux avec ce qu'elle entend démontrer. A l'image du bateau sur lequel elle va quitter l'Angleterre, elle change souvent de cap, contrairement à d'autres personnages, solidement ancrés dans leurs certitudes.
En cela, elle est un vrai personnage morrowien, si je puis dire, certainement pas une fanatique, mais quelqu'un qui pense, doute, se forge un avis en toute connaissance de cause, à l'écart des dogmes de tout poil. C'est aussi un personnage très touchant, charismatique, débrouillard, sachant mettre ses talents de comédienne au service de sa cause. Une héroïne bien plus puissante que celles qu'elle a incarnées dans ses romances tragiques...
Roman historique, roman d'aventures, conte philosophique à la Swift, roman d'amour, aussi, mais ce n'est pas tout. Le moment est venu d'évoquer une des dimensions les plus surprenantes de "L'Arche de Darwin", qui justifie d'ailleurs la remise d'un Grand Prix de l'Imaginaire à James Morrow, c'est la dimension fantastique.
Je ne vais pas la contextualiser, car il faut garder la surprise pour les lecteurs à venir, mais il se trouve qu'elle n'est pas juste là pour faire joli ou ajouter une touche spectaculaire supplémentaire. Non, elle a un but bien précis, qui est de rendre hommage à ceux, et plus encore celles qui, avec Darwin, ont permis à la science de franchir des étapes décisives pour expliquer le phénomène qu'est la vie.
James Morrow utilise le fantastique, car la plupart des personnalités qu'il fait intervenir dans son récit ont publié leur recherches ou ont tout simplement vécu après Charles Darwin : de Gregor Mendel, le père de la génétique, à Rosalind Franklin, sans laquelle Watson et Crick n'auraient pu découvrir la double hélice d'ADN, en passant par Pierre Teilhard de Chardin et son amie Lucile Swan...
Chose à la fois amusante et intéressante, parmi ces personnages dont le travail détruit le créationnisme en expliquant, étape par étape, l'évolution de l'être humain, deux sont des religieux : Gregor Mandel et Pierre Teilhard de Chardin (qui aura d'ailleurs bien des soucis avec sa hiérarchie au sein des Jésuites à cause de ses recherches).
"Que celui qui peut réfuter les preuves fossiles me lance le premier os", affirme d'ailleurs Teilhard de Chardin dans le roman, avec un humour qu'on ne lui connaissait pas tout à fait, phrase à laquelle fait écho une autre citation tirée du livre, savoureuse par son cynisme et symbolique de la malice de James Morrow, alors que son pays, l'Amérique, souffre de la montée de fanatismes chrétiens : "Un chrétien n'a rien à craindre des faits".
Ils ne sont pas les seuls à apparaître dans le roman, il ne faut pas oublier deux personnages qui ont joué un rôle très important dans le travail de Charles Darwin. Le premier, c'est Jean-Baptiste Lamarck, qui bien avant Darwin a élaboré une théorie de l'évolution ; on croise son nom de manière très amusante dans le roman.
Et le second, c'est Alfred Wallace, dont les recherches et les idées ont poussé Charles Darwin à publier ses travaux plus tôt qu'il ne le souhaitait. Lui, pour le coup, on le croise de manière tout à fait normale, enfin presque, dans le cours du récit, en pleine expérimentation. Tout cela incite le lecteur à se pencher non pas uniquement sur Darwin, mais sur la révolution scientifique entamée au XIXe siècle et poursuivie jusqu'à nos jours.
A chaque livre, James Morrow démontre un peu plus qu'on peut aborder des sujets sérieux sans se prendre au sérieux, que l'humour et l'ironie sont des armes de destruction massive d'idées reçues et de dogmatismes. Dans "En remorquant Jéhovah", il fallait empêcher l'enterrement de Dieu, au sens très concret du terme, ici, la rousseauiste Chloé Bathurst vent enterrer Dieu métaphoriquement.
Dans cette folle (et divine) comédie, Charles Darwin est un personnage fort et lui aussi très touchant. Plus que le scientifique, c'est l'homme que l'on découvre, et le père, également. Au milieu de cette folie générale suscitée par le concours, il fait figure de sage, avant tout concentré sur la science et son implacable beauté.
Chloe Bathurst est comédienne dans un théâtre londonien de seconde zone, spécialisé dans la romance tragique (tout un programme), jusqu'au jour où elle se lance en pleine représentation dans un discours politique qui manque déclencher une émeute. Renvoyée aussitôt, elle se retrouve sans emploi et voit toutes les portes des théâtres se fermer devant elle.
Et ça tombe mal. Car cette envolée lyrique et révolutionnaire est la conséquence de la visite de son père, devenu indigent en raison de ses dettes et obligé d'effectuer des travaux forcés pour les rembourser. Chloé n'a plus qu'une idée en tête : aider son père à retrouver un peu de fierté. Mais comment trouver une telle somme ?
Puisqu'elle ne peut plus monter sur les planches, il lui faut trouver autre chose. Elle entend alors parler d'un certain Charles Darwin, qui vit à Downe, dans le Kent, et cherche quelqu'une gouvernante pour ses enfants. Hélas, Chloé arrive trop tard, et elle craque, devant cette étonnante famille... Charles Darwin lui offre alors de l'aider en l'embauchant pour tout autre chose.
Dans le jardin de Darwin House, se trouve un véritable petit zoo, où vivent des animaux exotiques que le scientifique a rapportés de ses différentes expéditions, et en particulier des reptiles. Darwin propose à Chloé de s'occuper de la ménagerie, de devenir son aide-gardienne de zoo, ce qui lui permettra de poursuivre ses recherches.
Tout se passe bien, non seulement Chloé finit par adorer les animaux qui l'avaient un peu surprise de prime abord, mais elle devient également très complice des enfants Darwin, Annie et William. Et puis, elle s'entend bien avec Darwin lui-même, qui apprécie que la jeune femme ne soit pas trop portée sur la religion, comme lui-même.
Un jour, lors d'un déjeuner où Darwin a convié plusieurs de ses collègues scientifiques, Chloé est témoin d'une conversation qui la frappe. Il est question d'un concours, organisé par une société d'étudiants d'Oxford, oisifs et provocateurs, dont le but est d'apporter la preuve de l'existence ou de la non-existence de Dieu, rien que ça. Avec à la clé, une récompense de 10 000£ à qui convaincra le jury.
Une telle somme serait la solution aux problèmes de Chloé, et plus encore de son père ! Or, Chloé sait que Darwin travaille sur une théorie qui a pour but de démontrer que les êtres vivants évoluent au fil du temps et qu'ils ne s'agit pas d'une création divine. Autrement dit, la théorie de Darwin pourrait tout à fait remporter le prix.
Mais, le scientifique ne veut surtout pas participer au concours. D'abord, parce qu'il juge que sa théorie doit encore être peaufinée, ensuite parce qu'il a promis à son épouse, très croyante, qu'elle ne serait publiée qu'après leur mort. Chloé est abattue, puis elle se reprend : puisque Darwin ne veut pas l'aider, alors, elle se débrouillera toute seule et remportera le prix !
Pour cela, elle a besoin de comprendre en quoi consiste la fameuse théorie de Darwin et trouver comment la démontrer. Elle met alors au point un projet fou : se rendre aux îles Galapagos et revenir avec des spécimens des mêmes espèces que celles que Darwin possède dans son zoo personnel, afin de montrer devant le jury du Grand concours de Dieu comment fonctionne l'évolution.
Mais, elle n'est pas la seule sur le coup. Une expédition a pris la mer pour les Galapagos avec une mission très clairement définie, parfaitement sordide, dont le but est d'empêcher, par tous les moyens, Chloé de pouvoir démontrer sa théorie. Et, pour la surveiller et éventuellement la dissuader, un prêtre est chargé de voyager aux côtés de la comédienne.
Et, en parallèle, une autre expédition menée par un jeune homme, fils du pasteur de la paroisse où vit Darwin, est également prête à s'élancer, mais dans une toute autre direction. Ces homme aussi participent au Grand concours de Dieu, mais entendent prouver l'existence de Dieu. Et, pour cela, elle entreprend des recherches pour découvrir les vestiges de l'Arche de Noé sur les pentes du mont Ararat...
Avant d'aller plus loin, il convient de resituer cette histoire dans son contexte historique : le roman débute en 1848, soit une dizaine d'années avant la publication du livre fondamental de Charles Darwin, "L'Origine des espèces". Le scientifique est encore alors complètement inconnu du grand public et, comme dit plus haut, il ne prévoit pas de publier son travail dans l'immédiat.
Et l'essentiel du roman va se dérouler avant 1859, année de publication de ce livre exposant une théorie révolutionnaire pour les uns, hérétique pour les autres. James Morrow joue d'ailleurs avec le contenu de cette théorie tout au long du livre, Chloé se confrontant à un texte qu'elle peine à comprendre, mais qu'elle ne cesse de potasser.
"L'Arche de Darwin" est donc un roman historique, qui nous plonge d'abord dans l'Angleterre du milieu du XIXe siècle, à une période où, dans toute l'Europe, des mouvements sociaux et politiques apparaissent, où les idées d'un autre personnage très important de cette époque, Karl Marx, commencent à émerger, où l'on dresse des barricades et remet l'ordre établi en question.
Comme il l'avait fait, par exemple, dans "le Dernier chasseur de sorcières", James Morrow joue avec ce contexte historique, y met son grain de sel et lui donne un aspect de conte philosophique, en accentuant le côté romanesque des choses. Ainsi, Chloé va vivre d'incroyables aventures dans son voyage jusqu'aux îles Galapagos, mais aussi une fois débarquée dans cet archipel.
C'est l'autre aspect très important de ce roman : on est dans un véritable roman d'aventures, plein de rebondissements, de surprises, d'événements forts et souvent dramatique, de retournements de situation et d'humour (souvent noir). Si vous trouvez que l'argument premier, démontrer la non-existence de Dieu à travers les écrits de Darwin, a l'air prise de tête, vous vous trompez carrément.
C'est captivant, enlevé, drôle, foutraque, bourré de clins d'oeil et de situations improbables, le tout porté par une galerie de personnages étonnante, au sein de laquelle Charles Darwin paraît d'un flegme tout à fait britannique. Un joueur invétéré, des marins avides, un ecclésiastique en proie au doute, une maquerelle complètement folle, des indiens d'Amazonie, un empereur fantoche et polygame, un pasteur interné, passionné de colombophilie et de peinture, et son fils accro au haschisch...
Si ce casting ne vous fait pas envie, je ne sais pas quoi vous dire de plus ! Mais si, ne vous inquiétez pas, j'ai encore quelques tours dans mon sac. Il y a, dans "L'Arche de Darwin", quelque chose d'un roman de Jules Verne. Chloé est une sorte de cousine de Philéas Fogg, elle aussi embarquée autour du monde, non pour battre un record, mais mener une quête semée d'embûches elle aussi.
C'est surtout un très beau personnage, parce qu'elle n'est pas monolithique : si elle ne va jamais perdre la détermination à sauver son père qui l'a poussée dans cette incroyable histoire, en revanche, au fil du voyage, on la voit osciller, hésiter, douter, se raccrocher à différentes choses, changer d'avis, évoluer (c'est le cas de le dire) de la foi à l'athéisme en passant par les étapes intermédiaires.
Cette quête, c'est aussi la sienne, une quête philosophique qui passe en revue nombre de postures que l'on rencontre couramment face à la question de l'existence de Dieu. Au départ, finalement, la réponse lui importe peu, ce qui compte, c'est de pouvoir réussir la démonstration la plus convaincante pour remporter les 10 000£.
Mais, au fil du voyage, des rencontres, de ses réflexions, des événements, elle ne peut s'empêcher de réfléchir elle aussi à tout cela, jusqu'à parfois se retrouver en porte-à-faux avec ce qu'elle entend démontrer. A l'image du bateau sur lequel elle va quitter l'Angleterre, elle change souvent de cap, contrairement à d'autres personnages, solidement ancrés dans leurs certitudes.
En cela, elle est un vrai personnage morrowien, si je puis dire, certainement pas une fanatique, mais quelqu'un qui pense, doute, se forge un avis en toute connaissance de cause, à l'écart des dogmes de tout poil. C'est aussi un personnage très touchant, charismatique, débrouillard, sachant mettre ses talents de comédienne au service de sa cause. Une héroïne bien plus puissante que celles qu'elle a incarnées dans ses romances tragiques...
Roman historique, roman d'aventures, conte philosophique à la Swift, roman d'amour, aussi, mais ce n'est pas tout. Le moment est venu d'évoquer une des dimensions les plus surprenantes de "L'Arche de Darwin", qui justifie d'ailleurs la remise d'un Grand Prix de l'Imaginaire à James Morrow, c'est la dimension fantastique.
Je ne vais pas la contextualiser, car il faut garder la surprise pour les lecteurs à venir, mais il se trouve qu'elle n'est pas juste là pour faire joli ou ajouter une touche spectaculaire supplémentaire. Non, elle a un but bien précis, qui est de rendre hommage à ceux, et plus encore celles qui, avec Darwin, ont permis à la science de franchir des étapes décisives pour expliquer le phénomène qu'est la vie.
James Morrow utilise le fantastique, car la plupart des personnalités qu'il fait intervenir dans son récit ont publié leur recherches ou ont tout simplement vécu après Charles Darwin : de Gregor Mendel, le père de la génétique, à Rosalind Franklin, sans laquelle Watson et Crick n'auraient pu découvrir la double hélice d'ADN, en passant par Pierre Teilhard de Chardin et son amie Lucile Swan...
Chose à la fois amusante et intéressante, parmi ces personnages dont le travail détruit le créationnisme en expliquant, étape par étape, l'évolution de l'être humain, deux sont des religieux : Gregor Mandel et Pierre Teilhard de Chardin (qui aura d'ailleurs bien des soucis avec sa hiérarchie au sein des Jésuites à cause de ses recherches).
"Que celui qui peut réfuter les preuves fossiles me lance le premier os", affirme d'ailleurs Teilhard de Chardin dans le roman, avec un humour qu'on ne lui connaissait pas tout à fait, phrase à laquelle fait écho une autre citation tirée du livre, savoureuse par son cynisme et symbolique de la malice de James Morrow, alors que son pays, l'Amérique, souffre de la montée de fanatismes chrétiens : "Un chrétien n'a rien à craindre des faits".
Ils ne sont pas les seuls à apparaître dans le roman, il ne faut pas oublier deux personnages qui ont joué un rôle très important dans le travail de Charles Darwin. Le premier, c'est Jean-Baptiste Lamarck, qui bien avant Darwin a élaboré une théorie de l'évolution ; on croise son nom de manière très amusante dans le roman.
Et le second, c'est Alfred Wallace, dont les recherches et les idées ont poussé Charles Darwin à publier ses travaux plus tôt qu'il ne le souhaitait. Lui, pour le coup, on le croise de manière tout à fait normale, enfin presque, dans le cours du récit, en pleine expérimentation. Tout cela incite le lecteur à se pencher non pas uniquement sur Darwin, mais sur la révolution scientifique entamée au XIXe siècle et poursuivie jusqu'à nos jours.
A chaque livre, James Morrow démontre un peu plus qu'on peut aborder des sujets sérieux sans se prendre au sérieux, que l'humour et l'ironie sont des armes de destruction massive d'idées reçues et de dogmatismes. Dans "En remorquant Jéhovah", il fallait empêcher l'enterrement de Dieu, au sens très concret du terme, ici, la rousseauiste Chloé Bathurst vent enterrer Dieu métaphoriquement.
Dans cette folle (et divine) comédie, Charles Darwin est un personnage fort et lui aussi très touchant. Plus que le scientifique, c'est l'homme que l'on découvre, et le père, également. Au milieu de cette folie générale suscitée par le concours, il fait figure de sage, avant tout concentré sur la science et son implacable beauté.
jeudi 23 août 2018
"Voltaire (...) a entendu dire que je suis un scientifique. Je lui réponds qu'il fait erreur. Je fais seulement l'inventaire des aliments que je consomme, je note leur goût et le plaisir qu'ils me procurent".
Il y a les lectures qu'on attend, les auteurs qu'on surveille, les séries auxquelles on essaye d'être fidèles, les livres dont on entend parler si souvent qu'on finit par s'y intéresser. Et puis, il y a les rencontres de hasard, au gré d'un rayon de librairie, des tables d'un salon du livre, un titre qui accroche, une quatrième qui intrigue... C'est le cas de notre roman du jour, acheté lors d'un salon après être tombé dessus sans s'y attendre. Achat compulsif, mea culpa ! "Le Dernier banquet", de Jonathan Grimwood (en poche au Livre de Poche), est un roman historique qui, par certains côtés, en rappelle un autre, beaucoup plus connu. C'est une histoire de goût, vous l'aurez compris avec la citation placée en titre de ce billet, dans un contexte historique particulier. Et le tout, porté par un personnage très spécial, certainement pas le plus sympathique qu'on puisse croiser, mais un passionné, en quête d'un idéal, d'un absolu... Attention, ceci n'est pas un guide gastronomique ou un recueil de recettes à réaliser pour votre prochain repas de famille. Mais c'est une existence extraordinaire, dédiée à la recherche du goût capable de faire chavirer les papilles comme jamais auparavant...
Jean-Marie n'a que 5 ans quand on le découvre dans la cour d'une maison menaçant ruine, adossé à un tas de fumier. Si la famille qui vivait là a pu être riche à une époque, force est de constater qu'elle est révolue. Dans la maison, les parents de l'enfant sont morts ; dans la cour, le marmot attrape les scarabées venu se nourrir dans le fumier... et les croque.
Combien de temps aurait-il survécu si un convoi n'était pas passé devant le portail de la demeure ? Nul ne le sait, pas même le croqueur de scarabées, qui ne se posait de toute façon pas la question, mais faisait des comparaisons gustatives après avoir mâché et avalé consciencieusement ses proies, pourtant peu appétissantes...
Dans ce convoi, le Régent en personne. Nous sommes en 1723, le futur Louis XV est encore trop jeune pour gouverner le royaume et c'est cet homme, Philippe d'Orléans, qui est à la tête du pays. A ses côtés, son aide de camp, le Vicomte d'Anvers, et l'un de ses fils illégitimes. Lorsqu'il découvre Jean-Marie sur son tas de fumier, ils interviennent.
Ce jour-là est une renaissance pour Jean-Marie d'Aumont, dernier membre de sa famille encore vivant, noble par la naissance, mais sans un sou en héritage. Une naissance qui n'est pas seulement sociale, puisque, sur l'ordre du Régent, on va s'occuper de lui et s'assurer qu'il pourra avoir une existence digne de son rang. Mais aussi une naissance gustative.
Oubliez les scarabées, même si pour lui, cela restera dans sa tête, pour nourrir le petit affamé, on lui sert un morceau de roquefort qui lui procure une espèce d'extase... Jean-Marie n'a donc que 5 ans, mais l'émotion ressenti lorsque le goût du fromage s'est diffusé lui a ouvert une voie qu'il ne cessera d'arpenter : la quête des goûts. La quête DU goût...
Emmené dans une école, où il va rencontrer celui qui va devenir son meilleur ami, un roturier, un bourgeois, fils d'avocat, Emile Duras, il va déjà, à sa manière, bien peu académique, entreprendre ses premières recherches. Dans la plus grande discrétion... Le gamin n'est pas très expansif, mais il a du caractère et du charisme, et il devient vite une petite terreur.
Les autres rencontres qui vont marquer sa vie, il les fera dans l'école militaire de Brienne-le-Château, qu'il va intégrer en compagnie d'Emile, une fois devenu adolescent. Charles et Jérôme sont eux issues de familles aristocratiques anciennes et installées et leur avenir est tout tracé vers d'importantes fonctions. Une différence sociale qui ne sera pas anodine dans la relation entre les garçons.
Avec des points négatifs, mais aussi d'autres plus positifs pour Jean-Marie. Car c'est ce qui va lui permettre d'oublier les revers de fortune passés et de pouvoir s'installer à son tour dans un domaine, quelque part dans le sud de la France, avec son épouse. Un domaine qu'il va rapidement entreprendre de modeler à sa convenance, ainsi que les alentours.
On est alors en plein Siècle des Lumières et, même s'il refuse le terme de scientifique, comme on le voit dans le titre du billet, il poursuit des recherches dans différents domaines, parfois les plus surprenants, avec une ambition tout de même : améliorer l'ordinaire, pas seulement le sien, il a de quoi se permettre tous les excès, mais celui du peuple, pour que cessent les disettes.
Un homme de bien, semble-t-il, préoccupé par le sort des plus modestes, ce qui est loin d'être le cas d'un Cour qui s'enferme de plus en plus à Versailles et un roi qui s'éloigne de plus en plus de ses sujets. Mais, au milieu de ses multiples activités, jamais Jean-Marie ne perd de vue son objectif premier, celle d'un goût idéal, inédit, incomparable...
J'ai choisi d'aller assez loin dans le récit, sans pour autant trop entrer dans les détails. Car chaque époque de la vie de Jean-Marie est développée dans le roman. On suit ce parcours très particulier, entre le jeune homme qui grandit et devient un adulte en charge d'une famille et d'affaires qu'on devine fructueuse, et le garçon obsédé par le goût, jusqu'à entreprendre les expériences les plus surprenantes.
Oh, bien sûr, au début, on peut mettre cette lubie sur le compte d'un gamin turbulent, marqué par les drames de sa tendre enfance, mais au fil des ans, rien ne change. Il ne s'occupe pas en permanence de cette passion, mais saisit chaque occasion de compléter ses connaissances et les nomenclatures qu'il rédige dans des cahiers.
Une quête complexe, car finalement, il n'a aucune idée a priori de ce qu'il cherche. De ce qui pourrait receler ce goût unique. Alors, il faut tenter, y compris là où le plus gourmand pourrait être rebuté. Pour Jean-Marie, toute nouveauté, même la plus étrange, est source d'excitation, car elle pourrait lui ouvrir de nouvelles portes... Mais souvent aussi de déceptions...
Il ne s'agit d'ailleurs pas tant du goût brut, mais aussi des meilleures manières d'accommoder un mets pour qu'il donne le maximum de sa puissance gustative. Tout est une question d'équilibre, d'assaisonnement, de cuisson et de mise en condition. Ce n'est peut-être pas de la science, mais la rigueur qu'il déploie, elle, l'est.
Je vous donne peut-être l'impression que "le Dernier banquet" est une succession de repas et de passages en cuisine, précisons que ce n'est pas le cas. Car, en dehors de cette activité très personnelle, une sorte de jardin secret que très peu, même parmi ses proches, connaissent, la vie de Jean-Marie d'Aumont va être mouvementée.
Il y a la vie de famille, avec un destin qui sait se montrer cruel, comme souvent. Et puis, il y a les relations, avec ses trois amis d'enfance, qui ont suivi des voies différentes, tout en restant liés. Mais, là encore, ces amitiés vont réserver à Jean-Marie quelques aléas qui vont donner à sa vie un tour fort romanesque.
"Le Dernier banquet" n'est peut-être pas à proprement parler un roman d'aventures, mais cette vie n'est pas un long fleuve tranquille et, à sa manière, Jean-Marie incarne parfaitement son époque, tumultueuse, bouillonnante, au cours de laquelle les idées se libèrent des carcans, les fondations de la société sont remises en cause et la politique n'est plus l'apanage du gouvernement.
Si ça ne tenait qu'à lui, il vivrait paisiblement avec les siens dans ce domaine où il a crée un monde qui lui appartient, où il peut mener ses recherches... Mais, l'autarcie ne pourra jamais être sociale, il faut faire avec les autres, et parfois à contre-coeur. Jusqu'à se retrouver dans des histoires insolubles et des situations impossibles.
Puisque tout est une question d'équilibre, la recette concoctée par Jonathan Grimwood est très agréable. Entre cette vie loin d'être morne, trop sans doute au goût de Jean-Marie quelquefois, et cette quête (dont on devine petit à petit vers quoi elle peut déboucher), on se laisse captiver, salivant parfois, grimaçant à d'autres moments, mais appréciant à chaque fois l'imagination de l'auteur.
Car les scarabées ne sont qu'une mise en bouche, si je puis dire... Par la suite, Jean-Marie va goûter des aliments que nous n'aimerions pas forcément les uns et les autres retrouver dans notre assiette, même lorsqu'on est un vilain carniste dans mon genre... Pour différentes raisons, d'ailleurs, mais à chaque fois, pourtant, la curiosité est titillée, et seule l'imagination peut alors agir (car imiter Jean-Marie n'est pas une bonne idée).
Je viens d'écrire deux fois le mot "imagination" dans les deux derniers paragraphes, et ce n'est pas forcément surprenant : quand on regarde la bibliographie de Jonathan Grimwood, on découvre qu'il est avant tout un auteur de science-fiction et de fantasy, pour lesquels il a d'ailleurs reçu quelques prestigieux prix, et que "le Dernier banquet" fait figure d'exception parmi ses publications.
Car il s'agit d'un pur roman historique, et même une peinture assez intéressante du XVIIIe siècle en France, avec, on s'en doute, l'échéance révolutionnaire au bout du chemin. Mais, il demeure dans cette histoire une bonne part d'imaginaire, malgré tout, jusque dans cette quête du goût parfait. Enfin, j'espère que ces expériences relèvent de la plus pure fiction !
Dans mon introduction, j'évoquais un autre roman, au succès mondial, sans doute aurez-vous deviné qu'il s'agit du "Parfum", de Patrick Süskind. Il y a un lien naturel qui se fait : les deux livres se déroulent au XVIIIe siècle, mettent en scène un personnage qu'on découvre sur des tas d'ordures et qui auront un destin exceptionnel, avec pour fil conducteur un sens particulier.
Chez Süskind, c'est l'odorat, chez Grimwood, le goût. Mais, c'est à peu près tout ce qu'on peut mettre en commun. Jean-Baptiste Grenouille est un criminel, ce que n'est pas Jean-Marie d'Aumont, il n'y a donc pas de dimension policière dans "le Dernier banquet", qui est plus le récit d'une vie bien remplie mais nettement plus aisée que celle du héros du "Parfum".
On pourrait poursuivre le parallèle, car je pense que cela peut-être amusant et pertinent, mais cela nous emmènerait un peu loin. Et puis, chez Grimwood, le personnage a plutôt un intérêt premier pour le monde animal que pour ses congénères humains. Sa solitude est choisie, contrairement à Grenouille, toujours marginalisé.
C'est vrai que Jean-Marie d'Aumont est un personnage qui ne suscitera pas forcément la sympathie. Ce sera peut-être même le contraire, car il émane de lui une certaine froideur, sauf lorsqu'il se mue en amant ardent, une certaine dureté, aussi. Curieusement, il y a chez lui un mélange d'égoïsme et d'altruisme un peu déstabilisant.
Tout ce qu'il fait semble tourné vers un accomplissement personnel, au point de provoquer pas mal de friction dans sa vie familiale. Oui, c'est ce coté solitaire qui donne sans doute cette impression. Pourtant, dans le même temps, il consacre son temps et ses ressources à améliorer les infrastructures de la région où se trouve son domaine, utilisant les lieux pour appliquer grandeur nature ses théories philosophiques et scientifiques.
C'est un mystère, ce personnage, j'ai du mal à le cerner. Je crois qu'il y a chez lui une forme de désenchantement que vient contrebalancer cette passion gustative qui seule, parvient à le captiver, à le pousser à agir, à continuer, malgré tout, malgré les malheurs, les ennuis, la lassitude... Malgré les échecs et les déceptions aussi. Mais il ne veut pas tirer sa révérence avant d'avoir atteint son but...
Sa vision du goût est passionnante, parce qu'elle n'est pas hédoniste ou épicurienne. Il ne s'agit pas simplement d'un plaisir de gourmet, mais bien d'un travail d'apprentissage et de formation d'un de nos sens. Il déplore d'ailleurs qu'on délaisse l'initiation au goût de la plupart des citoyens, de toutes les classes sociales, d'ailleurs.
Une position qui pourrait parfaitement trouver un écho de nos jours, où notre goût est clairement aseptisé, limité dans la palette de ce qu'il connaît par le sel, le sucre et autres exhausteurs de goûts et arômes artificiels... Connaissons-nous le goût véritable des choses ? Du lait, des fruits et légumes, du fromage ou de la charcuterie, par exemple ?
Pire, on évite les goûts trop forts, trop prononcés, parce qu'ils sont une sorte d'agression... Mais, c'est tout l'inverse ! Il est là, le véritable goût, et on devrait au contraire l'apprécier doublement. Encore faut-il pouvoir accéder à ces goûts, qui ne sont certainement pas ceux que nous offre l'industrie agro-alimentaire, refermons la parenthèse.
Ou pas... Car "le Dernier banquet" est un roman qui fait la part belle à la sensualité. Au plaisir des sens, de tous les sens, en fait. Et il faut saluer Jonathan Grimwood qui relève le défi de faire justement partager à ses lecteurs ce qu'il y a de plus difficile à faire sentir. Car on peut désormais facilement écouter une chanson ou regarder un tableau sur internet.
Mais les goûts, à l'instar des odeurs, sont des sensations difficilement définissables, très subjectives, et comme les mots ne suffisent pas, l'idéal serait d'expérimenter à son tour. Mais c'est loin d'être aussi facile que de retrouver une photo ou une vidéo sur internet. Sans compter, pour reprendre le point de départ du roman, qu'on n'a pas super envie de croquer un scarabée vivant... Hum...
J'imagine bien Jonathan Grimwood bichant au moment de rédiger certaines scènes, en se disant qu'il allait provoquer quelques onomatopées allant du "wouaaaah" au "beeeeurk", sans forcément toujours chercher à choquer. Non, il s'agit simplement de proposer de l'inhabituel au lecteur, de le placer face à l'inconnu, l'étrange... L'insaisissable.
Oui, Grimwood provoque, c'est certain, mais c'est fait avec une grande finesse, jusque dans la lucidité dont fait preuve Jean-Marie jusqu'aux derniers moments. Lucidité, mais aussi sérénité, parce qu'il sait, il sait qu'à cet instant, il est arrivé au bout de sa vie. Mais aussi que ce qu'il vit en ces derniers instants, marquent la fin de sa quête. Une boucle qui se boucle, écrit-il.
Jean-Marie n'a que 5 ans quand on le découvre dans la cour d'une maison menaçant ruine, adossé à un tas de fumier. Si la famille qui vivait là a pu être riche à une époque, force est de constater qu'elle est révolue. Dans la maison, les parents de l'enfant sont morts ; dans la cour, le marmot attrape les scarabées venu se nourrir dans le fumier... et les croque.
Combien de temps aurait-il survécu si un convoi n'était pas passé devant le portail de la demeure ? Nul ne le sait, pas même le croqueur de scarabées, qui ne se posait de toute façon pas la question, mais faisait des comparaisons gustatives après avoir mâché et avalé consciencieusement ses proies, pourtant peu appétissantes...
Dans ce convoi, le Régent en personne. Nous sommes en 1723, le futur Louis XV est encore trop jeune pour gouverner le royaume et c'est cet homme, Philippe d'Orléans, qui est à la tête du pays. A ses côtés, son aide de camp, le Vicomte d'Anvers, et l'un de ses fils illégitimes. Lorsqu'il découvre Jean-Marie sur son tas de fumier, ils interviennent.
Ce jour-là est une renaissance pour Jean-Marie d'Aumont, dernier membre de sa famille encore vivant, noble par la naissance, mais sans un sou en héritage. Une naissance qui n'est pas seulement sociale, puisque, sur l'ordre du Régent, on va s'occuper de lui et s'assurer qu'il pourra avoir une existence digne de son rang. Mais aussi une naissance gustative.
Oubliez les scarabées, même si pour lui, cela restera dans sa tête, pour nourrir le petit affamé, on lui sert un morceau de roquefort qui lui procure une espèce d'extase... Jean-Marie n'a donc que 5 ans, mais l'émotion ressenti lorsque le goût du fromage s'est diffusé lui a ouvert une voie qu'il ne cessera d'arpenter : la quête des goûts. La quête DU goût...
Emmené dans une école, où il va rencontrer celui qui va devenir son meilleur ami, un roturier, un bourgeois, fils d'avocat, Emile Duras, il va déjà, à sa manière, bien peu académique, entreprendre ses premières recherches. Dans la plus grande discrétion... Le gamin n'est pas très expansif, mais il a du caractère et du charisme, et il devient vite une petite terreur.
Les autres rencontres qui vont marquer sa vie, il les fera dans l'école militaire de Brienne-le-Château, qu'il va intégrer en compagnie d'Emile, une fois devenu adolescent. Charles et Jérôme sont eux issues de familles aristocratiques anciennes et installées et leur avenir est tout tracé vers d'importantes fonctions. Une différence sociale qui ne sera pas anodine dans la relation entre les garçons.
Avec des points négatifs, mais aussi d'autres plus positifs pour Jean-Marie. Car c'est ce qui va lui permettre d'oublier les revers de fortune passés et de pouvoir s'installer à son tour dans un domaine, quelque part dans le sud de la France, avec son épouse. Un domaine qu'il va rapidement entreprendre de modeler à sa convenance, ainsi que les alentours.
On est alors en plein Siècle des Lumières et, même s'il refuse le terme de scientifique, comme on le voit dans le titre du billet, il poursuit des recherches dans différents domaines, parfois les plus surprenants, avec une ambition tout de même : améliorer l'ordinaire, pas seulement le sien, il a de quoi se permettre tous les excès, mais celui du peuple, pour que cessent les disettes.
Un homme de bien, semble-t-il, préoccupé par le sort des plus modestes, ce qui est loin d'être le cas d'un Cour qui s'enferme de plus en plus à Versailles et un roi qui s'éloigne de plus en plus de ses sujets. Mais, au milieu de ses multiples activités, jamais Jean-Marie ne perd de vue son objectif premier, celle d'un goût idéal, inédit, incomparable...
J'ai choisi d'aller assez loin dans le récit, sans pour autant trop entrer dans les détails. Car chaque époque de la vie de Jean-Marie est développée dans le roman. On suit ce parcours très particulier, entre le jeune homme qui grandit et devient un adulte en charge d'une famille et d'affaires qu'on devine fructueuse, et le garçon obsédé par le goût, jusqu'à entreprendre les expériences les plus surprenantes.
Oh, bien sûr, au début, on peut mettre cette lubie sur le compte d'un gamin turbulent, marqué par les drames de sa tendre enfance, mais au fil des ans, rien ne change. Il ne s'occupe pas en permanence de cette passion, mais saisit chaque occasion de compléter ses connaissances et les nomenclatures qu'il rédige dans des cahiers.
Une quête complexe, car finalement, il n'a aucune idée a priori de ce qu'il cherche. De ce qui pourrait receler ce goût unique. Alors, il faut tenter, y compris là où le plus gourmand pourrait être rebuté. Pour Jean-Marie, toute nouveauté, même la plus étrange, est source d'excitation, car elle pourrait lui ouvrir de nouvelles portes... Mais souvent aussi de déceptions...
Il ne s'agit d'ailleurs pas tant du goût brut, mais aussi des meilleures manières d'accommoder un mets pour qu'il donne le maximum de sa puissance gustative. Tout est une question d'équilibre, d'assaisonnement, de cuisson et de mise en condition. Ce n'est peut-être pas de la science, mais la rigueur qu'il déploie, elle, l'est.
Je vous donne peut-être l'impression que "le Dernier banquet" est une succession de repas et de passages en cuisine, précisons que ce n'est pas le cas. Car, en dehors de cette activité très personnelle, une sorte de jardin secret que très peu, même parmi ses proches, connaissent, la vie de Jean-Marie d'Aumont va être mouvementée.
Il y a la vie de famille, avec un destin qui sait se montrer cruel, comme souvent. Et puis, il y a les relations, avec ses trois amis d'enfance, qui ont suivi des voies différentes, tout en restant liés. Mais, là encore, ces amitiés vont réserver à Jean-Marie quelques aléas qui vont donner à sa vie un tour fort romanesque.
"Le Dernier banquet" n'est peut-être pas à proprement parler un roman d'aventures, mais cette vie n'est pas un long fleuve tranquille et, à sa manière, Jean-Marie incarne parfaitement son époque, tumultueuse, bouillonnante, au cours de laquelle les idées se libèrent des carcans, les fondations de la société sont remises en cause et la politique n'est plus l'apanage du gouvernement.
Si ça ne tenait qu'à lui, il vivrait paisiblement avec les siens dans ce domaine où il a crée un monde qui lui appartient, où il peut mener ses recherches... Mais, l'autarcie ne pourra jamais être sociale, il faut faire avec les autres, et parfois à contre-coeur. Jusqu'à se retrouver dans des histoires insolubles et des situations impossibles.
Puisque tout est une question d'équilibre, la recette concoctée par Jonathan Grimwood est très agréable. Entre cette vie loin d'être morne, trop sans doute au goût de Jean-Marie quelquefois, et cette quête (dont on devine petit à petit vers quoi elle peut déboucher), on se laisse captiver, salivant parfois, grimaçant à d'autres moments, mais appréciant à chaque fois l'imagination de l'auteur.
Car les scarabées ne sont qu'une mise en bouche, si je puis dire... Par la suite, Jean-Marie va goûter des aliments que nous n'aimerions pas forcément les uns et les autres retrouver dans notre assiette, même lorsqu'on est un vilain carniste dans mon genre... Pour différentes raisons, d'ailleurs, mais à chaque fois, pourtant, la curiosité est titillée, et seule l'imagination peut alors agir (car imiter Jean-Marie n'est pas une bonne idée).
Je viens d'écrire deux fois le mot "imagination" dans les deux derniers paragraphes, et ce n'est pas forcément surprenant : quand on regarde la bibliographie de Jonathan Grimwood, on découvre qu'il est avant tout un auteur de science-fiction et de fantasy, pour lesquels il a d'ailleurs reçu quelques prestigieux prix, et que "le Dernier banquet" fait figure d'exception parmi ses publications.
Car il s'agit d'un pur roman historique, et même une peinture assez intéressante du XVIIIe siècle en France, avec, on s'en doute, l'échéance révolutionnaire au bout du chemin. Mais, il demeure dans cette histoire une bonne part d'imaginaire, malgré tout, jusque dans cette quête du goût parfait. Enfin, j'espère que ces expériences relèvent de la plus pure fiction !
Dans mon introduction, j'évoquais un autre roman, au succès mondial, sans doute aurez-vous deviné qu'il s'agit du "Parfum", de Patrick Süskind. Il y a un lien naturel qui se fait : les deux livres se déroulent au XVIIIe siècle, mettent en scène un personnage qu'on découvre sur des tas d'ordures et qui auront un destin exceptionnel, avec pour fil conducteur un sens particulier.
Chez Süskind, c'est l'odorat, chez Grimwood, le goût. Mais, c'est à peu près tout ce qu'on peut mettre en commun. Jean-Baptiste Grenouille est un criminel, ce que n'est pas Jean-Marie d'Aumont, il n'y a donc pas de dimension policière dans "le Dernier banquet", qui est plus le récit d'une vie bien remplie mais nettement plus aisée que celle du héros du "Parfum".
On pourrait poursuivre le parallèle, car je pense que cela peut-être amusant et pertinent, mais cela nous emmènerait un peu loin. Et puis, chez Grimwood, le personnage a plutôt un intérêt premier pour le monde animal que pour ses congénères humains. Sa solitude est choisie, contrairement à Grenouille, toujours marginalisé.
C'est vrai que Jean-Marie d'Aumont est un personnage qui ne suscitera pas forcément la sympathie. Ce sera peut-être même le contraire, car il émane de lui une certaine froideur, sauf lorsqu'il se mue en amant ardent, une certaine dureté, aussi. Curieusement, il y a chez lui un mélange d'égoïsme et d'altruisme un peu déstabilisant.
Tout ce qu'il fait semble tourné vers un accomplissement personnel, au point de provoquer pas mal de friction dans sa vie familiale. Oui, c'est ce coté solitaire qui donne sans doute cette impression. Pourtant, dans le même temps, il consacre son temps et ses ressources à améliorer les infrastructures de la région où se trouve son domaine, utilisant les lieux pour appliquer grandeur nature ses théories philosophiques et scientifiques.
C'est un mystère, ce personnage, j'ai du mal à le cerner. Je crois qu'il y a chez lui une forme de désenchantement que vient contrebalancer cette passion gustative qui seule, parvient à le captiver, à le pousser à agir, à continuer, malgré tout, malgré les malheurs, les ennuis, la lassitude... Malgré les échecs et les déceptions aussi. Mais il ne veut pas tirer sa révérence avant d'avoir atteint son but...
Sa vision du goût est passionnante, parce qu'elle n'est pas hédoniste ou épicurienne. Il ne s'agit pas simplement d'un plaisir de gourmet, mais bien d'un travail d'apprentissage et de formation d'un de nos sens. Il déplore d'ailleurs qu'on délaisse l'initiation au goût de la plupart des citoyens, de toutes les classes sociales, d'ailleurs.
Une position qui pourrait parfaitement trouver un écho de nos jours, où notre goût est clairement aseptisé, limité dans la palette de ce qu'il connaît par le sel, le sucre et autres exhausteurs de goûts et arômes artificiels... Connaissons-nous le goût véritable des choses ? Du lait, des fruits et légumes, du fromage ou de la charcuterie, par exemple ?
Pire, on évite les goûts trop forts, trop prononcés, parce qu'ils sont une sorte d'agression... Mais, c'est tout l'inverse ! Il est là, le véritable goût, et on devrait au contraire l'apprécier doublement. Encore faut-il pouvoir accéder à ces goûts, qui ne sont certainement pas ceux que nous offre l'industrie agro-alimentaire, refermons la parenthèse.
Ou pas... Car "le Dernier banquet" est un roman qui fait la part belle à la sensualité. Au plaisir des sens, de tous les sens, en fait. Et il faut saluer Jonathan Grimwood qui relève le défi de faire justement partager à ses lecteurs ce qu'il y a de plus difficile à faire sentir. Car on peut désormais facilement écouter une chanson ou regarder un tableau sur internet.
Mais les goûts, à l'instar des odeurs, sont des sensations difficilement définissables, très subjectives, et comme les mots ne suffisent pas, l'idéal serait d'expérimenter à son tour. Mais c'est loin d'être aussi facile que de retrouver une photo ou une vidéo sur internet. Sans compter, pour reprendre le point de départ du roman, qu'on n'a pas super envie de croquer un scarabée vivant... Hum...
J'imagine bien Jonathan Grimwood bichant au moment de rédiger certaines scènes, en se disant qu'il allait provoquer quelques onomatopées allant du "wouaaaah" au "beeeeurk", sans forcément toujours chercher à choquer. Non, il s'agit simplement de proposer de l'inhabituel au lecteur, de le placer face à l'inconnu, l'étrange... L'insaisissable.
Oui, Grimwood provoque, c'est certain, mais c'est fait avec une grande finesse, jusque dans la lucidité dont fait preuve Jean-Marie jusqu'aux derniers moments. Lucidité, mais aussi sérénité, parce qu'il sait, il sait qu'à cet instant, il est arrivé au bout de sa vie. Mais aussi que ce qu'il vit en ces derniers instants, marquent la fin de sa quête. Une boucle qui se boucle, écrit-il.
Inscription à :
Articles (Atom)