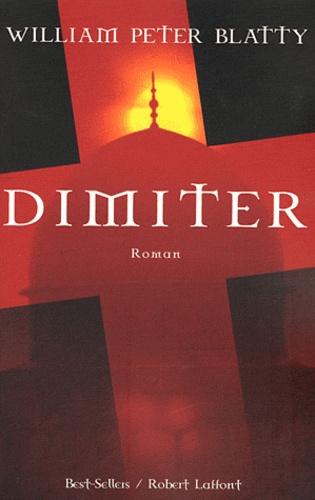Ce pavé de 660 pages se déroule dans un pays inconnu (sans doute en Amérique Latine, si l'on se fie à quelques indices), en des temps inconnus mais incontestablement modernes, dans un régime politique que l'on découvre d'emblée et qui va nous accompagner jusqu'au bout : "Notre oncle" a pour cadre une dictature militaire de la pire espèce, où l'armée a les coudées franches pour réduire au silence tout opposant présumé, où l'arbitraire règne en maître, mais où une opposition s'organise et vient mettre un grain de sable dans la belle mécanique totalitaire en place.
Le major Anthony est l'un des rouages de cette belle mécanique. Son boulot, c'est justement de débarquer chez les opposants présumés, de les arrêter, par la force, si nécessaire, et de remettre ces prisonniers à d'autres militaires qui sauront au mieux, remettre ces victimes désignées au pas, ou, au pire, les empêcher de nuire. Définitivement.
Un soir, alors qu'il doit arrêter un couple en pleine nuit, l'intervention tourne au drame. Un jeune soldat du détachement commandé par le major Anthony, commet une bavure. Avant même d'avoir été mis aux fers et soumis à la torture, ces opposants présumés sont exécutés pour un geste mal interprété...
Du souci en perspective pour le major, qui aime le travail bien fait et pas cette intervention bâclé par inexpérience... Pire, en fouillant la maison, Anthony découvre la fillette du couple qui vient d'être tué. Elle était dans sa chambre mais elle est sans doute trop jeune pour avoir bien compris ce qui se tramait sous son toit.
Dilemme pour le major. Lui qui est du genre à appliquer les règles à la lettre, service, service, le voilà déchiré par un sentiment violent... Normalement, il devrait faire subir à la gamine le même sort qu'à ses parents. Dégât collatéral. Mais voilà, le major a aussi une vie privée. Et son mariage avec la plantureuse Paloma va mal. Pour une raison simple : Anthony est stérile et n'a donc pas pu donné à son épouse l'enfant qu'elle désirerait tant avoir.
Et voilà un enfant désormais sans parent qui se trouve juste là, devant lui... La tentation est grande de soustraire l'enfant à l'autorité et de se l'approprier, purement et simplement. Et comme la gamine n'était pas prévue au programme, voilà qui facilite les choses. Anthony "adopte" donc la fillette, Lina.
Lorsqu'il la ramène au foyer conjugal, Anthony se dit qu'il a réussi le coup du siècle et que son couple est sauvé. Lui qui jusque-là n'a comme unique fierté la piscine minable qu'il est parvenue à faire creuser dans son jardin, il est sûr que cette fois, une vraie vie de famille l'attend.
Mais c'est sans compter la réaction des deux autres intéressées : Lina se languit de ses parents et veut rentrer chez elle ; Paloma, elle, voudrait surtout connaître les joies biologiques de la maternité (grossesse, accouchement, etc.). Résultat des courses, Anthony a enfreint ses sacro-saintes règles pour rien, pris le risque de gâcher sa carrière pour une femme neurasthénique et une fillette quasi muette...
Tant bien que mal, il va essayer de cimenter cette nouvelle famille, mais c'est lui qui va la faire définitivement exploser quand il va devoir quitter son foyer pour partir au front. Car une partie du pays est tenue par un mouvement de résistance qui semble donner plus que du fil à retordre à l'armée chargée de faire régner sur l'ensemble du territoire sa main de fer (et sans gant de velours).
Pour avoir trop souvent dit comment il voyait la stratégie à appliquer sur le terrain, Anthony, plus bureaucrate zélé que militaire d'élite, va se voir confier par son supérieurs hiérarchique (et, accessoirement, amant de sa femme) une mission qui devrait, en principe, l'éloigner de sa famille pour une quinzaine de jours maximum.
Mais rien ne se déroule jamais comme prévu et la famille reconstituée du major Anthony va voler en éclats, incapable de résister à son absence. Après cette séparation, nous allons donc suivre le chemin séparé de ces trois personnages, Anthony, Paloma et Lina, en route vers leurs inéluctables destins (que je vous laisse le soin de découvrir plus en détails).
Grunberg se lance dans ce genre si spécial de la saga familial, ce genre qui nous raconte les vies de personnages romanesques que l'on voit traverser les vicissitudes de l'existence. Là, le traitement est un peu... différent. Pour y avoir des vicissitudes, il y en a, c'est certain, de la première à la dernière page. Ce qui change, ce sont les personnages eux-mêmes et leur conception de l'existence (à moi que ce soit justement l'existence elle-même qui ait fait d'eux ce qu'ils sont...).
En mettant en scène des personnages désenchantés, sans avenir, espoir ou sentiment, Grunberg étale son profond pessimisme à propos de l'espèce humaine, sur fond de totalitarisme qui s'affrontent. Dans aucun des lieux où vont les personnages, on ne trouve autre chose que froideur, fatalisme et manque d'ambition. Partout, un absent de marque : l'amour. Toute cette société, du côté du pouvoir en place comme du côté de ceux qui s'y opposent, la même carence affective.
Le major est un soldat obtus, arc-bouté sur des principes et des valeurs démentis chaque jour par les faits. Lui qui se rêvait en Napoléon dans sa jeunesse n'est qu'un minable exécutant qui s'en prend à des personnes désarmés et abat sur eux le bras d'une justice d'autant plus aveugle qu'elle n'a rien de juste. L'idée même de liberté donne des boutons à ce brave homme, simple participant à la grande machine liberticide. Construit sur des principes, il estime que la liberté abolit tout repère, ce qui la rend dangereuse, et que la seule liberté qui vaille, c'est la guerre, qu'il ne connaîtra enfin de près que pour son malheur.
Paloma rêve de strass, de paillettes et de célébrité. Ses modèles sont en photo dans les magazines de mode et people. Son principal atout, elle en est certaine, c'est son sex-appeal. Le mariage devait en faire une femme grâce à la maternité, mais la voilà enchaîné à son médiocre et stérile mari pour le pire sans qu'il ne puisse y avoir de meilleur. Son seul espoir, cet amant fertile qui lui promet de l'engrosser dès que la guerre aura pris fin... Sauf que la fin de la guerre est loin d'être proche, si j'ose dire....
Lina, enfin, est née dans une famille qu'on suppose heureuse, jusqu'au jour où la bêtise d'un soldat inexpérimenté va la faire basculer. Privée de la seule famille qu'elle aurait jamais dû avoir, la gamine va se renfermer sur elle même, se construire sans cet amour familial aussi indispensable à l'être humain pour se développer que la lumière pour les plantes. D'abord en quête de ses parents (dont elle ignore toujours le sort funeste), elle va ensuite péniblement se chercher un talent à mettre en valeur pour devenir quelqu'un et ensuite, un idéal, ambition qui lui a toujours fait défaut. Mais, lorsqu'enfin, elle aura trouvé sa voie, une nouvelle fois, la Fortune, la Providence, la Destinée, quel que soit le nom qu'on lui donne, réduira ses efforts à néant.
Tous subissent les évènements qui se produise. Seul celui qu'on appelle le chef d'orchestre, dernière rencontre-clef dans la vie de Lina (et dans le roman itou), semble vouloir contrôler cela. Seule autorité visible du livre, puisque jamais on ne voit les dirigeants de la dictature, rien que des sous-fifres, il est le moteur de la révolution en marche chargée de renverser le pouvoir totalitaire. Mais, on le soupçonne de vouloir remplacer le pouvoir déboulonné en en instaurant à terme un autre, tout aussi autoritaire et fondé sur la haine. Car, le chef d'orchestre ne déteste pas que le péché, mais aussi les pécheurs, nous rappelle Grunberg. Une idéologie qui nourrit constamment sa paranoïa au point de voir des espions partout...
Mais, comme toutes les figures autoritaires rencontrées au long du roman, le chef d'orchestre n'est qu'un mythe. Les autres autorités sont des mythes, car abstraites, lui est un mythe car tout ce qu'il représente n'est qu'illusion, du flanc.
Et Lina doit se construire, depuis la mort de ses parents, jusqu'à sa rencontre tronquée avec le chef d'orchestre, dans cette absence d'autorité, qui ne peut mener qu'à la désillusion, au désespoir... à l'indifférence, au détachement total de cette vie dont elle a été expulsée.
Voilà comment on en arrive au point final de ce long exposé : l'explication (succincte) du titre, "notre oncle". Cet "oncle", on le rencontre à plusieurs reprises dans le livre. Et à chaque fois, il désigne les figures tutélaires censées présider à l'existence des personnages. Etat, terre ou dieu, notre oncle est partout sans jamais être là, symbole très puissant de l'autre grand absent du livre : le père.
Pas de père, juste des oncles, et des oncles fantoches, hypothétiques, désincarnés, désintéressés.
Alors, oui, "Notre oncle" est un roman sombre et pessimiste. Mais le regard de Grunberg sur la vacuité de l'existence est frappant, violemment intéressant. Sans malheur, le bonheur est impossible. Mais, ce bonheur, autre mythe pour nos personnages, est d'abord individuel quand tous ceux qui le recherchent le rêvent collectif.
Reste donc à la pauvre Lina, condamnée par la vie à la solitude, à s'accomplir dans ce qui a brisé définitivement les minces espoirs de ses parents (biologiques comme "adoptifs") : la mort.
La mort que l'on donne autant que celle qu'on attend.