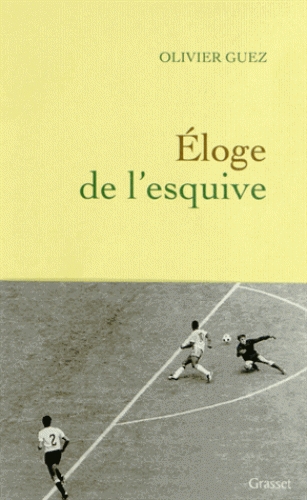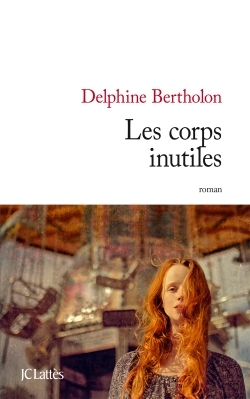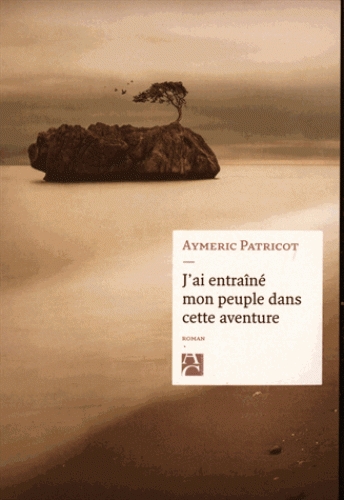Georges n'aspire qu'à une chose : goûter une retraite bien méritée. D'ailleurs, il sait déjà ce qu'il va faire : après 15 ans passés à l'étranger, il veut s'installer dans les Landes et ouvrir un camping, peinard. Un endroit où on oublierait qu'il s'appelle Clounet, Georges Clounet... Si ses parents avaient pu savoir... Bref.
Pour mener à bien son projet, Georges a besoin de récupérer l'argent qu'il a mis de côté. Enfin, plus exactement, qu'il a confié à son beau-frère, Régis, conseiller patrimonial dans une boîte monégasque... et gros naze, spécialiste des investisseurs foireux dévoreurs d'économies. Surtout celle des autres, même quand l'autre en question est le frère de sa tendre épouse...
Adieu veaux, vaches, cochons, couvée, camping dans les Landes... Le pécule de Georges a joué les peaux de chagrin et il ne lui reste plus guère que des parts dans une boîte de nuit minables sur les hauteurs de Cagnes-sur-Mer, plus exactement sur le territoire de la commune de Cinjus-Tésauris (où se déroulaient déjà les précédents romans de l'auteur).
Cette boîte, c'est "le Kif" et, par un malencontreux concours de circonstances, à moins que ce ne soit suite à une fusillade, Georges se retrouve à la tête de l'établissement, lui qui n'y connaît rien en la matière. En revanche, il connaît un peu la faune nocturne qui fréquente ce genre d'endroit et il n'a pas du tout envie de frayer avec elle.
Alors, il a bien l'intention, puisque tel est son destin, de redonner un peu de lustre et de respectabilité à l'endroit avant de récupérer ses billes et quelques autres et filer droit dans les Landes. Le hic, c'est qu'il a un peu sous-estimé la tâche qui l'attend. Tant dans la gestion de la boîte que dans son envie de récupérer une partie de ses économies qui a fondu comme neige au soleil du Golfe Persique...
Pendant ce temps, dans un palace de la Riviera, un milliardaire se prélasse, s'adonnant à ses deux activités préférées, l'argent et le sexe. Il s'appelle Ben Laden (mais prononcez Bineladan, s'il vous plaît, on a sa dignité) et il est le bâtard d'un des frères d'Oussama. Mais, son modèle dans l'existence, ce n'est pas son célèbre oncle, bien au contraire, mais... DSK. Pour ses frasques, pas sa carrière.
Steeve (avec deux e !!), lui, est un minable qui se prend pour un caïd. Une petite frappe qui vit chez sa mère, la pôôôôvre, et gagne sa vie en petits trafics, production de spectacles de striptease bas de gamme et en prostitution. Et, dans le cadre du développement horizontal de sa petite entreprise, qui n'échappe pas toujours à la crise, "le Kif" serait un bel atout.
Patrick lui aussi, aimerait bien en croquer, du "Kif". A force d'assurer la sécurité du lieu, on en devient ambitieux et on se verrait bien le diriger de A à Z... Intéressé aussi, le capitaine Trillard. La PJ, ça ne nourrit pas si bien son homme, alors qu'une petite part prélevée sur les trafics en tous genres qui pourraient s'effectuer au "Kif"...
Anne-Dominique Sauvin, elle, est élue municipale à Cinjus-Tésauris, sous les couleurs du Front National. Plus exactement, du Rassemblement Bleu Marine. Une élue engagée plus par opportunisme que réelle conviction, mais comme l'extrême-droite a le vent en poupe, alors, elle espère en tirer profit pour nourrir une ambition sans borne. Et ce, malgré quelques petits secrets inavouables.
Djamila travaille au "Kif" la nuit, mais elle bosse aussi comme toiletteuse dans le salon de Gisèle, la soeur de Georges. Deux emplois, c'est ce qu'il faut quand on est mère célibataire et qu'on a un passé d'actrice X. La beauté de la jeune femme, qui n'est pas sans rappeler Amy Winehouse, ne passe guère inaperçue, même aux yeux de ce grand blasé de Georges.
Kevin a rencontré Allah en prison. Depuis sa sortie de centrale, pas l'école, il porte la barbe, la djellaba, se fait appeler Kader et travaille même dans un abattoir où il pratique l'abattage rituel avec Moktar, son ombre. Il prêche un Islam radical, sans concession et se verrait bien convertir la région de gré ou de force. Et il a surtout une idée en tête qu'il compte bien mettre en oeuvre rapidement...
Enfin, il y a Hassan. Garçon plein de mystères, on dit que c'est un ancien djihadiste. Les rumeurs de ce genre courent à une vitesse, c'est fou ! Pourtant, les raisons de sa présence sur la Côte d'Azur reste flou et il en a bien vite marre d'être le colocataire de Kevin-Kader. Alors, il explore diverses façons de s'émanciper de ce fou furieux...
Voilà les acteurs de ce roman, sans ordre particulier, si ce n'est évidemment, que tout tourne autour du Kif et donc, par ricochet, de Georges, débarqué bien malgré lui dans un panier de crabes avec autant de facettes que la boule qui tourne au plafond de la boîte. Le malheureux Clounet va devoir entrer dans une folle sarabande qui a pour centre le dernier élément de cette histoire :
Un million d'euros !
Laurent Chalumeau se moque de tout et de tous. Chacun en prend pour son grade et la galerie de portraits est croquignolesque. Mais surtout, depuis cette boîte ringarde, part un incroyable tourbillon qui mêle radicalisme religieux, extrémisme politique, ambitions diverses et variées et par-dessus tout, une cupidité taille XXXL.
Jouant de la caricature avec talent et drôlerie, il signe une espèce de vaudeville délirant où tous ces personnages sont interconnectés, parfois de façon surprenante. Et, comme le dit le titre de ce billet, phrase qui revient souvent dans le livre, "t'a des fois t'es le pare-brise. Puis d'autres, t'es l'insecte". Dit autrement : ça va, ça vient.
Chacun, Georges compris, va avoir des moments où il pensera avoir les choses en main avant qu'elles lui échappent et qu'il se retrouve largué, perdu. Il faut dire qu'on a là une splendide collection de losers, pas toujours magnifiques, et d'ambitieux qui n'ont pas toujours les moyens pour en faire une réalité.
En jouant avec les peurs actuelles pour mieux s'en moquer, qu'il s'agisse du terrorisme et de son financement, de l'immigration, des extrémistes religieux comme politiques, Laurent Chalumeau mène la danse et ridiculise tout le monde. Pas vraiment de gentil, dans cette histoire, en tout cas pas au sens de "jeunes premiers" qu'on peut donner à ce terme.
Quant aux méchants, ce sont quand même plus des bras cassés que des terreurs, ce qui ne veut pas dire qu'il n'ont pas un pouvoir de nuisance certain. Entre roman noir et western, "Kif" reprend pas mal d'ingrédients déjà croisés dans "Maurice le siffleur" ou "les arnaqueurs aussi", avec quelques variantes, en particulier, l'irruption du religieux et de l'extrême-droite, ouvertement désignés.
Avec son côté saltimbanque et déconneur, Laurent Chalumeau gratte où ça fait mal. L'argent, le pouvoir, le sexe, l'envie, sont les maux qui rongent notre société et les réponses qu'on essaye d'y apporter prennent des formes qui peuvent aller de l'opportunisme politique à la radicalité religieuse, sans oublier une délinquance plus classique.
Les archétypes sont là, servis par un style et un sens de la formule qui, personnellement, me font beaucoup rire. Je me suis bidonné tout au long de cette lecture, malgré le trait grossi fortement. Ca fuse dans tous les sens et personnages nous transmettent le tournis qui est le leur, au fur et à mesure des rebondissements et des changements de cap.
Car bien sûr, chacun a son plan et rien ne se passe comme prévu, malgré les situations les plus absurdes et les plus délirantes qui on été envisagées. A chaque engrenage, son grain de sable, son imprévu, même minuscule, qui vient tout remettre en cause. Et la méfiance de chacun, car, évidemment, les alliances ne sont bien souvent que de circonstances et les trahisons jamais bien loin.
Et puis, il y a Georges. Un grain de sable à lui tout seul. Le moteur d'une partie des événements qui se déroulent à partir du moment où il pose le pied sur la Côte d'Azur. C'est un gars cool, le Georges Clounet, le genre débonnaire. Mais, faut pas le chercher trop longtemps non plus, parce qu'il sait avoir du répondant.
Eh oui, lui aussi a ses petits secrets, bien gardés. Et celui que les autres prennent pour un papy n'a en fait pas vraiment le profil du directeur de camping qu'il rêve d'être. Chassez le naturel, l'expérience revient au galop et ce ne sont pas des petits enquiquineurs à deux euros qui vont venir lui marcher sur les arpions. "Le Kif", il s'en fout un peu, mais on a ses principes.
Il y a chez Georges pas mal de traits qu'on voyait déjà chez Armand et son double, Maurice, dans "Maurice le siffleur". Avec toutefois, une nuance de taille ici : Georges ne maîtrise absolument rien et lui, comme les autres, essuie des échecs à répétition dès qu'il entreprend quelque chose. Lui aussi a des idées derrière la tête et, même s'il est sûrement mieux intentionné que beaucoup d'autres, lui aussi est humain et a des failles.
Je le redis, je me suis énormément amusé à lire ce jeu de chat et de souris où chaque personnage occupe ces rôles alternativement, où on se demande si quelqu'un va véritablement tirer son épingle du jeu ou si tout le monde ne va pas se retrouver le bec dans l'eau, avec juste ses yeux pour pleurer. Ni moraliste, ni moralisateur, Chalumeau n'est qu'un grand gamin ricanant qui joue avec des poupées. Vaudous, les poupées.
"Kif", c'est le genre de roman qui fera ricaner aussi les sales gosses dans mon genre, prompts à se moquer pour ne pas pleurer, mais qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Trop ceci, pas assez cela, chacun selon sa sensibilité réagira à cette histoire. Je suis client de cet auteur, de se verve, de sa gouaille, et je suis le genre de lecteur qui peut l'encourager à pousser le bouchon chaque fois un peu plus loin. Parce que plus c'est gros et plus je me marre.
De la même façon, l'écriture de Laurent Chalumeau ne conviendra pas à tous les lecteurs. Nez pince et bouche en cul de poule, abstenez-vous. Ici, on appelle un chat, un chat, le vocabulaire est choisi mais pas forcément ciselé dans du cristal de Baccarat. Je fais partie des lecteurs qui voient un lui un héritier d'Audiard, et les dialogues de "Kif" sont croustillants.
Je l'ai dit au début, j'ai lu ce livre alors que l'ambiance était pour le moins lourde. Certains aspects de "Kif" touchent indirectement aux drames de ce début janvier 2015. Et il faut être reconnaissant à Laurent Chalumeau de nous aider à dédramatiser les situations pas roses du quotidien et par son ironie goguenarde, de ridiculiser tous les tristes sires.
Ah oui, j'allais oublier... Le pare-brise, l'insecte, Dire Straits, tout ça...