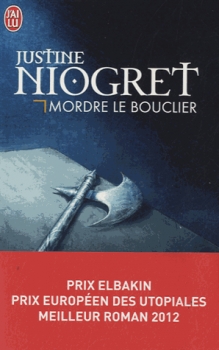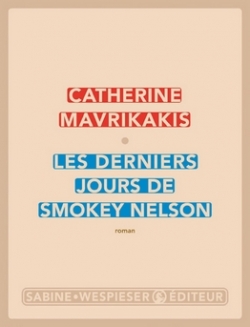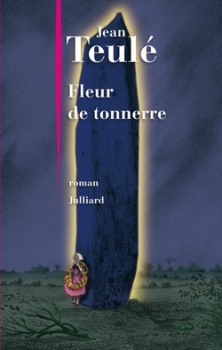
Hélène Jégado est une petite fille charmante, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, comme on dit. Elle grandit, en ce début de XIXème siècle, dans une vieille famille de la petite aristocratie terrienne de Bretagne, dans un hameau morbihannais joliment nommé Kerhordevin en Plouhinec. A 7 ans, sans être turbulente, Hélène est une gamine pleine de curiosité, attirée par toutes ces fleurs qui poussent sur la lande aux beaux jours.
Une curiosité que se doit de réfréner Anne, la maman de la blondinette, qui sait que la beauté d'une plante peut cacher quelques dangers, dont elle tient à informer sa fille. Il serait dommage de la donzelle s'empoisonnât accidentellement en mangeant une baie séduisant ou en se piquant à une tige sournoise... C'est à cause de ces cavalcades en pleine lande et de sa curiosité botanique que Hélène va hériter de ce surnom de "Fleur de Tonnerre".
Mais, Anne Jégado n'est pas seulement une fine connaisseuse en matière de plantes et d'effets secondaires... Cette femme pleine de bon sens est aussi une grande superstitieuse et, comme elle met en garde sa fille contre ces si jolies fleurs, elle lui énonce à l'envi et selon les circonstances, tout un tas de croyances locales qu'il convient d'appliquer au quotidien si l'on ne veut pas, le plus souvent, qu'il nous arrive malheur...
Une superstition qui atteint son point culminant le soir, à la veillée, lorsque Anne raconte les histoires merveilleuses et horrifiantes qui courent la lande, pleine de créatures fantastiques, korrigans, gnomes, poulpiquets, lutins et surtout le terrible Ankou... Dans ce petit coins de Bretagne où vivent d'irréductibles Bretons, on ne prend pas ces choses-là à la légère, oh que non !
Voilà les mamelles d'où est sorti le lait (métaphorique) dont a été nourrie la petite Hélène Jégado dans son enfance. Allez savoir comment ce mélange de flore et de faune locales s'est fait dans le petit cerveau en construction d'Hélène, mais, très jeune, vers 7-8 ans, elle va manifester certains signes assez inquiétants, dont un recours aux baies de belladone, particulièrement toxiques, qui n'est pas le moindre...
Mais, la gamine manque encore de savoir-faire et ce sont encore une fois les conseils prodigués par l'autorité maternelle qui vont permettre à Hélène de se lancer dans une incroyable carrière qui va durer plus de 40 ans : Hélène Jégado va empoisonner son monde ! Euh, empoisonner au sens strict du terme, attention ! Elle va devenir une incroyable meurtrière en série, laissant, partout où elle va passer, une innombrable collection de cadavres...
La belladone, elle l'utilisera à ses débuts, mais, là encore, profitant d'une heureuse opportunité, la présence de rongeurs nuisibles dans la demeure d'un de ses premiers maîtres, elle va rapidement découvrir une substance qui va lui donner, et pour longtemps, entière satisfaction : l'arsenic. Ce qu'elle appelle, en bonne bretonne bretonnante n'ayant appris que très tardivement à baragouiner le français, "la reusenic'h", terme qui m'a bien amusé, au point de l'utiliser dans le titre de ce billet...
Bon, je ne vais pas tout vous raconter, même si "Fleur de tonnerre" n'est pas à proprement parler un roman à suspense, il recèle tout de même quelques surprises que le lecteur se doit de découvrir par lui-même pour goûter tout le sel (non, pas un sel d'arsenic, cette fois...) du roman. Toutefois, il convient de vous expliquer comment Hélène Jégado a pu sévir aussi longtemps sans qu'on l'arrête...
En fait, quittant très tôt la demeure familiale, la jeune Hélène, tout juste adolescente, analphabète et presque complètement inculte, va aller travailler comme cuisinière, une passion qu'elle s'est découverte, pour laquelle elle manifeste un réel talent, mais qui a surtout l'avantage de lui offrir un moyen efficace et discret d'accomplir la tâche qu'elle s'est fixée : faire passer de vie à trépas le plus possible de ses contemporains...
Elle va d'abord travailler dans des presbytères, comme ses tantes, puis, devant, par la force des choses, régulièrement trouver de nouveaux employeurs, elle va arpenter la Basse-Bretagne du sud au nord, et du nord au sud, sur 3 départements... A chaque fois qu'elle pose son maigre bagage, un simple bissac, quelque part, ça tombe comme à Gravelotte, si vous m'autorisez cet anachronisme... Après les presbytères, il y aura des maisons de maîtres, des demeures bourgeoises, un bordel militaire sordide...
Et le plus surprenant dans tout ça, c'est qu'on ne la soupçonne jamais directement... Elle a beau survivre à l'éradication en quelques jours d'une famille toute entière, par exemple, on se dit que c'est la faute à une quelconque épidémie, comme il en sévissait tant dans les campagnes bretonnes en ces époques morbides. Et, lorsque les regards se portent sur elle, ce n'est pas pour l'accuser d'un quelconque forfait pénalement répréhensible, mais parce qu'on pense qu'elle a le mauvais oeil !
Eh oui, longtemps, Hélène Jégado, alias Fleur de tonnerre, va sévir dans des villages où cohabitent plus ou moins harmonieusement croyances locales et religion catholique, ce qui laisse de côté tout regard raisonnable pouvant envisager qu'une aussi ravissante jeune femme, si bonne cuisinière, de surcroît, puisse en réalité être un assassin sans scrupule et bénéficiant d'une chance assez incroyable...
Une seule fois le temps se gâtera sévèrement pour Fleur de tonnerre. On n'a pas la réputation d'avoir le mauvais oeil sans conséquence, dans un pays si pétri de superstitions en tous genres... Aussi, Hélène, folle à lier mais loin d'être bête, va sentir qu'il est temps pour elle de se mettre au vert, là où on la laissera agir à sa guise... Dans un couvent, par exemple. Ce sera le seul véritable accroc de sa "carrière", car on lui confiera des tâches ménagères, mais jamais la Mère Supérieure n'acceptera qu'elle cuisine... Frustrée, Hélène finira chassée de ce havre de paix, non sans y avoir sévi, auparavant, y montrant l'ampleur de sa folie... de manière particulièrement loufoque.
Loufoque comme son incroyable procès, à la fin de l'année 1851 qui, chose incroyable, fera passer complètement au second plan dans toute la Bretagne le coup d'Etat de Louis-Napoléon Bonaparte, qui a pourtant conduit la France au bord de la guerre civile ! Une véritable et savoureuse vengeance pour l'empoisonneuse, qui n'a jamais digéré le fait que Napoléon, l'autre, le Premier, ait été accusé d'avoir causé la mort de près de 2 millions de personnes...
Hélène n'a beau savoir ni qui est ce "Léon Napo", dont tout le monde parlait lorsque ses cendres ont été rapatriées, ni savoir ce qu'est la France (c'est en Bretagne, demande-t-elle, l'ingénue), ces rumeurs viennent entacher son orgueil d'artisan tueur au savoir-faire indéniable ! N'est-ce pas elle qui doit répandre la mort, après tout, et pas ce Léon sorti de nulle part et même plus vivant ?
Un procès où viendra aussi témoigner le seul homme que Fleur de tonnerre aura épargné de toute sa carrière d'empoisonneuse, le seul amour de sa vie, un amour vrai et réciproque, qui va résister même aux pires accusations. La preuve aussi sans doute, que, là où il y a le tonnerre, finit forcément un jour par tomber la foudre, et son fameux coup, aussi dévastateur que tout l'arsenic du monde... Un sentiment, le seul exprimé par Hélène de toute sa vie, mais insuffisant pour lui épargner la condamnation suprême...
Le roman ne vaut pas seulement par ce qui se passera pendant ce procès hors norme, mais aussi par ce que fera et surtout, dira Hélène dans sa geôle, avant son exécution. C'est là que se trouve l'explication de son odyssée meurtrière, sans far... euh, sans fard, pardon, et, en quelques mots, elle éclaire le lecteur sur ses réelles motivations, loin d'être légendaires ou fantastiques, non, bassement humaines...
Alors, bien sûr, on peut trouver que ce roman est un catalogue monotone et répétitif des actes monstrueux commis par Hélène Jégado pendant plus de 40 ans. Dans la forme, c'est sans doute un peu vrai. Mais, contrairement à certains commentaires de lecteurs mal lunés que je vois fleurir ça et là, je ne me suis pas ennuyé une seconde. Parce que c'est drôle, avant tout, mais oui, mesdames et messieurs les sinistres, ensuite parce qu'il y a un véritable fond à cette histoire.
"Fleur de tonnerre" n'est pas simplement la relation de la vie et de l'oeuvre d'Hélène Jégado, mais un roman sur la Bretagne, terre si particulière, à l'identité si affirmée, jusque dans les gestes et les habitudes les plus quotidiens. Il y a d'ailleurs tout au long du roman une omniprésence de la terre, sous différentes formes, à commencer par cette lande si fertile en fleurs aux vertus étranges, jusqu'à cette poussière 100% bretonne, dont se sont munies certaines femmes avant d'assister au procès d'Hélène, sans oublier cette scène de communion délirante avec le sol breton à laquelle participent Hélène et deux autres personnages récurrents du livre, deux Normands dont nous dirons quelques mots en fin de billet.
"Fleur de tonnerre", c'est aussi la rencontre étonnante de trois composantes difficilement conciliables : la croyance, la foi et la loi. Avec des exemples incroyables que Teulé a été piocher dans des ouvrages de référence... Deux en particuliers sont frappants pour évoquer le mélange sulfureux qui peut résulter de l'assimilation de la croyance par la foi... et réciproquement ! Je veux parler de Notre-Dame-de-la-Haine et Saint-Yves de vérité...
Situé dans les actuelles Côtes d'Armor, Notre-Dame-de-la-Haine est un oratoire construit en haut d'une colline. Y viennent en pèlerinage ceux qui souhaitent que leur ennemi, un parent gênant ou n'importe qui pouvant, par sa disparition aussi tragique que précoce, rapporter quelque chose, connaisse une fin ni forcément rapide, ni forcément indolore, mais prochaine... Fascinant endroit où la prière la plus fervente est habitée des haines les plus humaines et intéressées...
Quand à Saint-Yves-de-Vérité, c'est en fait une statue, sise dans une église du centre de la Bretagne. Saint Yves, c'est le patron de la Bretagne, le saint vers qui chaque Breton se tourne lorsqu'il a un besoin urgent d'aide providentielle... Mais voilà, un saint, même patron, ça ne peut pas tout faire en un temps record. Parfois, il arrive que la demande, même fervente, s'égare... Alors, le fidèle non exaucé peut se rendre à Saint-Yves-de-Vérité... où il pourra infliger à la statue du saint la correction qu'il mérite pour l'avoir laissé dans la dèche...
On voit bien là comment la superstition prend le pas sur tout, dans cette région. "Chaque pays a sa folie. La Bretagne les a toutes", écrivait Jacques Cambry, fondateur de l'Académie Celtique, cité en exergue du livre par Teulé. Et c'est ce que l'écrivain contemporain essaye de démontrer dans ce roman. Hélène Jégado est le fruit de ses croyances et légendes si pittoresques lorsqu'on les regarde en spectateur, mais qui lui ont farci le crâne de tant de choses délirantes sans qu'on lui ait inculqué les repères nécessaires qu'elle a perdu le contact avec la réalité pour entrer littéralement au coeur de cette mythologie.
Comme je le disais, elle affronte la religion, dans les presbytères ou au couvent, puis sera confronté aux strates les plus élevés de la société, les grands bourgeois, y compris ceux qui ont des ambitions politiques, qui briguent des mairies, voire mieux encore. Et, à chaque fois, elle agira avec un égalitarisme qui devrait en rendre beaucoup jaloux ! Hommes ou femmes, enfants, adultes ou vieillards, riches ou pauvres, croyants ou athées, dévots ou dépravés, tous y passent, mieux qu'avec la guillotine...
Il n'y aura que peu de survivants à cette fascinante hécatombe, que Teulé nous sert avec sa verve, sa gouaille et son cynisme habituel, pour en faire une noire comédie humaine. La première de ses cibles échappera aux baies de belladone, l'homme qu'elle a aimé, qu'elle épargnera en le quittant, sûre que si elle reste, elle le tuera forcément, sa dernière cible, un homme qui n'a rien vu venir, lui qui est connu partout comme un spécialiste des affaires criminelles, qui s'en sortira in extremis...
Et puis, il y a les deux Normands... Deux hommes qui réapparaissent régulièrement sur le chemin de Fleur de tonnerre, deux paisibles commerçants qui vont, au contact de la Bretagne, connaître les pires tracas, les pires avanies, les pires désillusions... La Bretagne va, peu à peu, les digérer, ces deux-là... Oui, je sais, le terme est étrange, mais la dégradation connue par ces deux-là au fil des pages est étonnante... Jusqu'à la scène finale du roman où les deux énergumènes vont, dans une scène complètement grotesque et orgiaque, faire le lien entre le monde réel et le monde de légende dans lequel croyait vivre Hélène... Et si elle avait eu raison, si ces deux mondes étaient plus proches, plus fusionnels qu'on ne le croit lorsqu'on est tristement raisonnable ?
Au final, j'ai beaucoup ri avec ce nouveau roman de Jean Teulé. Une sarabande macabre, bien rythmée, qui peut certes paraître répétitive, mais n'est sûrement pas monotone, justement parce qu'il n'y a pas deux situations identiques. Le mode opératoire, le poison, ne change pas, mais la façon de faire évolue, se perfectionne, devient une véritable mécanique...
Si l'on s'appuie sur le récit de Jean Teulé d'une part, et sur les critères utilisés pour définir le profil d'un serial killer, pour utiliser un vocable contemporain, on a là un formidable spécimen. Hélène Jegado tue sans scrupule, sans émotion, suivant un mode opératoire quasi identique à chaque fois, même si elle sait se montrer pragmatique. Pas de dimension sexuelle, a priori, je n'en dirais pas autant pour la question de la domination... Car, nulle doute que Hélène Jégado s'est érigée en exécutrice comme pour affirmer une forme de puissance à exercer sur ses prochains, tous ses prochains.
Et c'est sans doute cela le plus fascinant. Oui, je sais, il est toujours troublant d'être fasciné par le mal. Mais, le paradoxe, c'est qu'en lui préférant la fascination à l'horreur, on agit finalement... exactement comme elle, pour se protéger. Mais je n'en dis pas plus. Fascinant, car, une fois le livre terminé, il convient de revenir page 28.
Une phrase, simple inscription au pied d'une statue, simple expression d'une énième légende bretonne qui, vue par la gamine de Kerhordevin en Plouhinec, nourrie de cet imaginaire merveilleux pour les uns, mais potentiellement effrayant pour d'autres, va devenir une véritable profession de foi... Vraiment, je vous encourage à la relire en fin de lecture, et vous verrez à quel point Hélène Jégado a suivi à la lettre cet devise.
A un détail près : elle ne sait pas lire... Alors comment a-t-elle pu à ce point respecter ce texte qu'elle n'a pu déchiffrer ??
Et, pendant ce temps, les personnages animés par Teulé continuent à faire les quatre-ç'Ankou... Wriik... Wriik... Wriik...