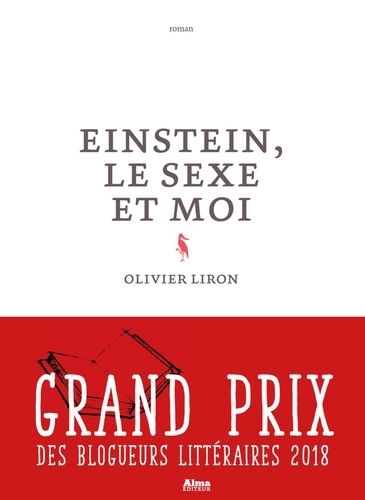En lisant "A son image", de Jérôme Ferrari, des souvenirs d'une autre lecture, plus ancienne, me sont revenus. Une histoire de photographe qui a couvert la guerre en Yougoslavie et qui est rentré traumatisé de cette expérience, cela évoquait pour moi un roman datant d'une dizaine d'années et signé par un auteur que j'aime beaucoup pour l'étendue de son imaginaire et la variété des sujets qu'il aborde. Ce roman, c'est "le Peintre de batailles", d'Arturo Perez-Reverte (en grand format au Seuil, et disponible en poche chez Points ; traduction de François Maspero), où l'écrivain espagnol pose des questions qui sont assez proches de celle abordées par Jérôme Ferrari, à commencer par le lien entre photographie et peinture, mais aussi ce poids terrible de l'image et cette mission de témoigner. J'ai eu envie de relire ce livre, non pour comparer, mais parce que je me disais que ces deux lectures pouvaient être très complémentaires, et c'est, je crois, effectivement le cas. Et, dernier élément commun, il y a aussi un magnifique personnage féminin, très différent de celui de l'Antonia de Jérôme Ferrari, mais tout aussi important...
Faulques vit seul, retiré du monde, dans une tour de guet abandonnée depuis longtemps, située au bord de la Méditerranée. Enfermé dans ce bâtiment menaçant ruine la plupart du temps, il peint. Il peint une impressionnante fresque, décrivant une effroyable guerre. Un travail qui n'est destiné ni à être vu par quiconque ni à perdurer, mais auquel il se consacre corps et âme.
Il ne sort que pour aller nager ou faire des courses dans la ville la plus proche et ses contacts avec le genre humain se résument à écouter la voie d'une jeune femme commentant aux touristes empruntant la navette maritime ce qu'il y a à voir sur le littoral. A peine quelques minutes, le temps de la saison estivale, et rien d'autre.
Faulques n'est pas un grand peintre, il le sait et il s'en moque. L'oeuvre gigantesque qu'il peaufine au gré de son inspiration n'a pas pour but d'être un chef d'oeuvre impérissable, c'est juste sa manière de régurgiter tout ce qu'il a vu au cours de sa carrière, et plus particulièrement lors de sa dernière expérience sur le terrain.
Dans cette vie antérieure, Faulques était photographe, un photo-reporter qui couvrait les conflits, les événements marquants de l'actualité, les lieux où l'humanité est malmenée, fracassée, massacrée, même. Ce fut le cas en Yougoslavie, dans la décennie précédente. Presque dix ans ont passé depuis, et Faulques n'est toujours pas remis.
Ce qu'il a vu, ce qu'il a connu lors de cette guerre devenue génocide (j'aurais presque envie de mettre le mot au pluriel, tant les exactions ont concerné tous les camps en présence), l'a laissé écoeuré au point de se couper du monde. A moins qu'il y ait une autre raison, plus personnelle, à cette rupture complète avec son passé, à cette rumination expulsée à coups de pinceaux sur les murs de cette tour.
Jusqu'au jour où quelqu'un débarque devant la tour, demandant à voir Faulques. L'homme semble surgir de ce passé que Faulques essaye d'exorciser. Il s'appelle Ivo, il est Croate et les deux hommes se sont croisés, même si le peintre de batailles ne semble pas s'en souvenir immédiatement. Ils se sont croisés et Faulques a bouleversé le destin d'Ivo... Irrémédiablement...
Par la suite, il a voyagé, fait mille métiers, sans jamais oublier Faulques. Aujourd'hui, il l'a retrouvé et l'heure est venue de solder les comptes. Oui, pour Ivo, Faulques a une dette envers lui, une dette exorbitante, incommensurable. Une dette que l'ancien photographe ne peut rembourser que d'une seule manière : en donnant sa vie.
Débute un étrange huis clos discontinu (l'action se déroule sur plusieurs jours, Ivo disparaissant et revenant, tandis que Faulques demeure dans sa tour, sans changer son train-train et poursuivant sa tâche, complétant sa fresque), où les deux hommes s'affrontent de manière surprenante, sans violence, mais avec des mots.
Ivo cherche à comprendre ce que veut faire Faulques avec cette immense peinture, cherche à comprendre Faulques, tout simplement. A lui rafraîchir la mémoire, également, et à le mettre face aux responsabilités qui furent les siennes en tant que photographe. A le culpabiliser, ce qui n'est pas difficile, tant Faulques est déjà rongé par le remords depuis toutes ces années.
Et c'est d'ailleurs avec une certaine résignation que Faulques reçoit Ivo, que l'on perçoit comme une espèce de statue du Commandeur venue rendre justice. Venue incarner le destin, si féroce. A moins que le plus violent dans ce monde ne soit l'être humain lui-même, capable de toutes les monstruosités, d'une immoralité totale et d'une haine tenace.
Car le coeur de cette histoire, c'est bel et bien le genre humain. Une vision particulièrement sombre et pessimiste de ce genre humain, d'ailleurs. Faulques et Ivo échangent sur ces questions, partageant leurs expériences respectives, très différentes, presque complémentaire : le Croate était une victime, le photographe, un témoin.
Mais, le leitmotiv, c'est que personne dans ce monde n'est innocent, quelle que soit sa position. Car, même si Faulques n'était pas un belligérant, sa présence même sur les lieux l'impliquait. Chacun de ses gestes, chacune des impulsions de son doigt sur le déclencheur a eu des conséquences, exactement comme un soldat qui appuierait sur la détente de son arme...
"Je soupçonne que rien ne peut aider à changer la nature humaine. Ou aider à s'en protéger constamment", dit par exemple Faulques. C'est dur, définitif. Sans doute les mots d'un homme désabusé et malheureux, en colère autant contre lui-même autant que contre ses congénères. Mais, c'est sans doute assez juste.
Ce passage évoque, comme une bonne partie du livre, la question de la culture comme outil contre la barbarie. Mais, là encore, Faulques peine à croire que cela suffise. Il met plutôt en avant la mémoire, à condition toutefois qu'elle s'accompagne de lucidité. Qu'elle ne soit donc pas déformée pour quelque cause que ce soit, mais examinée avec objectivité.
Là, on retrouve des thématiques proches de celles développées par Jérôme Ferrari dans "A son image", et en particulier le parallèle entre peinture et photographie, deux manières de créer des images, de représenter le monde, mais des fonctions aussi différentes que les techniques qu'on emploie pour chacune d'entre elles.
L'interrogatoire, utilisons ce mot, même s'il peut sembler fort, d'Ivo tourne beaucoup autour de cela : pourquoi abandonner la photo pour se consacrer à la peinture ? Que cherche à représenter Faulques dans cette fresque ? Après quel objectif court-il ? Et l'on sent que le peintre de batailles lui-même n'a pas forcément toutes les réponses...
C'est un processus en cours dans lequel Ivo s'invite, précipitant la réflexion de son interlocuteur. On se dit que la fin de cette fresque marquera la fin de ce processus, que Faulques aura des réponses, peut-être pas toutes, mais suffisantes. Avec l'irruption du Croate, une autre échéance apparaît qui rend soudain toute projection dans l'avenir pour le moins incertaine...
Ne vous attendez pas, en ouvrant le roman d'Arturo Perez-Reverte, à l'un des romans mouvementés, plein d'aventures et de rebondissements, parfois flirtant avec le polar, auxquels l'écrivain espagnol a pu nous habituer depuis "le Tableau du maître flamand" (presque 30 ans, déjà ! Et déjà un roman autour de la peinture...).
On est dans un roman nettement plus introspectif, où les échanges confinent à la philosophie, à la métaphysique, où la violence est omniprésente, puisqu'elle est la source de tout cela, mais sans se manifester concrètement entre les deux protagonistes. Il y a, entre Faulques et Ivo, un lien particulier, étrange, quand on sait ce qui les unit personnellement, une cordialité qui s'avère glaçante...
Il y aurait beaucoup à dire sur cette relation, mais cela nous emmènerait un peu loin, il y aurait pas mal à dire sur Ivo, et en faisant référence à la statue du Commandeur, j'ai déjà laissé transparaître l'hypothèse qui est la mienne à son sujet. Arturo Perez-Reverte laisse au lecteur le choix de la perception de son roman, il ne dicte rien, n'impose rien, à vous de décider...
Dans "le Peintre de batailles", Arturo Perez-Reverte évoque la puissance de l'image et de la photographie en particulier, comme le fait Jérôme Ferrari dans "A son image". Avec les mêmes écueils : la photo montre-t-elle le réel ou capte-t-elle autre chose, en particulier de la personne qui est choisie comme sujet, de la situation qu'elle offre à ceux qui ne sont pas présents sur place.
Oui, Faulques a été le témoin, il a joué durant toute sa carrière de photographe une courroie de transmission, montrant aux lecteurs des journaux, des magazines dans lesquels paraissaient ses clichés, ce qui se déroule loin d'eux, loin de leur regard. Rendre visible ce que personne ne voulait voir, pour reprendre une formule extraite du roman de Jérôme Ferrari.
Mais être témoin, c'est s'exposer soi-même à l'horreur, sans filtre autre que la carapace que l'on peut se constituer. Supporter l'insupportable pour en saisir l'horreur ou attraper un fugace moment de grâce au milieu du chaos... A chaque drame, une goutte de plus tombant dans un vase, jusqu'à celle qui fait tout déborder. Jusqu'à l'événement qui pousse à tout laisser tomber et à s'isoler du reste de l'humanité.
C'est ça, le parcours de Faulques, un dur à cuire qui en a vu des vertes et des pas mûres au fil de ses décennies comme photographe, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter cette abomination, cette capacité de l'être humain à infliger des souffrances à son prochain, à ôter la vie pour toutes les raisons qu'on peut trouver pour justifier l'injustifiable...
Le peintre de bataille ne peut effacer ce qu'il a vu, jusqu'à l'écoeurement. Ce qui l'a poussé à devenir un ermite enfermé dans sa tour de guet. Il n'est pas Sisyphe, ni Pénélope, son oeuvre avance sans cesse, se complète à chaque jour, qu'il y apporte un simple coup de pinceau ou qu'il conçoive un pan plus large. Ce qu'il peint ne s'efface pas dans la nuit, il ne doit pas tout reprendre.
Le mal est profond, métastasé, incurable. On trouve dans le roman l'idée que l'amour puisse être la solution, l'antidote, et là encore, Faulques semble repousser cette idée, peut-être simpliste à ses yeux. Il y a bien cette jeune femme, dont il ne connaît que la voix, à travers le haut-parleur du bateau qui passe quotidiennement sous ses fenêtres (ou presque).
On la rencontre finalement, elle semble intriguée par cet homme, ses choix de vie, son travail de dingue. Enfin, quand je dis "on", il faut évidemment comprendre Faulques, et l'on caresse l'espoir d'une étincelle qui réveillerait cet homme, le ramènerait au monde, enfin. mais cela peut-il être suffisant ? N'est-il pas déjà au-delà de tout cela ?
Le principal, c'est ce lien particulier entre l'homme et son oeuvre, comme s'il jetait sur les murs lézardés les dernières substances maintenant son être en vie. Il est une sorte d'ectoplasme en sursis, vide, peut-être déjà moribond, ne tenant que pour témoigner une dernière fois de la folie des hommes à travers la folie picturale d'un homme.
Cette oeuvre, évidemment, on ne la voit pas, elle n'existe que dans le roman et on n'en a pas une description très précise. On devine, par touche, qu'il y a des détails très réalistes, crus, terriblement violents, mais aussi des éléments sortis droit de la mémoire du peintre, comme une espèce de testament jalonné de rencontres passées, d'événements vécus...
Mais, il manque un élément à tout cela. Et l'on va finir par comprendre qu'il s'agit d'un personnage, elle s'appelle Olvido, un prénom si paradoxal, puisqu'il signifie "l'oubli" en espagnol et que, manifestement, elle est inoubliable. En creux, on va découvrir cette femme, pourquoi elle est si importante pour Faulques, et pas seulement pour ce que l'on imagine de prime abord.
Autant Faulques paraît bourru, peu attachant (mais peut-être l'était-il avant tout ça, ne préjugeons pas), autant Olvido semble exubérante, un grain de fantaisie dans un univers où il n'y en a pas beaucoup, quelqu'un que l'on remarque partout où elle passe. Une photographe, aussi, mais pas du tout du même genre que Faulques.
Elle est l'artiste et utilise l'image comme telle. Pas de visage, que des objets, avec lesquels elle constitue des espèces d'accumulations fort déroutantes aux yeux de Faulques. Des clichés en noir et blanc, à l'opposé, nous dit-on, de ceux dont elle fut le modèle lorsqu'elle travaillait dans la mode et qu'elle incarnait la beauté. Cette beauté qu'elle expulse délibérément de ses propres photos.
Déroutante, mystérieuse, insaisissable, tellement belle, capable de sortir apprêtée comme pour une soirée de gala alors qu'ils se rendent sur le terrain... Bref, une femme libre, qui n'en fait qu'à sa tête, piétinant les normes et les conventions, bousculant le quotidien si bien réglé de Faulques, apportant à son univers mortifère une bouffée de vie salvatrice.
Olvido, c'est l'antithèse des deux autres personnages principaux, Faulques et Ivo, parce qu'elle incarne le vivant quand les deux hommes puent la mort. Elle est la joie quand ils sont le deuil. Elle est l'insouciance quand ils sont le remords et la rancune. Elle est la beauté quand Faulques est la culpabilité et Ivo la vengeance...
C'est un beau et fort personnage, dont il est un peu difficile de parler, car si elle n'est pas aussi présente que les deux autres protagonistes, son rôle est essentiel (j'allais faire involontairement un jeu de mots de très, très mauvais goût...) dans le roman. C'est à travers elle que toutes les pièces du puzzle vont se mettre en place.
Je l'ai dit, "Le Peintre de batailles" est un roman assez atypique dans la bibliographie d'Arturo Perez-Reverte, qui livre là une sorte de conte philosophique sombre et douloureux sur la condition humaine, avec un Faulques qui est une sorte d'anti-Candide, observant avec une lucidité déprimante un monde qui ne va certainement pas pour le mieux et qu'il est effrayant d'imaginer être le meilleur...
C'est d'ailleurs là que réside le dernier élément qui rapproche "le Peintre de batailles" du livre de Jérôme Ferrari, "A son image" : un véritable pessimisme qui n'est sans doute pas qu'une posture ou un simple élément romanesque. Hélas, depuis la parution de ce roman, la situation en Syrie ou dans d'autres régions du globe tend à leur donner raison.
"Il va falloir un jour qu'enfin je me décide à lire les livres que, depuis trente ans, je conseille à mes amis de lire". (Sacha Guitry)
dimanche 30 septembre 2018
samedi 29 septembre 2018
"[Les photographes] rendaient visible ce que personne ne voulait voir, ils n'étaient pas stupidement ballottés entre l'insignifiance et le mensonge, ils étaient utiles, courageux et obstinés";
Notre roman du jour n'est pas seulement un roman sur la photographie (et pas n'importe quelle forme de photographie, on le verra, oubliez les selfies et Instagram), mais elle en est un élément important. Un outil formidable plus qu'une technique artistique, un moyen de transmettre de l'information parfois plus fort que bien des mots, mais qui nécessite de connaître son contexte. Six ans après avoir reçu le prix Goncourt pour "Le Sermon sur la chute de Rome", Jérôme Ferrari propose avec "A son image" (en grand format aux éditions Actes Sud) un roman à la construction narrative très intéressante, où il évoque l'île qui lui est chère, la Corse, et propose de découvrir un personnage féminin dont le portrait se dessine en creux au fil des chapitres. Une jeune femme pleine de force et de détermination, en quête d'un idéal, d'une raison de vivre, jusqu'à choisir une voie déroutante, qui la marquera profondément. Un roman fort, superbement écrit, et un hommage appuyé aux photographes de guerre, à ceux dont le métier est de fixer sur le papier les moments forts de l'actualité qui, un jour, illustreront peut-être un livre d'Histoire...
Un soir d'août 2003, Antonia se trouve sur le port de Calvi quand elle aperçoit un visage qu'elle reconnaît immédiatement parmi un groupe de légionnaires. Cet homme, elle en est certaine, elle l'a bien connu, quelques années plus tôt, dans un contexte très différent. Cela se passait dans ce qui ne s'appelait déjà plus la Yougoslavie, un pays déchiré par une effroyable guerre civile.
La jeune femme a passé la journée à photographier de jeunes mariés qui venaient de se dire oui et ce visage la replonge brusquement dans un passé douloureux. Elle décide d'aller voir celui qu'elle connaît sous le nom de Dragan et ensemble, il passe la soirée et une bonne partie de la nuit à discuter, à se souvenir de cette période si violente.
A l'aube, malgré la fatigue de la nuit blanche, elle dit au revoir à Dragan et prend la route pour rentrer chez elle, dans le sud de l'île. Alors qu'elle circule sur une route sinueuse et escarpée, son véhicule quitte la route et s'écrase en contrebas... Antonia, 38 ans, passionnée de photographie depuis l'enfance au point d'en faire son métier, est tuée sur le coup...
Pour ses proches, le choc est terrible, on l'imagine, et en particulier pour son parrain, qui était également son confident, et qui va présider les funérailles. En effet, ce parrain est devenu prêtre, une vocation tardive qu'il exerce avec une foi farouche dans un contexte corse loin d'être toujours évident, loin d'être toujours très calme.
Cette messe d'obsèques est le fil rouge de ce roman, construit comme un Requiem, et à chaque étape, c'est l'occasion pour l'ecclésiastique de se souvenir d'Antonia, de sa jeunesse, de ses engagements, de ses amours, de ses choix de vie quelquefois surprenant, de sa passion pour la photographie, qu'il a initiée en lui offrant son premier appareil, de cette quête d'idéal qu'elle n'a jamais vraiment trouvé...
On va donc découvrir petit à petit son parcours, en Corse, d'abord, avec ce premier amour, si fort, pour un jeune nationaliste, alors que l'île s'embrase dans ces années 1980 tumultueuses, une relation douloureuse, qui va laisser bien des traces et la pousser à vouloir aller ailleurs. A quitter ses fonctions de journaliste pour un canard corse afin de voler de ses propres ailes comme photographe de guerre.
A l'époque, à quelques heures à peine de la France, un pays européen implose à coup de massacres de civils et de nettoyage ethnique. Antonia s'envole alors pour la Yougoslavie, ou ce qu'il en reste, en pensant qu'elle sera plus utile qu'à couvrir les conférences de presse plus ou moins clandestines du FLNC. Mais n'a-t-elle pas été un peu présomptueuse ?
A travers ces souvenirs et cette vie que l'on appréhende de mieux en mieux, on comprend mieux ce qui a à ce point bouleversé Antonia quand elle a vu Dragan. Une rencontre impromptue dont seul le lecteur a connaissance et qui, dans ce contexte nouveau, laisse apparaître une ambiguïté sur la mort d'Antonia : accident... ou suicide ?
Sur ce dernier point, c'est véritablement mon impression que je vous donne. A chacun de se faire une réponse, Jérôme Ferrari ne donnant aucun élément décisif sur la question et mettant en scène avec beaucoup de finesse les derniers instants d'Antonia. Mais, si j'en parle, c'est parce que je crois que la question se pose et qu'elle est cohérente avec la personnalité de la jeune femme et son parcours un peu chaotique.
"A son image" est le roman d'une vie imparfaite, d'un destin incomplet, inaccompli. On ressent une réelle frustration chez Antonia qui n'est finalement heureuse que lorsqu'elle peut prendre des photos. Pas celles grâce auxquelles elle gagne sa vie, et l'on ressent d'ailleurs le côté utilitaire de cette activité, mais ces photos qui font vraiment battre son coeur, parce qu'elle saisit un instant magique, important.
C'est aussi en pensant à Antonia que j'ai choisi cette phrase comme titre de ce billet. Parce qu'il y a d'abord une espèce de profession de foi qu'embrasse la photographe, "rendre visible ce que personne ne voulait voir", ensuite, un résumé de sa propre histoire en Corse, lorsqu'elle couvre les actions d'éclat des nationalistes en sachant très bien qui se cache sous les cagoules et qu'on l'utilise pour une propagande inepte.
Enfin, il y a cet idéal, résumé en trois adjectifs : utile, courageuse, obstinée... Les deux derniers correspondent parfaitement au caractère entier d'Antonia. Reste l'utilité, après laquelle on a l'impression qu'elle a couru, en vain, toute sa courte vie. Qu'elle couvre l'actualité locale en Corse, et pas la plus passionnante, ou qu'elle immortalise les mariages et les anniversaires, elle ne ressent pas cette plénitude.
C'est pour cela qu'elle a choisi de partir suivre un conflit, en l'occurrence la guerre de Yougoslavie. Avec l'idée que ce qu'elle photographierait servirait à informer un public de ce qui se passe si près, tellement près de chez eux... Force est de reconnaître que ce sera encore un échec, peut-être le pire de tous ceux essuyés par Antonia, et assorti de souvenirs durs à porter.
Non, Antonia n'a jamais réussi à se sentir utile, parce qu'elle s'est sans doute fait une très (trop ?) haute opinion de ce mot. Son parrain, plus confident que confesseur, a été le témoin privilégié de cette lutte pour devenir quelqu'un d'utile et, au moment de dire cette messe, la messe du dernier adieu à Antonia, il se dit certainement que lui aussi à échoué.
Il a échoué toutes ces années à trouver les mots pour convaincre Antonia qu'elle était utile, quoi qu'elle fasse. Il l'a vue, accro à Pascal, ce petit voyou qui lu préfère la cause indépendantiste et se moque d'elle et de ses sentiments. Il l'a vue, plus abîmée encore à son retour de Yougoslavie, par ce qu'elle y a vu, mais n'a pu transmettre.
Il l'a vue, enfin, dans cette dernière partie de sa vie, paisible en apparence, mais tellement insatisfaisante, tellement artificielle, entre la première risette du petit dernier, l'anniversaire du cadet et le mariage en blanc de la plus grande. Des moments forts pour ceux qui les vivent et qui les revivront en regardant les photos d'Antonia, mais tellement creux, vides de sens pour elle...
Je n'ai pas lu tous les romans de Jérôme Ferrari, mais il me semble que c'est la première fois qu'il construit un roman autour d'un personnage principal féminin. Il installe une femme libre, qui a en tout cas tout fait pour le devenir après son entrée délicate dans la vie adulte. Une battante, une femme qui lutte autant contre le monde qui l'entoure que contre elle-même, éternelle insatisfaite.
Plus on la découvre, plus on s'attache à Antonia. Plus on s'attache et plus on voudrait la rassurer, l'aider. Et puis, on se rappelle qu'il est trop tard, que les mots sont dérisoires et cela rend ce parcours plus douloureux encore. Là, je pense aussi que vous voyez pourquoi se poser la question "accident ou suicide ?" a un sens et une vraie cohérence.
Et puis, il y a la photographie, l'image. Ce sont des éléments centraux de ce roman, au même titre que la vie et la mort d'Antonia. Il y a évidemment la passion de la jeune femme pour cette activité, d'abord un hobby, puis une profession, mais ce n'est pas tout. Au cours du récit, décidément bien rempli, entre les moments forts des funérailles d'Antonia et les souvenirs du prêtre, viennent s'intercaler d'autres éléments.
Apparaissent d'autres personnages, présentés sous leur prénom et la simple initiale de leur patronyme. Des personnages qui, contrairement à Antonia, ne sont pas sortis de l'imagination de l'auteur, mais ont bel et bien existé. Des personnages qui ont laissé une trace, qui ont laissé des images. Et des clichés qui ont marqué leur époque, parfois perduré...
Ces personnages, ce sont des photographes, et plus particulièrement des photographes de guerre, terme un peu générique, car certaines des photos qui sont évoqués ne sont pas toutes des photographies de guerre, en tout cas, pas au sens où on les imagine. Ce sont aussi parfois les conséquences des guerres ou les moments marquant leur fin.
Les noms de ces personnages ne vous diront sans doute rien pour la plupart, et pourtant, certaines des photos évoquées par Jérôme Ferrari nous ont marqué, comme cette brèche s'ouvrant dans le Mur de Berlin, un jour de novembre 1989. Si vous tapez "Chute du Mur de Berlin" sur un moteur de recherche, il est probable que cette photo de Gérard Malie apparaîtra dans les premières occurrences :
Chaque photo évoquée nous parle, par les émotions qu'elles nous transmettent, positives comme négatives, la violence de notre monde comme des instants incroyables. Là est la force de la photographie : capturer l'instant, attraper le petit truc qui passerait en quelques secondes et le rendre immortel. A condition de connaître son contexte.
On a coutume de dire que les premiers reporters de guerre sont apparus pendant la Guerre de Crimée. Les photographes aussi ont suivi le mouvement (au cours de ma lecture du roman d'Alan Spence "Le Monde flottant", évoqué il y a quelques semaines sur le blog, je découvrais ainsi les clichés pris au Japon par Felice Beato au tournant des années 1850-60).
Jérôme Ferrari ne remonte pas aussi loin, mais il y a une raison à cela : le premier photographe qu'il évoque est Gaston Chérau, à qui il a consacré il y a quelques années un livre écrit à quatre mains avec Olivier Rohe, "A fendre le coeur". Il y étudiait le travail photographique incroyablement riche et complètement oublié réalisé par cette homme en Libye entre 1911 et 1912, lors de la guerre italo-ottomane.
Sans doute y a-t-il une complémentarité entre cet ouvrage et ce roman dont Gaston C. devient un personnage, un pionnier qui va ouvrir la voie à d'autres, de différents pays, à différentes époques, chargés de prendre des photos de conflits nés pour différentes raisons... La guerre, mais aussi ses conséquences, parce que c'est l'humain qui est au coeur de tout.
Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si c'est le visage de Dragan qui lance le roman, lorsque Antonia le repère, au milieu de ses compagnons de régiment. Elle a l'oeil du photographe, les traits de cet homme sont gravés dans sa mémoire, comme tant d'autres sujets qu'elle a cadrés et fixé sur la pellicule. Avec ce visage, une ribambelle de souvenirs et d'images resurgissent...
Des souvenirs qui ne sont pas juste un instantané, mais tout un contexte, stimulant tous les sens et réveillant des émotions profondes. Car, ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce qu'on est témoin et qu'on décide de le prendre en photo qu'on est insensible à tout le reste, au contraire. C'est parce qu'on ressent la puissance de cet instant qu'on veut partager ce qu'il induit...
Gaston C. est le premier d'une série de photographes ayant laissé leur empreinte par des clichés très forts. A moins d'être spécialiste du sujet, difficile de les reconnaître juste avec leur prénom et l'initiale de leur nom. Rassurez-vous, ils sont tous cités en fin d'ouvrage et je vous invite à aller regarder leur travail, du moins ce que l'on peut en voir sur internet. Et leur biographie, aussi.
Jérôme Ferrari s'interroge sur la photographie dans ce roman. Huitième art ? Non, la photo n'est pas la peinture, "ce n'est pas en tant qu'art que la photographie donne la mesure de sa puissance", lit-on dans "A son image". La fonction de la photographie, c'est de porter témoignage, de donner la preuve qui étaye les mots, les soutient, les renforce.
Oh, bien sûr, de nos jours, on peut tout faire dire à une photo, même ce qu'elle n'a jamais voulu dire, on la détourne, la déforme, la recadre, la monte à des fins bien peu glorieuses. Tous les jours sur les réseaux sociaux, on y a droit. Mieux vaut qu'Antonia n'ait pas connu cette époque, ses maux n'en auraient été que renforcés...
Oui, la photo est d'abord un témoignage, nous dit Jérôme Ferrari : "le cliché relève non de l'histoire, mais de l'actualité", écrit-il. Elle n'a pas forcément pour objectif de perdurer, de devenir un document historique, en tout cas, ce n'est pas l'idée du photographe lorsqu'il appuie sur le déclencheur, mais l'Histoire peut parfois s'emparer d'un cliché.
La photo témoigne, de tout et de n'importe quoi, des moments les plus forts et importants, comme des plus futiles et éphémères. "Les hommes aiment à conserver le souvenir émouvant de leurs crimes comme de leurs noces, de la naissance de leurs enfants ou de tout autre moment notable de leur vie, avec la même innocence", lit-on encore.
J'ai été frappé par la récurrence dans le roman du mot "innocence", alors même que les photographes évoqués dans le livre captent régulièrement la laideur de l'être humain et sa profonde duplicité. Un des clichés évoqués, d'ailleurs, incarne parfaitement cela, un soldat frappant violemment du pied un cadavre sur un trottoir, quelque part en Bosnie...
Il y a, derrière cette question de l'innocence, un débat philosophique sur l'image : représente-t-elle la réalité ? Là encore, je vous renvoie au roman, à la vision de Jérôme Ferrari. Mais il est vrai que le choix du cadre, de la composition, de la lumière, tout le travail technique du photographe semble s'opposer à l'idée d'un réel cru, saisi sur le vif.
Et ce débat renvoie au titre du roman : "A son image". Impossible de lire ce roman sans essayer d'attraper les différents sens qui se cachent derrière ce titre. Evidemment en lien avec le personnage d'Antonia, avec les expériences des différents photographes évoqués, sans oublier la dimension religieuse, puisque la Genèse nous dit que "Dieu créa l'homme à son image".
Simple syllogisme : Dieu créa l'homme à son image, or l'homme est monstrueux, donc Dieu est monstrueux. "Le modèle doit être encore pire !", s'écriait Antonia, en partie par révolte contre cet humain capable sans cesse du pire et en partie pour provoquer son parrain. A travers cette formule, c'est bien la question de la fidélité de la reproduction qui est posée, du décalage entre le modèle et sa représentation.
Je suis bien long, je m'en excuse, il y aurait sans doute encore beaucoup à dire sur ce roman, porté par une écriture forte, marque de fabrique de Jérôme Ferrari. De longues semaines que j'ai fini de lire ce livre et vous voyez que les questions qu'il m'a inspirées sont encore bien vivantes. Certainement parce qu'il s'agit de questions très contemporaines dans un monde où l'image est devenue reine.
"Il y a tant de façons de se montrer obscène", écrit Antonia dans le roman. J'ai gardé cette phrase pour la fin de ce billet, car elle met en évidence l'écueil du sensationnalisme, bien plus "vendeur" que la photo de guerre ou d'actualité, pourtant tellement plus importantes que les vulgaires paparazzades... Ainsi va le monde, où le superflu l'emporte sur l'essentiel.
Je vais juste terminer en mettant le lien vers le site du salon du photojournalisme de Perpignan, qui se tient chaque année à la fin de l'été. En surfant sur ce site, en regardant ces clichés, on voit le travail des héritiers de Gaston C. et des autres, et l'on pense alors à Antonia, en se rappelant ces trois mots : utile, courageux, obstiné. Et la volonté de rendre visible ce que personne ne veut voir...
Un soir d'août 2003, Antonia se trouve sur le port de Calvi quand elle aperçoit un visage qu'elle reconnaît immédiatement parmi un groupe de légionnaires. Cet homme, elle en est certaine, elle l'a bien connu, quelques années plus tôt, dans un contexte très différent. Cela se passait dans ce qui ne s'appelait déjà plus la Yougoslavie, un pays déchiré par une effroyable guerre civile.
La jeune femme a passé la journée à photographier de jeunes mariés qui venaient de se dire oui et ce visage la replonge brusquement dans un passé douloureux. Elle décide d'aller voir celui qu'elle connaît sous le nom de Dragan et ensemble, il passe la soirée et une bonne partie de la nuit à discuter, à se souvenir de cette période si violente.
A l'aube, malgré la fatigue de la nuit blanche, elle dit au revoir à Dragan et prend la route pour rentrer chez elle, dans le sud de l'île. Alors qu'elle circule sur une route sinueuse et escarpée, son véhicule quitte la route et s'écrase en contrebas... Antonia, 38 ans, passionnée de photographie depuis l'enfance au point d'en faire son métier, est tuée sur le coup...
Pour ses proches, le choc est terrible, on l'imagine, et en particulier pour son parrain, qui était également son confident, et qui va présider les funérailles. En effet, ce parrain est devenu prêtre, une vocation tardive qu'il exerce avec une foi farouche dans un contexte corse loin d'être toujours évident, loin d'être toujours très calme.
Cette messe d'obsèques est le fil rouge de ce roman, construit comme un Requiem, et à chaque étape, c'est l'occasion pour l'ecclésiastique de se souvenir d'Antonia, de sa jeunesse, de ses engagements, de ses amours, de ses choix de vie quelquefois surprenant, de sa passion pour la photographie, qu'il a initiée en lui offrant son premier appareil, de cette quête d'idéal qu'elle n'a jamais vraiment trouvé...
On va donc découvrir petit à petit son parcours, en Corse, d'abord, avec ce premier amour, si fort, pour un jeune nationaliste, alors que l'île s'embrase dans ces années 1980 tumultueuses, une relation douloureuse, qui va laisser bien des traces et la pousser à vouloir aller ailleurs. A quitter ses fonctions de journaliste pour un canard corse afin de voler de ses propres ailes comme photographe de guerre.
A l'époque, à quelques heures à peine de la France, un pays européen implose à coup de massacres de civils et de nettoyage ethnique. Antonia s'envole alors pour la Yougoslavie, ou ce qu'il en reste, en pensant qu'elle sera plus utile qu'à couvrir les conférences de presse plus ou moins clandestines du FLNC. Mais n'a-t-elle pas été un peu présomptueuse ?
A travers ces souvenirs et cette vie que l'on appréhende de mieux en mieux, on comprend mieux ce qui a à ce point bouleversé Antonia quand elle a vu Dragan. Une rencontre impromptue dont seul le lecteur a connaissance et qui, dans ce contexte nouveau, laisse apparaître une ambiguïté sur la mort d'Antonia : accident... ou suicide ?
Sur ce dernier point, c'est véritablement mon impression que je vous donne. A chacun de se faire une réponse, Jérôme Ferrari ne donnant aucun élément décisif sur la question et mettant en scène avec beaucoup de finesse les derniers instants d'Antonia. Mais, si j'en parle, c'est parce que je crois que la question se pose et qu'elle est cohérente avec la personnalité de la jeune femme et son parcours un peu chaotique.
"A son image" est le roman d'une vie imparfaite, d'un destin incomplet, inaccompli. On ressent une réelle frustration chez Antonia qui n'est finalement heureuse que lorsqu'elle peut prendre des photos. Pas celles grâce auxquelles elle gagne sa vie, et l'on ressent d'ailleurs le côté utilitaire de cette activité, mais ces photos qui font vraiment battre son coeur, parce qu'elle saisit un instant magique, important.
C'est aussi en pensant à Antonia que j'ai choisi cette phrase comme titre de ce billet. Parce qu'il y a d'abord une espèce de profession de foi qu'embrasse la photographe, "rendre visible ce que personne ne voulait voir", ensuite, un résumé de sa propre histoire en Corse, lorsqu'elle couvre les actions d'éclat des nationalistes en sachant très bien qui se cache sous les cagoules et qu'on l'utilise pour une propagande inepte.
Enfin, il y a cet idéal, résumé en trois adjectifs : utile, courageuse, obstinée... Les deux derniers correspondent parfaitement au caractère entier d'Antonia. Reste l'utilité, après laquelle on a l'impression qu'elle a couru, en vain, toute sa courte vie. Qu'elle couvre l'actualité locale en Corse, et pas la plus passionnante, ou qu'elle immortalise les mariages et les anniversaires, elle ne ressent pas cette plénitude.
C'est pour cela qu'elle a choisi de partir suivre un conflit, en l'occurrence la guerre de Yougoslavie. Avec l'idée que ce qu'elle photographierait servirait à informer un public de ce qui se passe si près, tellement près de chez eux... Force est de reconnaître que ce sera encore un échec, peut-être le pire de tous ceux essuyés par Antonia, et assorti de souvenirs durs à porter.
Non, Antonia n'a jamais réussi à se sentir utile, parce qu'elle s'est sans doute fait une très (trop ?) haute opinion de ce mot. Son parrain, plus confident que confesseur, a été le témoin privilégié de cette lutte pour devenir quelqu'un d'utile et, au moment de dire cette messe, la messe du dernier adieu à Antonia, il se dit certainement que lui aussi à échoué.
Il a échoué toutes ces années à trouver les mots pour convaincre Antonia qu'elle était utile, quoi qu'elle fasse. Il l'a vue, accro à Pascal, ce petit voyou qui lu préfère la cause indépendantiste et se moque d'elle et de ses sentiments. Il l'a vue, plus abîmée encore à son retour de Yougoslavie, par ce qu'elle y a vu, mais n'a pu transmettre.
Il l'a vue, enfin, dans cette dernière partie de sa vie, paisible en apparence, mais tellement insatisfaisante, tellement artificielle, entre la première risette du petit dernier, l'anniversaire du cadet et le mariage en blanc de la plus grande. Des moments forts pour ceux qui les vivent et qui les revivront en regardant les photos d'Antonia, mais tellement creux, vides de sens pour elle...
Je n'ai pas lu tous les romans de Jérôme Ferrari, mais il me semble que c'est la première fois qu'il construit un roman autour d'un personnage principal féminin. Il installe une femme libre, qui a en tout cas tout fait pour le devenir après son entrée délicate dans la vie adulte. Une battante, une femme qui lutte autant contre le monde qui l'entoure que contre elle-même, éternelle insatisfaite.
Plus on la découvre, plus on s'attache à Antonia. Plus on s'attache et plus on voudrait la rassurer, l'aider. Et puis, on se rappelle qu'il est trop tard, que les mots sont dérisoires et cela rend ce parcours plus douloureux encore. Là, je pense aussi que vous voyez pourquoi se poser la question "accident ou suicide ?" a un sens et une vraie cohérence.
Et puis, il y a la photographie, l'image. Ce sont des éléments centraux de ce roman, au même titre que la vie et la mort d'Antonia. Il y a évidemment la passion de la jeune femme pour cette activité, d'abord un hobby, puis une profession, mais ce n'est pas tout. Au cours du récit, décidément bien rempli, entre les moments forts des funérailles d'Antonia et les souvenirs du prêtre, viennent s'intercaler d'autres éléments.
Apparaissent d'autres personnages, présentés sous leur prénom et la simple initiale de leur patronyme. Des personnages qui, contrairement à Antonia, ne sont pas sortis de l'imagination de l'auteur, mais ont bel et bien existé. Des personnages qui ont laissé une trace, qui ont laissé des images. Et des clichés qui ont marqué leur époque, parfois perduré...
Ces personnages, ce sont des photographes, et plus particulièrement des photographes de guerre, terme un peu générique, car certaines des photos qui sont évoqués ne sont pas toutes des photographies de guerre, en tout cas, pas au sens où on les imagine. Ce sont aussi parfois les conséquences des guerres ou les moments marquant leur fin.
Les noms de ces personnages ne vous diront sans doute rien pour la plupart, et pourtant, certaines des photos évoquées par Jérôme Ferrari nous ont marqué, comme cette brèche s'ouvrant dans le Mur de Berlin, un jour de novembre 1989. Si vous tapez "Chute du Mur de Berlin" sur un moteur de recherche, il est probable que cette photo de Gérard Malie apparaîtra dans les premières occurrences :
Chaque photo évoquée nous parle, par les émotions qu'elles nous transmettent, positives comme négatives, la violence de notre monde comme des instants incroyables. Là est la force de la photographie : capturer l'instant, attraper le petit truc qui passerait en quelques secondes et le rendre immortel. A condition de connaître son contexte.
On a coutume de dire que les premiers reporters de guerre sont apparus pendant la Guerre de Crimée. Les photographes aussi ont suivi le mouvement (au cours de ma lecture du roman d'Alan Spence "Le Monde flottant", évoqué il y a quelques semaines sur le blog, je découvrais ainsi les clichés pris au Japon par Felice Beato au tournant des années 1850-60).
Jérôme Ferrari ne remonte pas aussi loin, mais il y a une raison à cela : le premier photographe qu'il évoque est Gaston Chérau, à qui il a consacré il y a quelques années un livre écrit à quatre mains avec Olivier Rohe, "A fendre le coeur". Il y étudiait le travail photographique incroyablement riche et complètement oublié réalisé par cette homme en Libye entre 1911 et 1912, lors de la guerre italo-ottomane.
Sans doute y a-t-il une complémentarité entre cet ouvrage et ce roman dont Gaston C. devient un personnage, un pionnier qui va ouvrir la voie à d'autres, de différents pays, à différentes époques, chargés de prendre des photos de conflits nés pour différentes raisons... La guerre, mais aussi ses conséquences, parce que c'est l'humain qui est au coeur de tout.
Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si c'est le visage de Dragan qui lance le roman, lorsque Antonia le repère, au milieu de ses compagnons de régiment. Elle a l'oeil du photographe, les traits de cet homme sont gravés dans sa mémoire, comme tant d'autres sujets qu'elle a cadrés et fixé sur la pellicule. Avec ce visage, une ribambelle de souvenirs et d'images resurgissent...
Des souvenirs qui ne sont pas juste un instantané, mais tout un contexte, stimulant tous les sens et réveillant des émotions profondes. Car, ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce qu'on est témoin et qu'on décide de le prendre en photo qu'on est insensible à tout le reste, au contraire. C'est parce qu'on ressent la puissance de cet instant qu'on veut partager ce qu'il induit...
Gaston C. est le premier d'une série de photographes ayant laissé leur empreinte par des clichés très forts. A moins d'être spécialiste du sujet, difficile de les reconnaître juste avec leur prénom et l'initiale de leur nom. Rassurez-vous, ils sont tous cités en fin d'ouvrage et je vous invite à aller regarder leur travail, du moins ce que l'on peut en voir sur internet. Et leur biographie, aussi.
Jérôme Ferrari s'interroge sur la photographie dans ce roman. Huitième art ? Non, la photo n'est pas la peinture, "ce n'est pas en tant qu'art que la photographie donne la mesure de sa puissance", lit-on dans "A son image". La fonction de la photographie, c'est de porter témoignage, de donner la preuve qui étaye les mots, les soutient, les renforce.
Oh, bien sûr, de nos jours, on peut tout faire dire à une photo, même ce qu'elle n'a jamais voulu dire, on la détourne, la déforme, la recadre, la monte à des fins bien peu glorieuses. Tous les jours sur les réseaux sociaux, on y a droit. Mieux vaut qu'Antonia n'ait pas connu cette époque, ses maux n'en auraient été que renforcés...
Oui, la photo est d'abord un témoignage, nous dit Jérôme Ferrari : "le cliché relève non de l'histoire, mais de l'actualité", écrit-il. Elle n'a pas forcément pour objectif de perdurer, de devenir un document historique, en tout cas, ce n'est pas l'idée du photographe lorsqu'il appuie sur le déclencheur, mais l'Histoire peut parfois s'emparer d'un cliché.
La photo témoigne, de tout et de n'importe quoi, des moments les plus forts et importants, comme des plus futiles et éphémères. "Les hommes aiment à conserver le souvenir émouvant de leurs crimes comme de leurs noces, de la naissance de leurs enfants ou de tout autre moment notable de leur vie, avec la même innocence", lit-on encore.
J'ai été frappé par la récurrence dans le roman du mot "innocence", alors même que les photographes évoqués dans le livre captent régulièrement la laideur de l'être humain et sa profonde duplicité. Un des clichés évoqués, d'ailleurs, incarne parfaitement cela, un soldat frappant violemment du pied un cadavre sur un trottoir, quelque part en Bosnie...
Il y a, derrière cette question de l'innocence, un débat philosophique sur l'image : représente-t-elle la réalité ? Là encore, je vous renvoie au roman, à la vision de Jérôme Ferrari. Mais il est vrai que le choix du cadre, de la composition, de la lumière, tout le travail technique du photographe semble s'opposer à l'idée d'un réel cru, saisi sur le vif.
Et ce débat renvoie au titre du roman : "A son image". Impossible de lire ce roman sans essayer d'attraper les différents sens qui se cachent derrière ce titre. Evidemment en lien avec le personnage d'Antonia, avec les expériences des différents photographes évoqués, sans oublier la dimension religieuse, puisque la Genèse nous dit que "Dieu créa l'homme à son image".
Simple syllogisme : Dieu créa l'homme à son image, or l'homme est monstrueux, donc Dieu est monstrueux. "Le modèle doit être encore pire !", s'écriait Antonia, en partie par révolte contre cet humain capable sans cesse du pire et en partie pour provoquer son parrain. A travers cette formule, c'est bien la question de la fidélité de la reproduction qui est posée, du décalage entre le modèle et sa représentation.
Je suis bien long, je m'en excuse, il y aurait sans doute encore beaucoup à dire sur ce roman, porté par une écriture forte, marque de fabrique de Jérôme Ferrari. De longues semaines que j'ai fini de lire ce livre et vous voyez que les questions qu'il m'a inspirées sont encore bien vivantes. Certainement parce qu'il s'agit de questions très contemporaines dans un monde où l'image est devenue reine.
"Il y a tant de façons de se montrer obscène", écrit Antonia dans le roman. J'ai gardé cette phrase pour la fin de ce billet, car elle met en évidence l'écueil du sensationnalisme, bien plus "vendeur" que la photo de guerre ou d'actualité, pourtant tellement plus importantes que les vulgaires paparazzades... Ainsi va le monde, où le superflu l'emporte sur l'essentiel.
Je vais juste terminer en mettant le lien vers le site du salon du photojournalisme de Perpignan, qui se tient chaque année à la fin de l'été. En surfant sur ce site, en regardant ces clichés, on voit le travail des héritiers de Gaston C. et des autres, et l'on pense alors à Antonia, en se rappelant ces trois mots : utile, courageux, obstiné. Et la volonté de rendre visible ce que personne ne veut voir...
jeudi 20 septembre 2018
"Notre sentence peut-elle signifier que l'accusé aurait dû se comporter en héros ? (...) La justice peut-être correspondre à un très haut idéal : décider de mourir pour des hommes qui auraient été massacrés de toute façon ?"
Ah oui, le titre de notre billet du jour place la barre très haut, j'en conviens ! Mais c'est à la hauteur de ce livre qui nous offre de très nombreuses pistes de réflexion sur l'âme humaine, mais aussi sur cette institution si importance qu'est la justice. Je dois dire que je suis sorti de la lecture de ce roman non seulement bouleversé, mais également bien embarrassé, car le problème qui est posé paraît tout simplement insoluble. "Comme si j'étais seul", titre qui en dit long sur les personnages que l'on va rencontrer, est le premier roman de Marco Magini, sorti il y a quelques jours en poche chez Folio (traduction de Chantal Moiroud) et nous entraîne en Yougoslavie en 1995, alors que la guerre civile qui déchire le pays et les violences ethniques atteignent leur apogée... Un nom symbolise cette période : Srebrenica. Effroyable massacre, effroyable imbroglio. Et les éternelles questions : qui est coupable ? Qui est responsable ? Un roman d'une exceptionnelle densité, d'une grande puissance et des personnages qui hanteront longtemps le lecteur...
Dirk est Néerlandais et appartient au contingent d'un peu plus de 400 Casques bleus envoyé en Yougoslavie au milieu des années 1990 pour s'interposer entre les belligérants. Ils sont basés à Potocari, dans ce que nous appelons désormais la Bosnie et leur quotidien ne ressemble pas vraiment à celui de Drogo et de ses hommes, dans "le Désert des Tartares".
Car si Dirk et ses camarades s'ennuient ferme, c'est avant tout à cause des ordres qu'ils reçoivent, mais pas parce qu'ils attendent l'ennemi. Parce que, officiellement, il n'a pas d'ennemi, le rôle des Casques bleus n'est pas de choisir un camp. Mais, officieusement, l'ennemi est partout : en s'interposant, les soldats de l'ONU réussissent à faire l'unanimité contre eux...
Pire : bientôt, les belligérants, et particulièrement les Serbes, qui gagnent sans cesse du terrain, ont compris qu'ils ne risquaient rien de ces soldats entravés par leur engagement qui leur interdit de combattre. Les provocations se multiplient, les Casques bleus deviennent des cibles, on les attaque de plus en plus ouvertement... Mais les ordres restent les mêmes : on ne tire pas.
En juillet 1995, la nasse se referme : les Serbes encerclent une ville, Srebrenica, et posent un ultimatum aux Casques bleus présents. Ils veulent qu'on leur livre les habitants de cette enclave bosniaque. Commence alors un des plus écoeurants jeux de dupes de l'histoire, dans lequel l'ONU va perdre le peu de crédibilité qu'elle avait déjà, et Dirk une grande partie de son âme...
De l'autre côté, au sein de l'armée serbe, se trouve Drazen. Engagé à tout juste 20 ans, dans les premières heures de la guerre, il a ensuite fondé une famille. Conscient que la situation de son pays natal, s'il existe encore, a franchi un point de non-retour, il envisage sérieusement de s'exiler avec sa femme et sa petite fille, mais on lui refuse sans cesse le droit de se rendre en Suisse.
Puisque la voie officielle ne fonctionne pas, Drazen essaye de se procurer de faux papiers. Il obtient un contact auprès d'un homme qui va profiter de la naïveté du jeune homme et l'amener à s'enrôler encore une fois. Sauf qu'on ne parle plus d'armée yougoslave, mais d'armée serbe, qui n'a plus grand-chose d'une armée régulière.
Et ses méthodes non plus, d'ailleurs. Pillages, viols, exécutions sommaires... Drazen est témoin de tout cela, ne résistant qu'en pensant à Irina et Sanja qui attendent son retour. Témoin, et bientôt acteur. On ne lui laisse pas le choix, s'il refuse d'obéir, on lui fera subir le même sort et il ne reverra jamais sa femme et sa fille...
Alors, Drazen s'exécute, à contre-coeur, certes, mais il commet ces mêmes actes de barbarie que ses camarades. Il n'y prend aucun plaisir, se dégoûte carrément, mais c'est une question de survie. Bientôt, il laissera ça derrière lui et reprendra le cours de sa vie. Comme tout ce pays au bord de l'abîme, essaye-t-il de croire.
Jusqu'à ce que son unité se retrouve aux portes de Srebrenica...
Romeo est Espagnol et il exerce dans son pays la belle profession de juge. Mais il ne siège pas dans son pays, c'est à La Haye qu'il travaille désormais. Au sein du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, mise en place dès 1993 pour juger les crimes de guerre commis lors de ce conflit. Et plus encore après l'horreur de Srebrenica...
Romeo a une très haute opinion de cette nouvelle fonction, qui lui vaut également une notoriété qu'il n'avait pas jusque-là. Il s'agit de rendre la justice, comme auparavant, mais selon le droit international, cette fois. Or, depuis Nuremberg, on sait que ce sont les vainqueurs qui rendent la justice et font condamner les vaincus.
C'est cet écueil que Romeo veut à tout prix éviter : à La Haye, c'est le droit qui devra être dit, en fonction des actes commis et non des rapports de force géopolitiques. Une profession de foi qui va rapidement s'avérer difficile à tenir, car les conflits examinés dans le cadre de la Cour Pénale Internationale offrent des cas particulièrement complexe.
Dans le cas de Romeo, ce cas épineux s'appelle Drazen... "Un simple soldat, Croate, combattant en Bosnie pour les armées serbes", pour citer Romeo lui-même. Le seul participant aux massacres de Srebrenica à avoir avoué son rôle actif, non seulement devant le tribunal, mais avant même cela, devant des caméras de télévision américaines...
En avouant avoir tué des innocents de sang froid, Drazen devient un coupable. En expliquant qu'il a agi sous la contrainte, sa situation devient déjà plus complexe. Mais, lorsqu'on regarde tout ce qui s'est passé en quelques jours à Srebrenica, du côté serbe avant tout, mais aussi du côté de l'ONU et de sa chaîne de commandement, les choses se brouillent carrément.
Drazen est-il coupable, et si oui, de quoi, exactement ? Peut-on donc condamner un homme qui a agi pour ne pas mourir ? Ses aveux sont-ils une circonstance atténuante, surtout si l'on considère qu'il est un cas unique, par sa reddition et ses explications ? Comprendrait-on qu'un homme avouant plus de 70 meurtres puisse être innocenté ?
Au coeur de cette histoire, les notions tellement difficiles à discerner de culpabilité et de responsabilité (en France, on connaît bien ce refrain, souvenez-vous du "responsable mais pas coupable" de Georgina Dufoix, même si ses mots exacts n'étaient pas tout à fait ceux-là), mais aussi des clivages qui apparaissent entre les juges.
On suit les débats entre eux, qui sont autant juridiques que philosophiques, mais aussi culturels et évidemment politiques. Car, malgré les bonnes intentions énoncées par Romeo, tout est question de politique, de rapports de force, d'influence, d'opinions publiques... En un mot comme en sang : tout est question d'image.
On suit les débats qui oppose Romeo et ses collègues, issus de différents pays, de différents continents (on notera l'intransigeance et l'arrogance du juge français, au passage...), mais on suit surtout l'infléchissement progressif des positions du magistrat espagnol. Ses hésitations et ses interrogations, mais aussi, disons-le simplement, sa faiblesse...
"Comme si j'étais seul" est un roman sur des personnes qui n'ont rien de héros. Au sens glorieux du terme, mais également d'une manière plus terre à terre : les protagonistes n'agissent pas par idéal, ou alors, il est vite rangé aux oubliettes. Ils sont finalement assez passifs, à l'exception de Drazen, qui lui a agi... Hélas...
Non, il n'y a pas de héros, dans ce roman. Et aucun des personnages au coeur de ce livre n'est un monstre non plus. Ce sont des êtres tristement humains, soumis à des situations exceptionnelles, comme l'Histoire sait en engendrer. Des héros et des monstres, et entre les deux, une multitude d'hommes et de femmes emportés par ce tourbillon...
Il y a surtout chez Drazen, Dirk et Romeo une effarante naïveté (oui, je sais, c'est toujours facile à dire a posteriori et confortablement assis sur son canapé). Drazen a fait confiance à un inconnu, manifestement indigne de cette confiance ; Dirk a cru qu'en représentant l'ONU, il était au service de l'ordre. De la paix. Et Romeo s'est vu au service de la Justice, avec son épée et sa balance, et surtout son bandeau sur les yeux...
A ce point du billet, il y a un élément très important à donner pour les lecteurs de "Comme si j'étais seul" : si Dirk et Romeo sont des personnages de fiction, Drazen, lui, existe vraiment. Drazen Erdemovic, né en 1971 à Tuzla, en Bosnie, dans une famille croate et combattant au sein de l'armée serbe. A lui seul, il semble incarner l'irrationalité et la complexité de ce conflit.
Marco Magini a choisi de garder son identité et de suivre son parcours chaotique en en faisant l'un des fils rouges de son livre. De raconter cette histoire, l'histoire extraordinaire d'un homme extraordinaire, détruit par des circonstances exceptionnelles. Un homme rongé par une culpabilité immense, qui n'a d'égale que le silence des autres meurtriers de Srebrenica.
Je dois avouer que si on écrivait un roman racontant un tel parcours, on aurait du mal à y croire. Ses origines elles-même paraissent incroyables, tant elles le mettent dans une position terrible, au croisement des trois peuples belligérants... On pourrait honnêtement croire à un artifice romanesque, une création d'un auteur à l'esprit tordu.
Mais ce n'est pas le cas, Drazen Erdemovic est bien ce personnage coincé entre l'enclume yougoslave et les marteaux serbe, croate et bosniaque. Dans ce contexte où chacun doit choisir un camp, rejeter son identité yougoslave pour prendre celle de sa future patrie, il apparaît là encore comme une exception, se sentant avant tout Yougoslave et observant, navré, l'implosion de son pays...
Vous verrez que l'exergue du roman est une phrase de Drazen Erdemovic, vous découvrirez également en ouverture du livre une sorte de prologue, quelques pages à peine, qu'il est bon de relire une fois le livre terminé, pour bien les comprendre, bien les remettre dans leur contexte. Car la construction narrative de "Comme si j'étais seul" est particulière.
Les trois personnages centraux, Dirk, Romeo, Drazen, dans cet ordre, interviennent à travers des chapitres qui leur sont consacrés. Dirk et Drazen sont les narrateurs de leurs histoires respectives, retraçant ainsi leur expérience, comme s'ils témoignaient devant la cour et comme si le lecteur assistait aux audiences. Les chapitres consacrés à Romeo sont à la troisième personne, et donc plus neutres.
Ces récits alternent donc régulièrement, un chapitre sur Dirk, un sur Romeo, un sur Drazen, avec cette particularité que ces trois parcours ne sont pas simultanés : celui de Drazen commence avant les autres puis rejoint celui de Dirk, celui de Romeo se déroulant après. Ce qui accrédite l'idée des témoignages devant la cour, même si ce n'est pas formalisé ainsi.
A travers les yeux de Drazen et de Dirk, on découvre donc comment s'est déroulé le drame de Srebrenica, le pire massacre commis sur le continent européen depuis la IIe Guerre mondiale, huit mille victimes au total. Et ce double point de vue est tout sauf anodin : bien sûr, la folie des troupes serbes d'un côté (et l'on sait que les autres camps ne furent pas en reste), de l'autre, l'inertie de l'ONU.
Je ne suis même pas certain que "inertie" soit un mot suffisant. C'est aussi ce qui est fondamental dans ce livre : nous rappeler les erreurs, les errances, l'impuissance des Casques bleus sur le terrain que vient encore accroître l'absence d'ordres des officiers de l'ONU et l'absence d'initiatives des soldats néerlandais sur le terrain.
Ce roman, c'est aussi un réquisitoire contre "le Machin", qui a démontré jusqu'à l'absurde, jusqu'à l'atroce son inutilité. Une instance internationale qui a fermé les yeux, disons les choses, même si cela peut paraître assez doux, comme formule, mais qui ne s'est pas retrouvée à La Haye, ou alors du côté des juges. Vous voyez le parallèle avec Nuremberg qui réapparaît ?
En fin de roman, Marco Magini a placé trois pages de notes, qui sont en fait des éléments très factuels sur le massacre de Srebrenica. Si le roman ne vous a pas déjà fait froid dans le dos, ces quelques lignes devraient s'en charger... En faisant apparaître tant de lâcheté(s), mais aussi tant de parapluies ouverts pour surtout ne pas reconnaître trop clairement ses fautes...
Je vais être franc, je n'ai aucune idée à propos de Drazen : est-il coupable ou non, fallait-il le condamner ou pas ? Justice n'est pas morale, et réciproquement. Quant à chercher à savoir ce que l'on aurait fait à la place de cet homme, c'est une question absurde, stupide même. De la simple rhétorique qui ne pèserait pas lourd, justement, si l'on était à la place de Drazen.
Non, je ne sais pas ce qu'il fallait faire de Drazen Erdemovic, mais je lui reconnais une immense qualité au milieu de ce sac de crabes : le courage. Le courage d'avoir assumé ses actes, aussi horribles soient-ils. D'affronter la justice, en sachant qu'elle risquait fort de l'envoyer derrière les barreaux pendant un moment.
Le seul homme à avoir reconnu ses fautes. A avoir été condamné pour cela. Côté serbe, mais on pourrait élargir à la communauté internationale, dont la responsabilité est très nettement engagée dans ce massacre. Les Pays-Bas, en première ligne, mais aussi la France, l'OTAN, l'ONU... Tout ceux qui n'ont pas levé le petit doigt et ont laissé faire...
Drazen Erdemovic est aujourd'hui un témoin protégé car on estime que ses aveux le mettent en danger... Aucun autre des assassins de Srebrenica n'a à ce jour comparu devant le Tribunal Pénal International, officiellement, ils sont toujours recherchés... A tout ce que je viens d'énumérer, j'ai la furieuse envie d'ajouter la lenteur de la justice internationale, en me demandant s'il s'agit d'un euphémisme ou d'un oxymore...
Aujourd'hui, quand on tape Srebrenica sur un moteur de recherche et que l'on regarde les images qui sont proposées, ce ne sont pas des vues de cette petite ville de Bosnie qui apparaissent, mais des dizaines, des centaines de clichés du mémorial de Srebrenica-Potorica, inaugurée en 2003, exactement là où se trouvait la base des Casques bleus néerlandais.
On y rappelle le calvaire des 8372 victimes, dont les corps furent jetés dans des charnier. Aujourd'hui encore, le travail d'identification se poursuit, car si l'on connaît l'identité des victimes (vous comprendrez pourquoi en lisant le roman de Marco Magini ; c'est un des éléments les plus consternants de cette affaire), il faut encore déterminer à qui appartiennent les restes...
Vous l'aurez compris, ce roman n'est pas un livre qui brille par sa légèreté. Au contraire, c'est un roman d'une immense puissance, d'une très grande force, écrit par un jeune écrivain (né en 1985, il n'avait que 10 ans lorsque le massacre eut lieu). Un homme engagé, puisque son travail actuel concerne les changements climatiques et le développement durable...
Il est rare qu'en cours de lecture, je note autant de passages qui mériteraient d'être cités dans le billet. J'ai coché près d'une vingtaine de pages sur un roman de 260, des pages où il y a des mots qui frappent, qui troublent, qui mettent en colère, qui bouleversent, qui interrogent, qui déstabilisent, qui bousculent. Marco Magini ne laisse aucun répit à ses lecteurs.
En accroche, sur la quatrième de couverture, on lit : "A Srebrenica, la seule façon de rester innocent était de mourir". Et ce n'est certainement pas une formule. Plus que d'innocence, terme par trop juridique, surtout vu le contexte, on devrait peut-être parler d'humanité... Une question que ne cessent de se poser Drazen et Dirk. Une question qui les hantent, sans doute encore aujourd'hui, près de 25 ans après le massacre...
Dirk est Néerlandais et appartient au contingent d'un peu plus de 400 Casques bleus envoyé en Yougoslavie au milieu des années 1990 pour s'interposer entre les belligérants. Ils sont basés à Potocari, dans ce que nous appelons désormais la Bosnie et leur quotidien ne ressemble pas vraiment à celui de Drogo et de ses hommes, dans "le Désert des Tartares".
Car si Dirk et ses camarades s'ennuient ferme, c'est avant tout à cause des ordres qu'ils reçoivent, mais pas parce qu'ils attendent l'ennemi. Parce que, officiellement, il n'a pas d'ennemi, le rôle des Casques bleus n'est pas de choisir un camp. Mais, officieusement, l'ennemi est partout : en s'interposant, les soldats de l'ONU réussissent à faire l'unanimité contre eux...
Pire : bientôt, les belligérants, et particulièrement les Serbes, qui gagnent sans cesse du terrain, ont compris qu'ils ne risquaient rien de ces soldats entravés par leur engagement qui leur interdit de combattre. Les provocations se multiplient, les Casques bleus deviennent des cibles, on les attaque de plus en plus ouvertement... Mais les ordres restent les mêmes : on ne tire pas.
En juillet 1995, la nasse se referme : les Serbes encerclent une ville, Srebrenica, et posent un ultimatum aux Casques bleus présents. Ils veulent qu'on leur livre les habitants de cette enclave bosniaque. Commence alors un des plus écoeurants jeux de dupes de l'histoire, dans lequel l'ONU va perdre le peu de crédibilité qu'elle avait déjà, et Dirk une grande partie de son âme...
De l'autre côté, au sein de l'armée serbe, se trouve Drazen. Engagé à tout juste 20 ans, dans les premières heures de la guerre, il a ensuite fondé une famille. Conscient que la situation de son pays natal, s'il existe encore, a franchi un point de non-retour, il envisage sérieusement de s'exiler avec sa femme et sa petite fille, mais on lui refuse sans cesse le droit de se rendre en Suisse.
Puisque la voie officielle ne fonctionne pas, Drazen essaye de se procurer de faux papiers. Il obtient un contact auprès d'un homme qui va profiter de la naïveté du jeune homme et l'amener à s'enrôler encore une fois. Sauf qu'on ne parle plus d'armée yougoslave, mais d'armée serbe, qui n'a plus grand-chose d'une armée régulière.
Et ses méthodes non plus, d'ailleurs. Pillages, viols, exécutions sommaires... Drazen est témoin de tout cela, ne résistant qu'en pensant à Irina et Sanja qui attendent son retour. Témoin, et bientôt acteur. On ne lui laisse pas le choix, s'il refuse d'obéir, on lui fera subir le même sort et il ne reverra jamais sa femme et sa fille...
Alors, Drazen s'exécute, à contre-coeur, certes, mais il commet ces mêmes actes de barbarie que ses camarades. Il n'y prend aucun plaisir, se dégoûte carrément, mais c'est une question de survie. Bientôt, il laissera ça derrière lui et reprendra le cours de sa vie. Comme tout ce pays au bord de l'abîme, essaye-t-il de croire.
Jusqu'à ce que son unité se retrouve aux portes de Srebrenica...
Romeo est Espagnol et il exerce dans son pays la belle profession de juge. Mais il ne siège pas dans son pays, c'est à La Haye qu'il travaille désormais. Au sein du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, mise en place dès 1993 pour juger les crimes de guerre commis lors de ce conflit. Et plus encore après l'horreur de Srebrenica...
Romeo a une très haute opinion de cette nouvelle fonction, qui lui vaut également une notoriété qu'il n'avait pas jusque-là. Il s'agit de rendre la justice, comme auparavant, mais selon le droit international, cette fois. Or, depuis Nuremberg, on sait que ce sont les vainqueurs qui rendent la justice et font condamner les vaincus.
C'est cet écueil que Romeo veut à tout prix éviter : à La Haye, c'est le droit qui devra être dit, en fonction des actes commis et non des rapports de force géopolitiques. Une profession de foi qui va rapidement s'avérer difficile à tenir, car les conflits examinés dans le cadre de la Cour Pénale Internationale offrent des cas particulièrement complexe.
Dans le cas de Romeo, ce cas épineux s'appelle Drazen... "Un simple soldat, Croate, combattant en Bosnie pour les armées serbes", pour citer Romeo lui-même. Le seul participant aux massacres de Srebrenica à avoir avoué son rôle actif, non seulement devant le tribunal, mais avant même cela, devant des caméras de télévision américaines...
En avouant avoir tué des innocents de sang froid, Drazen devient un coupable. En expliquant qu'il a agi sous la contrainte, sa situation devient déjà plus complexe. Mais, lorsqu'on regarde tout ce qui s'est passé en quelques jours à Srebrenica, du côté serbe avant tout, mais aussi du côté de l'ONU et de sa chaîne de commandement, les choses se brouillent carrément.
Drazen est-il coupable, et si oui, de quoi, exactement ? Peut-on donc condamner un homme qui a agi pour ne pas mourir ? Ses aveux sont-ils une circonstance atténuante, surtout si l'on considère qu'il est un cas unique, par sa reddition et ses explications ? Comprendrait-on qu'un homme avouant plus de 70 meurtres puisse être innocenté ?
Au coeur de cette histoire, les notions tellement difficiles à discerner de culpabilité et de responsabilité (en France, on connaît bien ce refrain, souvenez-vous du "responsable mais pas coupable" de Georgina Dufoix, même si ses mots exacts n'étaient pas tout à fait ceux-là), mais aussi des clivages qui apparaissent entre les juges.
On suit les débats entre eux, qui sont autant juridiques que philosophiques, mais aussi culturels et évidemment politiques. Car, malgré les bonnes intentions énoncées par Romeo, tout est question de politique, de rapports de force, d'influence, d'opinions publiques... En un mot comme en sang : tout est question d'image.
On suit les débats qui oppose Romeo et ses collègues, issus de différents pays, de différents continents (on notera l'intransigeance et l'arrogance du juge français, au passage...), mais on suit surtout l'infléchissement progressif des positions du magistrat espagnol. Ses hésitations et ses interrogations, mais aussi, disons-le simplement, sa faiblesse...
"Comme si j'étais seul" est un roman sur des personnes qui n'ont rien de héros. Au sens glorieux du terme, mais également d'une manière plus terre à terre : les protagonistes n'agissent pas par idéal, ou alors, il est vite rangé aux oubliettes. Ils sont finalement assez passifs, à l'exception de Drazen, qui lui a agi... Hélas...
Non, il n'y a pas de héros, dans ce roman. Et aucun des personnages au coeur de ce livre n'est un monstre non plus. Ce sont des êtres tristement humains, soumis à des situations exceptionnelles, comme l'Histoire sait en engendrer. Des héros et des monstres, et entre les deux, une multitude d'hommes et de femmes emportés par ce tourbillon...
Il y a surtout chez Drazen, Dirk et Romeo une effarante naïveté (oui, je sais, c'est toujours facile à dire a posteriori et confortablement assis sur son canapé). Drazen a fait confiance à un inconnu, manifestement indigne de cette confiance ; Dirk a cru qu'en représentant l'ONU, il était au service de l'ordre. De la paix. Et Romeo s'est vu au service de la Justice, avec son épée et sa balance, et surtout son bandeau sur les yeux...
A ce point du billet, il y a un élément très important à donner pour les lecteurs de "Comme si j'étais seul" : si Dirk et Romeo sont des personnages de fiction, Drazen, lui, existe vraiment. Drazen Erdemovic, né en 1971 à Tuzla, en Bosnie, dans une famille croate et combattant au sein de l'armée serbe. A lui seul, il semble incarner l'irrationalité et la complexité de ce conflit.
Marco Magini a choisi de garder son identité et de suivre son parcours chaotique en en faisant l'un des fils rouges de son livre. De raconter cette histoire, l'histoire extraordinaire d'un homme extraordinaire, détruit par des circonstances exceptionnelles. Un homme rongé par une culpabilité immense, qui n'a d'égale que le silence des autres meurtriers de Srebrenica.
Je dois avouer que si on écrivait un roman racontant un tel parcours, on aurait du mal à y croire. Ses origines elles-même paraissent incroyables, tant elles le mettent dans une position terrible, au croisement des trois peuples belligérants... On pourrait honnêtement croire à un artifice romanesque, une création d'un auteur à l'esprit tordu.
Mais ce n'est pas le cas, Drazen Erdemovic est bien ce personnage coincé entre l'enclume yougoslave et les marteaux serbe, croate et bosniaque. Dans ce contexte où chacun doit choisir un camp, rejeter son identité yougoslave pour prendre celle de sa future patrie, il apparaît là encore comme une exception, se sentant avant tout Yougoslave et observant, navré, l'implosion de son pays...
Vous verrez que l'exergue du roman est une phrase de Drazen Erdemovic, vous découvrirez également en ouverture du livre une sorte de prologue, quelques pages à peine, qu'il est bon de relire une fois le livre terminé, pour bien les comprendre, bien les remettre dans leur contexte. Car la construction narrative de "Comme si j'étais seul" est particulière.
Les trois personnages centraux, Dirk, Romeo, Drazen, dans cet ordre, interviennent à travers des chapitres qui leur sont consacrés. Dirk et Drazen sont les narrateurs de leurs histoires respectives, retraçant ainsi leur expérience, comme s'ils témoignaient devant la cour et comme si le lecteur assistait aux audiences. Les chapitres consacrés à Romeo sont à la troisième personne, et donc plus neutres.
Ces récits alternent donc régulièrement, un chapitre sur Dirk, un sur Romeo, un sur Drazen, avec cette particularité que ces trois parcours ne sont pas simultanés : celui de Drazen commence avant les autres puis rejoint celui de Dirk, celui de Romeo se déroulant après. Ce qui accrédite l'idée des témoignages devant la cour, même si ce n'est pas formalisé ainsi.
A travers les yeux de Drazen et de Dirk, on découvre donc comment s'est déroulé le drame de Srebrenica, le pire massacre commis sur le continent européen depuis la IIe Guerre mondiale, huit mille victimes au total. Et ce double point de vue est tout sauf anodin : bien sûr, la folie des troupes serbes d'un côté (et l'on sait que les autres camps ne furent pas en reste), de l'autre, l'inertie de l'ONU.
Je ne suis même pas certain que "inertie" soit un mot suffisant. C'est aussi ce qui est fondamental dans ce livre : nous rappeler les erreurs, les errances, l'impuissance des Casques bleus sur le terrain que vient encore accroître l'absence d'ordres des officiers de l'ONU et l'absence d'initiatives des soldats néerlandais sur le terrain.
Ce roman, c'est aussi un réquisitoire contre "le Machin", qui a démontré jusqu'à l'absurde, jusqu'à l'atroce son inutilité. Une instance internationale qui a fermé les yeux, disons les choses, même si cela peut paraître assez doux, comme formule, mais qui ne s'est pas retrouvée à La Haye, ou alors du côté des juges. Vous voyez le parallèle avec Nuremberg qui réapparaît ?
En fin de roman, Marco Magini a placé trois pages de notes, qui sont en fait des éléments très factuels sur le massacre de Srebrenica. Si le roman ne vous a pas déjà fait froid dans le dos, ces quelques lignes devraient s'en charger... En faisant apparaître tant de lâcheté(s), mais aussi tant de parapluies ouverts pour surtout ne pas reconnaître trop clairement ses fautes...
Je vais être franc, je n'ai aucune idée à propos de Drazen : est-il coupable ou non, fallait-il le condamner ou pas ? Justice n'est pas morale, et réciproquement. Quant à chercher à savoir ce que l'on aurait fait à la place de cet homme, c'est une question absurde, stupide même. De la simple rhétorique qui ne pèserait pas lourd, justement, si l'on était à la place de Drazen.
Non, je ne sais pas ce qu'il fallait faire de Drazen Erdemovic, mais je lui reconnais une immense qualité au milieu de ce sac de crabes : le courage. Le courage d'avoir assumé ses actes, aussi horribles soient-ils. D'affronter la justice, en sachant qu'elle risquait fort de l'envoyer derrière les barreaux pendant un moment.
Le seul homme à avoir reconnu ses fautes. A avoir été condamné pour cela. Côté serbe, mais on pourrait élargir à la communauté internationale, dont la responsabilité est très nettement engagée dans ce massacre. Les Pays-Bas, en première ligne, mais aussi la France, l'OTAN, l'ONU... Tout ceux qui n'ont pas levé le petit doigt et ont laissé faire...
Drazen Erdemovic est aujourd'hui un témoin protégé car on estime que ses aveux le mettent en danger... Aucun autre des assassins de Srebrenica n'a à ce jour comparu devant le Tribunal Pénal International, officiellement, ils sont toujours recherchés... A tout ce que je viens d'énumérer, j'ai la furieuse envie d'ajouter la lenteur de la justice internationale, en me demandant s'il s'agit d'un euphémisme ou d'un oxymore...
Aujourd'hui, quand on tape Srebrenica sur un moteur de recherche et que l'on regarde les images qui sont proposées, ce ne sont pas des vues de cette petite ville de Bosnie qui apparaissent, mais des dizaines, des centaines de clichés du mémorial de Srebrenica-Potorica, inaugurée en 2003, exactement là où se trouvait la base des Casques bleus néerlandais.
On y rappelle le calvaire des 8372 victimes, dont les corps furent jetés dans des charnier. Aujourd'hui encore, le travail d'identification se poursuit, car si l'on connaît l'identité des victimes (vous comprendrez pourquoi en lisant le roman de Marco Magini ; c'est un des éléments les plus consternants de cette affaire), il faut encore déterminer à qui appartiennent les restes...
Vous l'aurez compris, ce roman n'est pas un livre qui brille par sa légèreté. Au contraire, c'est un roman d'une immense puissance, d'une très grande force, écrit par un jeune écrivain (né en 1985, il n'avait que 10 ans lorsque le massacre eut lieu). Un homme engagé, puisque son travail actuel concerne les changements climatiques et le développement durable...
Il est rare qu'en cours de lecture, je note autant de passages qui mériteraient d'être cités dans le billet. J'ai coché près d'une vingtaine de pages sur un roman de 260, des pages où il y a des mots qui frappent, qui troublent, qui mettent en colère, qui bouleversent, qui interrogent, qui déstabilisent, qui bousculent. Marco Magini ne laisse aucun répit à ses lecteurs.
En accroche, sur la quatrième de couverture, on lit : "A Srebrenica, la seule façon de rester innocent était de mourir". Et ce n'est certainement pas une formule. Plus que d'innocence, terme par trop juridique, surtout vu le contexte, on devrait peut-être parler d'humanité... Une question que ne cessent de se poser Drazen et Dirk. Une question qui les hantent, sans doute encore aujourd'hui, près de 25 ans après le massacre...
vendredi 14 septembre 2018
"Enfin, le champion peut être un personnage de roman" (Jean Hatzfeld).
Ce titre est un peu spécial, je le reconnais, et il faut donc quelques explications avant d'aller plus loin. Ce billet va concerner le nouveau roman de Jean Hatzfeld, "Deux mètres dix", paru chez Gallimard en cette rentrée littéraire, et l'auteur bénéficie de pas mal de presse, dont un entretien dans le quotidien sportif "L'Equipe", ainsi titré. Mais, ce n'est pas tout : cette phrase est une réponse, à cinquante années d'intervalle, à une tribune d'Antoine Blondin dans "Le Monde", où l'auteur d' "Un singe en hiver" expliquait que "Le champion, élément fabuleux dans le paysage moderne, est un héros qui ne parvient pas à devenir un personnage". En nous emmenant à la rencontre de quatre champions dans deux disciplines quasiment opposées (le saut en hauteur pour les deux athlètes féminines, l'haltérophilie pour les deux athlètes masculins) dont les carrières ont coïncidé avec un événement historique majeur, la Guerre froide, Jean Hatzfeld dresse le portrait de héros, au sens patriotique du terme, mais aussi en son sens antique. Il leur donne de la chair, les montre hors de leur contexte sportif, avec leurs failles, leurs doutes, leurs travers et leurs désillusions. Et en fait de beaux personnages, qui vont grandir en se rencontrant sans s'affronter, cette fois...
Les heures de gloire de Susan Baxter sont loin derrière elle, elles remontent au tournant des années 1970-1980, lorsqu'elle devint une athlète de très haut niveau. Une spécialiste du saut en hauteur ! Une carrière qui a coïncidé avec une période où sport et politique sont entrés en collision, nouvel avatar de la Guerre froide et outil patriotique des deux côtés du rideau de fer.
Aujourd'hui, Susan n'est pas au mieux de sa forme et vie dans un mobile home, quelque part en Arizona. Earl veille sur elle après l'avoir découverte inanimée dans un parc, mais il ne peut rien contre les douleurs qui la tenaillent. Elle n'a plus grand chose de l'athlète qui fut parmi les premières à passer la barre mythique des deux mètres en compétition.
Un jour, au courrier, une enveloppe portant des caractères cyrilliques. Un peu étonnée, elle l'ouvre, déplie le papier qu'elle contient et lis une lettre que lui adresse une certaine Tatyana Alymkul. Un nom qui ne lui aurait rien dit si son interlocutrice n'avait pas précisé qu'il s'agissait de son nom d'épouse et qu'elles sont connues quand elle se nommait Tatyan Izvitkaya.
Plus de trente ans plus tôt, elle fut un phénomène dans le milieu de l'athlétisme mondial. Une sauteuse en hauteur au talent exceptionnel, en dépit d'un gabarit moins élancé que ses concurrentes. Mais une technique parfaite, inimitable. A l'époque où Susan et Tatyana se sont croisées près d'un sautoir, elle était citoyenne soviétique.
Mais Tatyana est désormais Kirghize. Un pays situé dans les steppes d'Asie centrale, indépendant depuis 1991 et le démantèlement de l'U.R.S.S. Un minuscule pays que Susan aurait bien du mal à situer sur une carte. Si vous le cherchez, sachez qu'il est coincé entre le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et la Chine. Capitale : Bichkek.
Tatyana évoque ce pays lointain dans sa lettre et lance à son ancienne rivale une invitation à venir passer quelque temps là-bas, histoire de mieux faire connaissance et d'oublier les soucis en se rappelant des souvenirs de jeunesse. Des souvenirs d'un concours d'anthologie, le seul qu'elles ont disputé l'une contre l'autre.
La famille de Tatyana n'est pas originaire du Kirgizistan, mais de Corée. Elle a fui son pays pour échapper à l'invasion japonaise et est venue s'installer à Vladivostok. On a appelé cette communauté les Koryo-saram, dont les traits reflètent ces racines extrêmes-orientales. Mais, surtout, ces populations ont été victimes comme d'autres des déportations ordonnées par Staline au moment de la IIe Guerre mondiale. Un exil au carré...
Tatyana aussi a connu une carrière éclair, mais glorieuse, du fait des choix politiques en vigueur à l'époque. Championne olympique à Moscou en 1980, à la surprise générale, elle n'a pas pu participé aux Jeux suivants. Et ce n'est pas la seule athlète dans ce cas. Un autre Kirghize a marqué cette Olympiade : Chabdan Orozbakov, l'homme aux 53 records du monde.
Lui aussi est monté sur la plus haute marche du podium olympique à Moscou, en remportant l'or en haltérophilie, mais ce qui devait être l'apothéose de sa carrière a pris une tournure tout à fait inattendue. Ce colosse aux mouvements d'une fluidité exceptionnelle a fait un choix fort, dangereux, en toute connaissance de cause. Tatyana fut témoin de sa chute...
Mais, aujourd'hui, Chabdan est une véritable légende au Kirghizistan, on le célèbre comme un personnage mythologique, un demi-dieu, on le statufie, on lui consacre des fresques, un musée... Il est l'idole de ce pays tout juste naissant, lui, l'homme fort issu des montagnes kirghizes, si différents des autres athlètes de son temps.
En 1978, lors des Championnats du monde à Gettysburg, Chabdan s'était imposé sans coup férir, malgré l'ambiance terriblement hostile : "Fuck the Red", criait la foule, et l'un de ceux qui criaient le plus fort s'appelait Randy Wayne. Il n'était pas un simple spectateur, non, il était le principal concurrent de Chabdan.
Ce jour-là, en plus d'une bonne leçon sportive, il a également pris une sacrée leçon d'humilité. Il ne l'a pas compris sur le moment, aveuglé par la haine inculquée par tout un système, mais bien plus tard, une fois sa carrière terminée, alors qu'il ne met plus les pieds dans les salles de musculation, il s'est rendu compte que son adversaire d'alors était un être hors norme.
Aujourd'hui, Randy a bien changé, il a laissé derrière lui cette agressivité qui n'avait rien de fair-play et n'était certainement pas dans l'esprit du sport. En quête de rédemption, mais aussi d'une vie plus saine, Randy a décidé de partir sur les traces de son légendaire rival et d'en profiter pour prendre un bon bol d'air dans les montagnes kirghizes...
Quatre athlètes, quatre personnages, quatre héros, même si ce mot est à nuancer. Quatre champions, en tout cas, car dans leurs disciplines respectives, ils ont tous brillé, parfois très brièvement. Quatre trajectoires qui auraient pu les mener plus loin encore au panthéon du sport s'il n'y avait eu la politique internationale. La bipolarisation du monde, sa séparation en deux blocs idéologiques antagonistes.
Avant de revenir sur ce contexte, il faut que je précise quelque chose : j'ai chois de présenter les quatre personnages centraux de "Deux mètres dix" sans tout à fait tenir compte de la narration. Car, vous le verrez, on ne suit pas ces personnages simultanément, l'une amène l'autre, et l'autre amène le suivant, comme s'ils étaient reliés les uns aux autres.
On découvre ces deux femmes et ces deux hommes à travers deux époques : celle de leur gloire sportive et leur vie actuelle, sensiblement différente (j'essaye de ne pas tout dévoiler, je reste donc prudent). Le temps qui a passé n'explique pas seulement les différences entre ces deux âges, non, c'est l'Histoire qui les a marqués de façon indélébile.
Venons-en à ce contexte historique loin d'être anodin : tout tourne en effet entre la fin des années 1970, l'U.R.S.S. de Brejnev face aux Etats-Unis de Carter, jusqu'aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984. Et cette courte période occupe pourtant une place charnière, tant sur le plan politique que sportif, la première investissant alors le champ du second.
L'image de cet envahissement du sport par la politique est presque allégorique, car l'événement clé, c'est l'entrée des chars soviétiques en Afghanistan, fin 1979. Oh, avant cela, il y avait déjà des tensions entre les deux superpuissances, mais à partir de cette date, on entre dans quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusque-là, en tout cas avec cette ampleur.
Ce phénomène, c'est l'ère des boycotts : plus de 60 pays, les Etats-Unis en tête, ne se sont pas rendus à Moscou, d'autres ont choisi d'y participer, mais on ne hissa pas leur drapeau, on ne joua pas leur hymne lors des remises de médailles. Rebelote quatre ans plus tard, à Los Angeles, avec l'U.R.S.S. qui rend la monnaie de sa pièce à l'Amérique, suivie par ses satellites et certains alliés...
Des décisions qui ont eu des conséquences pour les athlètes, devenus malgré eux des pions sur un échiquier qu'on déplace au gré des périodes de tension ou de détente diplomatique. Certains ont vu leur rêve olympique, leur graal brisé, d'autres ont dû attendre, d'autres, comme les Français, à Moscou, en garderont un souvenir un peu gâché...
Pire encore, à cette époque, c'est la politique qui a fait et défait les carrières. Et dans "Deux mètres dix", c'est vraiment le cas pour les deux sauteuses en hauteur, ainsi que pour Chabdan. Leurs performances, leurs ambitions, tout cela a été jeté aux orties et les choix qui ont été effectués ont été très violents pour certains athlètes.
Enfin, il y a la question du dopage : un système étatique et scientifique, côté bloc soviétique ; des méthodes plus personnelles et individuelles, côté américain. Mais le même objectif : gagner, pour marquer son territoire, pour s'imposer à l'autre. Pour déclencher une espèce de partie de "Risk" où l'on utilise les médailles, et les médailles d'or en particulier, pour gagner du terrain et de l'influence.
Un objectif qui ne tient absolument pas compte de la santé et de l'avenir de celles et ceux qu'on a gavé de substances censées améliorer les performances. Combien ont été détruits par ce système complètement fou ? Susan et Randy sont dans un état physique déplorable, et ce qu'ils ont absorbé pour devenir des champions n'y est pas étranger.
Mais, si Jean Hatzfeld tient compte de tout cela pour façonner ses personnages, ce n'est pas ce qui l'intéresse en premier lieu. Car, chargés ou pas, ces athlètes sont exceptionnels et ont travaillé d'arrache-pied pour le devenir depuis longtemps. A travers les histoires des uns et des autres, on découvre d'ailleurs les systèmes de formation des deux blocs.
On découvre ainsi que Dick Fosbury, qui révolutionna le saut en hauteur en abandonnant le saut ventral pour le saut dorsal, était considéré comme un ennemi de l'Union Soviétique et sa technique était interdite à l'est. Les entraîneurs qui enfreignaient cette règle risquaient gros... jusqu'à ce qu'on réalise que les sauteuses et les sauteurs qui ne le pratiquaient pas n'avait plus aucune chance de gagner...
Cela nous amène à un point toujours délicat dans les livres traitant de sport : l'évocation de la technique. Oh, j'en vois qui, en découvrant que le roman de Jean Hatzfeld parle de saut en hauteur et d'haltérophilie (d'haltérophilie !!! Nan mais allô, quoi !!!) ont déjà décidé de boycotter cette lecture. Ils auraient bien tort, en tout cas pas en s'appuyant sur de tels a priori.
Il y a de magnifiques pages sur la technique de ces deux sports, sur la manière dont les pratiquent les différents personnages, ce qui les démarque de la concurrence et en fait des champions hors norme, non seulement par les palmarès, les hauteurs passées et les poids soulevés, mais aussi parce qu'ils s'agissent pas comme les autres...
Les deux Kirghizes, plus particulièrement, sont des exemples remarquables, des athlètes qui ont appris les techniques, certes, mais les ont assimilé à leur manière, en y ajoutant leur culture, leur philosophie de l'existence... Les descriptions des sauts de Tatyana et des levers de Chabdan sont des merveilles, on a l'impression d'être aux premières loges.
De ces gestes, loin d'être évidents, qu'on doive sauter plus de deux mètres ou soulever à bout de bras plus de 250 kilos de fonte, Tatyana et Chabdan savent tirer une quintessence, leur donner un naturel qui semble atténuer les contraintes physiques. C'est délié, léger, fluide, ça semble d'une facilité déconcertante, quand tous les autres échouent.
Tatyana semble s'envoler et apprivoiser la barre, quelle que soit sa hauteur, quand Chabdan fait corps avec la charge au lieu de se battre contre elle. C'est magnifique à voir, pardon, à imaginer, puisque ces personnages n'ont jamais vraiment évoluer, qu'on ne peut pas retrouver sur YouTube leurs exploits, comme on peut le faire, par exemple, avec ceux d'une Nadia Comaneci...
Oui, "Deux mètres dix" est bien un roman sur le sport, sur deux disciplines qui sont loin d'être les plus médiatiques, les plus courues, en tout cas dans notre pays. Au passage, précisons que ce titre, "Deux mètres dix", fait référence à la hauteur infranchissable depuis toujours par les sauteuses. Depuis 1987, le record du monde est bloqué à 2,09m, par une athlète bulgare (donc à prendre avec les doutes liés à ce que nous avons évoqué plus haut).
Mais c'est aussi un roman sur les sportifs, qui depuis toujours, depuis l'antiquité et la fondation des Jeux olympiques, ont été considérés comme des héros, s'inscrivant dans une mythologie, acquérant une essence quasi divine par leurs exploits. On retrouve toujours cela, on le voit d'ailleurs à chaque grande victoire, la dernière en date, à Moscou, encore, en juillet, l'a bien montré.
Des héros, oui, des légendes, et dans le roman, c'est véritablement le cas de Chabdan, dont l'histoire personnelle, les origines, le parcours personnel et sportif, le destin ont intégré l'histoire du pays jusqu'à faire de lui une image tutélaire, une idole absolue, un symbole de la nation et de sa culture. Une incarnation de son sport. Un homme à la carrure de dieu.
Il est aussi un héros pour son geste fou sur le podium de Moscou, pour cet acte de liberté et de rébellion qui a marqué tous ceux qui ont vu la scène. Au héros sportif, il ajoute la dimension de héros politique, de symbole patriotique et même, ce qui, hélas, n'est jamais très bon, nationaliste. Un résistant. Un héros de l'Histoire.
A l'inverse, les trois autres personnages se sont éloignés de leur sport. Ils sont retombés dans l'anonymat et ont laissé complètement derrière eux la discipline qui leur a apporté la gloire. Leurs noms n'apparaissent qu'en petits caractères dans les livres et les sites internet spécialisés, même si certains de leurs exploits restent en mémoire des aficionados.
C'est là que l'on retrouve toute la réponse de Jean Hatzfeld à Antoine Blondin : ce dernier, qui a écrit de si beaux éditoriaux sur les exploits sportifs pour "l'Equipe", ne voit en eux que des héros ne vivant qu'à travers leurs exploits ; Hatzfeld lui prouve encore une fois qu'ils sont aussi des être humains, possédant un libre arbitre, soumis aux soubresauts de l'histoire et à leurs passions.
D'ailleurs, on peut aller dans le sens de Jean Hatzfeld avec un simple exemple : Jesse Owens serait un immense champion quoi qu'il arrive, mais ce qui le fait entrer dans l'histoire, dans l'imaginaire collectif bien au-delà du sport, c'est le contexte de ses exploits, le camouflet infligé aux nazis. Quant à Chabdan, dans le livre, son geste rappelle le point levé et ganté de Tommie Smith et John Carlos...
Oui, Jean Hatzfeld donne vie à ses héros, il leur donne une existence en tant que personnages, et ce n'est pas la première fois : avec "Où en est la nuit", déjà, puis "Robert Mitchum ne revient pas", il avait confronté des personnages de sportifs à la guerre et à ses conséquences. Sur leurs carrières, mais plus encore sur leur vie.
A ceux qui ont découvert Jean Hatzfeld, comme ce fut mon cas, à travers ses livres sur le génocide rwandais, ce goût pour le sport peut surprendre. Mais il faut savoir que c'est par le journaliste sportif qu'il a entamé sa carrière dans les années 1970. Il a d'ailleurs couvert les JO de Moscou et Los Angeles (il cite d'ailleurs un de ses articles dans le roman), et ce qu'il évoque ici le renvoie aussi à ses souvenirs.
Vous n'aimez pas le sport ? Vous avez galéré au collège avec le saut en hauteur et vous soulevez péniblement un pack d'eau pour le mettre dans le coffre de votre voiture ? Peu importe, ce livre est bien plus que cela, un récit positif sur l'amitié et la solidarité, malgré la rivalité, malgré la politique qui les a tronquées, sur l'expérience commune du haut niveau, mais aussi la passion pour un sport et les gestes qui le symbolisent.
Et si vous ne voyez pas en eux des héros, parce que le sport vous indiffère ou que vous préférez attribuer ce mot à d'autres genres de personnes, alors, découvrez ces personnages, attachants malgré leurs failles, leurs erreurs parfois. Et laissez vous transporter dans un univers dépaysant, le Kirghizistan, ses montagnes et ses lacs, son air pur et ses moutons...
"La vie est une histoire pleine de cruauté, de bruit et de fureur et elle est racontée par Julien Lepers".
Comme souvent en cette rentrée littéraire, on cherche les livres un peu marrants, ceux qui ne vont pas vous donner envie d'ouvrir le gaz ou la fenêtre de votre 8e étage. Bref, des livres qui adoptent le ton de la comédie, même si, derrière les apparences et la tonalité globale, on trouve des sujets sérieux... C'est le cas avec notre livre du jour, au sujet pour le moins surprenant, puisque nous allons entrer dans les coulisses d'un célèbre jeu télévisé... "Einstein, le sexe et moi", d'Olivier Liron (chez Alma éditeur), est une auto-fiction (oui, je sais... Je sais !), mais c'est aussi un roman qui parle de la différence, du mal-être que cela suscite, de l'impression de ne pas trouver sa place dans le monde, de la timidité profonde d'un jeune homme qu'il combat avec les armes dont il dispose, et en particulier une mémoire travaillée comme on sculpte une musculature. Sans oublier une bonne dose d'humour et d'auto-dérision, une chemise rouge, des madeleines et du Coca (le goûter des champions !)...
A l'été 2012, Olivier est convoqué aux studios de la Plaine-Saint-Denis pour participer à un enregistrement. Quelques mois plus tôt, il a remporté trois victoires à l'émission "Questions pour un champion" avant de chuter (et de louper la cagnotte, qu'on décroche avec 5 victoires consécutives). Mais, cela lui ouvre les portes de la version dominicale du jeu.
Si vous n'êtes pas des habitués du jeu diffusé en début de soirée sur France 3, il y a le jeu dans sa version classique, du lundi au samedi, et le dimanche, une émission particulière où s'affrontent ceux qui ont gagné un certain nombre de fois. La crème de la crème des champions, avec un champion en titre qu'il faut détrôner, et cinq duels à gagner pour repartir avec 50 000 euros.
Olivier n'est donc qu'un challenger parmi d'autres, quatre personnes pleines d'érudition qui vont devoir se départager à travers différentes épreuves. Le matin des enregistrements (qui ont lieu plusieurs mois avant la diffusion), Olivier n'entend pas son réveil ! Début de panique, départ en catastrophe, arrivée en nage et dépenaillé... Pour découvrir que son tour aura lieu en fin d'après-midi...
Des heures à tuer dans les coulisses, sans trop s'intéresser aux enregistrements précédents ou au champion qu'il devra affronter dans un face-à-face crucial s'il se débarrasse de ses adversaires. De temps en temps, il croise un membre de l'équipe de production ou Julien Lepers himself, mais l'essentiel de cette journée, il le passe à réviser mentalement ce qu'il a appris.
Car Olivier a sacrément bossé pour devenir un champion, franchir les différentes épreuves, "le 9 points gagnants", où il faut faire preuve de rapidité, "le quatre à la suite", qui nécessite de la concentration pour ne pas perdre le fil, et "le face-à-face", où la stratégie est aussi importante que les connaissances.
Il a rédigé des listes et des listes, de dates, d'événements, de personnalités, il est incollable en botanique, capable de reconnaître n'importe quelle plante à son nom latin... Mais il a aussi des lacunes, forcément, comme les autres candidats, d'ailleurs. A lui de savoir gérer au mieux ses points forts et de bluffer quand c'est nécessaire.
Reste un élément que je n'ai pas encore évoqué : à 25 ans, Olivier est devenu un des plus jeunes champions de l'émission, et s'il a fait cette démarche de s'inscrire aux sélections et de participer à ce jeu télévisé, ce n'est pas par appât du gain, par passion pour ces émissions, par narcissisme, mais parce qu'il y voyait un moyen d'améliorer sa situation...
Olivier présente un syndrome d'Asperger, "ce n'est pas une maladie", insiste-t-il, "c'est une différence". Mais c'est surtout ce qui fait de lui depuis toujours un être à part. Cette expression, "être à part", est véritablement à double tranchant : on peut l'employer pour désigner quelqu'un qui sort du lot par ses compétences, son talent, mais, si on le prend au premier degré, c'est quelqu'un qu'on met à part.
Et depuis l'enfance, Olivier à été mis à part. A l'école et depuis qu'il est adulte aussi. Quoi qu'il fasse, on le regarde différemment, il est bizarre, trop bizarre, un drôle de bonhomme. Il était un parfait souffre-douleur, un gars qu'on peut moquer, qu'on peut ridiculiser dans la cour de récréation. Qu'on peut cogner, aussi...
Il y a, dans cette distinction entre maladie et différence qui intervient tout de suite dans le livre, quelque chose qui frappe l'esprit, et lui fait un méchant oeil au beurre noir... "Einstein, le sexe et moi", c'est l'histoire d'un homme qui peine à trouver sa place dans la société, à vivre, aïe, le vilain mot qui arrive, à vivre "normalement".
La relation à l'autre est un problème constant pour Olivier, et lorsqu'il s'agit des femmes, des sentiments, de l'amour et donc, du sexe, c'est sans doute encore plus compliqué... Et toute cette accumulation de difficultés, cette sensation d'être sans cesse mis à l'écart, rejeté, ça n'aide pas à grandir, à avoir confiance en soi...
"Einstein, le sexe et moi", c'est le récit de cette journée pas comme les autres où Olivier va participer à l'enregistrement de "Questions pour un super champion", avec la détermination farouche de s'imposer, coûte que coûte. Cela fait longtemps que je n'ai pas regardé ce jeu (je crois que je ne l'ai même jamais vu depuis que Samuel Etienne a remplacé Julien Lepers), mais je ne l'avais jamais vu ainsi.
Car, Olivier ne se contente pas de nous faire pénétrer dans les coulisses du jeu, mais on vit cette émission de l'intérieur, comme en caméra embarquée, si je puis dire, à travers le regard d'Olivier, ses observations, ses sensations, ses impressions sur les autres participants, son état d'esprit au fil des questions, des réponses et des scores qui évoluent.
Le fil conducteur, c'est cette émission, dont on imagine qu'elle n'a pas été totalement choisie au hasard (il faut dire qu'il y a tous les ingrédients pour en faire un sujet de romans, rebondissements, émotions, suspense... Il emprunte aux codes du thriller et on se prend au jeu, c'est le cas de le dire), que l'on suit non pas comme si on était devant sa télé, mais comme si on était dans le public, au studio.
Au gré des épreuves, des questions, des différentes étapes du jeu, des pauses, parfois prévues, d'autres fois nom, l'esprit d'Olivier s'éloigne du plateau et de la Plaine-Saint-Denis. Il nous emmène alors dans son passé, dans son enfance complexe, dans ses souvenirs et même dans ses rêves (dont certains sont assez croquignolets, joyeusement délirants, mais aussi empreints de souffrance)...
Jusque-là, Olivier était à part, dans le mauvais sens du terme. Cette fois, il entend bien être à part en sortant du lot. En éliminant un à un ses adversaires et en allant défier le champion en titre, en lui piquant sa place. Il a bossé, il a confiance en ce qu'il sait, il espère qu'il aura le zeste de chance nécessaire... Il est surtout remonté comme un coucou suisse, le garçon !
Au coeur, il a une rage flamboyante, celle qu'il a accumulée au fil de toute sa jeune existence, à travers ses échecs, ses problèmes, ses déceptions, ses blessures... Une rage qu'il canalise cette fois pour en faire une arme positive vers la consécration d'une victoire à l'un des jeux les plus populaires de la télévision française (et certainement pas le plus facile, qui plus est).
"L'important, c'est de participer", ce n'est pas la maxime d'Olivier, non, lui n'envisage qu'une seule chose, la victoire. Il n'est pas là pour faire de cadeaux, pour sympathiser avec ses adversaires, pas même avec le célèbre présentateur du show, non, il veut l'emporter. Et pour cela, il est prêt à tout déchiqueter avec les dents...
L'expression n'est pas de moi, je le précise. C'est un leitmotiv du roman que je reprends ici, parce qu'il reflète très bien l'état d'esprit d'Olivier : longtemps passif face à ceux qui lui faisaient du mal, le brutalisaient, il est désormais mû par une combativité de chaque instant. Lorsqu'il appuie sur le buzzer, lorsqu'il prend la main, lorsqu'il répond à une question, c'est comme s'il rendait les coups ou les insultes reçus.
Comme s'il exorcisait les moments pénibles et les désillusions, comme s'il renversait le destin, comme on détrône un super champion en quelques réponses données au meilleur moment (celui qui vaut 4 points). Cette agressivité qui traverse le roman est à la fois très amusante (il a l'oeil du tigre !), mais aussi un symptôme de tout ce qui est allé de travers dans sa vie. Et c'est ce qui touche aussi...
Alors, oui, "Einstein, le sexe et moi" est un roman très drôle, grâce au sens de l'observation d'Olivier Liron, qui nous offre quelques portraits sur le vif de ses concurrents, qui croque un Julien Lepers plus vrai que nature et ressort quelques dossiers (ah, la carrière de chanteur de Julien, du miel pour les oreilles... A écouter Pour le plaisiiiir... hum, désolé...), qui se met en scène avec beaucoup d'humour.
Oui, c'est une auto-fiction, mais il y a quelque chose d'un spectacle de stand-up dans ce roman. Olivier Liron saisit les aspérité, les travers, les dérapages, les imprévus et les raconte à sa manière. Avec en plus un énorme avantage : la très grande majorité des lecteurs visualisera parfaitement de quoi il est question lorsque c'est le jeu qui est le cadre du récit.
Et puis, derrière le décor télévisuel, la mise en scène de l'émission (avec un Julien Lepers plus vrai que nature, complètement barré, ne surjouant jamais, non, c'est pas son genre, et agaçant à souhait, dont le nom, je crois savoir, devait initialement figurer dans le titre du roman avant d'y être remplacé par Einstein, quelle promotion !), il y a cette douleur qui transparaît.
Asperger, c'est un mot qui fait peur, qu'on sache ou non ce qu'il veut dire exactement. Et peut-être plus encore quand on ne sait pas à quoi ça correspond. Reste la différence... Ce gouffre qui sépare un jeune homme intelligent (Olivier Liron est normalien, spécialiste en histoire de l'art, musicien de talent... Il n'est pas du tout énervant non plus, mais pas pour les mêmes raisons que Julien Lepers !) des autres.
Pour lui, participer à "Questions pour un champion", c'est se lancer dans une quête initiatique. Une quête vers l'épanouissement, vers une meilleure estime de soi. Peut-être aussi vers le droit d'être regardé autrement, avec plus de respect. Et plus de séduction, aussi, eh oui, ça compte ! Le gouffre n'est pas entièrement comblé, le sera-t-il d'ailleurs un jour, mais il s'est réduit.
Le dernier chapitre du roman est très émouvant, le récit du premier jour du reste de la vie d'Olivier Liron. Une vie qui n'est plus un boulet attaché à la cheville et entravant les mouvements, mais quelque chose de plus léger, de plus zen. Une période où le regard d'autrui n'a plus vraiment d'importance.
J'ai retrouvé dans "Einstein, le sexe et moi" bien des aspects déjà vus dans "les Bracassées", de Marie-Sabine Roger. Olivier Liron ne déparerait certainement pas aux côtés de Fleur et Harmonie, d'ailleurs. Avec la même volonté de traiter ces questions difficiles et douloureuses avec humour pour les pourfendre.
Mais il y a un élément en plus dans le livre d'Olivier Liron : ce qu'il nous raconte, c'est sa vie, pas celle de personnages qu'il a inventés. On est bien sûr dans l'auto-fiction, pas dans le récit brut des faits, mais qu'on le veuille ou non, c'est de lui qu'il nous parle. Il nous ouvre son coeur, sa mémoire, sa douleur, pour que nous la partagions et que nous assistions à sa bataille décisive.
C'est un livre très drôle, mais aussi plein d'émotions, ce garçon est très touchant, capable de rire de lui-même autant que des autres (ce qui n'est pas la moindre des qualités), mais capable aussi d'une grande poésie, comme lorsqu'on le suit au milieu des oeuvres de Mark Rothko, exposées à la Tate Modern, à Londres.
Rien n'est simple, on le comprend en lisant certains passages du livre, même après cette émission qui marque un tournant, il y a eu des obstacles et des difficultés lourdes, mais je crois que l'Olivier Liron d'après QPUC n'est plus le même qu'avant cette expérience. Il se sent sans doute toujours différent, mais pour nous, admirable.
A l'été 2012, Olivier est convoqué aux studios de la Plaine-Saint-Denis pour participer à un enregistrement. Quelques mois plus tôt, il a remporté trois victoires à l'émission "Questions pour un champion" avant de chuter (et de louper la cagnotte, qu'on décroche avec 5 victoires consécutives). Mais, cela lui ouvre les portes de la version dominicale du jeu.
Si vous n'êtes pas des habitués du jeu diffusé en début de soirée sur France 3, il y a le jeu dans sa version classique, du lundi au samedi, et le dimanche, une émission particulière où s'affrontent ceux qui ont gagné un certain nombre de fois. La crème de la crème des champions, avec un champion en titre qu'il faut détrôner, et cinq duels à gagner pour repartir avec 50 000 euros.
Olivier n'est donc qu'un challenger parmi d'autres, quatre personnes pleines d'érudition qui vont devoir se départager à travers différentes épreuves. Le matin des enregistrements (qui ont lieu plusieurs mois avant la diffusion), Olivier n'entend pas son réveil ! Début de panique, départ en catastrophe, arrivée en nage et dépenaillé... Pour découvrir que son tour aura lieu en fin d'après-midi...
Des heures à tuer dans les coulisses, sans trop s'intéresser aux enregistrements précédents ou au champion qu'il devra affronter dans un face-à-face crucial s'il se débarrasse de ses adversaires. De temps en temps, il croise un membre de l'équipe de production ou Julien Lepers himself, mais l'essentiel de cette journée, il le passe à réviser mentalement ce qu'il a appris.
Car Olivier a sacrément bossé pour devenir un champion, franchir les différentes épreuves, "le 9 points gagnants", où il faut faire preuve de rapidité, "le quatre à la suite", qui nécessite de la concentration pour ne pas perdre le fil, et "le face-à-face", où la stratégie est aussi importante que les connaissances.
Il a rédigé des listes et des listes, de dates, d'événements, de personnalités, il est incollable en botanique, capable de reconnaître n'importe quelle plante à son nom latin... Mais il a aussi des lacunes, forcément, comme les autres candidats, d'ailleurs. A lui de savoir gérer au mieux ses points forts et de bluffer quand c'est nécessaire.
Reste un élément que je n'ai pas encore évoqué : à 25 ans, Olivier est devenu un des plus jeunes champions de l'émission, et s'il a fait cette démarche de s'inscrire aux sélections et de participer à ce jeu télévisé, ce n'est pas par appât du gain, par passion pour ces émissions, par narcissisme, mais parce qu'il y voyait un moyen d'améliorer sa situation...
Olivier présente un syndrome d'Asperger, "ce n'est pas une maladie", insiste-t-il, "c'est une différence". Mais c'est surtout ce qui fait de lui depuis toujours un être à part. Cette expression, "être à part", est véritablement à double tranchant : on peut l'employer pour désigner quelqu'un qui sort du lot par ses compétences, son talent, mais, si on le prend au premier degré, c'est quelqu'un qu'on met à part.
Et depuis l'enfance, Olivier à été mis à part. A l'école et depuis qu'il est adulte aussi. Quoi qu'il fasse, on le regarde différemment, il est bizarre, trop bizarre, un drôle de bonhomme. Il était un parfait souffre-douleur, un gars qu'on peut moquer, qu'on peut ridiculiser dans la cour de récréation. Qu'on peut cogner, aussi...
Il y a, dans cette distinction entre maladie et différence qui intervient tout de suite dans le livre, quelque chose qui frappe l'esprit, et lui fait un méchant oeil au beurre noir... "Einstein, le sexe et moi", c'est l'histoire d'un homme qui peine à trouver sa place dans la société, à vivre, aïe, le vilain mot qui arrive, à vivre "normalement".
La relation à l'autre est un problème constant pour Olivier, et lorsqu'il s'agit des femmes, des sentiments, de l'amour et donc, du sexe, c'est sans doute encore plus compliqué... Et toute cette accumulation de difficultés, cette sensation d'être sans cesse mis à l'écart, rejeté, ça n'aide pas à grandir, à avoir confiance en soi...
"Einstein, le sexe et moi", c'est le récit de cette journée pas comme les autres où Olivier va participer à l'enregistrement de "Questions pour un super champion", avec la détermination farouche de s'imposer, coûte que coûte. Cela fait longtemps que je n'ai pas regardé ce jeu (je crois que je ne l'ai même jamais vu depuis que Samuel Etienne a remplacé Julien Lepers), mais je ne l'avais jamais vu ainsi.
Car, Olivier ne se contente pas de nous faire pénétrer dans les coulisses du jeu, mais on vit cette émission de l'intérieur, comme en caméra embarquée, si je puis dire, à travers le regard d'Olivier, ses observations, ses sensations, ses impressions sur les autres participants, son état d'esprit au fil des questions, des réponses et des scores qui évoluent.
Le fil conducteur, c'est cette émission, dont on imagine qu'elle n'a pas été totalement choisie au hasard (il faut dire qu'il y a tous les ingrédients pour en faire un sujet de romans, rebondissements, émotions, suspense... Il emprunte aux codes du thriller et on se prend au jeu, c'est le cas de le dire), que l'on suit non pas comme si on était devant sa télé, mais comme si on était dans le public, au studio.
Au gré des épreuves, des questions, des différentes étapes du jeu, des pauses, parfois prévues, d'autres fois nom, l'esprit d'Olivier s'éloigne du plateau et de la Plaine-Saint-Denis. Il nous emmène alors dans son passé, dans son enfance complexe, dans ses souvenirs et même dans ses rêves (dont certains sont assez croquignolets, joyeusement délirants, mais aussi empreints de souffrance)...
Jusque-là, Olivier était à part, dans le mauvais sens du terme. Cette fois, il entend bien être à part en sortant du lot. En éliminant un à un ses adversaires et en allant défier le champion en titre, en lui piquant sa place. Il a bossé, il a confiance en ce qu'il sait, il espère qu'il aura le zeste de chance nécessaire... Il est surtout remonté comme un coucou suisse, le garçon !
Au coeur, il a une rage flamboyante, celle qu'il a accumulée au fil de toute sa jeune existence, à travers ses échecs, ses problèmes, ses déceptions, ses blessures... Une rage qu'il canalise cette fois pour en faire une arme positive vers la consécration d'une victoire à l'un des jeux les plus populaires de la télévision française (et certainement pas le plus facile, qui plus est).
"L'important, c'est de participer", ce n'est pas la maxime d'Olivier, non, lui n'envisage qu'une seule chose, la victoire. Il n'est pas là pour faire de cadeaux, pour sympathiser avec ses adversaires, pas même avec le célèbre présentateur du show, non, il veut l'emporter. Et pour cela, il est prêt à tout déchiqueter avec les dents...
L'expression n'est pas de moi, je le précise. C'est un leitmotiv du roman que je reprends ici, parce qu'il reflète très bien l'état d'esprit d'Olivier : longtemps passif face à ceux qui lui faisaient du mal, le brutalisaient, il est désormais mû par une combativité de chaque instant. Lorsqu'il appuie sur le buzzer, lorsqu'il prend la main, lorsqu'il répond à une question, c'est comme s'il rendait les coups ou les insultes reçus.
Comme s'il exorcisait les moments pénibles et les désillusions, comme s'il renversait le destin, comme on détrône un super champion en quelques réponses données au meilleur moment (celui qui vaut 4 points). Cette agressivité qui traverse le roman est à la fois très amusante (il a l'oeil du tigre !), mais aussi un symptôme de tout ce qui est allé de travers dans sa vie. Et c'est ce qui touche aussi...
Alors, oui, "Einstein, le sexe et moi" est un roman très drôle, grâce au sens de l'observation d'Olivier Liron, qui nous offre quelques portraits sur le vif de ses concurrents, qui croque un Julien Lepers plus vrai que nature et ressort quelques dossiers (ah, la carrière de chanteur de Julien, du miel pour les oreilles... A écouter Pour le plaisiiiir... hum, désolé...), qui se met en scène avec beaucoup d'humour.
Oui, c'est une auto-fiction, mais il y a quelque chose d'un spectacle de stand-up dans ce roman. Olivier Liron saisit les aspérité, les travers, les dérapages, les imprévus et les raconte à sa manière. Avec en plus un énorme avantage : la très grande majorité des lecteurs visualisera parfaitement de quoi il est question lorsque c'est le jeu qui est le cadre du récit.
Et puis, derrière le décor télévisuel, la mise en scène de l'émission (avec un Julien Lepers plus vrai que nature, complètement barré, ne surjouant jamais, non, c'est pas son genre, et agaçant à souhait, dont le nom, je crois savoir, devait initialement figurer dans le titre du roman avant d'y être remplacé par Einstein, quelle promotion !), il y a cette douleur qui transparaît.
Asperger, c'est un mot qui fait peur, qu'on sache ou non ce qu'il veut dire exactement. Et peut-être plus encore quand on ne sait pas à quoi ça correspond. Reste la différence... Ce gouffre qui sépare un jeune homme intelligent (Olivier Liron est normalien, spécialiste en histoire de l'art, musicien de talent... Il n'est pas du tout énervant non plus, mais pas pour les mêmes raisons que Julien Lepers !) des autres.
Pour lui, participer à "Questions pour un champion", c'est se lancer dans une quête initiatique. Une quête vers l'épanouissement, vers une meilleure estime de soi. Peut-être aussi vers le droit d'être regardé autrement, avec plus de respect. Et plus de séduction, aussi, eh oui, ça compte ! Le gouffre n'est pas entièrement comblé, le sera-t-il d'ailleurs un jour, mais il s'est réduit.
Le dernier chapitre du roman est très émouvant, le récit du premier jour du reste de la vie d'Olivier Liron. Une vie qui n'est plus un boulet attaché à la cheville et entravant les mouvements, mais quelque chose de plus léger, de plus zen. Une période où le regard d'autrui n'a plus vraiment d'importance.
J'ai retrouvé dans "Einstein, le sexe et moi" bien des aspects déjà vus dans "les Bracassées", de Marie-Sabine Roger. Olivier Liron ne déparerait certainement pas aux côtés de Fleur et Harmonie, d'ailleurs. Avec la même volonté de traiter ces questions difficiles et douloureuses avec humour pour les pourfendre.
Mais il y a un élément en plus dans le livre d'Olivier Liron : ce qu'il nous raconte, c'est sa vie, pas celle de personnages qu'il a inventés. On est bien sûr dans l'auto-fiction, pas dans le récit brut des faits, mais qu'on le veuille ou non, c'est de lui qu'il nous parle. Il nous ouvre son coeur, sa mémoire, sa douleur, pour que nous la partagions et que nous assistions à sa bataille décisive.
C'est un livre très drôle, mais aussi plein d'émotions, ce garçon est très touchant, capable de rire de lui-même autant que des autres (ce qui n'est pas la moindre des qualités), mais capable aussi d'une grande poésie, comme lorsqu'on le suit au milieu des oeuvres de Mark Rothko, exposées à la Tate Modern, à Londres.
Rien n'est simple, on le comprend en lisant certains passages du livre, même après cette émission qui marque un tournant, il y a eu des obstacles et des difficultés lourdes, mais je crois que l'Olivier Liron d'après QPUC n'est plus le même qu'avant cette expérience. Il se sent sans doute toujours différent, mais pour nous, admirable.
mercredi 12 septembre 2018
"On devrait toujours adopter le nom de ses symptômes syndromes affections craquelures du vernis (...) Ne pas nier la différence (...) On devrait en faire notre signature notre originalité".
Notre roman du jour entre dans la catégories de ce que j'appelle les sujets casse-gueule (et peut-être plus encore par les temps qui courent...), car la romancière choisit d'écrire sur un fil, au risque non seulement de chuter, mais d'atterrir, et le lecteur avec elle, dans une caricature de mauvais aloi. Quand on découvre le sujet de ce livre, on se dit : ouille, ah, ok, bon... Ou un truc du genre. Mais, en voyant sur la couverture le nom de Marie-Sabine Roger, qui a signé, entre autres, "la Tête en friche", on se sent plus rassuré, car on peut s'attendre à ce que les choses soient abordées avec délicatesse. "Les Bracassées", en voilà un titre énigmatique, est paru en cette rentrée littéraire aux éditions du Rouergue, et c'est un roman plein d'ondes positives, qui appelle ceux qui souffrent, ceux qui peinent avec leur image, ceux qui craignent le regard des autres à prendre leur destin en main et à faire de ces différences un atout, au mépris des canons de la société, des ricanements crétins et des peurs imbéciles. Un roman autour d'une rencontre en forme de carrefour, une bifurcation vers un dénouement très fort et émouvant. Ce qui n'empêche pas de rire (et de se sentir un peu coupable de ces rires).
Fleur a 76 ans et vit à Paris avec pour seul compagnon son chien, Mylord, un carlin qui commence à accuser un âge certain et affiche une santé flageolante. Ce qui n'empêche pas sa maîtresse de le considérer comme un véritable membre de sa famille, allant jusqu'à s'adresser à lui comme elle s'adresserait à un être humain.
Veuve, obèse, vivant dans un appartement fort spacieux et rempli d'oeuvres d'art, elle ne sort guère que pour promener Mylord et pour se rendre chez son thérapeute, le docteur Borodine, qu'elle idolâtre autant qu'elle redoute le reste du genre humain. Fleur est agoraphobe, et tout un tas d'autres mots se terminant en -phobe, d'ailleurs, car c'est le monde extérieur qui l'effraie.
Mais, le docteur Borodine a le truc pour la rassurer et, lorsqu'elle sent l'angoisse monter, elle a toujours près d'elle quelques pilules aux effets rapides et réconfortants qui lui permettent de tenir le coup. Son appartement est un havre, le seul endroit où elle se sent à l'abri des agressions d'un monde horrible, dangereux, malsain.
Toutefois, constatant que son Mylord n'a plus la forme de sa jeunesse, elle cherche un moyen pour qu'il puisse rester à la maison lorsqu'elle se rend à ses consultations, histoire de lui éviter un aller-retour fatiguant et une attente longuette. L'idéal, ce serait que quelqu'un vienne chez elle, même si cette simple idée la met dans tous ses états, pour s'occuper du carlin juste le temps de son absence...
Harmonie a 26 ans et ses parents ne se doutaient pas de l'ironie douloureuse que prendrait ce choix de prénom quelques années plus tard. Car Harmonie incarne tout... sauf l'harmonie, justement. Elle souffre d'un trouble fort handicapant, dont le nom suffit à faire ricaner les amateurs de raccourcis et de railleries faciles : le syndrome de Gilles de la Tourette.
Effectivement, Harmonie ne peut s'exprimer sans parsemer ses phrases de mots orduriers, d'insultes et de jurons qu'elle ne choisit hélas pas. Mais ce n'est pas tout : on oublie systématiquement que le syndrome de Gilles de la Tourette se manifeste aussi par des problèmes nerveux qui rendent la coordination des mouvements délicates et provoque des gestes aussi brusques qu'incontrôlables.
Tout cela constitue un obstacle considérable dans la vie de tous les jours, vis-à-vis de ceux qui ignorent qu'elle souffre de ce mal, mais aussi dans l'intimité, qu'elle partage avec Freddie, bienveillant et amoureux. Une situation qu'elle subit depuis l'enfance et qu'elle gère tant bien que mal, en tout cas dans une grande colère devant son impuissance.
Et Harmonie en a marre de ne pouvoir rien faire comme tout le monde, de devoir accepter que Freddie prenne tout en charge dans leur couple. Elle a le sentiment de vivre à ses crochets, d'être une sorte de monstre qu'on montre du doigt, de n'avoir aucune chance de s'émanciper, de gagner son autonomie, comme n'importe quelle jeune femme de son âge.
Elle veut que cela change, et tant pis si elle échoue, elle ne pourra pas dire qu'elle n'a pas essayé ! Une décision prise en découvrant dans son épicerie habituelle une annonce passée par une habitante de la même rue qui cherche quelqu'un pour garder son chien pendant quelques heures. Si elle n'y arrive pas, alors que pourra-t-elle faire ?
Et voilà comment l'improbable rencontre entre Fleur et Harmonie va se produire...
La scène de cette rencontre est d'ailleurs un des moments formidables de ce roman, tant ces deux personnages sont intrinsèquement différents, pas du tout faits pour s'entendre. Sans même évoquer leurs... singularités. Cette rencontre, c'est exactement ce que je décrivais en introduction : une scène qui m'a beaucoup amusé, tout en me donnant sérieusement mauvaise conscience.
Une scène aussi qui rassemble tous les éléments qui pourraient faire dire : mais qui est Marie-Sabine Roger pour se moquer ainsi de ces deux femmes ? Certes, mais ce qu'on n'imagine pas encore, c'est à quel point cette première rencontre calamiteuse va bouleverser le destin de ces deux personnes en marge, écrasées par leurs différences, par leur inadaptation au monde.
Il faut toujours mesurer les mots qu'on emploie, on en galvaude si facilement, sans même s'en rendre compte. Mais, je crois pouvoir dire que cette première rencontre entre Fleur et Harmonie va s'avérer providentielle. Oh, il y aura bien sûr des heurts et des orages, il va leur falloir s'apprivoiser, apprendre à se connaître et même, accepter l'autre telle qu'elle est.
Ce n'est pas parce qu'on a souffert soi-même si longtemps du regard des autres qu'on échappe à ce travers si humain lorsqu'on se trouve confronté à une différence aussi... flagrante que celles dont elles souffrent respectivement. Et puis, il y a des caractères assez forts, face à face : la rigidité morale de Fleur face au tourbillon en mouvement perpétuel d'Harmonie, ça fait des étincelles.
Je ne vais pas en dire beaucoup plus, car finalement, ce qui se produit ensuite ne se limite justement pas à la cohabitation de ces deux êtres tellement différents, à un simple "buddy-book" à la Francis Veber. Non, cette histoire, c'est d'abord et avant tout l'illustration que l'union, même de personnes inadaptées au monde, peut faire la force.
Ensemble, Fleur et Harmonie, mais bientôt d'autres personnages cabossés, décalés, en marge, oubliés, méprisés, rejetés, la liste des adjectifs est longue, vont s'allier avec comme objectif de renverser la fatalité de leur existence en faisant de ce qu'ils et elles ont toujours traîné comme un boulet, une marque, un atout. Une signature, comme le dit le titre de ce billet.
Bien sûr, Marie-Sabine Roger met en scène des personnages dont les comportements suscitent des situations qui nous font sourire. Mais, rapidement, on se reprend, on se reproche de se laisser aller. Et la puissance de ce livre, c'est de rendre attachants ces personnages qui ne le sont pas forcément d'emblée (qui ne pensera pas, parfois, à un refrain de Georges Brassens, en songeant à Fleur ?).
N'imaginez pas pour autant que cette alchimie va se faire en claquant des doigts. Non, il va y avoir des moments très durs à affronter, des décisions à prendre, parfois brutales, et l'on se dit que, s'il avait fallu faire face à ces événements en solitaire, cela aurait sans doute été insurmontable. Harmonie d'abord, puis Fleur, plus tard, vont chacune connaître ces moments pénibles, et s'entraider...
Marie-Sabine Roger instille à son histoire un souffle positif d'une grande force. Elle pose un regard plein de tendresse sur ses personnages et les guide vers un dénouement plein d'émotions, qui n'effacent pas le sourire, mais y ajouteront probablement quelques larmes. A l'instigation du duo Fleur/Harmonie (avec la seconde en moteur, du genre turbo), c'est une merveilleuse aventure qui est lancée.
Evidemment, si l'on s'en tient à "c'est une vieille agoraphobe et une jeune syndrome de la Tourette qui se rencontre et alors, ah, ah, ah, tu imagines, qu'est-ce qu'on va rigoler !", on est à côté de la plaque. Ici, l'humour est une manière de dédramatiser, mais aussi de nous faire comprendre que notre propension à rire de ces femmes peut être blessante, déplacée...
A travers l'exemple de Fleur et d'Harmonie, mais aussi de leurs amis (je ne vais pas expliquer ici le titre du roman, c'est un choix, mais je crois que cela fait aussi partie des questions qui méritent de trouver leur réponse en le lisant), c'est une leçon que nous inculque la romancière, une leçon de respect élémentaire, une leçon d'humanisme finalement très simple à assimiler, si on en a la volonté.
Avec un axe fort, qui est celui de l'acceptation de la différence et du regard que les autres portent sur soi. Un sujet qui concerne bien plus de monde que les cas particuliers comme Fleur et Harmonie, d'abord. La liste de tout ce qui nous rend méprisables ou "moquables" aux yeux de notre prochain est longue, et a même tendance à s'allonger ces temps-ci...
Nous sommes, nous, lecteurs, d'une certaine façon, dans la même situation que Fleur et Harmonie lorsqu'elles se rencontrent : nous laissons nos préjugés prendre le dessus, nous jugeons l'autre sans aller plus loin qu'un premier regard complètement faussé. Nous nous arrêtons au paraître, sans faire l'effort de découvrir l'être.
Tout aurait pu s'arrêter, après la première rencontre catastrophique entre les deux femmes. L'image que chacune a envoyée à l'autre n'est vraiment pas la meilleure qu'on puisse afficher pour une prise de contact... Combien d'entre nous en resteraient là, en assortissant tout cela d'un commentaire dédaigneux, d'un sourire sarcastique, d'une remarque acerbe ?
Au début du roman, c'est une Harmonie très virulente qui s'exprime, avec une écriture qui s'en ressent. Pas seulement par les moments où le syndrome réapparaît, mais aussi parce que la ponctuation disparaît. On s'en rend compte dans notre phrase de titre, avec une énumération sans virgule et des phrases sans point. Seules les majuscules résistent.
On sent la rage qui bouillonne en elle, mais aussi l'impuissance et l'humiliation, ce qui est forcément très touchant. Elle explique alors que les gens comme elle sont voués à se faire oublier pour survivre, parce que inclassables, impossible à faire entrer dans le moule de la société. Comme un objet qui aurait un défaut et qu'on enverrait au rebut avant même de le mettre sur le marché...
Mais, ce constat va plus loin, car Harmonie l'affirme, cette catégorie à laquelle elle appartient est une espèce en voie de progression : dans un monde qui sait de moins en moins tolérer l'autre, surtout s'il est... bizarre... ou effrayant... il y a de plus en plus de personnes qu'on écarte, qu'on laisse en marge parce qu'elles ne sont pas standardisées, parce qu'elles dérangent. Vous vous souvenez de cette merveilleuse formule si factice, "le vivre-ensemble" ?
Sous le vernis (pas craquelé, celui-là) de la comédie, Marie-Sabine Roger aborde des sujets essentiels avec tact et intelligence. Elle nous tend un miroir, en fait : et vous, n'êtes-vous pas intolérant ? Et vous, n'êtes-vous pas aussi l'inclassable de quelqu'un ? Avec, à la clé, le risque de devenir aigri, méchant, de rejeter sur autrui son mal-être, enclenchant un cercle vicieux difficile à enrayer.
Et puis, le ton change après la rencontre avec Fleur. Non pas que sa colère soit apaisée, mais elle envisage de canaliser son énergie et sa rage autrement, pour en faire quelque chose d'utile. A elle et aux autres. Renverser le rapport de force, en faisant de ce qui nous mine une arme de tolérance massive, une marque de confiance en soi pour ceux qui en manquent cruellement depuis longtemps.
Il y a bien sûr le regard des autres, mais surtout, peut-être, le regard qu'on porte sur soi et qui n'est pas toujours bienveillant lui non plus. Dans la démarche initiée par Harmonie, il y a la restauration de ce premier regard, le fait de s'accepter soi-même tel que l'on est, avec ses défauts, ses complexes. Cela n'efface pas les maux, ça ne guérit pas, mais cela permet d'avancer, et c'est déjà important.
A travers cette aventure, car c'en est une, sans cascade, fusillade ou effets spéciaux surpuissants, se dessine une quête d'émancipation et de libération, qui touchera les unes et les autres et leur permettra de prendre la vie d'un meilleur côté. De se sentir mieux accepté. Il n'est d'ailleurs pas anodin qu'il y ait dans ce livre une unité de lieu qui est le quartier, là où on passe le plus de temps.
Puisqu'il est impossible de soigner le mal à la source de cette situation, ou en tout cas difficilement pour ceux qui ne sont pas incurables, il faut s'attaquer au mal social qui en découle. Avec comme idée de soigner le mal par le mal, justement : ce qui blesse, c'est l'image, alors c'est par l'image que l'on vaincra la douleur et ceux qui l'infligent !
Oui, c'est énigmatique, comme formule, mais je ne peux évidemment pas tout vous dire dans ce billet, il y a tant à découvrir dans ce roman qui n'est pas qu'un livre "feel good", comme on dit, mais qui recèle beaucoup de pistes de réflexion, des enseignements et des raisons de nous remettre, toutes et tous, en question.
C'est surtout un livre plein de joie, une joie contagieuse, vitaminée, roborative. Ces Bracassées ont du pep's à revendre et ont trouvé un vrai gisement d'optimisme dans lequel puiser à chaque coup de mou. C'est un livre drôle, également, mais pas au détriment des personnages, mais aussi parce que l'humour fait partie de l'arsenal contre le désespoir.
A l'image de ce passage évoquant la coprolalie, c'est-à-dire la propension des malades atteints du syndrome de Gilles de la Tourette à recourir à un vocabulaire ordurier, insultant. "Coprolalie du grec ancien Kopros qui veut dire excrément comme on l'entend dans Coprophages les insectes bouffeurs de merde Coprolithes petits cacas fossilisés mais également dans Copropriété sans doute parce que c'est la merde..."
"Les Bracassées", c'est un roman qui s'appuie sur des valeurs de respect, de solidarité, d'entraide, d'écoute, tout ce que la vie moderne, et pas seulement les réseaux sociaux, mais dans le genre, c'est le pompon, ont tendance à balayer, à négliger, voire à rejeter. On en ressort regonflé, mais aussi plein de contrition, en se jurant que l'on se comportera mieux avec son prochain à l'avenir...
Fleur a 76 ans et vit à Paris avec pour seul compagnon son chien, Mylord, un carlin qui commence à accuser un âge certain et affiche une santé flageolante. Ce qui n'empêche pas sa maîtresse de le considérer comme un véritable membre de sa famille, allant jusqu'à s'adresser à lui comme elle s'adresserait à un être humain.
Veuve, obèse, vivant dans un appartement fort spacieux et rempli d'oeuvres d'art, elle ne sort guère que pour promener Mylord et pour se rendre chez son thérapeute, le docteur Borodine, qu'elle idolâtre autant qu'elle redoute le reste du genre humain. Fleur est agoraphobe, et tout un tas d'autres mots se terminant en -phobe, d'ailleurs, car c'est le monde extérieur qui l'effraie.
Mais, le docteur Borodine a le truc pour la rassurer et, lorsqu'elle sent l'angoisse monter, elle a toujours près d'elle quelques pilules aux effets rapides et réconfortants qui lui permettent de tenir le coup. Son appartement est un havre, le seul endroit où elle se sent à l'abri des agressions d'un monde horrible, dangereux, malsain.
Toutefois, constatant que son Mylord n'a plus la forme de sa jeunesse, elle cherche un moyen pour qu'il puisse rester à la maison lorsqu'elle se rend à ses consultations, histoire de lui éviter un aller-retour fatiguant et une attente longuette. L'idéal, ce serait que quelqu'un vienne chez elle, même si cette simple idée la met dans tous ses états, pour s'occuper du carlin juste le temps de son absence...
Harmonie a 26 ans et ses parents ne se doutaient pas de l'ironie douloureuse que prendrait ce choix de prénom quelques années plus tard. Car Harmonie incarne tout... sauf l'harmonie, justement. Elle souffre d'un trouble fort handicapant, dont le nom suffit à faire ricaner les amateurs de raccourcis et de railleries faciles : le syndrome de Gilles de la Tourette.
Effectivement, Harmonie ne peut s'exprimer sans parsemer ses phrases de mots orduriers, d'insultes et de jurons qu'elle ne choisit hélas pas. Mais ce n'est pas tout : on oublie systématiquement que le syndrome de Gilles de la Tourette se manifeste aussi par des problèmes nerveux qui rendent la coordination des mouvements délicates et provoque des gestes aussi brusques qu'incontrôlables.
Tout cela constitue un obstacle considérable dans la vie de tous les jours, vis-à-vis de ceux qui ignorent qu'elle souffre de ce mal, mais aussi dans l'intimité, qu'elle partage avec Freddie, bienveillant et amoureux. Une situation qu'elle subit depuis l'enfance et qu'elle gère tant bien que mal, en tout cas dans une grande colère devant son impuissance.
Et Harmonie en a marre de ne pouvoir rien faire comme tout le monde, de devoir accepter que Freddie prenne tout en charge dans leur couple. Elle a le sentiment de vivre à ses crochets, d'être une sorte de monstre qu'on montre du doigt, de n'avoir aucune chance de s'émanciper, de gagner son autonomie, comme n'importe quelle jeune femme de son âge.
Elle veut que cela change, et tant pis si elle échoue, elle ne pourra pas dire qu'elle n'a pas essayé ! Une décision prise en découvrant dans son épicerie habituelle une annonce passée par une habitante de la même rue qui cherche quelqu'un pour garder son chien pendant quelques heures. Si elle n'y arrive pas, alors que pourra-t-elle faire ?
Et voilà comment l'improbable rencontre entre Fleur et Harmonie va se produire...
La scène de cette rencontre est d'ailleurs un des moments formidables de ce roman, tant ces deux personnages sont intrinsèquement différents, pas du tout faits pour s'entendre. Sans même évoquer leurs... singularités. Cette rencontre, c'est exactement ce que je décrivais en introduction : une scène qui m'a beaucoup amusé, tout en me donnant sérieusement mauvaise conscience.
Une scène aussi qui rassemble tous les éléments qui pourraient faire dire : mais qui est Marie-Sabine Roger pour se moquer ainsi de ces deux femmes ? Certes, mais ce qu'on n'imagine pas encore, c'est à quel point cette première rencontre calamiteuse va bouleverser le destin de ces deux personnes en marge, écrasées par leurs différences, par leur inadaptation au monde.
Il faut toujours mesurer les mots qu'on emploie, on en galvaude si facilement, sans même s'en rendre compte. Mais, je crois pouvoir dire que cette première rencontre entre Fleur et Harmonie va s'avérer providentielle. Oh, il y aura bien sûr des heurts et des orages, il va leur falloir s'apprivoiser, apprendre à se connaître et même, accepter l'autre telle qu'elle est.
Ce n'est pas parce qu'on a souffert soi-même si longtemps du regard des autres qu'on échappe à ce travers si humain lorsqu'on se trouve confronté à une différence aussi... flagrante que celles dont elles souffrent respectivement. Et puis, il y a des caractères assez forts, face à face : la rigidité morale de Fleur face au tourbillon en mouvement perpétuel d'Harmonie, ça fait des étincelles.
Je ne vais pas en dire beaucoup plus, car finalement, ce qui se produit ensuite ne se limite justement pas à la cohabitation de ces deux êtres tellement différents, à un simple "buddy-book" à la Francis Veber. Non, cette histoire, c'est d'abord et avant tout l'illustration que l'union, même de personnes inadaptées au monde, peut faire la force.
Ensemble, Fleur et Harmonie, mais bientôt d'autres personnages cabossés, décalés, en marge, oubliés, méprisés, rejetés, la liste des adjectifs est longue, vont s'allier avec comme objectif de renverser la fatalité de leur existence en faisant de ce qu'ils et elles ont toujours traîné comme un boulet, une marque, un atout. Une signature, comme le dit le titre de ce billet.
Bien sûr, Marie-Sabine Roger met en scène des personnages dont les comportements suscitent des situations qui nous font sourire. Mais, rapidement, on se reprend, on se reproche de se laisser aller. Et la puissance de ce livre, c'est de rendre attachants ces personnages qui ne le sont pas forcément d'emblée (qui ne pensera pas, parfois, à un refrain de Georges Brassens, en songeant à Fleur ?).
N'imaginez pas pour autant que cette alchimie va se faire en claquant des doigts. Non, il va y avoir des moments très durs à affronter, des décisions à prendre, parfois brutales, et l'on se dit que, s'il avait fallu faire face à ces événements en solitaire, cela aurait sans doute été insurmontable. Harmonie d'abord, puis Fleur, plus tard, vont chacune connaître ces moments pénibles, et s'entraider...
Marie-Sabine Roger instille à son histoire un souffle positif d'une grande force. Elle pose un regard plein de tendresse sur ses personnages et les guide vers un dénouement plein d'émotions, qui n'effacent pas le sourire, mais y ajouteront probablement quelques larmes. A l'instigation du duo Fleur/Harmonie (avec la seconde en moteur, du genre turbo), c'est une merveilleuse aventure qui est lancée.
Evidemment, si l'on s'en tient à "c'est une vieille agoraphobe et une jeune syndrome de la Tourette qui se rencontre et alors, ah, ah, ah, tu imagines, qu'est-ce qu'on va rigoler !", on est à côté de la plaque. Ici, l'humour est une manière de dédramatiser, mais aussi de nous faire comprendre que notre propension à rire de ces femmes peut être blessante, déplacée...
A travers l'exemple de Fleur et d'Harmonie, mais aussi de leurs amis (je ne vais pas expliquer ici le titre du roman, c'est un choix, mais je crois que cela fait aussi partie des questions qui méritent de trouver leur réponse en le lisant), c'est une leçon que nous inculque la romancière, une leçon de respect élémentaire, une leçon d'humanisme finalement très simple à assimiler, si on en a la volonté.
Avec un axe fort, qui est celui de l'acceptation de la différence et du regard que les autres portent sur soi. Un sujet qui concerne bien plus de monde que les cas particuliers comme Fleur et Harmonie, d'abord. La liste de tout ce qui nous rend méprisables ou "moquables" aux yeux de notre prochain est longue, et a même tendance à s'allonger ces temps-ci...
Nous sommes, nous, lecteurs, d'une certaine façon, dans la même situation que Fleur et Harmonie lorsqu'elles se rencontrent : nous laissons nos préjugés prendre le dessus, nous jugeons l'autre sans aller plus loin qu'un premier regard complètement faussé. Nous nous arrêtons au paraître, sans faire l'effort de découvrir l'être.
Tout aurait pu s'arrêter, après la première rencontre catastrophique entre les deux femmes. L'image que chacune a envoyée à l'autre n'est vraiment pas la meilleure qu'on puisse afficher pour une prise de contact... Combien d'entre nous en resteraient là, en assortissant tout cela d'un commentaire dédaigneux, d'un sourire sarcastique, d'une remarque acerbe ?
Au début du roman, c'est une Harmonie très virulente qui s'exprime, avec une écriture qui s'en ressent. Pas seulement par les moments où le syndrome réapparaît, mais aussi parce que la ponctuation disparaît. On s'en rend compte dans notre phrase de titre, avec une énumération sans virgule et des phrases sans point. Seules les majuscules résistent.
On sent la rage qui bouillonne en elle, mais aussi l'impuissance et l'humiliation, ce qui est forcément très touchant. Elle explique alors que les gens comme elle sont voués à se faire oublier pour survivre, parce que inclassables, impossible à faire entrer dans le moule de la société. Comme un objet qui aurait un défaut et qu'on enverrait au rebut avant même de le mettre sur le marché...
Mais, ce constat va plus loin, car Harmonie l'affirme, cette catégorie à laquelle elle appartient est une espèce en voie de progression : dans un monde qui sait de moins en moins tolérer l'autre, surtout s'il est... bizarre... ou effrayant... il y a de plus en plus de personnes qu'on écarte, qu'on laisse en marge parce qu'elles ne sont pas standardisées, parce qu'elles dérangent. Vous vous souvenez de cette merveilleuse formule si factice, "le vivre-ensemble" ?
Sous le vernis (pas craquelé, celui-là) de la comédie, Marie-Sabine Roger aborde des sujets essentiels avec tact et intelligence. Elle nous tend un miroir, en fait : et vous, n'êtes-vous pas intolérant ? Et vous, n'êtes-vous pas aussi l'inclassable de quelqu'un ? Avec, à la clé, le risque de devenir aigri, méchant, de rejeter sur autrui son mal-être, enclenchant un cercle vicieux difficile à enrayer.
Et puis, le ton change après la rencontre avec Fleur. Non pas que sa colère soit apaisée, mais elle envisage de canaliser son énergie et sa rage autrement, pour en faire quelque chose d'utile. A elle et aux autres. Renverser le rapport de force, en faisant de ce qui nous mine une arme de tolérance massive, une marque de confiance en soi pour ceux qui en manquent cruellement depuis longtemps.
Il y a bien sûr le regard des autres, mais surtout, peut-être, le regard qu'on porte sur soi et qui n'est pas toujours bienveillant lui non plus. Dans la démarche initiée par Harmonie, il y a la restauration de ce premier regard, le fait de s'accepter soi-même tel que l'on est, avec ses défauts, ses complexes. Cela n'efface pas les maux, ça ne guérit pas, mais cela permet d'avancer, et c'est déjà important.
A travers cette aventure, car c'en est une, sans cascade, fusillade ou effets spéciaux surpuissants, se dessine une quête d'émancipation et de libération, qui touchera les unes et les autres et leur permettra de prendre la vie d'un meilleur côté. De se sentir mieux accepté. Il n'est d'ailleurs pas anodin qu'il y ait dans ce livre une unité de lieu qui est le quartier, là où on passe le plus de temps.
Puisqu'il est impossible de soigner le mal à la source de cette situation, ou en tout cas difficilement pour ceux qui ne sont pas incurables, il faut s'attaquer au mal social qui en découle. Avec comme idée de soigner le mal par le mal, justement : ce qui blesse, c'est l'image, alors c'est par l'image que l'on vaincra la douleur et ceux qui l'infligent !
Oui, c'est énigmatique, comme formule, mais je ne peux évidemment pas tout vous dire dans ce billet, il y a tant à découvrir dans ce roman qui n'est pas qu'un livre "feel good", comme on dit, mais qui recèle beaucoup de pistes de réflexion, des enseignements et des raisons de nous remettre, toutes et tous, en question.
C'est surtout un livre plein de joie, une joie contagieuse, vitaminée, roborative. Ces Bracassées ont du pep's à revendre et ont trouvé un vrai gisement d'optimisme dans lequel puiser à chaque coup de mou. C'est un livre drôle, également, mais pas au détriment des personnages, mais aussi parce que l'humour fait partie de l'arsenal contre le désespoir.
A l'image de ce passage évoquant la coprolalie, c'est-à-dire la propension des malades atteints du syndrome de Gilles de la Tourette à recourir à un vocabulaire ordurier, insultant. "Coprolalie du grec ancien Kopros qui veut dire excrément comme on l'entend dans Coprophages les insectes bouffeurs de merde Coprolithes petits cacas fossilisés mais également dans Copropriété sans doute parce que c'est la merde..."
"Les Bracassées", c'est un roman qui s'appuie sur des valeurs de respect, de solidarité, d'entraide, d'écoute, tout ce que la vie moderne, et pas seulement les réseaux sociaux, mais dans le genre, c'est le pompon, ont tendance à balayer, à négliger, voire à rejeter. On en ressort regonflé, mais aussi plein de contrition, en se jurant que l'on se comportera mieux avec son prochain à l'avenir...
Inscription à :
Articles (Atom)