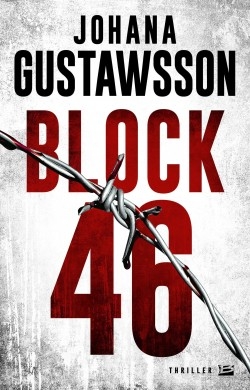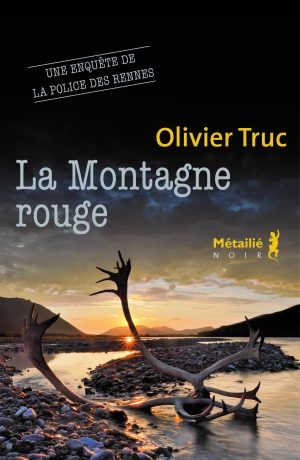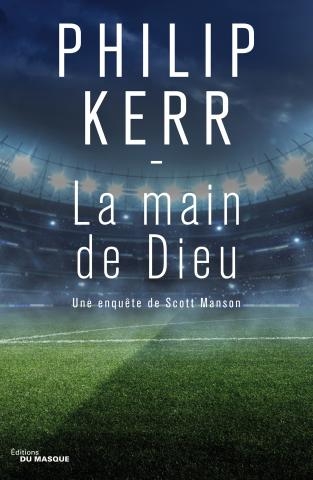Je suis allé piocher le titre du billet chez Camus, dont la Peste, on le sait, est surtout brune et allégorique, pour parler d'un livre se déroulant, lui, véritablement pendant la Grande Peste de 1348. Et il faut donc prendre cette phrase au pied de la lettre, car il me semble que c'est bien un des enjeux de cette saga, "la Malédiction de Gabrielle, dont le deuxième volet, "A l'ombre du diable", vient de paraître aux éditions Flammarion. Après "Le Fléau de Dieu", Andrea H. Japp nous ramène dans ce Moyen-Âge qu'elle aime tant pour une fresque historique qui commence à gagner en intensité et ressemble de plus en plus à un thriller. Meurtres, complots, espionnage, convoitises, manigances politiques, tout est là, dans une époque extrêmement agitée, entre les ravages de l'épidémie et la fragilité du pouvoir royal. Dans ce deuxième volet, ce sont toutefois les femmes qui tirent leur épingle du jeu et occupent les premiers rôles...
Cette fin d'été est décidément éprouvante pour Gabrielle d'Aurillay. La peste, qui a failli l'emporter avant de la laisser miraculeusement vivante, continue à ravager Paris. Elle a découvert que son bonheur conjugal était un leurre et, en plus de ces tourments personnels, elle se retrouve avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
L'insignifiant diptyque, qu'elle a dérobé à son époux pour se venger de ses mensonges et indélicatesses, attise les convoitises. Pour quelles raisons ? On ne le sait pas plus que la jeune femme, mais elle compte bien comprendre pourquoi on a voulu l'assassiner. L'oiselle naïve et gentillette que l'on a connu avant le début de l'épidémie, a laissé place à une femme déterminée et prête à tout.
Avec l'aide de la sage-femme Adeline Musard, qui a subi les mêmes tragiques événements, elle se reconstruit peu à peu. Mais, la paix espérée aux Loges-en-Josas, à l'écart de la capitale transformée en charnier, n'est pas au rendez-vous. Le village est sous tension, les étrangers mal vus, car possibles vecteurs de la maladie et l'atmosphère pesante...
Bientôt, une évidence se fait : Gabrielle et Adeline seront plus en sécurité dans Paris. Persuadées que la maladie ne peut plus rien contre elles puisqu'elle ne les a pas emportées lorsqu'elle les a touchées, les deux femmes décident de rentrer dans la capitale où il sera plus facile de se faire oublier, en profitant de la panique et de la désorganisation.
Pendant ce temps, au Château de Vincennes, Jeanne de Bourgogne se morfond dans ses appartements. Sa camériste, comme une partie de sa cour, a été emportée par la peste et la reine est seule. En quarantaine. Ni son royal époux, Philippe VI, ni son fils, le futur Jean II, revenus à Paris de mauvais gré, veulent attendre de voir si elle a été contaminée...
Haïe du peuple, moquée parce qu'elle est boiteuse, considérée comme maudite par certains, vieillie précocement, elle est pourtant celle qui dirige quasiment le royaume depuis la déconvenue du roi à Crécy, deux ans plus tôt. Mais, comment pourrait-elle asseoir ce pouvoir, convaincre un pays hostile et en plein désarroi qu'elle est la femme providentielle ?
Et puis, il y a tous ceux qui s'agitent et sont à la recherche du fameux diptyque. Qu'ils sachent exactement ce que représente cette oeuvre d'art de qualité apparemment très médiocre ou qu'ils se doutent qu'elle recèle quelque chose d'extraordinaire, et donc une source de richesse, ils sont prêts à tout, jusqu'à faire disparaître tout témoin, pour l'avoir en leur possession.
Parmi ces comploteurs, se trouve une femme. Un personnage bien mystérieux : Marthe de Rolittret. Je ne vais pas en dire trop sur elle, c'est un beau personnage que je suis curieux de voir évoluer. Une sorte de Milady médiévale, jouant sur la séduction pour imposer ses vues, impitoyable et sans aucun état d'âme. Redoutable et puissante, elle joue sans doute sur plusieurs tableaux...
J'avais trouvé que "le Fléau de Dieu" était une introduction et tenait plus de la saga que du thriller. La tendance s'inverse un peu avec "A l'ombre du diable", car les choses se précise : Gabrielle possède ce que tout le monde veut et tout le monde est prêt à tuer pour mettre la main sur l'objet. La jeune femme est donc sur la brèche, cherchant des solutions pour se mettre en sécurité.
Les rebondissements, le mouvement, jamais évident à rendre à des époques où l'on n'a pas de moyens de transports rapides, la construction par brefs chapitres, tout est là pour donner du rythme et faire monter la tension. Mais, reconnaissons tout de même qu'on est encore loin d'une cadence effrénée, même si l'histoire gagne en intérêt.
Je n'évoque pas un des éléments très forts de ce deuxième volet qui va certainement ouvrir la suite de la série, mais l'idée est tout à fait passionnante, parce qu'elle raccroche vraiment la partie fiction à la réalité historique. En effet, on pourrait considérer ici que le contexte historique n'est qu'un décor, rien de plus, que Gabrielle évolue simplement au coeur de la Grande Peste.
Mais, on voit bien, par la simple présence de la Reine, parmi les personnages principaux, que la situation politique du royaume sera également un enjeu, à terme. Pourquoi ? Comment ? La suite nous le dira sans doute. Et Gabrielle n'est certainement pas au bout de ses peines, car il est bien difficile, dans ce chaos, de faire confiance à qui que ce soit...
Dans cette confusion générale, engendrée par les très nombreuses morts, la peur de la maladie, du châtiment divin qu'elle représentent en cette époque pieuse, la France, déjà affaiblie par les premières campagnes de la guerre de Cent Ans, est au bord de l'effondrement. Ce qui n'empêche pas les intrigues de se poursuive, à différents niveaux.
Ce deuxième tome, plus encore que le premier, est celui des femmes. J'ai évoqué déjà les principales actrices dans le résumé. Elles ont le pouvoir dans ce roman. Sous différentes formes, positives, mais aussi négatives, car elles ne sont pas toutes charmantes... Si Gabrielle gagne en roublardise et ose faire ce qu'elle n'aurait jamais imaginé faire quelques semaines plus tôt, elle reste encore une ingénue.
Bien sûr, elle agit avec intelligence et pragmatisme, elle est décidée mais sait aussi qu'elle va devoir affronter des adversaires tout aussi déterminés, mais bien plus aguerris qu'elle ne le sera jamais. Alors, il lui faut jouer en faisant fi des règles et de la morale stricte dans laquelle elle a été élevée. Pour elle, le mensonge n'est pas une seconde nature, mais une protection nécessaire.
Le vrai point d'interrogation, sur le plan de la caractérisation, c'est finalement Jeanne, dont le rôle précis reste encore très incertain et sera un des grands intérêts de la suite de la saga. Mais, on se dit déjà que ces femmes de caractère, Gabrielle, soutenue par Adeline, d'un côté, et Jeanne et Marthe d'un autre, vont se confronter...
Je dois avouer que, pour le moment, cette série n'a pas la densité et la richesse des autres séries médiévales d'Andrea H. Japp. Certes, on y retrouve la patte de l'auteur, avec les nombreuses notes qui viennent agrémenter la lecture d'explication sur le vocabulaire, les us et coutumes, les habitudes, mais j'espère que la suite de la série, en approchant du vif du sujet, saura gagner en ampleur.
La lecture reste agréable, le mystère entourant ce diptyque qui ne paye pourtant pas de mine demeure entier et la panique qui touche le royaume en raison de la peste sont des points forts de cette histoire. La métamorphose de Gabrielle, aussi, peut-être un peu rapide, mais qui semble avoir été brusquement libérée de tous les carcans dus à son rang pour devenir une femme n'ayant plus rien à perdre.
J'ai relégué les acteurs masculins au second rang, parce que je crois vraiment que cette histoire se dénouera à travers les personnages féminins, mais il en reste encore, évidemment. Et, si leurs rangs s'éclaircissent un peu au fil de ce deuxième tome, ceux qui demeurent auront leur mot à dire... A moins de tomber sur plus redoutable qu'eux et qu'on ne leur laisse pas mot dire...
J'en dégage un, tout de même : Armand Daubert. Il est coutelier auprès du roi, mais c'est un des derniers proches de la reine à ne pas craindre sa présence. Bien au contraire... C'est un garçon qui a l'air débonnaire, sympathique, charmant, même, et pourtant, on se dit, et on n'est pas le seul, qu'il cache certainement quelque secret son son air avenant...
Ah oui, j'oubliais : Armand est nain, mais delà à l'imaginer dans un rôle à la Thyrion Lannister, il est sans doute trop tôt pour le dire, et c'est peut-être même sans fondement. Je suis très curieux de voir comment il va évoluer, lui aussi, quel rôle lui réserve Andrea H. Japp dans tout cela. Car, sa position dans le récit est très particulière, et ce n'est sûrement pas un hasard.
Je suis intrigué par la suite de cette saga, j'ai évidemment très envie de comprendre ce qu'est ce diptyque et pourquoi il semble avoir un tel intérêt, inversement proportionnelle à sa qualité artistique. Je me demande simplement si tout cela n'est pas un peu trop délayé et n'aurait pu tenir dans un seul volume. Peut-être le prochain tome me fera-t-il changer d'idée.
En attendant, nous laissons Gabrielle dans une situation qu'elle juge plus stable, moins dangereuse, ce qui reste à démontrer et ce que ne semble pas penser Adeline. Si le plan suivi paraissait de bon aloi, on peut aussi se demander si la jeune veuve n'a pas choisi de se jeter dans la gueule du loup en voulant échapper aux crocs d'un autre. Non, la vie de Gabrielle d'Aurillay n'est pas un fleuve tranquille...
"Il va falloir un jour qu'enfin je me décide à lire les livres que, depuis trente ans, je conseille à mes amis de lire". (Sacha Guitry)
dimanche 27 novembre 2016
"Il n'y a qu'une façon d'écrire : on crée les personnages les plus vrais possible et, ensuite, on leur obéit".
Depuis que les éditions Fleuve ont eu la bonne idée de publier "Le Vide" et "Hell.com", de nombreux lecteurs français ont découvert l'univers du Québécois Patrick Senécal. Son nouveau roman vient de paraître chez son éditeur originel, les éditions Alire, et nous allons nous y intéresser. On y retrouve la noirceur, la violence, la petite pointe de cynisme, aussi, qui font la marque de fabrique de ce romancier prolifique et imaginatif. Avec "L'autre reflet", il poursuit la réflexion entamée dans "Faims", sur les artistes, leurs créations, leurs inspirations et les émotions que tout cela engendre. Une mise en abyme très intéressante qui devrait contribuer à alimenter les nombreuses comparaisons faites de longues dates entre Patrick Senécal et Stephen King. Mais, c'est aussi un roman mordant sur l'idéal artistique et le revers de cette médaille, le succès public...
Michaël (prononcez-le à la française) rêve de devenir écrivain. Quelques années plus tôt, une de ses nouvelles a été publiée, mais depuis, il rame pour boucler son premier roman. Ce livre est un thriller dont l'intrigue satisfait l'auteur, mais il trouve qu'il manque un je-ne-sais-quoi à l'ensemble pour aboutir à ce qu'il recherche.
Il est donc bien loin de pouvoir vivre de sa plume et, pour faire rentrer un peu d'argent dans le budget du ménage qu'il forme avec Alexandra. Michaël est enseignant, mais pour pouvoir consacrer le plus de temps à l'écriture, il a choisi de travailler en milieu carcéral : il y anime des ateliers d'écriture avec les détenus, ce qu'il trouve très enrichissant.
Dans la prison où il officie, une prison pour femmes, il fait la connaissance d'une prisonnière, Wanda, qui se démarque des autres. Certes, son style n'est pas terrible, son orthographe, sa grammaire et sa syntaxe laissent à désirer, mais la nouvelle qu'elle lui a remise a laissé le jeune auteur pantois. Il y trouve toute la force qui manque à son propre travail !
Le hic, c'est que Michaël comprend rapidement que les histoires que racontent Wanda sont tirées de sa propre expérience. En clair, ce sont ses propres crimes qu'elle relate avec force détails et cette énergie incroyable nées de l'expérience vécue du meurtre. Tout ce qui manque à Michaël, ébranlé par ces révélations, ainsi que par le fait que certains des crimes de Wanda n'ont jamais été élucidés...
Alors, après avoir longtemps hésité, pesé le pour et le contre, constaté qu'il ne parvenait pas à sortir tout seul de son impasse littéraire, Michaël décide de s'inspirer du travail de Wanda pour donner à son propre roman le petit truc qui lui manque... Et ça marche : non seulement "Sous pression" est accepté par un éditeur, mais il cartonne immédiatement.
En quelques semaines, il devient la coqueluche littéraire du Québec, invité dans tous les salons, dans tous les médias, vendant des livres par centaines, découvrant la popularité, l'aisance et le succès. Un vrai paradoxe pour un garçon qui a toujours mis en avant la qualité de son travail, et non une quelconque ambition à devenir auteur de best-sellers.
Mais, car il y a un mais, dans les années qui suivent, aucun des livres publiés par Michaël ne va retrouver le même succès. Revenu à des méthodes d'écriture plus traditionnelles, le romancier a perdu la formule magique. Une formule dont l'origine lui pose évidemment problème, son succès venant de véritables meurtres...
Michaël ne veut plus entendre parler de Wanda, qui, espère-t-il, restera encore longtemps derrière les barreaux. Mais, à chaque nouvelle parution, son succès et ses ventes s'érodent. Il est rentré dans le rang, supplanté par d'autres romanciers placé sous les feux de la rampe, et il s'aigrit, doucement mais sûrement, agacé de son impuissance et de l'ingratitude du public...
C'est alors que Wanda réapparaît dans sa vie et lui propose son aide...
A sa manière, Patrick Senécal revisite dans ce roman le mythe de Faust : Michael est dans le rôle de ce savant incapable d'accéder par la science à la connaissance universelle. Pour y parvenir, il signe un pacte avec Méphistophélès qui réalisera tout ses voeux en échange de son âme... On connaît l'histoire, si ce n'est en détails, au moins dans sa globalité.
Méphisto, ici, c'est Wanda, mais cette présence féminine dans le rôle du tentateur diabolique n'empêche pas, vous le verrez, je ne l'ai pas évoquée ici, "l'autre reflet" d'avoir également sa Marguerite (mais pas son air des bijoux). L'intrigue apparaît ensuite clairement : Michaël cédera-t-il à la proposition de Wanda, tout en sachant comment elle procédera ?
Ce dilemme moral est le moteur de ce thriller sombre où le parallèle entre Patrick Senécal et son double, Michaël, se pose évidemment. Pour ceux qui ont lu certains des livres précédents de l'auteur, simples thrillers, roman plus fantastiques ou carrément horrifiques, vous savez que son imagination en matière de violence est... débordante.
Comment faire passer cette violence, comment transmettre aux lecteurs la souffrance infligée lorsqu'on ne peut pas l'expérimenter concrètement pour la décrire ? Entre imagination et volonté de réalisme, il faut trouver les effets qui sauront provoquer chez le lecteur la grimace de dégoût, la répulsion, le frisson qu'il attend lorsqu'il ouvre ce genre de livre.
Dans "l'Autre reflet", la fiction permet à Senécal d'intégrer un élément nouveau : la possibilité de la transgression des tabous les plus fondamentaux de nos sociétés. Non seulement, en pompant le texte de Wanda pour son premier roman, Michaël lui a vendu son âme, mais la manière dont elle agi pour réaliser ses souhaits a de terribles conséquences...
Senécal pousse le jeu de miroirs plus loin de la simple relation auteur/personnage : Michaël et Wanda sont, d'une certaine manière, le reflet l'un de l'autre, un peu comme si la meurtrière était la jumelle maléfique, le cygne noir de l'écrivain. L'écrivain (le vrai) joue d'ailleurs avec cette impression de symétrie, qui forme l'architecture de son plan.
De la même manière, il place en vis-à-vis l'ambition artistique de Michaël et ce succès tellement addictif qu'on ne peut, quand on y a goûté, s'en défaire. Et, pour cela, il installe un personnage qui devient, là encore, le négatif de Michaël. On y vient, la voilà, la Marguerite de notre Faust : un ex travaillant dans l'édition, mais ne jurant que par le succès quand Michaël parle de création...
"L'autre reflet" est dans la stricte continuité de "Faims", le précédent roman de Patrick Senécal. On y voyait un cirque un peu particulier proposant des numéros stigmatisant les travers de la société contemporaine et aiguisant chez ses spectateurs des désirs inavoués, inavouables et fort peu moraux... Dans l'assouvissement de ces désirs, se trouvait un épanouissement franchement malsain...
Michaël lui aussi goûte à cet élixir qui rend puissant, mais, pour cela, il a dû passer outre ses dilemmes intérieurs, ses questionnements moraux (qui commencent par le choix de piquer les effets de Wanda pour les incorporer dans son propre livre jusqu'à la question collatérale des meurtres). La tentation de retrouver la saveur inimitable du succès devient alors insoutenable...
Comme souvent dans ses livres, Patrick Senécal sait faire vibrer la vilaine corde sensible de l'être humain, celle des instincts les plus bas que nous avons tous en nous. Cette métamorphose qui fait rejaillir la part d'ombre, la part de violence qui sommeille en chacun de nous. Et le lecteur, lui, assiste à ces combats, à ces chutes, à cette folie, en se demandant ce qu'il ferait, lui, à la place des personnages...
L'engrenage mis en place dans "l'autre reflet" est redoutable : une fois lancer, on ne peut ni l'arrêter, ni le faire repartir en arrière. En fait, en cédant à la tentation, de manière presque innocente, la première fois, Michaël a pénétré dans une souricière. Le voilà irrémédiablement piégé. Plus il se débat, plus il lutte, contre la tentation mais aussi contre l'horreur, plus il s'enferre...
La mécanique de "l'autre reflet", si elle peut avoir quelques côtés attendus par moments, reste implacable et redoutablement efficace. La montée des tensions est inexorable et la position de Michaël de plus en plus difficilement tenable. Wanda, c'est un peu la version féminine, littéraire et exponentielle du personnage incarné par Sergi Lopez dans "Harry, un ami qui vous veut du bien".
Mais, bien sûr, on pense à un autre thriller, un roman-culte, d'un auteur à qui Patrick Senécal est souvent comparé : le "Misery" de Stephen King. On retrouve un écrivain aux prises avec une fan un tantinet encombrante (oui, je maîtrise l'euphémisme...), mais Senécal aborde la question sous un angle différent, en donnant à Wanda un rôle sensiblement différent de celui d'Annie Wilkes.
Je n'ai que très peu parlé de Wanda, finalement, jusqu'ici. Et c'est un tort, parce que c'est un vrai personnage de sociopathe comme on les aime (enfin, tant qu'ils restent bien au chaud dans les pages d'un roman) : elle a cette allure candide, presque angélique. Au premier abord, on lui donnerait le bon dieu sans confession. Mais, dès qu'on gratte un peu le vernis...
Senécal n'en fait pas un Hannibal Lecter au féminin, machiavélique, cynique, tenant les commandes et décidant de tout. Non, même dans sa manière de raconter les horreurs qu'elle a commises, Wanda reste d'une ingénuité troublante. Puis, peu à peu, alors qu'elle se livre, aveux qui ne tomberont que sous les yeux du lecteur, on comprend que, à l'instar de Michaël, elle aussi est en quête d'un idéal...
Plutôt que du Lecter, c'est du Dexter qu'il y a chez Wanda. Elle n'a pas conscience d'être différente, dangereuse, non, simplement de ne rien ressentir, quoi qu'elle fasse. La rencontre avec Michaël va lui ouvrir les yeux, lui faire prendre conscience de certaines choses qu'elles n'avaient jamais envisagées jusqu'alors. Et surtout, une perspective...
A sa manière, Wanda va elle aussi trouver son nectar, comme Michaël a découvert le succès. Et c'est tout le drame de l'écrivain : avoir fait découvrir cette saveur à la tueuse, qui devient insatiable... Elle aussi s'inscrit dans la lignée des personnages de "Faims", par son effrayant épanouissement. Pour elle, pas de dilemme ou de questionnements, juste une voie à suivre...
Reste maintenant à savoir ce que décidera de faire Michaël, quelle option il va choisir...
Michaël (prononcez-le à la française) rêve de devenir écrivain. Quelques années plus tôt, une de ses nouvelles a été publiée, mais depuis, il rame pour boucler son premier roman. Ce livre est un thriller dont l'intrigue satisfait l'auteur, mais il trouve qu'il manque un je-ne-sais-quoi à l'ensemble pour aboutir à ce qu'il recherche.
Il est donc bien loin de pouvoir vivre de sa plume et, pour faire rentrer un peu d'argent dans le budget du ménage qu'il forme avec Alexandra. Michaël est enseignant, mais pour pouvoir consacrer le plus de temps à l'écriture, il a choisi de travailler en milieu carcéral : il y anime des ateliers d'écriture avec les détenus, ce qu'il trouve très enrichissant.
Dans la prison où il officie, une prison pour femmes, il fait la connaissance d'une prisonnière, Wanda, qui se démarque des autres. Certes, son style n'est pas terrible, son orthographe, sa grammaire et sa syntaxe laissent à désirer, mais la nouvelle qu'elle lui a remise a laissé le jeune auteur pantois. Il y trouve toute la force qui manque à son propre travail !
Le hic, c'est que Michaël comprend rapidement que les histoires que racontent Wanda sont tirées de sa propre expérience. En clair, ce sont ses propres crimes qu'elle relate avec force détails et cette énergie incroyable nées de l'expérience vécue du meurtre. Tout ce qui manque à Michaël, ébranlé par ces révélations, ainsi que par le fait que certains des crimes de Wanda n'ont jamais été élucidés...
Alors, après avoir longtemps hésité, pesé le pour et le contre, constaté qu'il ne parvenait pas à sortir tout seul de son impasse littéraire, Michaël décide de s'inspirer du travail de Wanda pour donner à son propre roman le petit truc qui lui manque... Et ça marche : non seulement "Sous pression" est accepté par un éditeur, mais il cartonne immédiatement.
En quelques semaines, il devient la coqueluche littéraire du Québec, invité dans tous les salons, dans tous les médias, vendant des livres par centaines, découvrant la popularité, l'aisance et le succès. Un vrai paradoxe pour un garçon qui a toujours mis en avant la qualité de son travail, et non une quelconque ambition à devenir auteur de best-sellers.
Mais, car il y a un mais, dans les années qui suivent, aucun des livres publiés par Michaël ne va retrouver le même succès. Revenu à des méthodes d'écriture plus traditionnelles, le romancier a perdu la formule magique. Une formule dont l'origine lui pose évidemment problème, son succès venant de véritables meurtres...
Michaël ne veut plus entendre parler de Wanda, qui, espère-t-il, restera encore longtemps derrière les barreaux. Mais, à chaque nouvelle parution, son succès et ses ventes s'érodent. Il est rentré dans le rang, supplanté par d'autres romanciers placé sous les feux de la rampe, et il s'aigrit, doucement mais sûrement, agacé de son impuissance et de l'ingratitude du public...
C'est alors que Wanda réapparaît dans sa vie et lui propose son aide...
A sa manière, Patrick Senécal revisite dans ce roman le mythe de Faust : Michael est dans le rôle de ce savant incapable d'accéder par la science à la connaissance universelle. Pour y parvenir, il signe un pacte avec Méphistophélès qui réalisera tout ses voeux en échange de son âme... On connaît l'histoire, si ce n'est en détails, au moins dans sa globalité.
Méphisto, ici, c'est Wanda, mais cette présence féminine dans le rôle du tentateur diabolique n'empêche pas, vous le verrez, je ne l'ai pas évoquée ici, "l'autre reflet" d'avoir également sa Marguerite (mais pas son air des bijoux). L'intrigue apparaît ensuite clairement : Michaël cédera-t-il à la proposition de Wanda, tout en sachant comment elle procédera ?
Ce dilemme moral est le moteur de ce thriller sombre où le parallèle entre Patrick Senécal et son double, Michaël, se pose évidemment. Pour ceux qui ont lu certains des livres précédents de l'auteur, simples thrillers, roman plus fantastiques ou carrément horrifiques, vous savez que son imagination en matière de violence est... débordante.
Comment faire passer cette violence, comment transmettre aux lecteurs la souffrance infligée lorsqu'on ne peut pas l'expérimenter concrètement pour la décrire ? Entre imagination et volonté de réalisme, il faut trouver les effets qui sauront provoquer chez le lecteur la grimace de dégoût, la répulsion, le frisson qu'il attend lorsqu'il ouvre ce genre de livre.
Dans "l'Autre reflet", la fiction permet à Senécal d'intégrer un élément nouveau : la possibilité de la transgression des tabous les plus fondamentaux de nos sociétés. Non seulement, en pompant le texte de Wanda pour son premier roman, Michaël lui a vendu son âme, mais la manière dont elle agi pour réaliser ses souhaits a de terribles conséquences...
Senécal pousse le jeu de miroirs plus loin de la simple relation auteur/personnage : Michaël et Wanda sont, d'une certaine manière, le reflet l'un de l'autre, un peu comme si la meurtrière était la jumelle maléfique, le cygne noir de l'écrivain. L'écrivain (le vrai) joue d'ailleurs avec cette impression de symétrie, qui forme l'architecture de son plan.
De la même manière, il place en vis-à-vis l'ambition artistique de Michaël et ce succès tellement addictif qu'on ne peut, quand on y a goûté, s'en défaire. Et, pour cela, il installe un personnage qui devient, là encore, le négatif de Michaël. On y vient, la voilà, la Marguerite de notre Faust : un ex travaillant dans l'édition, mais ne jurant que par le succès quand Michaël parle de création...
"L'autre reflet" est dans la stricte continuité de "Faims", le précédent roman de Patrick Senécal. On y voyait un cirque un peu particulier proposant des numéros stigmatisant les travers de la société contemporaine et aiguisant chez ses spectateurs des désirs inavoués, inavouables et fort peu moraux... Dans l'assouvissement de ces désirs, se trouvait un épanouissement franchement malsain...
Michaël lui aussi goûte à cet élixir qui rend puissant, mais, pour cela, il a dû passer outre ses dilemmes intérieurs, ses questionnements moraux (qui commencent par le choix de piquer les effets de Wanda pour les incorporer dans son propre livre jusqu'à la question collatérale des meurtres). La tentation de retrouver la saveur inimitable du succès devient alors insoutenable...
Comme souvent dans ses livres, Patrick Senécal sait faire vibrer la vilaine corde sensible de l'être humain, celle des instincts les plus bas que nous avons tous en nous. Cette métamorphose qui fait rejaillir la part d'ombre, la part de violence qui sommeille en chacun de nous. Et le lecteur, lui, assiste à ces combats, à ces chutes, à cette folie, en se demandant ce qu'il ferait, lui, à la place des personnages...
L'engrenage mis en place dans "l'autre reflet" est redoutable : une fois lancer, on ne peut ni l'arrêter, ni le faire repartir en arrière. En fait, en cédant à la tentation, de manière presque innocente, la première fois, Michaël a pénétré dans une souricière. Le voilà irrémédiablement piégé. Plus il se débat, plus il lutte, contre la tentation mais aussi contre l'horreur, plus il s'enferre...
La mécanique de "l'autre reflet", si elle peut avoir quelques côtés attendus par moments, reste implacable et redoutablement efficace. La montée des tensions est inexorable et la position de Michaël de plus en plus difficilement tenable. Wanda, c'est un peu la version féminine, littéraire et exponentielle du personnage incarné par Sergi Lopez dans "Harry, un ami qui vous veut du bien".
Mais, bien sûr, on pense à un autre thriller, un roman-culte, d'un auteur à qui Patrick Senécal est souvent comparé : le "Misery" de Stephen King. On retrouve un écrivain aux prises avec une fan un tantinet encombrante (oui, je maîtrise l'euphémisme...), mais Senécal aborde la question sous un angle différent, en donnant à Wanda un rôle sensiblement différent de celui d'Annie Wilkes.
Je n'ai que très peu parlé de Wanda, finalement, jusqu'ici. Et c'est un tort, parce que c'est un vrai personnage de sociopathe comme on les aime (enfin, tant qu'ils restent bien au chaud dans les pages d'un roman) : elle a cette allure candide, presque angélique. Au premier abord, on lui donnerait le bon dieu sans confession. Mais, dès qu'on gratte un peu le vernis...
Senécal n'en fait pas un Hannibal Lecter au féminin, machiavélique, cynique, tenant les commandes et décidant de tout. Non, même dans sa manière de raconter les horreurs qu'elle a commises, Wanda reste d'une ingénuité troublante. Puis, peu à peu, alors qu'elle se livre, aveux qui ne tomberont que sous les yeux du lecteur, on comprend que, à l'instar de Michaël, elle aussi est en quête d'un idéal...
Plutôt que du Lecter, c'est du Dexter qu'il y a chez Wanda. Elle n'a pas conscience d'être différente, dangereuse, non, simplement de ne rien ressentir, quoi qu'elle fasse. La rencontre avec Michaël va lui ouvrir les yeux, lui faire prendre conscience de certaines choses qu'elles n'avaient jamais envisagées jusqu'alors. Et surtout, une perspective...
A sa manière, Wanda va elle aussi trouver son nectar, comme Michaël a découvert le succès. Et c'est tout le drame de l'écrivain : avoir fait découvrir cette saveur à la tueuse, qui devient insatiable... Elle aussi s'inscrit dans la lignée des personnages de "Faims", par son effrayant épanouissement. Pour elle, pas de dilemme ou de questionnements, juste une voie à suivre...
Reste maintenant à savoir ce que décidera de faire Michaël, quelle option il va choisir...
lundi 21 novembre 2016
"Il me semble parfois avoir démontré qu'entre la célébrité et l'infamie il n'y a qu'un pas, et peut-être moins" (Oscar Wilde).
On aurait pu ressortir le fameux quart d'heure d'Andy Wahrol, mais, aujourd'hui, les aspirants stars espèrent l'être bien plus longtemps (et le sont, en général, bien moins). Devenir célèbre, sans que le pourquoi ait une quelconque importance, est devenu une activité prisée, pour le meilleur mais le plus souvent pour le pire. Voici un roman qui est une satire de cette course à la célébrité et qui la propose sous une forme originale : le giallo. Vous ne connaissez pas ? Explications dans la suite de ce billet, consacré au nouveau roman du jeune et talentueux écrivain argentin Leandro Avalos Blacha. "Malicia", qui vient de paraître aux éditions Asphalte (traduction : Hélène Serrano). Pas de zombies, comme dans l'excellent "Berazachussetts", mais le même esprit plein d'ironie et de fantaisie pour un court roman enlevé et bourré de clins d'oeil au cinéma et à la littérature horrifique. C'est atroce, et on ne peut s'empêcher de rire aux déboires de personnages tous dépassés par les événements qui vont secouer une paisible station balnéaire.
Juan Carlos et Perla ont récemment convolé en justes noces. Pour fêter cet heureux événement, les jeunes époux ont décidé de partir en lune de miel à Villa Carlos Paz, une coquette station balnéaire de la province de Cordoba, en Argentine. Un lieu qui a des faux air d'Atlantic City, avec ses casinos, ses luxueux hôtels, ses théâtres proposant d'incroyables revues...
Mais le couple n'est pas parti seul : le marié a tenu à emmener avec lui son meilleur ami, Mauricio, qu'il connaît depuis l'enfance. Bon, meilleurs amis, c'est peut-être un peu exagéré... Juan Carlos a toujours joyeusement profité de Mauricio, fils d'un commerçant tenant une boutique émettant des billets de loterie. L'activité principale de Juan Carlos et de sa mère, Élida.
Même ce mariage, conclu rapidement, semble avoir été décidé en fonction de cette passion dévorante pour le jeu. Perla, pourtant, ne semble pas se soucier de ces raisons et paraît s'accommoder de son nouveau statut de jeune mariée. Pour être franc, Perla est le genre de personne qu'on ne remarque jamais, qu'on oublie aussi vite qu'on l'a vue...
Cependant, si elle ne possède en apparence aucun talent particulier, Élida a su détecter chez elle quelque chose qui l'a poussée à hâter l'union de son fiston chéri avec Perla, à la surprise générale. Et, ce quelque chose, ce n'est pas rien : une méthode infaillible pour assurer à la petite famille, époux, enfant(s) à venir et belle-mère, une opulence sans fin...
Marta est médium. Une médium anonyme qui rêve de devenir "la médium des stars". Avec ça, fortune et célébrité assurées ! Pour cela, elle s'est dit que Villa Carlos Paz serait un lieu idéal. C'est en effet là que se produit Vilma Menta, la fameuse meneuse de revue, dont l'habitude est de faire monter sur scène un spectateur pour en faire la star d'un jour. Si seulement Marta pouvait être choisie !
Celina est une jeune fille venue à Villa Carlos Paz avec ses parents. C'est une enfant timide, introvertie, discrète. Bien loin des extravagances des cabarets de la station balnéaire. Une petite fille sage comme une image qui fait la fierté de ses parents. Enfin, jusqu'à maintenant... Jusqu'à ce que la fièvre de la célébrité la contamine à son tour...
Estela est une retraitée venue passer un bon moment à Villa Carlos Paz, comme tant d'autres retraités. Mais, si l'endroit lui plaît, parce que c'est une jolie station balnéaire, elle goûte moins les activités qui y sont proposées. Le vice et le mauvais goût sont partout, dans ces casinos, sur ces scènes de théâtre... Non, vraiment, rien de tout ça n'est fait pour Estela...
Tout ce petit monde profite donc de ces quelques jours dans ce petit paradis terrestre, qui va pourtant connaître un gros choc. Une série de meurtres atroces, sans doute l'oeuvre d'un tueur en série, et de la pire espèce. Ses cibles : des actrices, déjà célèbres ou en passe de le devenir dans tout le pays. Et un début de psychose qui gagne...
Jusqu'ici, cela ressemble à un thriller assez classique avec l'ombre d'un impitoyable serial killer. C'est vrai, mais la tonalité générale du roman, teinté d'ironie et d'humour, des personnages décalés, certainement pas des héros en puissance, tout juste des antihéros, assez pénibles pour certains, tout cela crée une atmosphère proche de la comédie noire.
Et puis, au détour d'un couloir, tout bascule. La raison de ce brusque changement, je ne vous la raconterai pas ici, mais elle met en scène un certain nombre de personnages déjà évoqués. Un événement suffisamment bizarre pour que le lecteur marque une pause et se dise : "Wow, je ne suis pas dans un thriller assez classique, là !"
Eh non ! Le fantastique débarque alors en force, amenant dans son sillage un autre élément qui va bientôt prendre le dessus : l'horreur. Qui a lu "Berazachussetts", par exemple, sait que, chez Leandro Avalos Blacha, l'horreur et le gore confinent vite au grand-guignol. On va peut-être avoir quelques moues de dégoût, mais ce sera certainement entre deux éclats de rire.
La paisible station balnéaire de Villa Carlos Paz va rapidement la perdre, la paix. Les événements les plus étonnants vont se produire alors que souffle un vent de folie furieuse. Et de nombreux masques vont tomber, car il s'en passe de belles, au bord du lac San Roque ! S'il reste assez de survivants, nul doute qu'ils auront droit à leur quart d'heure de célébrité et même plus !
Avec "Malicia", Leandro Avalos Blacha rend hommage à un genre très particulier : le giallo. Au départ, il s'agit de romans policiers tout ce qu'il y a de plus classiques, publié sous une couverture de couleur jaune ("giallo", en italien). Mais, ce n'est pas cela qui va nous intéresser. C'est plutôt sa déclinaison cinématographique...
Dans les années 1960, des réalisateurs italiens s'emparent du genre, conserve le côté intrigue policière mais lui adjoignent quelques autres ingrédients qui vont bientôt valoir à ce genre une renommée mondiale : l'horreur, vous vous en doutiez déjà, et l'érotisme. Parmi les fers de lance du giallo, deux noms se détachent : Mario Bava et Dario Argento, qui vont lui donner des lettres euh... pas vraiment de noblesse, en fait...
Leandro Avalos Blacha multiplie d'ailleurs les références à ce genre si particulier tout au long de son roman, mais aussi à quelques classiques comme "l'Exorciste" ou "Rosemary's baby". D'une revue centrée sur le personnage de Batman aux tableaux d'un kitsch absolu, l'histoire va alors partir en sucette pour notre plus grand plaisir.
Je ne suis pas moi-même un grand connaisseur du giallo, certainement moins que d'autres lecteurs. Mais, j'ai reconnu pas mal d'éléments qui m'ont rappelé des images, croisées ça et là, des extraits de films vus à la télé... C'est gratiné, c'est délirant, c'est joyeusement n'importe quoi, mais quelle importance, on s'amuse et c'est le principal.
Ca part un peu dans tous les sens, mais ça se tient. De toute manière, le parti pris est d'emblée gentiment loufoque, alors, on reste dans l'ambiance. Et l'histoire va crescendo, multipliant les péripéties et les situations plus ou moins sombres, plus ou moins folles, jusqu'à un dénouement en forme de bouquet final.
Tous les ingrédients du giallo sont là, même si certains, après ce que je viens d'en dire, trouveront peut-être que ça manque un peu d'érotisme... Bande de petits coquins ! Le reste est là, et permet à l'auteur de mettre en relief un des plus grands travers de notre époque : la soif de célébrité, le fait qu'on en face un but ultime sans se demander si la manière d'y arriver est la bonne.
Derrière la littérature de genre, on retrouve la remarquable sagacité de Leandro Avalos Blacha, son sens de l'observation aiguisé qui font de lui un formidable satiriste. Bien sûr, on peut s'arrêter à une lecture primaire de "Malicia" et n'y voir qu'une farce horrifique et grand-guignolesque. Mais, il me semble que, comme "Berazachussetts" n'est pas un simple roman de zombies, ce livre est plus que ce qu'il paraît être.
Je cite souvent le premier roman de l'auteur, mais c'est parce que je trouve que "Malicia" est dans sa parfaite continuité, entre drôlerie et véritable réflexion en profondeur. Mais, autant les zombies servaient à dénoncer les travers de la société argentine du début du XXIe siècle, autant ce nouvel opus s'adresse à tout le monde, car partout, la célébrité est devenue un idéal qu'on poursuit pas n'importe quel moyen...
Un dernier mot sur un personnage que je n'ai pas encore évoqué. Il est, certainement, le plus décalé de toute la bande : le commissaire Di Luca. Eh oui, le flic, puisqu'on a une intrigue policière dans ce livre. C'est un vieux de la vieille, une espèce de Colombo argentin (je parle surtout de son allure), aussi peu à sa place à Villa Carlos Paz que le célèbre lieutenant à l'imper dans les quartiers chics de Los Angeles.
Il est dépassé, out, complètement obsolète dans ce décor de strass et de paillettes, mais il le sait. Il ne comprend rien à ce qui se passe, mais il ne se décourage pas, mène son enquête, avec pragmatisme et détermination. Et, mine de rien, dans ce gigantesque barnum, il va tirer son épingle du jeu. Sans doute parce qu'il est le seul capable de garder son sang-froid dans cette tourmente...
Je l'aime bien, ce flic. J'aurais aimé le voir à l'oeuvre en d'autres circonstances, lorsqu'il était encore jeune, sémillant, pas complètement blasé et usé sous le harnais. Je suis certain qu'il a résolu bien des affaires, parmi les plus épineuses. Reste à savoir si les événements de Villa Carlos Paz seront un couronnement pour sa respectable carrière, ou la pire chose qui puisse lui arriver...
Je suis très friand de ce que fait Leandro Avalos Blacha, de ce cocktail détonant entre folie (plus ou moins) douce et réflexions sociétales pertinentes. Après "Berazachussetts" et "Côté cour" (à l'ambiance plus sombre mais tout aussi créatif et intelligent), le revoilà au meilleur de sa forme, avec une histoire spectaculaire et déjantée, à consommer sans aucune modération.
Je sais que les mots "horreur", "horrifique" risquent de freiner certains lecteurs. Mais ne craignez rien : "Malicia entre plutôt dans la catégorie de ces films gore qu'on regarde le samedi soir, entre potes, avec du pop-corn, pour passer un bon moment de rigolade. Oui, c'est violent, ça saigne, mais ça n'a rien de cauchemardesque, au contraire, on en ressort ragaillardi, parce qu'il est bon de rire, parfois.
Juan Carlos et Perla ont récemment convolé en justes noces. Pour fêter cet heureux événement, les jeunes époux ont décidé de partir en lune de miel à Villa Carlos Paz, une coquette station balnéaire de la province de Cordoba, en Argentine. Un lieu qui a des faux air d'Atlantic City, avec ses casinos, ses luxueux hôtels, ses théâtres proposant d'incroyables revues...
Mais le couple n'est pas parti seul : le marié a tenu à emmener avec lui son meilleur ami, Mauricio, qu'il connaît depuis l'enfance. Bon, meilleurs amis, c'est peut-être un peu exagéré... Juan Carlos a toujours joyeusement profité de Mauricio, fils d'un commerçant tenant une boutique émettant des billets de loterie. L'activité principale de Juan Carlos et de sa mère, Élida.
Même ce mariage, conclu rapidement, semble avoir été décidé en fonction de cette passion dévorante pour le jeu. Perla, pourtant, ne semble pas se soucier de ces raisons et paraît s'accommoder de son nouveau statut de jeune mariée. Pour être franc, Perla est le genre de personne qu'on ne remarque jamais, qu'on oublie aussi vite qu'on l'a vue...
Cependant, si elle ne possède en apparence aucun talent particulier, Élida a su détecter chez elle quelque chose qui l'a poussée à hâter l'union de son fiston chéri avec Perla, à la surprise générale. Et, ce quelque chose, ce n'est pas rien : une méthode infaillible pour assurer à la petite famille, époux, enfant(s) à venir et belle-mère, une opulence sans fin...
Marta est médium. Une médium anonyme qui rêve de devenir "la médium des stars". Avec ça, fortune et célébrité assurées ! Pour cela, elle s'est dit que Villa Carlos Paz serait un lieu idéal. C'est en effet là que se produit Vilma Menta, la fameuse meneuse de revue, dont l'habitude est de faire monter sur scène un spectateur pour en faire la star d'un jour. Si seulement Marta pouvait être choisie !
Celina est une jeune fille venue à Villa Carlos Paz avec ses parents. C'est une enfant timide, introvertie, discrète. Bien loin des extravagances des cabarets de la station balnéaire. Une petite fille sage comme une image qui fait la fierté de ses parents. Enfin, jusqu'à maintenant... Jusqu'à ce que la fièvre de la célébrité la contamine à son tour...
Estela est une retraitée venue passer un bon moment à Villa Carlos Paz, comme tant d'autres retraités. Mais, si l'endroit lui plaît, parce que c'est une jolie station balnéaire, elle goûte moins les activités qui y sont proposées. Le vice et le mauvais goût sont partout, dans ces casinos, sur ces scènes de théâtre... Non, vraiment, rien de tout ça n'est fait pour Estela...
Tout ce petit monde profite donc de ces quelques jours dans ce petit paradis terrestre, qui va pourtant connaître un gros choc. Une série de meurtres atroces, sans doute l'oeuvre d'un tueur en série, et de la pire espèce. Ses cibles : des actrices, déjà célèbres ou en passe de le devenir dans tout le pays. Et un début de psychose qui gagne...
Jusqu'ici, cela ressemble à un thriller assez classique avec l'ombre d'un impitoyable serial killer. C'est vrai, mais la tonalité générale du roman, teinté d'ironie et d'humour, des personnages décalés, certainement pas des héros en puissance, tout juste des antihéros, assez pénibles pour certains, tout cela crée une atmosphère proche de la comédie noire.
Et puis, au détour d'un couloir, tout bascule. La raison de ce brusque changement, je ne vous la raconterai pas ici, mais elle met en scène un certain nombre de personnages déjà évoqués. Un événement suffisamment bizarre pour que le lecteur marque une pause et se dise : "Wow, je ne suis pas dans un thriller assez classique, là !"
Eh non ! Le fantastique débarque alors en force, amenant dans son sillage un autre élément qui va bientôt prendre le dessus : l'horreur. Qui a lu "Berazachussetts", par exemple, sait que, chez Leandro Avalos Blacha, l'horreur et le gore confinent vite au grand-guignol. On va peut-être avoir quelques moues de dégoût, mais ce sera certainement entre deux éclats de rire.
La paisible station balnéaire de Villa Carlos Paz va rapidement la perdre, la paix. Les événements les plus étonnants vont se produire alors que souffle un vent de folie furieuse. Et de nombreux masques vont tomber, car il s'en passe de belles, au bord du lac San Roque ! S'il reste assez de survivants, nul doute qu'ils auront droit à leur quart d'heure de célébrité et même plus !
Avec "Malicia", Leandro Avalos Blacha rend hommage à un genre très particulier : le giallo. Au départ, il s'agit de romans policiers tout ce qu'il y a de plus classiques, publié sous une couverture de couleur jaune ("giallo", en italien). Mais, ce n'est pas cela qui va nous intéresser. C'est plutôt sa déclinaison cinématographique...
Dans les années 1960, des réalisateurs italiens s'emparent du genre, conserve le côté intrigue policière mais lui adjoignent quelques autres ingrédients qui vont bientôt valoir à ce genre une renommée mondiale : l'horreur, vous vous en doutiez déjà, et l'érotisme. Parmi les fers de lance du giallo, deux noms se détachent : Mario Bava et Dario Argento, qui vont lui donner des lettres euh... pas vraiment de noblesse, en fait...
Leandro Avalos Blacha multiplie d'ailleurs les références à ce genre si particulier tout au long de son roman, mais aussi à quelques classiques comme "l'Exorciste" ou "Rosemary's baby". D'une revue centrée sur le personnage de Batman aux tableaux d'un kitsch absolu, l'histoire va alors partir en sucette pour notre plus grand plaisir.
Je ne suis pas moi-même un grand connaisseur du giallo, certainement moins que d'autres lecteurs. Mais, j'ai reconnu pas mal d'éléments qui m'ont rappelé des images, croisées ça et là, des extraits de films vus à la télé... C'est gratiné, c'est délirant, c'est joyeusement n'importe quoi, mais quelle importance, on s'amuse et c'est le principal.
Ca part un peu dans tous les sens, mais ça se tient. De toute manière, le parti pris est d'emblée gentiment loufoque, alors, on reste dans l'ambiance. Et l'histoire va crescendo, multipliant les péripéties et les situations plus ou moins sombres, plus ou moins folles, jusqu'à un dénouement en forme de bouquet final.
Tous les ingrédients du giallo sont là, même si certains, après ce que je viens d'en dire, trouveront peut-être que ça manque un peu d'érotisme... Bande de petits coquins ! Le reste est là, et permet à l'auteur de mettre en relief un des plus grands travers de notre époque : la soif de célébrité, le fait qu'on en face un but ultime sans se demander si la manière d'y arriver est la bonne.
Derrière la littérature de genre, on retrouve la remarquable sagacité de Leandro Avalos Blacha, son sens de l'observation aiguisé qui font de lui un formidable satiriste. Bien sûr, on peut s'arrêter à une lecture primaire de "Malicia" et n'y voir qu'une farce horrifique et grand-guignolesque. Mais, il me semble que, comme "Berazachussetts" n'est pas un simple roman de zombies, ce livre est plus que ce qu'il paraît être.
Je cite souvent le premier roman de l'auteur, mais c'est parce que je trouve que "Malicia" est dans sa parfaite continuité, entre drôlerie et véritable réflexion en profondeur. Mais, autant les zombies servaient à dénoncer les travers de la société argentine du début du XXIe siècle, autant ce nouvel opus s'adresse à tout le monde, car partout, la célébrité est devenue un idéal qu'on poursuit pas n'importe quel moyen...
Un dernier mot sur un personnage que je n'ai pas encore évoqué. Il est, certainement, le plus décalé de toute la bande : le commissaire Di Luca. Eh oui, le flic, puisqu'on a une intrigue policière dans ce livre. C'est un vieux de la vieille, une espèce de Colombo argentin (je parle surtout de son allure), aussi peu à sa place à Villa Carlos Paz que le célèbre lieutenant à l'imper dans les quartiers chics de Los Angeles.
Il est dépassé, out, complètement obsolète dans ce décor de strass et de paillettes, mais il le sait. Il ne comprend rien à ce qui se passe, mais il ne se décourage pas, mène son enquête, avec pragmatisme et détermination. Et, mine de rien, dans ce gigantesque barnum, il va tirer son épingle du jeu. Sans doute parce qu'il est le seul capable de garder son sang-froid dans cette tourmente...
Je l'aime bien, ce flic. J'aurais aimé le voir à l'oeuvre en d'autres circonstances, lorsqu'il était encore jeune, sémillant, pas complètement blasé et usé sous le harnais. Je suis certain qu'il a résolu bien des affaires, parmi les plus épineuses. Reste à savoir si les événements de Villa Carlos Paz seront un couronnement pour sa respectable carrière, ou la pire chose qui puisse lui arriver...
Je suis très friand de ce que fait Leandro Avalos Blacha, de ce cocktail détonant entre folie (plus ou moins) douce et réflexions sociétales pertinentes. Après "Berazachussetts" et "Côté cour" (à l'ambiance plus sombre mais tout aussi créatif et intelligent), le revoilà au meilleur de sa forme, avec une histoire spectaculaire et déjantée, à consommer sans aucune modération.
Je sais que les mots "horreur", "horrifique" risquent de freiner certains lecteurs. Mais ne craignez rien : "Malicia entre plutôt dans la catégorie de ces films gore qu'on regarde le samedi soir, entre potes, avec du pop-corn, pour passer un bon moment de rigolade. Oui, c'est violent, ça saigne, mais ça n'a rien de cauchemardesque, au contraire, on en ressort ragaillardi, parce qu'il est bon de rire, parfois.
dimanche 20 novembre 2016
"La cité des mensonges".
Après l'Afghanistan, direction le Japon, pour un roman complètement différent, dans le fond comme dans la forme. Plus un roman noir qu'un thriller, d'ailleurs, dans une ambiance pesante et assez malsaine, vous allez comprendre pourquoi. Entre dépaysement et choc culturel, voici un livre qui met en scène de beaux personnages ayant tous une particularité : ils ont une relation particulière à la vérité. Oui, disons-le, pour plusieurs d'entre eux, ils mentent comme une armée d'arracheurs de dents... "Kabukicho" est le nouveau roman de Dominique Sylvain (aux éditions Viviane Hamy) et il vous offrira une ambiance très prenante et dérangeante, mais aussi une montée progressive de la tension qui entraîne le lecteur dans un univers de noirceur... Avec une plongée dans un Japon inattendu, déroutant, glauque, débarrassé de sa rigidité et de ses tabous.
Kabukicho, c'est l'un des quartiers les plus chauds de Tokyo. Pas le plus chic, loin de là, mais c'est là que les habitants de la capitale japonaise viennent relâcher la pression. Dans les établissements de ce quartier, ils y passent un bonne partie de la nuit à boire et à faire la fête, laissant au vestiaire leur traditionnelle retenue diurne. Et puis, ils y rencontrent hôtes et hôtesses...
Il s'agit d'une profession étrange, qui consiste en grande partie à faire la conversation à ses clients, mais aussi, parce qu'il faut bien vivre, à alourdir gentiment leur note en remplissant leur verre à peine vidé. Et les mots qui sont prononcés sont évidemment, la plupart du temps, de pure forme : on dit au client ce qu'il veut entendre, ce qui rehausse l'image qu'il a de lui-même.
Et le sexe, dans tout ça ? Naturellement, la question se pose, puisqu'on a évoqué ce "quartier chaud". Les hôtes et les hôtesses ne sont pas des prostitués, rien ne les oblige à aller plus loin que les conversations que je viens d'évoquer. Certains poussent la prestation au-delà, couchent avec certains clients contre rémunération, c'est vrai.
C'est le cas de Yudai. Il est l'hôte n°1 de Kabukicho, une personnalité incontournable du quartier. Elégant, dandy, presque, il se considère comme le roi des menteurs à Tokyo, car c'est son talent pour la conversation qui a fait de lui une figure de la vie nocturne dans la capitale japonaise, immortalisée dans un manga et célébrée par de nombreuses photos.
Sachant cela, on pourrait s'attendre à faire la connaissance d'un personnage odieux, hautain, jouant les stars... Mais ce n'est pas le cas. Yudai est un personnage plein de sensibilité. Plein de blessures secrètes, également, que l'on va voir apparaître au fil de ce roman. Un homme usé, abîmé, déchiré entre sa véritable personnalité et son image professionnelle.
Son réconfort, il le trouve auprès d'une de ses collègues. Kate est une hôtesse en vue, elle aussi, sans doute pour des raisons différentes : anglaise d'origine, venue s'installer à Tokyo quelques années plus tôt, elle a séduit les clients avec son allure européenne, ses cheveux blonds, son humour et son sens de la conversation.
Yudai et Kate sont très différents, et c'est certainement ce qui explique pourquoi ils s'apprécient tant. Pourquoi ils ont noué une amitié sans ambiguïté : entre eux, une grande tendresse, une vraie complicité, une réelle confiance et rien d'autre. En d'autres circonstances, sans doute seraient-ils devenus amants, mais pas à Kabukicho.
Jusqu'au jour où Kate disparaît...
A Londres, son père, qui n'avait plus de nouvelle de sa fille après une brouille qui l'avait poussée au départ, reçoit un étrange message sur son portable. On y voit une photo de Kate, étendue, inerte, accompagnée d'un court message : "elle dort ici". Est-elle endormie, détenue quelque part ? Est-elle morte ? Impossible à dire.
Sanders décide aussitôt de se rendre à Tokyo pour retrouver sa fille par tous les moyens. Sur place, il prend contact avec Marie, une jeune française qui était la colocataire de sa fille, et découvre le mode de vie des deux jeunes femmes. Pas de quoi l'offusque, l'urgence est ailleurs et Sanders entend remuer ciel et terre pour qu'on retrouve Kate...
La police locale a confié l'affaire à un flic de métier, pourtant mis au rencart depuis un moment. Le capitaine Yamada était un des meilleurs flics de Tokyo jusqu'à ce qu'il soit grièvement blessé par balle en service. Revenu à son poste, il souffre d'une amnésie qu'il essaye de combler en compulsant sans cesse les dossiers de ses propres affaires. Mais il sent qu'on ne lui fait plus confiance...
Alors, avec humilité, discrétion mais détermination, il se lance dans cette enquête qui pourrait, peut-être, l'aider à retrouver le respect perdu et un statut qui correspondra mieux à son exemplaire carrière. Mais qui doit-il traquer ? Un kidnappeur, du genre amant jaloux qui aurait voulu garder l'hôtesse pour lui ? Un détraqué qui aurait flashé sur la belle Anglaise ? Ou pire, un tueur en série, espèce rare au Japon ?
Yudai, Marie et Yamada vont nous relater leurs recherches pour essayer de retrouver la trace de Kate avant qu'il ne soit trop tard. Chaque chapitre est raconté du point de vue d'un de ces trois personnages et, au-delà des questions posées par la disparition de Kate, c'est eux que l'on découvre, avec leur vérité... Et leurs réalités faussées.
Le décor est planté, enfin, pas tout à fait, encore un mot sur Kabukicho, qui est plus qu'un décor. Le quartier est bien sûr le socle de l'ambiance très particulière qui préside au roman de Dominique Sylvain, mais c'est un vrai personnage. Construit peu après la IIe Guerre mondiale, il devait être, comme son nom l'indique, un quartier dédié au théâtre kabuki.
Mais, la présence américaine dans l'archipel a fait dévier le projet : il fallait accueillir les GI's à la recherche d'un havre où passer ses permissions. Voilà comment ce quartier tout neuf est devenu un lieu de plaisirs divers et variés, à condition d'y mettre le prix. Et voilà comment sa sulfureuse réputation n'a plus cessé de grandir, jusqu'à devenir une cible : la mairie de Tokyo voudrait s'en débarrasser avant d'accueillir les prochains Jeux olympiques, en 2020...
Ce qui est fascinant, c'est que le parallèle entre sa nouvelle vocation et sa destination première demeure : Kabukicho reste un gigantesque théâtre, certes bien différent de l'art très codifié du kabuki. Pourtant, endormi le jour, le quartier prend vie la nuit, comme une scène qui s'allume sous les feux de la rampe. Hôtes et hôtesses en sont les acteurs vedettes, jouant un rôle jusqu'au lever du jour, où ils réintègrent leur propre existence.
Dominique Sylvain, qui a vécu à Tokyo et apprécie la culture japonaise, rend très bien cet atmosphère étrange, déroutante pour le regard occidental. On y voit les salariés japonais dépenser des sommes énormes en alcool, se lâcher comme jamais ils ne le feraient en journée, dans leur vie professionnelle ou familiale... On se croirait dans une espèce de fête des fous, où tout est permis, où la rigidité traditionnelle n'existe plus.
Yudai et Kate gagnent leur vie en jouant les hôtes parfaits, apportant le réconfort nécessaire à leur clientèle. Mais, l'ambiguïté de cette profession, le mélange affaires, argent, alcool, jeux, sexe, tout cela est propice aux mauvais coups et aux dangers. Une fois sortis de scène, les acteurs se retrouvent vulnérables et doivent affronter leurs propres démons...
"Kabukicho" est un roman plein de mensonges et de faux-semblants. Vous comprendrez évidemment que je ne peux pas développer trop cette facette du livre : c'est l'un des moteurs de l'intrigue et il se dévoile petit à petit. Mais, Dominique Sylvain l'alimente avec habileté, en multipliant les clins d'oeil au gré des chapitres.
Ainsi, aperçoit-on Delon dans "Plein Soleil", film adapté du roman "Le talentueux M. Ripley", de Patricia Highsmith, dont on repère la couverture, ou encore Deneuve dans "la Sirène du Mississippi"... Leur dénominateur commun ; le mensonge, la dissimulation, la fabrication d'un autre... J'aurais bien vu une autre référence cinématographique, mais pas de Bridget Fonda ou de Jennifer Jason Leigh..;
Oui, on ment dans ce roman. Pour plein de raisons, souvent d'excellentes, d'ailleurs. Je l'ai dit à propos de Yudai mais cela vaut pour d'autres. Se construire une autre vie que celle dans laquelle on évolue, écarter les murs, se faire passer pour un autre, se grandir, s'embellir, tout cela est très humain et, finalement, assez peu répréhensible. A priori...
Mais je m'en voudrais de finir ce billet sans parler un peu plus de Kate.Oh, je ne vais pas entrer dans le détail, mais simplement parce que ce personnage, détonateur de l'intrigue lorsqu'elle disparaît, reste omniprésente d'un bout à l'autre. Elle n'est pas la Rebecca de Daphné du Maurier, mais c'est vrai que sa présence a quelque chose de subliminal, d'indélébile.
Or, si elle n'intervient pas, comme d'autres, dans la narration, et donc si elle ne participe pas à la révélation des secrets qui font la trame de ce livre, sa personnalité tient une place importante dans tout cela. Sa personnalité, mais aussi ses mensonges... Il ne s'agit pas de dénigrer la victime, attention, juste de constater des faits : Kate exelle dans l'art de dissimuler...
Un dernier point, rapide. Dans "Kabukicho", Dominique Sylvain joue aussi sur une espèce de mise en abyme. Et c'est logique : l'écrivain n'est-il pas un parfait menteur, lui aussi ? Umberto Eco, dans "Baudolino", entre autres, explorait cette idée. Ici, vous le découvrirez, l'écriture tient une place particulière dans ce roman noir. Mais, chut, n'en disons pas plus !
En jouant avec les différences culturels entre Japon et Occident, Dominique Sylvain réussit à créer une tension qui va croissant. Ce côté oppressant, assez glauque, franchement déroutant est l'un des côtés forts du livre, tout comme la personnalité du tueur, qui mériterait un ou deux paragraphes, si je pouvais... Personnage fascinant, complexe et effrayant...
Êtes-vous prêt à plonger au coeur des lumières de Kabukicho, à la rencontre des hôtes et des hôtesses, de leurs clients, des propriétaires de ces établissements nocturnes et de tout ceux qui y fraient ? Soyez prudent, chaque ombre n'est sans doute pas ce qu'elle semble être et le danger pourrait être... n'importe qui !
Kabukicho, c'est l'un des quartiers les plus chauds de Tokyo. Pas le plus chic, loin de là, mais c'est là que les habitants de la capitale japonaise viennent relâcher la pression. Dans les établissements de ce quartier, ils y passent un bonne partie de la nuit à boire et à faire la fête, laissant au vestiaire leur traditionnelle retenue diurne. Et puis, ils y rencontrent hôtes et hôtesses...
Il s'agit d'une profession étrange, qui consiste en grande partie à faire la conversation à ses clients, mais aussi, parce qu'il faut bien vivre, à alourdir gentiment leur note en remplissant leur verre à peine vidé. Et les mots qui sont prononcés sont évidemment, la plupart du temps, de pure forme : on dit au client ce qu'il veut entendre, ce qui rehausse l'image qu'il a de lui-même.
Et le sexe, dans tout ça ? Naturellement, la question se pose, puisqu'on a évoqué ce "quartier chaud". Les hôtes et les hôtesses ne sont pas des prostitués, rien ne les oblige à aller plus loin que les conversations que je viens d'évoquer. Certains poussent la prestation au-delà, couchent avec certains clients contre rémunération, c'est vrai.
C'est le cas de Yudai. Il est l'hôte n°1 de Kabukicho, une personnalité incontournable du quartier. Elégant, dandy, presque, il se considère comme le roi des menteurs à Tokyo, car c'est son talent pour la conversation qui a fait de lui une figure de la vie nocturne dans la capitale japonaise, immortalisée dans un manga et célébrée par de nombreuses photos.
Sachant cela, on pourrait s'attendre à faire la connaissance d'un personnage odieux, hautain, jouant les stars... Mais ce n'est pas le cas. Yudai est un personnage plein de sensibilité. Plein de blessures secrètes, également, que l'on va voir apparaître au fil de ce roman. Un homme usé, abîmé, déchiré entre sa véritable personnalité et son image professionnelle.
Son réconfort, il le trouve auprès d'une de ses collègues. Kate est une hôtesse en vue, elle aussi, sans doute pour des raisons différentes : anglaise d'origine, venue s'installer à Tokyo quelques années plus tôt, elle a séduit les clients avec son allure européenne, ses cheveux blonds, son humour et son sens de la conversation.
Yudai et Kate sont très différents, et c'est certainement ce qui explique pourquoi ils s'apprécient tant. Pourquoi ils ont noué une amitié sans ambiguïté : entre eux, une grande tendresse, une vraie complicité, une réelle confiance et rien d'autre. En d'autres circonstances, sans doute seraient-ils devenus amants, mais pas à Kabukicho.
Jusqu'au jour où Kate disparaît...
A Londres, son père, qui n'avait plus de nouvelle de sa fille après une brouille qui l'avait poussée au départ, reçoit un étrange message sur son portable. On y voit une photo de Kate, étendue, inerte, accompagnée d'un court message : "elle dort ici". Est-elle endormie, détenue quelque part ? Est-elle morte ? Impossible à dire.
Sanders décide aussitôt de se rendre à Tokyo pour retrouver sa fille par tous les moyens. Sur place, il prend contact avec Marie, une jeune française qui était la colocataire de sa fille, et découvre le mode de vie des deux jeunes femmes. Pas de quoi l'offusque, l'urgence est ailleurs et Sanders entend remuer ciel et terre pour qu'on retrouve Kate...
La police locale a confié l'affaire à un flic de métier, pourtant mis au rencart depuis un moment. Le capitaine Yamada était un des meilleurs flics de Tokyo jusqu'à ce qu'il soit grièvement blessé par balle en service. Revenu à son poste, il souffre d'une amnésie qu'il essaye de combler en compulsant sans cesse les dossiers de ses propres affaires. Mais il sent qu'on ne lui fait plus confiance...
Alors, avec humilité, discrétion mais détermination, il se lance dans cette enquête qui pourrait, peut-être, l'aider à retrouver le respect perdu et un statut qui correspondra mieux à son exemplaire carrière. Mais qui doit-il traquer ? Un kidnappeur, du genre amant jaloux qui aurait voulu garder l'hôtesse pour lui ? Un détraqué qui aurait flashé sur la belle Anglaise ? Ou pire, un tueur en série, espèce rare au Japon ?
Yudai, Marie et Yamada vont nous relater leurs recherches pour essayer de retrouver la trace de Kate avant qu'il ne soit trop tard. Chaque chapitre est raconté du point de vue d'un de ces trois personnages et, au-delà des questions posées par la disparition de Kate, c'est eux que l'on découvre, avec leur vérité... Et leurs réalités faussées.
Le décor est planté, enfin, pas tout à fait, encore un mot sur Kabukicho, qui est plus qu'un décor. Le quartier est bien sûr le socle de l'ambiance très particulière qui préside au roman de Dominique Sylvain, mais c'est un vrai personnage. Construit peu après la IIe Guerre mondiale, il devait être, comme son nom l'indique, un quartier dédié au théâtre kabuki.
Mais, la présence américaine dans l'archipel a fait dévier le projet : il fallait accueillir les GI's à la recherche d'un havre où passer ses permissions. Voilà comment ce quartier tout neuf est devenu un lieu de plaisirs divers et variés, à condition d'y mettre le prix. Et voilà comment sa sulfureuse réputation n'a plus cessé de grandir, jusqu'à devenir une cible : la mairie de Tokyo voudrait s'en débarrasser avant d'accueillir les prochains Jeux olympiques, en 2020...
Ce qui est fascinant, c'est que le parallèle entre sa nouvelle vocation et sa destination première demeure : Kabukicho reste un gigantesque théâtre, certes bien différent de l'art très codifié du kabuki. Pourtant, endormi le jour, le quartier prend vie la nuit, comme une scène qui s'allume sous les feux de la rampe. Hôtes et hôtesses en sont les acteurs vedettes, jouant un rôle jusqu'au lever du jour, où ils réintègrent leur propre existence.
Dominique Sylvain, qui a vécu à Tokyo et apprécie la culture japonaise, rend très bien cet atmosphère étrange, déroutante pour le regard occidental. On y voit les salariés japonais dépenser des sommes énormes en alcool, se lâcher comme jamais ils ne le feraient en journée, dans leur vie professionnelle ou familiale... On se croirait dans une espèce de fête des fous, où tout est permis, où la rigidité traditionnelle n'existe plus.
Yudai et Kate gagnent leur vie en jouant les hôtes parfaits, apportant le réconfort nécessaire à leur clientèle. Mais, l'ambiguïté de cette profession, le mélange affaires, argent, alcool, jeux, sexe, tout cela est propice aux mauvais coups et aux dangers. Une fois sortis de scène, les acteurs se retrouvent vulnérables et doivent affronter leurs propres démons...
"Kabukicho" est un roman plein de mensonges et de faux-semblants. Vous comprendrez évidemment que je ne peux pas développer trop cette facette du livre : c'est l'un des moteurs de l'intrigue et il se dévoile petit à petit. Mais, Dominique Sylvain l'alimente avec habileté, en multipliant les clins d'oeil au gré des chapitres.
Ainsi, aperçoit-on Delon dans "Plein Soleil", film adapté du roman "Le talentueux M. Ripley", de Patricia Highsmith, dont on repère la couverture, ou encore Deneuve dans "la Sirène du Mississippi"... Leur dénominateur commun ; le mensonge, la dissimulation, la fabrication d'un autre... J'aurais bien vu une autre référence cinématographique, mais pas de Bridget Fonda ou de Jennifer Jason Leigh..;
Oui, on ment dans ce roman. Pour plein de raisons, souvent d'excellentes, d'ailleurs. Je l'ai dit à propos de Yudai mais cela vaut pour d'autres. Se construire une autre vie que celle dans laquelle on évolue, écarter les murs, se faire passer pour un autre, se grandir, s'embellir, tout cela est très humain et, finalement, assez peu répréhensible. A priori...
Mais je m'en voudrais de finir ce billet sans parler un peu plus de Kate.Oh, je ne vais pas entrer dans le détail, mais simplement parce que ce personnage, détonateur de l'intrigue lorsqu'elle disparaît, reste omniprésente d'un bout à l'autre. Elle n'est pas la Rebecca de Daphné du Maurier, mais c'est vrai que sa présence a quelque chose de subliminal, d'indélébile.
Or, si elle n'intervient pas, comme d'autres, dans la narration, et donc si elle ne participe pas à la révélation des secrets qui font la trame de ce livre, sa personnalité tient une place importante dans tout cela. Sa personnalité, mais aussi ses mensonges... Il ne s'agit pas de dénigrer la victime, attention, juste de constater des faits : Kate exelle dans l'art de dissimuler...
Un dernier point, rapide. Dans "Kabukicho", Dominique Sylvain joue aussi sur une espèce de mise en abyme. Et c'est logique : l'écrivain n'est-il pas un parfait menteur, lui aussi ? Umberto Eco, dans "Baudolino", entre autres, explorait cette idée. Ici, vous le découvrirez, l'écriture tient une place particulière dans ce roman noir. Mais, chut, n'en disons pas plus !
En jouant avec les différences culturels entre Japon et Occident, Dominique Sylvain réussit à créer une tension qui va croissant. Ce côté oppressant, assez glauque, franchement déroutant est l'un des côtés forts du livre, tout comme la personnalité du tueur, qui mériterait un ou deux paragraphes, si je pouvais... Personnage fascinant, complexe et effrayant...
Êtes-vous prêt à plonger au coeur des lumières de Kabukicho, à la rencontre des hôtes et des hôtesses, de leurs clients, des propriétaires de ces établissements nocturnes et de tout ceux qui y fraient ? Soyez prudent, chaque ombre n'est sans doute pas ce qu'elle semble être et le danger pourrait être... n'importe qui !
"Nous sommes les enfants éternels de la nuit, aux enfers, on nous appelle les Furies" (Eschyle).
- Le billet sur "Pukhtu primo".
Un citation tirée de "l'Orestie" que l'on trouve dans notre roman du jour. Le choix de ce titre peut sembler un peu brumeux, comme ça, mais je vous assure que, si vous lisez le livre, vous comprendrez pourquoi je me suis arrêté dessus. A la fois symboliques et réalistes, et, si vous doutez encore, allez voir qui sont les Furies. Notre roman du jour marque la fin d'un cycle, entamé il y a près de dix ans, je parle du cycle d'écriture. Avec "Pukhtu secundo" (récemment parue à la Série Noire), DOA achève la trilogie, devenue tétralogie, avec le découpage de "Pukhtu" en deux volets, entamée avec "Citoyens clandestins". Si l'Afghanistan était le coeur de "Primo", "Secundo", lui, se déroule en majeure partie en Europe, nous emmène en Afrique, avant de revenir en Afghanistan pour un final à couper le souffle. C'est toujours aussi violent, lyrique et puissant, mais, dans ce monde sinistre, cynique et dangereux qu'il nous décrit, DOA parvient à laisser filtrer quelques lueurs d'espoir, vite mises sous le boisseau par un certain pessimisme...
D'abord, un petit rappel, pour qui n'a pas forcément lu "Pukhtu primo". Pukhtu, c'est un mot pachtoune qu'on ne peut traduire littéralement en français. C'est une notion très forte dans la culture afghane, l'honneur, mais un honneur qui regroupe la notion sur le plan individuel et collectif, via le clan, la famille.
Dans ces deux romans, même s'il est moins présent dans ce deuxième volet, c'est Sher Ali Khan Zadran qui incarne cette valeur traditionnelle, dans un pays où elle est de plus en plus bafouée, des forces occidentales installés sur son sol aux combattants du djihad, prêts à tout pour imposer leur vision.
Sher Khan n'aspire qu'à une chose : la vengeance, seul moyen de restaurer son pukhtu. La mort de sa famille dans un raid américain l'a poussé à s'engager aux côtés des Talibans, mais il a rapidement compris qu'il avait choisi la peste contre le choléra. Dans ce roman, sa soif de vengeance va se heurter à l'horreur qu'il côtoie et cautionne ; à lui de trouver une autre voie pour restaurer son honneur.
Je referme ce rappel pour revenir aux trames principales de ce second volet. A commencer par Fox. Mercenaire, agent secret, personnage au passé complexe au point de ne plus savoir vraiment qui il est, il travaille en Afghanistan au sein d'une entreprise paramilitaire américaine, 6N, dont les salariés ont des méthodes pour le moins troubles...
Ces chiens de guerre, nourris de violence, ne faisant aucun quartier et venus là surtout pour se battre, encore et encore, ont mis sur pied un trafic d'héroïne lucratif, s'éloignant encore un peu plus de l'honneur militaire qu'ils devraient incarner. Fox a pour mission de se rapprocher de ces hommes, dont le meneur, Voodoo, ne l'aime pas, mais pas du tout.
La troupe de Voodoo est sous tension, l'un des leurs, Ghost, a été capturé et l'on assiste, dans les premières pages du livre, aux tortures qui lui sont infligées. Là encore, colère et soif de vengeance vont s'en mêler et ces mercenaires, usés, incapables de s'imaginer dans un autre contexte mais laminés par le danger, la peur, sentent qu'ils sont à la croisée des chemins...
Fox, lui, ressent aussi cette montée des tensions et redoutent le pire, certain que ces hommes sont prêts à faire payer au pays et à sa population la colère brute, atroce, qu'ils ressentent. Le voilà coincé, contraint de poursuivre sa mission, les démasquer, au risque de devoir prendre part à leur sinistre expédition punitive...
Mais Fox n'est pas plus frais que ses compagnons. Lui aussi commence à en avoir assez de ces guerres interminables, de ces conflits qui bouffent sa part d'humanité, de son incapacité à savoir qui il est réellement... Lui aussi ressent subitement le besoin de restaurer un honneur largement terni par ses années passées comme "citoyen clandestin"...
Amel Balhimer est journaliste. A Paris, elle travaille discrètement à l'enquête qui lui permettra de faire tomber Alain Montana, figure trouble et néfaste, comme notre chère République sait en produire parfois. Ancien ponte des services secrets, Montana a quitté l'administration pour fonder une officine, PEMEO, dont l'influence reste forte dans les sphères du pouvoir.
Mais, derrière cette façade, Alain Montant a mis un place un réseau bien moins reluisant, en s'alliant, entre autres, à des mafieux kosovars. Amel a compris que PEMEO n'était qu'un paravent pour des activités illégales et particulièrement sordides. Elle veut monter un dossier solide contre Montana et sa boîte, mais cela demande du temps.
Dans ce but, elle a séduit Chloé, la maîtresse de Montana, et se sert de la jeune femme, accro aux stupéfiants, pour obtenir quelques informations. Mais, elle sait que ce n'est pas à Paris qu'elle trouvera les éléments à charge indiscutables qui lui permettront d'avoir la tête de Montana, un des hommes les plus puissants du pays.
Reste à organiser cette dernière partie de l'enquête, en Afghanistan, avec le soutien de Peter Dang, un ami journaliste qui connaît très bien ce pays. Amel est prête à tout pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Peu importe que sa croisade journalistique la prive de toute autre vie, menace ses relations familiales. Elle veut faire tomber Montana et est prête à braver tous les dangers pour cela...
Dernier personnage central de ce "Pukhtu secundo", nous l'appellerons Lynx, puisque c'est son alias le plus fameux. Vous l'aurez compris, il est de la même "famille" que Fox ou Voodoo. Lui aussi a été citoyen clandestin et donc barbouze. Mais lui a su se retirer lorsqu'il a senti qu'il arrivait et se reconstruire, ailleurs.
Enfin, se reconstruire... C'est tout l'enjeu de ce cycle : montrer qu'on ne se remet jamais de cette expérience, qu'on ne cesse jamais d'être un citoyen clandestin, qu'on ne sera plus jamais celui qu'on était à la naissance. Et Lynx, malgré les apparences, en est là, lui aussi. Il essaye de fuir ce passé, de profiter du présent et d'envisager un avenir. Mais...
Ce passé tordu va le rattraper de la pire des façons. Je n'entre pas dans les détails, cela fait partie de l'intrigue, à vous de le découvrir. Mais, Lynx n'a plus le choix : redevenir celui qu'il fut, le chien de guerre intraitable, pour assouvir sa vengeance. A lui aussi, de trouver une façon de canaliser sa colère pour qu'elle soit finalement utile à quelque chose, pas uniquement destructrice...
Amel, Lynx et Fox vont rapidement devenir les personnages moteurs de ce roman très sombre, terriblement violent, parce qu'ils sont aussi ceux que DOA met en scène depuis près de dix ans. Pourrais-je affirmer dans ce billet que "Pukhtu secundo" est le point final à leur destin ? Non, même si je le pense. Mais la fin reste finalement assez ouverte, alors, pourquoi ne pas les retrouver ?
Tout ce petit monde est mû par des émotions bien humaines, preuve qu'ils n'ont pas complètement franchi la limite vers le néant. Il y a la haine, la vengeance et la volonté de ne laisser aucun répit à ceux qu'on vise (êtes-vous allés voir qui étaient les Furies ?). Pourtant, chez nos trois protagonistes principaux, ces forces terribles qui vont se déchaîner, vont trouver d'autres objectifs.
Des objectifs plus justes, à condition de se détourner du but initial. L'expression "quête initiatique" serait peut-être un peu trop forte. Ou alors, sa dernière ligne droite, car la leur a été entamée depuis un moment. Mais, cette fois, il y a le sentiment certains de faire quelque chose d'utile, de fort, de juste, j'y reviens. Quelque chose qui vaille vraiment le coup de tout sacrifier...
Et, malgré le déchaînement de violence constant, malgré la folie qui guette et qui est proche d'engloutir tout ce beau monde, c'est bel et bien le côté humain qui va percer, s'imposer, si ce n'est l'emporter. Oui, c'est ce qui fait la force de ce récit, cette révélation chez Lynx et Fox en particulier de cette facette enfouie depuis plus ou moins longtemps au plus profond d'eux, comme oubliée, refoulée...
La grande force de DOA, c'est incontestablement de savoir allier le rythme à l'anglo-saxonne du (techno-)thriller, entre espionnage et politique fiction, et une écriture bien plus riche, littéraire, donnant de la chair à ces histoires, du liant. On est captivé par ce récit, on a un pavé en main et on ne s'en rend pas compte.
On avance, on veut savoir ce qui attend ces personnages, tous proches de partir à la dérive, de lâcher prise, soit dès le départ, soit en cours d'aventure. Tous, personnages principaux comme secondaires (je pense à Voodoo ou à Chloé, principalement), sont au bord du gouffre, les nerfs à fleur de peau, écrasés par la peur, le doute, les deux à la fois...
DOA sait parfaitement créer des personnages, leur donner vie, les caractériser. Et puis les faire souffrir, aussi, et pas qu'un peu... Mais, c'est vrai que je trouve encore une fois dans ce "secundo" que ce sont les personnages qui l'emportent sur l'action. Pourtant, il s'en passe, des choses, des rebondissements, des scènes haletantes, des scènes de violence, aussi, des poursuites, presque relatées "caméra à l'épaule"...
Mais, à chaque fois, c'est bien l'humain qui prend le dessus, auquel le lecteur s'ancre. Ce sont les personnages qui prennent le pas sur l'action, parce que c'est eux qui sont le moteur de tout, de l'action et de l'émotion. Quelle force, dans les mots de DOA, sans esbroufe, sans chichi, on va à l'essentiel et on finit toujours rattrapé par l'onde de choc qu'il déclenche.
Chacun s'attachera plus particulièrement à l'un ou l'autre. Ceux qui ont lu auparavant "Citoyens clandestins" et "le serpent aux mille coupures" ont déjà peut-être une préférence et la poursuivront ici. D'autres, dont je suis, vont trouver celui ou celle pour qui on croise les doigts en espérant qu'il s'en sortira sans trop d'égratignures...
En ce qui me concerne, je dois dire que Lynx est le personnage avec qui je suis entré le plus en empathie. En est-ce vraiment, d'ailleurs ? Mais, son côté écorché vif, celui qui n'a plus rien à perdre et qui, pourtant, va réussir à se trouver une cause plus juste, plus positif pour évacuer sa haine et sa violence, m'ont touché.
J'ai l'air de minimiser l'histoire, évidemment, ce n'est pas mon propos. On est, avec ce "secundo", dans un climax, comme si une boîte de Pandore avait été ouverte et laissait échapper tous les tourments qu'elle contenait. DOA nous entraîne dans un monde qui n'a rien de rose. Il est sale, brutale, sans pitié. Sans morale, surtout. Sans honneur, sans pukhtu.
L'action se déroule en 2008. Nous possédons donc quelques années de recul, désormais, pour juger de l'évolution de la situation. En Afghanistan, où cette période fut celle d'une terrible recrudescence des combats et des violences, et ailleurs. Tout près de chez nous, même... Et j'ai bien peur, comme DOA, je crois, que rien n'ait changé depuis... Regardez ce qui se passe en Syrie, désormais...
On attend maintenant de voir où nous emmènera DOA à l'avenir, quels personnages il nous proposera de suivre et quels aléas il leur fera vivre. Le voir apparaître à "La Grande Librairie", lors d'une émission récente, est l'occasion de découvrir (un peu) cet auteur mystérieux et montre qu'il s'impose de plus en plus avec son univers très noir et singulier. Et l'écouter ouvre de nombreuses perspectives, avant ou après lecture...
Un citation tirée de "l'Orestie" que l'on trouve dans notre roman du jour. Le choix de ce titre peut sembler un peu brumeux, comme ça, mais je vous assure que, si vous lisez le livre, vous comprendrez pourquoi je me suis arrêté dessus. A la fois symboliques et réalistes, et, si vous doutez encore, allez voir qui sont les Furies. Notre roman du jour marque la fin d'un cycle, entamé il y a près de dix ans, je parle du cycle d'écriture. Avec "Pukhtu secundo" (récemment parue à la Série Noire), DOA achève la trilogie, devenue tétralogie, avec le découpage de "Pukhtu" en deux volets, entamée avec "Citoyens clandestins". Si l'Afghanistan était le coeur de "Primo", "Secundo", lui, se déroule en majeure partie en Europe, nous emmène en Afrique, avant de revenir en Afghanistan pour un final à couper le souffle. C'est toujours aussi violent, lyrique et puissant, mais, dans ce monde sinistre, cynique et dangereux qu'il nous décrit, DOA parvient à laisser filtrer quelques lueurs d'espoir, vite mises sous le boisseau par un certain pessimisme...
D'abord, un petit rappel, pour qui n'a pas forcément lu "Pukhtu primo". Pukhtu, c'est un mot pachtoune qu'on ne peut traduire littéralement en français. C'est une notion très forte dans la culture afghane, l'honneur, mais un honneur qui regroupe la notion sur le plan individuel et collectif, via le clan, la famille.
Dans ces deux romans, même s'il est moins présent dans ce deuxième volet, c'est Sher Ali Khan Zadran qui incarne cette valeur traditionnelle, dans un pays où elle est de plus en plus bafouée, des forces occidentales installés sur son sol aux combattants du djihad, prêts à tout pour imposer leur vision.
Sher Khan n'aspire qu'à une chose : la vengeance, seul moyen de restaurer son pukhtu. La mort de sa famille dans un raid américain l'a poussé à s'engager aux côtés des Talibans, mais il a rapidement compris qu'il avait choisi la peste contre le choléra. Dans ce roman, sa soif de vengeance va se heurter à l'horreur qu'il côtoie et cautionne ; à lui de trouver une autre voie pour restaurer son honneur.
Je referme ce rappel pour revenir aux trames principales de ce second volet. A commencer par Fox. Mercenaire, agent secret, personnage au passé complexe au point de ne plus savoir vraiment qui il est, il travaille en Afghanistan au sein d'une entreprise paramilitaire américaine, 6N, dont les salariés ont des méthodes pour le moins troubles...
Ces chiens de guerre, nourris de violence, ne faisant aucun quartier et venus là surtout pour se battre, encore et encore, ont mis sur pied un trafic d'héroïne lucratif, s'éloignant encore un peu plus de l'honneur militaire qu'ils devraient incarner. Fox a pour mission de se rapprocher de ces hommes, dont le meneur, Voodoo, ne l'aime pas, mais pas du tout.
La troupe de Voodoo est sous tension, l'un des leurs, Ghost, a été capturé et l'on assiste, dans les premières pages du livre, aux tortures qui lui sont infligées. Là encore, colère et soif de vengeance vont s'en mêler et ces mercenaires, usés, incapables de s'imaginer dans un autre contexte mais laminés par le danger, la peur, sentent qu'ils sont à la croisée des chemins...
Fox, lui, ressent aussi cette montée des tensions et redoutent le pire, certain que ces hommes sont prêts à faire payer au pays et à sa population la colère brute, atroce, qu'ils ressentent. Le voilà coincé, contraint de poursuivre sa mission, les démasquer, au risque de devoir prendre part à leur sinistre expédition punitive...
Mais Fox n'est pas plus frais que ses compagnons. Lui aussi commence à en avoir assez de ces guerres interminables, de ces conflits qui bouffent sa part d'humanité, de son incapacité à savoir qui il est réellement... Lui aussi ressent subitement le besoin de restaurer un honneur largement terni par ses années passées comme "citoyen clandestin"...
Amel Balhimer est journaliste. A Paris, elle travaille discrètement à l'enquête qui lui permettra de faire tomber Alain Montana, figure trouble et néfaste, comme notre chère République sait en produire parfois. Ancien ponte des services secrets, Montana a quitté l'administration pour fonder une officine, PEMEO, dont l'influence reste forte dans les sphères du pouvoir.
Mais, derrière cette façade, Alain Montant a mis un place un réseau bien moins reluisant, en s'alliant, entre autres, à des mafieux kosovars. Amel a compris que PEMEO n'était qu'un paravent pour des activités illégales et particulièrement sordides. Elle veut monter un dossier solide contre Montana et sa boîte, mais cela demande du temps.
Dans ce but, elle a séduit Chloé, la maîtresse de Montana, et se sert de la jeune femme, accro aux stupéfiants, pour obtenir quelques informations. Mais, elle sait que ce n'est pas à Paris qu'elle trouvera les éléments à charge indiscutables qui lui permettront d'avoir la tête de Montana, un des hommes les plus puissants du pays.
Reste à organiser cette dernière partie de l'enquête, en Afghanistan, avec le soutien de Peter Dang, un ami journaliste qui connaît très bien ce pays. Amel est prête à tout pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Peu importe que sa croisade journalistique la prive de toute autre vie, menace ses relations familiales. Elle veut faire tomber Montana et est prête à braver tous les dangers pour cela...
Dernier personnage central de ce "Pukhtu secundo", nous l'appellerons Lynx, puisque c'est son alias le plus fameux. Vous l'aurez compris, il est de la même "famille" que Fox ou Voodoo. Lui aussi a été citoyen clandestin et donc barbouze. Mais lui a su se retirer lorsqu'il a senti qu'il arrivait et se reconstruire, ailleurs.
Enfin, se reconstruire... C'est tout l'enjeu de ce cycle : montrer qu'on ne se remet jamais de cette expérience, qu'on ne cesse jamais d'être un citoyen clandestin, qu'on ne sera plus jamais celui qu'on était à la naissance. Et Lynx, malgré les apparences, en est là, lui aussi. Il essaye de fuir ce passé, de profiter du présent et d'envisager un avenir. Mais...
Ce passé tordu va le rattraper de la pire des façons. Je n'entre pas dans les détails, cela fait partie de l'intrigue, à vous de le découvrir. Mais, Lynx n'a plus le choix : redevenir celui qu'il fut, le chien de guerre intraitable, pour assouvir sa vengeance. A lui aussi, de trouver une façon de canaliser sa colère pour qu'elle soit finalement utile à quelque chose, pas uniquement destructrice...
Amel, Lynx et Fox vont rapidement devenir les personnages moteurs de ce roman très sombre, terriblement violent, parce qu'ils sont aussi ceux que DOA met en scène depuis près de dix ans. Pourrais-je affirmer dans ce billet que "Pukhtu secundo" est le point final à leur destin ? Non, même si je le pense. Mais la fin reste finalement assez ouverte, alors, pourquoi ne pas les retrouver ?
Tout ce petit monde est mû par des émotions bien humaines, preuve qu'ils n'ont pas complètement franchi la limite vers le néant. Il y a la haine, la vengeance et la volonté de ne laisser aucun répit à ceux qu'on vise (êtes-vous allés voir qui étaient les Furies ?). Pourtant, chez nos trois protagonistes principaux, ces forces terribles qui vont se déchaîner, vont trouver d'autres objectifs.
Des objectifs plus justes, à condition de se détourner du but initial. L'expression "quête initiatique" serait peut-être un peu trop forte. Ou alors, sa dernière ligne droite, car la leur a été entamée depuis un moment. Mais, cette fois, il y a le sentiment certains de faire quelque chose d'utile, de fort, de juste, j'y reviens. Quelque chose qui vaille vraiment le coup de tout sacrifier...
Et, malgré le déchaînement de violence constant, malgré la folie qui guette et qui est proche d'engloutir tout ce beau monde, c'est bel et bien le côté humain qui va percer, s'imposer, si ce n'est l'emporter. Oui, c'est ce qui fait la force de ce récit, cette révélation chez Lynx et Fox en particulier de cette facette enfouie depuis plus ou moins longtemps au plus profond d'eux, comme oubliée, refoulée...
La grande force de DOA, c'est incontestablement de savoir allier le rythme à l'anglo-saxonne du (techno-)thriller, entre espionnage et politique fiction, et une écriture bien plus riche, littéraire, donnant de la chair à ces histoires, du liant. On est captivé par ce récit, on a un pavé en main et on ne s'en rend pas compte.
On avance, on veut savoir ce qui attend ces personnages, tous proches de partir à la dérive, de lâcher prise, soit dès le départ, soit en cours d'aventure. Tous, personnages principaux comme secondaires (je pense à Voodoo ou à Chloé, principalement), sont au bord du gouffre, les nerfs à fleur de peau, écrasés par la peur, le doute, les deux à la fois...
DOA sait parfaitement créer des personnages, leur donner vie, les caractériser. Et puis les faire souffrir, aussi, et pas qu'un peu... Mais, c'est vrai que je trouve encore une fois dans ce "secundo" que ce sont les personnages qui l'emportent sur l'action. Pourtant, il s'en passe, des choses, des rebondissements, des scènes haletantes, des scènes de violence, aussi, des poursuites, presque relatées "caméra à l'épaule"...
Mais, à chaque fois, c'est bien l'humain qui prend le dessus, auquel le lecteur s'ancre. Ce sont les personnages qui prennent le pas sur l'action, parce que c'est eux qui sont le moteur de tout, de l'action et de l'émotion. Quelle force, dans les mots de DOA, sans esbroufe, sans chichi, on va à l'essentiel et on finit toujours rattrapé par l'onde de choc qu'il déclenche.
Chacun s'attachera plus particulièrement à l'un ou l'autre. Ceux qui ont lu auparavant "Citoyens clandestins" et "le serpent aux mille coupures" ont déjà peut-être une préférence et la poursuivront ici. D'autres, dont je suis, vont trouver celui ou celle pour qui on croise les doigts en espérant qu'il s'en sortira sans trop d'égratignures...
En ce qui me concerne, je dois dire que Lynx est le personnage avec qui je suis entré le plus en empathie. En est-ce vraiment, d'ailleurs ? Mais, son côté écorché vif, celui qui n'a plus rien à perdre et qui, pourtant, va réussir à se trouver une cause plus juste, plus positif pour évacuer sa haine et sa violence, m'ont touché.
J'ai l'air de minimiser l'histoire, évidemment, ce n'est pas mon propos. On est, avec ce "secundo", dans un climax, comme si une boîte de Pandore avait été ouverte et laissait échapper tous les tourments qu'elle contenait. DOA nous entraîne dans un monde qui n'a rien de rose. Il est sale, brutale, sans pitié. Sans morale, surtout. Sans honneur, sans pukhtu.
L'action se déroule en 2008. Nous possédons donc quelques années de recul, désormais, pour juger de l'évolution de la situation. En Afghanistan, où cette période fut celle d'une terrible recrudescence des combats et des violences, et ailleurs. Tout près de chez nous, même... Et j'ai bien peur, comme DOA, je crois, que rien n'ait changé depuis... Regardez ce qui se passe en Syrie, désormais...
On attend maintenant de voir où nous emmènera DOA à l'avenir, quels personnages il nous proposera de suivre et quels aléas il leur fera vivre. Le voir apparaître à "La Grande Librairie", lors d'une émission récente, est l'occasion de découvrir (un peu) cet auteur mystérieux et montre qu'il s'impose de plus en plus avec son univers très noir et singulier. Et l'écouter ouvre de nombreuses perspectives, avant ou après lecture...
jeudi 17 novembre 2016
"Il portait cette armature rigide, l'apparence. Il était monstre en dessous ; il vivait dans une peau d'homme de bien avec un coeur de bandit..." (Victor Hugo).
Ah, le monstre... Il revient, à intervalles réguliers, hanter les lignes de ce blog, sous diverses formes, sous diverses plumes, dans différents contextes... En voilà un nouvel exemple, avec un roman qui est sorti il y a un petit moment, a connu un joli succès, en particulier pour un premier roman, et vient de ressortir en édition de poche. Je l'avais, non pas dans une pile, mais au chaud dans une liseuse depuis un petit moment et je me suis lancé il y a quelques jours, curieux de découvrir ce livre dont j'avais beaucoup entendu parler. "Block 46", de Johana Gustawsson (paru chez Bragelonne et disponible en poche chez Milady), est un premier thriller très efficace, avec des côtés très originaux, d'autres plus classiques, tout comme les ficelles utilisées. Mais, on est happé d'emblée et on ne décroche plus jusqu'aux dernières pages, et c'est finalement ce qu'on attend de ce genre de livre. Un essai prometteur, à ne pas mettre entre toutes les mains, mais qui ne demande qu'à être transformé.
Alexis Castells est écrivaine et son domaine de prédilection, ce sont les tueurs en série. A l'instar d'un Stéphane Bourgoin, elle leur consacre des ouvrages très documentés et n'hésite pas, pour cela, à aller les rencontrer, les interviewer dans leurs prisons. Une vocation qui, on le comprend à l'inquiétude de ses parents, ne doit rien au hasard.
Alexis vit à Londres et, malgré l'intensité de son travail, elle conserve tout de même du temps pour ses amis. L'une d'entre elles, Linnéa Blix, doit présenter dans la capitale britannique la collection de bijoux qu'elle a dessinés pour Cartier. Un petit nombre de personnes est invité à cette soirée, dont Alexis, qui sort sa plus belle robe pour l'occasion.
Mais, lors de cette soirée, ne manque qu'une personne : la star attendue de la soirée, Linnéa Blix. On se dit d'abord qu'elle a du retard, puis qu'elle a sans doute eu un problème... La créatrice partait souvent se ressourcer en Suède, dans un coin à l'écart du monde. Un incident quelconque a dû se produire en chemin, rien de grave.
Jusqu'à ce que son compagnon débarque affolé à la soirée... Peter Templeton non plus n'a pas de nouvelle de celle qui partage sa vie et là, c'est franchement plus inquiétant. Qu'elle ne donne pas de nouvelle depuis la Suède, c'est habituel, mais qu'elle rate la soirée la plus importante de sa vie, c'est juste impensable, sauf gros souci.
Tout indique qu'elle n'a jamais quitté la Suède... C'est donc dans ce pays que se rend au plus vite Alexis, afin d'essayer de retrouver son amie. Mais, sur place, c'est la plus effroyable des nouvelles qui les attend : alors que ses amis se faisaient un sang d'encre, le corps de Linnéa était découvert par hasard, à Falkenberg, près de la maison où elle aimait tant se ressourcer...
Une mort qui n'a rien de naturelle. Un crime qui n'a rien d'anodin. Linnéa Brix a été massacrée, il n'y a pas d'autre mot. Et les traces laissées sur son corps par le tueur posent question. Comme ce Y gravé sur son bras... Alexis, déjà sous le choc de la nouvelle de la mort de son amie, est un peu plus touchée par ces informations.
Elle voit alors débarquer en Suède une de ses connaissances. La présence d'Emily Roy dans cette région est tout à fait inattendue. Une profileuse, l'une des plus renommées, qui se pointe dans un village côtier en Suède, ça ne se voit pas tous les jours. Et, si elle est là, c'est pour de bonnes raisons, qui aiguisent la curiosité de l'écrivaine...
Alexis y voit la confirmation que Linnéa n'a pas été tuée par un simple rôdeur. Elle a été victime d'un tueur en série. Mais, il y a un hic, et de taille : Linnéa ne ressemble pas du tout aux victimes précédentes, recensées en Angleterre. Jusqu'alors, ce sont des enfants qui ont été tuées selon ce mode opératoire. Pourquoi avoir changé d'aire géographique et de profil de victime ?
Emily, qui traque le tueur depuis de nombreux mois, et Alexis, qui veut comprendre ceux qui est arrivé à son amie, mènent l'enquête. Elles l'ignorent encore, mais leurs investigations vont les mener dans les zones les plus sombres de l'âme humaine. Et les transporter près de 70 ans en arrière, dans un lieu aux allures d'enfer : le camp de Buchenwald.
C'est évidemment le lien entre ces deux périodes qui est au coeur de l'intrigue. Sans en dire plus, Johana Gustawsson choisit de mettre en parallèle ces deux trames narratives, l'enquête d'Emily et d'Alexis, à notre époque, et une autre histoire se déroulant dans le camp d'extermination nazi. Si je l'évoque, c'est parce que ce second récit apparaît très tôt dans le roman.
Mais, si j'en parle, ce n'est que pour l'effleurer, car cette partie, il vous faudra la découvrir, au fur et à mesure, faire connaissance avec les personnages et l'atroce engrenage dans lequel ils sont embarqués. Et puis, pour le reste, laissez-vous porter par cette histoire haletante, addictive, qu'on ne lâche plus une fois lancé...
La force de "Block 46", c'est de mettre deux formes d'horreur en parallèle : celle attachée aux camps d'extermination nazis et l'autre, ce croquemitaine moderne qu'est le tueur en série. Deux thèmes qui, indépendamment, font déjà frémir quand on les évoque, alors, lorsqu'on les rassemble, à condition de bien mener sa barque, on tient un fort sujet de thriller.
Johana Gustawsson tient bien ses rames. L'affaire est rondement et parfaitement menée, avec son lot de rebondissements, de découvertes, de fausses pistes, jusqu'aux révélations finales. La tension monte régulièrement, les questions que l'on se pose, les hypothèses que l'on ébauche, tout cela fait de "Block 46" un vrai page-turner.
Il y a, au coeur de ce roman, de troublantes et passionnantes interrogations sur la nature humaine. Sur le monstre, pour revenir à notre titre. Certains écrivains travaillent sur ce sujet, recherchent des explications, des causes... Johana Gustawsson choisit une option un peu différente et qui, je dois le dire, m'a fait passer un frisson le long de l'échine.
Là encore, n'entrons pas dans le détail. Disons qu'il est question de transmission. D'apprentissage... Je referme vite cette boîte, même s'il y aurait énormément à dire sur cette dimension-là de l'intrigue. C'est aussi un des aspects les plus étonnants de cette histoire : le véritable moteur de l'intrigue est là, ses clés, aussi, du moins, un certain nombre. Si loin des lieux des crimes, dans le temps et l'espace.
Alors que Emily, avec ses méthodes peu orthodoxes, et Alexis collectent des informations, des indices, recherchent des pistes concrètes, échafaudent des théories, le lecteur est le témoin direct des événements anciens dont il ressent l'importance. Et, petit à petit, Johana Gustawsson nous mène vers une hypothèse saisissante, effarante, douloureuse. Folle, presque...
Maintenant, distribuons aussi quelques bémols, car si "Block 46" a su me captiver et me faire passer un bon moment de lecture, ce thriller possède quelques petites faiblesses, de mon point de vue. En commençant par l'autre face de ce que je viens d'évoquer : la technique d'écriture du thriller est très bien maîtrisée, mais certaines ficelles utilisées sont beaucoup plus classiques.
On a un contexte original qui permet de ne pas se dire qu'on lit un énième thriller sur un serial-killer, mais certains ressorts de l'intrigue ne possèdent pas cette originalité. Bon, même les plats les plus savoureux ne se préparent pas avec des ingrédients qu'on utilise nulle part ailleurs. Mais, dans "Block 46", si ça ne grippe pas la mécanique, ça vient atténuer la force de l'ensemble.
Et puis, mais là, il est possible que je chipote et que d'autres fans de thrillers ne partagent pas son avis, il m'a manqué un peu plus de profondeur dans les personnages centraux, une dimension psychologique un peu plus fouillée. Je le sais, ce n'est pas forcément prisé par tout le monde, certains trouvent que cela freine le rythme des thrillers. Bon.
Pour ma part, il m'a manqué quelques développements. En particulier sur nos deux enquêtrices : Emily Roy, mystérieuse, originale, compétente, capable d'une incroyable empathie dans son métier mais pas dans ses relations personnelles ; et Alexis, que l'on suit en premier mais qui, j'ai trouvé, s'efface petit à petit...
J'aurais aimé qu'on s'arrête un peu plus longuement sur ces deux jeunes femmes, sur leur précédente rencontre, sur les zones d'ombre que recèlent leurs personnalités. On ressent, dans un premier temps, qu'elles ont de lourds et douloureux secrets, on les découvre ensuite. Mais, à mon grand regret, je trouve ces deux personnages un peu mince, manquant d'épaisseur.
"Block 46" fait 336 pages, il devait peut-être y avoir moyen de consacrer quelques pages supplémentaires pour une caractérisation un peu plus riche et des profils psychologiques tout à fait intéressant. A moins que Emily et Alexis soient appelées à revenir, dans de prochains romans, permettant d'enrichir leurs personnalités mais je ne connais pas les projets de Johana Gustawsson.
A un degré moindre, je trouve que la partie "Buchenwald" souffre du même genre de problème. Il y a un processus à l'oeuvre, il y a quelque chose de terrible et de captivant qui se déroule sous nos yeux, mais il manque là aussi quelques éléments et d'autres qui sont trop rapidement esquissés chez les protagonistes de cette seconde trame. Oui, je chipote, je chipote...
C'est curieux de se dire qu'on a pris un plaisir sincère à lire un livre mais qu'il aurait pu être plus grand encore... Au-delà de ce roman précisément, le thriller a cette tendance à se diluer dans l'efficacité, au détriment de la psychologie, désormais l'apanage du polar et plus encore du roman noir. Ne coupons pas les liens entre ces trois genres si proche, continuons à alimenter les vases communicants entre eux.
Reste que "Block 46" est un premier roman qui atteint certains de ses objectifs, et assez largement au-dessus de la moyenne. C'est dur, violent, par moments très dur et très violent, que ce soit dans les années 2010 ou dans les années 1940. On touche à des sujets que certains lecteurs n'aiment pas, parce que ça peut vite devenir insoutenable.
Johana Gustawsson n'en rajoute pas dans les effets, mais son intrigue n'épargne pas non plus le lecteur. Je suis très curieux de voir ce qu'elle nous proposera dans ses futurs romans, car je pense que cette jeune femme, dont le grand-père connut lui-même la déportation, possède une vraie marge de progression, une imagination fertile, une technique déjà affûtée et un coeur bien accroché.
Alexis Castells est écrivaine et son domaine de prédilection, ce sont les tueurs en série. A l'instar d'un Stéphane Bourgoin, elle leur consacre des ouvrages très documentés et n'hésite pas, pour cela, à aller les rencontrer, les interviewer dans leurs prisons. Une vocation qui, on le comprend à l'inquiétude de ses parents, ne doit rien au hasard.
Alexis vit à Londres et, malgré l'intensité de son travail, elle conserve tout de même du temps pour ses amis. L'une d'entre elles, Linnéa Blix, doit présenter dans la capitale britannique la collection de bijoux qu'elle a dessinés pour Cartier. Un petit nombre de personnes est invité à cette soirée, dont Alexis, qui sort sa plus belle robe pour l'occasion.
Mais, lors de cette soirée, ne manque qu'une personne : la star attendue de la soirée, Linnéa Blix. On se dit d'abord qu'elle a du retard, puis qu'elle a sans doute eu un problème... La créatrice partait souvent se ressourcer en Suède, dans un coin à l'écart du monde. Un incident quelconque a dû se produire en chemin, rien de grave.
Jusqu'à ce que son compagnon débarque affolé à la soirée... Peter Templeton non plus n'a pas de nouvelle de celle qui partage sa vie et là, c'est franchement plus inquiétant. Qu'elle ne donne pas de nouvelle depuis la Suède, c'est habituel, mais qu'elle rate la soirée la plus importante de sa vie, c'est juste impensable, sauf gros souci.
Tout indique qu'elle n'a jamais quitté la Suède... C'est donc dans ce pays que se rend au plus vite Alexis, afin d'essayer de retrouver son amie. Mais, sur place, c'est la plus effroyable des nouvelles qui les attend : alors que ses amis se faisaient un sang d'encre, le corps de Linnéa était découvert par hasard, à Falkenberg, près de la maison où elle aimait tant se ressourcer...
Une mort qui n'a rien de naturelle. Un crime qui n'a rien d'anodin. Linnéa Brix a été massacrée, il n'y a pas d'autre mot. Et les traces laissées sur son corps par le tueur posent question. Comme ce Y gravé sur son bras... Alexis, déjà sous le choc de la nouvelle de la mort de son amie, est un peu plus touchée par ces informations.
Elle voit alors débarquer en Suède une de ses connaissances. La présence d'Emily Roy dans cette région est tout à fait inattendue. Une profileuse, l'une des plus renommées, qui se pointe dans un village côtier en Suède, ça ne se voit pas tous les jours. Et, si elle est là, c'est pour de bonnes raisons, qui aiguisent la curiosité de l'écrivaine...
Alexis y voit la confirmation que Linnéa n'a pas été tuée par un simple rôdeur. Elle a été victime d'un tueur en série. Mais, il y a un hic, et de taille : Linnéa ne ressemble pas du tout aux victimes précédentes, recensées en Angleterre. Jusqu'alors, ce sont des enfants qui ont été tuées selon ce mode opératoire. Pourquoi avoir changé d'aire géographique et de profil de victime ?
Emily, qui traque le tueur depuis de nombreux mois, et Alexis, qui veut comprendre ceux qui est arrivé à son amie, mènent l'enquête. Elles l'ignorent encore, mais leurs investigations vont les mener dans les zones les plus sombres de l'âme humaine. Et les transporter près de 70 ans en arrière, dans un lieu aux allures d'enfer : le camp de Buchenwald.
C'est évidemment le lien entre ces deux périodes qui est au coeur de l'intrigue. Sans en dire plus, Johana Gustawsson choisit de mettre en parallèle ces deux trames narratives, l'enquête d'Emily et d'Alexis, à notre époque, et une autre histoire se déroulant dans le camp d'extermination nazi. Si je l'évoque, c'est parce que ce second récit apparaît très tôt dans le roman.
Mais, si j'en parle, ce n'est que pour l'effleurer, car cette partie, il vous faudra la découvrir, au fur et à mesure, faire connaissance avec les personnages et l'atroce engrenage dans lequel ils sont embarqués. Et puis, pour le reste, laissez-vous porter par cette histoire haletante, addictive, qu'on ne lâche plus une fois lancé...
La force de "Block 46", c'est de mettre deux formes d'horreur en parallèle : celle attachée aux camps d'extermination nazis et l'autre, ce croquemitaine moderne qu'est le tueur en série. Deux thèmes qui, indépendamment, font déjà frémir quand on les évoque, alors, lorsqu'on les rassemble, à condition de bien mener sa barque, on tient un fort sujet de thriller.
Johana Gustawsson tient bien ses rames. L'affaire est rondement et parfaitement menée, avec son lot de rebondissements, de découvertes, de fausses pistes, jusqu'aux révélations finales. La tension monte régulièrement, les questions que l'on se pose, les hypothèses que l'on ébauche, tout cela fait de "Block 46" un vrai page-turner.
Il y a, au coeur de ce roman, de troublantes et passionnantes interrogations sur la nature humaine. Sur le monstre, pour revenir à notre titre. Certains écrivains travaillent sur ce sujet, recherchent des explications, des causes... Johana Gustawsson choisit une option un peu différente et qui, je dois le dire, m'a fait passer un frisson le long de l'échine.
Là encore, n'entrons pas dans le détail. Disons qu'il est question de transmission. D'apprentissage... Je referme vite cette boîte, même s'il y aurait énormément à dire sur cette dimension-là de l'intrigue. C'est aussi un des aspects les plus étonnants de cette histoire : le véritable moteur de l'intrigue est là, ses clés, aussi, du moins, un certain nombre. Si loin des lieux des crimes, dans le temps et l'espace.
Alors que Emily, avec ses méthodes peu orthodoxes, et Alexis collectent des informations, des indices, recherchent des pistes concrètes, échafaudent des théories, le lecteur est le témoin direct des événements anciens dont il ressent l'importance. Et, petit à petit, Johana Gustawsson nous mène vers une hypothèse saisissante, effarante, douloureuse. Folle, presque...
Maintenant, distribuons aussi quelques bémols, car si "Block 46" a su me captiver et me faire passer un bon moment de lecture, ce thriller possède quelques petites faiblesses, de mon point de vue. En commençant par l'autre face de ce que je viens d'évoquer : la technique d'écriture du thriller est très bien maîtrisée, mais certaines ficelles utilisées sont beaucoup plus classiques.
On a un contexte original qui permet de ne pas se dire qu'on lit un énième thriller sur un serial-killer, mais certains ressorts de l'intrigue ne possèdent pas cette originalité. Bon, même les plats les plus savoureux ne se préparent pas avec des ingrédients qu'on utilise nulle part ailleurs. Mais, dans "Block 46", si ça ne grippe pas la mécanique, ça vient atténuer la force de l'ensemble.
Et puis, mais là, il est possible que je chipote et que d'autres fans de thrillers ne partagent pas son avis, il m'a manqué un peu plus de profondeur dans les personnages centraux, une dimension psychologique un peu plus fouillée. Je le sais, ce n'est pas forcément prisé par tout le monde, certains trouvent que cela freine le rythme des thrillers. Bon.
Pour ma part, il m'a manqué quelques développements. En particulier sur nos deux enquêtrices : Emily Roy, mystérieuse, originale, compétente, capable d'une incroyable empathie dans son métier mais pas dans ses relations personnelles ; et Alexis, que l'on suit en premier mais qui, j'ai trouvé, s'efface petit à petit...
J'aurais aimé qu'on s'arrête un peu plus longuement sur ces deux jeunes femmes, sur leur précédente rencontre, sur les zones d'ombre que recèlent leurs personnalités. On ressent, dans un premier temps, qu'elles ont de lourds et douloureux secrets, on les découvre ensuite. Mais, à mon grand regret, je trouve ces deux personnages un peu mince, manquant d'épaisseur.
"Block 46" fait 336 pages, il devait peut-être y avoir moyen de consacrer quelques pages supplémentaires pour une caractérisation un peu plus riche et des profils psychologiques tout à fait intéressant. A moins que Emily et Alexis soient appelées à revenir, dans de prochains romans, permettant d'enrichir leurs personnalités mais je ne connais pas les projets de Johana Gustawsson.
A un degré moindre, je trouve que la partie "Buchenwald" souffre du même genre de problème. Il y a un processus à l'oeuvre, il y a quelque chose de terrible et de captivant qui se déroule sous nos yeux, mais il manque là aussi quelques éléments et d'autres qui sont trop rapidement esquissés chez les protagonistes de cette seconde trame. Oui, je chipote, je chipote...
C'est curieux de se dire qu'on a pris un plaisir sincère à lire un livre mais qu'il aurait pu être plus grand encore... Au-delà de ce roman précisément, le thriller a cette tendance à se diluer dans l'efficacité, au détriment de la psychologie, désormais l'apanage du polar et plus encore du roman noir. Ne coupons pas les liens entre ces trois genres si proche, continuons à alimenter les vases communicants entre eux.
Reste que "Block 46" est un premier roman qui atteint certains de ses objectifs, et assez largement au-dessus de la moyenne. C'est dur, violent, par moments très dur et très violent, que ce soit dans les années 2010 ou dans les années 1940. On touche à des sujets que certains lecteurs n'aiment pas, parce que ça peut vite devenir insoutenable.
Johana Gustawsson n'en rajoute pas dans les effets, mais son intrigue n'épargne pas non plus le lecteur. Je suis très curieux de voir ce qu'elle nous proposera dans ses futurs romans, car je pense que cette jeune femme, dont le grand-père connut lui-même la déportation, possède une vraie marge de progression, une imagination fertile, une technique déjà affûtée et un coeur bien accroché.
samedi 12 novembre 2016
"Un bon Sami est un Sami qui n'existe pas".
- Le billet sur "Le Dernier Lapon".
- Le billet sur "Le Détroit du Loup".
Une précision, tout de suite, j'ai choisi ce titre lapidaire parce qu'il représente parfaitement l'enjeu de notre roman du jour. Et, d'une certaine manière, tout l'enjeu de la trilogie d'Olivier Truc qui arrive à son terme avec un troisième volet, à la fois dans la lignée des deux premiers mais aussi sensiblement différent. Oui, il va falloir se faire à l'idée de laisser Nina et Klemet, mais aussi le peuple Sami, ces Lapons, comme nous les appelons plus couramment, en méconnaissant le fait que ce mot est en fait péjoratif. "La Montagne rouge" vient de paraître aux éditions Métailié et nous offre une enquête au long cours, assez surprenante par son point de départ et qui va permettre de balayer de nombreux thèmes de société touchant particulièrement la Suède (et certainement pas qu'elle), mais aussi de poursuivre l'introspection entamée par les deux personnages centraux. Un roman dense et sombre qui vaut aussi par ses personnages secondaires épatants, touchants, déconcertants et, finalement, tout à fait surprenants...
C'est bien loin de leur territoire habituel que l'on retrouve la patrouille P9 de la Brigade des Rennes. En ce début d'automne, ils ont pris la direction de la Suède, à près de 1500 km de leur terrain de jeu habituel, dans une région où les Sami viennent faire paître leurs troupeaux de rennes à la belle saison et procède aussi aux abattages pour réguler une population qui pourrait devenir trop nombreuse.
C'est d'ailleurs lors d'une de ces opérations que débute l'histoire de "la Montagne rouge", avec une découverte problématique : les éleveurs Sami ont en effet trouvé un os qui ne ressemble en rien à celui d'un renne. Ils en sont même certains d'emblée : il s'agit d'un os qui appartient probablement à un squelette humain...
Pour Petrus, responsable du sameby local, comme on appelle ces communautés sami poursuivant l'élevage traditionnel du renne et installant leurs immenses enclos à des endroits précis, c'est un problème de plus à gérer. Un de plus, au milieu d'une multitude, car la période est très mouvementé pour son sameby et pour son peuple tout entier.
En effet, depuis longtemps, les éleveurs sami sont en conflit avec les forestiers et les agriculteurs suédois, des Scandinaves, pas des Sami. On se dispute les mêmes terres, les uns venant y faire paître leurs troupeaux quand les autres veulent faire pousser des arbres dont il pourront ensuite exploiter le bois. Derrière cette "simple" querelle, des questions aux relents bien plus désagréables...
Il s'agit de savoir qui est le plus légitime pour s'installer là, entre Sami et Scandinaves. Pour les seconds, c'est une évidence, les Sami ne sont venus là que bien après que leurs ancêtres, colonisant la région, se soient installés. Pour les premiers, ces terres, même assez éloignées de ce qu'on a coutume d'appeler la Laponie, sont des lieux ancestraux où les nomades venaient avant la présence des colons.
Les Sami, peuple aborigène cultivant une riche tradition orale mais ne possédant pas d'écrit attestant de son histoire, voient leur territoire se réduire comme peau de chagrin depuis longtemps. En Finlande, en Norvège ou en Suède, ils ne se sentent pas les bienvenus et ces bisbilles avec les forestiers de la Montagne rouge ne font qu'accentuer cette impression.
L'affaire a même été portée devant la justice. Deux fois, déjà, les Sami ont été débouté. Mais Petrus et les siens ne veulent pas renoncer et l'os est découvert alors que doit débuter un troisième procès devant la plus haute juridiction : la Cour Suprême de Stockholm. L'espoir est mince de gagner. Au contraire, un troisième échec pourrait sonner le glas de la présence Sami en Suède...
Et si cet os pouvait tout changer ? En effet, les premières recherches ont montré qu'il était très ancien. Plusieurs siècles. Pourrait-il s'agir de l'os d'un nomade sami enterré là de très longue date et attestant de la présence de ce peuple avant celle des Scandinaves ? Pour le prouver, il va falloir du temps aux archéologues, mais aussi d'autres indices.
Or, si le squelette auquel appartient le premier os a pu être mis à jour, il manque la tête... Et pour les scientifiques, ce crâne est fondamentale pour pouvoir se prononcer sur l'origine du corps... Alors, on fouille, on cherche, pendant que Petrus essaye, avec l'énergie du désespoir, de défendre les intérêts de son sameby, seul contre les juges et les forestiers...
La patrouille de la Brigade des Rennes, elle, doit essayer de faire baisser les tensions entre les deux camps. Celles-ci ne cessent d'enfler, les provocations et les sabotages se multiplient, entraînant des représailles de l'autre bord. Jusqu'à ce qu'on s'en prenne au site archéologique en cours de fouille... Apparemment, certains auraient intérêt à empêcher les archéologues de mener leurs recherches.
C'est donc autour d'un mort, certes, mais d'un mort très ancien dont rien n'indique qu'il a pu être assassiné, que s'organise cette troisième enquête de la Brigade des Rennes. Pas banal... Mais, la violence contemporaine, elle, est bien présente. Je l'ai dit, on se rend coup pour coup entre Sami et Scandinaves et la situation ne cesse de s'envenimer, au point de craindre le pire...
Klemet et Nina doivent donc jouer les casques bleus, si je puis dire. Empêcher le conflit de dégénérer en bataille rangée. Mais ils doivent aussi aider les archéologues dans leurs recherches, compliquées par les actes de vandalisme perpétrés sur le site. Leur quête semble dérisoire, folle, impossible : retrouver le crâne disparu, sans doute volé il y a bien longtemps...
On a donc une intrigue assez particulière qui va permettre de mettre en lumière le terrible rejet dont les Sami font l'objet dans la société suédoise. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, va-t-on comprendre, au fil des rebondissements. Ainsi, à travers cette quête archéologique, Olivier Truc va-t-il faire apparaître les côtés les plus sombres de la société suédoise.
Ce troisième tome de la trilogie Sami m'a fait penser à certains romans de Hennig Mankell : souvent, la société suédoise est érigée en exemple, comme ses voisines scandinaves, d'ailleurs. Pourtant, en y regardant de plus près, on se rend compte que cette paisible monarchie constitutionnelle a parfois sérieusement dépassé les lignes jaunes...
On va ainsi croiser dans le livre l'ombre d'Anders Retzius, scientifique suédois du XIXe siècle, inventeur de l'indice céphalique à la même époque où, en France, Arthur de Gobineau commence à exposer ses théories racialistes... La forme des crânes, leurs dimensions, leurs signes particuliers... Tout cela servira de bases aux pires théories racistes jusqu'au nazisme...
Olivier Truc nous rappelle des faits qui ne sont pas forcément si évident que cela : les Scandinaves sont des colons, ils ont conquis des terres sur lesquelles ils ne sont pas nés et ils se sont comportés avec les populations autochtones comme la plupart des civilisations impérialistes. Les Sami ont subi cette colonisation de plein fouet, mis au ban, considérés comme des êtres inférieurs...
Je mets en exergue cet aspect-là, très important dans le roman, sans trop le contextualiser pour ne pas trop en dévoiler. D'autres affaires bien peu reluisantes sont également évoquées dans "la Montagne rouge" et elles font froid dans le dos, plus encore quand on se dit que cela s'est déroulé dans une démocratie exemplaire et non dans la pire des dictatures...
N'entrons pas dans ces détails qui vous marqueront forcément, et intéressons-nous plutôt à ces personnages secondaires dont j'ai parlé dans mon introduction. J'en ai déjà cité un, Petrus, le chef du sameby de la Montagne rouge. Courageux, déterminé, mais aussi usé, fatigué, s'enfonçant dans le désespoir, mais fier et sage représentant de sa communauté.
Il a pour lui sa sincérité et son intégrité, c'est un personnage dont l'humanité et la détresse m'ont vraiment touché. Sur ses épaules, repose un poids immense, les attentes de tout un peuple, alourdi par la quasi certitude qu'il a de son échec annoncé. Face aux forestiers et à une justice suédoise qui penche naturellement vers les colons, sans autre argument que sa bonne foi, il vacille...
Et puis, il nous faut parler de cet incroyable couple : Justina et Bertil. Enfin, couple, je ne l'entends pas au sens conjugal, car personne ne sait vraiment quel lien les unit exactement. Justina a 87 ans, Bertil 92. Elle est la reine du bilbingo, organisatrice et maîtresse de cérémonie de soirée jeu rassemblant un monde fou. Il tient un magasin d'antiquité dont il connaît chaque objet.
On les voit apparaître, s'imposer peu à peu dans l'histoire. Justina est un personnage formidable : la vieille dame qui inspire la sympathie, toujours souriante, débordante d'énergie malgré son âge, chef d'une bande de copines du troisième âge que tout le monde connaît dans la région et qui ne se déplacent jamais sans leurs bâtons de marche nordique (et sans caoutchouc au bout des pointes !).
Et elle a bien du mérite de garder le sourire, tant Bertil, dont elle prend soin, la traite mal. Il la rabroue sans cesse, la critique, la rabaisse... Mais ça glisse sur elle comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ces deux-là m'ont fait penser aux personnages de San Antonio dans "la Vieille qui marchait dans la mer", mais en inversant les rôles de Lady M. et de Pompilius.
Ici, l'affreux jojo, c'est Bertil, l'homme qui marche dans la mer, avec le déambulateur qui ne le quitte jamais, tandis que Justina endure toutes ses brimades sans jamais rien laisser paraître. Précisons aussi que le vocabulaire d'Olivier Truc est moins fleuri que celui de Frédéric Dard, mais les mots adressés par l'antiquaire à la vieille femme n'en sont pas plus agréables...
On ne sait pas vraiment comment Bertil, Justina et sa bande de copines fans de bilbingo et de balades en groupe viennent s'inscrire dans la trame du roman. D'une certaine manière, ces personnages secondaires prennent même le dessus sur Klemet et Nina, placés en retrait, courant après des chimères et surtout, tourneboulés par leurs questions existentielles.
Nina peine toujours à trouver sa place au pays Sami. La jeune Norvégienne se retrouve embarrassée lorsqu'elle doit arbitrer ce conflit entre Sami et Scandinaves. Mais, c'est surtout la relation avec son père qui l'angoisse et lui pèse... Elle mène activement l'enquête, comme un dérivatif à ses soucis, mais l'on sent que le coeur n'y est pas...
Idem pour Klemet. Depuis que nous avons fait sa connaissance, depuis "le Dernier Lapon" (ce premier et ce troisième volet de la trilogie sont étroitement liés), il se pose des questions sur ses origines. Après avoir rejeté ses racines sami, il ne cesse d'y revenir et de s'interroger à leur sujet. Une quête tout en introversion, en secrets, en décisions complexes...
Une nouvelle fois confronté à cette situation, devant s'interposer entre Scandinaves et Sami, il cogite, et sévèrement. La part sami qui dort en lui n'en finit plus de se réveiller et de le tirer par les pieds comme un fantôme dans un château écossais, si vous me permettez la métaphore. Plus sérieusement, Klemet est tiraillé, sur les nerfs, en colère, sans doute contre lui-même avant tout.
Il y a, chez ce personnage, cette profonde douleur muette liée aux déchirements qu'il s'est imposé. Dans chacun des trois livres de cette trilogie, les événements versent du sel sur une plaie jamais refermé et la brûlure empire. Dans "la Montagne rouge", c'est un Klemet au bord de l'implosion que l'on retrouve et tout ce qu'il apprend, découvre, le met au supplice...
Je me rends compte que j'ai laissé filer les doigts sur le clavier et que je suis déjà bien long... Comme si je n'avais pas envie de quitter Klemet et Nina, la Laponie, les Sami... Il faut s'y résoudre, mais pas sans quelques mots de synthèse sur "la Montagne rouge", dont le thème principal reste la question des origines et l'acceptation de l'autre.
Avec beaucoup de finesse, en introduisant un fil narratif secondaire lié à l'oncle de Klemet et à sa compagne chinoise, Olivier Truc met en perspective cette question des flux migratoires, tellement sensible de nos jours... Quand les envahisseurs d'hier, si sûrs du bien-fondé de leur action, se sentent désormais envahis et se raidissent à cette idée...
Oh, bien sûr, les choses sont plus complexes que la manière dont je viens de les exposer. Mais, il y a quelque chose de violent, de dérangeant aussi, dans la réaction des sociétés actuelles face à l'immigration lorsqu'on la met en parallèle avec les dégâts des entreprises coloniales... Un parallèle qui, dans "la Montagne rouge", fait apparaître des similitudes troublantes...
"Science sans conscience n'est que ruine de l'âme", écrivait Rabelais dans "Pantagruel". De Retzius aux méthodes employées désormais pour juger si tel candidat à l'immigration entre dans les critères requis par les lois, il n'y a qu'un pas. Et l'on comprend facilement ce qui peut révolter Klemet, lorsqu'il est témoin de ces procédures...
Au-delà du coté atypique de ce polar, qui ne repose pas sur une enquête classique visant à démasquer le coupable d'un crime de sang, Olivier Truc nous offre une histoire sombre et qui bouscule aussi le lecteur dans ses certitudes à plusieurs reprises. Que des questions restent en tête une fois la dernière page tournée ! Que de questions qui ne se cantonnent pas à la Suède, à la Scandinavie et aux Sami !
- Le billet sur "Le Détroit du Loup".
Une précision, tout de suite, j'ai choisi ce titre lapidaire parce qu'il représente parfaitement l'enjeu de notre roman du jour. Et, d'une certaine manière, tout l'enjeu de la trilogie d'Olivier Truc qui arrive à son terme avec un troisième volet, à la fois dans la lignée des deux premiers mais aussi sensiblement différent. Oui, il va falloir se faire à l'idée de laisser Nina et Klemet, mais aussi le peuple Sami, ces Lapons, comme nous les appelons plus couramment, en méconnaissant le fait que ce mot est en fait péjoratif. "La Montagne rouge" vient de paraître aux éditions Métailié et nous offre une enquête au long cours, assez surprenante par son point de départ et qui va permettre de balayer de nombreux thèmes de société touchant particulièrement la Suède (et certainement pas qu'elle), mais aussi de poursuivre l'introspection entamée par les deux personnages centraux. Un roman dense et sombre qui vaut aussi par ses personnages secondaires épatants, touchants, déconcertants et, finalement, tout à fait surprenants...
C'est bien loin de leur territoire habituel que l'on retrouve la patrouille P9 de la Brigade des Rennes. En ce début d'automne, ils ont pris la direction de la Suède, à près de 1500 km de leur terrain de jeu habituel, dans une région où les Sami viennent faire paître leurs troupeaux de rennes à la belle saison et procède aussi aux abattages pour réguler une population qui pourrait devenir trop nombreuse.
C'est d'ailleurs lors d'une de ces opérations que débute l'histoire de "la Montagne rouge", avec une découverte problématique : les éleveurs Sami ont en effet trouvé un os qui ne ressemble en rien à celui d'un renne. Ils en sont même certains d'emblée : il s'agit d'un os qui appartient probablement à un squelette humain...
Pour Petrus, responsable du sameby local, comme on appelle ces communautés sami poursuivant l'élevage traditionnel du renne et installant leurs immenses enclos à des endroits précis, c'est un problème de plus à gérer. Un de plus, au milieu d'une multitude, car la période est très mouvementé pour son sameby et pour son peuple tout entier.
En effet, depuis longtemps, les éleveurs sami sont en conflit avec les forestiers et les agriculteurs suédois, des Scandinaves, pas des Sami. On se dispute les mêmes terres, les uns venant y faire paître leurs troupeaux quand les autres veulent faire pousser des arbres dont il pourront ensuite exploiter le bois. Derrière cette "simple" querelle, des questions aux relents bien plus désagréables...
Il s'agit de savoir qui est le plus légitime pour s'installer là, entre Sami et Scandinaves. Pour les seconds, c'est une évidence, les Sami ne sont venus là que bien après que leurs ancêtres, colonisant la région, se soient installés. Pour les premiers, ces terres, même assez éloignées de ce qu'on a coutume d'appeler la Laponie, sont des lieux ancestraux où les nomades venaient avant la présence des colons.
Les Sami, peuple aborigène cultivant une riche tradition orale mais ne possédant pas d'écrit attestant de son histoire, voient leur territoire se réduire comme peau de chagrin depuis longtemps. En Finlande, en Norvège ou en Suède, ils ne se sentent pas les bienvenus et ces bisbilles avec les forestiers de la Montagne rouge ne font qu'accentuer cette impression.
L'affaire a même été portée devant la justice. Deux fois, déjà, les Sami ont été débouté. Mais Petrus et les siens ne veulent pas renoncer et l'os est découvert alors que doit débuter un troisième procès devant la plus haute juridiction : la Cour Suprême de Stockholm. L'espoir est mince de gagner. Au contraire, un troisième échec pourrait sonner le glas de la présence Sami en Suède...
Et si cet os pouvait tout changer ? En effet, les premières recherches ont montré qu'il était très ancien. Plusieurs siècles. Pourrait-il s'agir de l'os d'un nomade sami enterré là de très longue date et attestant de la présence de ce peuple avant celle des Scandinaves ? Pour le prouver, il va falloir du temps aux archéologues, mais aussi d'autres indices.
Or, si le squelette auquel appartient le premier os a pu être mis à jour, il manque la tête... Et pour les scientifiques, ce crâne est fondamentale pour pouvoir se prononcer sur l'origine du corps... Alors, on fouille, on cherche, pendant que Petrus essaye, avec l'énergie du désespoir, de défendre les intérêts de son sameby, seul contre les juges et les forestiers...
La patrouille de la Brigade des Rennes, elle, doit essayer de faire baisser les tensions entre les deux camps. Celles-ci ne cessent d'enfler, les provocations et les sabotages se multiplient, entraînant des représailles de l'autre bord. Jusqu'à ce qu'on s'en prenne au site archéologique en cours de fouille... Apparemment, certains auraient intérêt à empêcher les archéologues de mener leurs recherches.
C'est donc autour d'un mort, certes, mais d'un mort très ancien dont rien n'indique qu'il a pu être assassiné, que s'organise cette troisième enquête de la Brigade des Rennes. Pas banal... Mais, la violence contemporaine, elle, est bien présente. Je l'ai dit, on se rend coup pour coup entre Sami et Scandinaves et la situation ne cesse de s'envenimer, au point de craindre le pire...
Klemet et Nina doivent donc jouer les casques bleus, si je puis dire. Empêcher le conflit de dégénérer en bataille rangée. Mais ils doivent aussi aider les archéologues dans leurs recherches, compliquées par les actes de vandalisme perpétrés sur le site. Leur quête semble dérisoire, folle, impossible : retrouver le crâne disparu, sans doute volé il y a bien longtemps...
On a donc une intrigue assez particulière qui va permettre de mettre en lumière le terrible rejet dont les Sami font l'objet dans la société suédoise. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, va-t-on comprendre, au fil des rebondissements. Ainsi, à travers cette quête archéologique, Olivier Truc va-t-il faire apparaître les côtés les plus sombres de la société suédoise.
Ce troisième tome de la trilogie Sami m'a fait penser à certains romans de Hennig Mankell : souvent, la société suédoise est érigée en exemple, comme ses voisines scandinaves, d'ailleurs. Pourtant, en y regardant de plus près, on se rend compte que cette paisible monarchie constitutionnelle a parfois sérieusement dépassé les lignes jaunes...
On va ainsi croiser dans le livre l'ombre d'Anders Retzius, scientifique suédois du XIXe siècle, inventeur de l'indice céphalique à la même époque où, en France, Arthur de Gobineau commence à exposer ses théories racialistes... La forme des crânes, leurs dimensions, leurs signes particuliers... Tout cela servira de bases aux pires théories racistes jusqu'au nazisme...
Olivier Truc nous rappelle des faits qui ne sont pas forcément si évident que cela : les Scandinaves sont des colons, ils ont conquis des terres sur lesquelles ils ne sont pas nés et ils se sont comportés avec les populations autochtones comme la plupart des civilisations impérialistes. Les Sami ont subi cette colonisation de plein fouet, mis au ban, considérés comme des êtres inférieurs...
Je mets en exergue cet aspect-là, très important dans le roman, sans trop le contextualiser pour ne pas trop en dévoiler. D'autres affaires bien peu reluisantes sont également évoquées dans "la Montagne rouge" et elles font froid dans le dos, plus encore quand on se dit que cela s'est déroulé dans une démocratie exemplaire et non dans la pire des dictatures...
N'entrons pas dans ces détails qui vous marqueront forcément, et intéressons-nous plutôt à ces personnages secondaires dont j'ai parlé dans mon introduction. J'en ai déjà cité un, Petrus, le chef du sameby de la Montagne rouge. Courageux, déterminé, mais aussi usé, fatigué, s'enfonçant dans le désespoir, mais fier et sage représentant de sa communauté.
Il a pour lui sa sincérité et son intégrité, c'est un personnage dont l'humanité et la détresse m'ont vraiment touché. Sur ses épaules, repose un poids immense, les attentes de tout un peuple, alourdi par la quasi certitude qu'il a de son échec annoncé. Face aux forestiers et à une justice suédoise qui penche naturellement vers les colons, sans autre argument que sa bonne foi, il vacille...
Et puis, il nous faut parler de cet incroyable couple : Justina et Bertil. Enfin, couple, je ne l'entends pas au sens conjugal, car personne ne sait vraiment quel lien les unit exactement. Justina a 87 ans, Bertil 92. Elle est la reine du bilbingo, organisatrice et maîtresse de cérémonie de soirée jeu rassemblant un monde fou. Il tient un magasin d'antiquité dont il connaît chaque objet.
On les voit apparaître, s'imposer peu à peu dans l'histoire. Justina est un personnage formidable : la vieille dame qui inspire la sympathie, toujours souriante, débordante d'énergie malgré son âge, chef d'une bande de copines du troisième âge que tout le monde connaît dans la région et qui ne se déplacent jamais sans leurs bâtons de marche nordique (et sans caoutchouc au bout des pointes !).
Et elle a bien du mérite de garder le sourire, tant Bertil, dont elle prend soin, la traite mal. Il la rabroue sans cesse, la critique, la rabaisse... Mais ça glisse sur elle comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ces deux-là m'ont fait penser aux personnages de San Antonio dans "la Vieille qui marchait dans la mer", mais en inversant les rôles de Lady M. et de Pompilius.
Ici, l'affreux jojo, c'est Bertil, l'homme qui marche dans la mer, avec le déambulateur qui ne le quitte jamais, tandis que Justina endure toutes ses brimades sans jamais rien laisser paraître. Précisons aussi que le vocabulaire d'Olivier Truc est moins fleuri que celui de Frédéric Dard, mais les mots adressés par l'antiquaire à la vieille femme n'en sont pas plus agréables...
On ne sait pas vraiment comment Bertil, Justina et sa bande de copines fans de bilbingo et de balades en groupe viennent s'inscrire dans la trame du roman. D'une certaine manière, ces personnages secondaires prennent même le dessus sur Klemet et Nina, placés en retrait, courant après des chimères et surtout, tourneboulés par leurs questions existentielles.
Nina peine toujours à trouver sa place au pays Sami. La jeune Norvégienne se retrouve embarrassée lorsqu'elle doit arbitrer ce conflit entre Sami et Scandinaves. Mais, c'est surtout la relation avec son père qui l'angoisse et lui pèse... Elle mène activement l'enquête, comme un dérivatif à ses soucis, mais l'on sent que le coeur n'y est pas...
Idem pour Klemet. Depuis que nous avons fait sa connaissance, depuis "le Dernier Lapon" (ce premier et ce troisième volet de la trilogie sont étroitement liés), il se pose des questions sur ses origines. Après avoir rejeté ses racines sami, il ne cesse d'y revenir et de s'interroger à leur sujet. Une quête tout en introversion, en secrets, en décisions complexes...
Une nouvelle fois confronté à cette situation, devant s'interposer entre Scandinaves et Sami, il cogite, et sévèrement. La part sami qui dort en lui n'en finit plus de se réveiller et de le tirer par les pieds comme un fantôme dans un château écossais, si vous me permettez la métaphore. Plus sérieusement, Klemet est tiraillé, sur les nerfs, en colère, sans doute contre lui-même avant tout.
Il y a, chez ce personnage, cette profonde douleur muette liée aux déchirements qu'il s'est imposé. Dans chacun des trois livres de cette trilogie, les événements versent du sel sur une plaie jamais refermé et la brûlure empire. Dans "la Montagne rouge", c'est un Klemet au bord de l'implosion que l'on retrouve et tout ce qu'il apprend, découvre, le met au supplice...
Je me rends compte que j'ai laissé filer les doigts sur le clavier et que je suis déjà bien long... Comme si je n'avais pas envie de quitter Klemet et Nina, la Laponie, les Sami... Il faut s'y résoudre, mais pas sans quelques mots de synthèse sur "la Montagne rouge", dont le thème principal reste la question des origines et l'acceptation de l'autre.
Avec beaucoup de finesse, en introduisant un fil narratif secondaire lié à l'oncle de Klemet et à sa compagne chinoise, Olivier Truc met en perspective cette question des flux migratoires, tellement sensible de nos jours... Quand les envahisseurs d'hier, si sûrs du bien-fondé de leur action, se sentent désormais envahis et se raidissent à cette idée...
Oh, bien sûr, les choses sont plus complexes que la manière dont je viens de les exposer. Mais, il y a quelque chose de violent, de dérangeant aussi, dans la réaction des sociétés actuelles face à l'immigration lorsqu'on la met en parallèle avec les dégâts des entreprises coloniales... Un parallèle qui, dans "la Montagne rouge", fait apparaître des similitudes troublantes...
"Science sans conscience n'est que ruine de l'âme", écrivait Rabelais dans "Pantagruel". De Retzius aux méthodes employées désormais pour juger si tel candidat à l'immigration entre dans les critères requis par les lois, il n'y a qu'un pas. Et l'on comprend facilement ce qui peut révolter Klemet, lorsqu'il est témoin de ces procédures...
Au-delà du coté atypique de ce polar, qui ne repose pas sur une enquête classique visant à démasquer le coupable d'un crime de sang, Olivier Truc nous offre une histoire sombre et qui bouscule aussi le lecteur dans ses certitudes à plusieurs reprises. Que des questions restent en tête une fois la dernière page tournée ! Que de questions qui ne se cantonnent pas à la Suède, à la Scandinavie et aux Sami !
mercredi 9 novembre 2016
"Peut-être que pour devenir un grand entraîneur, il faut être un peu comme un détective : capable d'observer les hommes (...) et savoir déceler les indices de ce qu'ils sont vraiment, et non de ce qu'ils semblent être".
"Le foot, le foot, le foot, le foot, le foot, le foot, y a plus que ça !", disait Guy Bedos, dans un de ses sketchs, à une époque où la place de ce sport dans nos existences était bien moindre qu'aujourd'hui. De nos jours, le foot est partout, au grand dam de ses détracteurs, jusque dans les polars. Et sous la plume d'un auteur qu'on n'attendait pas forcément dans ce créneau. En effet, beaucoup d'entre vous connaissez certainement Philip Kerr pour sa série de polars historiques mettant en scène Bernie Gunther, dont les enquêtes se déroulent sous le IIIe Reich (et un peu après). Mais l'écrivain écossais a lancé récemment une nouvelle série dont le deuxième tome vient de paraître aux éditions du Masque. Une série dont le personnage central, Scott Manson, est entraîneur d'un club professionnel de foot à Londres. Après "Mercato d'hiver", où l'on faisait sa connaissance (et qu'il faudra que je lise), voici "la Main de Dieu", qui nous emmène dans un des pays où les supporteurs sont les plus bouillants en Europe : la Grèce... Un regard critique sur le foot et ses coulisses, sur l'argent qui est partout et pourrit tout dans ce beau sport, prétexte à tant de passions humaines, et pas des meilleures...
La saison 2014-2015 s'annonce très importante pour le club de London City. Le club du milliardaire ukrainien Viktor Sokolnikov, présidé par Phil Hobday, a réussi sa meilleure saison lors de l'exercice précédent, en terminant quatrième de Premier League. Des résultats inespérés étant donné les événements terribles qui l'ont touché (cf "Mercato d'hiver").
Sans conteste, le mérite de cette extraordinaire saison revient à l'entraîneur Scott Manson, qui a pris l'équipe en main en cours de saison et a su remobiliser son groupe pour obtenir cet incroyable résultat. Un succès qui lui a valu un surnom : "The Lucky One", en référence au surnom de Jose Mourinho, lors de ses premières saisons à la tête de Chelsea, "The Special One".
Désormais, l'objectif de Scott, Ecossais au sang chaud, qui a fait une honnête carrière de défenseur dans de nombreux clubs anglais avant de se retrouver bombardé à la tête de London City, est de qualifier son équipe pour la première fois pour la plus importante des compétitions européennes : la Ligue des Champions.
Il faudra, pour cela, passer par un tour préliminaire, jamais évident à gérer : il arrive très tôt dans la saison, d'où une préparation anticipée, loin d'être évidente à mettre en place, puisque de nombreux joueurs de London City ont participé à la Coupe du Monde au Brésil avec leurs sélections... Scott Manson est donc inquiet, et son inquiétude va aller crescendo...
Car, en cet été 2014, rien ne se passe vraiment comme il le voudrait : des joueurs-clés blessés, des transferts qu'il n'a pas décidés, des rumeurs déstabilisantes et une ambiance loin d'être au beau fixe dans le vestiaire. Ajoutez à cela une désastreuse tournée préparatoire en Russie, et vous comprendrez pourquoi Scott Manson aborde le match le plus important de l'histoire de son club avec un doute...
Un doute que renforce le tirage au sort du tour préliminaire : London City devra écarter l'Olympiakos, le club du Pirée. A priori, rien d'inabordable, mais les déplacements en Grèce ne sont jamais une partie de plaisir, tant les supporteurs locaux savent se montrer hostiles envers les visiteurs. Oh, il y aura bien un match retour, à Londres, mais il faudra éviter le piège...
Pourtant, tout commence pour le mieux, avec un but de l'attaquant russe de London City, Bekim Develi. Le départ idéal... rapidement oublié quand, tout de suite après son but, il s'écroule près de la ligne médiane... Les secours arrivés rapidement près de lui n'y pourront rien, comme d'autres jeunes hommes en pleine santé exerçant un sport de haut niveau, Develi meurt en plein match...
La rencontre est aussitôt interrompue. Elle sera reprise le lendemain et London City, la tête ailleurs, se fera corriger par l'Olympiakos pour le plus grand bonheur de ses fans hystériques. Mais cette défaite n'est rien face à la mort d'un garçon de 29 ans... Et encore moins à côté du second coup du sort qui va frapper l'équipe de Scott Manson...
Voilà que la police et la justice grecques s'emmêlent : pas question pour les joueurs et le staff du club anglais de rentrer tranquillement au pays pour préparer le match retour. Il y a eu une mort suspecte, ils sont tous potentiellement coupables et doivent donc se soumettre à l'enquête en cours, à Athènes, et peu importe le calendrier si dense des championnats et autres coupes.
Le hic, c'est que la mort suspecte en question n'est pas celle de Bekim Devili...
Coincé en Grèce bien malgré lui, Scott Manson se mue en détective amateur pour tirer son équipe de ce mauvais pas. A lui de comprendre pourquoi son joueur, son ami, est décédé si brutalement, mais aussi élucider l'autre mort violente qui vient lui compliquer un peu plus la tâche. Le tout, en gardant son équipe sous pression en vue d'un hypothétique match retour et en gérant les caprices de son président...
Le résumé peut paraître un peu long, mais il est fidèle au livre, la mort de Devili, véritable coup d'envoi de l'intrigue, arrivant assez loin dans le roman. Auparavant, Philip Kerr plante le décor de cette intersaison pas comme les autres. Ce n'est pas pour rien : les événements qui précèdent le départ en Grèce vont venir nourrir l'intrigue.
Car, une question se pose : la mort de Devili pourrait-elle être un meurtre ? Et, si c'est le cas, le mobile pourrait-il se trouver dans les dernières semaines avant le match contre l'Olympiakos ? Mais, là encore, obstacle : en cet été 2014, la Grèce doit faire face à une grève quasi générale. Dans tous les secteurs, public comme privé, on proteste contre la situation économique dramatique du pays.
Et, dans ces conditions, il est hors de question d'autopsier les victimes, ce qui n'aide pas vraiment Scott, alors que la police grecque, elle, ne semble pas vouloir envisager que l'hypothétique assassin n'appartienne pas au club ou à son entourage... Un délai qui repousse d'autant l'espoir de quitter le soleil athénien pour retrouver les brouillards de Londres...
Pour cette deuxième enquête, Scott Manson doit donc autant se frotter à tout un pays, désorganisé, exsangue, révolté, désemparé, qu'à l'idée qu'il côtoie un tueur ou qu'un tueur puisse s'en prendre de nouveau à ses hommes... Pas évident, malgré toute sa détermination et son solide caractère d'Ecossais, incapable de renoncer.
La Grèce n'est pas seulement un décor social, même si cela tient une place importante, mais aussi un décor sportif, à travers l'incroyable rivalité qui règne entre les supporteurs de l'Olympiakos et ceux du Panathinaïkos, le club rival d'Athènes. A Athènes, chacun a choisi son camp et les relations avec l'autre camp sont pour le moins... musclées...
Le foot n'est plus un jeu, n'est plus un sport, c'est un enjeu bien plus fort et on est prêt à tout, y compris au pire, pour obtenir la victoire... Une ambiance délétère qui rappelle aux Anglais les heures les plus sombres que leur championnat a traversées lorsque le hooliganisme sévissait régulièrement, provoquant drame sur drame...
Et puis, si le foot côté pelouse est un des moteurs de l'intrigue, le foot côté coulisses en est un autre. Scott Manson doit faire avec un président assez fantasque, comme souvent désormais, dans les grands clubs européens. L'entraîneur doit sans cesse batailler pour obtenir les joueurs qu'il veut, gérer son effectif à sa guise et intégrer des recrues qu'il n'a pas demandées...
Face à des agents de plus en plus puissants, capables d'imposer leur volonté aux dirigeants pour placer leurs poulains (évidemment, contre de confortables commissions qui renforcent leur puissance, etc.), la volonté d'un entraîneur, tout "Lucky One" qu'il soit, ne pèse pas très lourd... Le pouvoir sportif est écrasé par le pouvoir économique, par les millions et les millions qui tombent partout en cascades intarissables...
Il y a quelque chose de déroutant dans ce livre ; le décalage entre ces footballeurs (entraîneur compris) riches comme Crésus dans ce pays en faillite... Pendant que les Grecs se battent pour leur survie, on cause gros sous sur des yachts d'un luxe indécent, on décide du sort d'hommes qu'on va vendre et acheter, enfin, leurs contrats, mais c'est pareil... Panem et circenses au XXIe siècle...
Philip Kerr n'épargne rien, ni personne dans ce microcosme du ballon rond, capable de fasciner les foules tout en s'attirant (à juste titre) bien des foudres... Il décrit parfaitement les côtés les moins agréables du jeu le plus populaire au monde, ses dérives, chez les joueurs, enfants gâtés et mal élevés, chez les supporteurs et chez les dirigeants, qui ressemblent de plus en plus à des marchands d'esclaves.
Le racisme et l'homophobie sont là, eux aussi, dans les tribunes, bien sûr, mais aussi dans les vestiaires. Ca barde, entre équipes adverses, mais aussi entre coéquipiers. L'individualisme de ces joueurs, si paradoxal dans un sport qu'on dit collectif, est patent. On travaille ensemble, on n'est pas obligé de s'apprécier. Et c'est à l'entraîneur de réussir un impossible amalgame entre frère ennemis...
Le foot moderne, c'est Dallas, en pire. Et Scott Manson n'a pour lui que sa passion dévorante pour ce sport. A l'image de bien des personnages de ce roman, l'entraîneur de London City n'a rien d'un gentleman. Son franc-parler, en toutes circonstances, vaut le coup d'oeil. Mais quel meneur d'hommes ! Ses causeries d'avant match sont des modèles du genre, des tirades d'anthologie...
Mais, ce caractère entier est aussi un atout dans sa seconde activité, celle de détective amateur. Tout en s'inscrivant dans la droite ligne des héros façon Agatha Christie, il s'en démarque nettement par ses manières et son vocabulaire, entre autres. Philip Kerr joue avec les clichés entourant le foot et les footeux, frôle parfois la caricature mais reste pertinent dans sa satire.
L'intrigue est bien ficelée, avec son lot de fausses pistes, de ramifications attendues débouchant sur des impasses et son dénouement en forme de bouquet final qui ouvre de nouvelles perspectives très intéressantes en vue d'un troisième volet (déjà paru en Grande-Bretagne). On est dans un polar, assez lent, malgré tout, mais prenant, surtout si on aime le foot.
Pour ceux qui ne regardent les matches que de loin en loin où qui n'apprécient guère ce sport, cette série n'est sans doute pas faite pour vous. Outre quelques scènes de matches, il y a de nombreuses références à des joueurs, des entraîneurs, des clubs, des compétitions, des événements liés à l'histoire du foot et les notes de bas de page ne suffiront pas forcément à vous faire entrer dans cet univers.
Tenez, prenez le titre de ce livre : "la Main de Dieu". Pour tout amateur de foot, enfin pour ceux de ma génération (hum...), cette expression parle tout de suite. On se retrouve en 1986, au Mexique, en demi-finale de Coupe du Monde, lorsque Diego Maradona qualifie l'Argentine pour la finale en marquant un but extraordinaire et un autre de la main, qui n'aurait pas dû être validé...
C'est Maradona lui-même qui a trouvé cette formule de "la Main de Dieu", à une époque où les relations entre l'Argentine et le Royaume-Uni étaient très tendues (la guerre des Malouines n'est pas si lointaine). Une provocation bien dans le genre du "Pibe de oro", dont les frasques ont marqué l'histoire du foot autant que son immense talent.
Rassurez-vous, Maradona n'apparaît pas dans le roman de Philip Kerr, au-delà de l'exergue du roman. Ce n'est pas lui qui a tué le colonel Develi sur le terrain de foot avec le chandelier. Mais le clin d'oeil de Philip Kerr est clair comme de l'eau de roche. Reste à voir comment cela s'intègre dans le cours de son intrigue.
J'aime le foot, moins ses dérives et ses us et coutumes actuels, je me retrouve assez dans la démarche de Philip Kerr et je trouve son idée de mêler foot et polar très intéressante. Reste à savoir comment il va développer cette série. A la fin de "la Main de Dieu", il amorce un premier virage très fort. J'attends de voir comment il le négociera dans le prochain tome, désormais.
La saison 2014-2015 s'annonce très importante pour le club de London City. Le club du milliardaire ukrainien Viktor Sokolnikov, présidé par Phil Hobday, a réussi sa meilleure saison lors de l'exercice précédent, en terminant quatrième de Premier League. Des résultats inespérés étant donné les événements terribles qui l'ont touché (cf "Mercato d'hiver").
Sans conteste, le mérite de cette extraordinaire saison revient à l'entraîneur Scott Manson, qui a pris l'équipe en main en cours de saison et a su remobiliser son groupe pour obtenir cet incroyable résultat. Un succès qui lui a valu un surnom : "The Lucky One", en référence au surnom de Jose Mourinho, lors de ses premières saisons à la tête de Chelsea, "The Special One".
Désormais, l'objectif de Scott, Ecossais au sang chaud, qui a fait une honnête carrière de défenseur dans de nombreux clubs anglais avant de se retrouver bombardé à la tête de London City, est de qualifier son équipe pour la première fois pour la plus importante des compétitions européennes : la Ligue des Champions.
Il faudra, pour cela, passer par un tour préliminaire, jamais évident à gérer : il arrive très tôt dans la saison, d'où une préparation anticipée, loin d'être évidente à mettre en place, puisque de nombreux joueurs de London City ont participé à la Coupe du Monde au Brésil avec leurs sélections... Scott Manson est donc inquiet, et son inquiétude va aller crescendo...
Car, en cet été 2014, rien ne se passe vraiment comme il le voudrait : des joueurs-clés blessés, des transferts qu'il n'a pas décidés, des rumeurs déstabilisantes et une ambiance loin d'être au beau fixe dans le vestiaire. Ajoutez à cela une désastreuse tournée préparatoire en Russie, et vous comprendrez pourquoi Scott Manson aborde le match le plus important de l'histoire de son club avec un doute...
Un doute que renforce le tirage au sort du tour préliminaire : London City devra écarter l'Olympiakos, le club du Pirée. A priori, rien d'inabordable, mais les déplacements en Grèce ne sont jamais une partie de plaisir, tant les supporteurs locaux savent se montrer hostiles envers les visiteurs. Oh, il y aura bien un match retour, à Londres, mais il faudra éviter le piège...
Pourtant, tout commence pour le mieux, avec un but de l'attaquant russe de London City, Bekim Develi. Le départ idéal... rapidement oublié quand, tout de suite après son but, il s'écroule près de la ligne médiane... Les secours arrivés rapidement près de lui n'y pourront rien, comme d'autres jeunes hommes en pleine santé exerçant un sport de haut niveau, Develi meurt en plein match...
La rencontre est aussitôt interrompue. Elle sera reprise le lendemain et London City, la tête ailleurs, se fera corriger par l'Olympiakos pour le plus grand bonheur de ses fans hystériques. Mais cette défaite n'est rien face à la mort d'un garçon de 29 ans... Et encore moins à côté du second coup du sort qui va frapper l'équipe de Scott Manson...
Voilà que la police et la justice grecques s'emmêlent : pas question pour les joueurs et le staff du club anglais de rentrer tranquillement au pays pour préparer le match retour. Il y a eu une mort suspecte, ils sont tous potentiellement coupables et doivent donc se soumettre à l'enquête en cours, à Athènes, et peu importe le calendrier si dense des championnats et autres coupes.
Le hic, c'est que la mort suspecte en question n'est pas celle de Bekim Devili...
Coincé en Grèce bien malgré lui, Scott Manson se mue en détective amateur pour tirer son équipe de ce mauvais pas. A lui de comprendre pourquoi son joueur, son ami, est décédé si brutalement, mais aussi élucider l'autre mort violente qui vient lui compliquer un peu plus la tâche. Le tout, en gardant son équipe sous pression en vue d'un hypothétique match retour et en gérant les caprices de son président...
Le résumé peut paraître un peu long, mais il est fidèle au livre, la mort de Devili, véritable coup d'envoi de l'intrigue, arrivant assez loin dans le roman. Auparavant, Philip Kerr plante le décor de cette intersaison pas comme les autres. Ce n'est pas pour rien : les événements qui précèdent le départ en Grèce vont venir nourrir l'intrigue.
Car, une question se pose : la mort de Devili pourrait-elle être un meurtre ? Et, si c'est le cas, le mobile pourrait-il se trouver dans les dernières semaines avant le match contre l'Olympiakos ? Mais, là encore, obstacle : en cet été 2014, la Grèce doit faire face à une grève quasi générale. Dans tous les secteurs, public comme privé, on proteste contre la situation économique dramatique du pays.
Et, dans ces conditions, il est hors de question d'autopsier les victimes, ce qui n'aide pas vraiment Scott, alors que la police grecque, elle, ne semble pas vouloir envisager que l'hypothétique assassin n'appartienne pas au club ou à son entourage... Un délai qui repousse d'autant l'espoir de quitter le soleil athénien pour retrouver les brouillards de Londres...
Pour cette deuxième enquête, Scott Manson doit donc autant se frotter à tout un pays, désorganisé, exsangue, révolté, désemparé, qu'à l'idée qu'il côtoie un tueur ou qu'un tueur puisse s'en prendre de nouveau à ses hommes... Pas évident, malgré toute sa détermination et son solide caractère d'Ecossais, incapable de renoncer.
La Grèce n'est pas seulement un décor social, même si cela tient une place importante, mais aussi un décor sportif, à travers l'incroyable rivalité qui règne entre les supporteurs de l'Olympiakos et ceux du Panathinaïkos, le club rival d'Athènes. A Athènes, chacun a choisi son camp et les relations avec l'autre camp sont pour le moins... musclées...
Le foot n'est plus un jeu, n'est plus un sport, c'est un enjeu bien plus fort et on est prêt à tout, y compris au pire, pour obtenir la victoire... Une ambiance délétère qui rappelle aux Anglais les heures les plus sombres que leur championnat a traversées lorsque le hooliganisme sévissait régulièrement, provoquant drame sur drame...
Et puis, si le foot côté pelouse est un des moteurs de l'intrigue, le foot côté coulisses en est un autre. Scott Manson doit faire avec un président assez fantasque, comme souvent désormais, dans les grands clubs européens. L'entraîneur doit sans cesse batailler pour obtenir les joueurs qu'il veut, gérer son effectif à sa guise et intégrer des recrues qu'il n'a pas demandées...
Face à des agents de plus en plus puissants, capables d'imposer leur volonté aux dirigeants pour placer leurs poulains (évidemment, contre de confortables commissions qui renforcent leur puissance, etc.), la volonté d'un entraîneur, tout "Lucky One" qu'il soit, ne pèse pas très lourd... Le pouvoir sportif est écrasé par le pouvoir économique, par les millions et les millions qui tombent partout en cascades intarissables...
Il y a quelque chose de déroutant dans ce livre ; le décalage entre ces footballeurs (entraîneur compris) riches comme Crésus dans ce pays en faillite... Pendant que les Grecs se battent pour leur survie, on cause gros sous sur des yachts d'un luxe indécent, on décide du sort d'hommes qu'on va vendre et acheter, enfin, leurs contrats, mais c'est pareil... Panem et circenses au XXIe siècle...
Philip Kerr n'épargne rien, ni personne dans ce microcosme du ballon rond, capable de fasciner les foules tout en s'attirant (à juste titre) bien des foudres... Il décrit parfaitement les côtés les moins agréables du jeu le plus populaire au monde, ses dérives, chez les joueurs, enfants gâtés et mal élevés, chez les supporteurs et chez les dirigeants, qui ressemblent de plus en plus à des marchands d'esclaves.
Le racisme et l'homophobie sont là, eux aussi, dans les tribunes, bien sûr, mais aussi dans les vestiaires. Ca barde, entre équipes adverses, mais aussi entre coéquipiers. L'individualisme de ces joueurs, si paradoxal dans un sport qu'on dit collectif, est patent. On travaille ensemble, on n'est pas obligé de s'apprécier. Et c'est à l'entraîneur de réussir un impossible amalgame entre frère ennemis...
Le foot moderne, c'est Dallas, en pire. Et Scott Manson n'a pour lui que sa passion dévorante pour ce sport. A l'image de bien des personnages de ce roman, l'entraîneur de London City n'a rien d'un gentleman. Son franc-parler, en toutes circonstances, vaut le coup d'oeil. Mais quel meneur d'hommes ! Ses causeries d'avant match sont des modèles du genre, des tirades d'anthologie...
Mais, ce caractère entier est aussi un atout dans sa seconde activité, celle de détective amateur. Tout en s'inscrivant dans la droite ligne des héros façon Agatha Christie, il s'en démarque nettement par ses manières et son vocabulaire, entre autres. Philip Kerr joue avec les clichés entourant le foot et les footeux, frôle parfois la caricature mais reste pertinent dans sa satire.
L'intrigue est bien ficelée, avec son lot de fausses pistes, de ramifications attendues débouchant sur des impasses et son dénouement en forme de bouquet final qui ouvre de nouvelles perspectives très intéressantes en vue d'un troisième volet (déjà paru en Grande-Bretagne). On est dans un polar, assez lent, malgré tout, mais prenant, surtout si on aime le foot.
Pour ceux qui ne regardent les matches que de loin en loin où qui n'apprécient guère ce sport, cette série n'est sans doute pas faite pour vous. Outre quelques scènes de matches, il y a de nombreuses références à des joueurs, des entraîneurs, des clubs, des compétitions, des événements liés à l'histoire du foot et les notes de bas de page ne suffiront pas forcément à vous faire entrer dans cet univers.
Tenez, prenez le titre de ce livre : "la Main de Dieu". Pour tout amateur de foot, enfin pour ceux de ma génération (hum...), cette expression parle tout de suite. On se retrouve en 1986, au Mexique, en demi-finale de Coupe du Monde, lorsque Diego Maradona qualifie l'Argentine pour la finale en marquant un but extraordinaire et un autre de la main, qui n'aurait pas dû être validé...
C'est Maradona lui-même qui a trouvé cette formule de "la Main de Dieu", à une époque où les relations entre l'Argentine et le Royaume-Uni étaient très tendues (la guerre des Malouines n'est pas si lointaine). Une provocation bien dans le genre du "Pibe de oro", dont les frasques ont marqué l'histoire du foot autant que son immense talent.
Rassurez-vous, Maradona n'apparaît pas dans le roman de Philip Kerr, au-delà de l'exergue du roman. Ce n'est pas lui qui a tué le colonel Develi sur le terrain de foot avec le chandelier. Mais le clin d'oeil de Philip Kerr est clair comme de l'eau de roche. Reste à voir comment cela s'intègre dans le cours de son intrigue.
J'aime le foot, moins ses dérives et ses us et coutumes actuels, je me retrouve assez dans la démarche de Philip Kerr et je trouve son idée de mêler foot et polar très intéressante. Reste à savoir comment il va développer cette série. A la fin de "la Main de Dieu", il amorce un premier virage très fort. J'attends de voir comment il le négociera dans le prochain tome, désormais.
lundi 7 novembre 2016
"Tous pour un et un pour tous, c'était cela l'idée autrichienne".
Je pourrais presque commencer ce billet en chantant : "Si je t'écris ce soir de Vienne...". Mais, il y a deux différences notables (enfin, au moins deux) entre Barbara et moi : je ne suis pas vraiment à Vienne, même si je vais vous y emmener par la magie de la lecture, et il ne s'agira pas de la ville contemporaine, mais de la capitale de l'Empire austro-hongrois. Car nous allons parler d'une saga familiale et historique, un classique de la littérature autrichienne, publié en 1944 aux Etats-Unis, et qui vient d'être traduit en français par Elisabeth Landes. "Mélodie de Vienne", d'Ernst Lothar (aux éditions Liana Levi), est un roman-fleuve à la construction prodigieuse, aux nombreux niveaux de lecture et d'une fabuleuse lucidité. Loin de tout chauvinisme, patriotisme ou nationalisme, c'est un chant d'amour à l'Autriche, lancé à un moment où elle n'existait plus. Une ode à un pays dont l'agonie aura duré près d'un demi-siècle, avant de renaître dans des proportions bien plus modestes...
La famille Alt vit dans une grande maison de trois étages, au 10, Seilerstätte, en plein coeur de Vienne. Le fondateur de la dynastie, Christophe Alt, était facteur de piano et sa renommée a pris un essor jamais démenti depuis, le soir où un certain Wolfgang Amadeus Mozart, quelques mois avant sa mort, a joué sur un instrument sorti des ateliers Alt.
C'est au même Christophe que l'on doit l'installation de la famille dans cette maison. Et, par testament, il a imposé à ses descendants d'y demeurer et d'y cohabiter, génération après génération. Un siècle plus tard, on ressent un certain confinement... L'arbre généalogique s'est étoffé, mais ses différentes branches n'ont pas l'air de très bien s'entendre.
Ftanz, le dernier de sa fratrie, âgé de 36 ans, vient d'annoncer qu'il comptait bientôt se marier. Enfin !, pense-t-on, tant on redoutait de le voir finir vieux garçon. Mais, chez les Alt, on a souvent fondé famille sur le tard. Le hic, c'est l'identité de l'heureuse élue : Henriette. Henriette Stein. Certes, son père, professeur de droit en vue, est converti au catholicisme, mais tout de même...
Qui plus est, la jeune femme, bien plus jeune que son fiancé, va très vite faire mauvaise impression auprès de sa nouvelle famille, qui se méfie ouvertement d'elle. Et cette tendance ne cessera de se confirmer au fil des ans, creusant de plus en plus le gouffre entre les différentes branches de la famille Alt, dont Franz sera bientôt le chef.
La vie du couple que forment Franz et Henriette est le coeur de "Mélodie de Vienne", car c'est vraiment avec l'entrée de le jeune femme dans le clan Alt que les problèmes vont vraiment commencer. Par la suite, leur fils aîné, Hans, sera l'autre moteur du récit, par son existence atypique, romantique, désespérée...
Je ne vais pas entrer dans le détails des vicissitudes de la famille Alt, elles sont nombreuses, douloureuses, blessantes mais aussi, quelquefois, bouleversantes. Car, aussi imparfaits soient-ils, on s'attache à Henriette, Franz et Hans, beaucoup moins à tous les autres, dont le rôle, s'il est secondaire si l'on s'en tient au vocabulaire littéraire, est fondamental.
Et, si je ne parle pas plus en détails des événements que vont traverser les Alt lors du demi-siècle que couvre le roman, c'est parce qu'ils épousent parfaitement les événements historiques qui vont jalonner la période. Du suicide de Mayerling (intéressant, d'ailleurs, de voir que Ernst Lothar remet en cause cette thèse...) jusqu'à l'Anschluss, les Alt sont toujours des témoins privilégiés, voire des acteurs.
C'est là que réside le tour de force de ce roman de près de 600 pages qu'on ne peut pas lâcher. Non pas d'imbriquer les faits historiques et les personnages de fiction, car c'est très courant, mais de construire un formidable parallèle entre l'Autriche et la famille Alt, entre une société toute entière et la maison du 10, Seilersträtte.
D'ailleurs, "Mélodie de Vienne" possède un sous-titre tout à fait explicite : "Roman d'une maison". C'est tout à fait cela, c'est frappant d'un bout à l'autre et remarquablement mené. Puisqu'on évoque le titre, un mot de ce "Mélodie de Vienne", choisi pour l'édition française : c'est le surnom élogieux que les pianos Alt ont gagné, au fil des ans, en raison de leur qualité.
Mais, cette mélodie, c'est aussi celle de cette ville magnifique, riche d'une incroyable culture, tolérante et cosmopolite, puissante et altière. C'est le rythme auquel vit cette ville, un air du temps passé, comme une valse à trois temps qui peut s'accélérer pour devenir une joyeuse mazurka ou une vibrante polka... Autant de danses symbolisant tout l'empire...
Des musiques mélodieuses et entraînantes que vont remplacer des musiques plus modernes, avant-gardistes, comme celle de Strauss (Richard, pas Johan) ou de Schönberg, qui seront elles aussi bientôt couvertes par le bruit que font les bottes lorsque les hommes marchent au pas de l'oie et celui des fusils et des canons...
Un dernier mot sur le titre, celui du roman dans sa version originale : "Der Engel mit der Posaune", ce qui, dans le pauvre allemand qui est le mien, doit signifier peu ou proue "l'Ange au trombone". Euh, l'instrument de musique, par l'accessoire de bureau... Cet ange musicien, il orne la façade du 10, Seilersträtte, il fait presque office d'armoiries.
On le croise à plusieurs reprises au fil du roman, à chaque fois à des moments importants et cet ange aussi va connaître, à l'instar de la maison, de la famille Alt, des moments marquants et d'autres, plus douloureux, plus difficiles... Symbolique au point d'être le titre du livre, il le sera jusqu'au bout, accompagnant la famille Alt dans son déclin...
Chez les Alt, il y a le tronc, autrichien depuis toujours, mais on s'est marié avec des Tchèques, des Hongrois, des Roumains, autant de peuples composant le fameux Empire Austro-Hongrois. Au fil des pages, des chapitres, des années, les deux entités vont se désagréger et perdre leur superbe. Immenses et respectées, elles vont se réduire comme peau de chagrin jusqu'au démantèlement.
Mais, avant cela, que de doutes, de douleurs ! Nos trois personnages centraux n'ont pas un destin facile, même s'ils ne sont pas non plus exempts de tout reproche. Commençons par Franz, un homme un peu falot, qui n'a certainement pas la carrure pour devenir le chef de famille. Un peu borné, orgueilleux jusqu'à la vanité, il est surtout tombé amoureux de la mauvaise personne...
Car Henriette, on le comprend vite, ne partage pas ces sentiments. Si elle a accepté d'épouser Franz, c'est pour d'autres raisons moins avouables. Alors, rapidement, elle déprime, pas franchement aidé par l'accueil plus que froid des Alt. Pour oublier, elle vole de ses propres ailes, s'étourdit dans Vienne et ses fêtes somptueuses, charme, séduit, trompe, dépasse les bornes...
Et pourtant, quelle femme ! Quel beau personnage, qui acquiert peu à peu la noblesse dont elle n'a pas hérité à la naissance, qui s'impose, à la fois aux siens mais aussi à ses adversaires, jusque dans le clan Alt. Comprenant ses erreurs de jeunesse, laissant derrière elle son égoïsme, elle va évoluer vers un repentir sincère auquel elle sacrifiera son épanouissement, jusqu'à devenir une vraie Alt.
Et puis, il y a Hans... Si Henriette m'a profondément agacé dans la première partie, avant de me toucher dans la seconde, Hans, lui, m'a bouleversé d'un bout à l'autre. Hans, c'est l'incarnation de l'Autriche, ou plus exactement, de l'idéal autrichien, tel que le titre du billet le définit. La tirade est d'ailleurs bien plus longue, mais je n'en ai gardé que la conclusion, par souci de concision.
Hans naît au moment où le déclin de l'Empire s'amorce, à la fin des années 1880. La mort de l'héritier du trône, Rodolphe, en est le premier signe. Peut-être même aussi le plus terrible, celui qui conditionnera la suite... Désormais, rien ne sera plus pareil, jusqu'à ce qu'un ancien petit caporal, Autrichien pourtant, ne porte le coup de grâce et ne fasse disparaître l'Autriche de la carte, en 1938...
Hans grandit dans une famille qui aborde mal le virage. Mais, surtout, il souffre de l'indifférence de ses parents. Au point de nourrir des envies d'émancipation très tôt. Un doux rêve, un voeu pieux, car les Alt sont comme enchaînés au 10, Seilersträtter, comme un sort que Christophe, le patriarche, leur aurait jeté, en rédigeant son testament.
Contrairement à sa mère, née Stein et devenue Alt, Hans est né Alt mais cherche sans cesse à se débarrasser de ce poids, insupportable. Son désenchantement va sans cesse croissant, au même rythme que son pays se délite. Et c'est une des autres causes de son mal-être, de son désespoir : ni patriote, ni nationaliste, Hans aime l'Autriche, ce que représente ce pays.
Par-dessus tout, ce qu'il aime, c'est se sentir Autrichien. Elle est là, sa véritable famille. L'idéal de Hans est en phase avec la diversité sociale de ce pays qui va bientôt être bafouée par la montée inexorable de l'intolérance et du rejet de l'autre. De quoi déboussolé un peu plus Hans, qui n'a jamais vu autre chose chez ses compatriotes que des Autrichiens.
Hans n'appartient plus aux générations "impériales", si je puis dire. Son idéal passe aussi par une justice sociale que commencent à incarner les mouvements ouvriers naissants. Pourtant, il ne les ralliera pas non plus, fera son chemin seul, traçant sa route tant bien que mal, avec son malaise en bandoulière.
Enfin, pour achever d'en faire un personnage romantique, il y a cet amour qui va rester son unique moteur. Hans est, si ce n'est le seul, en tout cas le plus sincère des membres de la famille Alt. Son amour pour Selma est pur, entier, total. Et surtout, réciproque. Le sentiment passe avant tout, avant les intérêts et la réputation des Alt, avant tout calcul social.
A mes mots, vous devez vous douter que cet amour n'aura rien d'éternel... Je n'entre pas dans le détail, vous découvrirez ces situations qui prennent aux tripes, mais aussi leurs terribles conséquences, pour Hans, pour les Alt... Là encore, le lien entre le destin de Hans et celui de son pays est étroit, pour le pire bien plus que pour le meilleur...
Ernst Lothar est bien moins connu que ses amis, Stefan Zweig ou Robert Musil. Homme de théâtre, avant tout, il a fui l'Autriche peu après l'Anschluss, en raison de ses origines juives, et s'est installé à New York, où il a écrit ce roman, alors que la guerre n'était pas encore terminée. Alors que son pays, son Autriche, n'existait plus.
Il est certain que, de tous les protagonistes du roman, c'est de Hans qu'il est le plus proche. Il partage avec son double de papier et d'encre cette passion profonde pour l'Autriche, pour l'idéal que voulait incarner (à tort ou à raison) cette société, et pour les Autrichiens, tous sans distinction. "Mélodie de Vienne" est ce cri d'amour à un pays disparu à jamais, car l'Autriche de l'après-guerre n'aura rien de l'envergure de son aïeule...
Avec cette incroyable fresque historique et familiale, Ernst Lothar signe un roman qui a tout d'un "anti-Sissi". La fantaisie de la fameuse série, sa candeur et sa joie, si éloignées des réalités historiques véritables, sont ici bien loin. Oh, on s'étourdit bien dans les soirées viennoises de la Belle Epoque, et dans les salles privées où l'on s'adonne à la frivolité, on s'encanaille sur les champs de courses, mais tout moment plus léger est vite rattrapé par le principe de réalité. Et par l'Histoire.
J'ai refermé ce roman bouleversé par ce dénouement, qui m'a rappelé celui du "Tabac Tresniek", de Robert Seethaler. Par cette violente rupture et l'incertitude qu'elle engendre. Ou qu'on voudrait qu'elle engendre, car, hélas, il est difficile d'espérer un avenir radieux... Et quitter les Alt, quitter Hans, aussi soudainement après les avoir accompagnés si longuement, c'est un déchirement...
Un dernier mot avant d'être vraiment trop long : l'édition française qui vient de sortir chez Liana Levi est enrichie de deux courtes annexes, signées par l'auteur. L'une date de 1945, en décembre, quelques mois après la fin de la guerre, alors qu'un nouveau monde se dessine, rédigée à chaud, et l'autre, bénéficiant d'un recul d'une vingtaine d'années.
Ne faites pas l'impasse, lisez-les. Elle apportent des éléments supplémentaires pour nourrir votre lecture, en particulier la seconde. Elles ont aussi valeur de témoignage, de la part d'un homme dont la vie a connu un tournant, qui l'a vu être privé de son pays natal, de sa nationalité dont il était fier, de deux amis proches, Zwieg et Musil, morts tous les deux en 1942, etc.
Mais rien, rien n'aura atténué l'amour de cet homme pour son pays, il le démontre encore dans ces dernières pages. Et, déjà ébranlé par le roman lui-même, j'ai été frappé cet ajout tout à fait pertinent, par l'éclairage qu'il donne et par l'ouverture sur la suite des événements, sur l'après, qu'il propose, avec énormément de délicatesse et d'intelligence.
La famille Alt vit dans une grande maison de trois étages, au 10, Seilerstätte, en plein coeur de Vienne. Le fondateur de la dynastie, Christophe Alt, était facteur de piano et sa renommée a pris un essor jamais démenti depuis, le soir où un certain Wolfgang Amadeus Mozart, quelques mois avant sa mort, a joué sur un instrument sorti des ateliers Alt.
C'est au même Christophe que l'on doit l'installation de la famille dans cette maison. Et, par testament, il a imposé à ses descendants d'y demeurer et d'y cohabiter, génération après génération. Un siècle plus tard, on ressent un certain confinement... L'arbre généalogique s'est étoffé, mais ses différentes branches n'ont pas l'air de très bien s'entendre.
Ftanz, le dernier de sa fratrie, âgé de 36 ans, vient d'annoncer qu'il comptait bientôt se marier. Enfin !, pense-t-on, tant on redoutait de le voir finir vieux garçon. Mais, chez les Alt, on a souvent fondé famille sur le tard. Le hic, c'est l'identité de l'heureuse élue : Henriette. Henriette Stein. Certes, son père, professeur de droit en vue, est converti au catholicisme, mais tout de même...
Qui plus est, la jeune femme, bien plus jeune que son fiancé, va très vite faire mauvaise impression auprès de sa nouvelle famille, qui se méfie ouvertement d'elle. Et cette tendance ne cessera de se confirmer au fil des ans, creusant de plus en plus le gouffre entre les différentes branches de la famille Alt, dont Franz sera bientôt le chef.
La vie du couple que forment Franz et Henriette est le coeur de "Mélodie de Vienne", car c'est vraiment avec l'entrée de le jeune femme dans le clan Alt que les problèmes vont vraiment commencer. Par la suite, leur fils aîné, Hans, sera l'autre moteur du récit, par son existence atypique, romantique, désespérée...
Je ne vais pas entrer dans le détails des vicissitudes de la famille Alt, elles sont nombreuses, douloureuses, blessantes mais aussi, quelquefois, bouleversantes. Car, aussi imparfaits soient-ils, on s'attache à Henriette, Franz et Hans, beaucoup moins à tous les autres, dont le rôle, s'il est secondaire si l'on s'en tient au vocabulaire littéraire, est fondamental.
Et, si je ne parle pas plus en détails des événements que vont traverser les Alt lors du demi-siècle que couvre le roman, c'est parce qu'ils épousent parfaitement les événements historiques qui vont jalonner la période. Du suicide de Mayerling (intéressant, d'ailleurs, de voir que Ernst Lothar remet en cause cette thèse...) jusqu'à l'Anschluss, les Alt sont toujours des témoins privilégiés, voire des acteurs.
C'est là que réside le tour de force de ce roman de près de 600 pages qu'on ne peut pas lâcher. Non pas d'imbriquer les faits historiques et les personnages de fiction, car c'est très courant, mais de construire un formidable parallèle entre l'Autriche et la famille Alt, entre une société toute entière et la maison du 10, Seilersträtte.
D'ailleurs, "Mélodie de Vienne" possède un sous-titre tout à fait explicite : "Roman d'une maison". C'est tout à fait cela, c'est frappant d'un bout à l'autre et remarquablement mené. Puisqu'on évoque le titre, un mot de ce "Mélodie de Vienne", choisi pour l'édition française : c'est le surnom élogieux que les pianos Alt ont gagné, au fil des ans, en raison de leur qualité.
Mais, cette mélodie, c'est aussi celle de cette ville magnifique, riche d'une incroyable culture, tolérante et cosmopolite, puissante et altière. C'est le rythme auquel vit cette ville, un air du temps passé, comme une valse à trois temps qui peut s'accélérer pour devenir une joyeuse mazurka ou une vibrante polka... Autant de danses symbolisant tout l'empire...
Des musiques mélodieuses et entraînantes que vont remplacer des musiques plus modernes, avant-gardistes, comme celle de Strauss (Richard, pas Johan) ou de Schönberg, qui seront elles aussi bientôt couvertes par le bruit que font les bottes lorsque les hommes marchent au pas de l'oie et celui des fusils et des canons...
Un dernier mot sur le titre, celui du roman dans sa version originale : "Der Engel mit der Posaune", ce qui, dans le pauvre allemand qui est le mien, doit signifier peu ou proue "l'Ange au trombone". Euh, l'instrument de musique, par l'accessoire de bureau... Cet ange musicien, il orne la façade du 10, Seilersträtte, il fait presque office d'armoiries.
On le croise à plusieurs reprises au fil du roman, à chaque fois à des moments importants et cet ange aussi va connaître, à l'instar de la maison, de la famille Alt, des moments marquants et d'autres, plus douloureux, plus difficiles... Symbolique au point d'être le titre du livre, il le sera jusqu'au bout, accompagnant la famille Alt dans son déclin...
Chez les Alt, il y a le tronc, autrichien depuis toujours, mais on s'est marié avec des Tchèques, des Hongrois, des Roumains, autant de peuples composant le fameux Empire Austro-Hongrois. Au fil des pages, des chapitres, des années, les deux entités vont se désagréger et perdre leur superbe. Immenses et respectées, elles vont se réduire comme peau de chagrin jusqu'au démantèlement.
Mais, avant cela, que de doutes, de douleurs ! Nos trois personnages centraux n'ont pas un destin facile, même s'ils ne sont pas non plus exempts de tout reproche. Commençons par Franz, un homme un peu falot, qui n'a certainement pas la carrure pour devenir le chef de famille. Un peu borné, orgueilleux jusqu'à la vanité, il est surtout tombé amoureux de la mauvaise personne...
Car Henriette, on le comprend vite, ne partage pas ces sentiments. Si elle a accepté d'épouser Franz, c'est pour d'autres raisons moins avouables. Alors, rapidement, elle déprime, pas franchement aidé par l'accueil plus que froid des Alt. Pour oublier, elle vole de ses propres ailes, s'étourdit dans Vienne et ses fêtes somptueuses, charme, séduit, trompe, dépasse les bornes...
Et pourtant, quelle femme ! Quel beau personnage, qui acquiert peu à peu la noblesse dont elle n'a pas hérité à la naissance, qui s'impose, à la fois aux siens mais aussi à ses adversaires, jusque dans le clan Alt. Comprenant ses erreurs de jeunesse, laissant derrière elle son égoïsme, elle va évoluer vers un repentir sincère auquel elle sacrifiera son épanouissement, jusqu'à devenir une vraie Alt.
Et puis, il y a Hans... Si Henriette m'a profondément agacé dans la première partie, avant de me toucher dans la seconde, Hans, lui, m'a bouleversé d'un bout à l'autre. Hans, c'est l'incarnation de l'Autriche, ou plus exactement, de l'idéal autrichien, tel que le titre du billet le définit. La tirade est d'ailleurs bien plus longue, mais je n'en ai gardé que la conclusion, par souci de concision.
Hans naît au moment où le déclin de l'Empire s'amorce, à la fin des années 1880. La mort de l'héritier du trône, Rodolphe, en est le premier signe. Peut-être même aussi le plus terrible, celui qui conditionnera la suite... Désormais, rien ne sera plus pareil, jusqu'à ce qu'un ancien petit caporal, Autrichien pourtant, ne porte le coup de grâce et ne fasse disparaître l'Autriche de la carte, en 1938...
Hans grandit dans une famille qui aborde mal le virage. Mais, surtout, il souffre de l'indifférence de ses parents. Au point de nourrir des envies d'émancipation très tôt. Un doux rêve, un voeu pieux, car les Alt sont comme enchaînés au 10, Seilersträtter, comme un sort que Christophe, le patriarche, leur aurait jeté, en rédigeant son testament.
Contrairement à sa mère, née Stein et devenue Alt, Hans est né Alt mais cherche sans cesse à se débarrasser de ce poids, insupportable. Son désenchantement va sans cesse croissant, au même rythme que son pays se délite. Et c'est une des autres causes de son mal-être, de son désespoir : ni patriote, ni nationaliste, Hans aime l'Autriche, ce que représente ce pays.
Par-dessus tout, ce qu'il aime, c'est se sentir Autrichien. Elle est là, sa véritable famille. L'idéal de Hans est en phase avec la diversité sociale de ce pays qui va bientôt être bafouée par la montée inexorable de l'intolérance et du rejet de l'autre. De quoi déboussolé un peu plus Hans, qui n'a jamais vu autre chose chez ses compatriotes que des Autrichiens.
Hans n'appartient plus aux générations "impériales", si je puis dire. Son idéal passe aussi par une justice sociale que commencent à incarner les mouvements ouvriers naissants. Pourtant, il ne les ralliera pas non plus, fera son chemin seul, traçant sa route tant bien que mal, avec son malaise en bandoulière.
Enfin, pour achever d'en faire un personnage romantique, il y a cet amour qui va rester son unique moteur. Hans est, si ce n'est le seul, en tout cas le plus sincère des membres de la famille Alt. Son amour pour Selma est pur, entier, total. Et surtout, réciproque. Le sentiment passe avant tout, avant les intérêts et la réputation des Alt, avant tout calcul social.
A mes mots, vous devez vous douter que cet amour n'aura rien d'éternel... Je n'entre pas dans le détail, vous découvrirez ces situations qui prennent aux tripes, mais aussi leurs terribles conséquences, pour Hans, pour les Alt... Là encore, le lien entre le destin de Hans et celui de son pays est étroit, pour le pire bien plus que pour le meilleur...
Ernst Lothar est bien moins connu que ses amis, Stefan Zweig ou Robert Musil. Homme de théâtre, avant tout, il a fui l'Autriche peu après l'Anschluss, en raison de ses origines juives, et s'est installé à New York, où il a écrit ce roman, alors que la guerre n'était pas encore terminée. Alors que son pays, son Autriche, n'existait plus.
Il est certain que, de tous les protagonistes du roman, c'est de Hans qu'il est le plus proche. Il partage avec son double de papier et d'encre cette passion profonde pour l'Autriche, pour l'idéal que voulait incarner (à tort ou à raison) cette société, et pour les Autrichiens, tous sans distinction. "Mélodie de Vienne" est ce cri d'amour à un pays disparu à jamais, car l'Autriche de l'après-guerre n'aura rien de l'envergure de son aïeule...
Avec cette incroyable fresque historique et familiale, Ernst Lothar signe un roman qui a tout d'un "anti-Sissi". La fantaisie de la fameuse série, sa candeur et sa joie, si éloignées des réalités historiques véritables, sont ici bien loin. Oh, on s'étourdit bien dans les soirées viennoises de la Belle Epoque, et dans les salles privées où l'on s'adonne à la frivolité, on s'encanaille sur les champs de courses, mais tout moment plus léger est vite rattrapé par le principe de réalité. Et par l'Histoire.
J'ai refermé ce roman bouleversé par ce dénouement, qui m'a rappelé celui du "Tabac Tresniek", de Robert Seethaler. Par cette violente rupture et l'incertitude qu'elle engendre. Ou qu'on voudrait qu'elle engendre, car, hélas, il est difficile d'espérer un avenir radieux... Et quitter les Alt, quitter Hans, aussi soudainement après les avoir accompagnés si longuement, c'est un déchirement...
Un dernier mot avant d'être vraiment trop long : l'édition française qui vient de sortir chez Liana Levi est enrichie de deux courtes annexes, signées par l'auteur. L'une date de 1945, en décembre, quelques mois après la fin de la guerre, alors qu'un nouveau monde se dessine, rédigée à chaud, et l'autre, bénéficiant d'un recul d'une vingtaine d'années.
Ne faites pas l'impasse, lisez-les. Elle apportent des éléments supplémentaires pour nourrir votre lecture, en particulier la seconde. Elles ont aussi valeur de témoignage, de la part d'un homme dont la vie a connu un tournant, qui l'a vu être privé de son pays natal, de sa nationalité dont il était fier, de deux amis proches, Zwieg et Musil, morts tous les deux en 1942, etc.
Mais rien, rien n'aura atténué l'amour de cet homme pour son pays, il le démontre encore dans ces dernières pages. Et, déjà ébranlé par le roman lui-même, j'ai été frappé cet ajout tout à fait pertinent, par l'éclairage qu'il donne et par l'ouverture sur la suite des événements, sur l'après, qu'il propose, avec énormément de délicatesse et d'intelligence.
Inscription à :
Articles (Atom)