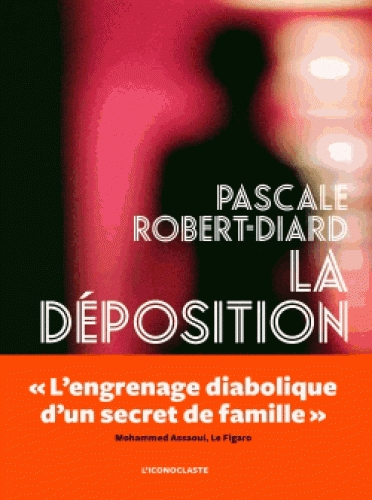Lorsque Elena apprend la soudaine disparition de son amie de toujours, Lila, elle n'est pas plus surprise que ça. Alors que le fils de Lila semble incapable d'agir ou de réagir, elle prend la nouvelle avec un calme olympien et plutôt que de se lancer à la recherche de Lila, elle décide de s'installer devant son ordinateur et d'écrire leur histoire commune.
Elena et Lila sont nées à Naples à la fin de la IIe Guerre Mondiale et grandissent dans une Italie en pleine reconstruction après un quart de siècle de fascisme. Les deux filles sont issues d'un milieu modeste : le père d'Elena est portier, celui de Lila cordonnier, et leurs mères sont femmes au foyer. C'est à l'école primaire qu'elles vont se rencontrer et se lier, devenir inséparables.
Très tôt, les deux filles s'avèrent être les deux meilleures élèves de leur classe. Mais, là où Lila semble faire preuve d'une insolente facilité et d'une insatiable curiosité, Elena doit énormément travailler pour obtenir d'excellentes notes. Est-ce pour cela que la seconde va prendre la première pour modèle ?
Pourtant, Lila, à l'allure négligée, personnage renfermé, parfois dur, que certains jugent même méchante, n'est pas le genre de camarade parfait. Mais, il émane d'elle un vrai charisme. Quant à Elena, elle est alors une ravissante petite fille modèle, ou presque, car, à la maison, les relations avec sa mère sont mauvaises.
Au fil des années, les enfants du quartier, pour qui l'école pourrait être un moyen de s'extraire de leur classe d'origine, vont mener leur barque différemment. Certains ont les capacités pour aller plus loin, poursuivre au collège et peut-être au-delà. D'autres non, et ils retourneront auprès de leurs parents, sans doute pour débuter une carrière professionnelle à leurs côtés.
Lila et Elena n'ont pas ces doutes : toutes les deux sont largement capables d'entrer au collège. Mais, si Elena réussit à obtenir de son père, en particulier, qu'elle ne revienne pas aider sa mère à la maison et poursuive sa scolarité, ce n'est pas le cas de Lila, qui arrête ses études à la fin du primaire, malgré ses évidentes capacités.
A partir de là, les trajectoires des deux filles vont diverger quasiment en tout, sans pour autant jamais couper le lien qui les unit. Même lorsqu'elles semblent s'éloigner l'une de l'autre, elles finissent toujours par se rapprocher. Et particulièrement, parce que Elena semble avoir besoin des repères que Lila lui procure. De la confiance en elle dont elle manque cruellement.
Quand je dis qu'elles vont diverger en tout, cela concerne l'école, on l'a dit, Elena allant jusqu'au lycée quand Lila quitte l'école avant le collège. Ensuite, avec la famille, les garçons, la relation aux autres, la réputation, même... Et, cependant, on ressent l'étrange impression que toutes les deux suivent le même objectif, la même volonté de se sortir de ce quartier, de monter dans la hiérarchie sociale.
Pendant qu'Elena choisit la voie des études, Lila se lance dans une aventure forte, dans le domaine de sa famille : la cordonnerie. Elle verrait bien l'échoppe de son père prendre du galon et, plutôt que de réparer les chaussures des autres, elle aimerait que les Cerullo fabriquent leurs propres modèles, suivant les dessins qu'elles réalisent.
Lila est un personnage fascinant, une espèce de vilain petit canard napolitain, maigrelette, les genoux toujours couronnés, pauvrement attifée, mais rayonnant d'une énergie inextinguible. Une soif de savoir, d'abord, puis, quand la voie scolaire se ferme, une soif de réussir par tous les moyens ou presque.
Puis, à l'adolescence, alors qu'Elena nourrit un univers de complexes sur son physique, son acné, ses formes, sa timidité, etc., Lila s'épanouit, embellit, son charisme et son pouvoir de séduction croissent, et elle sait parfaitement en jouer. Tout en gardant ce côté imprévisible qui en fait, ce n'est pas moi qui le dit, mais Elena, la méchante de leur duo. En tout cas, aux yeux des autres.
L'entrée dans l'adolescence sera aussi l'occasion de s'intéresser aux garçons. Mais, dans ce roman initiatique où cette partie adolescente tient la plus grosse part (quasiment les trois quarts de ce premier volet), d'autres critères viennent jouer. Car, à l'image de toute l'Italie, le quartier de Naples dans lequel grandissent Lila et Elena est fragmenté et se cherche de nouveaux repères.
L'Italie fait sa guerre froide, les derniers feux du fascisme se trouvent confrontés à la montée du communisme. Chaque famille sait à quel camp leurs voisins se rattachent et la vie sociale du quartier s'organisent de plus en plus autour de cela, chacun ayant ses infréquentables... Mais, les gamins, eux, ont grandi sans rien connaître de tout ça, et ça ne les gêne pas... Jusqu'à ce que ces questions les rattrapent.
Alors, oui, premiers émois, mais aussi premières rivalités amoureuses, car les garçons qui s'intéressent à Elena et encore plus à Lila sont les principaux acteurs de cette nouvelle donne. A laquelle il ne faut pas oublier d'ajouter un élément, très discret dans ce premier tome, mais nullement absent, comme flottant au-dessus de la ville : la Camorra.
Les tensions sociales, familiales, politiques, amoureuses, inextricablement liées, vont s'exacerber durant toute cette partie adolescente et "l'amie prodigieuse", c'est aussi le récit de l'évolution de Lila et d'Elena dans cet univers mouvant, tendu. Là encore, avec des choix et des façons d'agir sensiblement différentes pour l'une et l'autre.
Lila ose, ose encore, ose toujours, mène tout le monde par le bout du nez, change, peut-être pas forcément en bien, manipule, manigance, alors qu'Elena est indécise, peine à faire des choix clairs et nets, surtout lorsqu'ils ne concernent pas qu'elle. Lila semble avancer droit vers l'objectif qu'elle s'est fixé, sans se soucier plus que d'une guigne des autres, Elena avance plus doucement, sans certitude.
Le parcours de ces deux-là, en tout cas, le début de ce parcours, est remarquablement relaté dans ce premier tome. La relation assez complexe, parfois déroutante, entre Elena et Lila tient en haleine. Par moments, mais c'est un avis personnel, on comprend mal ce lien indéfectible qui les unit tant elles sont différentes, tant Elena est trop attentive à Lila, alors que Lila semble ne se préoccuper que d'elle.
Mais, les choses sont plus compliquées que cette phrase ne semble l'indiquer. Et je serais bien incapable de vous dire, à ce stade, si c'est Elena qui est fascinée par Lila ou si Lila, consciemment ou non, exerce une emprise sur son amie. Peut-être y a-t-il un peu des deux, tant on a l'impression que les deux se doivent de se réunir lorsqu'elles abordent, l'une et l'autre, une nouvelle phase-clé de leur existence.
Sans doute suis-je aussi influencée par ces premières pages, ce prologue annonçant la volatilisation de Lila, devenue sexagénaire... Il plane au-dessus de ces deux fillettes, devenues femmes, un mystère dont la solution ne nous apparaîtra certainement pas tout de suite, puisque cette saga en est à son quatrième tome, en Italie.
Oui, ce lien d'amitié si spécial, qui n'est pas un pacte ou une alliance quelconque, mais une vraie relation amicale forte comme on en connaît peu dans une vie, est au coeur de ce premier tome, et certainement des suivants. Et seuls les faits pourront nous permettre de mieux le comprendre. Et de voir comment l'une et l'autre se complètent parfaitement et avancent, sans pour autant se ressembler.
"L'amie prodigieuse" est le début d'une fresque vivante et colorée, comme peut l'être la ville de Naples. La famille y tient une place particulière mais j'ai été frappé par cette espèce d'enfermement qu'on ressent : celui qui naît dans ce quartier n'en sort quasiment jamais, pas même pour aller dans une autre partie de la ville. Pas même pour aller à la mer, pourtant si proche.
Je suis sans doute un brin naïf, je sais, mais cela m'a frappé. Cela donne à la quête des deux filles une ambition énorme, car c'est aussi rompre plus ou moins nettement avec la quartier, la vie de famille, qu'elles recherchent. Que cela passe par les études, par le mariage, par des choix d'avenir forts, manifestement, ni l'une, ni l'autre n'envisage de se sédentariser dans leur quartier natal.
Parce que, malgré tout, en grandissant, il devient petit, ce quartier, étouffant, peut-être. Le vilain petit canard devenu cygne a besoin d'espace pour s'envoler et c'est certainement aussi le cas d'Elena, même si elle l'exprime avec moins de force. Je suis d'ailleurs curieux de voir comment elles vont évoluer et s'éloigner, plus ou moins, du bercail.
En avançant dans ce premier tome, j'ai commencé à me demander quelle part autobiographique il pouvait y avoir dans cette saga. Là encore, je plaide coupable, le prénom Elena m'a sans doute influencé, même si le personnage du livre a pour patronyme Greco et non Ferrante. Qu'à cela ne tienne, j'ai voulu en avoir le coeur net.
Et, première surprise, pas une ligne de biographie de l'auteur dans le livre, édition Folio, que j'ai en main. Bon, pas grave, je lance le moteur de recherches, Elena Ferrante, ça mouline, ça nous donne pas mal d'entrée, dont la traditionnelle fiche Wikipedia, qui suffisait largement pour ce que je voulais savoir. Et là, deuxième surprise, et de taille...
Elena Ferrante... n'existe pas ! Enfin, c'est un pseudonyme, pour être plus précis. Mais qui se cache derrière ce pseudo ? Le secret semble très bien gardé. Sur la page italienne de Wikipedia, pas moins d'une demi-douzaine de candidats potentiels, dont des paires, qui écriraient à quatre mains cette saga en se dissimulant derrière un nom unique...
Invisible, Elena Ferrante a pourtant accepté la requête d'un célèbre Napolitain, Roberto Saviano. L'auteur de "Gomorra" a souhaité que "l'amie prodigieuse" soit en lice pour le prix Strega, l'équivalent de notre Goncourt. Requête acceptée, sans résultat, le prix ayant été décerné à un autre roman...
Saura-t-on un jour réellement qui se cache derrière le nom d'Elena Ferrante ? Pour tout dire, cela importe peu, à part pour cette question de la dimension plus ou moins autobiographique du roman. Mais, dans une certaine mesure, voilà qui donne encore plus d'ampleur et de force à ce projet, puisqu'il pourrait s'agir d'une pure fiction.
Elena et Lila sont deux personnages auxquels on s'attache. Peut-être, comme elles le disent, à tour de rôle, les percevrez-vous comme la gentille et la méchante, mais je suis plus nuancé sur ce sujet. Elena est une jeune fille très naïve qui a beaucoup à apprendre de la vie, plus encore que des études. Lila est naturellement plus dégourdie et possède cette confiance en elle, du moins en apparence, ce caractère qui lui feraient soulever des montagnes.
Une détermination et une ambition qui, parfois, donnent l'impression qu'elle est dur, égoïste, et peut-être l'est-elle effectivement, mais c'est encore tôt pour le dire. A plusieurs reprises, elle fait preuve d'altruisme pour aider son amie, en particulier dans le cours de ses études (Lila se révèle une latiniste autodidacte particulièrement douée), mais elle se livre également très peu.
La lecture, car cela se fera, pas forcément tout de suite, mais prochainement de "Le nouveau nom", tome 2 de la saga, devrait apporter quelques réponses, en tout cas des débuts de réponse. Et ouvrir aussi vers de nouveaux horizons pour nos deux héroïnes, avec l'arrivée des années 60, dans une Italie qui continuera sa mutation et dans une ville de Naples qui, elle aussi, devrait subir quelques soubresauts.