Un samedi soir, au Cap, en Afrique du sud. Dans un township, un des quartiers les plus pauvres de la ville, une adolescente tellement maigre qu'on dirait une fillette cherche de quoi manger dans les poubelles d'un bar assez minable. Pendant qu'elle farfouille dans les containers, des clients sortent de l'établissement et, manifestement, plusieurs d'entre eux n'ont pas bu que de l'eau...
L'un des hommes, un de ceux qui paraît le plus éméchés, monte à la place du conducteur d'un imposant 4x4, malgré les demandes de l'aîné du groupe, met le contact, enclenche une vitesse... Et la voiture part brusquement en marche arrière, arrêté par les énormes poubelles. Peu de dégâts sur la voiture, mais la gamine qui se trouvait là est en revanche bien mal en point.
Elle n'est pas morte, mais son corps a été écrasé par l'énorme voiture contre les containers à ordures. Peut-être aurait-on pu la sauver en appelant immédiatement les secours, mais celui qui semble être à la tête du groupe va en décider autrement. A cette heure-là, dans ce quartier, il n'y a pas de témoin, il décide donc de mettre les voiles au plus vite...
Le sergent Radebe Turner est le premier policier arrivé sur les lieux du drame. Pour la jeune fille, il est déjà trop tard. Sur elle, aucun papier, elle va sans doute rejoindre le cortège des morts anonymes qui remplissent les morgues des grandes villes sud-africaines, victimes de la violence qui fait rage dans le pays.
Mais, pour Turner, cette idée est intolérable ; il ne laissera pas ce drame impuni, quoi qu'il en coûte. Et, s'il ne sait rien de celle qui est morte là, au milieu des poubelles, pour avoir voulu se nourrir, il a trouvé des indices majeurs pouvant lui permettre de retrouver ceux qui l'ont tuée. Des preuves qui montrent qu'il s'agit d'un délit de fuite en bonne et due forme.
L'homme qui est dans le collimateur de Turner s'appelle Dirk Le Roux, un jeune homme de 24 ans qui doit débuter une prometteuse carrière d'avocat la semaine suivante. Mais, surtout, Dirk est le fils de Margot Le Roux, une richissime veuve qui se trouve à la tête d'un empire minier installé dans la province du Cap-Nord, une immense région en grande partie désertique, qui s'étend jusqu'aux frontières avec la Namibie et le Botswana.
Un jeune homme blanc, riche, influent a tué une fillette noire, pauvre, sans avenir dans un des coins les plus défavorisés du Cap... Même des années après la fin de l'Apartheid, cette affaire paraît jouée d'avance. Sauf pour le sergent Radebe Turner. A peine a-t-il quitté la scène de crime qu'il se rend chez son supérieur, le capitaine Venter, pour le mettre au courant de ses intentions.
Dirk Le Roux et ses compagnons de bringue ont semble-t-il précipitamment repris la route vers le Cap-Nord, Turner entend faire la route jusqu'à Langkopf, le fief des Le Roux, pour l'arrêter et le ramener pour qu'il soit jugé. Une décision qui s'accompagne d'une volonté si forte que Venter, malgré ses doutes, ne peut empêcher Turner de se lancer dans cette course-poursuite.
Mais Turner ignore où il va mettre les pieds : à Langkopf, les Le Roux sont rois et c'est la loi telle qu'ils la définissent qui s'applique. Avec Dirk, ce soir-là, se trouvaient son meilleur ami, Jason, mais aussi Hennie, son beau-père et homme de confiance de Margot Le Roux, également ancien mercenaire, et Simon, le chef de la sécurité des Le Roux.
Hennie et Simon, avec la bénédiction de Margot, qui ferait tout pour protéger ce fils qu'elle aime plus que tout, n'ont aucunement l'intention de laisser l'héritier trinquer pour cette funeste erreur. Et s'il faut pour cela se débarrasser d'un policier un peu trop curieux et téméraire, ce n'est pas la place qui manque dans les alentours de Langkopf...
Bientôt, entre le flic noir, à la détermination sans faille et l'intégrité inoxydable, et la famille Le Roux, la guerre est déclarée. Et ne croyez pas que le fait de se retrouver seul contre tous effraie Radebe Turner. Il réclamait justice pour cette enfant morte si bêtement, mais dans ces conditions, se lancer dans une véritable vendetta n'est pas un souci...
"C'est le Far West, ici...", constate Turner au cours de son voyage dans le Cap-Nord, et on ne peut pas lui donner tort. Même le décor contribue à cette impression : Langkopf, bled perdu au milieu de nulle part, en plein désert, on se croirait effectivement revenu au temps des pionniers, de la conquête de l'ouest et des ruées vers l'or.
Le côté western, c'est aussi cette famille qui règne, il n'y a pas d'autre mot, sur son territoire, nourrissant tout le monde et ayant tout le monde à ses ordres en retour. Même le flic vétéran qui a quitté la grande ville et ses dangers pour s'offrir une pré-retraite pépère dans cet endroit où l'on attend surtout de lui qu'il n'en fasse pas trop...
Soyons franc, en soi, la trame de "La Mort selon Turner" est ultra-classique, un western, un justicier solitaire, une famille puissante et déterminée à le rester, une loi du plus fort qui s'écrit à coups de flingues... Oui, dit ainsi, c'est ultra-classique, mais en y regardant de plus près, on se rend compte que Tim Willocks n'a pas mis en scène une histoire si classique que cela.
On pourrait croire à un manichéisme de bon aloi, vu le contexte : une pauvre noire victime d'un riche blanc, dans la droite ligne de la période d'Apartheid. Mais il s'agit d'abord d'un accident et tout concorde à faire de Dirk un portrait très élogieux, bien loin de l'Afrikaaner professant la suprématie blanche, même lorsqu'il n'a pas abusé de la bouteille.
C'est plutôt l'entourage de Dirk, le souci. En particulier ce Hennie, qui correspond déjà beaucoup mieux au méchant qu'on s'attend à croiser dans un tel contexte. Violent, sans scrupule, manipulateur et pas franchement motivé par le sort de son prochain. Et surtout, il a l'oreille d'une Margot Le Roux qui est prête à tout pour aider son fils.
Et puis, il y a Turner. Franchement, si on ne le savait pas flic, c'est probablement le personnage qui ficherait le plus les jetons dans ce roman. A commencer par son regard, des yeux verts qu'on remarque aussitôt, d'une froideur à vous figer le sang dans les veines. Et tout, dans son attitude décidée, dans sa démarche, dans son côté imprévisible, vous fait passer un frisson dans le dos...
Mais, c'est un flic, sans doute pas un flic comme les autres, mais tout de même un flic. De Turner, Venter dit : "il hait la police. Il méprise les flics. C'est pour ça qu'il en est devenu un". Et, malgré cette haine que décrit son supérieur, c'est un excellent flic, qui fait surtout preuve d'une intégrité absolue, dans un pays où la corruption est partout.
Froid comme une lame, ne ressentant pas la peur, débrouillard et fine gâchette, "il n'est pas n'importe quel flic, c'est le flic de vos cauchemars" (dixit Venter une nouvelle fois). Attention, le cauchemar de ceux qui ne respectent pas les règles, qui les méprisent, même, du haut de leurs privilèges. Ceux que leur confère la couleur de leur peau, par exemple.
Turner, c'est une boule de colère, une tornade alimentée par l'injustice extrême subie par les populations noires d'Afrique du Sud depuis si longtemps. Turner, c'est un homme qui en a marre du fonctionnement de ce monde et a décidé de faire un exemple. Turner, c'est un garçon qui n'a plus rien à perdre, mais qui connaît ses forces ; et les faiblesses des autres.
C'est un magnifique personnage, à la fois impitoyable et fragile, le corps et l'esprit blindés pour pouvoir continuer à avancer, malgré tout. Un policier intègre, oui, mais qui devient dans cette histoire un justicier décidé à appliquer ses propres règles. Et finalement, de jouer avec les mêmes armes que les adversaires qu'il va devoir défier.
Je ne peux pas évoquer les personnages de "La Mort selon Turner" sans évoquer les deux personnages féminins qui occupent une place importante dans le livre. D'abord, Margot Le Roux, personnage bien plus complexe qu'il n'y paraît là encore. On imagine volontiers une Charlize Theron dans ce rôle, celui d'une femme qui ne vit pas la vie dont elle rêvait étant jeune.
Mais, lorsqu'elle s'est retrouvée à la tête de l'entreprise familiale, elle a accepté de ranger définitivement ses rêves au placard pour endosser le costume de patronne intraitable. C'est aussi un personnage ambivalent, mue par des sentiments nobles, mais faisant pour cela des choix plus que contestables sur le plan moral.
Eh oui, on est toujours entre deux, à cheval sur la limite entre le bien et le mal, que chacun enjambe, traverse dans un sens et dans l'autre (en tout cas de son point de vue, et parfois de celui du lecteur) en fonction des événements. Tim Willocks brouille tout cela avec grand talent, pour simplement mettre face à face des êtres humains espérant agir au mieux pour les leurs.
Autre personnage féminin, Imi. Une jeune femme noire qui vit à Langkopf et que rencontre Turner dès son arrivée. Ah, vous croyez me voir arriver, mais ne vous emballer pas, son rôle est tout autre. Sauf que je ne vous le révélerai pas ici, car il va apparaître petit à petit, essentiellement à travers son rapport à la famille Le Roux.
Elle est certainement le personnage le plus candide du roman, au sens positif du terme. En tout cas, celle qui a l'âme la plus pure, plus encore depuis que Dirk est monté dans son 4x4 après avoir trop arrosé la soirée... Malgré des différences évidentes, son destin peut faire penser à celui de Margot au même âge, du moins dans sa trajectoire. Son avenir pourrait être un enjeu.
"La Mort selon Turner" est un roman très sombre, malgré le soleil brûlant du Cap-Nord, très violent, mais ce n'est pas surprenant lorsqu'on connaît le travail de Tim Willocks. Il y a pourtant au coeur de cette histoire un passage comme on en lit rarement et qui risque de vous faire faire la grimace et même un peu plus.
Je ne vais pas vous la raconter, mais j'ai rarement lu un truc pareil et je ne me suis rarement senti aussi peu à l'aise face à cet épisode. Non, n'insistez pas, vous n'en saurez pas plus, imaginez simplement une version gore de "McGyver", et vous aurez une (toute petite) idée de ce qui vous attend. Je ne sais pas où Tim Willocks puise (le mot est choisi) son inspiration, mais ça ne doit pas être beau !
Il signe là un thriller sous tension permanente, porté par le personnage de Turner et sa lente évolution, du représentant de la loi jusqu'au justicier. Et du simple rapport entre un camp du bien et un camp du mal, il dévie pour proposer une galerie de personnages capables de susciter (à quelques exceptions près, il ne faut ps exagérer) l'empathie et même la sympathie.
Son intrigue est une boule de neige, d'abord minuscule, et qui va grossir jusqu'à prendre des proportions dignes d'une avalanche. Du genre dévastatrice... Car, encore une fois, à l'origine de tout, il y a un accident et un événement, certes dramatique, mais qui aurait pu être classé rapidement. Mais, en choisissant la fuite, le clan Le Roux a enclenché la machine infernale.
C'est extrêmement visuel, en particulier dans les scènes de castagne évidemment, mais pas uniquement. Les décors sont très importants, et particulièrement les paysages arides du Cap-Nord, et contribuent à cette dimension cinématographique captivante. La chaleur est écrasante et l'on ressent vite son poids, difficilement supportable.
On retrouve comme souvent avec les personnages qu'imagine Tim Willocks, des caractéristiques qui lui ressemblent. Dans sa bio, on lit qu'il est chirurgien et psychiatre de formation, par exemple, ou encore qu'il est ceinture noire de karaté. Autant de compétences qui apparaissent, en particulier chez Turner, dont le calme glacial et les techniques de combat rappelle les disciplines martiales.
Un dernier mot sur le titre du roman, qui a apparemment changé au dernier moment. Les premiers services presse portaient semble-t-il le titre "l'Affrontement", mais lors de la mise en vente, c'est "La Mort selon Turner" qui apparaissait sur la couverture. Laissons ces questions éditoriales, c'est plus le titre original qui nous intéresse : "Memo from Turner".
Ce mémo, on le découvre dès le prologue du livre, avec des éléments contextuels qui plantent immédiatement le décor. On en découvrira l'intégralité bien plus loin, mais surtout on comprendra toute l'importance de ce message (dont j'ai extrait la phrase de titre de ce billet). C'est d'ailleurs assez amusant de voir comment, à travers ce mémo, Willocks introduit des éléments de modernité dans son univers de western apparemment très traditionnel.
Mais, si je parle de ce titre, c'est parce qu'il y a derrière une référence que je n'imagine pas être un hasard. "Memo from Turner" est le titre d'une chanson, enregistrée en 1970 par Mick Jagger, sans les Rolling Stones, mais avec Ry Cooder, pour la BO du film "Performance". Pour la petite histoire, le texte de la chanson fait référence à un roman de William Burroughs, "la Machine molle"... Eh ouais, on en apprend des choses, par ici !







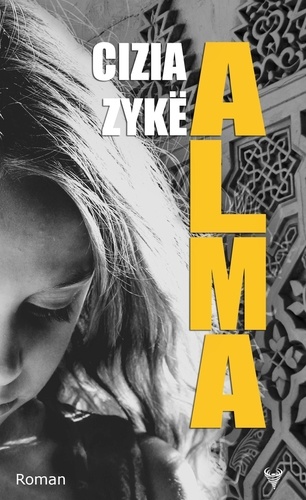

%2C_from_Los_Caprichos_-_Google_Art_Project.jpg/800px-Francisco_Jos%C3%A9_de_Goya_y_Lucientes_-_The_sleep_of_reason_produces_monsters_(No._43)%2C_from_Los_Caprichos_-_Google_Art_Project.jpg)