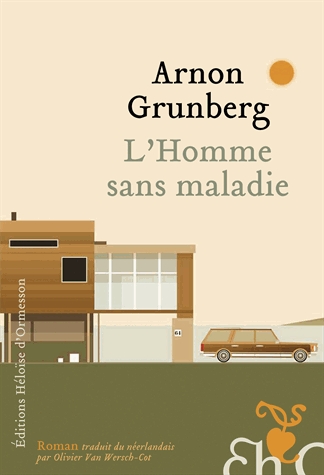Il est très rare sur ce blog que le titre du livre apparaisse dans le titre du billet qui lui est consacré. De mémoire, c'est la deuxième fois, même si, dans le cas présent, c'est la citation extraite du livre qui contient son titre... Suis-je clair ? Mais il y a une raison à ce choix : cette citation montre parfaitement la totale absurdité qui règne dans cette histoire. Arnon Grunberg, auteur néerlandais installé à New York, est un habitué du genre, mais ici, il se frotte à une actualité très complexe dont, hélas, on constate tous les jours qu'elle truste la une de l'actualité. En emmenant son personnage dans le Golfe Persique, épicentre de bien des séismes géopolitiques actuels, Arnon Grunberg signe une fable d'un terrible cynisme, une histoire qui m'a fait rire autant qu'elle m'a mis mal à l'aise. Mais, surtout, "L'homme sans maladie", que publient les éditions Héloïse d'Ormesson, rappelle les grandes oeuvres d'un auteur désormais considéré comme un classique : Franz Kafka.
Sam est né d'un père indien et d'une mère suisse. Son père est décédé dans un accident en montage, sa mère se consacre à Aida, la soeur de Sam, qui souffre d'une terrible maladie génétique. Et puis, il y a Nina, son amie, comme il dit, sa compagne, comprend-on. Sam a plutôt réussi. Formé auprès des meilleurs architectes, il a ouvert son propre cabinet, avec un associé, Dave, originaire d'Australie, mais qui a lui aussi céder au charme d'une Suissesse.
Un jour, Sam postule pour un concours. L'objectif : obtenir un contrat qui, au-delà de l'aspect financier, représente quelque chose de fort aux yeux de l'architecte, parce qu'il s'agit de construire un nouvel opéra à Badgad. L'homme qui a pris contact avec lui a évoqué Puccini, l'émotion, l'opéra accompagnant la renaissance d'une ville en ruines... Sam est conquis.
Il décide de partir, sans Dave qui n'est pas très chaud pour y aller et qui est jeune papa. Il laisse derrière lui sa mère et sa soeur, qui, elle, aurait bien voulu partir avec lui. Et en route pour l'aventure ! Mais, rien ne va vraiment se passer comme prévu, dès l'arrivée, dans un aéroport qui n'est pas celui de Bagdad. Ensuite, il est pris en charge par des inconnus et se retrouve dans une maison, sans explication, sans planning, sans rien...
Pendant ces journées-là, il assiste à des événements, de visu ou à la télévision, qu'il ne comprend pas mais que ne lui disent rien qui vaille... Jusqu'au jour où il se retrouve seul dans cette maison. Tous les autres ont disparu, lui est là, en plein Irak, abandonné, sans aucune idée de comment il va se sortir de là, retrouver Bagdad, son commanditaire ou même la Suisse.
Alors qu'il essaye de repartir, le taxi dans lequel il circule fait l'objet d'un contrôle routier. Mais le passeport de Sam a disparu en même temps que ses mystérieux hôtes et l'architecte est embarqué, mis au secret et bientôt torturé. Avec un raffinement et une créativité, si je puis dire, qui confinent à l'art... Encore une fois, il ne comprend rien à ce qui se passe, plaide la bonne foi, explique qu'il est Suisse, architecte, venu pour construire un opéra...
Rien n'y fait. Autant pisser dans un violon... Et en plus, le violon, c'est lui... Sam morfle pendant ces jours atroces, il est psychologiquement démoli par les mauvais traitements. Il est au bord de la folie, incapable d'avouer quoi que ce soit, tant il est abasourdi par ce qui lui arrive. Jusqu'à ce qu'enfin, on se préoccupe de lui. Mais, l'homme de la Croix-Rouge qui le sort de sa geôle le culpabilise aussitôt au lieu de le rassurer...
S'ensuit un dur retour à la vie. Ce qu'a vécu Sam, il est le seul à pouvoir le comprendre et il ne peut guère dire l'indicible. Oui, sa vie change sensiblement, particulièrement sa relation avec Nina, qui prend des tours inattendus et, finalement, pas si désagréables, on dirait. Mais, il manque quelque chose à Sam. Et ce quelque chose, il sait ce que c'est et où le trouver. Et là encore...
Je n'en dis pas plus sur l'histoire, même si, je vous le dis d'avance, nous seront obligés de lever un tout petit peu, promis, craché, juré, le voile sur ce qui se passe dans la troisième partie de "L'homme sans maladie". Vous pouvez en tout cas constater que, ainsi raconté, ce roman n'a pas les allures d'un livre entraînant une franche rigolade.
Et pourtant, et c'est tout le talent, toute la force d'Arnon Grunberg, j'ai beaucoup ri en lisant ce roman. Pas à gorge déployée, n'exagérons pas, mais le décalage des situations, les postures de Sam, toujours à contre-temps, largués, tellement naïf qu'il en devient par moment touchant, à d'autres ridicule. Il y a un côté clown triste chez ce garçon qui ne m'a pas laissé indifférent.
Alors, du cynisme ? Oui, il serait injuste de ne pas évoquer cette propension chez Arnon Grunberg. Il l'est évidemment, dans le regard qu'il pose sur le monde et dans la façon dont il exploite cette vision. Blindage de celui qui a connu le terrible et fascinant métier de reporter de guerre ? Arme de destruction massive contre le désespoir ? L'un comme l'autre sont fort possibles...
Ici, le cap est clairement mis sur le Moyen-Orient et même, le Golfe Persique. Berceau d'humanité aujourd'hui partagé entre guerres interminables, théocraties plus ou moins sournoises et incommensurables fortunes pétrolières, épicentre de bien des conflits planétaires et objet d'inquiétudes grandissantes...
L'Irak, d'abord. Pays martyr, rasé pour être reconstruit et qui reste aujourd'hui une zone grise. Les récentes actualités montrent à quel point l'intervention de 2003 a fait tomber le pays de Charybde en Sylla, remplaçant une épouvantable dictature par d'autres maux qui pourraient s'avérer bien pire à terme. C'est là que Sam s'imagine construire un opéra...
Puisqu'on va parler d'absurde, dans ce billet, n'est-ce pas là un de ses manifestations les plus éclatantes ? Un opéra à Bagdad, là où les seuls concerts auxquels on est habitué depuis plus de 10 ans, sont ceux des explosions... Puccini ? Madame Butterfly avec un beau GI rentrant au pays, allons donc, quelle vaste blague !
Car, dans cet Irak-là (plus vrai que nature ?), on est vite perdu. Personne, à commencer par Sam, ne sait qui est qui. Et ne vous fiez même pas au sempiternel clivage gentils/méchants, il est totalement inopérant, faute de repères, de valeurs viables, de signes de reconnaissance. Tenez, par qui Sam est-il torturé ? Mais on n'en sait rien ! Jamais !!
Ce garçon si posé, si calme va se retrouver dans ce capharnaüm comme un chien dans un jeu de quilles, bringuebalé de groupes en groupes, sans savoir qui l'a pris en charge, qui l'a récupéré, qui l'a repris, ni même qui l'a fait venir. Est-il tombé dans un piège et, si oui, de quelle nature ? Tout cela, personne ne peut le dire...
Et puisqu'on parle de Sam, restons-y. Il est donc "l'homme sans maladie". Là encore, plusieurs dimensions à cette expression, puisque c'est lui qui évoque ce fait en tout début de livre, puis, bien plus tard, elle va revenir dans un contexte qui vous reste à découvrir. Le credo de Sam : je suis Suisse, je suis neutre, je suis architecte.
En toute circonstance, c'est ce qu'il répète. Inlassablement, jusque dans les pires moments, quand tout le monde avouerait n'importe quoi. Mais que peut-il dire d'autre ? C'est profondément lui, même si, aux yeux de ses tortionnaires, c'est sans doute impossible. Car, effectivement, il est tout ça, mais pas seulement.
Est-on neutre, dans ce XXIe siècle rempli de danger quand on est issu d'une double culture ? Est-on neutre quand on est Européen ? Est-on neutre quand on fait passer l'espoir de culture avant les basses manigances politiques et la soif de pouvoir ? Est-on neutre quand on est, finalement, un idéaliste et un doux rêveur ?
Cela, c'est pour les apparences. Mais voyons au-delà. Malgré ce portrait plutôt sympathique que je viens de faire de lui, Sam est plus complexe. D'abord, parce qu'il lui manque singulièrement quelque chose : l'émotion. Plus lisse que Sam, difficile de trouver. Une pierre, du marbre, ce garçon. Jamais de moment d'abandon, enfin si, mais dans des situations intimes d'une glauquerie sans nom...
Sam n'a aucune émotion, qu'il soit en présence de sa mère, de sa soeur, de Nina, de ses amis, collègues, pas plus que dans des bâtiments anonymes, des cellules immondes, des salles de torture sordides... Où qu'on le voit évoluer, toute émotion semble glisser sur lui, de la plus passionnée à la plus révoltée.
Mais ne croyez pas qu'autour de lui, ce soit mieux. L'empathie est quasiment absente de ce roman. Tous les personnages sont égocentrés, jusqu'à la soeur, pardonnez-moi, je suis sans doute plus ignoble encore, dont la dernière intervention, terrible, m'a fait éclaté de rire. Quoi qu'il arrive à Sam, cela ne provoque qu'un ahurissant fatalisme, une résignation inexpugnable qui, vus par le lecteur, font tout de même passer un frisson le long de l'échine.
La dernière partie du roman, que j'ai lue sans pouvoir effacer le sourire imprimé sur mon visage (oui, je suis un monstre !), m'a rappelé de façon criante "le procès", de Kafka. Toutes proportions gardées, Sam, c'est un Joseph K. du XXIe siècle, en proie à l'absurdité de son temps, à la folie du monde dans lequel il vit mais ne trouve pas vraiment sa place.
J'ai failli appeler ce billet "Kafka sur le rivage du Golfe Persique", en clin d'oeil à l'oeuvre de Haruki Murakami, mais c'était peut-être pousser le bouchon un peu loin. La différence, signe des temps, entre Kafka et Grunberg, c'est qu'on rit peu en lisant Kafka. Même avec mon esprit tordu, c'est dire. En revanche, on retrouve cette implacable mécanique à broyer l'innocent dans l'indifférence générale.
J'ai parlé de piège, tout à l'heure. Mais c'est bien pire que ça. Car, finalement, tout se tient, Sam a le profil parfait de l'espion qu'on lui reproche d'être, les preuves, mêmes indirectes, sont incontestables, l'agencement des événements est impossible à prévoir, encore moins à maîtriser, Un piège, c'est mécanique, orchestré. Or, ce que vit Sam est bien pire : c'est le destin en marche.
Un dernier point, là aussi brièvement abordé plus haut. Il concerne la culture et sa place dans ce monde froid et impitoyable. Elle devient un outil de pouvoir et de puissance et plus un outil de beauté. Elle est instrumentalisée à des fins qui n'ont finalement plus grand chose de culturelle. Mais, et là, il me faut dire un mot de la partie du roman que je n'ai pas du tout explicitée.
Sam y a un autre projet, gigantesque, faramineux, non, pharaonique, voilà le mot juste. Et l'on voit comment ce bassin méditerranée qui, au fil des siècles, a perdu de son influence, serait en train de la retrouver, de revenir un pôle, un centre. Il y a dans ce projet, comme le rappel d'une merveille du monde revenue du néant.
Et, derrière ce projet indéniablement remarquable s'il se concrétisait, l'étouffante impression d'une prise de contrôle, d'une centralisation de tout pour pouvoir posséder, imposer, gouverner, diriger. Oui, j'a beaucoup ri et souri en lisant "l'homme sans maladie", d'Arnon Grunberg, mais c'est aussi un rire jaune, empli d'inquiétude pour l'avenir.
Et les événements que nous voyons se produire ces derniers jours, ces dernières semaines, ne sont vraiment, mais alors vraiment pas faits du tout pour me rassurer. Publié en 2012 dans sa version originale, ce nouveau roman d'Arnon Grunberg sort dans un contexte qui le fera sans doute résonner très cruellement à vos oreilles, comme ce fut le cas aux miennes...
"Il va falloir un jour qu'enfin je me décide à lire les livres que, depuis trente ans, je conseille à mes amis de lire". (Sacha Guitry)
mardi 30 septembre 2014
mardi 23 septembre 2014
"Tu ne le sais pas encore, mais si tu sors de là indemne, tu banderas tellement que tu recommenceras".
Il y a des coïncidences, des hasards, choisissez le mot qui vous convient, qui rendent certaines journées intéressantes... Ce matin, alors que j'avais déjà décidé de vous parler de notre livre du jour, je découvre que son auteur, Jérémie Guez, venait de recevoir le Prix Historia dans la catégorie roman policier pour "le dernier tigre rouge" (en poche chez 10/18, il faudra qu'on en parle un jour, tiens, je l'aperçois pas loin de moi...). J'avais envie de retrouver l'écriture et la force d'évocation que possède ce jeune auteur après avoir dévoré en une matinée l'an passé "Balancé dans les cordes". Alors, nous y voilà, avec une nouvelle évocation de Paris, brillante et violente, mais aussi un roman marqué par un désespoir profond et l'annonce inéluctable d'un drame, quel qu'il soit... "Paris la nuit", publié avant "Balancé dans les cordes", disponible en poche chez J'ai Lu, est le premier volet d'un triptyque où la capitale joue un rôle majeur.
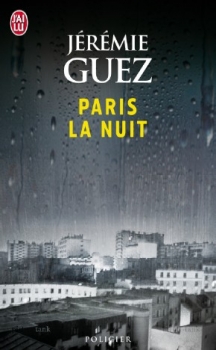
Abraham est un garçon livré à lui-même. Sa mère est morte, son père passe sa journée vautré devant la télévision et le contact avec lui est quasiment rompu. Alors, quand il n'est pas dans sa chambre, Abraham zone autour de chez lui, vers Barbès. Pour se faire de l'argent de poche, il deal un peu, mais il ne veut pas en faire une profession.
Abraham a un ami inséparable, Goran. Deux frères, vraiment, ils se connaissent par coeur, partagent tout, n'ont aucun secret l'un pour l'autre. Ils ne sont pas sans cesse collés l'un à l'autre, non, chacun vit sa vie de son côté, mais ils finissent toujours pas se retrouver pour partager un moment, un délire, un peu d'herbe...
Tellement proche que c'est à la vie, à la mort. Quand l'un est agressé, l'autre le défend. Peu importent les conséquences d'une baston, les coups, les flics, la garde à vue. De toute façon, Abraham fait ce qu'il veut, son père s'en fout, même s'il découche, le vieux ne se rend compte de rien. Ou s'en moque. Goran est vraiment ce qui ressemble le plus à une famille pour le jeune homme, désormais.
La plupart du temps, Abraham vit dans ce quartier qu'il considère comme le sien, en y mettant une notion de propriété et surtout une immense fierté. Abraham ne supporte pas qu'on vienne marcher sur ses terres, Barbès est aux habitants de Barbès. C'est un royaume dont il voudrait être roi. Enfin, non, il faudrait en avoir l'ambition. Il est juste comme un poisson dans l'eau.
Lorsqu'il quitte le quartier, qu'il traverse la Seine et passe sur l'autre rive, celle des riches, des privilégiés, des nantis, il se sent perdu, étranger. Mais il y va car c'est là que se trouve la jeune femme qu'il aime. Julia est étudiante, vit dans le Quartier Latin, a son appartement. Elle est tout ce que n'est pas Abraham, mais il entretien avec elle une relation satisfaisante.
Un jour, Abraham s'arrête dans un bar de Belleville, avec un pote, Nathan. Il remarque un remue-ménage qui l'intrigue dans l'arrière-boutique. Renseignements pris, on y joue d'assez grosses sommes d'argent au poker, en toute discrétion, certaines nuits. Soudain, germe l'idée de braquer les joueurs. Non seulement, cela semble assez simple à faire, mais en plus, quasiment sans danger.
Aussitôt dit, aussitôt fait, Goran et Nathan sont de la partie, évidemment, ainsi que deux autres garçons de leur connaissance, l'un qui fournira la quincaillerie nécessaire à la réalisation du coup, l'autre qui fera le chauffeur. Mais Nathan prévient Abraham qu'il s'approche d'un engrenage bien dangereux. La phrase qui sert de titre à ce billet est son avertissement.
Arrive le casse et... tout change. Plus question de traîner ensemble, de toute façon, on se fait discret, on rase les murs. Ils ont pris leurs précautions, mais lorsqu'on a détroussé des truands, on sait qu'ils n'en resteront pas là. Alors, objectif discrétion la plus totale, pas de signes extérieurs de richesse brusquement affichés, départ en province ou ailleurs pendant un certain temps.
Sauf qu'en dehors de son quartier, Abraham ne peut pas vivre. Alors, il reste, change de vie. Non, change tout court. Une véritable métamorphose, comme si son côté sombre s'était emparé de son âme dès la sortie du bar. Abraham n'est plus Abraham, il est devenu un autre homme, hanté, mais pas par la peur. En tout cas, ce n'est pas l'impression que j'ai eue, même si elle est forcément là.
Non, j'ai ressenti un immense dégoût. Pas du tout l'érection promise par Nathan et le besoin de ressentir à nouveau les mêmes émotions, la même montée d'adrénaline, le même pied lorsqu'on a le pognon en main et qu'on a réussit le braquo... Abraham est dans une sorte de dépression profonde qui le pousse à s'auto-détruire.
Mais pas physiquement, même s'il va là aussi changer son comportement. Non, c'est son univers entier qu'il entreprend consciencieusement de démolir. Les "armes" employées diffèrent selon les situations, mais il n'y va pas de main morte, rejette tout ce qu'il était et devient tout ce qu'il avait toujours voulu éviter de devenir jusque-là.
Abraham se fustige. "Ca ne sert à rien de courir, je suis mon propre mal", dit-il. Avant même le casse, d'ailleurs, il avait confiance du mal qu'il ferait autour de lui en se lançant dans cette histoire, mais ce qui s'en suit, jusqu'au drame final, inexorable, va sans doute dépasser encore ses craintes initiales. Abraham, en imaginant ce coup, presque comme on se lance un défi, va récolter une tempête terrible.
Devenu une sorte de spectre maléfique, Abraham hante ce Paris nocturne qui est son écosystème naturel. Mais il est devenu un prédateur dans ce paysage qui change tellement vite, le temps de passer au-dessus d'un fleuve, de franchir un point, de mettre le pied sur une autre rive. La terre brûlée aussi doit toucher ce Paris qui n'est pas le sien, qui n'est pas Paris.
Le Paris populaire opposé au Paris des riches, des lumières, des touristes. Ce Paris de toc et de strass, de faux-semblants et d'illusions, de paraître sans être, de branleurs et de fils à papa qui n'ont rien à craindre de leur existence forcément confortable, sans risque, sans précarité. Son Paris n'est pas celui des spots qui illuminent les monuments, mais celui de l'ombre, de la nuit, de la noirceur dans laquelle on se fond, on disparaît.
Ce contraste dans le décor, comme si l'on passait d'un bout à l'autre d'un spectre lumineux m'a frappé, mais on le retrouve aussi dans l'évolution d'Abraham qui pourrait être un être lumineux mais va choisir de s'enfoncer dans les ténèbres. Ou de devenir un trou noir qui attire toute matière alentour dans son vide éternel...
Curieusement, plus j'avançais à la rencontre d'Abraham et plus je pensais à un autre personnage croisé récemment : Fitz, le dealer loser créé par Olivier Gay et qui écume lui aussi les nuits parisiennes pour refourguer sa dope. Comment cette étrange association d'idées a-t-elle pu se former dans mon esprit tordu ?
Abraham et Fitz, tout les sépare, leurs origines sociales, leur univers, leur philosophie de vie, la manière dont ils envisagent le deal et même leur relation au danger (qui n'est certes pas de la même nature, ne soyons pas de mauvaise foi). Et pourtant, ils se rejoignent dans ce Paris nocturne qu'ils arpentent, dans les choix de vie qu'ils ont fait, dans leur renoncement.
L'obscurité de Jérémis Guez, la noirceur terrible de ses histoires, des destins qu'il trace, contraste avec la nonchalance de Fitz et son côté beau gosse, séducteur, dilettante professionnel. Mais derrière son cynisme de dandy, il y a aussi un abîme profond et sombre. La différence, c'est simplement la façon qu'ont les deux de vivre leur propre noirceur.
Cessons ce parallèle, revenons à Jérémie Guez, puisque c'est à lui qu'est consacré ce billet. "Balancé dans les cordes" m'avait fait découvrir sa plume percutante, si vous permettez ce jeu de mots en parlant d'un roman dans lequel la boxe tient une place importante. J'ai retrouvé ici toute cette force des mots et des situations.
On ne mâche pas ses mots, chez Guez, on ne s'embarque pas dans des longues digressions, on va à l'essentiel, des directs au plexus solaire qui sonnent et laissent KO. Court roman, à peine plus de 120 pages, "Paris la nuit" se lit d'une traite, emportant le lecteur dans cette descente aux enfers. Jusqu'où faudra-t-il que tombe Abraham ?
Que lui manque-t-il pour éviter ce chaos ? Une vie. Là encore, c'est mon ressenti. Abraham, jeune adulte, n'a aucune perspective. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, qu'il ne pourrait pas s'en sortir dans l'existence comme tout un chacun, avec un job, une vie peinarde dans un chemin qu'on dit droit.
Mais non, il est abandonné des dieux, Abraham. Les fées ont oublié de se pencher sur son berceau. En tout cas, c'est ce qu'il s'est mis en tête. Sa vie est minable. Le braquage, c'est peut-être un moyen de se prouver quelque chose, de s'étalonner, ou alors, c'est une fuite en avant. Oh, pas pour bander rien qu'à l'idée de recommencer, non, mais pour se projeter dans la spirale infernale dont il sait qu'il ne sortira pas.
Je ne sais pas, encore une fois, c'est ma lecture du roman de Jérémie Guez, je ne prétends pas détenir la vérité dessus. Il y a tant de désespoir dans les univers de Guez, on y est enfermé même à l'air libre. Lorsqu'on cherche à en sortir, c'est comme si une chaîne à la cheville l'empêchait, comme si un élastique ramenait au bercail, celui qu'on ne quitte jamais.
La fatalité sociale qui a fait naître sur la mauvaise rive de la Seine, avec un minimum de chances de se tirer de là une bonne fois pour toutes. La lumière d'espoir luit parfois au bout du tunnel mais elle est si lointaine et il y a tant d'obstacles avant de pouvoir y parvenir qu'on se décourage forcément, qu'on s'enracine malgré soi...
Alors oui, les romans de Jérémis Guez sont noirs, plus noirs que les nuits parisiennes, peu importe le quartier. Mais justement, c'est peut-être ça la clé : l'irrésistible attraction de cette ville qui ne fait pas de cadeaux et qui s'insinue par chaque pore de la peau pour posséder ceux qui y naissent, y vivent. Oui, c'est certain, c'est ce Paris qui envoûte et emprisonne les siens qui est au coeur de ce triptyque.
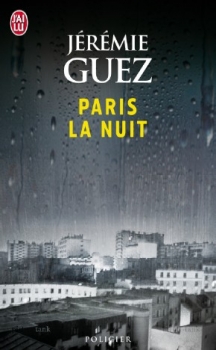
Abraham est un garçon livré à lui-même. Sa mère est morte, son père passe sa journée vautré devant la télévision et le contact avec lui est quasiment rompu. Alors, quand il n'est pas dans sa chambre, Abraham zone autour de chez lui, vers Barbès. Pour se faire de l'argent de poche, il deal un peu, mais il ne veut pas en faire une profession.
Abraham a un ami inséparable, Goran. Deux frères, vraiment, ils se connaissent par coeur, partagent tout, n'ont aucun secret l'un pour l'autre. Ils ne sont pas sans cesse collés l'un à l'autre, non, chacun vit sa vie de son côté, mais ils finissent toujours pas se retrouver pour partager un moment, un délire, un peu d'herbe...
Tellement proche que c'est à la vie, à la mort. Quand l'un est agressé, l'autre le défend. Peu importent les conséquences d'une baston, les coups, les flics, la garde à vue. De toute façon, Abraham fait ce qu'il veut, son père s'en fout, même s'il découche, le vieux ne se rend compte de rien. Ou s'en moque. Goran est vraiment ce qui ressemble le plus à une famille pour le jeune homme, désormais.
La plupart du temps, Abraham vit dans ce quartier qu'il considère comme le sien, en y mettant une notion de propriété et surtout une immense fierté. Abraham ne supporte pas qu'on vienne marcher sur ses terres, Barbès est aux habitants de Barbès. C'est un royaume dont il voudrait être roi. Enfin, non, il faudrait en avoir l'ambition. Il est juste comme un poisson dans l'eau.
Lorsqu'il quitte le quartier, qu'il traverse la Seine et passe sur l'autre rive, celle des riches, des privilégiés, des nantis, il se sent perdu, étranger. Mais il y va car c'est là que se trouve la jeune femme qu'il aime. Julia est étudiante, vit dans le Quartier Latin, a son appartement. Elle est tout ce que n'est pas Abraham, mais il entretien avec elle une relation satisfaisante.
Un jour, Abraham s'arrête dans un bar de Belleville, avec un pote, Nathan. Il remarque un remue-ménage qui l'intrigue dans l'arrière-boutique. Renseignements pris, on y joue d'assez grosses sommes d'argent au poker, en toute discrétion, certaines nuits. Soudain, germe l'idée de braquer les joueurs. Non seulement, cela semble assez simple à faire, mais en plus, quasiment sans danger.
Aussitôt dit, aussitôt fait, Goran et Nathan sont de la partie, évidemment, ainsi que deux autres garçons de leur connaissance, l'un qui fournira la quincaillerie nécessaire à la réalisation du coup, l'autre qui fera le chauffeur. Mais Nathan prévient Abraham qu'il s'approche d'un engrenage bien dangereux. La phrase qui sert de titre à ce billet est son avertissement.
Arrive le casse et... tout change. Plus question de traîner ensemble, de toute façon, on se fait discret, on rase les murs. Ils ont pris leurs précautions, mais lorsqu'on a détroussé des truands, on sait qu'ils n'en resteront pas là. Alors, objectif discrétion la plus totale, pas de signes extérieurs de richesse brusquement affichés, départ en province ou ailleurs pendant un certain temps.
Sauf qu'en dehors de son quartier, Abraham ne peut pas vivre. Alors, il reste, change de vie. Non, change tout court. Une véritable métamorphose, comme si son côté sombre s'était emparé de son âme dès la sortie du bar. Abraham n'est plus Abraham, il est devenu un autre homme, hanté, mais pas par la peur. En tout cas, ce n'est pas l'impression que j'ai eue, même si elle est forcément là.
Non, j'ai ressenti un immense dégoût. Pas du tout l'érection promise par Nathan et le besoin de ressentir à nouveau les mêmes émotions, la même montée d'adrénaline, le même pied lorsqu'on a le pognon en main et qu'on a réussit le braquo... Abraham est dans une sorte de dépression profonde qui le pousse à s'auto-détruire.
Mais pas physiquement, même s'il va là aussi changer son comportement. Non, c'est son univers entier qu'il entreprend consciencieusement de démolir. Les "armes" employées diffèrent selon les situations, mais il n'y va pas de main morte, rejette tout ce qu'il était et devient tout ce qu'il avait toujours voulu éviter de devenir jusque-là.
Abraham se fustige. "Ca ne sert à rien de courir, je suis mon propre mal", dit-il. Avant même le casse, d'ailleurs, il avait confiance du mal qu'il ferait autour de lui en se lançant dans cette histoire, mais ce qui s'en suit, jusqu'au drame final, inexorable, va sans doute dépasser encore ses craintes initiales. Abraham, en imaginant ce coup, presque comme on se lance un défi, va récolter une tempête terrible.
Devenu une sorte de spectre maléfique, Abraham hante ce Paris nocturne qui est son écosystème naturel. Mais il est devenu un prédateur dans ce paysage qui change tellement vite, le temps de passer au-dessus d'un fleuve, de franchir un point, de mettre le pied sur une autre rive. La terre brûlée aussi doit toucher ce Paris qui n'est pas le sien, qui n'est pas Paris.
Le Paris populaire opposé au Paris des riches, des lumières, des touristes. Ce Paris de toc et de strass, de faux-semblants et d'illusions, de paraître sans être, de branleurs et de fils à papa qui n'ont rien à craindre de leur existence forcément confortable, sans risque, sans précarité. Son Paris n'est pas celui des spots qui illuminent les monuments, mais celui de l'ombre, de la nuit, de la noirceur dans laquelle on se fond, on disparaît.
Ce contraste dans le décor, comme si l'on passait d'un bout à l'autre d'un spectre lumineux m'a frappé, mais on le retrouve aussi dans l'évolution d'Abraham qui pourrait être un être lumineux mais va choisir de s'enfoncer dans les ténèbres. Ou de devenir un trou noir qui attire toute matière alentour dans son vide éternel...
Curieusement, plus j'avançais à la rencontre d'Abraham et plus je pensais à un autre personnage croisé récemment : Fitz, le dealer loser créé par Olivier Gay et qui écume lui aussi les nuits parisiennes pour refourguer sa dope. Comment cette étrange association d'idées a-t-elle pu se former dans mon esprit tordu ?
Abraham et Fitz, tout les sépare, leurs origines sociales, leur univers, leur philosophie de vie, la manière dont ils envisagent le deal et même leur relation au danger (qui n'est certes pas de la même nature, ne soyons pas de mauvaise foi). Et pourtant, ils se rejoignent dans ce Paris nocturne qu'ils arpentent, dans les choix de vie qu'ils ont fait, dans leur renoncement.
L'obscurité de Jérémis Guez, la noirceur terrible de ses histoires, des destins qu'il trace, contraste avec la nonchalance de Fitz et son côté beau gosse, séducteur, dilettante professionnel. Mais derrière son cynisme de dandy, il y a aussi un abîme profond et sombre. La différence, c'est simplement la façon qu'ont les deux de vivre leur propre noirceur.
Cessons ce parallèle, revenons à Jérémie Guez, puisque c'est à lui qu'est consacré ce billet. "Balancé dans les cordes" m'avait fait découvrir sa plume percutante, si vous permettez ce jeu de mots en parlant d'un roman dans lequel la boxe tient une place importante. J'ai retrouvé ici toute cette force des mots et des situations.
On ne mâche pas ses mots, chez Guez, on ne s'embarque pas dans des longues digressions, on va à l'essentiel, des directs au plexus solaire qui sonnent et laissent KO. Court roman, à peine plus de 120 pages, "Paris la nuit" se lit d'une traite, emportant le lecteur dans cette descente aux enfers. Jusqu'où faudra-t-il que tombe Abraham ?
Que lui manque-t-il pour éviter ce chaos ? Une vie. Là encore, c'est mon ressenti. Abraham, jeune adulte, n'a aucune perspective. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, qu'il ne pourrait pas s'en sortir dans l'existence comme tout un chacun, avec un job, une vie peinarde dans un chemin qu'on dit droit.
Mais non, il est abandonné des dieux, Abraham. Les fées ont oublié de se pencher sur son berceau. En tout cas, c'est ce qu'il s'est mis en tête. Sa vie est minable. Le braquage, c'est peut-être un moyen de se prouver quelque chose, de s'étalonner, ou alors, c'est une fuite en avant. Oh, pas pour bander rien qu'à l'idée de recommencer, non, mais pour se projeter dans la spirale infernale dont il sait qu'il ne sortira pas.
Je ne sais pas, encore une fois, c'est ma lecture du roman de Jérémie Guez, je ne prétends pas détenir la vérité dessus. Il y a tant de désespoir dans les univers de Guez, on y est enfermé même à l'air libre. Lorsqu'on cherche à en sortir, c'est comme si une chaîne à la cheville l'empêchait, comme si un élastique ramenait au bercail, celui qu'on ne quitte jamais.
La fatalité sociale qui a fait naître sur la mauvaise rive de la Seine, avec un minimum de chances de se tirer de là une bonne fois pour toutes. La lumière d'espoir luit parfois au bout du tunnel mais elle est si lointaine et il y a tant d'obstacles avant de pouvoir y parvenir qu'on se décourage forcément, qu'on s'enracine malgré soi...
Alors oui, les romans de Jérémis Guez sont noirs, plus noirs que les nuits parisiennes, peu importe le quartier. Mais justement, c'est peut-être ça la clé : l'irrésistible attraction de cette ville qui ne fait pas de cadeaux et qui s'insinue par chaque pore de la peau pour posséder ceux qui y naissent, y vivent. Oui, c'est certain, c'est ce Paris qui envoûte et emprisonne les siens qui est au coeur de ce triptyque.
"Jamais un homme n'aura renoncé à autant de choses que toi pour la religion !"
"Je suis un sournois". Ce n'est pas moi qui parle (quoi que...), mais c'est le titre français de notre roman du jour. Un livre paru dans la mythique Série Noire, signé par Peter Duncan (on n'est pas certain de qui se cache sous ce pseudonyme, d'ailleurs). Un roman fidèle à la ligne de cette légendaire collection, en mêlant noirceur, cynisme, dénonciation des travers de la société, mais aussi quelques petits trucs en plus dont je ne vais pas vous parler là, maintenant, dans le préambule, quand même ! Sinon, vous ne voudrez pas lire la suite ! Alors, patientez un peu, je vais tout vous expliquer. Et aussi, pourquoi ce roman sort maintenant en poche chez Folio Policier. Parce que, en regardant d'un peu plus près, ça pourrait surprendre...

Mais qui est donc Buck Peters ? Pour vous répondre simplement, il est le chef de la police de Greenhill, ville du sud des Etats-Unis, je suppute un peu, mais il y a un fleuve tout près et on circule pas mal en bateau... Mais ce n'est pas notre sujet principal. Non, Buck Peters est un garçon qui a tout du gendre idéal.
28 ans, grand, beau et fort. Star de football américain dans son école, il aurait parfaitement pu passer professionnel et faire une brillante carrière sportive. Brillante et rémunératrice... Au lieu de ça, il a préféré rester dans son bled et devenir chef de la police, avec un salaire modeste, des pouvoirs assez réduits et une marge de progression quasiment nulle.
A tel point que certains, à Greenhill, le prennent un peu pour un simplet, un idiot qui n'a rien compris. Il faut dire qu'en plus de tout cela, Buck Peters est un vrai bigot. Elevé par une mère qui l'adore en bon chrétien, il est devenu marguillier dans sa paroisse. Autrement dit, il est un des laïques qui encadrent la petite communauté.
Sa réputation est sans tache, un saint, si l'on en croit sa mère et les vieilles dames de Greenhill, qui je jurent que par Buck, une belle andouille, pour les hommes qui voient dans ce grand dadais confit en dévotion un brave gars sans cervelle. Malgré son uniforme, son poste à la tête de la police et ce rôle au sein de la paroisse, on ne le prend pas vraiment au sérieux.
Mais alors, qui est donc Buck Peters, narrateur du roman ? Eh bien, la réponse est dans le titre français de ce livre. Buck Peters cache bien son jeu. Attention, ne vous méprenez pas, tout ce que je viens de vous dire de lui est vrai, on n'a pas un méchant garçon qui cache sous des dehors un peu benêt un ignoble tueur en série.
Non, il est sincère dans sa foi, dans ses choix de vie... Mais c'est un sacré cachottier ! D'une part, il connaît une multitude de vilains petits secrets que cachent les uns et les autres à Greenhill ; d'autre part, il a lui-même des choses à cacher et réussit depuis des années, douze, pour être précis, à mener une double vie sans que personne ne se doute de rien.
Le célibataire le plus endurci de Greenhill n'est pas du tout le petit saint abstinent que tout le monde croit. Il fait même cocu l'un des personnages les plus importants de la ville, Kip Belton, qui se trouve par ailleurs être son supérieur dans la police de la ville. Et celle qui partage ces moments, Lacey, est la femme de sa vie depuis toujours.
Elle s'est mariée à un autre ? Oui, c'est vrai. Mais ensemble, Lacey et Buck ont passé un pacte implicite à travers lequel ils ourdissent une sombre vengeance. Et le rôle de composition que tient Buck à Greenhill n'est que la partie visible de cet iceberg. En attendant le moment propice pour que cette vengeance s'accomplisse, Buck s'accommode de son rôle public et de sa relation clandestine.
Et puis, Rita Singleton est retrouvée morte par balles...
Au-delà de l'événement aussi horrible qu'inédit que cela représente pour toute la ville de Greenhill, voilà une histoire qui va compliquer la situation. Suicide ? Possible, quoi qu'on puisse plutôt penser à un meurtre, vu le nombre de balles tirées... Et surtout, c'est toute la gent masculine, à l'exception de Buck, que tout le monde croit puceau, qui peut être soupçonné. A moins qu'une femme jalouse, lassée de frasques de son cher et tendre...
Il faut dire que, à Greenhill, derrière le vernis de religiosité, les mâles ont deux faiblesses coupables : l'alcool, consommé sans modération, et Rita Singleton. La riche veuve la plus convoitée de la ville chez qui tout le monde essaye d'aller se consoler quand l'ivresse rend un peu plus nostalgique et triste ou, au contraire, désinhibe et rend beau et séduisant...
Alors oui, les suspects sont nombreux. Et tous véritablement crédible. Car Rita en savait elle aussi beaucoup sur ses prétendants... Mais, un se détache particulièrement de ce lot de braves gens bien sous tous rapports ou presque. Et il s'agit de Kip Belton, le mari de Lacey, l'homme dont Buck voudrait bien se venger.
Commence alors une enquête en bonne et due forme au cours de laquelle le chef de la police Peters doit encore donner le change, examiner les pistes et ne pas donner l'impression de trop se focaliser sur l'homme puissant. On connaît son béguin de jeunesse pour Lacey, ça pourrait jaser. Et puis, aussi bizarrement, l'enquête pourrait bien empêcher la vengeance de s'accomplir...
Au-delà de la série noire, du polar, de l'enquête, "Je suis un sournois" est en fait un véritable vaudeville avec un mari, une femme, un amant, la soeur du mari, l'affriolante Pert, 18 ans et déjà femme fatale qui ne rêve que de faire quitter au beau chef de la police le droit chemin, le maire, le médecin, les paroissiennes et tutti quanti...
Tout le monde tient les autres par la barbichette et essaye d'avancer ses propres pions pour tirer profit de ce qu'il sait. Mais le seul qui a l'ensemble du puzzle sous les yeux, c'est Buck, puisque lui connaît les petits secrets des uns et des autres. Et il va même pouvoir en jouer sans dévoiler son jeu, puisqu'il a récupéré le journal de Rita... Celui où elle a dû consigner tout ce qu'on lui a appris...
Quand je parle de vaudeville, c'est vraiment ça, des quiproquos, des portes qui claquent, des situations gênantes et inattendues et un final ! Je ne vous dis que ça ! Du Feydeau chez Fauklner, la troupe du Splendid chez Steinbeck ! Euh, bon, là, j'en fais quand même peut-être un peu beaucoup, mais je me suis énormément amusé en lisant ce roman.
Ah oui, j'ai oublié un élément : ça se passe à la fin des années 50. Attendez, je m'exprime mal : "Je suis un sournois" a été publié dans sa version originale en 1959 et l'année suivante par Gallimard dans la Série Noire. Oui, ce livre, que Folio SF vient de rééditer en poche a 55 ans ! Mais pourquoi exhumer cette Série Noire-là précisément, en cette année 2014 ?
Tout simplement parce que derrière le côté Série Noire et polar, "Je suis un sournois" dépeint les travers d'une Amérique qui planque sous sa bigoterie croissante tous ses maux, ses vices, ses tartuferies, ses hypocrisies. Cela concerne plus les petites villes que les mégapoles, bien sûr, ce qu'on peut appeler l'Amérique profonde, même si l'expression est franchement moche.
Ah, l'hypocrisie, thème éternel et universel ! Ici, il est particulièrement soignée dans une ville où la moitié masculine ment à qui mieux mieux, tandis que la moitié féminine comprend soit des séductrices invétérées, soit des grenouilles de bénitier. La vie est calme, il y a peu de tensions, parce que la hiérarchie est bien définie : les leaders, les suiveurs, ceux qui la ramènent et ceux qui s'écrasent.
Greenhill, c'est un petit bout d'Amérique, mais pas celui qui inspire un quelconque rêve américain. C'est étroit, mesquin, bas, mais peu importe, puisque "God bless America" et ses concitoyens ! Dieu est de son côté, alors on peut tout se permettre, la concupiscence, l'ivrognerie, pour les choses les plus évidentes, celles que tout le monde connaît et sur lesquelles on ferme les yeux.
Et puis, il y a tout ce qui se passe derrière les rideaux, les secrets d'alcôve ! On ne croirait pas, comme ça, en arrivant à Greenhill, paisible bourgade sans histoire, mais c'est Sodome et Gomorrhe ! Ou pas loin... Il s'en passe de belles et ce que nous raconte Buck est parfois hilarant, tant il y a de misère morale et de ridicule dans tout cela.
Quant à Buck, il aurait aujourd'hui plus de 80 ans. Et je ne serais pas surpris qu'il soutienne un tea-party... Il a tout à fait le profil d'un néo-conservateur, sûr de sa foi, sûr d'agir de son bon droit, sûr d'agir pour le bien de tous. Car, quoi qu'il fasse, même lorsqu'il pratique le chantage, grâce à tous les vilains petits secrets dont il est dépositaire, il le fait pour le bien général. Ou s'en persuade, en tout cas.
"Faire chanter quelqu'un pour lui soutirer de l'argent, c'est un péché ; le faire chanter pour sauver son âme, c'est un apostolat", voilà l'une des devises de Buck Peters. Au moins, ça a le mérite d'être clair ! Et, même si l'on peut trouver son histoire touchante, comprendre son envie de se venger, comme celle de Lacey, d'ailleurs, la manière dont il se donne bonne conscience malgré tout le renvoie au même niveau que tous les autres habitantes de Greenhill. Il est juste plus malin que la moyenne.
"Je suis sournois" est d'abord une Série Noire. Ce que je veux dire, c'est que ce livre risque de surprendre voire désarçonner les fans purs et durs de thriller et de polars. Le meurtre de Rita est plus un déclencheur qui décante une situation tombée dans la routine, l'enquête, elle, va mettre au jour tout ce que tout le monde à Greenhill croyait caché, et bien caché.
Ensuite, Peter Duncan joue, s'amuse avec ses marionnettes et les mets dans des situations délicates, les fait danser au bout de leurs fils et entrecroisent les secrets des uns et des autres pour semer une pagaille qui monte progressivement comme de l'eau qui bout dans une casserole. Et gare à tous, si ça déborde !
Le côté très théâtral de cette histoire m'a beaucoup amusé, également, et donne une vraie originalité à ce roman complètement amoral, ce qui n'est pas le moindre de ses paradoxes. Oui, Buck Peters est sournois, mais il n'est sûrement pas le seul à l'être à Greenhill. Je n'ose même pas imaginer l'ambiance qui régnerait à Greenhill après tout cela... Les cadavres (au sens propre comme au figuré) dans les placards et les relations de voisinage où tout le monde s'épie... Ah, quel bel endroit !

Mais qui est donc Buck Peters ? Pour vous répondre simplement, il est le chef de la police de Greenhill, ville du sud des Etats-Unis, je suppute un peu, mais il y a un fleuve tout près et on circule pas mal en bateau... Mais ce n'est pas notre sujet principal. Non, Buck Peters est un garçon qui a tout du gendre idéal.
28 ans, grand, beau et fort. Star de football américain dans son école, il aurait parfaitement pu passer professionnel et faire une brillante carrière sportive. Brillante et rémunératrice... Au lieu de ça, il a préféré rester dans son bled et devenir chef de la police, avec un salaire modeste, des pouvoirs assez réduits et une marge de progression quasiment nulle.
A tel point que certains, à Greenhill, le prennent un peu pour un simplet, un idiot qui n'a rien compris. Il faut dire qu'en plus de tout cela, Buck Peters est un vrai bigot. Elevé par une mère qui l'adore en bon chrétien, il est devenu marguillier dans sa paroisse. Autrement dit, il est un des laïques qui encadrent la petite communauté.
Sa réputation est sans tache, un saint, si l'on en croit sa mère et les vieilles dames de Greenhill, qui je jurent que par Buck, une belle andouille, pour les hommes qui voient dans ce grand dadais confit en dévotion un brave gars sans cervelle. Malgré son uniforme, son poste à la tête de la police et ce rôle au sein de la paroisse, on ne le prend pas vraiment au sérieux.
Mais alors, qui est donc Buck Peters, narrateur du roman ? Eh bien, la réponse est dans le titre français de ce livre. Buck Peters cache bien son jeu. Attention, ne vous méprenez pas, tout ce que je viens de vous dire de lui est vrai, on n'a pas un méchant garçon qui cache sous des dehors un peu benêt un ignoble tueur en série.
Non, il est sincère dans sa foi, dans ses choix de vie... Mais c'est un sacré cachottier ! D'une part, il connaît une multitude de vilains petits secrets que cachent les uns et les autres à Greenhill ; d'autre part, il a lui-même des choses à cacher et réussit depuis des années, douze, pour être précis, à mener une double vie sans que personne ne se doute de rien.
Le célibataire le plus endurci de Greenhill n'est pas du tout le petit saint abstinent que tout le monde croit. Il fait même cocu l'un des personnages les plus importants de la ville, Kip Belton, qui se trouve par ailleurs être son supérieur dans la police de la ville. Et celle qui partage ces moments, Lacey, est la femme de sa vie depuis toujours.
Elle s'est mariée à un autre ? Oui, c'est vrai. Mais ensemble, Lacey et Buck ont passé un pacte implicite à travers lequel ils ourdissent une sombre vengeance. Et le rôle de composition que tient Buck à Greenhill n'est que la partie visible de cet iceberg. En attendant le moment propice pour que cette vengeance s'accomplisse, Buck s'accommode de son rôle public et de sa relation clandestine.
Et puis, Rita Singleton est retrouvée morte par balles...
Au-delà de l'événement aussi horrible qu'inédit que cela représente pour toute la ville de Greenhill, voilà une histoire qui va compliquer la situation. Suicide ? Possible, quoi qu'on puisse plutôt penser à un meurtre, vu le nombre de balles tirées... Et surtout, c'est toute la gent masculine, à l'exception de Buck, que tout le monde croit puceau, qui peut être soupçonné. A moins qu'une femme jalouse, lassée de frasques de son cher et tendre...
Il faut dire que, à Greenhill, derrière le vernis de religiosité, les mâles ont deux faiblesses coupables : l'alcool, consommé sans modération, et Rita Singleton. La riche veuve la plus convoitée de la ville chez qui tout le monde essaye d'aller se consoler quand l'ivresse rend un peu plus nostalgique et triste ou, au contraire, désinhibe et rend beau et séduisant...
Alors oui, les suspects sont nombreux. Et tous véritablement crédible. Car Rita en savait elle aussi beaucoup sur ses prétendants... Mais, un se détache particulièrement de ce lot de braves gens bien sous tous rapports ou presque. Et il s'agit de Kip Belton, le mari de Lacey, l'homme dont Buck voudrait bien se venger.
Commence alors une enquête en bonne et due forme au cours de laquelle le chef de la police Peters doit encore donner le change, examiner les pistes et ne pas donner l'impression de trop se focaliser sur l'homme puissant. On connaît son béguin de jeunesse pour Lacey, ça pourrait jaser. Et puis, aussi bizarrement, l'enquête pourrait bien empêcher la vengeance de s'accomplir...
Au-delà de la série noire, du polar, de l'enquête, "Je suis un sournois" est en fait un véritable vaudeville avec un mari, une femme, un amant, la soeur du mari, l'affriolante Pert, 18 ans et déjà femme fatale qui ne rêve que de faire quitter au beau chef de la police le droit chemin, le maire, le médecin, les paroissiennes et tutti quanti...
Tout le monde tient les autres par la barbichette et essaye d'avancer ses propres pions pour tirer profit de ce qu'il sait. Mais le seul qui a l'ensemble du puzzle sous les yeux, c'est Buck, puisque lui connaît les petits secrets des uns et des autres. Et il va même pouvoir en jouer sans dévoiler son jeu, puisqu'il a récupéré le journal de Rita... Celui où elle a dû consigner tout ce qu'on lui a appris...
Quand je parle de vaudeville, c'est vraiment ça, des quiproquos, des portes qui claquent, des situations gênantes et inattendues et un final ! Je ne vous dis que ça ! Du Feydeau chez Fauklner, la troupe du Splendid chez Steinbeck ! Euh, bon, là, j'en fais quand même peut-être un peu beaucoup, mais je me suis énormément amusé en lisant ce roman.
Ah oui, j'ai oublié un élément : ça se passe à la fin des années 50. Attendez, je m'exprime mal : "Je suis un sournois" a été publié dans sa version originale en 1959 et l'année suivante par Gallimard dans la Série Noire. Oui, ce livre, que Folio SF vient de rééditer en poche a 55 ans ! Mais pourquoi exhumer cette Série Noire-là précisément, en cette année 2014 ?
Tout simplement parce que derrière le côté Série Noire et polar, "Je suis un sournois" dépeint les travers d'une Amérique qui planque sous sa bigoterie croissante tous ses maux, ses vices, ses tartuferies, ses hypocrisies. Cela concerne plus les petites villes que les mégapoles, bien sûr, ce qu'on peut appeler l'Amérique profonde, même si l'expression est franchement moche.
Ah, l'hypocrisie, thème éternel et universel ! Ici, il est particulièrement soignée dans une ville où la moitié masculine ment à qui mieux mieux, tandis que la moitié féminine comprend soit des séductrices invétérées, soit des grenouilles de bénitier. La vie est calme, il y a peu de tensions, parce que la hiérarchie est bien définie : les leaders, les suiveurs, ceux qui la ramènent et ceux qui s'écrasent.
Greenhill, c'est un petit bout d'Amérique, mais pas celui qui inspire un quelconque rêve américain. C'est étroit, mesquin, bas, mais peu importe, puisque "God bless America" et ses concitoyens ! Dieu est de son côté, alors on peut tout se permettre, la concupiscence, l'ivrognerie, pour les choses les plus évidentes, celles que tout le monde connaît et sur lesquelles on ferme les yeux.
Et puis, il y a tout ce qui se passe derrière les rideaux, les secrets d'alcôve ! On ne croirait pas, comme ça, en arrivant à Greenhill, paisible bourgade sans histoire, mais c'est Sodome et Gomorrhe ! Ou pas loin... Il s'en passe de belles et ce que nous raconte Buck est parfois hilarant, tant il y a de misère morale et de ridicule dans tout cela.
Quant à Buck, il aurait aujourd'hui plus de 80 ans. Et je ne serais pas surpris qu'il soutienne un tea-party... Il a tout à fait le profil d'un néo-conservateur, sûr de sa foi, sûr d'agir de son bon droit, sûr d'agir pour le bien de tous. Car, quoi qu'il fasse, même lorsqu'il pratique le chantage, grâce à tous les vilains petits secrets dont il est dépositaire, il le fait pour le bien général. Ou s'en persuade, en tout cas.
"Faire chanter quelqu'un pour lui soutirer de l'argent, c'est un péché ; le faire chanter pour sauver son âme, c'est un apostolat", voilà l'une des devises de Buck Peters. Au moins, ça a le mérite d'être clair ! Et, même si l'on peut trouver son histoire touchante, comprendre son envie de se venger, comme celle de Lacey, d'ailleurs, la manière dont il se donne bonne conscience malgré tout le renvoie au même niveau que tous les autres habitantes de Greenhill. Il est juste plus malin que la moyenne.
"Je suis sournois" est d'abord une Série Noire. Ce que je veux dire, c'est que ce livre risque de surprendre voire désarçonner les fans purs et durs de thriller et de polars. Le meurtre de Rita est plus un déclencheur qui décante une situation tombée dans la routine, l'enquête, elle, va mettre au jour tout ce que tout le monde à Greenhill croyait caché, et bien caché.
Ensuite, Peter Duncan joue, s'amuse avec ses marionnettes et les mets dans des situations délicates, les fait danser au bout de leurs fils et entrecroisent les secrets des uns et des autres pour semer une pagaille qui monte progressivement comme de l'eau qui bout dans une casserole. Et gare à tous, si ça déborde !
Le côté très théâtral de cette histoire m'a beaucoup amusé, également, et donne une vraie originalité à ce roman complètement amoral, ce qui n'est pas le moindre de ses paradoxes. Oui, Buck Peters est sournois, mais il n'est sûrement pas le seul à l'être à Greenhill. Je n'ose même pas imaginer l'ambiance qui régnerait à Greenhill après tout cela... Les cadavres (au sens propre comme au figuré) dans les placards et les relations de voisinage où tout le monde s'épie... Ah, quel bel endroit !
dimanche 21 septembre 2014
"Chacun de nous est une lune avec une face cachée que personne ne voit" (Mark Twain).
J'ai un peu triché, je dois l'avouer, mais puisque notre roman du jour est ouvertement placé sous l'égide de Mark Twain, il semblait logique d'aller chercher chez cet écrivain une sentence pouvant l'illustrer. Ce n'est pas parfait, mais ça devrait aller. Fin du cycle apocalyptique, en tout cas pour le moment, avec un roman qui est sorti en poche chez Folio SF à la fin du mois d'août, mais que je possède en grand format, chez Denoël. Une première expérience avec un auteur dont je possède d'autres livres, mais que je découvre à l'occasion (qui fait le larron) de cette sortie. Une belle découverte, dois-je ajouter, avec un roman feuilleton qui fleure bon le XIXe siècle, mais qui se passe au XXIIe et parle beaucoup du XXIe... Je vous présente "Julian", de Robert Charles Wilson. "Apostat, fugitif, conquérant", dit le sous-titre...
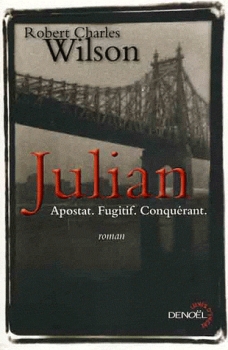
Lorsque commence notre histoire, nous sommes en 2172. Les Etats-Unis comptent désormais 60 Etats, qu'on imagine avoir été grappillés au nord et au sud. Depuis ce qu'on appelle "la Fausse Affliction", quelques décennies plus tôt, il n'y a plus de pétrole, ou alors si cher qu'il est inaccessible. Et l'on a recommencé à vivre comme au XIXe siècle.
On se déplace à cheval, en train ou en bateau à vapeur, les grandes mégapoles n'existent plus, beaucoup de choses ont changé pour le lecteur de 2014. Mais, les personnages, eux, n'ont pas ce genre de référence. Il faut dire que, depuis ces changements économiques et climatiques, on a fait table rase du passé. L'Histoire n'existe plus et elle n'est pas la seule. Les sciences aussi sont revenues à ce qu'elles étaient au moins 3 siècles plus tôt.
Le pouvoir politique est aux mains d'un homme, Deklan Comstock, surnommé Deklan le Conquérant, pour l'auréoler d'une gloire qu'il ne mérite sans doute pas. Mais, plus qu'une tyrannie placée entre les mains d'un seul homme, l'Amérique est devenue une théocratie, sous le joug d'un organisme qui s'appelle "le Dominion de Jésus-Christ sur Terre", mais on ne vous en voudra pas de dire juste "le Dominion".
En revanche, le Dominion, qui regroupe en fait toutes les églises chrétiennes d'Amérique, y compris catholiques, vous en voudra d'à peu près tout le reste et fait régner un puritanisme fanatique sur les 60 Etats. Le Dominion est partout, contrôle tout, dirige tout, sait tout, et fonctionne comme une véritable armée intérieure en charge de la morale, valeur placée au-dessus de tout le reste.
Le territoire américain connaît la guerre, en cette année 2172. On se bat pour préserver l'intégrité de l'Union des ennemis extérieurs qui voudraient l'abattre. On les appelles les Hollandais, mais il est plus probable que ce soit des Allemands. Mais la guerre vient bien des forces de la MittelEuropa, devenu un continent athée, matérialiste et rejetant le modèle américain avec force.
Voilà rapidement esquissé le contexte de ce roman. En cette année 2172, nous découvrons les deux personnages principaux que nous allons accompagner pendant près de 600 pages (pour l'édition Denoël). Adam, le narrateur, et Julian, bien sûr. Tous les deux ont 17 ans, et vivent dans un trou paumé quelque part en Athabaska, dans l'Ouest boréal américain.
Adam est originaire de ce coin. Il appartient à la classe bailleresse, autrement dit, il est fils d'artisan. Mais il se rêve écrivain, lui qui a dévoré tous les romans (portant l'imprimatur du Dominion) d'un célèbre écrivain contemporain, Charles Curtis Easton. Ces lectures nourrissent les rêves et l'imaginaire de ce garçon qui va se révéler au fil d'un roman être un grand, très grand naïf.
Julian, lui, appartient à la classe eupatridienne, autrement dit, l'aristocratie des grands propriétaires et industriels. Et il se cache dans le village d'Adam. Ce n'est pas qu'il soit directement en danger, mais mieux vaut prévenir que guérir. On l'a rapidement éloigné de New York et de celui qui y règne en despote, Deklan Comstock. Julian est son neveu. Le fils de Bryce Comstock, frère du président. Frère défunt, devrais-je dire...
Piégé par Deklan, le général Bryce Comstock, plus populaire et flamboyant que don frère, a été pendu pour haute trahison. Et Emily, sa veuve, craint pour la vie de son fils. Elle l'a confié à un ancien soldat, Sma Godwin, compagnon d'armes de Bryce, qui doit veiller sur l'adolescent et surtout, l'aider à devenir un homme.
Mais Julian est un garçon extrêmement intelligent et surtout iconoclaste de nature. Là où Adam se rêve écrivain, Julian ne songe qu'à la science. Pas la science officielle, non, celle d'avant, dont on trouve quelques traces dans les Dépotoirs où ont été balancés les livres que ne voulait plus voir le Dominion. Et l'icone de Julian, c'est Darwin, qui n'a, évidemment plus droit de cité dans une Amérique plus créationniste que jamais.
Cela fait de Julian un agnostique. Et donc, un apostat, puisque ces idées contredisent celles du Dominion. Voilà qui le met en danger. Mais, c'est d'une toute autre manière que va arriver le péril véritable : une vague de conscription. En envoyant Julian se faire tuer au front et rejoindre dans la légende son père, Deklan réglerait bien des problèmes d'un coup.
Voilà comment Julian va devoir fuir. Accompagné, presque malgré lui, d'Adam et de Sam Godwin, il va se lancer dans de grandes aventures pleines de bruit, de violence, de risque, mais aussi d'héroïsme, de découvertes, d'aléas... Peu à peu, ce jeune homme timide et introverti va devoir endosser les habits de conquérant, car il es peut-être le seul à pouvoir sortir son pays de l'ornière.
Ces aventures, ou plutôt, ces actes, comme va les intituler Adam, vont leur faire traverser tout le continent, connaître la guerre, le pouvoir, l'amour, mais aussi la solitude, la peur, la trahison, la rédemption, les menaces... Toute une palette de situations et d'émotions humaines qui vont faire grandir et mûrir ces deux adolescents paisibles.
Je ne vais pas vous raconter ce que contiennent les actes, lisez le roman, mais on est vraiment dans une fresque qui pourrait parfaitement se passer dans un grand film hollywoodien en Technicolor qui se déroulerait des grandes plantations jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir en passant par les terribles champs de bataille de la Guerre de Sécession. Entre le western et le film de guerre. Le tout, transposé dans ce XXIIe siècle post-apocalyptique.
Laissez-moi vous parler de Calyxa. Eh oui, que serait un roman de ce genre sans un personnage féminin fort ? On doit d'ailleurs l'associer à Emily Comstock, la mère de Julian, car ces deux-là, une fois réunies, vont avoir bien plus de on sens et de jugeote que les deux garçons, sans doute dépassés par des événements qu'ils ne vont plus finir par maîtriser, Adam prenant son rôle de biographe trop à coeur pour voir que Julian s'enferme dans une tour d'ivoire.
Pardon, Calyxa. Belle, impétueuse, chanteuse, caractère entier et pas froid aux yeux... Elle va devenir indispensable dans la vie des deux amis et elle se montrera d'une grande aide lorsque les nuages, jamais vraiment dissipés, recommenceront à s'amonceler. Mais c'est son côté provocateur qui est le plus intéressant.
Dans un pays tenu par une double main de fer, Calyxa ne se couche pas. Au contraire, au mépris du danger, elle ose affirmer ses opinions à contre-courant, refuse l'arbitraire et l'injustice, remet en cause l'ordre établi et vise juste pour toucher là où ses le plus douloureux les personnes qu'elle n'aime pas. Une femme libre, une héroïne, peut-être plus encore que Julian et Adam.
La fascination qu'elle exerce vient forcément de là, parce qu'elle est différente des deux garçons (attention, je noie un peu le poisson ici, pour ne pas révéler différents éléments du récit, pardonnez quelques imprécisions, elles sont volontaires). Non qu'ils soient lâches, bien au contraire. Julian prouvera lorsqu'il sera au feu, et à plusieurs reprises, qu'il en a à revendre, jusqu'à friser l'inconscience.
Mais, Julian est un idéaliste et Adam un doux rêveur, quand Calyxa a connu depuis toujours des conditions de vie, de subsistance, devrais-je dire, qui l'ont obligée à mûrir rapidement et à s'affirmer. Les deux garçons ont plutôt grandi dans le coton (sans lien avec les plantations...), protégés et privilégiés, bénéficiant de l'éducation et de l'attention que n'a pas reçues Calyxa.
Mais ils nous faut aussi venir à Julian et au lien avec le titre de ce billet. Evidemment, nous voyons le Conquérant à travers les yeux d'Adam, qui l'admire, l'aime comme un frère, le respecte. Et qui, en outre, je l'ai dit, est d'une naïveté par moments confondantes. Reste qu'il est honnête. Nourri aux romans d'aventures, il enjolive peut-être un peu les situations, mais sur le plan du caractère, de ce qui relève de l'intime, il ne trompe pas.
Et il laisse apparaître certains éléments de la personnalité de Julian qui lui échappent mais que le lecteur, s'il est un peu perspicace, va comprendre. Julian est un garçon très secret, je l'ai dit, plutôt introverti, bien loin, finalement, de l'image qu'a laissée son père et qu'on voudrait peut-être un peu facilement lui accoler dans le cours de l'histoire.
Il est, pour moi, et pardon du jeu de mot avec la phrase de Twain, plus lunaire, alors que son père était solaire. Mais il est aussi quelqu'un qui intériorise énormément, se confie peu, même à son alter ego, cultive son jardin secret, préfère les sciences et les arts à la politique et à ses compromissions. Peut-être a-t-il la carrure d'un chef d'Etat, mais il n'en a pas l'ambition.
Mais, pour revenir à Twain, l'aura de Julian s'assombrit tout au long du livre. Attention, je ne veux pas dire que le gentil garçon va devenir un monstre, non, c'est plus complexe que cela. Mais le pouvoir corrompt. La dernière partie du roman est une lutte terrible menée par Julian plus encore contre lui-même que contre ses adversaires, pourtant puissants et déterminés.
Ce côté sombre, sans que j'émette un quelconque jugement moral sur la question, on le découvre lentement. Mais plus vite que ne le fait Adam. Je pense que Julian, Emily, sa mère, Calyxa et Sam ont compris bien plus rapidement que le destin du fils de Bryce Comstock ne pouvait que s'accomplir dans le drame.
Et là, j'en viens à un des raisonnements tordus dont j'ai le secret. Allez savoir pourquoi, est-ce l'utilisation du mot "actes" employé par Adam pour qualifier les aventures de Julian, je n'ai cessé de voir en lui quelque chose de christique. Oh, qu'il serait fâché, s'il me lisait, lui qui rejetait la religion, lui préférant la conscience et la connaissance.
Pourtant, malgré son incontestable caractère laïque, on le pare des atours d'un sauveur, d'un messie, on l'attend sans le connaître puis, à partir de sa révélation, on voit en lui le seul homme capable de renverser une situation oppressante, de mettre de l'ordre et de la justice dans un pays qui n'en a plus depuis longtemps.
Je ne vais pas plus développer cette idée, mais il y a tout de même aussi dans le travail d'Adam un côté évangéliste qui saute aux yeux, aux miens, en tout cas. Et cette face cachée de Julian finira par se révéler pour qu'enfin les écailles tombent des yeux d'Adam et qu'il voie ce qu'il avait sans doute manqué : la parfaite connaissance de Julian de l'inéluctabilité de son destin. Et d'autres choses, que vous découvrirez.
"Julian", c'est une immense fresque. J'allais dire historique. Oui, presque. Robert Charles Wilson joue parfaitement avec la notion de passé et de présent. Son XXIIe siècle est presque un XIXe uchronique, en fait. Presque un point de vue, un univers comme un autre, sorti d'une vision du monde à la Philipp K. Dick, mais avec une technologie rudimentaire. Oui, on pourrait presque se croire dans "le Maître du Haut-Château".
Mais, à travers ce décorum, l'écrivain désormais naturalisé canadien (et sa charge envers une Amérique de plus en plus autoritaire et bigote confirme son envie d'ailleurs) rend aussi hommage à la littérature du XIXe, au roman feuilleton, à la naissance de la littérature populaire, dont Twain fut un des fers de lance. On ne s'ennuie pas une seconde. J'ai vu des lecteurs dire qu'il y avait des longueurs, je n'en ai pas vu, personnellement, il se passe sans cesse quelque chose qui vient étayer le raisonnement global.
Un vrai roman d'aventures, à lire même si vous n'êtes pas un fan de romans d'anticipation, de récits post-apocalyptiques ou de SF. On se prend au jeu à suivre ces deux gamins, qui auraient sans doute bien mieux à faire que de se retrouver embringués dans tout cela. Ils sont attachants, même s'ils sont plus, selon moi, des anti-héros. Ils subissent les événements, même s'il influent sur leur cours.
Robert Charles Wilson multiplie aussi les clins d'oeil (lorsque Julian retrouve les vestiges d'un film, c'est un film catastrophe prévoyant une apocalypse nucléaire), nous parle de nous, ici, en 2014, de la fin du pétrole et de ses conséquences, de l'incurie de tous en matière environnementale, mais il dénonce aussi ces tartufes qui veulent imposer un pouvoir religieux bien loin des enseignements initiaux de leur culte.
Enfin, et je termine, c'est déjà bien trop long, parce que je n'ai brièvement parlé que des principaux protagonistes du roman. Mais on retrouve en arrière-plan toute une galerie de personnages secondaires magnifiques, hauts en couleurs, qu'on imagine avec des gueules, et là encore, on y voit un véritable hommage à l'âge d'or du western, qui savait employer à merveille ce genre de caractères. Et au premier chef, Lymon Pugh ; il m'a bien plu, celui-là !
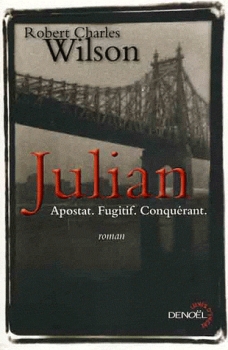
Lorsque commence notre histoire, nous sommes en 2172. Les Etats-Unis comptent désormais 60 Etats, qu'on imagine avoir été grappillés au nord et au sud. Depuis ce qu'on appelle "la Fausse Affliction", quelques décennies plus tôt, il n'y a plus de pétrole, ou alors si cher qu'il est inaccessible. Et l'on a recommencé à vivre comme au XIXe siècle.
On se déplace à cheval, en train ou en bateau à vapeur, les grandes mégapoles n'existent plus, beaucoup de choses ont changé pour le lecteur de 2014. Mais, les personnages, eux, n'ont pas ce genre de référence. Il faut dire que, depuis ces changements économiques et climatiques, on a fait table rase du passé. L'Histoire n'existe plus et elle n'est pas la seule. Les sciences aussi sont revenues à ce qu'elles étaient au moins 3 siècles plus tôt.
Le pouvoir politique est aux mains d'un homme, Deklan Comstock, surnommé Deklan le Conquérant, pour l'auréoler d'une gloire qu'il ne mérite sans doute pas. Mais, plus qu'une tyrannie placée entre les mains d'un seul homme, l'Amérique est devenue une théocratie, sous le joug d'un organisme qui s'appelle "le Dominion de Jésus-Christ sur Terre", mais on ne vous en voudra pas de dire juste "le Dominion".
En revanche, le Dominion, qui regroupe en fait toutes les églises chrétiennes d'Amérique, y compris catholiques, vous en voudra d'à peu près tout le reste et fait régner un puritanisme fanatique sur les 60 Etats. Le Dominion est partout, contrôle tout, dirige tout, sait tout, et fonctionne comme une véritable armée intérieure en charge de la morale, valeur placée au-dessus de tout le reste.
Le territoire américain connaît la guerre, en cette année 2172. On se bat pour préserver l'intégrité de l'Union des ennemis extérieurs qui voudraient l'abattre. On les appelles les Hollandais, mais il est plus probable que ce soit des Allemands. Mais la guerre vient bien des forces de la MittelEuropa, devenu un continent athée, matérialiste et rejetant le modèle américain avec force.
Voilà rapidement esquissé le contexte de ce roman. En cette année 2172, nous découvrons les deux personnages principaux que nous allons accompagner pendant près de 600 pages (pour l'édition Denoël). Adam, le narrateur, et Julian, bien sûr. Tous les deux ont 17 ans, et vivent dans un trou paumé quelque part en Athabaska, dans l'Ouest boréal américain.
Adam est originaire de ce coin. Il appartient à la classe bailleresse, autrement dit, il est fils d'artisan. Mais il se rêve écrivain, lui qui a dévoré tous les romans (portant l'imprimatur du Dominion) d'un célèbre écrivain contemporain, Charles Curtis Easton. Ces lectures nourrissent les rêves et l'imaginaire de ce garçon qui va se révéler au fil d'un roman être un grand, très grand naïf.
Julian, lui, appartient à la classe eupatridienne, autrement dit, l'aristocratie des grands propriétaires et industriels. Et il se cache dans le village d'Adam. Ce n'est pas qu'il soit directement en danger, mais mieux vaut prévenir que guérir. On l'a rapidement éloigné de New York et de celui qui y règne en despote, Deklan Comstock. Julian est son neveu. Le fils de Bryce Comstock, frère du président. Frère défunt, devrais-je dire...
Piégé par Deklan, le général Bryce Comstock, plus populaire et flamboyant que don frère, a été pendu pour haute trahison. Et Emily, sa veuve, craint pour la vie de son fils. Elle l'a confié à un ancien soldat, Sma Godwin, compagnon d'armes de Bryce, qui doit veiller sur l'adolescent et surtout, l'aider à devenir un homme.
Mais Julian est un garçon extrêmement intelligent et surtout iconoclaste de nature. Là où Adam se rêve écrivain, Julian ne songe qu'à la science. Pas la science officielle, non, celle d'avant, dont on trouve quelques traces dans les Dépotoirs où ont été balancés les livres que ne voulait plus voir le Dominion. Et l'icone de Julian, c'est Darwin, qui n'a, évidemment plus droit de cité dans une Amérique plus créationniste que jamais.
Cela fait de Julian un agnostique. Et donc, un apostat, puisque ces idées contredisent celles du Dominion. Voilà qui le met en danger. Mais, c'est d'une toute autre manière que va arriver le péril véritable : une vague de conscription. En envoyant Julian se faire tuer au front et rejoindre dans la légende son père, Deklan réglerait bien des problèmes d'un coup.
Voilà comment Julian va devoir fuir. Accompagné, presque malgré lui, d'Adam et de Sam Godwin, il va se lancer dans de grandes aventures pleines de bruit, de violence, de risque, mais aussi d'héroïsme, de découvertes, d'aléas... Peu à peu, ce jeune homme timide et introverti va devoir endosser les habits de conquérant, car il es peut-être le seul à pouvoir sortir son pays de l'ornière.
Ces aventures, ou plutôt, ces actes, comme va les intituler Adam, vont leur faire traverser tout le continent, connaître la guerre, le pouvoir, l'amour, mais aussi la solitude, la peur, la trahison, la rédemption, les menaces... Toute une palette de situations et d'émotions humaines qui vont faire grandir et mûrir ces deux adolescents paisibles.
Je ne vais pas vous raconter ce que contiennent les actes, lisez le roman, mais on est vraiment dans une fresque qui pourrait parfaitement se passer dans un grand film hollywoodien en Technicolor qui se déroulerait des grandes plantations jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir en passant par les terribles champs de bataille de la Guerre de Sécession. Entre le western et le film de guerre. Le tout, transposé dans ce XXIIe siècle post-apocalyptique.
Laissez-moi vous parler de Calyxa. Eh oui, que serait un roman de ce genre sans un personnage féminin fort ? On doit d'ailleurs l'associer à Emily Comstock, la mère de Julian, car ces deux-là, une fois réunies, vont avoir bien plus de on sens et de jugeote que les deux garçons, sans doute dépassés par des événements qu'ils ne vont plus finir par maîtriser, Adam prenant son rôle de biographe trop à coeur pour voir que Julian s'enferme dans une tour d'ivoire.
Pardon, Calyxa. Belle, impétueuse, chanteuse, caractère entier et pas froid aux yeux... Elle va devenir indispensable dans la vie des deux amis et elle se montrera d'une grande aide lorsque les nuages, jamais vraiment dissipés, recommenceront à s'amonceler. Mais c'est son côté provocateur qui est le plus intéressant.
Dans un pays tenu par une double main de fer, Calyxa ne se couche pas. Au contraire, au mépris du danger, elle ose affirmer ses opinions à contre-courant, refuse l'arbitraire et l'injustice, remet en cause l'ordre établi et vise juste pour toucher là où ses le plus douloureux les personnes qu'elle n'aime pas. Une femme libre, une héroïne, peut-être plus encore que Julian et Adam.
La fascination qu'elle exerce vient forcément de là, parce qu'elle est différente des deux garçons (attention, je noie un peu le poisson ici, pour ne pas révéler différents éléments du récit, pardonnez quelques imprécisions, elles sont volontaires). Non qu'ils soient lâches, bien au contraire. Julian prouvera lorsqu'il sera au feu, et à plusieurs reprises, qu'il en a à revendre, jusqu'à friser l'inconscience.
Mais, Julian est un idéaliste et Adam un doux rêveur, quand Calyxa a connu depuis toujours des conditions de vie, de subsistance, devrais-je dire, qui l'ont obligée à mûrir rapidement et à s'affirmer. Les deux garçons ont plutôt grandi dans le coton (sans lien avec les plantations...), protégés et privilégiés, bénéficiant de l'éducation et de l'attention que n'a pas reçues Calyxa.
Mais ils nous faut aussi venir à Julian et au lien avec le titre de ce billet. Evidemment, nous voyons le Conquérant à travers les yeux d'Adam, qui l'admire, l'aime comme un frère, le respecte. Et qui, en outre, je l'ai dit, est d'une naïveté par moments confondantes. Reste qu'il est honnête. Nourri aux romans d'aventures, il enjolive peut-être un peu les situations, mais sur le plan du caractère, de ce qui relève de l'intime, il ne trompe pas.
Et il laisse apparaître certains éléments de la personnalité de Julian qui lui échappent mais que le lecteur, s'il est un peu perspicace, va comprendre. Julian est un garçon très secret, je l'ai dit, plutôt introverti, bien loin, finalement, de l'image qu'a laissée son père et qu'on voudrait peut-être un peu facilement lui accoler dans le cours de l'histoire.
Il est, pour moi, et pardon du jeu de mot avec la phrase de Twain, plus lunaire, alors que son père était solaire. Mais il est aussi quelqu'un qui intériorise énormément, se confie peu, même à son alter ego, cultive son jardin secret, préfère les sciences et les arts à la politique et à ses compromissions. Peut-être a-t-il la carrure d'un chef d'Etat, mais il n'en a pas l'ambition.
Mais, pour revenir à Twain, l'aura de Julian s'assombrit tout au long du livre. Attention, je ne veux pas dire que le gentil garçon va devenir un monstre, non, c'est plus complexe que cela. Mais le pouvoir corrompt. La dernière partie du roman est une lutte terrible menée par Julian plus encore contre lui-même que contre ses adversaires, pourtant puissants et déterminés.
Ce côté sombre, sans que j'émette un quelconque jugement moral sur la question, on le découvre lentement. Mais plus vite que ne le fait Adam. Je pense que Julian, Emily, sa mère, Calyxa et Sam ont compris bien plus rapidement que le destin du fils de Bryce Comstock ne pouvait que s'accomplir dans le drame.
Et là, j'en viens à un des raisonnements tordus dont j'ai le secret. Allez savoir pourquoi, est-ce l'utilisation du mot "actes" employé par Adam pour qualifier les aventures de Julian, je n'ai cessé de voir en lui quelque chose de christique. Oh, qu'il serait fâché, s'il me lisait, lui qui rejetait la religion, lui préférant la conscience et la connaissance.
Pourtant, malgré son incontestable caractère laïque, on le pare des atours d'un sauveur, d'un messie, on l'attend sans le connaître puis, à partir de sa révélation, on voit en lui le seul homme capable de renverser une situation oppressante, de mettre de l'ordre et de la justice dans un pays qui n'en a plus depuis longtemps.
Je ne vais pas plus développer cette idée, mais il y a tout de même aussi dans le travail d'Adam un côté évangéliste qui saute aux yeux, aux miens, en tout cas. Et cette face cachée de Julian finira par se révéler pour qu'enfin les écailles tombent des yeux d'Adam et qu'il voie ce qu'il avait sans doute manqué : la parfaite connaissance de Julian de l'inéluctabilité de son destin. Et d'autres choses, que vous découvrirez.
"Julian", c'est une immense fresque. J'allais dire historique. Oui, presque. Robert Charles Wilson joue parfaitement avec la notion de passé et de présent. Son XXIIe siècle est presque un XIXe uchronique, en fait. Presque un point de vue, un univers comme un autre, sorti d'une vision du monde à la Philipp K. Dick, mais avec une technologie rudimentaire. Oui, on pourrait presque se croire dans "le Maître du Haut-Château".
Mais, à travers ce décorum, l'écrivain désormais naturalisé canadien (et sa charge envers une Amérique de plus en plus autoritaire et bigote confirme son envie d'ailleurs) rend aussi hommage à la littérature du XIXe, au roman feuilleton, à la naissance de la littérature populaire, dont Twain fut un des fers de lance. On ne s'ennuie pas une seconde. J'ai vu des lecteurs dire qu'il y avait des longueurs, je n'en ai pas vu, personnellement, il se passe sans cesse quelque chose qui vient étayer le raisonnement global.
Un vrai roman d'aventures, à lire même si vous n'êtes pas un fan de romans d'anticipation, de récits post-apocalyptiques ou de SF. On se prend au jeu à suivre ces deux gamins, qui auraient sans doute bien mieux à faire que de se retrouver embringués dans tout cela. Ils sont attachants, même s'ils sont plus, selon moi, des anti-héros. Ils subissent les événements, même s'il influent sur leur cours.
Robert Charles Wilson multiplie aussi les clins d'oeil (lorsque Julian retrouve les vestiges d'un film, c'est un film catastrophe prévoyant une apocalypse nucléaire), nous parle de nous, ici, en 2014, de la fin du pétrole et de ses conséquences, de l'incurie de tous en matière environnementale, mais il dénonce aussi ces tartufes qui veulent imposer un pouvoir religieux bien loin des enseignements initiaux de leur culte.
Enfin, et je termine, c'est déjà bien trop long, parce que je n'ai brièvement parlé que des principaux protagonistes du roman. Mais on retrouve en arrière-plan toute une galerie de personnages secondaires magnifiques, hauts en couleurs, qu'on imagine avec des gueules, et là encore, on y voit un véritable hommage à l'âge d'or du western, qui savait employer à merveille ce genre de caractères. Et au premier chef, Lymon Pugh ; il m'a bien plu, celui-là !
vendredi 19 septembre 2014
Fluctuat sed mergitur...
Comme dit précédemment, je suis dans une période catastrophique. Euh, en termes de lectures, pas dans ma vie, je vous remercie ! Non, il se trouve que j'ai enchaîné une série de romans qui, dans des genres différents, évoquent des catastrophes, naturelles ou non, et l'hypothétique fin de notre monde... En voilà un nouvel exemple, avec un thriller d'anticipation, véritable page-turner, qui nous emmène au coeur d'un Paris englouti sous des eaux pas vraiment tranquilles. Dans ce décor sidérant, et avec tous les inconvénients que cela entraîne, nous suivons une course-poursuite échevelée dont la source est à définir. Le seul indice : à côté de ce qui se trame, la pluie n'est qu'un léger souci... Avec "le dernier déluge" (publié en grand format chez Albin Michel), David Emton nous fait boire la tasse, nous glace jusqu'aux os et nous assène une idée centrale assez terrifiante : et si la nature, loin d'être une Mère, était notre pire ennemi ?

La veille de Noël. Des fêtes un peu particulière, car voici cinq semaines qu'il pleut sans discontinuer sur Paris. Et pas une petite bruine. Non, des cordes, des hallebardes, des trombes d'eau ininterrompues. Le cours de la Seine n'a cessé d'enfler au point de commencer à déborder au coeur de la capitale et la crue historique de 1910 n'est déjà plus qu'un lointain souvenir comparé à ce qui est en train de se produire.
Tout le monde est sur les dents pour sauver ce qui peut l'être, patrimoine, archives, oeuvres d'art, sans oublier la population, qu'il faut essayer d'évacuer. Car l'eau, on ne l'arrête pas, elle s'immisce partout, remplit chaque vide, chaque creux, chaque tunnel, et à Paris, ce n'est pas ce qui manque. On annonce même que les digues de retenue en amont ont lâché. Bref, la situation est grave, mais elle sera bientôt désespérée, surtout s'il ne s'arrête pas de pleuvoir !
Les autorités politiques, la police, l'armée, les pompiers, tout le monde travaille d'arrache-pied dans des conditions précaires, dangereuses, incertaines pour essayer d'éviter un drame pire encore. Mais la chaîne de commandement va bientôt devoir jongler entre les priorités. Et les maillons de cette chaîne vont recevoir des ordres qui ne se discutent pas, sans forcément avoir tous les éléments en main...
Malgré tout, certains s'apprêtent à fêter Noël. Difficile d'envisager un réveillon traditionnel dans cette ambiance et ces complications, mais ceux qui ont encore un domicile suffisamment élevé pour ne pas être inondé vont essayer de continuer à vivre. C'est le cas de Christine Petit, jeune femme célibataire, qui occupe un poste d'hôtesse d'accueil dans une grosse société : Galaxim.
Elle vit dans un modeste deux pièces du Ve arrondissement de la capitale, assez haut pour ne pas craindre l'eau, mais s'attend à se retrouver sous peu confinée chez elle, car la circulation dans Paris va devenir bientôt un vrai casse-tête. Pas de famille, pas vraiment d'ami, ce Noël diluvien s'annonce d'une rare tristesse pour elle.
Et puis, on sonne à sa porte. Un coursier qui lui apporte un paquet. Bizarre, parce qu'il est 7h du matin un 24 décembre et parce qu'elle n'attend rien. D'autant que, vu le bazar dehors, ce n'est pas vraiment le moment de passer sa commande sur un site de vente en ligne... Les délais de livraison sont pour le moins aléatoire...
Mais, il n'y a pas d'erreur, c'est bien à elle qu'est destiné ce paquet. Et, apparemment, c'est la société pour laquelle elle travaille qui le lui envoie. Du boulot à la maison ? Une veille de Noël, en plus ? Non, c'est trop inhabituel, trop bizarre. Et c'est encore pire que ce qu'elle imaginait quand elle ouvre le paquet car dedans, se trouve...
... Un bébé.
Oui, vous avez bien lu. Un bébé. Emmailloté, si je puis dire, dans un paquet spécial, une espèce de liquide amniotique artificiel, dirait-on, qui doit avoir pour but de maintenir l'enfant comme s'il était encore dans le ventre de sa mère. Il se pourrait bien que ce soit un prématuré. Quant à ses parents, difficile d'imaginer qui ils peuvent être.
Il faut dire que Galaxim est une boîte qui travaille dans les technologies scientifiques de pointe. Une société à l'excellente réputation dans un domaine où l'on devient vite un apprenti-sorcier dès qu'on choisit de s'aventurer dans des domaines qui flirtent avec les lignes jaunes de la bioéthique. Mais Jacques Levine, généticien mondialement reconnu et patron de Christine est respecté justement pour son humanisme et son respect de l'éthique.
C'est d'ailleurs Jacques Levine lui-même qui lui a fait parvenir ce... colis, enfin, ce... bébé. Mais pourquoi ? Pourquoi elle, insignifiante et surtout, pas scientifique pour deux sous ? Pourquoi cet homme qu'elle admire l'a-t-elle choisie pour lui confier un enfant qui doit avoir quelque chose de spécial ? Pourquoi lui confier ainsi, en passant par une entreprise de coursiers ?
Cela en fait des questions. D'autant que, si Christine n'a jamais perdu l'espoir de devenir mère un jour, elle a été un tantinet prise de court par cet "accouchement" express. Ce n'est pas qu'elle n'a pas l'instinct maternel, mais là, ce nourrisson dans son liquide étrange, elle ne sait pas trop comment s'y prendre... Un petit coup de main, quelques conseils ne seraient pas de trop. Sans même parler de ce que M. Levine voudrait qu'elle fasse de cet enfant...
Alors, elle prend son courage à deux mains et va sur le palier frapper à la porte de ce voisin qu'elle a toujours trouvé craquant, sans jamais oser lui dire, persuadée d'être transparente pour ce beau gosse, journaliste scientifique, le genre baroudeur... Pas vraiment le mec qui se retourne sur une voisine hôtesse d'accueil...
Mais, là, cas de force majeure. Lui aura les connaissances pour savoir quoi faire ou au moins lui donner des pistes. L'aider à comprendre ce qui lui échappe dans cette histoire. Et lui dire quoi faire... Evidemment, Damien est plus qu'intrigué par cette étrange apparition. Et plus encore par l'enfant. Mais c'est avant tout le nom de "Galaxim" qui semble exciter sa curiosité...
Il ne semble pas si certain que cette respectable société le soit autant qu'on veut bien le dire. Et ce bébé, là, dans son jus nutritif, pourrait bien être la preuve de quelques magouilles pas franchement glorieuses. Bref, son sixième sens journalistique se déclenche et il décide de se pencher sur la question. En décryptant d'abord l'énigme fixée sur le paquet qui contenait le bébé...
Et puis, rapidement, autre chose va le pousser à s'impliquer... Pendant que Christine est chez lui, on sonne chez elle. Et la personne en question n'a pas vraiment une tête d'angelot, de berger ou de roi mage venant se recueillir à la crèche... Apparemment, ce bébé est demandé... Et pas par des gentils, non, le mec, là, a une tête de tueur...
Commence alors une fuite éperdue dans Paris sous les eaux pour échapper à un, non, pardon, à deux tueurs ultra-déterminés dont la mission semble claire : récupérer l'enfant et ne laisser aucun témoin. Mais qui les envoie ? C'est là le hic : le déluge ne semble plus préoccuper personne dans les plus hautes sphères mondiales. Non, la cible n°1, c'est le bébé...
David Emton est un petit coquin. En effet, lorsqu'on se retrouve avec son livre en main, ce titre, cette couverture, on pense à un roman catastrophe où la météo tient le rôle principal, où les personnages centraux vont devoir lutter contre la montée des eaux, vivre des aventures dans Paris martyrisée, Paris outragée, Paris inondée...
De prime abord, avant d'entamer la lecture du "Dernier déluge", j'avais pensé à une version française d'un formidable roman britannique, "De feu et d'eau", de Richard Doyle, où Londres se retrouve sous la menace d'une gigantesque tempête qui pourrait s'engouffrer dans l'estuaire de la Tamise et remonter son court... Un suspense haletant qui aurait fait un parfait film catastrophe, comme on en a tant connu pendant les années 70.
Sauf qu'après quelques pages seulement, on comprend que ce n'est pas du tout ça. Que la pluie, l'eau qui monte, Paris, les inondations, le Zouave du Pont de l'Alma qui risque la noyade au lieu de se mouiller les chausses comme d'hab', tout ça, c'est du décor. C'est du théâtre. Une unité de lieu, humide et hostile, qui va accueillir une intrigue bien différente.
En fait, ce déluge, c'est ce qui vient pimenter et donner une bonne touche d'originalité à un thriller qui proposerait sinon, une course-poursuite assez classique, une intrigue que Dan Brown ne renierait pas (on pense d'ailleurs un peu au Silas du "Da Vinci Code" avec l'un des tueurs, même s'il ne porte ni robe de bure, ni cilice).
Mais là, alors qu'on se déplace au mieux en cuissardes, au pire en barque en plein coeur de la capitale, que l'eau monte partout et, quand elle monte, il lui arrive aussi de descendre, dès qu'elle trouve de l'espace, dans les sous-sols, le métro et bien d'autres lieux qui peuvent devenir des pièges, qu'il faut échapper à ses poursuivants et essayer de comprendre qui est ce bébé et ce qu'il faut en faire, là, ça devient très étonnant.
Cependant, tout cela, ce n'est pas le coeur du problème qui se dessine sous nos yeux. D'abord, il y a la vision du monde très différente de Christine, idéaliste, parfois naïve, et de Damien, plus cynique, plus pessimiste, aussi. Elle est amoureuse de cette nature qu'elle voudrait voir préserver. Il tient un discours bien différent, dans lequel la Nature n'est pas une victime, ni une alliée, mais une adversaire.
La pluie, qui ne cesse de tomber, comme tout autre fléau météorologique ou sismique, par exemple, tout ça pourrait être une réaction de défense d'une planète qui se sent agresser. Pour Damien, la relation entre l'Homme et la Nature ne peut passer que par la domination de l'un sur l'autre et pas dans la cohabitation harmonieuse.
Et donc, l'homme doit tout faire pour empêcher la nature de lui nuire par quelque moyen que ce soit. Voilà une vision largement à contre-courant ! Attention, Damien n'est pas quelqu'un qui veut détruire la nature, entendons-nous bien, mais il ne lui fait pas confiance, il la croit dangereuse et voudrait pourvoir calmer ses ardeurs. Il la redoute, et le déluge semble lui donner en partie raison.
Etonnamment, ce côté "entité vivante" d'une nature capable de réagir et de se venger de celui qui la maltraite, était déjà au coeur du livre dont nous avons parlé il y a quelques jours, "Après la chute", de Nancy Kress. Dans un genre littéraire, un style et un contexte totalement différents, mais j'ai été amusé et surpris de croiser cette théorie très intéressante.
Euh, intéressante ne signifie pas que je la partage. En revanche, je trouve que sur le plan strictement romanesque, cette Nature douée d'un... instinct, d'une... raison, je ne sais pas quel mot pourrait convenir, est un formidable argument et un bel outil pour toute imagination galopante. D'autant que David Emton, à travers Damien, multiplie les démonstrations scientifiques, comme si ces créations humaines étaient des boucliers ou des preuves de la supériorité humaine, remise en cause par les éléments.
Entre la visite de Paris telle qu'on ne la verra jamais, en tout cas, je l'espère, malgré les prévisions de crues bien plus fortes et violentes que celle de 1910, et les questions qui tournent autour du bébé, le suspense, assez classique dans la structure, fonctionne bien. David Emton utilise des ficelles qu'on connaît, mais il casse aussi quelques codes.
Enfin, il y a cet enfant... Il y a quelque chose de biblique dans ce déluge. Le navire du blason de la capitale a des airs d'Arche de Noé (non, même pas de jeu mots avec le nom de l'ancien maire, tant pis pour vous !). Mais, comment ne pas songer à Jésus, avec ce bébé qui apparaît comme par l'opération du Saint-Esprit, oui, je sais, c'est facile, un 24 décembre ?
Hérode a des héritiers, nombreux et puissants, prêts à tout pour traquer cet innocent qui ne pourra pas fuir en Egypte à dos d'âne, mais va devoir faire confiance à ses parents adoptifs et provisoires pour retrouver des terres plus calmes, en traversant une Mer Morte pas près de s'ouvrir toute seule sur son passage, bien au contraire.
Que l'on soit croyant ou pas, nous vivons dans l'ère chrétienne, dont le point zéro est la date (approximative) de la naissance de Jésus. En cela aussi, ce bébé si menacé, a des airs christiques, puisqu'on croit deviner peu à peu que, par lui, une nouvelle ère pourrait débuter... Mais de quelle manière ?
Terminons par quelques derniers mots sur la toute fin du livre. Sans la dévoiler, bien sûr. Mais David Emton joue là aussi avec des peurs qu'on a déjà vu exploitées par d'autres romanciers, qui ont aussi été évoquées lors d'événements récents et qu'on pourrait relier à des événements présents. En imaginant les dernières pages se déroulant sur un autre continent, on se sent saisis d'un profond malaise et on croise fort les doigts pour que l'auteur se trompe.

La veille de Noël. Des fêtes un peu particulière, car voici cinq semaines qu'il pleut sans discontinuer sur Paris. Et pas une petite bruine. Non, des cordes, des hallebardes, des trombes d'eau ininterrompues. Le cours de la Seine n'a cessé d'enfler au point de commencer à déborder au coeur de la capitale et la crue historique de 1910 n'est déjà plus qu'un lointain souvenir comparé à ce qui est en train de se produire.
Tout le monde est sur les dents pour sauver ce qui peut l'être, patrimoine, archives, oeuvres d'art, sans oublier la population, qu'il faut essayer d'évacuer. Car l'eau, on ne l'arrête pas, elle s'immisce partout, remplit chaque vide, chaque creux, chaque tunnel, et à Paris, ce n'est pas ce qui manque. On annonce même que les digues de retenue en amont ont lâché. Bref, la situation est grave, mais elle sera bientôt désespérée, surtout s'il ne s'arrête pas de pleuvoir !
Les autorités politiques, la police, l'armée, les pompiers, tout le monde travaille d'arrache-pied dans des conditions précaires, dangereuses, incertaines pour essayer d'éviter un drame pire encore. Mais la chaîne de commandement va bientôt devoir jongler entre les priorités. Et les maillons de cette chaîne vont recevoir des ordres qui ne se discutent pas, sans forcément avoir tous les éléments en main...
Malgré tout, certains s'apprêtent à fêter Noël. Difficile d'envisager un réveillon traditionnel dans cette ambiance et ces complications, mais ceux qui ont encore un domicile suffisamment élevé pour ne pas être inondé vont essayer de continuer à vivre. C'est le cas de Christine Petit, jeune femme célibataire, qui occupe un poste d'hôtesse d'accueil dans une grosse société : Galaxim.
Elle vit dans un modeste deux pièces du Ve arrondissement de la capitale, assez haut pour ne pas craindre l'eau, mais s'attend à se retrouver sous peu confinée chez elle, car la circulation dans Paris va devenir bientôt un vrai casse-tête. Pas de famille, pas vraiment d'ami, ce Noël diluvien s'annonce d'une rare tristesse pour elle.
Et puis, on sonne à sa porte. Un coursier qui lui apporte un paquet. Bizarre, parce qu'il est 7h du matin un 24 décembre et parce qu'elle n'attend rien. D'autant que, vu le bazar dehors, ce n'est pas vraiment le moment de passer sa commande sur un site de vente en ligne... Les délais de livraison sont pour le moins aléatoire...
Mais, il n'y a pas d'erreur, c'est bien à elle qu'est destiné ce paquet. Et, apparemment, c'est la société pour laquelle elle travaille qui le lui envoie. Du boulot à la maison ? Une veille de Noël, en plus ? Non, c'est trop inhabituel, trop bizarre. Et c'est encore pire que ce qu'elle imaginait quand elle ouvre le paquet car dedans, se trouve...
... Un bébé.
Oui, vous avez bien lu. Un bébé. Emmailloté, si je puis dire, dans un paquet spécial, une espèce de liquide amniotique artificiel, dirait-on, qui doit avoir pour but de maintenir l'enfant comme s'il était encore dans le ventre de sa mère. Il se pourrait bien que ce soit un prématuré. Quant à ses parents, difficile d'imaginer qui ils peuvent être.
Il faut dire que Galaxim est une boîte qui travaille dans les technologies scientifiques de pointe. Une société à l'excellente réputation dans un domaine où l'on devient vite un apprenti-sorcier dès qu'on choisit de s'aventurer dans des domaines qui flirtent avec les lignes jaunes de la bioéthique. Mais Jacques Levine, généticien mondialement reconnu et patron de Christine est respecté justement pour son humanisme et son respect de l'éthique.
C'est d'ailleurs Jacques Levine lui-même qui lui a fait parvenir ce... colis, enfin, ce... bébé. Mais pourquoi ? Pourquoi elle, insignifiante et surtout, pas scientifique pour deux sous ? Pourquoi cet homme qu'elle admire l'a-t-elle choisie pour lui confier un enfant qui doit avoir quelque chose de spécial ? Pourquoi lui confier ainsi, en passant par une entreprise de coursiers ?
Cela en fait des questions. D'autant que, si Christine n'a jamais perdu l'espoir de devenir mère un jour, elle a été un tantinet prise de court par cet "accouchement" express. Ce n'est pas qu'elle n'a pas l'instinct maternel, mais là, ce nourrisson dans son liquide étrange, elle ne sait pas trop comment s'y prendre... Un petit coup de main, quelques conseils ne seraient pas de trop. Sans même parler de ce que M. Levine voudrait qu'elle fasse de cet enfant...
Alors, elle prend son courage à deux mains et va sur le palier frapper à la porte de ce voisin qu'elle a toujours trouvé craquant, sans jamais oser lui dire, persuadée d'être transparente pour ce beau gosse, journaliste scientifique, le genre baroudeur... Pas vraiment le mec qui se retourne sur une voisine hôtesse d'accueil...
Mais, là, cas de force majeure. Lui aura les connaissances pour savoir quoi faire ou au moins lui donner des pistes. L'aider à comprendre ce qui lui échappe dans cette histoire. Et lui dire quoi faire... Evidemment, Damien est plus qu'intrigué par cette étrange apparition. Et plus encore par l'enfant. Mais c'est avant tout le nom de "Galaxim" qui semble exciter sa curiosité...
Il ne semble pas si certain que cette respectable société le soit autant qu'on veut bien le dire. Et ce bébé, là, dans son jus nutritif, pourrait bien être la preuve de quelques magouilles pas franchement glorieuses. Bref, son sixième sens journalistique se déclenche et il décide de se pencher sur la question. En décryptant d'abord l'énigme fixée sur le paquet qui contenait le bébé...
Et puis, rapidement, autre chose va le pousser à s'impliquer... Pendant que Christine est chez lui, on sonne chez elle. Et la personne en question n'a pas vraiment une tête d'angelot, de berger ou de roi mage venant se recueillir à la crèche... Apparemment, ce bébé est demandé... Et pas par des gentils, non, le mec, là, a une tête de tueur...
Commence alors une fuite éperdue dans Paris sous les eaux pour échapper à un, non, pardon, à deux tueurs ultra-déterminés dont la mission semble claire : récupérer l'enfant et ne laisser aucun témoin. Mais qui les envoie ? C'est là le hic : le déluge ne semble plus préoccuper personne dans les plus hautes sphères mondiales. Non, la cible n°1, c'est le bébé...
David Emton est un petit coquin. En effet, lorsqu'on se retrouve avec son livre en main, ce titre, cette couverture, on pense à un roman catastrophe où la météo tient le rôle principal, où les personnages centraux vont devoir lutter contre la montée des eaux, vivre des aventures dans Paris martyrisée, Paris outragée, Paris inondée...
De prime abord, avant d'entamer la lecture du "Dernier déluge", j'avais pensé à une version française d'un formidable roman britannique, "De feu et d'eau", de Richard Doyle, où Londres se retrouve sous la menace d'une gigantesque tempête qui pourrait s'engouffrer dans l'estuaire de la Tamise et remonter son court... Un suspense haletant qui aurait fait un parfait film catastrophe, comme on en a tant connu pendant les années 70.
Sauf qu'après quelques pages seulement, on comprend que ce n'est pas du tout ça. Que la pluie, l'eau qui monte, Paris, les inondations, le Zouave du Pont de l'Alma qui risque la noyade au lieu de se mouiller les chausses comme d'hab', tout ça, c'est du décor. C'est du théâtre. Une unité de lieu, humide et hostile, qui va accueillir une intrigue bien différente.
En fait, ce déluge, c'est ce qui vient pimenter et donner une bonne touche d'originalité à un thriller qui proposerait sinon, une course-poursuite assez classique, une intrigue que Dan Brown ne renierait pas (on pense d'ailleurs un peu au Silas du "Da Vinci Code" avec l'un des tueurs, même s'il ne porte ni robe de bure, ni cilice).
Mais là, alors qu'on se déplace au mieux en cuissardes, au pire en barque en plein coeur de la capitale, que l'eau monte partout et, quand elle monte, il lui arrive aussi de descendre, dès qu'elle trouve de l'espace, dans les sous-sols, le métro et bien d'autres lieux qui peuvent devenir des pièges, qu'il faut échapper à ses poursuivants et essayer de comprendre qui est ce bébé et ce qu'il faut en faire, là, ça devient très étonnant.
Cependant, tout cela, ce n'est pas le coeur du problème qui se dessine sous nos yeux. D'abord, il y a la vision du monde très différente de Christine, idéaliste, parfois naïve, et de Damien, plus cynique, plus pessimiste, aussi. Elle est amoureuse de cette nature qu'elle voudrait voir préserver. Il tient un discours bien différent, dans lequel la Nature n'est pas une victime, ni une alliée, mais une adversaire.
La pluie, qui ne cesse de tomber, comme tout autre fléau météorologique ou sismique, par exemple, tout ça pourrait être une réaction de défense d'une planète qui se sent agresser. Pour Damien, la relation entre l'Homme et la Nature ne peut passer que par la domination de l'un sur l'autre et pas dans la cohabitation harmonieuse.
Et donc, l'homme doit tout faire pour empêcher la nature de lui nuire par quelque moyen que ce soit. Voilà une vision largement à contre-courant ! Attention, Damien n'est pas quelqu'un qui veut détruire la nature, entendons-nous bien, mais il ne lui fait pas confiance, il la croit dangereuse et voudrait pourvoir calmer ses ardeurs. Il la redoute, et le déluge semble lui donner en partie raison.
Etonnamment, ce côté "entité vivante" d'une nature capable de réagir et de se venger de celui qui la maltraite, était déjà au coeur du livre dont nous avons parlé il y a quelques jours, "Après la chute", de Nancy Kress. Dans un genre littéraire, un style et un contexte totalement différents, mais j'ai été amusé et surpris de croiser cette théorie très intéressante.
Euh, intéressante ne signifie pas que je la partage. En revanche, je trouve que sur le plan strictement romanesque, cette Nature douée d'un... instinct, d'une... raison, je ne sais pas quel mot pourrait convenir, est un formidable argument et un bel outil pour toute imagination galopante. D'autant que David Emton, à travers Damien, multiplie les démonstrations scientifiques, comme si ces créations humaines étaient des boucliers ou des preuves de la supériorité humaine, remise en cause par les éléments.
Entre la visite de Paris telle qu'on ne la verra jamais, en tout cas, je l'espère, malgré les prévisions de crues bien plus fortes et violentes que celle de 1910, et les questions qui tournent autour du bébé, le suspense, assez classique dans la structure, fonctionne bien. David Emton utilise des ficelles qu'on connaît, mais il casse aussi quelques codes.
Enfin, il y a cet enfant... Il y a quelque chose de biblique dans ce déluge. Le navire du blason de la capitale a des airs d'Arche de Noé (non, même pas de jeu mots avec le nom de l'ancien maire, tant pis pour vous !). Mais, comment ne pas songer à Jésus, avec ce bébé qui apparaît comme par l'opération du Saint-Esprit, oui, je sais, c'est facile, un 24 décembre ?
Hérode a des héritiers, nombreux et puissants, prêts à tout pour traquer cet innocent qui ne pourra pas fuir en Egypte à dos d'âne, mais va devoir faire confiance à ses parents adoptifs et provisoires pour retrouver des terres plus calmes, en traversant une Mer Morte pas près de s'ouvrir toute seule sur son passage, bien au contraire.
Que l'on soit croyant ou pas, nous vivons dans l'ère chrétienne, dont le point zéro est la date (approximative) de la naissance de Jésus. En cela aussi, ce bébé si menacé, a des airs christiques, puisqu'on croit deviner peu à peu que, par lui, une nouvelle ère pourrait débuter... Mais de quelle manière ?
Terminons par quelques derniers mots sur la toute fin du livre. Sans la dévoiler, bien sûr. Mais David Emton joue là aussi avec des peurs qu'on a déjà vu exploitées par d'autres romanciers, qui ont aussi été évoquées lors d'événements récents et qu'on pourrait relier à des événements présents. En imaginant les dernières pages se déroulant sur un autre continent, on se sent saisis d'un profond malaise et on croise fort les doigts pour que l'auteur se trompe.
mardi 16 septembre 2014
"Nul n'est besoin de faire de la terre un paradis : elle en est un. A nous de nous adapter pour l'habiter" (Henry Miller).
Je suis dans une période très... romans catastrophes. Je ne vais pas sortir les mots compliqués, post-apocalyptique, dystopie et tous ces machins-là, non parlons simple, dans mes lectures, tout part en vrille, en ce moment, à commencer par cette bonne vieille terre. Après "le nuage radioactif", de Benjamin Berton, qui se trouve en rayon littérature générale, voici un pur roman de SF signée par une romancière américaine, Nancy Kress. "Après la chute", que viennent de publier en France les éditions ActuSF, est un roman fascinant, dans le fond comme dans la forme, dans l'histoire qu'elle développe comme dans les thèmes plus profonds qui y sont abordés. Sans oublier une narration très étonnante qui fait de ce livre une sorte de puzzle dont les pièces ne s'assemblent que petit à petit sous nos yeux. Défi à relever : ne pas trop en dire. Et pourtant, il y aurait tant de choses à évoquer ! Ah, le billet frustrant que je sens arriver là !!

De nos jours, une mystérieuse série de disparitions. Toujours des enfants, jamais d'adultes, toujours des circonstances troubles, inquiétantes, même. En tout cas, difficile à expliquer et à comprendre. Voilà qui ne facilite pas le travail de la police. Oh, disons-le, les enquêteurs pataugent dans la semoule, la choucroute, le riz au lait, tout ce que vous voulez.
Pas l'ombre d'une piste pouvant expliquer ces disparitions qui laissent des familles éplorées et incapables de faire le deuil, si tant est qu'il y ait deuil... D'un côté, le désespoir de ne pas savoir, de l'autre, la colère de ne pas comprendre. Et des enfants qui disparaissent, encore et toujours, à intervalles plus ou moins réguliers.
Impuissantes, les autorités n'ont pas choisi de faire appel à un médium, non, ils ont choisi une voie scientifique. Enfin, un des enquêteurs, l'agent spécial Gordon, a opté pour cette voie, de façon tout à fait officieuse et même clandestine. Il a demandé l'aide d'une informaticienne, Julie, qui, à partir des données récoltées par les enquêteurs, a mis en place un algorithme.
Recoupant non seulement les lieux et les dates des enlèvements, mais aussi les ceux d'autres événements apparemment mineurs et sans lien apparent avec l'affaire, elle affine sans cesse ses calculs. Elle espère ainsi pouvoir prendre de vitesse les kidnappeurs en "prédisant" (je mets des guillemets, car le mot n'est pas forcément adéquat) où et quand ils frapperont la prochaine fois.
Force est de constater que, si l'algorithme est au point, techniquement parlant, il n'est pas encore parfait car, telle la cavalerie, la police arrive toujours trop tard. Le délai se réduit, c'est vrai, mais pas suffisamment pour empêcher de nouvelles tragiques disparitions, au grand désespoir de tous, et particulièrement de Julie et de Gordon.
Le temps presse, pas seulement parce que les disparitions inexpliquées atteignent un nombre inquiétant, mais aussi parce que les vies de Julie et Gordon évoluent de telle façon que, bientôt, l'algorithme ne servira plus à rien. Julie se doit de vite comprendre la démarche des kidnappeurs pour endiguer leurs méfaits.
A la même époque, loin des regards humains, se déroulent des changements microscopiques mais fondamentaux. Dans la nature, ces changements modifient d'abord quelques écosystèmes, mais, bientôt, cela gagne du terrain, devient apparent. Pas de quoi inquiéter. Non, on s'interroge, seulement. Sans trouver de véritable réponse.
Et puis, on suit Pete, McAllister, Ravi, Caity, Darlene et quelques autres. Ils vivent dans l'Abri, qui a plus des allures de prison ou de caisson hyperbare, de très grande taille, il est vrai. Mais, en dehors des pièces, nombreuses, qui le compose, l'Abri semble être en dehors du temps et de l'espace, coupé de tout le reste du... monde, là encore, difficile, au moins au début, de dire si le mot est juste.
Là, on survit, comme on peut. Certains de ces habitants ont des malformations, d'autres soucis apparaissent aussi, dues au confinement permanent, au fait que les plus jeunes ne semblent rien savoir de ce qui peut exister en dehors de l'abri. Ni même rien de ce que peut être l'humanité, le monde, l'histoire... Ne reste que quelques cantiques claironnés par Darlene, sans aucune base pour les comprendre.
Pete est celui qu'on suit le plus parmi ces personnages. C'est un adolescent vindicatif, en colère, jaloux, plein de sève et d'envie. Un garçon impulsif et malheureux qui souffre sans doute de ne pas vraiment comprendre ce qu'il fait là. Volontiers bagarreur, aussi. L'Abri est trop petit pour lui, mais comment s'en émanciper ?
Cette communauté vit tant bien que mal, s'organise comme elle peut, attribuant des tâches à chacun, essayant d'entretenir des relations sociales les plus classiques possibles. Mais tous semblent avoir certains objectifs précis à remplir, mais sans vraiment en maîtriser tous les tenants et aboutissants. Ils agissent ou plutôt, obéissent.
Et voilà la dernière composante de ce roman, dont je ne vais vous donner que le nom : les Tesslies. Si j'en dis si peu, c'est que c'est un peu l'Arlésienne et qu'on pourrait se demander si ce n'est pas une illusion ou un mythe. A vrai dire, leur nature reste tout à fait incertaine même une fois le livre refermé. Leur rôle, lui, est plus évident. Mais, ça, je ne peux évidemment pas en parler ici.
Ah, nous voilà arrivé au point difficile de notre billet... Je vais essayer de parler des grandes thématiques de ce roman, sans trop en dire, mais si vous êtes "spoilosensible", autrement dit, si vous avez déjà eu des éruptions eczémateuses depuis que vous avez entamé la lecture de ce billet parce que j'ai osé dire un peu de quoi parle "Après la chute", alors, il semble plus prudent de vous arrêter ici.
"Après la chute" est un roman qui pose clairement la question de la survie de notre planète et, au-delà, de notre espèce. Mais Nancy Kress parvient à le faire de façon très habile, puisqu'elle brouille parfaitement les pistes. La façon dont les trois histoires qui s'entrecroisent dans le roman sont présentées contribuent.
Le fameux point de vue cher à Philip K. Dick.
Derrière, il y a les inconséquences, allez, disons le mot, l'incurie de tous ceux qui vivent sur ce petit caillou bleu. Par ignorance, négligence, indifférence, pour le profit, la gloire, pour maîtriser notre environnement et même le contrôler, le mettre à notre botte, nous concourons à la destruction de l'endroit où nous vivons.
Dans "Après la chute", pour la partie présente, tout du moins, rien ne semble aller de travers. Ce qui focalise l'attention, ce sont ces disparitions et cette partie qui est quasiment un polar. On n'est pas du tout dans un univers science-fictif, dans le sens où Nancy Kress y décrit la réalité. La normalité. Et pourtant, c'est bien là qu'est la source du dysfonctionnement : notre quotidien.
Là encore, pardon de ne pouvoir plus entrer dans le coeur de ce développement, cela en révélerait trop sur l'intrigue de ce roman. Je vous renvoie, comme c'est toujours le cas avec les livres publiés par ActuSF (et c'est une excellente idée, toujours intéressante et parfait complément de la lecture elle-même) à l'entretien avec Nancy Kress qui se trouve en fin d'ouvrage.
On y comprend que, là aussi, il est beaucoup question de point de vue. Et que ce qu'un auteur pet mettre en scène est une vision des choses, une vision (science-)fictive qui n'est pas forcément la sienne. Mais, cela sert un propos et ce propos est écologique : il n'est pas trop tard pour changer avant... la chute, justement.
L'enfance et la maternité plus largement, sont au coeur de ce roman, le premier que je lis de Nancy Kress. Que ce soit dans la partie contemporaine ou dans la partie future, ce sont des sujets qui occupent et préoccupent la plupart des personnages impliqués dans ces histoires. Et l'on va peu à peu comprendre pourquoi.
On s'attache aux personnages que Nancy Kress met en scène, aussi différents et éloignes soient-ils les uns des autres. Julie, d'un côté, et sachez que je ne vous ai pas tout dit à son propos, femme libre, indépendante et qui entend le rester, quoi qu'il arrive. Peter, de l'autre, pour qui on finit par ressentir de la compassion, piégé qu'il est dans un univers (dans le sens contextuel, pas astronomique) qui le dépasse.
A une vingtaine d'années d'intervalles, leurs destins respectifs deviennent les centres d'intérêt du lecteur : que va-t-il leur arriver et comment vont-ils pouvoir se sortir des situations forcément périlleuses qui les attendent ? Rien ne les relie l'un à l'autre, sauf justement ce lien qui passe par les interrogations et les inquiétudes du lecteur.
Reste une question sur laquelle je suis incapable de me prononcer : "Après la chute" est-il un roman optimiste ou pessimiste ? Chaque lecteur a sa sensibilité propre, chaque lecteur va projeter dans sa lecture ses idéaux, ses pensées, sa vision des choses, mais aussi son sentiment profond sur ce qui l'entoure. En gros, s'il est lui-même d'un naturel optimiste ou pessimiste.
Bon, ça ne fonctionne pas avec tous les romans. Mais j'ai toujours été frappé, en lisant les commentaires sur "la Route", de Cormac McCarthy, par exemple, de la divergence des avis entre lecteurs : d'un côté, ceux qui considèrent le livre comme uniformément sombre et dénué d'espoir : de l'autre, ceux qui pensent que l'espoir est au bout de la route...
Avec "Après la chute", je pense que l'on pourrait avoir le même genre de phénomène. Indéniablement, le lecteur est sous tension tout au long de la lecture, jusqu'à ce que le mécanismes narratifs lui révèlent ce qui peut bien relier les trois fils narratifs distincts. Et c'est une fin ouverte qui nous attend alors.
C'est alors, sans doute, que les points de vue de chaque lecteur devraient différer. Et tant mieux ! Il n'y a pas de vérité qui colle parfaitement à une fin ouverte. C'est l'interprétation du lecteur, selon les critères évoqués plus haut, qui va jouer. Chacun aura raison dans son interprétation des faits qui lui sont racontés. Qu'on y voit un éternel recommencement ou l'opportunité unique de se rédimer.
Je me suis pris au jeu proposé par Nancy Kress. J'ai cherché à comprendre où elle venait en venir. J'ai peu à peu profité du point de vue différent qui était le mien par rapport aux personnages pour comprendre ce qu'eux ne peuvent pas voir. Mais cela ne suffisait pas à assembler idéalement le puzzle. Non, pour cela, il a fallu aller jusqu'au bout.
En tout cas, jusqu'à un passage-clé de la dernière partie du roman, un passage bouleversant, aussi terrible qu'il résume exactement ce qui se passe dans cette histoire. Et puis, il y a tout ce dont je ne peux pas parler ici, qui est fascinant et change la relation que le lecteur pourrait avoir à ce qui l'entoure. Le fameux "et si..."
Un dernier mot sur le titre. Le titre français est différent du titre original. Là encore, je ne vais pas détailler mais juste attirer votre attention. Et, une fois n'est pas coutume, je trouve plus judicieux le titre français, même s'il est moins explicite que le titre américain. Plus judicieux, parce qu'il laisse une partie de la mécanique du roman dans l'ombre.
Récompensée à de multiples reprises pour "Après la chute", Nancy Kress signe là un véritable roman de science-fiction, avec ce qu'on s'attend à y trouver. Mais, c'est bien plus que ça, parce que le message sous-jacent est on ne peut plus d'actualité, on ne peut plus fort, on ne peut plus concernant. Reste à savoir si nous sommes prêts à l'entendre.

De nos jours, une mystérieuse série de disparitions. Toujours des enfants, jamais d'adultes, toujours des circonstances troubles, inquiétantes, même. En tout cas, difficile à expliquer et à comprendre. Voilà qui ne facilite pas le travail de la police. Oh, disons-le, les enquêteurs pataugent dans la semoule, la choucroute, le riz au lait, tout ce que vous voulez.
Pas l'ombre d'une piste pouvant expliquer ces disparitions qui laissent des familles éplorées et incapables de faire le deuil, si tant est qu'il y ait deuil... D'un côté, le désespoir de ne pas savoir, de l'autre, la colère de ne pas comprendre. Et des enfants qui disparaissent, encore et toujours, à intervalles plus ou moins réguliers.
Impuissantes, les autorités n'ont pas choisi de faire appel à un médium, non, ils ont choisi une voie scientifique. Enfin, un des enquêteurs, l'agent spécial Gordon, a opté pour cette voie, de façon tout à fait officieuse et même clandestine. Il a demandé l'aide d'une informaticienne, Julie, qui, à partir des données récoltées par les enquêteurs, a mis en place un algorithme.
Recoupant non seulement les lieux et les dates des enlèvements, mais aussi les ceux d'autres événements apparemment mineurs et sans lien apparent avec l'affaire, elle affine sans cesse ses calculs. Elle espère ainsi pouvoir prendre de vitesse les kidnappeurs en "prédisant" (je mets des guillemets, car le mot n'est pas forcément adéquat) où et quand ils frapperont la prochaine fois.
Force est de constater que, si l'algorithme est au point, techniquement parlant, il n'est pas encore parfait car, telle la cavalerie, la police arrive toujours trop tard. Le délai se réduit, c'est vrai, mais pas suffisamment pour empêcher de nouvelles tragiques disparitions, au grand désespoir de tous, et particulièrement de Julie et de Gordon.
Le temps presse, pas seulement parce que les disparitions inexpliquées atteignent un nombre inquiétant, mais aussi parce que les vies de Julie et Gordon évoluent de telle façon que, bientôt, l'algorithme ne servira plus à rien. Julie se doit de vite comprendre la démarche des kidnappeurs pour endiguer leurs méfaits.
A la même époque, loin des regards humains, se déroulent des changements microscopiques mais fondamentaux. Dans la nature, ces changements modifient d'abord quelques écosystèmes, mais, bientôt, cela gagne du terrain, devient apparent. Pas de quoi inquiéter. Non, on s'interroge, seulement. Sans trouver de véritable réponse.
Et puis, on suit Pete, McAllister, Ravi, Caity, Darlene et quelques autres. Ils vivent dans l'Abri, qui a plus des allures de prison ou de caisson hyperbare, de très grande taille, il est vrai. Mais, en dehors des pièces, nombreuses, qui le compose, l'Abri semble être en dehors du temps et de l'espace, coupé de tout le reste du... monde, là encore, difficile, au moins au début, de dire si le mot est juste.
Là, on survit, comme on peut. Certains de ces habitants ont des malformations, d'autres soucis apparaissent aussi, dues au confinement permanent, au fait que les plus jeunes ne semblent rien savoir de ce qui peut exister en dehors de l'abri. Ni même rien de ce que peut être l'humanité, le monde, l'histoire... Ne reste que quelques cantiques claironnés par Darlene, sans aucune base pour les comprendre.
Pete est celui qu'on suit le plus parmi ces personnages. C'est un adolescent vindicatif, en colère, jaloux, plein de sève et d'envie. Un garçon impulsif et malheureux qui souffre sans doute de ne pas vraiment comprendre ce qu'il fait là. Volontiers bagarreur, aussi. L'Abri est trop petit pour lui, mais comment s'en émanciper ?
Cette communauté vit tant bien que mal, s'organise comme elle peut, attribuant des tâches à chacun, essayant d'entretenir des relations sociales les plus classiques possibles. Mais tous semblent avoir certains objectifs précis à remplir, mais sans vraiment en maîtriser tous les tenants et aboutissants. Ils agissent ou plutôt, obéissent.
Et voilà la dernière composante de ce roman, dont je ne vais vous donner que le nom : les Tesslies. Si j'en dis si peu, c'est que c'est un peu l'Arlésienne et qu'on pourrait se demander si ce n'est pas une illusion ou un mythe. A vrai dire, leur nature reste tout à fait incertaine même une fois le livre refermé. Leur rôle, lui, est plus évident. Mais, ça, je ne peux évidemment pas en parler ici.
Ah, nous voilà arrivé au point difficile de notre billet... Je vais essayer de parler des grandes thématiques de ce roman, sans trop en dire, mais si vous êtes "spoilosensible", autrement dit, si vous avez déjà eu des éruptions eczémateuses depuis que vous avez entamé la lecture de ce billet parce que j'ai osé dire un peu de quoi parle "Après la chute", alors, il semble plus prudent de vous arrêter ici.
"Après la chute" est un roman qui pose clairement la question de la survie de notre planète et, au-delà, de notre espèce. Mais Nancy Kress parvient à le faire de façon très habile, puisqu'elle brouille parfaitement les pistes. La façon dont les trois histoires qui s'entrecroisent dans le roman sont présentées contribuent.
Le fameux point de vue cher à Philip K. Dick.
Derrière, il y a les inconséquences, allez, disons le mot, l'incurie de tous ceux qui vivent sur ce petit caillou bleu. Par ignorance, négligence, indifférence, pour le profit, la gloire, pour maîtriser notre environnement et même le contrôler, le mettre à notre botte, nous concourons à la destruction de l'endroit où nous vivons.
Dans "Après la chute", pour la partie présente, tout du moins, rien ne semble aller de travers. Ce qui focalise l'attention, ce sont ces disparitions et cette partie qui est quasiment un polar. On n'est pas du tout dans un univers science-fictif, dans le sens où Nancy Kress y décrit la réalité. La normalité. Et pourtant, c'est bien là qu'est la source du dysfonctionnement : notre quotidien.
Là encore, pardon de ne pouvoir plus entrer dans le coeur de ce développement, cela en révélerait trop sur l'intrigue de ce roman. Je vous renvoie, comme c'est toujours le cas avec les livres publiés par ActuSF (et c'est une excellente idée, toujours intéressante et parfait complément de la lecture elle-même) à l'entretien avec Nancy Kress qui se trouve en fin d'ouvrage.
On y comprend que, là aussi, il est beaucoup question de point de vue. Et que ce qu'un auteur pet mettre en scène est une vision des choses, une vision (science-)fictive qui n'est pas forcément la sienne. Mais, cela sert un propos et ce propos est écologique : il n'est pas trop tard pour changer avant... la chute, justement.
L'enfance et la maternité plus largement, sont au coeur de ce roman, le premier que je lis de Nancy Kress. Que ce soit dans la partie contemporaine ou dans la partie future, ce sont des sujets qui occupent et préoccupent la plupart des personnages impliqués dans ces histoires. Et l'on va peu à peu comprendre pourquoi.
On s'attache aux personnages que Nancy Kress met en scène, aussi différents et éloignes soient-ils les uns des autres. Julie, d'un côté, et sachez que je ne vous ai pas tout dit à son propos, femme libre, indépendante et qui entend le rester, quoi qu'il arrive. Peter, de l'autre, pour qui on finit par ressentir de la compassion, piégé qu'il est dans un univers (dans le sens contextuel, pas astronomique) qui le dépasse.
A une vingtaine d'années d'intervalles, leurs destins respectifs deviennent les centres d'intérêt du lecteur : que va-t-il leur arriver et comment vont-ils pouvoir se sortir des situations forcément périlleuses qui les attendent ? Rien ne les relie l'un à l'autre, sauf justement ce lien qui passe par les interrogations et les inquiétudes du lecteur.
Reste une question sur laquelle je suis incapable de me prononcer : "Après la chute" est-il un roman optimiste ou pessimiste ? Chaque lecteur a sa sensibilité propre, chaque lecteur va projeter dans sa lecture ses idéaux, ses pensées, sa vision des choses, mais aussi son sentiment profond sur ce qui l'entoure. En gros, s'il est lui-même d'un naturel optimiste ou pessimiste.
Bon, ça ne fonctionne pas avec tous les romans. Mais j'ai toujours été frappé, en lisant les commentaires sur "la Route", de Cormac McCarthy, par exemple, de la divergence des avis entre lecteurs : d'un côté, ceux qui considèrent le livre comme uniformément sombre et dénué d'espoir : de l'autre, ceux qui pensent que l'espoir est au bout de la route...
Avec "Après la chute", je pense que l'on pourrait avoir le même genre de phénomène. Indéniablement, le lecteur est sous tension tout au long de la lecture, jusqu'à ce que le mécanismes narratifs lui révèlent ce qui peut bien relier les trois fils narratifs distincts. Et c'est une fin ouverte qui nous attend alors.
C'est alors, sans doute, que les points de vue de chaque lecteur devraient différer. Et tant mieux ! Il n'y a pas de vérité qui colle parfaitement à une fin ouverte. C'est l'interprétation du lecteur, selon les critères évoqués plus haut, qui va jouer. Chacun aura raison dans son interprétation des faits qui lui sont racontés. Qu'on y voit un éternel recommencement ou l'opportunité unique de se rédimer.
Je me suis pris au jeu proposé par Nancy Kress. J'ai cherché à comprendre où elle venait en venir. J'ai peu à peu profité du point de vue différent qui était le mien par rapport aux personnages pour comprendre ce qu'eux ne peuvent pas voir. Mais cela ne suffisait pas à assembler idéalement le puzzle. Non, pour cela, il a fallu aller jusqu'au bout.
En tout cas, jusqu'à un passage-clé de la dernière partie du roman, un passage bouleversant, aussi terrible qu'il résume exactement ce qui se passe dans cette histoire. Et puis, il y a tout ce dont je ne peux pas parler ici, qui est fascinant et change la relation que le lecteur pourrait avoir à ce qui l'entoure. Le fameux "et si..."
Un dernier mot sur le titre. Le titre français est différent du titre original. Là encore, je ne vais pas détailler mais juste attirer votre attention. Et, une fois n'est pas coutume, je trouve plus judicieux le titre français, même s'il est moins explicite que le titre américain. Plus judicieux, parce qu'il laisse une partie de la mécanique du roman dans l'ombre.
Récompensée à de multiples reprises pour "Après la chute", Nancy Kress signe là un véritable roman de science-fiction, avec ce qu'on s'attend à y trouver. Mais, c'est bien plus que ça, parce que le message sous-jacent est on ne peut plus d'actualité, on ne peut plus fort, on ne peut plus concernant. Reste à savoir si nous sommes prêts à l'entendre.
jeudi 11 septembre 2014
"Ce que le nucléaire peut faire pour vous..."
Le titre ci-dessus est à prendre avec détachement, car, l'auteur de notre livre du jour l'utilise avec un parfait cynisme. Peu importe que vous soyez pour ou contre (voire indifférent) le nucléaire, d'ailleurs, même si, vous allez vite vous en rendre compte, le texte dont nous allons parler n'est pas vraiment un infomercial pour Areva, ni un de ces vieux films d'entreprise qui faisaient tant rire. Ce n'est pas non plus un guide du tourisme industriel en France, mais une fable écologique satirique qui devrait faire grincer quelques dents, car, au-delà de la charge contre le nucléaire, c'est aussi un roman qui dénonce la mondialisation, le modernisme poussé trop loin, l'oubli de l'Histoire et des racines de la France... Avec "le nuage radioactif", publié en grand format chez Ring Editions, Benjamin Berton renoue avec le mauvais esprit de ses premiers romans et nous offre une étrange galerie de personnages...
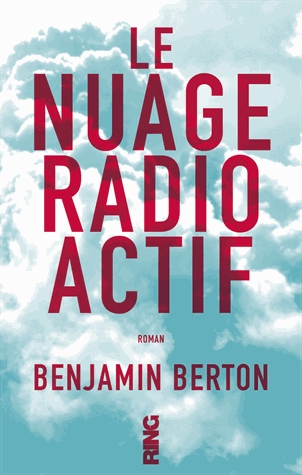
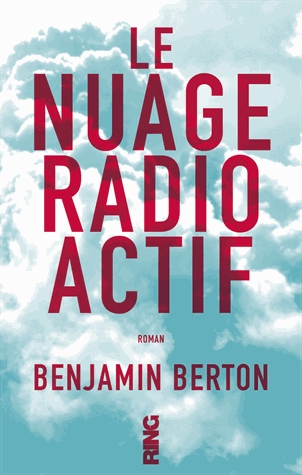
Un homme et un enfant sur une rive de la Loire. Face à eux, sur l'autre rive, un bâtiment fascinant : la centrale nucléaire de Chinon. La première centrale nucléaire construite en France, il y a 50 ans, fer de lance de cette industrie de pointe devenue un élément important de notre économie. Mais aussi, une activité controversée, jugée dangereuse et polluante par certains.
L'homme explique à l'enfant les principes de base du nucléaire et l'on sent, à sa façon d'en parler, que l'adulte n'est pas un chaud partisan du nucléaire. Pour lui, cette énergie modifie tout son entourage. La nature, mais aussi les hommes. Et pas seulement selon les clichés habituels, non, en profondeur, comme une forme d'évolution.
Il emmène le garçon à un endroit précis, à proximité de là où l'eau est pompée pour refroidir le réacteur et rejetée lorsqu'elle a rempli son rôle. Sous les yeux de l'homme et de l'enfant, monte alors dans le ciel un étrange nuage, pas très gros, mais à la couleur bizarre : bleu électrique. C'est comme si des éclairs brillaient de temps en temps à l'intérieur de ce nuage...
C'est lui, le centre de cette histoire. Son évolution, son développement, sa trajectoire... Et, effectivement, comme le pressent l'homme, il va influer sur tout l'entourage de la centrale, nature, hommes, relations humaines et encore énormément d'autres choses, que l'homme et l'enfant vont découvrir au cours de leur périple de quelques jours seulement.
Mais qui sont-ils ? Et pourquoi l'enfant ne semble-t-il pas connaître cet homme ? Un père et un fils, mais manifestement, l'histoire est plus compliquée que cela. Le père pourrait bien s'être imposé dans la vie de son rejeton. Peu à peu, on comprend qu'il a probablement enlevé cet enfant de 6 ou 7 ans à sa mère pour se lancer dans cette aventure nébuleuse, dans tous les sens du terme.
A chaque instant, Denis paraît mettre en garde son fils Ian contre le nucléaire, cette centrale et ses rejets, ce fameux nuage qui flotte, à la fois inoffensif et menaçant. Un voyage qui va les emmener dans un motel tenu par une jeune femme en fauteuil roulant, un bar à la rencontre d'un syndicaliste qui a travaillé longtemps à la centrale et de jumelles espiègles, dans un château habité par un duc qui incarne à lui seul tout le contraire d'un geek...
Et autour d'eux, vont s'agiter un détective privé corse en plein doute existentiel, un nationaliste norvégien aux pensées radicales, une jeune mère qui fait vivre comme elle peut sa famille monoparentale, une adolescente boutonneuse et fort complexée, un veuf très âgé et son épouse amoureux comme au premier jour et même des meutes de chiens-chiens à leurs mémères...
Tandis que tout ce petit monde s'agite, chacun cherchant à sa façon une espèce d'épanouissement personnel (oui, je sais, l'expression est un peu lourde et pas très claire, mais j'ai du mal à dire "bonheur"...), des choses bizarres se produisent, liées à ce fameux nuage, ou pas. Aucun d'eux ne s'en doute, à part Denis, mais la catastrophe guette et le monde ancien va s'en aller...
Difficile de savoir où nous emmène Benjamin Berton dans ce qui commence comme une flânerie avant de prendre de la vitesse, celle d'une locomotive folle lancée sur des rails à pleine vapeur. Mais c'était le cas déjà de certains de ses précédents romans, comme "Pirates" ou "Foudres de guerre". J'ai d'ailleurs retrouvé dans "le nuage radioactif" le même genre de construction et la volonté de l'auteur de nous faire rencontrer des personnages iconoclastes et des situations baroques.
Mention spéciale au fameux duc, personnage qui m'a énormément amusé, mais qui est aussi, nous allons y revenir, symptomatique de ce que nous raconte Benjamin Berton. Mais, commençons dans l'ordre, si vous le voulez bien, avec la question du nucléaire. Et, par conséquent, au titre de ce billet, qu'on retrouve plusieurs fois, dans des espèces d'interludes assez surprenants...
Oui, le nucléaire, dans ces situations-là, fait pour nous, enfin eux. Le nucléaire améliore effectivement considérablement la vie des gens. Il faudrait être de très mauvaise fois pour dire le contraire. Sauf que... Ce qui se passe sous nos yeux est drôle, déroutant, fou, incroyable, émouvant, délirant. Et toutes ces émotions, c'est au nucléaire qu'on le doit !
Mais, ce nucléaire, c'est comme ces plantes médicinales qui, à faibles doses, vous soignent, vous sauvent la vie, mais qui, si l'on en absorbe de trop fortes doses, vous empoisonnent. Et plane la menace de ces catastrophes terrifiantes, à nos portes, Three Mile Island, Tchernobyl ou, plus récemment, Fukushima. Et les nuages à venir, encore eux, pas bleu électrique, invisibles, insidieux et d'autant plus dangereux, ne s'arrêteront pas aux frontières...
Il y a dans "le nuage radioactif", et à plus d'un titre, quelque chose du "Ravage" de Barjavel. Une certaine méfiance dans la technologie, pour ne pas dire une véritable phobie. On la retrouve parfaitement incarnée chez le duc, en son château, qui pourfend les appareils électroniques, comme Don Quichotte chargeait les moulins à vent avec sa lance.
L'annonce d'un nouveau monde, différent du précédent, parce que table rase aura été faite et qu'il faudra reconstruire. Annonces prophétiques ou simples oiseaux de mauvais augure ? Si l'on suit Denis, on est clairement dans la première catégorie. Il n'a ni toge, ni gong et ne harangue pas les foules, tel Philippulus, mais il est sûr de ce qu'il avance, au point de tout laisser derrière lui, sauf son fils, promesse d'avenir.
Il y a aussi chez Berton la dénonciation de l'individualisme forcené du monde actuel. Finalement, la collectivité, la solidarité, l'entraide n'existent pas vraiment. Il y a beaucoup d'agissements qui ne sont que façade. Alors, si la catastrophe se profile, ce sera sauve qui peut et chacun pour soi. De quoi alimenter la panique et accroître les dégâts collatéraux.
Enfin, il y a la dénonciation du modernisme à tous crins, qui n'est pas que dans la technologie. Elle est aussi dans l'évolution des comportements, comme le château du duc qui menace ruine parce que plus personne ne vient le visiter, préférant d'autres activités, et même les visites de la centrale, puisque le tourisme industriel est en plein essor.
Mais ce duc, et ce n'est pas le seul élément à renvoyer à cela, incarne aussi le temps qui passe et efface le passé progressivement. Et les racines, avec. Oui, le duc est un homme d'aujourd'hui, mais il est vêtu comme au Moyen-Âge, vit dans un château aux antipodes d'un logement moderne, a la nostalgie d'un temps qu'il n'a pas connu mais auquel renvoie son nom, son titre, son rang...
La modernité submerge l'histoire, l'engloutit et donne naissance à des monstres. Avec la même efficacité invisible que le nucléaire quand il se déchaîne et quitte son confinement. Je trouve que la relation entre Denis et Ian fait écho à cela aussi, en posant la question de la transmission entre générations, qui connaît de la friture sur la ligne et a méchamment le hoquet.
Elle est très étrange, la relation entre l'homme et l'enfant. Chaotique, sinusoïdale, allant de la tendresse et de la complicité, presque jusqu'à l'affrontement, parfois. Denis n'est pas très patient et le gamin... est un gamin de 7 ans, actif, qu'il faut sans arrêt occuper et qui a la concentration flageolante...
Ian est presque l'allégorie de ce que nous sommes, nous, les adeptes de l'instantanéité, du zapping, de l'éphémère, du superflu, du superficiel... Emmenez l'enfant visiter des maisons troglodytes, il s'y intéressera jusqu'à ce que son regard tombe sur un dinosaure, dont on se demande quel rapport il a avec le lieu... Et c'est terminé, adieu, les maisons troglodytes et tout ce qui s'y rattache.
Je vois aussi dans le choix de Chinon et de la Loire quelque chose de tout à fait cohérent avec cette idée-là et je m'en vais en quelques lignes vous le démontrer. La Loire est le plus long fleuve de France et nombre de villes se sont construites sur ses rives. Ce fleuve majestueux invitait au voyage, aux rencontres, au commerce, au lien social.
Mais qui y circule encore, de nos jours ? Ce fleuve, qui fut si utile à la construction de la France, n'est plus aujourd'hui qu'un circuit de refroidissement pour centrales nucléaires, à côté desquels on ne veut pas vivre, dont on s'éloigne. On voyage autrement, loin, plus vite, sans s'attarder... On crée de moins en moins de lien.
Et puis, Chinon, c'est là que Jeanne d'Arc fut reconnue par Charles VII et que le royaume de France va entamer la période cruciale qui va le libérer du "perfide Anglois" voulant faire main basse sur lui. Quelque part, c'est le berceau de la France moderne que poursuivre François Ier, autre monarque à avoir installer son pouvoir sur les rives de la Loire.
Je ne peux pas trop développer l'aspect anti-mondialiste, il nous emmènerait trop loin dans le livre, mais c'est ainsi que j'ai lu la fin. D'aucuns pourraient parler de repli sur soi, de souverainisme. J'y ai lu cela, en tout cas, même si le personnage du Norvégien, qui rappelle furieusement, c'est le mot, un certain Breivik, vient contrebalancer les exagérations possibles dans une dénonciation du nationalisme et de ses dérives.
Bon, je crois que j'ai bien balayé ce livre qui m'a amusé autant qu'il m'a fait grincer des dents. Non, je ne suis pas forcément d'accord avec tous les points de vue développés par Benjamin Berton, mais, encore une fois, mon avis n'a pas d'importance, on parle du livre, ici, et je pense qu'on peut prendre du plaisir à cette lecture même si l'on ne partage pas cette vision du monde.
J'y ai retrouvé la verve et le côté provocateur des premiers romans même si je trouve qu'il va moins loin que dans ces livres, où les personnages ne se contentaient pas d'être extrêmes, leurs actes l'étaient aussi, jusqu'à une certaine folie. Régis, le syndicaliste, ou le duc, encore lui, pardon pour la fixette, sont de ces personnages complètement déjantés qui restent en mémoire, comme cet artiste qui remplaçait les fluides corporels de ses modèles par une solution de synthèse ou ces tordus qui prenaient leur pied dans des sables mouvants (personnages croisés chez Benjamin Berton, je le précise).
Il reste deux éléments connexes au roman à évoquer. Le premier, c'est la présence en fin d'ouvrage d'une courte bande dessinée signée par Kevin Cannon. Amusant, le sujet de cette bande dessinée commence là où s'arrête le passage du roman qu'elle illustre. Là aussi, c'est drôle et grinçant, un peu dérangeant également, surtout remis dans le contexte du livre. Mais l'idée est belle et la réalisation réussie.
Le second élément, c'est la présence, comme le font bien des auteurs maintenant, d'une copieuse play-list en fin d'ouvrage, où Black Reindeer tient la plus grande place. Mais, ce n'est pas de la carrière de Stephen Jones, alias Black Reindeer dont je veux vous parler, mais d'un musicien que l'on suit comme un fil rouge du début à la fin du livre : Aaron Copland.
Pourquoi lui ? Parce que sa vie et son oeuvre collent parfaitement à l'histoire du "nuage radioactif". Consciemment ou inconsciemment, Denis écoute la musique de ce compositeur à de nombreuses reprises. Et, lorsque les passages biographiques le concernant nous sont donnés, comme en voix-off, on se rend compte qu'il est l'incarnation de cet écartèlement permanent entre passé et futur, tradition et modernité, souvenir et oubli, être et paraître, discrétion et ostentation...
Autant finir en découvrant sa musique, non ?
dimanche 7 septembre 2014
Les états d'âme du Verlaine de la bidoche.
Voilà un roman qui ne devrait pas plaire à tout le monde. Parce qu'il est cru, sanglant, carnivore et même cannibale. Parce qu'il joue avec plein de choses, de l'auto-fiction au fait divers, en passant par les précédents livres de l'auteur. Rassurez-vous, pas besoin d'être incollables sur l'oeuvre de ce garçon qui sait se faire remarquer et donc les penchants alimentaires fortement carnés ne m'avaient pas échappé. Au moins, le titre annonce la couleur, sanglante ou bleue, selon le mode de cuisson que vous préférez : "la dévoration". C'est le nouveau roman que Nicolas d'Estienne d'Orves, romancier inclassable qui explose les genres à chaque fois qu'il sort un roman, sans sembler vraiment se soucier de froisser ses lecteurs, du politiquement correct et des modes, publie chez Albin Michel. Et, avec ce dernier livre, le voilà qui s'attaque de façon surprenante à la question de l'auteur, de son inspiration et de sa relation au mal, qui a toujours occupé une place de choix dans les romans de NEO.
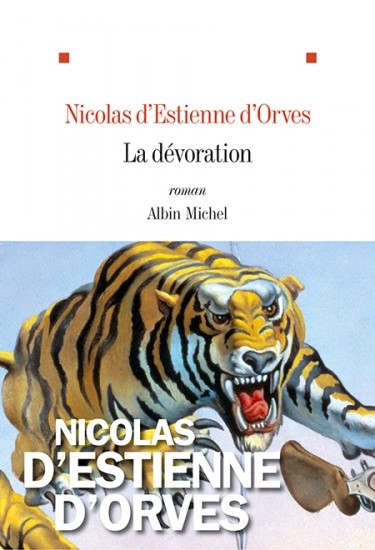
Nicolas est écrivain. Un écrivain connu pour ses livres où il ne se gêne pas pour explorer les ressorts du mal sous toutes ses formes, à grand renforts de scènes violentes et surtout sanglante. Voilà pourquoi on le surnomme "le Verlaine de la bidoche" et qu'on parle au sujet de son style, distancié, clinique, froid, de "poésie de la viande".
Lui-même, parfois, se demande sans vraiment trouver de réponses, d'où lui vient cette inspiration macabre et morbide qui le pousse à écrire de telles horreurs qui fascinent l'écrivain qu'il est mais turlupinent l'homme. Devenu écrivain suite à une douloureuse rupture sentimentale, Nicolas aimerait bien faire autre chose pour ses livres à venir, changer complètement, pour sa tranquillité d'esprit, mais nous allons y revenir.
La vie de Nicolas est assez particulière : il vit chez sa mère avec qui il ne s'entend pas, ne voit plus son père avec qui il fut complice mais dont il s'est éloigné, particulièrement depuis qu'il écrit et que son paternel n'adhère pas aux caractéristiques que j'ai évoquées. Et surtout à cette fascination pour la mort violente, le mal et tout ce qui les suscite.
Et puis, il y a sa grand-mère. Ah, quel personnage ! Si "vieille France", à la fois si délicieusement désuète, hors du temps, et en même temps, franchement insupportable, raciste et odieuse, profitant de sa condition de vieille dame en fauteuil roulant pour se montrer le plus souvent possible indigne, surtout lorsqu'elle emmène son petit-fils à l'opéra.
Toute la première partie de ce roman permet de découvrir la vie de vieux garçon de Nicolas, sa relation à ses proches, assez iconoclastes également, si vous m'avez bien suivi, son amitié avec Antoine, dont il accompagne les enfants dans des sorties culturelles et touristiques, et avec Cécile, la soeur d'Antoine, ses relations de travail, en particulier son éditrice, Judith...
Cécile, c'est son alter ego, avec elle, Nicolas explore et affronte son côté obscur, nourrissant une relation clandestine qui surprendrait sans doute leur entourage respectif s'il en avait connaissance. Je n'en dis pas plus, je suis certain que le mot "relation" nourrit déjà votre imagination. Mais vous êtes très loin de la vérité, croyez-moi.
Et puis, il y a Judith. Ils sont si différents l'un de l'autre mais si complices et incroyablement complémentaires dès qu'il s'agit de travailler. Une relation de travail, oui, mais un peu plus. Même si c'est plus compliqué que cela. Tout est plus compliqué, dans la vie de Nicolas, et dans l'oeuvre de Nicolas. Oui, moi aussi, je joue sur l'ambiguïté de ce prénom commun à l'écrivain et à son personnage.
Quand Nicolas évoque son envie de faire autre chose à Judith, elle l'encourage. Mais pour faire quoi ? "Décris ce que tu vois, qui tu rencontres, ce que tu manges", lui répond l'éditrice. Horrifié, Nicolas croit que Judith veut qu'il écrive de l'autofiction ! Mais, bientôt, entre sa vie si spéciale et un événement dont je ne vais rien vous dire, Nicolas va sentir affleurer le sujet de son prochain livre : Hojime Morimoto.
Un nom qui, une trentaine d'années plus tôt, a défrayé la frontière en France, en Europe et jusqu'à son Japon natal. Un nom qui, pour ceux qui s'en souviennent, fait encore froid dans le nom. Un nom qui rappelle des gros titres dans toute la presse, et pas seulement les feuilles de chou spécialisées dans le fait divers et le sordide. Un nom qui a pour synonyme le mot "cannibale"...
Que de choses à dire sur ce livre ! Que de choses sur un auteur adepte du contre-pied et du pied-de-nez à chacun de ses livres ! D'abord, cette première partie qui joue sur les codes de l'auto-fiction, en commençant pas ce prénom, j'en ai parlé. Mais aussi parce que Nicolas d'Estienne d'Orves multiplie les clins d'oeil à ses romans précédents. Tous ses romans !
Prime à la fidélité (successive ?) pour ses lecteurs ou simple facétie supplémentaire. Un peu des deux, d'autant que certains livres, comme le magnifique "Rue de l'Autre-Monde", sont désormais introuvable, à moins que le numérique... En attendant, cela permet d'entretenir l'équivoque entre les deux Nicolas, deux écrivains à la réputation un peu glauque.
Car il y a là Paris, les tunnels et les souterrains, les moments sombres de l'Histoire de France, à commencer par l'Occupation, l'opéra, les bonnes tables, les relations familiales compliquées, un rejet épidermique du politiquement correct, un léger côté réac' qui, j'en suis certain, en ravira certains (j'ironise, bien sûr...) et une vision de la nature humaine assez, euh, spéciale...
Les freaks ont pris une autre forme mais sont là aussi, composante marginale d'une société qui n'aime que le lisse et le propre sur lui. Enfin, Nicolas d'Estienne d'Orves réussit même avec beaucoup d'habileté et de drôlerie, à glisser le titre d'un de ses romans à un moment-clé de son récit. Le premier roman que j'ai lu de lui et qui m'a marqué, "Fin de race".
Oui, pour moi, c'est un jeu d'équilibriste assez amusant, un bel exercice de style qui fonde finalement toute le fond du roman et les questionnements du véritable Nicolas, celui de chair et de sang, si j'ose dire, pas celui d'encre et de papier. Car, les interrogations métaphysiques de Nicolas, le personnage, pourraient parfaitement s'appliquer au Nicolas, le créateur.
Nicolas d'Estienne d'Orves n'est pas le premier à se poser cette question de la relation du romancier au mal, à la violence, à la mort et aux multiples façons de la donner et de la raconter. J'ai déjà évoquer sur ce blog ce sujet à propos des romans les plus récents de Maxime Chattam, et en particulier son diptyque "Léviatemps - Requiem des Abysses".
Mais, autant je crois Maxime Chattam sincère dans sa démarche, autant je me méfie de la propension de Nicolas d'Estienne d'Orves à jouer du sarcasme. Reste que ces réflexions sont loin d'être inintéressantes, à commencer par une comparaison qui, je dois dire, m'a frappé et me donne encore matière à réfléchir.
Le romancier, le vrai, installe le romancier, pas tous les romanciers, mais disons l'auteur de thriller ou l'auteur de morbide, voire de grotesque, comme le bourreau des temps modernes. Dans une société où le voyeurisme est facilité par le développement des médias, en particulier audiovisuels, mais où la mort reste une image tabou, les romans qu'écrit Nicolas, le personnage, ont remplacé les exécutions publiques.
Les lecteurs de romans où la mal et le sang tiennent une grande place, assouvissent ce besoin de regarder l'horreur en face, comme lorsqu'on venait voir un criminel se faire raccourcir en place publique. D'un côté, l'auteur culpabilise de sa part sombre, ce démiurge qui donne vie mais peut aussi la retirer, et violemment, en plus, mais de l'autre, il renvoie le lecteur à son propre état de spectateur se délectant, si, si, du spectacle de l'horreur et du sang.
Nicolas d'Estienne d'Orves, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui peut le plus rebuter le lecteur non-averti, réduit, c'est vrai, notre brave vieux corps humain à un quartier de viande (sans négliger les abats), ce qui vaut à son personnage les appellations que j'ai données plus haut et jusque dans le titre de ce billet.
Sans doute face à la violence et au meurtre, faut-il désincarner l'humain, ne conserver que l'enveloppe de chair pour ne pas se sentir sale. Voilà ce que fait Nicolas, le personnage, quoi que, sans doute les deux Nicolas la font-ils, pour affronter les idées qui naisse dans son esprit et auxquelles il(s) donne(nt) vie sur le papier.
Reste qu'il y a quelque chose de dérangeant dans cet avilissement du corps, son rabaissement à un bout de barbaque qu'on imagine déjà pendu à un crochet dans une chambre froide... Et je ne dis pas ça par hasard, la boucherie joue un rôle non négligeable dans "la dévoration". Mais, évidemment, lorsqu'on évoque la viande, insidieusement, dans un premier temps, en tout cas, vient la dimension alimentaire de la chose.
Elle n'apparaît pas tout de suite, elle habite toute la deuxième moitié du livre, à travers le personnage de Hojime Morimoto. J'ai choisi d'en dire peu sur lui, le minimum, en fait, parce que cette histoire est vraie, même si les noms des personnages ont été modifiés, et si vous ne vous en souvenez plus ou êtes trop jeune pour cela, il faut vous laisser la découvrir.
Petite parenthèse, dans laquelle je vais parler de moi, ce n'est pas si courant. Un simple souvenir, lié à la venue de Nicolas d'Estienne d'Orves à Epinal, il y a quelques années. Ravi de le voir nous rejoindre, je vais le saluer le lendemain de son arrivée en lui demandant si tout se passait bien, s'il avait besoin de quelque chose.
Il me raconte alors qu'il est ravi de sa première soirée spinalienne car, lorsqu'il a été récupéré par le chauffeur à la descente du train, il était l'heure de dîner. Le romancier à alors demandé au bénévole chargé de le conduire de lui indiquer un restaurant sympa, si possible où l'on pouvait manger de la bonne viande. Eh oui, on y arrive...
S'en est suivi un repas dans un des restaurants bien connus des habitués de la préfecture des Vosges, près de la basilique, spécialisé dans les plats de viande. Un repas pour le moins copieux, aux dires de l'intéressé et qui m'est revenu à l'esprit en lisant ce livre. Et sans nausée, promis. Juste comme un élément à charge de plus dans la compréhension de cette vraie-fausse auto-fiction. Notre homme est un carnivore, un vrai. Refermons la parenthèse.
Et finissons ce billet avec un mot sur ce titre : "la dévoration". A prendre au propre et au figuré. Au propre, je ne vais pas m'étendre. Vous l'aurez compris, il est fortement question de cannibalisme dans ce roman et on a la démonstration parfaite de ce qui est dit plus haut, lorsqu'on évoque la fascination que l'horreur peut exercer sur le lecteur.
Mais, au figuré, je pense que c'est un des aspects les plus intéressants du roman. Car il répond aux interrogations du romancier, phagocyté par les contextes qu'il utilise comme décor, par les outils qu'il utilise, à commencer par la violence et les scènes sanglantes, par les personnages qu'il crée... Cette dévoration, c'est celle du roman qui happe son auteur et le grignote ou le mord à belles dents.
Les limites entre fiction et réalité deviennent floues, comme dans l'auto-fiction, justement, et il y a envahissement réciproque des monstres fictifs dans la calme existence de l'auteur. Nicolas, le personnage, est gagné par des pulsions dignes des personnages qu'il met en scène... Et il aime ça... Trop... Ne lui reste qu'une solution : dévorer pour ne pas être dévoré...
Et la dernière composante du travail habituel de Nicolas d'Estienne d'Orves intervient alors : la folie.
Oui, j'imagine que ce roman va en décontenancer, en dégoûter, en écoeurer certains. Je crois que NEO a tout à fait conscience de cela et que sa littérature, comme tout ce qu'il est et fait, a une vocation à provoquer cela chez les lecteurs. Viré de Radio France pour apologie de la pornographie et blasphème, il explore sans cesse dans ses romans ce qu'il y a de sombre en lui, mais pas seulement.
Et si ce qui nous met mal à l'aise dans tout cela venait de nous et pas de ce qu'écrit ce garçon ? Et si Nicolas d'Estienne d'Orves, comme sans doute beaucoup de ses collègues romanciers, déversait sur le papier ses funestes obsessions pour ne pas risque d'être dévoré par elles ? Encore une fois, lire "la dévoration" en restant au premier degré serait sans doute une erreur.
Prenez du recul. Appréciez "la poésie de la viande"...
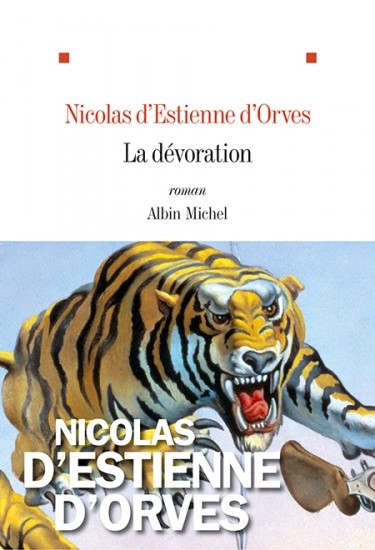
Nicolas est écrivain. Un écrivain connu pour ses livres où il ne se gêne pas pour explorer les ressorts du mal sous toutes ses formes, à grand renforts de scènes violentes et surtout sanglante. Voilà pourquoi on le surnomme "le Verlaine de la bidoche" et qu'on parle au sujet de son style, distancié, clinique, froid, de "poésie de la viande".
Lui-même, parfois, se demande sans vraiment trouver de réponses, d'où lui vient cette inspiration macabre et morbide qui le pousse à écrire de telles horreurs qui fascinent l'écrivain qu'il est mais turlupinent l'homme. Devenu écrivain suite à une douloureuse rupture sentimentale, Nicolas aimerait bien faire autre chose pour ses livres à venir, changer complètement, pour sa tranquillité d'esprit, mais nous allons y revenir.
La vie de Nicolas est assez particulière : il vit chez sa mère avec qui il ne s'entend pas, ne voit plus son père avec qui il fut complice mais dont il s'est éloigné, particulièrement depuis qu'il écrit et que son paternel n'adhère pas aux caractéristiques que j'ai évoquées. Et surtout à cette fascination pour la mort violente, le mal et tout ce qui les suscite.
Et puis, il y a sa grand-mère. Ah, quel personnage ! Si "vieille France", à la fois si délicieusement désuète, hors du temps, et en même temps, franchement insupportable, raciste et odieuse, profitant de sa condition de vieille dame en fauteuil roulant pour se montrer le plus souvent possible indigne, surtout lorsqu'elle emmène son petit-fils à l'opéra.
Toute la première partie de ce roman permet de découvrir la vie de vieux garçon de Nicolas, sa relation à ses proches, assez iconoclastes également, si vous m'avez bien suivi, son amitié avec Antoine, dont il accompagne les enfants dans des sorties culturelles et touristiques, et avec Cécile, la soeur d'Antoine, ses relations de travail, en particulier son éditrice, Judith...
Cécile, c'est son alter ego, avec elle, Nicolas explore et affronte son côté obscur, nourrissant une relation clandestine qui surprendrait sans doute leur entourage respectif s'il en avait connaissance. Je n'en dis pas plus, je suis certain que le mot "relation" nourrit déjà votre imagination. Mais vous êtes très loin de la vérité, croyez-moi.
Et puis, il y a Judith. Ils sont si différents l'un de l'autre mais si complices et incroyablement complémentaires dès qu'il s'agit de travailler. Une relation de travail, oui, mais un peu plus. Même si c'est plus compliqué que cela. Tout est plus compliqué, dans la vie de Nicolas, et dans l'oeuvre de Nicolas. Oui, moi aussi, je joue sur l'ambiguïté de ce prénom commun à l'écrivain et à son personnage.
Quand Nicolas évoque son envie de faire autre chose à Judith, elle l'encourage. Mais pour faire quoi ? "Décris ce que tu vois, qui tu rencontres, ce que tu manges", lui répond l'éditrice. Horrifié, Nicolas croit que Judith veut qu'il écrive de l'autofiction ! Mais, bientôt, entre sa vie si spéciale et un événement dont je ne vais rien vous dire, Nicolas va sentir affleurer le sujet de son prochain livre : Hojime Morimoto.
Un nom qui, une trentaine d'années plus tôt, a défrayé la frontière en France, en Europe et jusqu'à son Japon natal. Un nom qui, pour ceux qui s'en souviennent, fait encore froid dans le nom. Un nom qui rappelle des gros titres dans toute la presse, et pas seulement les feuilles de chou spécialisées dans le fait divers et le sordide. Un nom qui a pour synonyme le mot "cannibale"...
Que de choses à dire sur ce livre ! Que de choses sur un auteur adepte du contre-pied et du pied-de-nez à chacun de ses livres ! D'abord, cette première partie qui joue sur les codes de l'auto-fiction, en commençant pas ce prénom, j'en ai parlé. Mais aussi parce que Nicolas d'Estienne d'Orves multiplie les clins d'oeil à ses romans précédents. Tous ses romans !
Prime à la fidélité (successive ?) pour ses lecteurs ou simple facétie supplémentaire. Un peu des deux, d'autant que certains livres, comme le magnifique "Rue de l'Autre-Monde", sont désormais introuvable, à moins que le numérique... En attendant, cela permet d'entretenir l'équivoque entre les deux Nicolas, deux écrivains à la réputation un peu glauque.
Car il y a là Paris, les tunnels et les souterrains, les moments sombres de l'Histoire de France, à commencer par l'Occupation, l'opéra, les bonnes tables, les relations familiales compliquées, un rejet épidermique du politiquement correct, un léger côté réac' qui, j'en suis certain, en ravira certains (j'ironise, bien sûr...) et une vision de la nature humaine assez, euh, spéciale...
Les freaks ont pris une autre forme mais sont là aussi, composante marginale d'une société qui n'aime que le lisse et le propre sur lui. Enfin, Nicolas d'Estienne d'Orves réussit même avec beaucoup d'habileté et de drôlerie, à glisser le titre d'un de ses romans à un moment-clé de son récit. Le premier roman que j'ai lu de lui et qui m'a marqué, "Fin de race".
Oui, pour moi, c'est un jeu d'équilibriste assez amusant, un bel exercice de style qui fonde finalement toute le fond du roman et les questionnements du véritable Nicolas, celui de chair et de sang, si j'ose dire, pas celui d'encre et de papier. Car, les interrogations métaphysiques de Nicolas, le personnage, pourraient parfaitement s'appliquer au Nicolas, le créateur.
Nicolas d'Estienne d'Orves n'est pas le premier à se poser cette question de la relation du romancier au mal, à la violence, à la mort et aux multiples façons de la donner et de la raconter. J'ai déjà évoquer sur ce blog ce sujet à propos des romans les plus récents de Maxime Chattam, et en particulier son diptyque "Léviatemps - Requiem des Abysses".
Mais, autant je crois Maxime Chattam sincère dans sa démarche, autant je me méfie de la propension de Nicolas d'Estienne d'Orves à jouer du sarcasme. Reste que ces réflexions sont loin d'être inintéressantes, à commencer par une comparaison qui, je dois dire, m'a frappé et me donne encore matière à réfléchir.
Le romancier, le vrai, installe le romancier, pas tous les romanciers, mais disons l'auteur de thriller ou l'auteur de morbide, voire de grotesque, comme le bourreau des temps modernes. Dans une société où le voyeurisme est facilité par le développement des médias, en particulier audiovisuels, mais où la mort reste une image tabou, les romans qu'écrit Nicolas, le personnage, ont remplacé les exécutions publiques.
Les lecteurs de romans où la mal et le sang tiennent une grande place, assouvissent ce besoin de regarder l'horreur en face, comme lorsqu'on venait voir un criminel se faire raccourcir en place publique. D'un côté, l'auteur culpabilise de sa part sombre, ce démiurge qui donne vie mais peut aussi la retirer, et violemment, en plus, mais de l'autre, il renvoie le lecteur à son propre état de spectateur se délectant, si, si, du spectacle de l'horreur et du sang.
Nicolas d'Estienne d'Orves, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui peut le plus rebuter le lecteur non-averti, réduit, c'est vrai, notre brave vieux corps humain à un quartier de viande (sans négliger les abats), ce qui vaut à son personnage les appellations que j'ai données plus haut et jusque dans le titre de ce billet.
Sans doute face à la violence et au meurtre, faut-il désincarner l'humain, ne conserver que l'enveloppe de chair pour ne pas se sentir sale. Voilà ce que fait Nicolas, le personnage, quoi que, sans doute les deux Nicolas la font-ils, pour affronter les idées qui naisse dans son esprit et auxquelles il(s) donne(nt) vie sur le papier.
Reste qu'il y a quelque chose de dérangeant dans cet avilissement du corps, son rabaissement à un bout de barbaque qu'on imagine déjà pendu à un crochet dans une chambre froide... Et je ne dis pas ça par hasard, la boucherie joue un rôle non négligeable dans "la dévoration". Mais, évidemment, lorsqu'on évoque la viande, insidieusement, dans un premier temps, en tout cas, vient la dimension alimentaire de la chose.
Elle n'apparaît pas tout de suite, elle habite toute la deuxième moitié du livre, à travers le personnage de Hojime Morimoto. J'ai choisi d'en dire peu sur lui, le minimum, en fait, parce que cette histoire est vraie, même si les noms des personnages ont été modifiés, et si vous ne vous en souvenez plus ou êtes trop jeune pour cela, il faut vous laisser la découvrir.
Petite parenthèse, dans laquelle je vais parler de moi, ce n'est pas si courant. Un simple souvenir, lié à la venue de Nicolas d'Estienne d'Orves à Epinal, il y a quelques années. Ravi de le voir nous rejoindre, je vais le saluer le lendemain de son arrivée en lui demandant si tout se passait bien, s'il avait besoin de quelque chose.
Il me raconte alors qu'il est ravi de sa première soirée spinalienne car, lorsqu'il a été récupéré par le chauffeur à la descente du train, il était l'heure de dîner. Le romancier à alors demandé au bénévole chargé de le conduire de lui indiquer un restaurant sympa, si possible où l'on pouvait manger de la bonne viande. Eh oui, on y arrive...
S'en est suivi un repas dans un des restaurants bien connus des habitués de la préfecture des Vosges, près de la basilique, spécialisé dans les plats de viande. Un repas pour le moins copieux, aux dires de l'intéressé et qui m'est revenu à l'esprit en lisant ce livre. Et sans nausée, promis. Juste comme un élément à charge de plus dans la compréhension de cette vraie-fausse auto-fiction. Notre homme est un carnivore, un vrai. Refermons la parenthèse.
Et finissons ce billet avec un mot sur ce titre : "la dévoration". A prendre au propre et au figuré. Au propre, je ne vais pas m'étendre. Vous l'aurez compris, il est fortement question de cannibalisme dans ce roman et on a la démonstration parfaite de ce qui est dit plus haut, lorsqu'on évoque la fascination que l'horreur peut exercer sur le lecteur.
Mais, au figuré, je pense que c'est un des aspects les plus intéressants du roman. Car il répond aux interrogations du romancier, phagocyté par les contextes qu'il utilise comme décor, par les outils qu'il utilise, à commencer par la violence et les scènes sanglantes, par les personnages qu'il crée... Cette dévoration, c'est celle du roman qui happe son auteur et le grignote ou le mord à belles dents.
Les limites entre fiction et réalité deviennent floues, comme dans l'auto-fiction, justement, et il y a envahissement réciproque des monstres fictifs dans la calme existence de l'auteur. Nicolas, le personnage, est gagné par des pulsions dignes des personnages qu'il met en scène... Et il aime ça... Trop... Ne lui reste qu'une solution : dévorer pour ne pas être dévoré...
Et la dernière composante du travail habituel de Nicolas d'Estienne d'Orves intervient alors : la folie.
Oui, j'imagine que ce roman va en décontenancer, en dégoûter, en écoeurer certains. Je crois que NEO a tout à fait conscience de cela et que sa littérature, comme tout ce qu'il est et fait, a une vocation à provoquer cela chez les lecteurs. Viré de Radio France pour apologie de la pornographie et blasphème, il explore sans cesse dans ses romans ce qu'il y a de sombre en lui, mais pas seulement.
Et si ce qui nous met mal à l'aise dans tout cela venait de nous et pas de ce qu'écrit ce garçon ? Et si Nicolas d'Estienne d'Orves, comme sans doute beaucoup de ses collègues romanciers, déversait sur le papier ses funestes obsessions pour ne pas risque d'être dévoré par elles ? Encore une fois, lire "la dévoration" en restant au premier degré serait sans doute une erreur.
Prenez du recul. Appréciez "la poésie de la viande"...
Inscription à :
Articles (Atom)