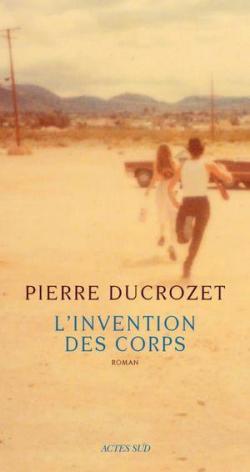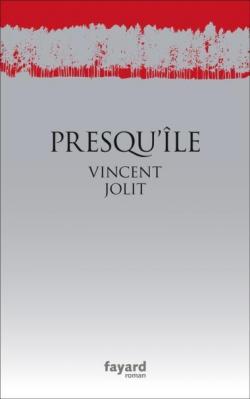Comme souvent ces dernières années, la science-fiction, sous différentes formes, diffusent dans la rentrée littéraire et s'installe, grâce à quelques titres, dans les rayons plus généralistes. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on déplore le manque de reconnaissance de ce genre, voici un roman à découvrir, dans lequel la dystopie permet d'évoquer des situations très actuelles et extrêmement complexes. Comme la situation au Moyen-Orient et la situation géopolitique de plus en plus tendue dans la vieille Europe, en raison du terrorisme islamiste. "Sous les serpents du ciel", d'Emmanuel Ruben (en grand format aux éditions Rivages), est une fable humaniste qui se déroule au milieu du XXIe siècle, dans un monde toujours plus difficile à vivre. Pourtant, c'est bien d'espoir qu'il est question, d'espoir et d'amour, de littérature, aussi, bref, de moyens alternatifs à la violence pour parvenir à la paix. Naïf et utopiste ? Certainement, mais n'avons-nous pas aussi besoin de croire cela possible, même le temps d'une lecture ?
Au milieu du XXIe siècle, le monde va mal. Le Moyen-Orient est devenu un archipel, baptisé les îles du Levant et, suite aux graves événements qui se sont succédé en Europe lors des premières décennies du siècle, un long mur a été construit pour empêcher de nouveaux terroristes de venir perpétrer des attentats en Occident.
Un mur construit de manière aussi arbitraire qu'aléatoire, car, comme ce fut le cas à Berlin, il traverse les villes, sépare les familles sans logique apparente, si ce n'est une certaine absurdité. Et, pour passer d'un coté à l'autre de ce mur, ultra-sécurisé en toutes circonstances, il faut se plier à des contrôles drastiques à des checkpoints.
De chaque côté du mur, des hommes et des femmes aux origines aussi diverses que peut l'être le monde. Des croyants, aussi, de toutes les religions, car c'est dans cette région que sont apparues les grandes religions monothéistes. Mais aussi des personnes qui se foutent éperdument de Dieu et de ses sbires, de ceux qui se revendiquent de lui pour justifier leurs violences.
Une fois encore les hommes ont choisi de diviser le monde en deux. Et cette zone, dans laquelle se déroule le roman, se retrouve coincé entre ce mur, protégé par les troupes régulières sous la surveillance (assez relâchée) de l'ONU et ceux qu'on appelle les Grands Barbures, comprenez ces fanatiques religieux qui veulent toujours imposer leur loi à tous, par la force. On est en pleine zone-tampon.
Lentement, comme ces eaux qui ont transformé cette région en une kyrielle d'îles, l'exaspération est montée. Le mur n'a rien calmé du tout, bien au contraire, et les tensions n'ont jamais diminué à son pied. Au point que, ce 30 septembre, la révolte a explosé, d'une manière totalement inattendue, surprenant tout le monde, acteurs comme spectateurs.
Et une première brèche a été ouverte, annonciatrice d'un prochain effondrement total du monument. Cela s'est produit dans un village, quelque part sur cette terre grignotée par la mer comme par le désert, sans violence, avec, au contraire, la volonté de faire de ce renversement un symbole de paix universelle. A condition que tout cela ne finisse pas par dégénérer, comme il est normal de le redouter.
Voilà pour le contexte, sur lequel nous reviendrons un peu plus loin. Voilà ce à quoi assiste quatre hommes, présents sur place, de part et d'autre de ce gigantesque mur, ce "Grand Barrage", soudain crevé. Depuis longtemps, ils observent la situation, y participent, même, quelquefois, et ils sont parmi les plus surpris de voir une brèche apparaître ce matin-là.
Pas n'importe quel matin...
Il y a Daniel, originaire de Normandie. Très tôt, il a eu une révélation, alors qu'il priait dans une chapelle de son village. Dieu lui a parlé et, malgré les réticences de sa famille, qui envisageait autrement sa destinée, il a fini par entrer dans les ordres, chez les Dominicains. Pendant ses études, il s'était découvert une passion pour cette région, à la fois sainte et tellement tourmenté.
Aussi, dès qu'il l'a pu, a-t-il postulé pour entrer au couvent Saint-Jude, l'un des hauts lieux spirituels de la région, situé à la frontière des quartiers d'une grande ville qui, sans jamais être nommée, rappelle Jérusalem. Un couvent qui, lors de la construction du Mur, va se retrouver du "mauvais" côté, celui que les constructeurs de l'ouvrage ont voulu isoler du reste du monde...
Mais, désormais, installé dans ce coin du monde où ne règne que la violence depuis aussi longtemps qu'on puisse s'en souvenir, confronté au drame de ces populations prises en tenailles et vouées au malheur, il a senti sa foi s'estomper jusqu'à disparaître. Comment croire encore dans ce Dieu qui l'irradiait pourtant de sa présence quelques années plus tôt, dans un endroit pareil ?
Il y a Mike, un militaire, un de ceux en charge de la surveillance permanente du mur, du contrôle de ceux qui veulent passer d'un côté à l'autre. Pour cela, ils bénéficient d'un matériel d'une grande modernité : des caméras un peu partout, des drones minuscules qui, avec une grande discrétion, observent les alentours du mur. Et l'oeil humain, bien sûr.
Sans pouvoir réaliser son rêve de devenir pilote de chasse, il a choisi la carrière militaire. Et s'est retrouvé devant ce mur, bien loin de ses rêves de gloire. A la différence du Drogo du "Désert des Tartares", il n'a jamais besoin d'attendre longtemps pour agir : sa citadelle a lui cristallise la colère de tout un peuple et celui-ci la manifeste de bien des façons possibles jour après jour...
La tension est de plus en plus forte, Mike le sent bien, et il doit faire peser toute son autorité pour maintenir le calme parmi ses hommes, prompts à vouloir dégainer, quitte à tirer sur des manifestants pacifiques. Lui a des états d'âme, hanté par des souvenirs douloureux. Sans oublier un élément très important dans ce contexte : même si le mot n'est jamais prononcé, on comprend que Mike est juif.
Il y a Djibril. Bien des années plus tôt, il a vécu en France et, en s'installant de l'autre côté du mur, il y a importé le Parkour, cette discipline urbaine où la ville n'est plus un décor, mais une succession d'obstacles qu'on franchit sans aucune aide matérielle, juste par les mouvements du corps (souvenez-vous du film "Yamakasi").
Désormais, à l'initiative de Djibril, le Parkour est la discipline sportive la plus en vogue de l'autre côté du mur. On le pratique dès l'enfance et l'on s'aguerrit en grandissant. Djibril est l'aîné de ces pratiquants, à la tête des Border Angels. Son rêve, c'est d'intégrer le Mur à leur terrain de jeu, d'affronter cette architecture particulière, mais aussi ceux qui le surveillent, au péril de leurs vies.
Personne ne semble vraiment les prendre au sérieux et pourtant, Djibril et ses amis sont tout aussi en colère que le reste des habitants de la zone tampon. Ils ne rêvent plus que de liberté, de briser le carcan dans lesquels ils sont piégés, entre le murs et les Barbures, qui voient en leur activité et leur mode de vie une insulte à leur religion... Alors, quitte à perdre la vie, autant le faire en essayant de sortir de là...
Enfin, il y a Samuel. Un ancien enseignant qui a choisi un jour de tout quitter pour s'engager dans une mission humanitaire auprès de l'ONU. Une carrière diplomatique qui, il l'a rapidement compris, n'aurait rien à voir avec ce qu'il imaginait : l'inactivité semble en être la première règle et l'ONU, plus "Machin" que jamais, n'a aucune autorité, aucun pouvoir...
Le voilà réduit au rôle d'observateur, gérant les cartes de la région en perpétuelle évolution, entre les changements imposés aux îles du Levant par les éléments, et la colonisation des territoires toujours à l'oeuvre. A peine un tracé est-il corrigé, à peine les cartes sont-elles imprimées, qu'elles sont obsolètes. Dans la région, la cartographie, c'est le mythe de Sisyphe !
Depuis un point surélevé, l'hôtel Belvédère, il a été le premier témoin des événements de ce 30 septembre. Il a observé cela avec passion et inquiétude, tout en revoyant défiler les souvenirs de son arrivée dans la région, plus de vingt ans auparavant. S'il est revenu, s'il a pris le risque de retrouver le Mur, c'est avec une ambition bien particulière...
Quatre narrateurs qui ont un point en commun : un cinquième personnage qui va s'inviter dans l'histoire. Walid, adolescent mort dans des circonstances dramatiques depuis des années. Tous l'ont connu, ont eu des liens particuliers avec lui. Tous, en ces circonstances, se souviennent de lui, car les personnes qui entreprennent de mettre bas le Mur l'ont choisi comme symbole.
Walid, qui va intervenir d'outre-tombe dans le cours du roman, fait figure d'exemple autant que d'ennemi public n°1, figure incarnant l'injustice de la situation et le joug qui pèse sur la population riveraine du Mur pour les uns, figure séditieuse et révoltée pour les autres, au point de craindre que son souvenir soit le moteur de nouvelles tentatives de soulèvement.
Mais qui est Walid et qui lui est-il exactement arrivé ?
On pourrait voir en lui une espèce de figure christique, servi par quatre évangélistes, mais il faut se méfier des apparences. Car, au fil des récits de chacun, on découvre la vie de Walid, sa personnalité très attachante, mais un peu déroutante, ainsi que la nature des relations que les autres entretenaient avec lui. Et leur culpabilité.
Walid, c'est, de prime abord, l'image des quelques grammes de finesse dans ce monde de brutes. Un enfant rempli de joie de vivre et d'espoir, dans ce décor chaotique et carcéral. Un esprit libre, un garçon qui, en grandissant, aurait pu devenir un poète... Mais, un jeune homme dont les zones d'ombre laissent entrevoir une personnalité plus complexe, où la révolte a pris le pas sur le reste...
A Walid, on va associer un objet : le cerf-volant. Là encore, Emmanuel Ruben fait de cet engin un élément qui dénote dans ce monde très sombre. Sa légèreté, sa flexibilité, la joie qu'il procure, son opposition directe au drone, version moderne, mais moins ludique, du cerf-volant, son côté poétique et aérien, tout cela semble incongru au pied du mur...
Vous le verrez en lisant le livre, le cerf-volant tient une place encore bien plus grande que ces quelques mots ne le laissent imaginer dans le roman. C'est aussi par eux que s'établissent les liens entre tous les personnages principaux. Et bien d'autres choses encore, mais il vous faudra attendre les dernières pages pour le comprendre.
Allégorie merveilleuse et pourtant à double tranchant, le cerf-volant est un message d'espoir, un message politique, aussi, porteur de paix. Il y a dans son usage un geste fort, aussi fort que les marches de Gandhi et de ses partisans, que les sit-in des opposants à la guerre du Vietnam ou que le violoncelle de Rostropovitch devant le mur de Berlin en passe de tomber.
Il y a, à travers lui, à travers la part d'enfance qu'il représente, aussi, avec l'insouciance qui l'accompagne, une vraie bouffée d'oxygène. Du beau pour contrer la laideur du monde. Et Walid, à travers cette objet, laisse aller son imagination, ses espoirs, ses souhaits, ses colères, aussi, écrivant à coups d'arabesque dans le ciel tout ce qu'il ressent.
Car "Sous les serpents du ciel" est bien un hymne au rêve, à l'imaginaire, en témoigne le choix de l'auteur de brouiller les pistes menant au réel : on est dans un futur proche, dans une région que l'on croit reconnaître mais où les lieux, les peuples, les pays ne sont pas clairement identifier avec les noms qu'on leur connaît.
On est dans un univers dystopique, indéniablement, avec tout ce que cela implique d'inquiétudes pour l'avenir, mais aussi dans un décor qui pourrait quasiment être celui d'un roman de fantasy, en réinventant complètement le monde que nous connaissons, en transposant les problématiques de notre monde dans un univers différents, parallèles...
Mais, ce flou savamment entretenu ne laisse jamais perdre de vue le principal sujet : la situation au Proche-Orient, véritable poudrière que la moindre étincelle rallume. Il y a d'ailleurs, dans la première partie du livre, quelque chose d'une énième Intifada. Et, face à cela, Walid, son regard si clair, son espoir évanoui si brutalement, son message si fort...
Oui, je le disais en préambule, il y a forcément une part de naïveté dans l'idée de dire que la lutte armée ne mène qu'à des spirales de violence, à d'interminables représailles dont les peuples sont les premières victimes, et que l'imaginaire, l'écriture, le romanesque et la poésie seraient des solutions bien plus pertinentes pour parvenir à la paix... Il y a là une belle réflexion à mener, malgré tout.
Mais je vous vois venir : n'y a-t-il pas de femmes, dans cet univers, dans cette histoire ? Mais, si, bien sûr, au contraire ! Elles y tiennent un rôle fondamental, essentiel. Elles sont les actrices qui dénoncent les autoritarismes, dont elles sont bien souvent les premières cibles, l'arbitraire et la présence de ce Mur, inculte et source de tourments, comme si briser le thermomètre effaçait la fièvre.
Les femmes sont là, oui, du début à la fin. Elles n'interviennent pas individuellement dans la narration, mais collectivement, tel un choeur antique. Des passages où l'on entend cette voix commune enfler, un chant, une scansion, même, symbolisée dans le livre par des passages en calligrammes.
Lisez-les bien, ces passages, ils sont forts, beaux, durs, violents, aussi. Un rejet puissant de la domination masculine, la volonté de ces êtres bafoués, refoulés, ignorés, maltraités, de prendre enfin les choses en main et d'imposer à leur tour leur vision du monde à ceux qui n'ont rien fait d'autre que détruire et tuer.
Là encore, vous le verrez, "Sous les serpents du ciel" se pare de poésie, de beauté, mais sans mâcher ses mots pour autant. L'expression d'une colère longtemps tue qui déferle et veut tout emporter sur son passage. A commencer par ce mur, qu'elle entend briser comme les lames parfois viennent briser les digues. Mais, l'inondation, ensuite, sera porteuse de vie, fertile et riche...
Voilà encore un bien long billet qu'il est temps d'achever. Il y a énormément de choses dans ce roman de 320 pages. Un livre qui utilise dans ce contexte à la fois contemporain, futuriste et proche des genres de l'imaginaire, les codes classiques de la tragédie. Parce que, hélas, pour le moment, c'en est une et ce n'est que cela. Mais, quoi qu'il arrive, il faut alimenter l'espoir, et la littérature sert aussi à ça.
"Il va falloir un jour qu'enfin je me décide à lire les livres que, depuis trente ans, je conseille à mes amis de lire". (Sacha Guitry)
jeudi 31 août 2017
mardi 29 août 2017
"Moi, je supportais Bruges et je n'étais personne".
Ouiiiiii, on va parler football ! Cinq mots et j'ai déjà fait fuir une bonne partie des lecteurs et d'autres aspergent leur écran d'eau bénite en brandissant de l'autre main un crucifix sur lequel est suspendu une gousse d'ail... Pourtant, rassurez-vous, s'il y a un ballon (en piteux état, d'ailleurs) sur la couverture et si le livre aborde effectivement ce sport autant adoré que honni, le foot n'est qu'un prétexte pour le narrateur pour raconter sa vie, une jeune existence qui peine à décoller, une adolescence qui s'attarde, refuse de laisser la place à l'âge adulte. Entre obsessions et expériences foireuses, voici un premier roman venu de Belgique, porté par un style assez trash. Le récit d'une page qui se tourne et d'une relation à la famille un peu compliquée. "Surface de réparation", d'Olivier El Khoury (aux éditions Noir sur Blanc), est aussi l'occasion d'aborder, sous ses airs potaches, quelques questions de société délicates que l'on retrouve également dans la société française...
Le narrateur est né un soir de match entre deux des grands rivaux du football belge, les bleus et noirs du Club de Bruges (j'allais écrire FC Bruges, trahissant d'emblée ma nationalité française, ouf, piège évité) et les mauves d'Anderlecht. Et, lorsqu'il a poussé son premier cri, ce sont les joueurs de la capitale qui menaient, au grand dam du père du narrateur.
Car ce médecin, pourtant sérieux en apparence, se mue en une espèce de furie dès que son équipe favorite, le Club de Bruges, entre sur la pelouse. Et ce soir-là, ce fut le cas. Peu importait la naissance de son premier enfant, il y avait match et il lui fallait connaître le résultat d'un match dont cet aléa familial l'avait privé...
Pour le narrateur, la passion du foot de son père, et plus précisément des Bleus et Noirs, est une véritable maladie qu'il a attrapé à son tour dès l'enfance (malgré un quiproquo initial qui aurait pu lui valoir d'être déshérité, au moins). Lui aussi devient un autre homme quand son équipe joue, un zébulon possédé, capable d'éprouver extase ou désespoir, comme si sa vie dépendait du résultat.
Mais, ce garçon n'est pas juste un supporteur un peu dingo, qui préfère d'ailleurs soutenir les siens depuis son canapé que dans les gradins d'un stade (je dois dire que je me reconnais un peu en lui ; et pas juste sur ce point...), c'est aussi un jeune adulte qui peine à assumer les responsabilités inhérentes à cet état. Celui que l'on découvre au fil des chapitres est un adolescent attardé de la plus belle eau.
Un garçon à qui pourrait parfaitement concurrencer le Tanguy d'Etienne Chatilliez si ses parents lui en avaient laissé l'occasion. Un garçon aux amitiés aussi rares que solides, même lorsque ces amis, eux, montent dans le train de l'âge adulte quand lui reste à quai. Ces amitiés, particulièrement celle qui l'unit à Pierre depuis un épisode mémorable, est de celle qu'on aimerait tous connaître.
Et puis, ce narrateur, c'est aussi un gentil potache, plus porté sur la bouteille que sur le boulot, capable de maladresses qui le mettent toujours dans des situations inconfortables, et pas très chanceux, aussi, reconnaissons-le, souffrant, outre son addiction aux performances du Club de Bruges, d'une sévère obsession sexuelle.
Un dernier point qui occupe une grande place dans le livre, d'autant que ses besoins sont inversement proportionnels à son succès avec la gent féminine. "Surface de réparation", c'est aussi le récit d'une immense frustration et d'une certaine jalousie vis-à-vis d'un de ses amis, Pierre, un don juan invétéré au pouvoir de séduction sans limite.
Au narrateur, reste la masturbation, qu'il pratique avec assiduité, faute de pouvoir rencontrer la femme de sa vie. Quand je vous dis qu'on a l'impression de lire le récit d'un adolescent ! Mais, si j'en parle, si j'insiste, c'est que le sexe, et la manière, assez crue, il faut bien le dire, dont il en parle, a des causes et aussi des conséquences dans sa vie.
Commençons par les conséquences, même si ce n'est pas très logique. Cette façon de parler de sa vie sexuelle dans ses écrits va valoir au narrateur la colère noire de ses parents, qui vont avoir toutes les difficultés du monde à accepter ces histoires et le style avec lequel leur fils les raconte. Ils ont enfanté un obsédé, un pervers, un monstre, et ils ne le tolèrent pas...
Fini, Tanguy, carton rouge pour le fiston, exclu de sa propre famille pour cause de turpitudes morales étalées sur la voie publique ! Indigne de venir soutenir les Bleus et Noirs devant la télé familiale, même pour les grands rendez-vous, contre Anderlecht ou contre les Rouches du Standard de Liège. Indigne de venir saluer sa chère mère qui tricote en attendant que la folie footballistique retombe...
Et puis, il y a les causes. Et là, on touche à une partie plus dure de ce livre qui, je dois le dire, m'a bien fait rire. La misère sexuelle du narrateur tient aussi à son faciès. En effet, "Surface de réparation" est aussi l'occasion pour Olivier El Khoury de parler du racisme de la société belge. Un racisme subi dès l'enfance, qui s'est poursuivi plus tard et qui a pris, ces dernières années, de l'ampleur.
Le père du narrateur est originaire d'Afrique du Nord et, malgré tous ses efforts d'intégration, d'assimilation même (attention, ce que je dis est dans le livre), reste un visage sur lequel on croit lire des origines, de manière tout à fait arbitraire, et qui valent au jeune homme d'être souvent rejeté. Et pas uniquement par les demoiselles...
Plus sérieusement, Olivier El Khoury aborde dans quelques chapitres les récents attentats qui ont touché la Belgique, comme la France, et on entraîné, comme un réflexe pavlovien, un changement de regard sur ceux dont le visage n'est pas... assez Belge à leurs yeux. Si le narrateur prend les choses avec philosophie et une bonne dose de désinvolture, on comprend que le mal est profond.
Le constat qui est fait là vaut largement pour le France, et pour bien d'autres pays aux prises avec ce terrorisme islamiste qui sévit partout. Sauf qu'il ne s'agit justement pas d'un changement brutal, mais de la révélation de tendances bien ancrées dans nos vieilles sociétés européennes, qui ont toujours tendance à se sentir menacées. Tendances longtemps rampantes, désormais étalées sans retenue...
Non, la vie du narrateur n'est pas si simple qu'on pourrait le croire. Ce n'est pas juste l'histoire d'un glandeur, d'un dilettante qui fond en larmes quand son équipe laisse passer une fois de plus un titre de champion de Belgique à sa portée. C'est aussi celle d'un jeune homme aux prises avec une société difficile qui ne fait aucun cadeau et rejette ceux qui ne sont pas exactement dans la norme.
Mais, il ne faudrait pas non plus tomber dans le drame, car "Surface de réparation" n'en est certainement pas un. En dix-sept chapitres et autant d'histoires le concernant, le narrateur nous offre quelques moments de son existence où, pour notre plus grand plaisir, il ne paraît pas toujours à son avantage. Le lecteur, lui, se marre.
De son expérience qui a tourné court comme journaliste sportif dans un grand titre de la presse écrite belge à sa douloureuse initiation au surf (rien que d'y repenser, je ne peux m'empêcher de rire à nouveau), de son expérience en colocation chez un couple qui semble droit sorti d'un de ses propres fantasmes à sa première communion mémorable, on découvre un garçon aussi horripilant qu'attachant.
Sa manière de raconter autant que ses histoires font qu'on rit. Olivier El Khoury appelle un chat un chat, le langage est cru, certains diront qu'il l'est un peu trop, qu'il passe même les bornes de la vulgarité, mais cela sert parfaitement le propos et nourrit l'image gentiment attardée de ce jeune homme en complet décalage et destiné à être un loser prie encore que son club de coeur.
La franchise de son langage et son ton qui ne s'embarrasse pas de manières contribuent grandement à la drôlerie de ce premier roman plein de verve. Un roman dont les chapitres sont à la fois distincts et complémentaires, formant une mosaïque de l'enfance jusqu'aux 28 ans du narrateur. Pourquoi cet âge-là précisément ?
On le comprend dans les dernières pages et l'on ajoute à la dimension humoristique de ces brèves tranches de vie, une grande tendresse, une grande humanité, aussi. Ces deux derniers chapitres, racontés avec beaucoup de pudeur, marquent la fin de cette période d'adolescence prolongée. Soudain, c'est comme s'il grandissait, d'un seul coup. Comme s'il entrait enfin dans l'âge adulte.
Comme s'il guérissait brusquement de tous ses maux, de toutes ses obsessions, aussi, y compris celle du foot. Le dernier paragraphe de ce court roman (160 pages) marque le début du reste de sa vie, enfin libre, libre d'être lui-même, libre d'avancer. Comme si son écharpe bleu et noir l'avait entravé dès le berceau et qu'il l'arrachait, comme on arrache un sparadrap.
Je me demande, comme toujours avec ce genre de roman, quelle est la part d'autofiction qu'il y a dans "Surface de réparation". L'imagination ne se niche-t-elle que dans le style, qui rend certaines situations burlesques, d'autres provocatrices ? Le narrateur n'est-il qu'un gamin bravache qui se la joue en voulant choquer ? Ou bien, tout est-il arrivé, album souvenirs d'une enfance prolongée ?
Et, comme toujours avec ce genre de roman, je réprime ce besoin de savoir, car c'est justement là que réside sa force. "Surface de réparation" est un roman d'apprentissage à la tonalité très moderne, où alternent désillusions et douce euphorie. Une découverte d'une existence qui ne se déroule pas comme un match de foot, même si, "mené au score', le narrateur a désormais "toute une vie pour renverser la vapeur".
La sortie de "Surface de réparation" a occasionné quelques interviews d'Olivier El Khoury, alors, plutôt que de jouer les doctes aux connaissances infinies et vous dire "Ce sont tel et tel auteurs qui l'inspirent, d'ailleurs, on retrouve la même verve ici, et là aussi", je vous invite à l'écouter dans cette capsule réalisée par la librairie bordelaise Mollat.
Le narrateur est né un soir de match entre deux des grands rivaux du football belge, les bleus et noirs du Club de Bruges (j'allais écrire FC Bruges, trahissant d'emblée ma nationalité française, ouf, piège évité) et les mauves d'Anderlecht. Et, lorsqu'il a poussé son premier cri, ce sont les joueurs de la capitale qui menaient, au grand dam du père du narrateur.
Car ce médecin, pourtant sérieux en apparence, se mue en une espèce de furie dès que son équipe favorite, le Club de Bruges, entre sur la pelouse. Et ce soir-là, ce fut le cas. Peu importait la naissance de son premier enfant, il y avait match et il lui fallait connaître le résultat d'un match dont cet aléa familial l'avait privé...
Pour le narrateur, la passion du foot de son père, et plus précisément des Bleus et Noirs, est une véritable maladie qu'il a attrapé à son tour dès l'enfance (malgré un quiproquo initial qui aurait pu lui valoir d'être déshérité, au moins). Lui aussi devient un autre homme quand son équipe joue, un zébulon possédé, capable d'éprouver extase ou désespoir, comme si sa vie dépendait du résultat.
Mais, ce garçon n'est pas juste un supporteur un peu dingo, qui préfère d'ailleurs soutenir les siens depuis son canapé que dans les gradins d'un stade (je dois dire que je me reconnais un peu en lui ; et pas juste sur ce point...), c'est aussi un jeune adulte qui peine à assumer les responsabilités inhérentes à cet état. Celui que l'on découvre au fil des chapitres est un adolescent attardé de la plus belle eau.
Un garçon à qui pourrait parfaitement concurrencer le Tanguy d'Etienne Chatilliez si ses parents lui en avaient laissé l'occasion. Un garçon aux amitiés aussi rares que solides, même lorsque ces amis, eux, montent dans le train de l'âge adulte quand lui reste à quai. Ces amitiés, particulièrement celle qui l'unit à Pierre depuis un épisode mémorable, est de celle qu'on aimerait tous connaître.
Et puis, ce narrateur, c'est aussi un gentil potache, plus porté sur la bouteille que sur le boulot, capable de maladresses qui le mettent toujours dans des situations inconfortables, et pas très chanceux, aussi, reconnaissons-le, souffrant, outre son addiction aux performances du Club de Bruges, d'une sévère obsession sexuelle.
Un dernier point qui occupe une grande place dans le livre, d'autant que ses besoins sont inversement proportionnels à son succès avec la gent féminine. "Surface de réparation", c'est aussi le récit d'une immense frustration et d'une certaine jalousie vis-à-vis d'un de ses amis, Pierre, un don juan invétéré au pouvoir de séduction sans limite.
Au narrateur, reste la masturbation, qu'il pratique avec assiduité, faute de pouvoir rencontrer la femme de sa vie. Quand je vous dis qu'on a l'impression de lire le récit d'un adolescent ! Mais, si j'en parle, si j'insiste, c'est que le sexe, et la manière, assez crue, il faut bien le dire, dont il en parle, a des causes et aussi des conséquences dans sa vie.
Commençons par les conséquences, même si ce n'est pas très logique. Cette façon de parler de sa vie sexuelle dans ses écrits va valoir au narrateur la colère noire de ses parents, qui vont avoir toutes les difficultés du monde à accepter ces histoires et le style avec lequel leur fils les raconte. Ils ont enfanté un obsédé, un pervers, un monstre, et ils ne le tolèrent pas...
Fini, Tanguy, carton rouge pour le fiston, exclu de sa propre famille pour cause de turpitudes morales étalées sur la voie publique ! Indigne de venir soutenir les Bleus et Noirs devant la télé familiale, même pour les grands rendez-vous, contre Anderlecht ou contre les Rouches du Standard de Liège. Indigne de venir saluer sa chère mère qui tricote en attendant que la folie footballistique retombe...
Et puis, il y a les causes. Et là, on touche à une partie plus dure de ce livre qui, je dois le dire, m'a bien fait rire. La misère sexuelle du narrateur tient aussi à son faciès. En effet, "Surface de réparation" est aussi l'occasion pour Olivier El Khoury de parler du racisme de la société belge. Un racisme subi dès l'enfance, qui s'est poursuivi plus tard et qui a pris, ces dernières années, de l'ampleur.
Le père du narrateur est originaire d'Afrique du Nord et, malgré tous ses efforts d'intégration, d'assimilation même (attention, ce que je dis est dans le livre), reste un visage sur lequel on croit lire des origines, de manière tout à fait arbitraire, et qui valent au jeune homme d'être souvent rejeté. Et pas uniquement par les demoiselles...
Plus sérieusement, Olivier El Khoury aborde dans quelques chapitres les récents attentats qui ont touché la Belgique, comme la France, et on entraîné, comme un réflexe pavlovien, un changement de regard sur ceux dont le visage n'est pas... assez Belge à leurs yeux. Si le narrateur prend les choses avec philosophie et une bonne dose de désinvolture, on comprend que le mal est profond.
Le constat qui est fait là vaut largement pour le France, et pour bien d'autres pays aux prises avec ce terrorisme islamiste qui sévit partout. Sauf qu'il ne s'agit justement pas d'un changement brutal, mais de la révélation de tendances bien ancrées dans nos vieilles sociétés européennes, qui ont toujours tendance à se sentir menacées. Tendances longtemps rampantes, désormais étalées sans retenue...
Non, la vie du narrateur n'est pas si simple qu'on pourrait le croire. Ce n'est pas juste l'histoire d'un glandeur, d'un dilettante qui fond en larmes quand son équipe laisse passer une fois de plus un titre de champion de Belgique à sa portée. C'est aussi celle d'un jeune homme aux prises avec une société difficile qui ne fait aucun cadeau et rejette ceux qui ne sont pas exactement dans la norme.
Mais, il ne faudrait pas non plus tomber dans le drame, car "Surface de réparation" n'en est certainement pas un. En dix-sept chapitres et autant d'histoires le concernant, le narrateur nous offre quelques moments de son existence où, pour notre plus grand plaisir, il ne paraît pas toujours à son avantage. Le lecteur, lui, se marre.
De son expérience qui a tourné court comme journaliste sportif dans un grand titre de la presse écrite belge à sa douloureuse initiation au surf (rien que d'y repenser, je ne peux m'empêcher de rire à nouveau), de son expérience en colocation chez un couple qui semble droit sorti d'un de ses propres fantasmes à sa première communion mémorable, on découvre un garçon aussi horripilant qu'attachant.
Sa manière de raconter autant que ses histoires font qu'on rit. Olivier El Khoury appelle un chat un chat, le langage est cru, certains diront qu'il l'est un peu trop, qu'il passe même les bornes de la vulgarité, mais cela sert parfaitement le propos et nourrit l'image gentiment attardée de ce jeune homme en complet décalage et destiné à être un loser prie encore que son club de coeur.
La franchise de son langage et son ton qui ne s'embarrasse pas de manières contribuent grandement à la drôlerie de ce premier roman plein de verve. Un roman dont les chapitres sont à la fois distincts et complémentaires, formant une mosaïque de l'enfance jusqu'aux 28 ans du narrateur. Pourquoi cet âge-là précisément ?
On le comprend dans les dernières pages et l'on ajoute à la dimension humoristique de ces brèves tranches de vie, une grande tendresse, une grande humanité, aussi. Ces deux derniers chapitres, racontés avec beaucoup de pudeur, marquent la fin de cette période d'adolescence prolongée. Soudain, c'est comme s'il grandissait, d'un seul coup. Comme s'il entrait enfin dans l'âge adulte.
Comme s'il guérissait brusquement de tous ses maux, de toutes ses obsessions, aussi, y compris celle du foot. Le dernier paragraphe de ce court roman (160 pages) marque le début du reste de sa vie, enfin libre, libre d'être lui-même, libre d'avancer. Comme si son écharpe bleu et noir l'avait entravé dès le berceau et qu'il l'arrachait, comme on arrache un sparadrap.
Je me demande, comme toujours avec ce genre de roman, quelle est la part d'autofiction qu'il y a dans "Surface de réparation". L'imagination ne se niche-t-elle que dans le style, qui rend certaines situations burlesques, d'autres provocatrices ? Le narrateur n'est-il qu'un gamin bravache qui se la joue en voulant choquer ? Ou bien, tout est-il arrivé, album souvenirs d'une enfance prolongée ?
Et, comme toujours avec ce genre de roman, je réprime ce besoin de savoir, car c'est justement là que réside sa force. "Surface de réparation" est un roman d'apprentissage à la tonalité très moderne, où alternent désillusions et douce euphorie. Une découverte d'une existence qui ne se déroule pas comme un match de foot, même si, "mené au score', le narrateur a désormais "toute une vie pour renverser la vapeur".
La sortie de "Surface de réparation" a occasionné quelques interviews d'Olivier El Khoury, alors, plutôt que de jouer les doctes aux connaissances infinies et vous dire "Ce sont tel et tel auteurs qui l'inspirent, d'ailleurs, on retrouve la même verve ici, et là aussi", je vous invite à l'écouter dans cette capsule réalisée par la librairie bordelaise Mollat.
lundi 28 août 2017
"Ma femme se sent seule, ma femme a besoin de ce que je ne peux pas lui donner, ma femme n'est jamais contente".
Il y avait sans doute des citations plus explicites pour parler de notre livre du jour, mais justement, je les trouvais trop explicites. Or, ce roman, on s'en rend compte lorsqu'on lit la quatrième de couverture, joue sur l'ambiguïté de la situation et sur un mystère entretenu ensuite une bonne partie du roman. Chaque lecteur doit se faire une idée de ce qui peut se passer, de ce qui va se passer, mais la contrainte qui sera la nôtre dans ce billet est donc d'évoquer tout cela sans vous donner les éléments fondamentaux de cette histoire. Je sens qu'on va bien s'amuser, merci, Alma Brami ! Nous avons déjà évoqué deux de ses précédents romans, "Lolo" et "J'aurais dû apporter des fleurs", voici son septième livre, "Qui ne dit mot consent", qui vient de paraître au Mercure de France. Une histoire noire, dérangeante, violente et parfaitement amorale, un très intéressant roman qui lorgne vers le thriller psychologique. Et vous, jusqu'où iriez-vous par amour ?
Emilie et Bernard ont choisi d'installer à la campagne leur jolie famille. Une maison agréable dans un village calme, un grand jardin où Laura, leur fille aînée et Pierre, leur cadet, pourront grandir sereinement et joyeusement. Un lieu idyllique, un petit coin de paradis, toujours aussi beau, des années après leur emménagement.
Désormais, les enfants volent de leurs propres ailes. Emilie et Bernard ont la grande maison pour eux deux, pour y couler des jours heureux et sereins. Pourtant, très vite, Emilie a montré des signes d'ennui. La maison est assez isolée, ils ne connaissent pas grand-monde dans le coin et, comme elle ne travaille pas et ne conduit pas, les journées sont longues.
Emilie n'est pas du genre à se plaindre, du moment qu'elle est avec Bernard, ce n'est pas grave. Mais son mari est attentionné, aux petits soins et, dès les premiers mois dans leur nouvelle maison, il a cru remarquer que sa femme, qu'il appelle tendrement "Mon coeur", s'ennuyait. Pas question de la laisser ainsi, Bernard s'est mis en quatre pour y remédier.
Et depuis toutes ces années, régulièrement, lorsqu'il sent que le bourdon revient, il essaye de trouver la solution pour que Emilie ne sombre pas. Entre présent et souvenirs du passé, Emilie nous raconte sa vie de famille, sa vie d'épouse aux côtés de l'indispensable Bernard, leur amour qui ne s'est jamais érodé malgré le temps qui passe.
Elle raconte aussi cette maison belle comme lorsqu'ils l'ont découverte la première fois. Elle l'a meublée avec goût, pris soin de ce jardin qui embellit à chaque saison. Elle nous présente sa vie, cette vie dont elle n'osait rêver dans sa jeunesse, lorsqu'elle était une enfant si réservée qu'elle passait inaperçue partout, et qui est la sienne, désormais.
Et puis surtout, elle nous explique la manière dont son cher mari se débrouille depuis qu'ils sont venus vivre là pour qu'elle ne s'ennuie pas. Mais, lorsque débute le roman, il semble qu'on soit dans une mauvaise phase. Alors, comme d'habitude, Bernard a pris les devants et cherché la solution idéale et l'a trouvée.
C'est évidemment cette solution qui est au coeur de ce roman, vous l'aurez compris, la énième d'une longue série. Des solutions qui sont aussi le point névralgique de cette histoire. Et, peu à peu, le lecteur découvre des pans de la vie de couple d'Emilie et Bernard que personne ne soupçonne. Car, il se passe des choses bien étranges dans cette maison si belle, si calme...
Alors, oui, je sais, je ne dis rien dans ce court résumé. Un tout petit peu plus que la quatrième de couverture du livre, en fait. Mais, j'ai choisi de soigneusement laisser dans l'ombre l'essentiel. Et, forcément, si tout va bien (mais vu le mal que j'ai eu à formuler tout ça, je n'en mettrais pas ma tête à couper), vous devriez vous poser plein de questions...
Mais qui sont ces deux-là, Emilie et Bernard ? Et qu'est-ce qu'ils trafiquent donc dans leur baraque isolée du reste du monde ? Eh oui, j'ai été comme vous, et mes questions se sont multipliées à la lecture des premières pages du livre. Mon imagination s'est emballée, démontrant que je lis décidément trop de thrillers...
Avec un élément qui ajoute au trouble : cette narration à la première personne du singulier, donc limitée au seul point de vue d'Emilie. Et c'est tout sauf anecdotique, vous le comprendrez rapidement. D'abord, parce qu'on manque tellement d'éléments et de repères qu'on peut s'imaginer plein de choses. Ensuite, parce que cela induit de la subjectivité, et ici, c'est ce qui fait tout le sel de cette histoire.
Il y a un an, Harold Cobert nous offrait dans "la Mésange et l'ogresse" un portrait de femme très dérangeant. Mais, son personnage, nous le connaissions d'emblée, nous en avions entendu parler, nous savions à peu près où nous situer par rapport à elle. Or, c'est justement tout cela qui manque, lorsqu'on rencontre Emilie et Bernard.
Alors, oui, il m'a effleuré l'esprit que Emilie et Bernard pouvait former un couple aussi pervers et sordide que les Fourniret. Il fallait aller plus loin pour comprendre qui sont ces deux-là exactement et comment fonctionne leur ménage. Savoir si cette intuition était la bonne ou si je me suis allègrement planté, preuve que Alma Brami a sacrément bien goupillé son affaire...
Il règne sur ce roman une ambiance très pesante, inquiétante. Là encore, mon esprit (qui va aussi bien qu'on puisse aller, enfin, je crois, je vous remercie de vous inquiéter) s'est mis en marche. J'y ai vu une métaphore du supplice de la goutte d'eau, où le condamné doit endurer jusqu'à la folie la chute d'une simple goutte d'eau sur son front à intervalle régulier.
Il y a de cela dans "Qui ne dit mot consent", même si on se demande à quel moment la folie va intervenir. Et surtout, quelle forme elle prendra. Qui est le bourreau ? Qui est la victime ? Qui sont les victimes ? Eh oui, vous en êtes au même point que moi, lorsque, fébrilement (si, si, j'insiste), je tournais les pages, cherchant à comprendre qui menait la danse.
Petit à petit, se dessine le portrait des principaux protagonistes, mais forcément déformés par la narratrice, partie prenante de cette affaire. On commence surtout à comprendre ce qui se passe dans leur maison. Et pourtant, demeure une vraie ambiguïté sur la finalité des choses. Est-ce moi qui ai eu cette impression, parce que je noircis tout, ou est-ce volontaire ?
Je crois que ça l'est, car l'ambiance est celle d'un thriller psychologique. Il y a, d'une certaine manière, un peu de "Psychose", dans "Qui ne dit mot consent". Plus le roman de Robert Bloch que le film d'Hitchcock, qui a pris quelques libertés. Entendons-nous bien, je ne compare pas les histoires, j'évoque l'ambiance, étrange, tendue, sombre, inquiétante...
Ce livre d'Alma Brami propose une atmosphère particulièrement pesante et ambiguë digne de celles que sait créer François Ozon dans certains de ses films (on pense ici surtout à "Swimming Pool"). Il n'y a peut-être pas la même tension sexuelle, pour des raisons que l'on comprendra en lisant le livre, mais cette même violence larvée est là.
Question ambiance, j'ai songé à un autre roman, "le Contrat", de Donald Westlake, connu pour ses séries de romans noirs plutôt où l'humour tient une bonne place (comme celle mettant en scène le cambrioleur malchanceux Dortmunder), mais qui était aussi capable de signer des joyaux de noirceur et de perversité.
"Le contrat" (adapté très librement, là encore, le réalisateur français Thomas Vincent sous le titre "Je suis un assassin") repose sur le même genre d'ambiguïté que le roman d'Alma Brami : qui est qui ? Et qui est le plus apte à prendre les choses en main lorsque tout va partir en vrille ? Parce que, j'en étais certain dès les premières lignes, tout cela ne peut que mal finir !
Oui, j'étais certain d'avoir en main un drame. Mais je n'imaginais pas à quel point. Là encore, il faut mettre en avant le travail de construction narrative d'Alma Brami qui joue avec son lecteur, le prend à contre-pied, sème le doute, renverse les valeurs, laisse penser que... Encore une référence, question ambiance, tiens, on pense aux Chabrol des années 1960, ceux avec Jean Yanne, qui aurait fait un parfait Bernard.
Et puisqu'on évoque les castings, je me suis amusé à réfléchir à qui pourrait incarner les principaux rôles. Naturellement, les visages de Karin Viard et François Cluzet me sont venus à l'esprit. Curieusement, je n'arrive pas à savoir si c'est ça qui m'a rappelé 'Je suis un assassin", où ils jouent déjà tous les deux, ou si, au contraire, c'est d'avoir pensé au film qui a imposé les deux acteurs...
Et puis, parce que je n'arrive pas à me défaire de cette image depuis que j'ai fini le livre, j'ai aussi "casté" quelqu'un pour le rôle de Sabine, qui est certes un personnage secondaire, mais sans qui l'intrigue ne pourrait se développer. Et là, s'est imposée l'image de Frédérique Bel. Physiquement, je sais qu'elle ne colle pas à la description, mais, je n'y peux rien, elle est Sabine !
Allez, fin du petit jeu sans conséquence et, pour le moment, mon pari de réussir à parler de "Qui ne dit mot consent" sans trop en dévoiler, voire en jouant à mon tour à brouiller les pistes, est en passe d'être gagné. Pas mécontent... Et si j'insiste tellement sur l'ambiance, ce n'est pas juste parce que je ne veux pas parler de l'histoire elle-même, mais bien parce que c'est, pour moi, le moteur du livre.
J'ai lu d'une traite, un après-midi, ce court roman de 160 pages parce que je voulais savoir comment tout cela allait (mal) finir. J'ai trouvé ce livre d'une redoutable efficacité et j'imaginais volontiers Alma Brami ricaner de manière sardonique devant sa table de travail et son ordinateur, contente de ses effets et du trouble qu'elle allait semer. Alma, c'est moche !
C'est aussi de sa faute si, au fil de ma lecture, s'est invité Géraut, le personnage central de son précédent roman, "J'aurais dû apporter des fleurs". Parce que Emilie et lui sont frère et soeur de papier. Tant de points communs entre eux et pourtant, tant de choses qui les séparent. Leurs existences sont si différentes, mais leurs caractère si proches...
Emilie se raconte, et c'est comme un aparté. Le lecteur est son seul auditoire, les autres personnages, eux, ont d'elle une toute autre image. Exactement comme Géraut. Ce à quoi on assiste est une histoire sur laquelle on a collé une voix off qui semble en complet décalage. Comme s'il y avait en fait deux personnes et non une seule, celle qu'on voit, celle qu'on écoute.
On retrouve le jeu sur l'intériorité de la narration, sur la colère qui couve sous le boisseau des conventions sociales, de la bienséance et surtout, de l'amour. Irrésolu, irrationnel, inconditionnel. Et pourtant, Géraut et Emilie sont très différents l'un de l'autre. Aux antipodes l'un de l'autre, même. Le vernis s'écaille, l'armure va craquer, mais pour quel résultat ?
Oui, "Qui ne dit mot consent ?" est un roman d'amour. Ca ne saute pas aux yeux après ce que j'ai dit, et pourtant. Un amour fou, démesuré. Mais ce genre d'amour qui détruit tout, inexorablement. Un amour qui n'est qu'une forme de dépendance, totale, absolu, comme peut paraître cet amour aux yeux du reste du monde (mais pas de tous).
Il faudrait parler des rôles secondaires, des enfants du couple, qui m'ont bien agacé, de tant de choses encore. Et d'Emilie. Et de Bertrand. Et de ces derniers mots échangés qui déchirent enfin le voile et révèlent l'abomination dans toute son ampleur. La lâcheté et la méchanceté, aussi. Qui, enfin, distribuent exactement les rôles et scellent le drame.
Je n'ai rien vu venir, j'étais parti dans plein de directions, mais pas celle-là qui, avec quelques jours de recul, de décantation, comme j'aime le dire, me semble être la pire qu'on pouvait mettre en oeuvre. C'est d'un sadisme et d'une perversité terribles, c'est parfaitement amoral, oui, je le réécris, parfaitement odieux, et pourtant, cela s'achève sur une note d'espoir inattendue. Inespérée.
Emilie et Bernard ont choisi d'installer à la campagne leur jolie famille. Une maison agréable dans un village calme, un grand jardin où Laura, leur fille aînée et Pierre, leur cadet, pourront grandir sereinement et joyeusement. Un lieu idyllique, un petit coin de paradis, toujours aussi beau, des années après leur emménagement.
Désormais, les enfants volent de leurs propres ailes. Emilie et Bernard ont la grande maison pour eux deux, pour y couler des jours heureux et sereins. Pourtant, très vite, Emilie a montré des signes d'ennui. La maison est assez isolée, ils ne connaissent pas grand-monde dans le coin et, comme elle ne travaille pas et ne conduit pas, les journées sont longues.
Emilie n'est pas du genre à se plaindre, du moment qu'elle est avec Bernard, ce n'est pas grave. Mais son mari est attentionné, aux petits soins et, dès les premiers mois dans leur nouvelle maison, il a cru remarquer que sa femme, qu'il appelle tendrement "Mon coeur", s'ennuyait. Pas question de la laisser ainsi, Bernard s'est mis en quatre pour y remédier.
Et depuis toutes ces années, régulièrement, lorsqu'il sent que le bourdon revient, il essaye de trouver la solution pour que Emilie ne sombre pas. Entre présent et souvenirs du passé, Emilie nous raconte sa vie de famille, sa vie d'épouse aux côtés de l'indispensable Bernard, leur amour qui ne s'est jamais érodé malgré le temps qui passe.
Elle raconte aussi cette maison belle comme lorsqu'ils l'ont découverte la première fois. Elle l'a meublée avec goût, pris soin de ce jardin qui embellit à chaque saison. Elle nous présente sa vie, cette vie dont elle n'osait rêver dans sa jeunesse, lorsqu'elle était une enfant si réservée qu'elle passait inaperçue partout, et qui est la sienne, désormais.
Et puis surtout, elle nous explique la manière dont son cher mari se débrouille depuis qu'ils sont venus vivre là pour qu'elle ne s'ennuie pas. Mais, lorsque débute le roman, il semble qu'on soit dans une mauvaise phase. Alors, comme d'habitude, Bernard a pris les devants et cherché la solution idéale et l'a trouvée.
C'est évidemment cette solution qui est au coeur de ce roman, vous l'aurez compris, la énième d'une longue série. Des solutions qui sont aussi le point névralgique de cette histoire. Et, peu à peu, le lecteur découvre des pans de la vie de couple d'Emilie et Bernard que personne ne soupçonne. Car, il se passe des choses bien étranges dans cette maison si belle, si calme...
Alors, oui, je sais, je ne dis rien dans ce court résumé. Un tout petit peu plus que la quatrième de couverture du livre, en fait. Mais, j'ai choisi de soigneusement laisser dans l'ombre l'essentiel. Et, forcément, si tout va bien (mais vu le mal que j'ai eu à formuler tout ça, je n'en mettrais pas ma tête à couper), vous devriez vous poser plein de questions...
Mais qui sont ces deux-là, Emilie et Bernard ? Et qu'est-ce qu'ils trafiquent donc dans leur baraque isolée du reste du monde ? Eh oui, j'ai été comme vous, et mes questions se sont multipliées à la lecture des premières pages du livre. Mon imagination s'est emballée, démontrant que je lis décidément trop de thrillers...
Avec un élément qui ajoute au trouble : cette narration à la première personne du singulier, donc limitée au seul point de vue d'Emilie. Et c'est tout sauf anecdotique, vous le comprendrez rapidement. D'abord, parce qu'on manque tellement d'éléments et de repères qu'on peut s'imaginer plein de choses. Ensuite, parce que cela induit de la subjectivité, et ici, c'est ce qui fait tout le sel de cette histoire.
Il y a un an, Harold Cobert nous offrait dans "la Mésange et l'ogresse" un portrait de femme très dérangeant. Mais, son personnage, nous le connaissions d'emblée, nous en avions entendu parler, nous savions à peu près où nous situer par rapport à elle. Or, c'est justement tout cela qui manque, lorsqu'on rencontre Emilie et Bernard.
Alors, oui, il m'a effleuré l'esprit que Emilie et Bernard pouvait former un couple aussi pervers et sordide que les Fourniret. Il fallait aller plus loin pour comprendre qui sont ces deux-là exactement et comment fonctionne leur ménage. Savoir si cette intuition était la bonne ou si je me suis allègrement planté, preuve que Alma Brami a sacrément bien goupillé son affaire...
Il règne sur ce roman une ambiance très pesante, inquiétante. Là encore, mon esprit (qui va aussi bien qu'on puisse aller, enfin, je crois, je vous remercie de vous inquiéter) s'est mis en marche. J'y ai vu une métaphore du supplice de la goutte d'eau, où le condamné doit endurer jusqu'à la folie la chute d'une simple goutte d'eau sur son front à intervalle régulier.
Il y a de cela dans "Qui ne dit mot consent", même si on se demande à quel moment la folie va intervenir. Et surtout, quelle forme elle prendra. Qui est le bourreau ? Qui est la victime ? Qui sont les victimes ? Eh oui, vous en êtes au même point que moi, lorsque, fébrilement (si, si, j'insiste), je tournais les pages, cherchant à comprendre qui menait la danse.
Petit à petit, se dessine le portrait des principaux protagonistes, mais forcément déformés par la narratrice, partie prenante de cette affaire. On commence surtout à comprendre ce qui se passe dans leur maison. Et pourtant, demeure une vraie ambiguïté sur la finalité des choses. Est-ce moi qui ai eu cette impression, parce que je noircis tout, ou est-ce volontaire ?
Je crois que ça l'est, car l'ambiance est celle d'un thriller psychologique. Il y a, d'une certaine manière, un peu de "Psychose", dans "Qui ne dit mot consent". Plus le roman de Robert Bloch que le film d'Hitchcock, qui a pris quelques libertés. Entendons-nous bien, je ne compare pas les histoires, j'évoque l'ambiance, étrange, tendue, sombre, inquiétante...
Ce livre d'Alma Brami propose une atmosphère particulièrement pesante et ambiguë digne de celles que sait créer François Ozon dans certains de ses films (on pense ici surtout à "Swimming Pool"). Il n'y a peut-être pas la même tension sexuelle, pour des raisons que l'on comprendra en lisant le livre, mais cette même violence larvée est là.
Question ambiance, j'ai songé à un autre roman, "le Contrat", de Donald Westlake, connu pour ses séries de romans noirs plutôt où l'humour tient une bonne place (comme celle mettant en scène le cambrioleur malchanceux Dortmunder), mais qui était aussi capable de signer des joyaux de noirceur et de perversité.
"Le contrat" (adapté très librement, là encore, le réalisateur français Thomas Vincent sous le titre "Je suis un assassin") repose sur le même genre d'ambiguïté que le roman d'Alma Brami : qui est qui ? Et qui est le plus apte à prendre les choses en main lorsque tout va partir en vrille ? Parce que, j'en étais certain dès les premières lignes, tout cela ne peut que mal finir !
Oui, j'étais certain d'avoir en main un drame. Mais je n'imaginais pas à quel point. Là encore, il faut mettre en avant le travail de construction narrative d'Alma Brami qui joue avec son lecteur, le prend à contre-pied, sème le doute, renverse les valeurs, laisse penser que... Encore une référence, question ambiance, tiens, on pense aux Chabrol des années 1960, ceux avec Jean Yanne, qui aurait fait un parfait Bernard.
Et puisqu'on évoque les castings, je me suis amusé à réfléchir à qui pourrait incarner les principaux rôles. Naturellement, les visages de Karin Viard et François Cluzet me sont venus à l'esprit. Curieusement, je n'arrive pas à savoir si c'est ça qui m'a rappelé 'Je suis un assassin", où ils jouent déjà tous les deux, ou si, au contraire, c'est d'avoir pensé au film qui a imposé les deux acteurs...
Et puis, parce que je n'arrive pas à me défaire de cette image depuis que j'ai fini le livre, j'ai aussi "casté" quelqu'un pour le rôle de Sabine, qui est certes un personnage secondaire, mais sans qui l'intrigue ne pourrait se développer. Et là, s'est imposée l'image de Frédérique Bel. Physiquement, je sais qu'elle ne colle pas à la description, mais, je n'y peux rien, elle est Sabine !
Allez, fin du petit jeu sans conséquence et, pour le moment, mon pari de réussir à parler de "Qui ne dit mot consent" sans trop en dévoiler, voire en jouant à mon tour à brouiller les pistes, est en passe d'être gagné. Pas mécontent... Et si j'insiste tellement sur l'ambiance, ce n'est pas juste parce que je ne veux pas parler de l'histoire elle-même, mais bien parce que c'est, pour moi, le moteur du livre.
J'ai lu d'une traite, un après-midi, ce court roman de 160 pages parce que je voulais savoir comment tout cela allait (mal) finir. J'ai trouvé ce livre d'une redoutable efficacité et j'imaginais volontiers Alma Brami ricaner de manière sardonique devant sa table de travail et son ordinateur, contente de ses effets et du trouble qu'elle allait semer. Alma, c'est moche !
C'est aussi de sa faute si, au fil de ma lecture, s'est invité Géraut, le personnage central de son précédent roman, "J'aurais dû apporter des fleurs". Parce que Emilie et lui sont frère et soeur de papier. Tant de points communs entre eux et pourtant, tant de choses qui les séparent. Leurs existences sont si différentes, mais leurs caractère si proches...
Emilie se raconte, et c'est comme un aparté. Le lecteur est son seul auditoire, les autres personnages, eux, ont d'elle une toute autre image. Exactement comme Géraut. Ce à quoi on assiste est une histoire sur laquelle on a collé une voix off qui semble en complet décalage. Comme s'il y avait en fait deux personnes et non une seule, celle qu'on voit, celle qu'on écoute.
On retrouve le jeu sur l'intériorité de la narration, sur la colère qui couve sous le boisseau des conventions sociales, de la bienséance et surtout, de l'amour. Irrésolu, irrationnel, inconditionnel. Et pourtant, Géraut et Emilie sont très différents l'un de l'autre. Aux antipodes l'un de l'autre, même. Le vernis s'écaille, l'armure va craquer, mais pour quel résultat ?
Oui, "Qui ne dit mot consent ?" est un roman d'amour. Ca ne saute pas aux yeux après ce que j'ai dit, et pourtant. Un amour fou, démesuré. Mais ce genre d'amour qui détruit tout, inexorablement. Un amour qui n'est qu'une forme de dépendance, totale, absolu, comme peut paraître cet amour aux yeux du reste du monde (mais pas de tous).
Il faudrait parler des rôles secondaires, des enfants du couple, qui m'ont bien agacé, de tant de choses encore. Et d'Emilie. Et de Bertrand. Et de ces derniers mots échangés qui déchirent enfin le voile et révèlent l'abomination dans toute son ampleur. La lâcheté et la méchanceté, aussi. Qui, enfin, distribuent exactement les rôles et scellent le drame.
Je n'ai rien vu venir, j'étais parti dans plein de directions, mais pas celle-là qui, avec quelques jours de recul, de décantation, comme j'aime le dire, me semble être la pire qu'on pouvait mettre en oeuvre. C'est d'un sadisme et d'une perversité terribles, c'est parfaitement amoral, oui, je le réécris, parfaitement odieux, et pourtant, cela s'achève sur une note d'espoir inattendue. Inespérée.
vendredi 25 août 2017
"Je crois que j'attends. J'ai passé toute la nuit sans rien faire dans cette salle obscure maintenant baignée de lumière, et en même temps, j'ai marché des semaines entières au grand soleil".
Je ne fais pas partie des lecteurs qui souhaitent ne jamais quitter leur zone de confort. Au contraire, j'aime être surpris, dérangé, dérouté, largué, même quelquefois, et avec notre livre du soir, j'ai été servi. A vrai dire, deux choses avaient retenu mon attention : les personnages sur la couverture et le nom de l'auteur, dont nous reparlerons dans le cours de ce billet. Et me voilà embarqué dans un bien étrange voyage, pour partie immobile, pour une autre à un train de pèlerin. "Identités françaises", de Brice Matthieussent (aux éditions Phébus), est indéniablement un roman à classer dans la catégorie littérature de l'absurde. Mais, derrière le côté frappadingue et abracadabrantesque, comme souvent avec l'absurde, le propos est sombre et traite des actualités dramatiques qui rythment, hélas, nos vies depuis quelques années maintenant. Avec un constat essentiel : contre ceux qui veulent tout détruire, il faut continuer à vivre, à raconter des histoires et ne surtout pas se laisser aller mollement à la résignation.
Deux hommes se retrouvent dans une salle assez vaste, plongée dans le noir. Aux murs, sont accrochés des tableaux, à ce que devinent les deux protagonistes à la lueur d'une lanterne. Un seul couloir mène à cette salle et, au bout, il y a un distributeur de boissons. Sont-ils dans un musée ? Ils l'ignorent, mais c'est fort possible.
Qui sont-ils ? L'un des deux hommes s'appellent Ribouldingue et il faisait partie d'un fameux trio, les Pieds Nickelés. Mais, ses deux acolytes, Croquignol et Filochard, sont morts et le dernier membre du trio a connu une étonnante aventure : il est sorti de sa bande dessinées et a découvert l'existence en 3D, lui qui avait toujours vécu jusque-là en deux dimensions.
L'autre personnage dit s'appeler Pataquès, mais rien ne prouve que ce soit son vrai nom. Malgré son allure de rond-de-cuir et ses chaussures un peu ridicules, Pataquès a vécu, comme Ribouldingue, en enfreignant la loi. Un monte-en-l'air qui ne se sépare jamais de sa boîte à outils, utile en toutes circonstances, comme on le verra au cours de l'histoire.
Si Ribouldngue est un homme naturellement avenant, il est tout de même surpris de la prolixité de son nouveau compagnon. En effet, Pataquès souffre de digressionnite aiguë, ce qui entraîne, par moments, d'interminables tirades dans lesquelles abondent les comparaisons, péché mignon du garçon. Il faut alors l'interrompre vite, sous peine d'être noyé sous des images plus ou moins heureuses.
Enfin, dernière particularité de ce drôle de bonhomme, il se plaint de ne pas sentir ses pieds qu'il explique avoir égaré quelque part. C'est embarrassant, forcément, et il y a de quoi se lamenter, même si Pataquès a tendance à vite taper sur les nerfs de Ribouldingue. Ce gars-là, avec sa collection de lubies est un peu pénible !
Et puis, soudain, Pataquès rappelle à Ribouldngue qu'ils se connaissent, en tout cas, qu'ils se sont déjà rencontrés. Les souvenirs reviennent au Pied Nickelé qui ne l'est plus vraiment. Et tous ceux qui mettent en scène Pataquès ne sont pas forcément agréable. De quoi susciter une certaine méfiance chez l'ancien personnage de BD...
Mais que font-ils là ? Eh bien, ils n'en ont aucune idée. Ils ne savent même pas vraiment comment ils se sont retrouvés là, ni ce qu'on attend d'eux. Alors, ils attendent, regardant ce qui se trouve autour d'eux. Et découvrent, en particulier, un tableau que Pataquès reconnaît pour l'avoir reçu récemment : "les énervés de Jumièges", d'un certain Evariste-Vital Luminais...
Oui, je sais, à première vue, les deux hommes de ce tableau n'ont pas vraiment l'air d'être énervés, et pourtant... Explication un peu plus loin dans ce billet, promis ! C'est bien beau, cette peinture, mais ça n'explique pas ce que Ribouldingue et Pataquès font là... Alors, de sa boîte à outils, le second nommé sort un carnet et se met à lire...
Et voilà que l'on retrouve nos deux personnages, cette fois nommés R. et P., sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, envoyés là par un mystérieux commanditaire ! S'agit-il vraiment d'eux ? Il semble bien, mais ils n'ont aucun souvenir de ce voyage. Le carnet relaterait-il leur futur, alors ? Ce serait extraordinaire, il faut poursuivre la lecture, dans ce cas !
Et voilà que l'on alterne entre ce voyage, conté par Pataquès et les remarques qu'échangent les deux hommes sur ce récit dans leur salle obscure... Deux histoires qui vont maintenant s'entrecroiser, se confondre, par moments, se répondre ou s'opposer, mais deux histoires que l'on suit en parallèle. Y trouverons-nous des explications ?
Ce n'est pas certain, d'autant que le voyage s'annonce bien plus mouvementé que leur séjour dans la (peut-être) salle de musée plongée dans le noir. Ils y font en effet des rencontres, mais vont surtout être, dès le premier soir sur le chemin suivi par tant de pèlerins venus du monde entier, témoin d'un événement extraordinaire...
Alors qu'ils se restaurent dans le gîte où ils espèrent passer la nuit avant de reprendre la route, alors qu'ils assistent à un concert, des personnes masquées et armées font irruption dans le bâtiment et s'apprêtent à arroser de balles une salle remplis de pèlerins et de spectateurs qui n'ont rien remarqué à cause de la musique... Et alors...
Et alors, il faudra que vous lisiez la suite. Car, si "Identités françaises" n'est pas un roman à suspense, son caractère absurde fait qu'il ménage un bon nombre de surprises tout au long de sa double histoire. Au lecteur, mais surtout aux personnages qui ne savent jamais vraiment à quoi s'attendre. Ni dans la salle aux tableaux, ni sur le chemin vers Compostelle...
Reste que se pose toujours la question : de quoi parle exactement ce livre ? J'aimerais vous faire une réponse claire, précise, étayée, mais on est dans l'absurde ! Donc, je suis bien incapable de vous le dire. En fait, au fil des pages, j'avais l'impression d'être quelque part entre un pièce de Ionesco ou de Beckett et un duo formé par un clown blanc et son auguste.
Mais, quelques éléments apparaissent, tout de même : l'identité française, qui est présente dès le titre du roman, mais qui est rapidement rejetée, dès l'exergue, signée Edouard Glissant, puis dénoncée par les personnages. Les concepts d'identité nationale et de récit national sont jetés aux ordures par Pataquès et Ribouldingue.
De même, l'irruption d'un policier capable de se montrer particulièrement à cheval sur les règles et l'étiquette, semble dénoncer l'état d'urgence permanent, inefficace et inutile (la preuve, les policiers arrivent toujours en retard quand il se passe quelque chose, comme la cavalerie dans les westerns...). On voit bien que, sous couvert de l'absurde et du double récit, c'est de la France qu'il est question.
Mais, les maux ne viennent pas que de notre cher et vieux pays. Il y a cette attaque, dans l'auberge. Difficile de ne pas y voir des similitudes avec les attentats de novembre 2015 : un concert, des clients attablés en train de boire un verre... Cela semble clair, c'est un coup de semonce, une action terroriste. L'expression d'un fascisme.
Si vous allez sur le site des éditions Phébus, vous verrez que le mot fascisme est employé au pluriel. L'hydre a bien plusieurs têtes, et si l'on en coupe une, il en repousse plusieurs. Des idéologies apparemment dissemblables, mais une seule et même détermination : imposer par la force sa manière de penser et de vivre, et la volonté de faire disparaître ceux qui ne respectent pas ces codes...
Pour Brice Matthieussent, il semble évident que la menace est aussi diverses qu'elle est grande. La fin de son livre est encore plus explicite, je ne vais évidemment pas entrer dans le détail ici, mais là encore, il appelle un chat un chat et les événements que traversent Ribouldingue et Pataquès font là encore clairement allusion à d'autres drames récents.
Il choisit pour dénoncer tout cela d'emprunter la voie de l'absurde, grinçante et sombre sous ses allures déjantées. La mort est partout, dans ce livre, elle semble planer sur les deux récits dans lesquels évoluent Ribouldingue et Pataquès. Une menace latente qui, tour à tour, joue les séductrices ou attaquent, à la vitesse du cobra...
Alors que je lisais ce roman, j'ai vu passer sur Twitter un dessin de Marc Large paru dans "le Canard enchaîné", l'édition de cette semaine, je pense, au pire la précédente. Et alors que je cogitais déjà pour savoir comment aborder ce billet, je me suis dit qu'il résumait bien mieux que tous les mots ce que Brice Matthieussent voulait raconter :
Face à cela, difficile de savoir sur quel pied danser : à l'image des deux contextes dans lesquels se retrouvent les deux personnages, on peut soit rester à l'arrêt, soit avancer, malgré tout. Là encore, la parabole semble limpide, elle s'adresse à nous, qui vivons ces périodes compliquées, où l'on a tendance à se replier sur soi et où la peur nous fige, parfois...
Une alternative (qui n'en est pas vraiment une, le repli, l'arrêt n'est pas une solution, c'est la victoire de ceux qui sèment la haine) qu'illustre le tableau de Luminais. Nos fameux énervés... On pourrait prendre ce mot dans le sens que l'on emploie le plus couramment, bien sûr, car tout cela a de quoi énerver... Et l'énervement n'est pas bon conseiller.
Mais, vous le voyez bien, ces deux personnages sont au contraire plutôt passif. Qui sont-ils ? Ce sont deux des fils du roi Clovis II qui, selon la légende (en effet, ce récit ne tient pas la route historiquement, mais on le retrouve couramment évoqué : on retrouve l'idée du récit national), se sont révoltés contre leur père alors qu'il était parti en pèlerinage (tiens, tiens) en Terre Sainte.
A son retour, le roi les a vaincu et a rétabli son autorité légitime sur le royaume. Et, en guise de condamnation, il leur aurait fait brûler ou couper les nerfs des jambes : il les aurait fait... énerver, voilà, il y en a deux qui suivent, merci ! Puis, on les aurait placé sur une espèce de radeau afin de les laisser dériver sur la Seine, ce que représente le tableau de Luminais.
Là encore, on le voit, tout se recoupe, tout concorde, même s'il faut lire entre les lignes (enfin, pas complètement, car tout ce que je dis là est dans le roman et, vous verrez qu'à la suite de la citation placée en tête de ce billet, il y a d'autres explications très claires pour appréhender ce livre). Que derrière le côté déroutant, sans queue ni tête de l'histoire, il y a bel et bien du fond.
Dans "Identités françaises", Brice Matthieussent met en avant les raconteurs d'histoire et l'importance qu'ils ont et doivent continuer à avoir. On veut les faire taire, ce n'est sans doute pas pour rien : ils grattent toujours là où ça peut faire mal. Aussi est-il très important de les protéger, de leur offrir les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent exercer leur art, librement et sans risque.
Les raconteurs d'histoire, Brice Matthieussent les connaît bien. Si "Identités françaises" est son quatrième roman et s'il a publié une dizaine d'essais, son nom apparaît sur beaucoup d'autres couvertures aux côtés de celui de pointures du monde littéraire contemporain. Peut-être avez-vous d'ailleurs lu son travail, sans forcément le remarquer.
Car Brice Matthieussent est un traducteur très renommé, au palmarès qui laisse rêveur : Kerouac, Bukowski, John Fante, Jim Harrison, Brett Easton Ellis, Richard Ford, Robert McLiam Wilson ou encore Denis Johnson, pour les plus connus et ceux qu'il a accompagnés le plus régulièrement. Nous avons d'ailleurs évoqué récemment sur le blog sa traduction d' "Arbre de feu", de Denis Johnson.
Je le découvrais avec ce livre comme auteur, et non comme porteur de l'histoire d'un autre, et je dois dire que je me suis bien amusé aux frasques et aux déboires de Ribouldingue et Pataquès (c'est vrai que ça fait duo de clowns, non ?), mais je reconnais que c'est un livre déroutant, inhabituel et que cela nécessite de creuser un peu.
Mais, c'est justement pour cela que je tenais à parler de ce livre qui, je le crains, aura du mal à émerger au milieu de l'abondante production de cette rentrée littéraire. Si vous trouvez qu'on parle toujours des même livres, si vous recherchez des lectures différentes, si vous avez envie de prendre des risques et de vous aventurer hors de votre zone de confort, alors voilà un livre fait pour vous.
Deux hommes se retrouvent dans une salle assez vaste, plongée dans le noir. Aux murs, sont accrochés des tableaux, à ce que devinent les deux protagonistes à la lueur d'une lanterne. Un seul couloir mène à cette salle et, au bout, il y a un distributeur de boissons. Sont-ils dans un musée ? Ils l'ignorent, mais c'est fort possible.
Qui sont-ils ? L'un des deux hommes s'appellent Ribouldingue et il faisait partie d'un fameux trio, les Pieds Nickelés. Mais, ses deux acolytes, Croquignol et Filochard, sont morts et le dernier membre du trio a connu une étonnante aventure : il est sorti de sa bande dessinées et a découvert l'existence en 3D, lui qui avait toujours vécu jusque-là en deux dimensions.
L'autre personnage dit s'appeler Pataquès, mais rien ne prouve que ce soit son vrai nom. Malgré son allure de rond-de-cuir et ses chaussures un peu ridicules, Pataquès a vécu, comme Ribouldingue, en enfreignant la loi. Un monte-en-l'air qui ne se sépare jamais de sa boîte à outils, utile en toutes circonstances, comme on le verra au cours de l'histoire.
Si Ribouldngue est un homme naturellement avenant, il est tout de même surpris de la prolixité de son nouveau compagnon. En effet, Pataquès souffre de digressionnite aiguë, ce qui entraîne, par moments, d'interminables tirades dans lesquelles abondent les comparaisons, péché mignon du garçon. Il faut alors l'interrompre vite, sous peine d'être noyé sous des images plus ou moins heureuses.
Enfin, dernière particularité de ce drôle de bonhomme, il se plaint de ne pas sentir ses pieds qu'il explique avoir égaré quelque part. C'est embarrassant, forcément, et il y a de quoi se lamenter, même si Pataquès a tendance à vite taper sur les nerfs de Ribouldingue. Ce gars-là, avec sa collection de lubies est un peu pénible !
Et puis, soudain, Pataquès rappelle à Ribouldngue qu'ils se connaissent, en tout cas, qu'ils se sont déjà rencontrés. Les souvenirs reviennent au Pied Nickelé qui ne l'est plus vraiment. Et tous ceux qui mettent en scène Pataquès ne sont pas forcément agréable. De quoi susciter une certaine méfiance chez l'ancien personnage de BD...
Mais que font-ils là ? Eh bien, ils n'en ont aucune idée. Ils ne savent même pas vraiment comment ils se sont retrouvés là, ni ce qu'on attend d'eux. Alors, ils attendent, regardant ce qui se trouve autour d'eux. Et découvrent, en particulier, un tableau que Pataquès reconnaît pour l'avoir reçu récemment : "les énervés de Jumièges", d'un certain Evariste-Vital Luminais...
Oui, je sais, à première vue, les deux hommes de ce tableau n'ont pas vraiment l'air d'être énervés, et pourtant... Explication un peu plus loin dans ce billet, promis ! C'est bien beau, cette peinture, mais ça n'explique pas ce que Ribouldingue et Pataquès font là... Alors, de sa boîte à outils, le second nommé sort un carnet et se met à lire...
Et voilà que l'on retrouve nos deux personnages, cette fois nommés R. et P., sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, envoyés là par un mystérieux commanditaire ! S'agit-il vraiment d'eux ? Il semble bien, mais ils n'ont aucun souvenir de ce voyage. Le carnet relaterait-il leur futur, alors ? Ce serait extraordinaire, il faut poursuivre la lecture, dans ce cas !
Et voilà que l'on alterne entre ce voyage, conté par Pataquès et les remarques qu'échangent les deux hommes sur ce récit dans leur salle obscure... Deux histoires qui vont maintenant s'entrecroiser, se confondre, par moments, se répondre ou s'opposer, mais deux histoires que l'on suit en parallèle. Y trouverons-nous des explications ?
Ce n'est pas certain, d'autant que le voyage s'annonce bien plus mouvementé que leur séjour dans la (peut-être) salle de musée plongée dans le noir. Ils y font en effet des rencontres, mais vont surtout être, dès le premier soir sur le chemin suivi par tant de pèlerins venus du monde entier, témoin d'un événement extraordinaire...
Alors qu'ils se restaurent dans le gîte où ils espèrent passer la nuit avant de reprendre la route, alors qu'ils assistent à un concert, des personnes masquées et armées font irruption dans le bâtiment et s'apprêtent à arroser de balles une salle remplis de pèlerins et de spectateurs qui n'ont rien remarqué à cause de la musique... Et alors...
Et alors, il faudra que vous lisiez la suite. Car, si "Identités françaises" n'est pas un roman à suspense, son caractère absurde fait qu'il ménage un bon nombre de surprises tout au long de sa double histoire. Au lecteur, mais surtout aux personnages qui ne savent jamais vraiment à quoi s'attendre. Ni dans la salle aux tableaux, ni sur le chemin vers Compostelle...
Reste que se pose toujours la question : de quoi parle exactement ce livre ? J'aimerais vous faire une réponse claire, précise, étayée, mais on est dans l'absurde ! Donc, je suis bien incapable de vous le dire. En fait, au fil des pages, j'avais l'impression d'être quelque part entre un pièce de Ionesco ou de Beckett et un duo formé par un clown blanc et son auguste.
Mais, quelques éléments apparaissent, tout de même : l'identité française, qui est présente dès le titre du roman, mais qui est rapidement rejetée, dès l'exergue, signée Edouard Glissant, puis dénoncée par les personnages. Les concepts d'identité nationale et de récit national sont jetés aux ordures par Pataquès et Ribouldingue.
De même, l'irruption d'un policier capable de se montrer particulièrement à cheval sur les règles et l'étiquette, semble dénoncer l'état d'urgence permanent, inefficace et inutile (la preuve, les policiers arrivent toujours en retard quand il se passe quelque chose, comme la cavalerie dans les westerns...). On voit bien que, sous couvert de l'absurde et du double récit, c'est de la France qu'il est question.
Mais, les maux ne viennent pas que de notre cher et vieux pays. Il y a cette attaque, dans l'auberge. Difficile de ne pas y voir des similitudes avec les attentats de novembre 2015 : un concert, des clients attablés en train de boire un verre... Cela semble clair, c'est un coup de semonce, une action terroriste. L'expression d'un fascisme.
Si vous allez sur le site des éditions Phébus, vous verrez que le mot fascisme est employé au pluriel. L'hydre a bien plusieurs têtes, et si l'on en coupe une, il en repousse plusieurs. Des idéologies apparemment dissemblables, mais une seule et même détermination : imposer par la force sa manière de penser et de vivre, et la volonté de faire disparaître ceux qui ne respectent pas ces codes...
Pour Brice Matthieussent, il semble évident que la menace est aussi diverses qu'elle est grande. La fin de son livre est encore plus explicite, je ne vais évidemment pas entrer dans le détail ici, mais là encore, il appelle un chat un chat et les événements que traversent Ribouldingue et Pataquès font là encore clairement allusion à d'autres drames récents.
Il choisit pour dénoncer tout cela d'emprunter la voie de l'absurde, grinçante et sombre sous ses allures déjantées. La mort est partout, dans ce livre, elle semble planer sur les deux récits dans lesquels évoluent Ribouldingue et Pataquès. Une menace latente qui, tour à tour, joue les séductrices ou attaquent, à la vitesse du cobra...
Alors que je lisais ce roman, j'ai vu passer sur Twitter un dessin de Marc Large paru dans "le Canard enchaîné", l'édition de cette semaine, je pense, au pire la précédente. Et alors que je cogitais déjà pour savoir comment aborder ce billet, je me suis dit qu'il résumait bien mieux que tous les mots ce que Brice Matthieussent voulait raconter :
Face à cela, difficile de savoir sur quel pied danser : à l'image des deux contextes dans lesquels se retrouvent les deux personnages, on peut soit rester à l'arrêt, soit avancer, malgré tout. Là encore, la parabole semble limpide, elle s'adresse à nous, qui vivons ces périodes compliquées, où l'on a tendance à se replier sur soi et où la peur nous fige, parfois...
Une alternative (qui n'en est pas vraiment une, le repli, l'arrêt n'est pas une solution, c'est la victoire de ceux qui sèment la haine) qu'illustre le tableau de Luminais. Nos fameux énervés... On pourrait prendre ce mot dans le sens que l'on emploie le plus couramment, bien sûr, car tout cela a de quoi énerver... Et l'énervement n'est pas bon conseiller.
Mais, vous le voyez bien, ces deux personnages sont au contraire plutôt passif. Qui sont-ils ? Ce sont deux des fils du roi Clovis II qui, selon la légende (en effet, ce récit ne tient pas la route historiquement, mais on le retrouve couramment évoqué : on retrouve l'idée du récit national), se sont révoltés contre leur père alors qu'il était parti en pèlerinage (tiens, tiens) en Terre Sainte.
A son retour, le roi les a vaincu et a rétabli son autorité légitime sur le royaume. Et, en guise de condamnation, il leur aurait fait brûler ou couper les nerfs des jambes : il les aurait fait... énerver, voilà, il y en a deux qui suivent, merci ! Puis, on les aurait placé sur une espèce de radeau afin de les laisser dériver sur la Seine, ce que représente le tableau de Luminais.
Là encore, on le voit, tout se recoupe, tout concorde, même s'il faut lire entre les lignes (enfin, pas complètement, car tout ce que je dis là est dans le roman et, vous verrez qu'à la suite de la citation placée en tête de ce billet, il y a d'autres explications très claires pour appréhender ce livre). Que derrière le côté déroutant, sans queue ni tête de l'histoire, il y a bel et bien du fond.
Dans "Identités françaises", Brice Matthieussent met en avant les raconteurs d'histoire et l'importance qu'ils ont et doivent continuer à avoir. On veut les faire taire, ce n'est sans doute pas pour rien : ils grattent toujours là où ça peut faire mal. Aussi est-il très important de les protéger, de leur offrir les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent exercer leur art, librement et sans risque.
Les raconteurs d'histoire, Brice Matthieussent les connaît bien. Si "Identités françaises" est son quatrième roman et s'il a publié une dizaine d'essais, son nom apparaît sur beaucoup d'autres couvertures aux côtés de celui de pointures du monde littéraire contemporain. Peut-être avez-vous d'ailleurs lu son travail, sans forcément le remarquer.
Car Brice Matthieussent est un traducteur très renommé, au palmarès qui laisse rêveur : Kerouac, Bukowski, John Fante, Jim Harrison, Brett Easton Ellis, Richard Ford, Robert McLiam Wilson ou encore Denis Johnson, pour les plus connus et ceux qu'il a accompagnés le plus régulièrement. Nous avons d'ailleurs évoqué récemment sur le blog sa traduction d' "Arbre de feu", de Denis Johnson.
Je le découvrais avec ce livre comme auteur, et non comme porteur de l'histoire d'un autre, et je dois dire que je me suis bien amusé aux frasques et aux déboires de Ribouldingue et Pataquès (c'est vrai que ça fait duo de clowns, non ?), mais je reconnais que c'est un livre déroutant, inhabituel et que cela nécessite de creuser un peu.
Mais, c'est justement pour cela que je tenais à parler de ce livre qui, je le crains, aura du mal à émerger au milieu de l'abondante production de cette rentrée littéraire. Si vous trouvez qu'on parle toujours des même livres, si vous recherchez des lectures différentes, si vous avez envie de prendre des risques et de vous aventurer hors de votre zone de confort, alors voilà un livre fait pour vous.
jeudi 24 août 2017
"Internet et le code, c'est du corps, et le corps est un réseau, dans lequel tous les éléments sont reliés".
Chez Actes Sud, cette rentrée littéraire semble placée sous le signe de l'immortalité. Enfin, de la quête d'immortalité. Ou, encore plus précisément, du refus de la mort. C'est en effet un des éléments forts de "Zabor ou les psaumes", de Kamel Daoud, et ce sujet est également abordé, de façon très différente, dans notre roman du soir. On touche ici à un sujet déjà évoqué plusieurs fois sur le blog, le transhumanisme. Mais, dans "L'Invention des corps", Pierre Ducrozet (chez Actes Sud, donc) va plus loin que la simple histoire de ces milliardaires qui rêvent d'abolir la mort. Il s'intéresse aussi à leurs exacts contraires. Plus clairement, il explore deux utopies qui, par les mêmes moyens, recherches des buts proches mais très différents, expose ce qui pourrait tourner à la dystopie dans cette furieuse bataille technologique (et idéologique) et décrit l'entrée de plain-pied de notre civilisation dans le XXIe siècle. Et, belle performance, il enveloppe tout cela dans un véritable roman d'action qu'on ne lâche pas.
Álvaro, jeune homme né d'un père mexicain et d'une mère cubaine, s'est découvert très tôt une passion pour l'informatique. Une passion, et un talent certain qui l'a naturellement poussé à jouer les hackers. Il a été proche un temps des Anonymous, mais il ne s'est pas reconnu dans leur engagement idéologique et a préféré prendre ses distances.
A l'été 2014, il est contacté par l'Ecole Normale Isidro Burgos d'Ayotzinapa, une petite ville de l'Etat de Guerrero, voisin de celui de Mexico. On lui propose de donner des cours aux étudiants dès la rentrée. Sans réfléchir, et même s'il n'en a pas forcément envie, Álvaro accepte. Il débarque dans un établissement où la contestation politique est forte.
En septembre, d'ailleurs, les étudiants se mobilisent pour manifester contre la corruption qui sévit à tous les niveaux au Mexique et dénoncer la collusion entre les pouvoirs publics, et jusqu'au plus haut niveau, et les cartels de narcotrafiquants. Álvaro accompagne les manifestants quand, dans la ville d'Iguala, le convoi est attaqué.
Ces événements vont faire date, le bilan est effroyable. Álvaro survit miraculeusement et parvient à s'enfuir, fou de colère et profondément traumatisé par ce qu'il a vécu. Sous le choc, il s'enfuit et décide de disparaître, de quitter ce pays dans lequel il ne se reconnaît plus, dans lequel il n'a plus aucune confiance. Direction, les Etats-Unis.
Ce n'est pas qu'il fasse plus confiance aux Américains, mais il veut qu'à Iguala, on oublie jusqu'à son existence. Alors, à pied, il traverse le pays jusqu'à cette frontière, l'une des plus surveillées au monde. Il devient un "dos mouillé", comme on appelle les candidats au passage clandestin vers le sol américain et, avec l'aide d'un passeur, il entre aux Etats-Unis.
Clandestin, sans le sou, mais confiant en ses moyens, et particulièrement en ses talents de programmeur, il s'installe en Californie. A South Los Angeles, quartier à majorité latino, où il pourra se fondre dans le décor. Malgré la rage qu'il ressent et le souvenir d'Iguala qui le ronge, il cherche l'opportunité qui lui permettra de démarrer une nouvelle vie, loin du carnage.
Et cette occasion va prendre la forme d'une conférence que donne une des figures de la Silicon Valley, Parker Hayes, dans un hôtel de LA. Fasciné par ce qu'il entend, Álvaro lui offre ses services comme programmeur. En vain, dans un premier temps. Mais, bientôt, le visionnaire milliardaire lui propose un job. Sauf que ce n'est pas tout à fait celui qu'espérait le jeune Mexicain...
Il y a longtemps que je n'ai pas abordé un livre en évoquant principalement ses personnages, il est temps de recommencer, car "l'Invention des corps" s'y prête bien. D'abord, parce que ce que je viens de vous raconter, ce résumé, n'est finalement pas d'une grande utilité pour savoir de quoi il est sujet. On se focalise sur les événements d'Iguala, mais ils ne sont que l'étincelle qui enclenche l'histoire.
Álvaro, d'abord. Sur lui, j'ai dit l'essentiel, déjà. Par la suite, c'est sa rage (c'est le mot employé dans le livre) qui domine. Il ne parle quasiment plus, ne répond pas quand on lui pose une question, accepte le marché de Hayes pour l'argent, en se disant que dès qu'il en aura mis assez de côté, il tracera sa route. Un homme en colère, mais contre tout, contre tous. Un nihiliste, sans aucune perspective.
C'est vrai qu'on a peu de prises pour parler de lui, seul cette immense colère transparaissant durant la plus grande partie du livre. Mais, ce qui lui arrive est l'un des éléments clés du récit et ses actes, même minimalistes, même anodins en apparence, auront une finalité qui fera d'Álvaro un antihéros, un rebelle et sans doute, un modèle dans son genre.
A priori, Parker Hayes semble bien plus intéressant. Si je ne dis pas de bêtise, Pierre Ducrozet s'est inspiré d'un personnage réel, Peter Thiel, cofondateur de PayPal, entre autres, pour bâtir ce personnage. Hayes fait partie de cette génération de jeunes entrepreneurs de la Silicon Valley qui ont participé, dans les années 1990-2000 au lancement de la nouvelle révolution industrielle, autour d'internet.
Et, parmi ses activités, Parke Hayes en a une à laquelle il consacre de plus en plus de temps (et d'argent) : en finir avec la mort. Comme nombre de ses petits camarades, Hayes est engagé dans le mouvement transhumaniste. Mais, digitaliser le corps ne lui suffit pas, il cherche dans un laboratoire appelé le Cube, basé à San Francisco, d'autres solutions... qui font froid dans le dos.
Hayes, c'est un mélange entre le docteur Frankenstein et le Blofeld de la série James Bond. C'est une espèce d'animal à sang froid (et même glacial) qui vit dans une sphère manifestement différente de la nôtre, envisageant tout en grand, se foutant de l'argent, mais pas du pouvoir qu'il procure, rêvant à la constitution d'une élite transhumaine qui vivrait sur des îles artificielles à l'écart du commun des mortels...
En découvrant ce personnage, je repensais à un autre roman qui, il y a quelques années, avait également marqué une rentrée littéraire d'automne : "La théorie de l'information", d'Aurélien Bellanger. Mais, à côté de Parker Hayes, son Pascal Ertanger (double de Xavier Niel) est un enfant de choeur, un doux rêveur.
Hayes incarne la frange dure de la Silicon Valley : politiquement, c'est un conservateur, et pas un tiède, économiquement, c'est un disciple d'Ayn Rand. Un problème se présente, l'argent engrangé doit le régler rapidement. Mais, c'est aussi un visionnaire, quelqu'un qui sait repérer les projets les plus prometteurs (Thiel fut un des premiers investisseurs de Facebook et cela lui rapporta très gros).
"La mort est une idéologie comme une autre", dit-il, sans ironie (je ne suis même pas sûr qu'il connaisse ce concept). C'est surtout un formidable enjeu économique. Qui contrôlera la mort, contrôlera le monde, a-t-on envie de renchérir. Et, en attendant de, peut-être, y parvenir, il a déjà, soyez-en sûr, entamé une campagne de clonage idéologique très efficace qui, au quotidien, donne naissance, dans la Silicon Valley, à plein de petits Parker Hayes...
Adèle Cara est une scientifique française. Une biologiste dont la spécialité est l'étude des cellules du corps humain et leur fonctionnement. En poste à Strasbourg, elle s'ennuie. Alors, après plusieurs refus, elle accepte de rejoindre le Cube de Hayes. Comme Álvaro, elle considère Hayes comme un fou, peut-être même un fou dangereux, mais elle espère gagner un max en peu de temps et passer vite à autre chose.
Elle est l'exemple que l'argent n'achète pas tout. Ses services, bien sûr, mais pas son âme. Adèle, c'est Marguerite repoussant Faust et ses bijoux, refusant de vendre son âme au diable contre quelque somme que ce soit. Jusqu'à se révolter. A un moment, je l'ai imaginée se lançant dans un road-trip façon "Thelma et Louise", mais vous verrez que c'est tout autre chose qui va se produire...
Werner Fehrenbach est le doyen des personnages que nous évoquerons. Son histoire, et même celle de sa famille, est le sujet d'un chapitre entier de "l'Invention des corps", à vous de le lire. C'est un des pionniers de ce qui va devenir internet, un de ceux qui a pressenti, dès le milieu des années 1960, l'émergence de ce concept, l'homme qui a inventé le mot cyberespace.
Comme Hayes, je suppose que ce personnage de fiction s'inspire d'un, voire de plusieurs personnages réels, mais comme je suis moins sûr de moi, je ne m'avancerai pas à donner des noms. Le plus important, c'est que son rêve, à lui, c'est celui d'un internet libéré de toute entrave, exempt de règle, un espace de liberté absolu accessible au plus grand nombre.
Ce qu'il y a de fascinant dans "l'Invention des corps", c'est qu'il met en présence des personnages diamétralement opposés qui vivent à quelques rues les uns des autres et ont des conceptions qui, finalement, ne varie que de quelques iotas d'une même chose : leur matière première, c'est le numérique, les 1 et les 0, le code, mais ce qui diffère, c'est ce qu'ils cherchent à construire avec.
Fehrenbach a ce côté vieux sage bienveillant, ce côté hippie qui lui reste de sa jeunesse qui en font sans doute le personnage le plus sympathique de ce roman. Mais, c'est aussi un observateur avisé de ce qui se passe et on a le sentiment qu'il se sent finalement trahi par tous ceux qui se réclament de lui, les Hayes, comme les pirates du net. Fataliste, mais pas dupe, il a un côté espiègle que j'adore. Un Donald Sutherland avec l'oeil qui frise.
Et puis, je termine avec Lin. Originaire de Hong Kong, c'est, comme Álvaro, un petit génie de l'informatique, plus précoce encore que le Mexicain. Elle est une rebelle de naissance, découvre-t-on. La rébellion comme règle de vie pour ne pas être paria. Fuyant très tôt sa famille, elle est venue à San Francisco où elle fréquente assidûment le hackerspace de Nosebridge.
C'est un personnage fascinant, d'un optimisme permanent, d'une vraie fraîcheur, mais elle est habitée par une ferme détermination. Elle aussi a de grandes idées pour internet. Tout en étant à l'opposé du spectre par rapport à Parker Hayes, on retrouve chez elle une soif d'absolu qui les rapproche. Oserais-je dire qu'elle est anarchiste quand Hayes est anarchocapitaliste ? J'ose !
L'accomplissement que recherche Lin, c'est un peu une Eve 2.0 recherchant l'accès à l'arbre de la connaissance via la technologie. Une pionnière dont l'ambition se rapproche encore une fois du transhumanisme, mais sous une autre forme. Avec les mêmes risques, de mon point de vue, de voir les choses partir à un moment ou à un autre en sucette.
Oui, on a bien face à face deux types d'utopies autour de concepts très proches. Deux philosophies politiques, mais aussi des philosophies de vie, qui s'opposent dans la réalité et qu'on veut transposer dans le cyberespace. Mais, toutes choses égales par ailleurs, peut-on reproduire tout cela dans l'infinité virtuelle sans reproduire avec les mêmes dérives ou erreurs ? Vous avez quatre heures...
Et quid du corps, dans tout ça ? Eh bien, c'est très simple : chacun des cinq personnages évoqués dans ce billet réinvente le corps à sa manière. Alors, je ne vais pas détailler, parce que cela en dirait trop sur des éléments que j'ai laissés dans l'ombre volontairement. Mais, réfléchissez-y, si vous souhaitez comprendre le titre du roman de Pierre Ducrozet.
Une remarque, tout de même : l'auteur démontre que, jusqu'à maintenant, l'humanité était spécialisée dans la destruction des corps, avec la Shoah comme terrible paroxysme. Après ces événements, la science, la technologie, sans doute aussi la culpabilité, tout cela a contribué à ce que l'on se penche sur la construction ou la reconstruction du corps.
Mais on en est désormais à réinvente le corps par la chirurgie esthétique, mais aussi lorsqu'on corrige les erreurs de la biologie, en rendant à tel garçon le corps de femme dans lequel il aurait dû naître. La transsexualité est aussi un invention des corps, vous le verrez. On doit aussi repenser le rôle des corps dans l'espace, dans la société, dans la vie quotidienne...
Ducrozet, à travers le personnage d'Adèle, dénonce la conception archaïque et honteuse du corps de la femme dans notre époque, sujet en vogue s'il en est. Au point que cette jeune femme, aussi belle qu'intelligente (aïe, je tombe aussi dans le sexisme, désolé), se sent étrangère dans son propre corps, sent son esprit et son corps séparés l'un de l'autre. Elle va chercher à se reconstituer, se réinventer.
Et puis, on en serait presque à fabriquer en série des Hommes qui valaient trois milliards (mais sans le ralenti et le bruitage tout pourri). Mieux, on pourrait carrément réinventer les corps, sous des formes complètement nouvelles qui pourraient, dans l'idéal (je mettrais bien des guillemets à ce mot...), mener à l'immortalité...
Enfin, il faut évoquer le titre de ce billet. Là encore, on retrouve la proximité entre les adversaires, car cette citation de Lin a son équivalent presque parfait dans la bouche de Hayes. Le corps est un système quasiment unique : toutes les parties semblent indépendantes, mais en fait, elles contribuent toutes à son fonctionnement en jouant un rôle précis. Si un élément dysfonctionne, tout a des ratés.
Or, la quête de chaque parti engagé dans cette histoire, c'est ça : faire du cyberespace un corps, un système parfait dans lequel chacun agisse de manière autonome tout en contribuant à faire avancer le tout. La quintessence de l'idée qui voudrait que la somme des intérêts particuliers soit égale à l'intérêt général. Belle idée sur le papier, mais le pessimiste qui ne sommeille jamais longtemps en moi doute.
J'évoquais Eve, plus haut, mais c'est vrai que dans ce roman, il y a une espèce de volonté de l'homme d'accéder au rang de divinité, de démiurge, et en ce qui me concerne, je trouve cela extrêmement flippant. Non pas le principe en lui-même (quoi que...), mais parce que je peine à faire confiance à ceux qui essayent de mettre tout ça en oeuvre.
Hayes est l'un des membres d'une oligarchie se rêvant en nouvelle Olympe, tandis que Lin et ses amis sont en quête d'une espèce de fusion avec l'univers où internet devient une sorte de drogue absolue, capable de provoquer des trips comme jamais personne n'en a vécu... Qui a tort ? Qui a raison ? Je n'en sais rien, je ne sais même pas si j'ai la légitimité pour en décider.
Il n'empêche que "L'Invention des corps" est un roman fort, mené tambour battant, avec beaucoup d'actions, beaucoup de fils narratifs, une partie chorale, un zeste de SF, un coté thriller, aussi, un dénouement passionnant... Ce roman aussi est un corps, chaque élément, même s'il paraît détaché du reste, est indissociable du livre dans son intégralité. Ducrozet est au bout du raisonnement.
Et il invente un nouveau genre littéraire : le roman rhizome (explication dans le roman !).
Álvaro, jeune homme né d'un père mexicain et d'une mère cubaine, s'est découvert très tôt une passion pour l'informatique. Une passion, et un talent certain qui l'a naturellement poussé à jouer les hackers. Il a été proche un temps des Anonymous, mais il ne s'est pas reconnu dans leur engagement idéologique et a préféré prendre ses distances.
A l'été 2014, il est contacté par l'Ecole Normale Isidro Burgos d'Ayotzinapa, une petite ville de l'Etat de Guerrero, voisin de celui de Mexico. On lui propose de donner des cours aux étudiants dès la rentrée. Sans réfléchir, et même s'il n'en a pas forcément envie, Álvaro accepte. Il débarque dans un établissement où la contestation politique est forte.
En septembre, d'ailleurs, les étudiants se mobilisent pour manifester contre la corruption qui sévit à tous les niveaux au Mexique et dénoncer la collusion entre les pouvoirs publics, et jusqu'au plus haut niveau, et les cartels de narcotrafiquants. Álvaro accompagne les manifestants quand, dans la ville d'Iguala, le convoi est attaqué.
Ces événements vont faire date, le bilan est effroyable. Álvaro survit miraculeusement et parvient à s'enfuir, fou de colère et profondément traumatisé par ce qu'il a vécu. Sous le choc, il s'enfuit et décide de disparaître, de quitter ce pays dans lequel il ne se reconnaît plus, dans lequel il n'a plus aucune confiance. Direction, les Etats-Unis.
Ce n'est pas qu'il fasse plus confiance aux Américains, mais il veut qu'à Iguala, on oublie jusqu'à son existence. Alors, à pied, il traverse le pays jusqu'à cette frontière, l'une des plus surveillées au monde. Il devient un "dos mouillé", comme on appelle les candidats au passage clandestin vers le sol américain et, avec l'aide d'un passeur, il entre aux Etats-Unis.
Clandestin, sans le sou, mais confiant en ses moyens, et particulièrement en ses talents de programmeur, il s'installe en Californie. A South Los Angeles, quartier à majorité latino, où il pourra se fondre dans le décor. Malgré la rage qu'il ressent et le souvenir d'Iguala qui le ronge, il cherche l'opportunité qui lui permettra de démarrer une nouvelle vie, loin du carnage.
Et cette occasion va prendre la forme d'une conférence que donne une des figures de la Silicon Valley, Parker Hayes, dans un hôtel de LA. Fasciné par ce qu'il entend, Álvaro lui offre ses services comme programmeur. En vain, dans un premier temps. Mais, bientôt, le visionnaire milliardaire lui propose un job. Sauf que ce n'est pas tout à fait celui qu'espérait le jeune Mexicain...
Il y a longtemps que je n'ai pas abordé un livre en évoquant principalement ses personnages, il est temps de recommencer, car "l'Invention des corps" s'y prête bien. D'abord, parce que ce que je viens de vous raconter, ce résumé, n'est finalement pas d'une grande utilité pour savoir de quoi il est sujet. On se focalise sur les événements d'Iguala, mais ils ne sont que l'étincelle qui enclenche l'histoire.
Álvaro, d'abord. Sur lui, j'ai dit l'essentiel, déjà. Par la suite, c'est sa rage (c'est le mot employé dans le livre) qui domine. Il ne parle quasiment plus, ne répond pas quand on lui pose une question, accepte le marché de Hayes pour l'argent, en se disant que dès qu'il en aura mis assez de côté, il tracera sa route. Un homme en colère, mais contre tout, contre tous. Un nihiliste, sans aucune perspective.
C'est vrai qu'on a peu de prises pour parler de lui, seul cette immense colère transparaissant durant la plus grande partie du livre. Mais, ce qui lui arrive est l'un des éléments clés du récit et ses actes, même minimalistes, même anodins en apparence, auront une finalité qui fera d'Álvaro un antihéros, un rebelle et sans doute, un modèle dans son genre.
A priori, Parker Hayes semble bien plus intéressant. Si je ne dis pas de bêtise, Pierre Ducrozet s'est inspiré d'un personnage réel, Peter Thiel, cofondateur de PayPal, entre autres, pour bâtir ce personnage. Hayes fait partie de cette génération de jeunes entrepreneurs de la Silicon Valley qui ont participé, dans les années 1990-2000 au lancement de la nouvelle révolution industrielle, autour d'internet.
Et, parmi ses activités, Parke Hayes en a une à laquelle il consacre de plus en plus de temps (et d'argent) : en finir avec la mort. Comme nombre de ses petits camarades, Hayes est engagé dans le mouvement transhumaniste. Mais, digitaliser le corps ne lui suffit pas, il cherche dans un laboratoire appelé le Cube, basé à San Francisco, d'autres solutions... qui font froid dans le dos.
Hayes, c'est un mélange entre le docteur Frankenstein et le Blofeld de la série James Bond. C'est une espèce d'animal à sang froid (et même glacial) qui vit dans une sphère manifestement différente de la nôtre, envisageant tout en grand, se foutant de l'argent, mais pas du pouvoir qu'il procure, rêvant à la constitution d'une élite transhumaine qui vivrait sur des îles artificielles à l'écart du commun des mortels...
En découvrant ce personnage, je repensais à un autre roman qui, il y a quelques années, avait également marqué une rentrée littéraire d'automne : "La théorie de l'information", d'Aurélien Bellanger. Mais, à côté de Parker Hayes, son Pascal Ertanger (double de Xavier Niel) est un enfant de choeur, un doux rêveur.
Hayes incarne la frange dure de la Silicon Valley : politiquement, c'est un conservateur, et pas un tiède, économiquement, c'est un disciple d'Ayn Rand. Un problème se présente, l'argent engrangé doit le régler rapidement. Mais, c'est aussi un visionnaire, quelqu'un qui sait repérer les projets les plus prometteurs (Thiel fut un des premiers investisseurs de Facebook et cela lui rapporta très gros).
"La mort est une idéologie comme une autre", dit-il, sans ironie (je ne suis même pas sûr qu'il connaisse ce concept). C'est surtout un formidable enjeu économique. Qui contrôlera la mort, contrôlera le monde, a-t-on envie de renchérir. Et, en attendant de, peut-être, y parvenir, il a déjà, soyez-en sûr, entamé une campagne de clonage idéologique très efficace qui, au quotidien, donne naissance, dans la Silicon Valley, à plein de petits Parker Hayes...
Adèle Cara est une scientifique française. Une biologiste dont la spécialité est l'étude des cellules du corps humain et leur fonctionnement. En poste à Strasbourg, elle s'ennuie. Alors, après plusieurs refus, elle accepte de rejoindre le Cube de Hayes. Comme Álvaro, elle considère Hayes comme un fou, peut-être même un fou dangereux, mais elle espère gagner un max en peu de temps et passer vite à autre chose.
Elle est l'exemple que l'argent n'achète pas tout. Ses services, bien sûr, mais pas son âme. Adèle, c'est Marguerite repoussant Faust et ses bijoux, refusant de vendre son âme au diable contre quelque somme que ce soit. Jusqu'à se révolter. A un moment, je l'ai imaginée se lançant dans un road-trip façon "Thelma et Louise", mais vous verrez que c'est tout autre chose qui va se produire...
Werner Fehrenbach est le doyen des personnages que nous évoquerons. Son histoire, et même celle de sa famille, est le sujet d'un chapitre entier de "l'Invention des corps", à vous de le lire. C'est un des pionniers de ce qui va devenir internet, un de ceux qui a pressenti, dès le milieu des années 1960, l'émergence de ce concept, l'homme qui a inventé le mot cyberespace.
Comme Hayes, je suppose que ce personnage de fiction s'inspire d'un, voire de plusieurs personnages réels, mais comme je suis moins sûr de moi, je ne m'avancerai pas à donner des noms. Le plus important, c'est que son rêve, à lui, c'est celui d'un internet libéré de toute entrave, exempt de règle, un espace de liberté absolu accessible au plus grand nombre.
Ce qu'il y a de fascinant dans "l'Invention des corps", c'est qu'il met en présence des personnages diamétralement opposés qui vivent à quelques rues les uns des autres et ont des conceptions qui, finalement, ne varie que de quelques iotas d'une même chose : leur matière première, c'est le numérique, les 1 et les 0, le code, mais ce qui diffère, c'est ce qu'ils cherchent à construire avec.
Fehrenbach a ce côté vieux sage bienveillant, ce côté hippie qui lui reste de sa jeunesse qui en font sans doute le personnage le plus sympathique de ce roman. Mais, c'est aussi un observateur avisé de ce qui se passe et on a le sentiment qu'il se sent finalement trahi par tous ceux qui se réclament de lui, les Hayes, comme les pirates du net. Fataliste, mais pas dupe, il a un côté espiègle que j'adore. Un Donald Sutherland avec l'oeil qui frise.
Et puis, je termine avec Lin. Originaire de Hong Kong, c'est, comme Álvaro, un petit génie de l'informatique, plus précoce encore que le Mexicain. Elle est une rebelle de naissance, découvre-t-on. La rébellion comme règle de vie pour ne pas être paria. Fuyant très tôt sa famille, elle est venue à San Francisco où elle fréquente assidûment le hackerspace de Nosebridge.
C'est un personnage fascinant, d'un optimisme permanent, d'une vraie fraîcheur, mais elle est habitée par une ferme détermination. Elle aussi a de grandes idées pour internet. Tout en étant à l'opposé du spectre par rapport à Parker Hayes, on retrouve chez elle une soif d'absolu qui les rapproche. Oserais-je dire qu'elle est anarchiste quand Hayes est anarchocapitaliste ? J'ose !
L'accomplissement que recherche Lin, c'est un peu une Eve 2.0 recherchant l'accès à l'arbre de la connaissance via la technologie. Une pionnière dont l'ambition se rapproche encore une fois du transhumanisme, mais sous une autre forme. Avec les mêmes risques, de mon point de vue, de voir les choses partir à un moment ou à un autre en sucette.
Oui, on a bien face à face deux types d'utopies autour de concepts très proches. Deux philosophies politiques, mais aussi des philosophies de vie, qui s'opposent dans la réalité et qu'on veut transposer dans le cyberespace. Mais, toutes choses égales par ailleurs, peut-on reproduire tout cela dans l'infinité virtuelle sans reproduire avec les mêmes dérives ou erreurs ? Vous avez quatre heures...
Et quid du corps, dans tout ça ? Eh bien, c'est très simple : chacun des cinq personnages évoqués dans ce billet réinvente le corps à sa manière. Alors, je ne vais pas détailler, parce que cela en dirait trop sur des éléments que j'ai laissés dans l'ombre volontairement. Mais, réfléchissez-y, si vous souhaitez comprendre le titre du roman de Pierre Ducrozet.
Une remarque, tout de même : l'auteur démontre que, jusqu'à maintenant, l'humanité était spécialisée dans la destruction des corps, avec la Shoah comme terrible paroxysme. Après ces événements, la science, la technologie, sans doute aussi la culpabilité, tout cela a contribué à ce que l'on se penche sur la construction ou la reconstruction du corps.
Mais on en est désormais à réinvente le corps par la chirurgie esthétique, mais aussi lorsqu'on corrige les erreurs de la biologie, en rendant à tel garçon le corps de femme dans lequel il aurait dû naître. La transsexualité est aussi un invention des corps, vous le verrez. On doit aussi repenser le rôle des corps dans l'espace, dans la société, dans la vie quotidienne...
Ducrozet, à travers le personnage d'Adèle, dénonce la conception archaïque et honteuse du corps de la femme dans notre époque, sujet en vogue s'il en est. Au point que cette jeune femme, aussi belle qu'intelligente (aïe, je tombe aussi dans le sexisme, désolé), se sent étrangère dans son propre corps, sent son esprit et son corps séparés l'un de l'autre. Elle va chercher à se reconstituer, se réinventer.
Et puis, on en serait presque à fabriquer en série des Hommes qui valaient trois milliards (mais sans le ralenti et le bruitage tout pourri). Mieux, on pourrait carrément réinventer les corps, sous des formes complètement nouvelles qui pourraient, dans l'idéal (je mettrais bien des guillemets à ce mot...), mener à l'immortalité...
Enfin, il faut évoquer le titre de ce billet. Là encore, on retrouve la proximité entre les adversaires, car cette citation de Lin a son équivalent presque parfait dans la bouche de Hayes. Le corps est un système quasiment unique : toutes les parties semblent indépendantes, mais en fait, elles contribuent toutes à son fonctionnement en jouant un rôle précis. Si un élément dysfonctionne, tout a des ratés.
Or, la quête de chaque parti engagé dans cette histoire, c'est ça : faire du cyberespace un corps, un système parfait dans lequel chacun agisse de manière autonome tout en contribuant à faire avancer le tout. La quintessence de l'idée qui voudrait que la somme des intérêts particuliers soit égale à l'intérêt général. Belle idée sur le papier, mais le pessimiste qui ne sommeille jamais longtemps en moi doute.
J'évoquais Eve, plus haut, mais c'est vrai que dans ce roman, il y a une espèce de volonté de l'homme d'accéder au rang de divinité, de démiurge, et en ce qui me concerne, je trouve cela extrêmement flippant. Non pas le principe en lui-même (quoi que...), mais parce que je peine à faire confiance à ceux qui essayent de mettre tout ça en oeuvre.
Hayes est l'un des membres d'une oligarchie se rêvant en nouvelle Olympe, tandis que Lin et ses amis sont en quête d'une espèce de fusion avec l'univers où internet devient une sorte de drogue absolue, capable de provoquer des trips comme jamais personne n'en a vécu... Qui a tort ? Qui a raison ? Je n'en sais rien, je ne sais même pas si j'ai la légitimité pour en décider.
Il n'empêche que "L'Invention des corps" est un roman fort, mené tambour battant, avec beaucoup d'actions, beaucoup de fils narratifs, une partie chorale, un zeste de SF, un coté thriller, aussi, un dénouement passionnant... Ce roman aussi est un corps, chaque élément, même s'il paraît détaché du reste, est indissociable du livre dans son intégralité. Ducrozet est au bout du raisonnement.
Et il invente un nouveau genre littéraire : le roman rhizome (explication dans le roman !).
mercredi 23 août 2017
"Je tente de recréer l'univers idyllique dans lequel j'ai tant de fois joué, dans lequel je me suis tant de fois rêvé aventurier".
Je vais être honnête avec vous : j'ai honteusement sorti cette citation de son contexte. Mais, je n'ai aucun remords, juste des excuses à présenter à l'auteur. Voici un roman écrit par un bibliothécaire, ce n'est finalement pas si courant, et qui nous emmène dans un endroit simplement merveilleux : la presqu'île de Giens, dans le Var. Rien que cela donne envie de s'y plonger ! Mais, "Presqu'île", de Vincent Jolit (en grand format aux éditions Fayard), c'est aussi un livre plein de nostalgie, celle de l'enfance, des souvenirs qu'on conserve précieusement de sa vie familiale passée. Et puis, c'est un joi paradoxe qui me motive à vous parler de cette histoire : c'est une autofiction qui repose sur l'imagination, le rêve, l'évasion... Un esprit qui vagabonde et essaye de percer le brouillard, de briser le fatalisme d'une situation pas très agréable, de rendre ces moments pénibles plus colorés et souriants en se souvenant de moments incarnant le bonheur et la douceur de vivre... Autant d'éléments qui pourraient même entrer en résonance avec la propre expérience du lecteur et l'entraîner lui aussi dans cette bienveillante nostalgie...
Le narrateur doit subir une opération chirurgicale et il s'apprête à passer quelque temps dans une chambre d'hôpital. Ces chambres impersonnelles et d'une tristesse infinie qui n'aident pas vraiment à garder le moral. Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans cette situation : depuis un accident subi dans l'enfance, il est déjà passé plusieurs fois sur le billard.
Cette fois, il a pris la bonne résolution de profiter de ce séjour forcé dans cette chambre pour relire Proust. Pourtant, dès le premier soir, à la veille de l'opération, son regard va être attiré par quelque chose : le ciel, d'une incroyable beauté, qu'il voit par la fenêtre de la chambre, seule rupture dans la monotonie de ce décor déprimant.
Ce ciel, au soleil couchant, se pare de couleurs magnifique allant du bleu au rose, et le narrateur se retrouve soudain face à un tableau qui lui ouvre de nouvelles perspectives. Ce ciel, c'est celui qu'il a connu, enfant, chez ses grands-parents, celui qu'il voyait par la grande fenêtre de leur maison sur la presqu'île de Giens...
Soudain, sans les avoir sollicité, les souvenirs affluent. Des souvenirs d'enfance, de ce bonheur simple des vacances d'été, mais aussi de la longue convalescence qui a suivi son accident. Le souvenir de ses grands-parents, et particulièrement de sa grand-mère, Marinette. Le souvenir de cette maison, du jardin qui l'entourait et de cette presqu'île, de la mer, de son double tombolo...
Après l'opération, malgré la douleur, la fatigue, l'abrutissement dû aux médicaments, voilà le narrateur plongé dans ces souvenirs. Et, de fil en aiguille, d'autres idées colorées vont s'imposer, se substituer à l'univers grisâtre de la chambre d'hôpital pour permettre à cet homme de s'évader de son lit de douleur et faire passer ces moments un peu moins lentement...
Aux souvenirs, vont se mêler d'autres choses, des réflexions, des histoires que le narrateur imagine, d'autres décors, d'autres couleurs. Quelquefois, il y a interruption du son et de l'image, quand la fatigue ou la chimie prennent le dessus sur un cerveau qui, par la force des choses, fonctionne tout de même au ralenti.
Mais, au fil des pages, on oublie la douleur (bon, c'est plus facile, c'est la douleur du narrateur, me direz-vous), on oublie la chambre d'hôpital, les odeurs antiseptiques, tout ce qui fait qu'on ne se sent pas à l'aise lorsqu'on est à l'hôpital, tout ce qui pèse sur le moral, aussi, pour les remplacer pas un endroit splendide, le soleil, la mer, d'autres odeurs infiniment plus agréables et la gentillesse de Marinette...
Je parle très peu de moi dans mes billets, habituellement, mais je vais faire une exception, car c'est aussi une expérience personnelle qui m'a donné envie de lire "Presqu'île". J'ai également connu ces moments compliqués où l'on se retrouve entre les quatre murs d'une chambre d'hôpital. Et, comme le narrateur, je n'avais guère que la grande fenêtre qui s'étendait le long d'un des murs pour penser à autre chose.
Mon ciel, enfin, celui que j'apercevais par cette fenêtre, cloué sur un lit que je ne pouvais quitter, n'avait pas les mêmes couleurs que celui évoqué par Vincent Jolit. Non, c'était un vague ciel d'Île de France, parfois strié de pollution, souvent grisâtre et hivernal... Mais, je l'avais en plein écran, si je puis dire, avec juste un élément qui brisait l'infinité...
Cet élément, c'était une grue. Un chantier comme il y en a tant était en cours quelque part et, avec la perspective, je voyais cette grue tourner. Et je me suis pris à imaginer ce que vivait celui ou celle qui montait dans cette cabine chaque jour pour actionner la grue... Une manière comme une autre de quitter ma chambre d'hôpital, mais, je le reconnais, bien moins idyllique que celle de Vincent Jolit.
Je me suis donc reconnu dans le personnage du narrateur de "Presqu'île", au moins dans ce comportement et ce regard tourné vers l'extérieur, recherchant un ailleurs meilleur au-delà des parois carcérales de cette chambre. Ce ne sera pas, on le verra, le seul point de ce roman qui fera vibrer quelques cordes sensibles chez le lecteur que je suis.
Mais, revenons à Vincent Jolit. Dans les souvenirs qui naissent de ce ciel aperçu par la fenêtre, trois personnages principaux ressortent, dont deux ont déjà été évoqué plus tôt : Marcel Proust ; Marinette, la grand-mère, (à laquelle j'associe le grand-père du narrateur, disparu plus tôt) ; et le peintre Pierre Bonnard, membre du groupe des Nabis (ça, c'est juste pour étaler la culture).
Je suis un peu moqueur, en mettant Proust au même niveau que Marinette et Pierre Bonnard, car, le pauvre, il est plutôt la victime de cette situation : comme toute bonne résolution qui se respecte, celle de relire Proust pendant cette hospitalisation est vite tombée aux oubliettes. Il faudra une nouvelle occasion, espérons-le moins désagréable, pour que le narrateur se replonge dans "la Recherche"...
Cependant, Proust reste un personnage clé de ce voyage immobile, car, d'une certaine façon, ce ciel multicolore, c'est la madeleine du narrateur. L'élément a priori anodin qui va faire remonter à la surface les souvenirs d'enfance enfouis. Or, dans "Presqu'île", c'est bien l'enfance du narrateur qui occupe la place la plus importante.
Marinette... C'est un personnage qu'on aimerait connaître. Une grand-mère câline et dévouée à son petit-fils, malgré son travail de cuisinière. Chaque matin, dès potron-minet, elle se mettait au fourneau jusqu'à l'heure du déjeuner. Ensuite, place au narrateur, particulièrement lors de sa convalescence, quand il ne pouvait guère baguenauder dans le jardin.
Ce jardin, mes amis, ce jardin ! Un rêve pour un enfant ! On a envie de s'y précipiter, de s'y perdre, entre les arbres fruitiers et les plantes en plein fleurissement. On imagine les odeurs incroyables qu'il devait exhaler et qui se mêlaient à celle de la Méditerranée toute proche ! Rien qu'à ces évocations, c'est mon imagination qui s'est mise en route.
Si on devait me demander la définition de la Dolce Vita, je crois que je parlerais de tout cela. Sans oublier l'endroit, cette presqu'île qui sert de titre au roman. Pas n'importe laquelle, celle de Giens, avec son double tombolo... Ah, je suis sûr que comme moi, vous vous demandez ce que c'est que ce drôle de truc...
Non, le tombolo n'est pas le mari de la tombola (je n'en suis pas fier, de celle-là, mais je ne peux pas m'empêcher). Non, le tombolo, c'est ce cordon sédimentaire qui, justement, fait d'une île une presqu'île. Et celle de Giens a la particularité de posséder quelque chose de très rare : un double tombolo, qu'on voit bien dès qu'on prend de l'altitude :
Ca, c'est pour la géologie. La peinture, maintenant. Avec Pierre Bonnard, dont un des tableaux revient en mémoire du narrateur, au cours de ses rêveries. Pas n'importe lequel, puisque c'est le dernier achevé par le peintre avant de mourir, un tableau où apparaît, presque subrepticement, sa muse et épouse, Marthe, décédée pendant qu'il travaillait à "L'Atelier au mimosa".
Un tableau qui accompagne le narrateur et le ramène à ces fameuses couleurs qui manquent tellement aux chambres d'hôpital. Un enchaînement d'idées qui va faire, fugacement, de Pierre Bonnard, un des personnages du roman. On est avec le narrateur, entre deux eaux, dans ce rêve éveillé ou cet assoupissement médicamenteux qui n'engendre pas de monstres, cette fois...
"Presqu'île" est une autofiction, mais elle sort de l'ordinaire de ce genre que je n'aime d'habitude pas beaucoup (ou avec modération). Elle fait, curieusement, la part belle au rêve et à l'imagination, plutôt qu'au récit souvent fade de la réalité quotidienne. Et j'ai aimé cela, j'ai aimé plonger dans les souvenirs et les rêves du narrateur.
D'autant qu'ils m'ont de nouveau rappelé des souvenirs personnels, mais bien plus agréables que la chambre d'hôpital. Ma propre enfance, mes propres grands-mères, à la fois si différentes et si proches de Marinette, les vacances varoises, le jardin dans lequel, chaque jour, on devient un aventurier, on s'imagine en héros de roman, chassant le trésor ou quelque monstre effrayant...
Oui, j'ai retrouvé beaucoup de choses de ma propre enfance dans ce roman, j'ai ressenti la même nostalgie qui étreint le narrateur. Ce n'est pas triste, la nostalgie, c'est la mélancolie qui l'est. Bien sûr, ces souvenirs ne reviendront pas, mais ils restent au coeur et nous nourrissent toujours tant d'années après qu'ils se sont produits.
Alors, pour cela, merci à Vincent Jolit. Merci d'avoir réveillé cette douce nostalgie alors que, doucement, la période des vacances estivales s'achemine vers sa fin. C'est un billet très particulier que je termine maintenant, car sans doute le plus personnel de tout ceux que j'ai écrits en six ans. Tout le monde ne partagera donc pas ce sentiment, si subjectif et revendiqué comme tel.
Mais j'espère que d'autres lecteurs ressentiront des émotions similaires à la lecture de ce roman. Parce que nous avons tous nos souvenirs, nos madeleines de Proust. Et parce qu'on voudrait tous que, dans les moments difficiles qu'il nous arrive de traverser, nous puissions les évoquer en jetant simplement un coup d'oeil au ciel, qui est par-dessus le toit, si bleu, si calme, pour paraphraser Verlaine...
Le narrateur doit subir une opération chirurgicale et il s'apprête à passer quelque temps dans une chambre d'hôpital. Ces chambres impersonnelles et d'une tristesse infinie qui n'aident pas vraiment à garder le moral. Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans cette situation : depuis un accident subi dans l'enfance, il est déjà passé plusieurs fois sur le billard.
Cette fois, il a pris la bonne résolution de profiter de ce séjour forcé dans cette chambre pour relire Proust. Pourtant, dès le premier soir, à la veille de l'opération, son regard va être attiré par quelque chose : le ciel, d'une incroyable beauté, qu'il voit par la fenêtre de la chambre, seule rupture dans la monotonie de ce décor déprimant.
Ce ciel, au soleil couchant, se pare de couleurs magnifique allant du bleu au rose, et le narrateur se retrouve soudain face à un tableau qui lui ouvre de nouvelles perspectives. Ce ciel, c'est celui qu'il a connu, enfant, chez ses grands-parents, celui qu'il voyait par la grande fenêtre de leur maison sur la presqu'île de Giens...
Soudain, sans les avoir sollicité, les souvenirs affluent. Des souvenirs d'enfance, de ce bonheur simple des vacances d'été, mais aussi de la longue convalescence qui a suivi son accident. Le souvenir de ses grands-parents, et particulièrement de sa grand-mère, Marinette. Le souvenir de cette maison, du jardin qui l'entourait et de cette presqu'île, de la mer, de son double tombolo...
Après l'opération, malgré la douleur, la fatigue, l'abrutissement dû aux médicaments, voilà le narrateur plongé dans ces souvenirs. Et, de fil en aiguille, d'autres idées colorées vont s'imposer, se substituer à l'univers grisâtre de la chambre d'hôpital pour permettre à cet homme de s'évader de son lit de douleur et faire passer ces moments un peu moins lentement...
Aux souvenirs, vont se mêler d'autres choses, des réflexions, des histoires que le narrateur imagine, d'autres décors, d'autres couleurs. Quelquefois, il y a interruption du son et de l'image, quand la fatigue ou la chimie prennent le dessus sur un cerveau qui, par la force des choses, fonctionne tout de même au ralenti.
Mais, au fil des pages, on oublie la douleur (bon, c'est plus facile, c'est la douleur du narrateur, me direz-vous), on oublie la chambre d'hôpital, les odeurs antiseptiques, tout ce qui fait qu'on ne se sent pas à l'aise lorsqu'on est à l'hôpital, tout ce qui pèse sur le moral, aussi, pour les remplacer pas un endroit splendide, le soleil, la mer, d'autres odeurs infiniment plus agréables et la gentillesse de Marinette...
Je parle très peu de moi dans mes billets, habituellement, mais je vais faire une exception, car c'est aussi une expérience personnelle qui m'a donné envie de lire "Presqu'île". J'ai également connu ces moments compliqués où l'on se retrouve entre les quatre murs d'une chambre d'hôpital. Et, comme le narrateur, je n'avais guère que la grande fenêtre qui s'étendait le long d'un des murs pour penser à autre chose.
Mon ciel, enfin, celui que j'apercevais par cette fenêtre, cloué sur un lit que je ne pouvais quitter, n'avait pas les mêmes couleurs que celui évoqué par Vincent Jolit. Non, c'était un vague ciel d'Île de France, parfois strié de pollution, souvent grisâtre et hivernal... Mais, je l'avais en plein écran, si je puis dire, avec juste un élément qui brisait l'infinité...
Cet élément, c'était une grue. Un chantier comme il y en a tant était en cours quelque part et, avec la perspective, je voyais cette grue tourner. Et je me suis pris à imaginer ce que vivait celui ou celle qui montait dans cette cabine chaque jour pour actionner la grue... Une manière comme une autre de quitter ma chambre d'hôpital, mais, je le reconnais, bien moins idyllique que celle de Vincent Jolit.
Je me suis donc reconnu dans le personnage du narrateur de "Presqu'île", au moins dans ce comportement et ce regard tourné vers l'extérieur, recherchant un ailleurs meilleur au-delà des parois carcérales de cette chambre. Ce ne sera pas, on le verra, le seul point de ce roman qui fera vibrer quelques cordes sensibles chez le lecteur que je suis.
Mais, revenons à Vincent Jolit. Dans les souvenirs qui naissent de ce ciel aperçu par la fenêtre, trois personnages principaux ressortent, dont deux ont déjà été évoqué plus tôt : Marcel Proust ; Marinette, la grand-mère, (à laquelle j'associe le grand-père du narrateur, disparu plus tôt) ; et le peintre Pierre Bonnard, membre du groupe des Nabis (ça, c'est juste pour étaler la culture).
Je suis un peu moqueur, en mettant Proust au même niveau que Marinette et Pierre Bonnard, car, le pauvre, il est plutôt la victime de cette situation : comme toute bonne résolution qui se respecte, celle de relire Proust pendant cette hospitalisation est vite tombée aux oubliettes. Il faudra une nouvelle occasion, espérons-le moins désagréable, pour que le narrateur se replonge dans "la Recherche"...
Cependant, Proust reste un personnage clé de ce voyage immobile, car, d'une certaine façon, ce ciel multicolore, c'est la madeleine du narrateur. L'élément a priori anodin qui va faire remonter à la surface les souvenirs d'enfance enfouis. Or, dans "Presqu'île", c'est bien l'enfance du narrateur qui occupe la place la plus importante.
Marinette... C'est un personnage qu'on aimerait connaître. Une grand-mère câline et dévouée à son petit-fils, malgré son travail de cuisinière. Chaque matin, dès potron-minet, elle se mettait au fourneau jusqu'à l'heure du déjeuner. Ensuite, place au narrateur, particulièrement lors de sa convalescence, quand il ne pouvait guère baguenauder dans le jardin.
Ce jardin, mes amis, ce jardin ! Un rêve pour un enfant ! On a envie de s'y précipiter, de s'y perdre, entre les arbres fruitiers et les plantes en plein fleurissement. On imagine les odeurs incroyables qu'il devait exhaler et qui se mêlaient à celle de la Méditerranée toute proche ! Rien qu'à ces évocations, c'est mon imagination qui s'est mise en route.
Si on devait me demander la définition de la Dolce Vita, je crois que je parlerais de tout cela. Sans oublier l'endroit, cette presqu'île qui sert de titre au roman. Pas n'importe laquelle, celle de Giens, avec son double tombolo... Ah, je suis sûr que comme moi, vous vous demandez ce que c'est que ce drôle de truc...
Non, le tombolo n'est pas le mari de la tombola (je n'en suis pas fier, de celle-là, mais je ne peux pas m'empêcher). Non, le tombolo, c'est ce cordon sédimentaire qui, justement, fait d'une île une presqu'île. Et celle de Giens a la particularité de posséder quelque chose de très rare : un double tombolo, qu'on voit bien dès qu'on prend de l'altitude :
Ca, c'est pour la géologie. La peinture, maintenant. Avec Pierre Bonnard, dont un des tableaux revient en mémoire du narrateur, au cours de ses rêveries. Pas n'importe lequel, puisque c'est le dernier achevé par le peintre avant de mourir, un tableau où apparaît, presque subrepticement, sa muse et épouse, Marthe, décédée pendant qu'il travaillait à "L'Atelier au mimosa".
Un tableau qui accompagne le narrateur et le ramène à ces fameuses couleurs qui manquent tellement aux chambres d'hôpital. Un enchaînement d'idées qui va faire, fugacement, de Pierre Bonnard, un des personnages du roman. On est avec le narrateur, entre deux eaux, dans ce rêve éveillé ou cet assoupissement médicamenteux qui n'engendre pas de monstres, cette fois...
"Presqu'île" est une autofiction, mais elle sort de l'ordinaire de ce genre que je n'aime d'habitude pas beaucoup (ou avec modération). Elle fait, curieusement, la part belle au rêve et à l'imagination, plutôt qu'au récit souvent fade de la réalité quotidienne. Et j'ai aimé cela, j'ai aimé plonger dans les souvenirs et les rêves du narrateur.
D'autant qu'ils m'ont de nouveau rappelé des souvenirs personnels, mais bien plus agréables que la chambre d'hôpital. Ma propre enfance, mes propres grands-mères, à la fois si différentes et si proches de Marinette, les vacances varoises, le jardin dans lequel, chaque jour, on devient un aventurier, on s'imagine en héros de roman, chassant le trésor ou quelque monstre effrayant...
Oui, j'ai retrouvé beaucoup de choses de ma propre enfance dans ce roman, j'ai ressenti la même nostalgie qui étreint le narrateur. Ce n'est pas triste, la nostalgie, c'est la mélancolie qui l'est. Bien sûr, ces souvenirs ne reviendront pas, mais ils restent au coeur et nous nourrissent toujours tant d'années après qu'ils se sont produits.
Alors, pour cela, merci à Vincent Jolit. Merci d'avoir réveillé cette douce nostalgie alors que, doucement, la période des vacances estivales s'achemine vers sa fin. C'est un billet très particulier que je termine maintenant, car sans doute le plus personnel de tout ceux que j'ai écrits en six ans. Tout le monde ne partagera donc pas ce sentiment, si subjectif et revendiqué comme tel.
Mais j'espère que d'autres lecteurs ressentiront des émotions similaires à la lecture de ce roman. Parce que nous avons tous nos souvenirs, nos madeleines de Proust. Et parce qu'on voudrait tous que, dans les moments difficiles qu'il nous arrive de traverser, nous puissions les évoquer en jetant simplement un coup d'oeil au ciel, qui est par-dessus le toit, si bleu, si calme, pour paraphraser Verlaine...
"Souverain, implacable, parfait".
Rassurez-vous (ou pas), ces trois mots ne sont pas des qualificatifs pour parler de notre roman du jour et le billet sera (un peu) plus long que ça. Cette devise, ce slogan, je ne sais pas vraiment quel mot est le plus adéquat, s'adresse à l'un des personnages centraux de notre roman du jour, dont l'absence est le moteur de l'angoisse que l'on ressent. On va parler cinéma, dans ce billet, mais pas seulement, avec un livre que les éditions Folio ont choisi de rééditer non pas chez Folio Policier, mais dans la collection blanche, ce qui, lorsqu'on entame "Intérieur nuit", de Marisha Pessl (traduction de Clément Baude), pose sérieusement question. On a en effet tous les éléments d'un grand roman noir dont on s'attend à ce qu'il bascule à tout moment vers le thriller, mais le genre très sombre, le fantastique et même l'horreur. Un roman-fleuve de près de 850 pages qui se dévore autour d'un mythe comme seul le Septième art sait en créer. Un livre sur la puissance de l'imagination, sa force de suggestion...
Ashley Cordova, ravissante et talentueuse jeune femme âgée de seulement 24 ans, s'est suicidée en se jetant du toit d'un squat new-yorkais. Sitôt la nouvelle connue, la presse s'est emballée, comme elle sait si bien le faire. Car Ashley n'est pas une inconnue : elle est la fille du plus génial, du plus controversé et du plus mystérieux cinéaste de son époque, Stan Cordova.
En une quinzaine de films, certains diffusés uniquement clandestinement et projeté dans des souterrains, car bien souvent interdit, Stan Cordova est devenu un véritable mythe. Pourquoi ? Parce que sa manière de filmer l'horreur s'est tellement affinée au fur et à mesure de sa filmographie qu'elle a fini par être jugée insupportable.
Mais, comme tout ce qui est interdit, l'oeuvre de Cordova a suscité un mouvement de grande ampleur, des fans absolus ont littéralement fondé un culte à cet homme et à son travail, organisant des projections clandestines et ritualisées, créant des sites internet hébergés dans le Darknet dont l'accès est impossible pour qui ne prouve pas son fanatisme, dressant à sa gloire un autel...
Au point que l'on en est venu à placer ces fans au même niveau que les sectes sataniques. Il faut dire que tant de rumeurs courent sur les films et sur Cordova lui-même que tout finit par se teinter d'une étrange lueur, inquiétante et morbide, qui ne fait que renforcer, dans le même temps, la ferveur des amateurs de cette oeuvre.
Quant à Cordova, lorsque sa fille meurt, cela fait des années, des décennies, même, qu'il n'est plus apparu. Sa dernière interview remonte à 1977 et on croit seulement savoir qu'il vit en reclus dans une immense propriété des Adirondacks, à l'écart de tout. Un Salinger cinématographique sentant le soufre et travaillant (peut-être) sur un nouveau chef d'oeuvre...
Si Cordova n'a pas réagi, comme à son habitude, à l'annonce de la mort de sa fille, un autre homme a appris la nouvelle avec intérêt : Scott McGrath. Journaliste d'investigation connu et reconnu, auteur de reportages et de livres qui ont marqué le public, il a, 5 ans plus tôt, voulu s'attaquer au mythe Cordova. Mal lui en a pris, incapable d'étayer ses accusations, il a vu sa carrière et sa vie s'effondrer.
Depuis, il peine à remonter la pente, mais reste persuadé que tout ce qui entoure Cordova est contaminé et que le Maître est ce qui se rapproche sans doute le plus du mal incarné. Il n'a pas renoncé à élucider les mystères qui entourent le réalisateur et lorsque sa fille est retrouvée morte, il décide de relancer son enquête, quoi qu'il lui en coûte...
Il faut dire qu'en plus de cet esprit de revanche qui l'anime, McGrath a une raison plus personnelle de comprendre pourquoi Ashley Cordova a décidé d'en finir avec l'existence : il est certain de l'avoir vue, peu de temps avant sa mort, alors qu'il faisait son jogging pendant la nuit à Central Park. Une apparition spectrale qui l'a impressionné, et qui, maintenant, vient renforcer ses questionnements...
Dès le début de ses investigations, McGrath se retrouve bien malgré lui flanqué de deux assistants un tantinet encombrants mais qu'il n'a pas le coeur de rembarrer : Nora, une jeune femme de 19 ans qui rêve d'être actrice et ne vit pour le moment que de petits boulots, et Hopper, un jeune homme énigmatique et lunatique que le journaliste soupçonne de dealer.
Nora est l'une des dernières personnes à avoir vue Ashley en vie. Elle va même apporter à McGrath un indice qui va le motiver encore un peu plus à percer le mystère qui entoure la morte et son célébrissime paternel. Quant à Hopper, McGrath l'a rencontré sur les lieux du drame ; il ne sait pas encore vraiment de quelle façon, mais le jeune homme a été liée à Ashley...
L'improbable trio essaye alors de reconstituer les derniers moments d'Ashley avant qu'elle ne se jette dans le vide. Et, au fur et à mesure de leurs recherches, une désagréable impression ne cesse de croître, un sentiment d'angoisse montent. Et, avec elle, apparaissent des éléments qui laissent penser qu'il pourrait y avoir du surnaturel derrière tout ça...
Et si, derrière le mythe qui s'est constitué autour de Stan Cordova, il y avait un fond de réalité ? Et si le réalisateur avait bel et bien passé un pacte faustien ? Et si, en plus du secret soigneusement entretenu par tout l'entourage du réalisateur, y compris ceux qui ont travaillé avec lui, était à l'oeuvre une forme de sorcellerie... De magie noire ?
"Intérieur nuit" est un grand livre, à l'ambiance aussi pesante qu'envoûtante. Portée par les Cordova père et fille et les mystères qui les entourent, l'intrigue est d'une grande efficacité : et si le génie et la folie ne faisait qu'un ? Et si le plus talentueux des réalisateurs ne rendait pas l'horreur seulement réaliste, mais avait abattu le mur qui sépare la fiction de la réalité ?
Evidemment, lorsqu'on évoque Stan Cordova, on pense à un autre "Stan", Stanley Kubrick, dont le mythe s'est forgé de son vivant à partir de sa discrétion et de films qui ont marqué les esprits. Mais Kubrick n'est rien à côté de la légende noire qu'est Stan Cordova, à côté des rumeurs extraordinaires qui entourent sa personne et de la manière dont ses fans le célèbrent.
Il y a, dans "Intérieur nuit", un jeu sur la paranoïa qui est tout à fait remarquable, puisqu'il concerne les différentes parties impliquées dans l'histoire. Du côté du clan Cordova, avec ce luxe de précautions pour que rien ne filtre sur leur vie, du côté des fans et de leurs sites internet ultra-protégés et de leurs invitations aux projections à côté desquels les rendez-vous pour les rave-parties ne sont que de vulgaires jeux de piste.
Enfin, du côté de McGrath, évidemment. Depuis 5 ans, le journaliste rumine : il est certain qu'on l'a piégé parce qu'il s'était approché trop près d'une vérité qui dérange, qui pourrait faire chuter l'idole de son piédestal. Aussi, se méfie-t-il de tout et de tous, soupçonnant que le suicide d'Ashley n'est qu'un indice de plus du côté maléfique et dangereux de Cordova.
Pourtant, au fil de l'enquête, alors que des signes de plus en plus inquiétants se manifestent, que l'impression surnaturelle se renforce et qu'on se dit qu'il se bat contre une force bien trop puissante, il conserve contre vents et marées son côté rationnel, pragmatique. Il est un journaliste d'investigation cherchant à redorer son blason, il lui faut du tangible, des preuves, des faits étayés...
Marina Pessl joue avec habileté avec différents aspects pour embrouiller son personnage, mais aussi le lecteur. Et l'un d'entre eux est la suggestion : puisqu'on enquête autour d'un personnage mythique en qui certains voient un génie du cinéma, et d'autres, un monstre sanguinaire, à chaque nouvel élément, l'imagination se met en marche.
Au coeur de tout cela, ce qu'on appelle le quatrième mur, au théâtre, ce mur imaginaire censé se dresser entre la scène et le spectateur, symbolisant la frontière entre la vie réelle et l'oeuvre qui est interprétée. Ici, on s'interroge longuement sur l'état de ce quatrième mur : existe-t-il encore ? A-t-il été partiellement ou totalement abattu ?
La fiction a-t-elle fait irruption dans le réel ou bien le réel cherche-t-il à s'infiltrer dans la fiction, celle qui a été savamment façonné pour faire de Cordova une légende suscitant des émotions extrêmement violentes ? Je me suis rapidement posé des questions à ce sujet, j'ai échafaudé quelques hypothèses à ce sujet qui me paraissaient séduisantes.
Entre l'ambiance façon "Rosemary's baby" et une enquête qui pourrait faire penser à "The Game" (le film de David Fincher, avec Michael Douglas et Sean Penn), le lecteur ne sait plus trop sur quel pied danser, tandis que McGarth s'acharne, jusqu'à prendre des libertés de plus en plus importantes avec sa déontologie journalistique.
Petit à petit, il n'est plus un reporter en quête de faits et de vérité, mais un homme qui se lance dans un combat singulier contre un ennemi qu'il faut abattre, coûte que coûte. Et plus il enquête, plus son regard sur Cordova et son entourage s'assombrit... Plus il est déterminé à en finir avec cette légende qui aura fait bien trop de mal.
Dans la famille Cordova, il y a le père, sorte de statue du Commandeur, omniprésent malgré son absence de longue date, au point que personne ne sait plus s'il est même encore vivant. Et puis, il y a la fille, Ashley, dont le destin tragique et les indices qu'elle semble avoir semé derrière elle. A son tour, son personnage se teinte d'un mystère qui dépasse toute rationalité...
"Intérieur nuit" est un magnifique hommage au cinéma d'angoisse, pas les slashers ou le gore, qui joue sur des effets factuels évidents, mais sur des ressorts psychologiques bien plus délicats. Une mécanique fort bien huilée, où chaque nouvel élément vient troubler un peu plus les choses. Et, cerise sur le gâteau, on ressort de cette lecture avec tout de même un léger doute en tête : et si... ?
Au fil de ces 850 pages, qu'on ne peut s'empêcher de tourner, sans même s'en rendre compte, on croise différents hommages à des maîtres du genre. J'ai évoqué Fincher, plus haut, par exemple (et d'ailleurs, je serais curieux de voir ce qu'il ferait d'un scénario tiré du livre de Marisha Pessl), mais aussi Bryan Singer, Hitchcock et tant d'autres.
Sans oublier cette scène d'ouverture dans Central Park, qui rappelle indéniablement "Marathon Man". On a l'impression de suivre une nouvelle fois Dustin Hoffmann dans son jogging, on passe même devant la South Gate House, où se déroule le dénouement du film, la chute des diamants, tout ça... Mais pas de Laurence Olivier à l'horizon, juste une mystérieuse jeune femme à l'allure spectrale...
Dustn Hoffmann est d'ailleurs très présent dans "Intérieur nuit", puisqu'on le retrouve dans un autre de ses fameux rôles, celui du journaliste Carl Bernstein, qui révéla le scandale du Watergate et que l'acteur immortalise dans "les Hommes du Président". McGrath s'amuse à surnommer ainsi Nora, qui lui rend en retour du Woodward (Robert Redford dans le film, il y a pire, comme vanne)...
Bref, Marisha Pessl s'amuse à semer des cailloux blancs, à lancer des clins d'oeil, à alimenter l'angoisse et l'imagination du lecteur et à construire la légende noire de Stan Cordova, le plus effrayant de tous les réalisateurs. Elle esquisse au passage quelques éléments de scénarios, il y aurait sûrement matière à concevoir tout ce qu'il pourrait y avoir autour et donner vie à l'oeuvre de Cordova...
Une référence m'est venue à l'esprit alors que je lisais "Intérieur nuit". Pas un film, mais bien un autre roman sur le cinéma et sur la peur. Un autre roman-fleuve que je tenais jusque-là comme un bouquin largement au-dessus de la moyenne et que le roman de Marisha Pessl vient de rejoindre : "la Conspiration des ténèbres", de Theodore Roszak.
Malgré la différence d'époque, il y a de nombreux liens entre le Max Castle de Roszak et le Stan Cordova de Pessl. De même, si les deux livres sont très éloignés l'un de l'autre dans leur facture, on pourra noter un certain nombre de passerelles, voir de point communs. En tout cas, pour qui a aimé l'un de ces deux livres, il faut lire l'autre.
Un dernier point, car l'image tient une place importante dans "Intérieur nuit". Lorsqu'on a en main le livre, ici, la version poche sortie chez Folio cet été, on remarque que la tranche n'est pas uniformément blanche. Il y a des pages noires, dirait-on. Des pages qui vont apparaître tout au long de l'histoire et qui sont en fait un complément à l'intrigue.
Ce sont des documents particuliers, des archives, des tirages imprimés issus d'internet ou des photocopies d'articles... Il y en a dès les premières pages (une fois le prologue dans Central Park passé) et jusqu'aux dernières. C'est même dans ces pages que vient s'inscrire la fameuse légende de Stan Cordova. Et c'est un procédé tout à fait intéressant, et remarquablement utilisé.
Avant de finir, il y a un point que je ne peux pas développer trop, puisqu'il concerne le dénouement d' "Intérieur nuit". Je suppose que c'est le genre de fin qui peut diviser les lecteurs. Pas en termes de qualité, après tout, cette fin n'est pas incohérente, au contraire, même. Mais, et je suis un peu sur cette longueur d'ondes, il y a quelque chose de frustrant dans cette fin.
Et l'on en revient à l'une des remarques initiales : tiens, pourquoi Folio, comme Gallimard lors de la sortie du livre en grand format, d'ailleurs, a choisi de publier "Intérieur nuit" dans des collections de littérature blanche et non de littérature noire ? Après tout, peu importe le jargon, les classements, cela pèse bien peu devant ce livre prenant, vrai page-turner dont on aimerait découvrir le contrechamp.
Ashley Cordova, ravissante et talentueuse jeune femme âgée de seulement 24 ans, s'est suicidée en se jetant du toit d'un squat new-yorkais. Sitôt la nouvelle connue, la presse s'est emballée, comme elle sait si bien le faire. Car Ashley n'est pas une inconnue : elle est la fille du plus génial, du plus controversé et du plus mystérieux cinéaste de son époque, Stan Cordova.
En une quinzaine de films, certains diffusés uniquement clandestinement et projeté dans des souterrains, car bien souvent interdit, Stan Cordova est devenu un véritable mythe. Pourquoi ? Parce que sa manière de filmer l'horreur s'est tellement affinée au fur et à mesure de sa filmographie qu'elle a fini par être jugée insupportable.
Mais, comme tout ce qui est interdit, l'oeuvre de Cordova a suscité un mouvement de grande ampleur, des fans absolus ont littéralement fondé un culte à cet homme et à son travail, organisant des projections clandestines et ritualisées, créant des sites internet hébergés dans le Darknet dont l'accès est impossible pour qui ne prouve pas son fanatisme, dressant à sa gloire un autel...
Au point que l'on en est venu à placer ces fans au même niveau que les sectes sataniques. Il faut dire que tant de rumeurs courent sur les films et sur Cordova lui-même que tout finit par se teinter d'une étrange lueur, inquiétante et morbide, qui ne fait que renforcer, dans le même temps, la ferveur des amateurs de cette oeuvre.
Quant à Cordova, lorsque sa fille meurt, cela fait des années, des décennies, même, qu'il n'est plus apparu. Sa dernière interview remonte à 1977 et on croit seulement savoir qu'il vit en reclus dans une immense propriété des Adirondacks, à l'écart de tout. Un Salinger cinématographique sentant le soufre et travaillant (peut-être) sur un nouveau chef d'oeuvre...
Si Cordova n'a pas réagi, comme à son habitude, à l'annonce de la mort de sa fille, un autre homme a appris la nouvelle avec intérêt : Scott McGrath. Journaliste d'investigation connu et reconnu, auteur de reportages et de livres qui ont marqué le public, il a, 5 ans plus tôt, voulu s'attaquer au mythe Cordova. Mal lui en a pris, incapable d'étayer ses accusations, il a vu sa carrière et sa vie s'effondrer.
Depuis, il peine à remonter la pente, mais reste persuadé que tout ce qui entoure Cordova est contaminé et que le Maître est ce qui se rapproche sans doute le plus du mal incarné. Il n'a pas renoncé à élucider les mystères qui entourent le réalisateur et lorsque sa fille est retrouvée morte, il décide de relancer son enquête, quoi qu'il lui en coûte...
Il faut dire qu'en plus de cet esprit de revanche qui l'anime, McGrath a une raison plus personnelle de comprendre pourquoi Ashley Cordova a décidé d'en finir avec l'existence : il est certain de l'avoir vue, peu de temps avant sa mort, alors qu'il faisait son jogging pendant la nuit à Central Park. Une apparition spectrale qui l'a impressionné, et qui, maintenant, vient renforcer ses questionnements...
Dès le début de ses investigations, McGrath se retrouve bien malgré lui flanqué de deux assistants un tantinet encombrants mais qu'il n'a pas le coeur de rembarrer : Nora, une jeune femme de 19 ans qui rêve d'être actrice et ne vit pour le moment que de petits boulots, et Hopper, un jeune homme énigmatique et lunatique que le journaliste soupçonne de dealer.
Nora est l'une des dernières personnes à avoir vue Ashley en vie. Elle va même apporter à McGrath un indice qui va le motiver encore un peu plus à percer le mystère qui entoure la morte et son célébrissime paternel. Quant à Hopper, McGrath l'a rencontré sur les lieux du drame ; il ne sait pas encore vraiment de quelle façon, mais le jeune homme a été liée à Ashley...
L'improbable trio essaye alors de reconstituer les derniers moments d'Ashley avant qu'elle ne se jette dans le vide. Et, au fur et à mesure de leurs recherches, une désagréable impression ne cesse de croître, un sentiment d'angoisse montent. Et, avec elle, apparaissent des éléments qui laissent penser qu'il pourrait y avoir du surnaturel derrière tout ça...
Et si, derrière le mythe qui s'est constitué autour de Stan Cordova, il y avait un fond de réalité ? Et si le réalisateur avait bel et bien passé un pacte faustien ? Et si, en plus du secret soigneusement entretenu par tout l'entourage du réalisateur, y compris ceux qui ont travaillé avec lui, était à l'oeuvre une forme de sorcellerie... De magie noire ?
"Intérieur nuit" est un grand livre, à l'ambiance aussi pesante qu'envoûtante. Portée par les Cordova père et fille et les mystères qui les entourent, l'intrigue est d'une grande efficacité : et si le génie et la folie ne faisait qu'un ? Et si le plus talentueux des réalisateurs ne rendait pas l'horreur seulement réaliste, mais avait abattu le mur qui sépare la fiction de la réalité ?
Evidemment, lorsqu'on évoque Stan Cordova, on pense à un autre "Stan", Stanley Kubrick, dont le mythe s'est forgé de son vivant à partir de sa discrétion et de films qui ont marqué les esprits. Mais Kubrick n'est rien à côté de la légende noire qu'est Stan Cordova, à côté des rumeurs extraordinaires qui entourent sa personne et de la manière dont ses fans le célèbrent.
Il y a, dans "Intérieur nuit", un jeu sur la paranoïa qui est tout à fait remarquable, puisqu'il concerne les différentes parties impliquées dans l'histoire. Du côté du clan Cordova, avec ce luxe de précautions pour que rien ne filtre sur leur vie, du côté des fans et de leurs sites internet ultra-protégés et de leurs invitations aux projections à côté desquels les rendez-vous pour les rave-parties ne sont que de vulgaires jeux de piste.
Enfin, du côté de McGrath, évidemment. Depuis 5 ans, le journaliste rumine : il est certain qu'on l'a piégé parce qu'il s'était approché trop près d'une vérité qui dérange, qui pourrait faire chuter l'idole de son piédestal. Aussi, se méfie-t-il de tout et de tous, soupçonnant que le suicide d'Ashley n'est qu'un indice de plus du côté maléfique et dangereux de Cordova.
Pourtant, au fil de l'enquête, alors que des signes de plus en plus inquiétants se manifestent, que l'impression surnaturelle se renforce et qu'on se dit qu'il se bat contre une force bien trop puissante, il conserve contre vents et marées son côté rationnel, pragmatique. Il est un journaliste d'investigation cherchant à redorer son blason, il lui faut du tangible, des preuves, des faits étayés...
Marina Pessl joue avec habileté avec différents aspects pour embrouiller son personnage, mais aussi le lecteur. Et l'un d'entre eux est la suggestion : puisqu'on enquête autour d'un personnage mythique en qui certains voient un génie du cinéma, et d'autres, un monstre sanguinaire, à chaque nouvel élément, l'imagination se met en marche.
Au coeur de tout cela, ce qu'on appelle le quatrième mur, au théâtre, ce mur imaginaire censé se dresser entre la scène et le spectateur, symbolisant la frontière entre la vie réelle et l'oeuvre qui est interprétée. Ici, on s'interroge longuement sur l'état de ce quatrième mur : existe-t-il encore ? A-t-il été partiellement ou totalement abattu ?
La fiction a-t-elle fait irruption dans le réel ou bien le réel cherche-t-il à s'infiltrer dans la fiction, celle qui a été savamment façonné pour faire de Cordova une légende suscitant des émotions extrêmement violentes ? Je me suis rapidement posé des questions à ce sujet, j'ai échafaudé quelques hypothèses à ce sujet qui me paraissaient séduisantes.
Entre l'ambiance façon "Rosemary's baby" et une enquête qui pourrait faire penser à "The Game" (le film de David Fincher, avec Michael Douglas et Sean Penn), le lecteur ne sait plus trop sur quel pied danser, tandis que McGarth s'acharne, jusqu'à prendre des libertés de plus en plus importantes avec sa déontologie journalistique.
Petit à petit, il n'est plus un reporter en quête de faits et de vérité, mais un homme qui se lance dans un combat singulier contre un ennemi qu'il faut abattre, coûte que coûte. Et plus il enquête, plus son regard sur Cordova et son entourage s'assombrit... Plus il est déterminé à en finir avec cette légende qui aura fait bien trop de mal.
Dans la famille Cordova, il y a le père, sorte de statue du Commandeur, omniprésent malgré son absence de longue date, au point que personne ne sait plus s'il est même encore vivant. Et puis, il y a la fille, Ashley, dont le destin tragique et les indices qu'elle semble avoir semé derrière elle. A son tour, son personnage se teinte d'un mystère qui dépasse toute rationalité...
"Intérieur nuit" est un magnifique hommage au cinéma d'angoisse, pas les slashers ou le gore, qui joue sur des effets factuels évidents, mais sur des ressorts psychologiques bien plus délicats. Une mécanique fort bien huilée, où chaque nouvel élément vient troubler un peu plus les choses. Et, cerise sur le gâteau, on ressort de cette lecture avec tout de même un léger doute en tête : et si... ?
Au fil de ces 850 pages, qu'on ne peut s'empêcher de tourner, sans même s'en rendre compte, on croise différents hommages à des maîtres du genre. J'ai évoqué Fincher, plus haut, par exemple (et d'ailleurs, je serais curieux de voir ce qu'il ferait d'un scénario tiré du livre de Marisha Pessl), mais aussi Bryan Singer, Hitchcock et tant d'autres.
Sans oublier cette scène d'ouverture dans Central Park, qui rappelle indéniablement "Marathon Man". On a l'impression de suivre une nouvelle fois Dustin Hoffmann dans son jogging, on passe même devant la South Gate House, où se déroule le dénouement du film, la chute des diamants, tout ça... Mais pas de Laurence Olivier à l'horizon, juste une mystérieuse jeune femme à l'allure spectrale...
Dustn Hoffmann est d'ailleurs très présent dans "Intérieur nuit", puisqu'on le retrouve dans un autre de ses fameux rôles, celui du journaliste Carl Bernstein, qui révéla le scandale du Watergate et que l'acteur immortalise dans "les Hommes du Président". McGrath s'amuse à surnommer ainsi Nora, qui lui rend en retour du Woodward (Robert Redford dans le film, il y a pire, comme vanne)...
Bref, Marisha Pessl s'amuse à semer des cailloux blancs, à lancer des clins d'oeil, à alimenter l'angoisse et l'imagination du lecteur et à construire la légende noire de Stan Cordova, le plus effrayant de tous les réalisateurs. Elle esquisse au passage quelques éléments de scénarios, il y aurait sûrement matière à concevoir tout ce qu'il pourrait y avoir autour et donner vie à l'oeuvre de Cordova...
Une référence m'est venue à l'esprit alors que je lisais "Intérieur nuit". Pas un film, mais bien un autre roman sur le cinéma et sur la peur. Un autre roman-fleuve que je tenais jusque-là comme un bouquin largement au-dessus de la moyenne et que le roman de Marisha Pessl vient de rejoindre : "la Conspiration des ténèbres", de Theodore Roszak.
Malgré la différence d'époque, il y a de nombreux liens entre le Max Castle de Roszak et le Stan Cordova de Pessl. De même, si les deux livres sont très éloignés l'un de l'autre dans leur facture, on pourra noter un certain nombre de passerelles, voir de point communs. En tout cas, pour qui a aimé l'un de ces deux livres, il faut lire l'autre.
Un dernier point, car l'image tient une place importante dans "Intérieur nuit". Lorsqu'on a en main le livre, ici, la version poche sortie chez Folio cet été, on remarque que la tranche n'est pas uniformément blanche. Il y a des pages noires, dirait-on. Des pages qui vont apparaître tout au long de l'histoire et qui sont en fait un complément à l'intrigue.
Ce sont des documents particuliers, des archives, des tirages imprimés issus d'internet ou des photocopies d'articles... Il y en a dès les premières pages (une fois le prologue dans Central Park passé) et jusqu'aux dernières. C'est même dans ces pages que vient s'inscrire la fameuse légende de Stan Cordova. Et c'est un procédé tout à fait intéressant, et remarquablement utilisé.
Avant de finir, il y a un point que je ne peux pas développer trop, puisqu'il concerne le dénouement d' "Intérieur nuit". Je suppose que c'est le genre de fin qui peut diviser les lecteurs. Pas en termes de qualité, après tout, cette fin n'est pas incohérente, au contraire, même. Mais, et je suis un peu sur cette longueur d'ondes, il y a quelque chose de frustrant dans cette fin.
Et l'on en revient à l'une des remarques initiales : tiens, pourquoi Folio, comme Gallimard lors de la sortie du livre en grand format, d'ailleurs, a choisi de publier "Intérieur nuit" dans des collections de littérature blanche et non de littérature noire ? Après tout, peu importe le jargon, les classements, cela pèse bien peu devant ce livre prenant, vrai page-turner dont on aimerait découvrir le contrechamp.
mardi 22 août 2017
"Pourquoi j'écris ? Parce que je témoigne, je suis le gardien, je fais reculer la mort des miens car ils sont essentiels et dignes d'éternité. Dieu écrit, moi aussi".
Après "Nos richesses", de Kaouther Adimi, voici un autre roman qui parle de la littérature, de l'écriture, de l'amour porté aux livres et de l'importance de l'écrit dans nos vies. Et c'est un roman signé par un autre romancier algérien, sans doute un de ceux dont on parle le plus ces derniers temps, Kamel Daoud, finaliste du Goncourt pour son précédent roman "Meursault contre-enquête". Avec "Zabor ou les psaumes" (en grand format aux éditions Actes Sud), il signe une sorte de conte philosophique, clin d'oeil à la tradition des "Mille et une nuits", porté par un personnage de paria magnifique qui devrait un peu plus agacer ses détracteurs. A travers l'importance de l'écrit pour laisser trace, pour garder le souvenir des gens, Kamel Daoud oppose également la littérature dans sa diversité à la tradition religieuse qui ne repose que sur un seul livre saint, dont les textes sont souvent transmis oralement. A ces ordres, imposés de façon de plus en plus virulente, il prône la liberté totale qu'offre l'imagination.
Il s'appelle Ismaël, mais se fait appeler Zabor. Il vit dans la petite ville d'Aboukir, en Algérie, où il ne se passe jamais rien et qui semble vivre en vase clos. Il est le fils d'un homme riche, le boucher du village, celui à qui l'on confie tous les sacrifices au moment des fêtes religieuses. Et pourtant, Zabor ne profite guère de cette aisance qui fait des envieux.
Âgé de 28 ans, puceau et non-circoncis, il vit seul aux côté de sa tante Hadjer, dans une maison à l'écart de celle où vivent son père et ses demi-frères. Fils d'une femme répudiée, morte quand il était encore très jeune, Zabor n'a jamais été accepté par les siens, bien au contraire. Et ça ne s'est pas arrangé avec les années. Il vit donc désormais en véritable paria.
Mais il s'en fout. Car, malgré sa mise à l'écart, il n'y a pas plus heureux que Zabor. Même si tout n'est pas parfait, comme son amour imparfait pour Djemila, une jeune femme divorcée et mère de deux enfants, Zabor se sent bien plus heureux que cette famille qui le rejette. Car il possède des aptitudes qu'il est le seul à maîtriser dans sa famille et dans son entourage : il sait lire et écrire.
Mieux que cela, il s'est découvert un don incroyable qui lui vaut d'être contacté régulièrement par des familles de la région : il sait comment repousser la mort. Lorsqu'il écrit sur quelqu'un, sa vie en est rallongée. Alors, lorsqu'une personne entre en agonie, on vient le chercher et il écrit alors sans discontinuer jusqu'à ce que le moment critique passe... On lui en est toujours très reconnaissant.
Depuis qu'il a compris qu'il possédait ce don, Zabor se consacre donc à l'écriture : vivant la nuit et dormant le jour, il noircit des dizaines, des centaines de cahiers d'une petite écriture serrée. Chaque cahier est dédié à l'un de ses proches, l'une de ses connaissances. Parfois, il en consacre plusieurs à un seul être, contribuant ainsi, il y croit dur comme fer, à éloigner de lui le spectre de la mort.
Jusqu'au jour où c'est son demi-frère, Abdel, celui avec lequel il est à couteaux tirés depuis l'enfance, qui vient frapper à sa porte. Leur père est sur le point de mourir et, même si c'est une idée qui doit les révulser, ses enfants ont accepté que Zabor, le paria, le mal-aimé, vienne au chevet du patriarche pour exercer son don...
"Zabor ou les psaumes" n'est pas un roman comme les autres, sa construction narrative, qui touche à la révélation du don du personnage principal, mais aussi au récit de ses 28 années d'existence, jusqu'à ces jours sombres lorsque le père approche de la fin, pouvant dérouter. Mais, un des points névralgiques de cette histoire, c'est le dilemme qui se présente à Zabor.
Doit-il faire usage de son don et permettre à son père de survivre, ce père qui ne l'aime pas et lui montre au quotidien, ou presque, ou bien doit-il échouer, plus ou moins volontairement, histoire de se venger ? Son don lui laisse un court laps de temps pour se décider, mais il va vite devoir choisir : écrire ou ne pas écrire, telle est la question.
Le don de Zabor... Il y a quelque chose de très poétique et de merveilleux dans ce don, fruit de l'imagination d'un enfant qui a grandi. Repousser la mort... Plus que la mort physique, c'est l'effacement, l'immersion définitive dans les ténèbres éternelles, que chasse Zabor : en écrivant sur les siens, il laisse une trace de leur passage sur terre, atteste de leur existence et en témoigne pour l'avenir.
En fait, et Kamel Daoud fait référence aux "Mille et une nuits" et au personnage de Shéhérazade, il en est un cousin éloigné. Chaque nuit, comme la reine du livre doit, pour survivre et échapper à la mort, raconter des histoires, Zabor doit absolument écrire pour éloigner la mort qui plane sur les siens, ses proches, ses amis, ses concitoyens. Et peu importe ce qu'il pense d'eux et ce qu'on pense de lui.
Il est en quelque sorte en mission, pas une mission divine, non, une mission humaine. Une mission qui commence par refuser l'idée même de la mort, nier jusqu'à son existence. Pour lui, écrire n'est rien moins qu'une quête d'éternité, une quête dont il espère qu'elle profitera à tous, peut-être même malgré eux. Pas de mort, pas d'oubli...
Mais qu'écrit-il, exactement ? On ne le saura pas (sauf si l'on considère qu'on en a un exemple sous les yeux et que les passages en italique et entre crochets sont en fait des passages oraux, appelés, eux, à s'envoler). En revanche, on découvre certaines habitudes de Zabor, dont l'une est absolument géniale et témoigne de l'incroyable culture littéraire de ce garçon.
Très tôt et seul, Zabor a appris à lire. En arabe puis, par la suite, en français (autre particularité inédite du jeune homme à Aboukir). Et il a découvert un univers incroyable dont il pouvait profiter seul et jouir à volonté. Il a dévoré des milliers de bouquins, arrivés jusqu'à lui tant bien que mal, parfois en très mauvais état, et s'est forgé une solide culture littéraire.
Au point de donner des titres de livres très connus à ses cahiers, dans lesquels il réinvente des histoires en permanence. Zabor, c'est l'incarnation de l'imagination et de la liberté totale qu'elle procure. Et cela, il le doit à l'éducation qu'il a reçue, car, dès l'enfance, auprès de sa tante, il a pu exercer ce véritable talent (sans doute bien plus puissant que son don).
Voilà en quoi "Zabor ou les psaumes" est un hymne à l'imaginaire, aux voyages immobiles vers des contrées que l'on ne visitera jamais physiquement, à la rencontre de personnages qui ne passeront jamais dans notre coin, aux histoires fabuleuses qui rendent notre quotidien plus mornes encore. Bref, un hymne à l'extraordinaire, au rêve, à l'évasion...
Mais il faut ajouter certains éléments. On le sait, Kamel Daoud, dans ses livres et plus encore dans ses chroniques de presse (il a longtemps été l'un des chroniqueurs les plus lus en Algérie, si ce n'est le plus lu), s'est montré très critique envers la religion, et au premier chef, l'Islam, et les fanatiques qui s'en revendiquent, se créant nombre d'inimitiés, y compris en France.
A travers cet éloge de l'écrit, Kamel Daoud rajoute une couche. Il oppose clairement l'écriture et la littérature, avec son champ des possibles infini, à la religion, concentrée sur un, ou au plus sur quelques livres dits saints, et dont l'enseignement repose sur l'oralité. La lecture, savoir lire, c'est aussi ce qui permet d'exercer un libre arbitre, de comprendre par soi-même, de remettre en cause l'ordre que l'on voudrait imposer à tous.
Zabor, le paria, l'intouchable, l'infréquentable, celui qu'on n'appelle que lorsqu'on est au plus mal, se retrouve au-dessus de tous ceux qui l'accablent et le méprisent parce qu'il possèdent ces aptitudes, et pas eux. Ils n'en savent rien, ils s'en moquent certainement, mais Zabor, lui, sait quel trésor il possède et n'a nulle intention de le partager avec eux. Qu'ils continuent à le prendre pour un fou !
Pour marquer encore cela, Kamel Daoud, le provocateur, glisse quelques éléments forts dans son roman. Cela passe par la phrase qui sert de titre à ce billet et qui, je pense, devrait lui attirer bien des critiques et sans doute quelques menaces : "Dieu écrit, moi aussi", ces mots sont lourds de sens dans le contexte que l'on connaît...
Son personnage se prénomme en réalité Ismaël, comme le fils aîné d'Abraham, celui que la tradition considère comme le père de la nation arabe. Un prophète important de l'Islam, ce que n'est pas le personnage de Zabor, qui semble par son comportement s'ériger comme son exact contraire. Il a même tout d'un mécréant, malgré l'éducation religieuse qu'il a reçue.
Quant à Zabor, le choix de ce surnom n'est pas anodin non plus : c'est ainsi que les musulmans appellent le livre des Psaumes (ce que rappelle d'ailleurs le sous-titre du roman de Kamel Daoud), qui est l'un des trois ouvrages, avec la Torah et les Evangiles, qui ont été révélés aux hommes par Allah, avant le Coran.
Et à qui le Zabor a-t-il été révélé ? A David, Daoud, pour l'Islam. Voilà, la boucle est bouclée, et à tout ce que l'on vient d'évoquer, vient s'ajouter de subtils clins d'oeil autobiographiques. Aboukir, depuis l'indépendance de l'Algérie, a pris le nom de Mesra, et c'est la ville natale de Kamel Daoud. Pour le reste, j'y vois surtout des symboles pour souligner l'indépendance d'esprit de l'auteur. Et son propre côté paria.
En revanche, Zabor, le mal-aimé de son père et de ses demi-frères, c'est clairement le journaliste et écrivain Kamel Daoud maltraité par son propre pays natal et ses concitoyens, l'homme mis à l'écart, vilipendé, menacé, parfois rappelé quand on ne peut faire autrement, mais qui refusera toujours de se plier à l'ordre établi par ce père qu'il estime trop rude, trop rigide.
A travers ces détails, on voit transparaître l'ironie mordante de Kamel Daoud, que l'on retrouve aussi dans un certain nombre d'épisodes que relate Zabor. Et, en particulier, dans un final qui, d'un seul coup, perd tout contact avec la réalité pour quelques instants de folie au cours desquels Zabor se transforme en une espèce de personnage insaisissable, rappelant le Charlot des "Temps modernes".
"Zabor ou les psaumes" n'est pas seulement un roman qui fait l'éloge de l'écrit, c'est un livre très joliment écrit. Vivace et truculent, un style riche, flamboyant par moments, déroutant, quelquefois, où la limite entre la réalité et l'imagination s'estompe. Nul ne peut réellement dire qui est vraiment Zabor, ce qui l'anime réellement.
Et c'est aussi ce qui rend tout cela merveilleux : que l'on croie Zabor ou non, qu'il épanche sur le papier la douleur que provoque chez lui sa situation de paria, la haine injuste qui pèse sur lui, ou qu'il relate fidèlement sa vie et les événements entourant la mort de son père, cela a finalement peu d'importance.
Ce qu'il faut retenir, c'est cette passion de l'écrit, de l'écriture comme de la lecture, et ce que cela apporte, quel que soit le contexte, à celle et à celui qui sait s'en emparer. A commencer par l'ouverture d'esprit. Ainsi, pourra-t-elle, pourra-t-il construire son existence comme il l'entend, sans se laisser enfermer par des préceptes immuables et inviolables sous peine d'être sévèrement puni ou rejeté.
Il s'appelle Ismaël, mais se fait appeler Zabor. Il vit dans la petite ville d'Aboukir, en Algérie, où il ne se passe jamais rien et qui semble vivre en vase clos. Il est le fils d'un homme riche, le boucher du village, celui à qui l'on confie tous les sacrifices au moment des fêtes religieuses. Et pourtant, Zabor ne profite guère de cette aisance qui fait des envieux.
Âgé de 28 ans, puceau et non-circoncis, il vit seul aux côté de sa tante Hadjer, dans une maison à l'écart de celle où vivent son père et ses demi-frères. Fils d'une femme répudiée, morte quand il était encore très jeune, Zabor n'a jamais été accepté par les siens, bien au contraire. Et ça ne s'est pas arrangé avec les années. Il vit donc désormais en véritable paria.
Mais il s'en fout. Car, malgré sa mise à l'écart, il n'y a pas plus heureux que Zabor. Même si tout n'est pas parfait, comme son amour imparfait pour Djemila, une jeune femme divorcée et mère de deux enfants, Zabor se sent bien plus heureux que cette famille qui le rejette. Car il possède des aptitudes qu'il est le seul à maîtriser dans sa famille et dans son entourage : il sait lire et écrire.
Mieux que cela, il s'est découvert un don incroyable qui lui vaut d'être contacté régulièrement par des familles de la région : il sait comment repousser la mort. Lorsqu'il écrit sur quelqu'un, sa vie en est rallongée. Alors, lorsqu'une personne entre en agonie, on vient le chercher et il écrit alors sans discontinuer jusqu'à ce que le moment critique passe... On lui en est toujours très reconnaissant.
Depuis qu'il a compris qu'il possédait ce don, Zabor se consacre donc à l'écriture : vivant la nuit et dormant le jour, il noircit des dizaines, des centaines de cahiers d'une petite écriture serrée. Chaque cahier est dédié à l'un de ses proches, l'une de ses connaissances. Parfois, il en consacre plusieurs à un seul être, contribuant ainsi, il y croit dur comme fer, à éloigner de lui le spectre de la mort.
Jusqu'au jour où c'est son demi-frère, Abdel, celui avec lequel il est à couteaux tirés depuis l'enfance, qui vient frapper à sa porte. Leur père est sur le point de mourir et, même si c'est une idée qui doit les révulser, ses enfants ont accepté que Zabor, le paria, le mal-aimé, vienne au chevet du patriarche pour exercer son don...
"Zabor ou les psaumes" n'est pas un roman comme les autres, sa construction narrative, qui touche à la révélation du don du personnage principal, mais aussi au récit de ses 28 années d'existence, jusqu'à ces jours sombres lorsque le père approche de la fin, pouvant dérouter. Mais, un des points névralgiques de cette histoire, c'est le dilemme qui se présente à Zabor.
Doit-il faire usage de son don et permettre à son père de survivre, ce père qui ne l'aime pas et lui montre au quotidien, ou presque, ou bien doit-il échouer, plus ou moins volontairement, histoire de se venger ? Son don lui laisse un court laps de temps pour se décider, mais il va vite devoir choisir : écrire ou ne pas écrire, telle est la question.
Le don de Zabor... Il y a quelque chose de très poétique et de merveilleux dans ce don, fruit de l'imagination d'un enfant qui a grandi. Repousser la mort... Plus que la mort physique, c'est l'effacement, l'immersion définitive dans les ténèbres éternelles, que chasse Zabor : en écrivant sur les siens, il laisse une trace de leur passage sur terre, atteste de leur existence et en témoigne pour l'avenir.
En fait, et Kamel Daoud fait référence aux "Mille et une nuits" et au personnage de Shéhérazade, il en est un cousin éloigné. Chaque nuit, comme la reine du livre doit, pour survivre et échapper à la mort, raconter des histoires, Zabor doit absolument écrire pour éloigner la mort qui plane sur les siens, ses proches, ses amis, ses concitoyens. Et peu importe ce qu'il pense d'eux et ce qu'on pense de lui.
Il est en quelque sorte en mission, pas une mission divine, non, une mission humaine. Une mission qui commence par refuser l'idée même de la mort, nier jusqu'à son existence. Pour lui, écrire n'est rien moins qu'une quête d'éternité, une quête dont il espère qu'elle profitera à tous, peut-être même malgré eux. Pas de mort, pas d'oubli...
Mais qu'écrit-il, exactement ? On ne le saura pas (sauf si l'on considère qu'on en a un exemple sous les yeux et que les passages en italique et entre crochets sont en fait des passages oraux, appelés, eux, à s'envoler). En revanche, on découvre certaines habitudes de Zabor, dont l'une est absolument géniale et témoigne de l'incroyable culture littéraire de ce garçon.
Très tôt et seul, Zabor a appris à lire. En arabe puis, par la suite, en français (autre particularité inédite du jeune homme à Aboukir). Et il a découvert un univers incroyable dont il pouvait profiter seul et jouir à volonté. Il a dévoré des milliers de bouquins, arrivés jusqu'à lui tant bien que mal, parfois en très mauvais état, et s'est forgé une solide culture littéraire.
Au point de donner des titres de livres très connus à ses cahiers, dans lesquels il réinvente des histoires en permanence. Zabor, c'est l'incarnation de l'imagination et de la liberté totale qu'elle procure. Et cela, il le doit à l'éducation qu'il a reçue, car, dès l'enfance, auprès de sa tante, il a pu exercer ce véritable talent (sans doute bien plus puissant que son don).
Voilà en quoi "Zabor ou les psaumes" est un hymne à l'imaginaire, aux voyages immobiles vers des contrées que l'on ne visitera jamais physiquement, à la rencontre de personnages qui ne passeront jamais dans notre coin, aux histoires fabuleuses qui rendent notre quotidien plus mornes encore. Bref, un hymne à l'extraordinaire, au rêve, à l'évasion...
Mais il faut ajouter certains éléments. On le sait, Kamel Daoud, dans ses livres et plus encore dans ses chroniques de presse (il a longtemps été l'un des chroniqueurs les plus lus en Algérie, si ce n'est le plus lu), s'est montré très critique envers la religion, et au premier chef, l'Islam, et les fanatiques qui s'en revendiquent, se créant nombre d'inimitiés, y compris en France.
A travers cet éloge de l'écrit, Kamel Daoud rajoute une couche. Il oppose clairement l'écriture et la littérature, avec son champ des possibles infini, à la religion, concentrée sur un, ou au plus sur quelques livres dits saints, et dont l'enseignement repose sur l'oralité. La lecture, savoir lire, c'est aussi ce qui permet d'exercer un libre arbitre, de comprendre par soi-même, de remettre en cause l'ordre que l'on voudrait imposer à tous.
Zabor, le paria, l'intouchable, l'infréquentable, celui qu'on n'appelle que lorsqu'on est au plus mal, se retrouve au-dessus de tous ceux qui l'accablent et le méprisent parce qu'il possèdent ces aptitudes, et pas eux. Ils n'en savent rien, ils s'en moquent certainement, mais Zabor, lui, sait quel trésor il possède et n'a nulle intention de le partager avec eux. Qu'ils continuent à le prendre pour un fou !
Pour marquer encore cela, Kamel Daoud, le provocateur, glisse quelques éléments forts dans son roman. Cela passe par la phrase qui sert de titre à ce billet et qui, je pense, devrait lui attirer bien des critiques et sans doute quelques menaces : "Dieu écrit, moi aussi", ces mots sont lourds de sens dans le contexte que l'on connaît...
Son personnage se prénomme en réalité Ismaël, comme le fils aîné d'Abraham, celui que la tradition considère comme le père de la nation arabe. Un prophète important de l'Islam, ce que n'est pas le personnage de Zabor, qui semble par son comportement s'ériger comme son exact contraire. Il a même tout d'un mécréant, malgré l'éducation religieuse qu'il a reçue.
Quant à Zabor, le choix de ce surnom n'est pas anodin non plus : c'est ainsi que les musulmans appellent le livre des Psaumes (ce que rappelle d'ailleurs le sous-titre du roman de Kamel Daoud), qui est l'un des trois ouvrages, avec la Torah et les Evangiles, qui ont été révélés aux hommes par Allah, avant le Coran.
Et à qui le Zabor a-t-il été révélé ? A David, Daoud, pour l'Islam. Voilà, la boucle est bouclée, et à tout ce que l'on vient d'évoquer, vient s'ajouter de subtils clins d'oeil autobiographiques. Aboukir, depuis l'indépendance de l'Algérie, a pris le nom de Mesra, et c'est la ville natale de Kamel Daoud. Pour le reste, j'y vois surtout des symboles pour souligner l'indépendance d'esprit de l'auteur. Et son propre côté paria.
En revanche, Zabor, le mal-aimé de son père et de ses demi-frères, c'est clairement le journaliste et écrivain Kamel Daoud maltraité par son propre pays natal et ses concitoyens, l'homme mis à l'écart, vilipendé, menacé, parfois rappelé quand on ne peut faire autrement, mais qui refusera toujours de se plier à l'ordre établi par ce père qu'il estime trop rude, trop rigide.
A travers ces détails, on voit transparaître l'ironie mordante de Kamel Daoud, que l'on retrouve aussi dans un certain nombre d'épisodes que relate Zabor. Et, en particulier, dans un final qui, d'un seul coup, perd tout contact avec la réalité pour quelques instants de folie au cours desquels Zabor se transforme en une espèce de personnage insaisissable, rappelant le Charlot des "Temps modernes".
"Zabor ou les psaumes" n'est pas seulement un roman qui fait l'éloge de l'écrit, c'est un livre très joliment écrit. Vivace et truculent, un style riche, flamboyant par moments, déroutant, quelquefois, où la limite entre la réalité et l'imagination s'estompe. Nul ne peut réellement dire qui est vraiment Zabor, ce qui l'anime réellement.
Et c'est aussi ce qui rend tout cela merveilleux : que l'on croie Zabor ou non, qu'il épanche sur le papier la douleur que provoque chez lui sa situation de paria, la haine injuste qui pèse sur lui, ou qu'il relate fidèlement sa vie et les événements entourant la mort de son père, cela a finalement peu d'importance.
Ce qu'il faut retenir, c'est cette passion de l'écrit, de l'écriture comme de la lecture, et ce que cela apporte, quel que soit le contexte, à celle et à celui qui sait s'en emparer. A commencer par l'ouverture d'esprit. Ainsi, pourra-t-elle, pourra-t-il construire son existence comme il l'entend, sans se laisser enfermer par des préceptes immuables et inviolables sous peine d'être sévèrement puni ou rejeté.
Inscription à :
Articles (Atom)
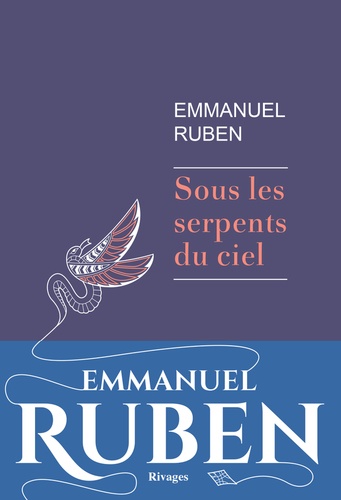



.jpg/1024px-Evariste_Vital_Luminais_-_Les_%C3%A9nerv%C3%A9s_de_Jumi%C3%A8ges_(Mus%C3%A9e_des_beaux-arts_de_Rouen).jpg)