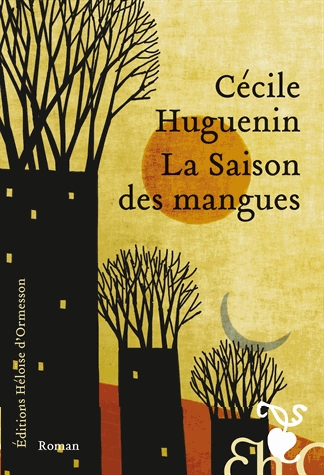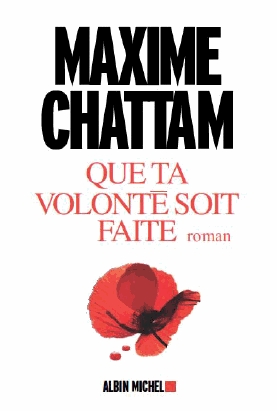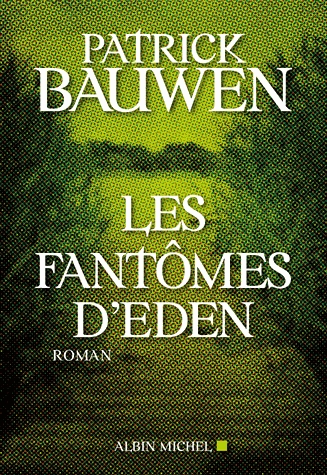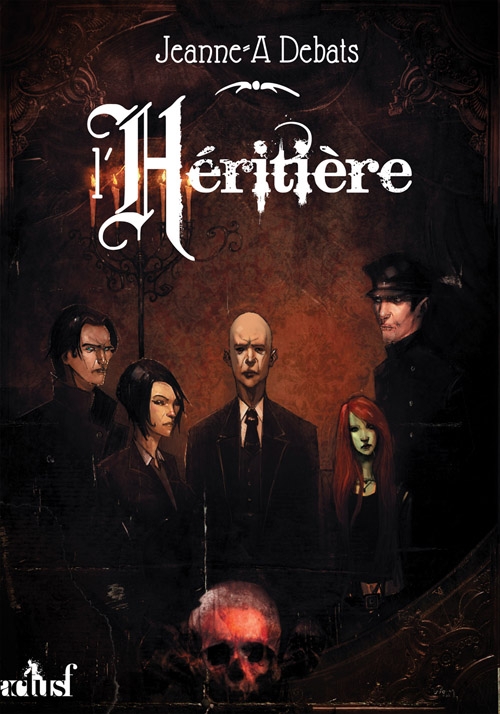Lorsque Couto se réveille, ce matin-là, c'est pour s'entendre annoncer une terrible nouvelle : elle est morte. Elle, c'est Dulce Neves, la voix de la Guinée-Bissau, comme Amalia Rodrigues au Portugal ou Cesaria Evora au Cap-Vert. Pour le moment, l'information n'a pas été rendue publique et Couto est l'un des premiers, l'un des seuls à la connaître.
Et s'il est parmi les premiers prévenus, c'est parce qu'il a bien connu Dulce. Ils ont été amants, avant qu'elle ne le quitte pour épouser un des personnages les plus puissants du pays, le général Gomes. Mais, surtout, ils se sont bien connus parce qu'ils appartenaient au même groupe, le génial Super Mama Djombo, le groupe le plus célèbre du pays pendant de nombreuses années, juste après l'indépendance du pays.
Alors, ce décès, forcément, ça le laisse un peu KO, ce bon Couto, qui était le guitariste du Super Mama Djombo. D'une seul coup, ce sont quarante années qui passent devant les yeux de cet homme qui n'a jamais eu la vie dont il rêvait dans sa jeunesse, quand il se battait pour chasser l'armée portugaise de son pays et obtenir l'indépendance.
Puis, la musique, la gloire, les tournées dans toute l'Afrique, mais aussi dans le monde, en Europe, à Cuba... Le temps qui passe, le pays, devenu indépendant, qui plonge dans la dictature, vit au rythme des coups d'Etat, ne connaît pas de stabilité politique ni de développement économique, malgré ses nombreux atouts naturels.
Lui-même, après avoir été une star, rempli des salles, des stades, fait danser des foules, enregistré des disques devenus cultes, a connu la précarité matérielle. Oh, sans doute s'est-il laissé un peu aller, sans doute n'a-t-il pas eu l'ambition de certains des autres membres du groupes, partis à l'étranger, mener des carrières plus ou moins réussies, vivre des vies plus ou moins heureuses.
Mais lui, il n'a jamais pu se résigner à quitter sa terre. C'est elle qui coule dans ses veines, qui le tient en vie, qui le nourrit, loin d'elle, il dépérirait, il en est sûr. Alors, il a progressivement abandonné la plupart de ses rêves, des plus sérieux, voir régner l'égalité et l'harmonie dans cette Guinée-Bissau qu'il aime tant, au plus légers, comme la musique, qui n'est plus son activité principale.
Pourtant, la musique revient peu à peu dans la vie de Couto. De jeunes musiciens sont venus rejoindre les vieux de la vieille pour faire revivre le Super Mama Djombo. Et, ce soir là, le groupe doit rejouer, justement. Un concert à tout casser, le plus grand de tous, espèrent-ils. Mais la mort de Dulce, l'être qui manque et dépeuple tout, change la donne.
Voilà qui devrait rajouter à l'émotion de se retrouver sur scène. La fête sera un peu moins joyeuse, sans doute, mais la musique devrait faire d'autant plus vibrer les spectateurs qui répondront forcément présents. Restera à gérer un impondérable de taille. Car le décès de Dulce n'est pas arrivée à n'importe quel moment...
Ce jour-là, en Guinée-Bissau, on vote. Les élections présidentielles, qui sont le point d'orgue d'une campagne électorale sans pitié. L'élection du général Gomes quasiment assurée, un résultat contesté avant même son officialisation et une tension qui monte, d'abord imperceptiblement, jusqu'à ce que les rumeurs d'un coup d'Etat, encore un, se répandent dans Bissau, la capitale.
"Les Grands", c'est le récit de cette journée pas ordinaire, où se télescopent des événements de plus ou moins grande importance. L'échelle, elle, est toute relative, bien sûr, et tout le monde sait que l'annonce officielle du décès de Dulce fera déferler une vague d'émotion sur le pays, à moins qu'il ne soit plongé dans le chaos d'un énième coup d'Etat.
Au milieu de tout cela, Couto revit ces décennies qui ont fait de lui l'homme qu'il est. Et puis, surtout, malgré la relation torride qu'il entretient avec la magnifique Esperança, se réveille le souvenir de son existence aux côtés de Dulce. Sa voix s'est tue et pourtant, elle n'a jamais été aussi présente dans l'esprit du guitariste.
Cette voix si particulière qui les a envoûtés dès le premier jour, sortant de cette personne dont ils ne soupçonnaient pas le charisme. Et la magie a fait effet, ce timbre a porté le groupes aux nues, a fait son immense popularité, a rendu l'effet de la musique entraînante ou pleine de saudade du Super Mama Djombo, lui a donné un supplément d'âme. Sans cette voix qui s'est éteinte, le groupe n'aurait jamais été le même.
Avec la mort de Dulce, Couto prend conscience de manière très brutale, inattendue, qu'une page ce tourne. Comme si, brusquement, il prenait conscience du poids de ces quarante années, il réalisait qu'elles ont passé et emporté avec elles ses illusions, ses rêves, ses attentes les plus profondes. Et il accuse le coup.
Pourtant, "un bon guitariste, ça a le cuir dur", ce n'est pas moi qui le dit, c'est Couto qui le dit dans le roman. Mais, là, c'en est un peu trop pour lui. La goutte d'eau qui fait déborder le vase de son amertume. Les guitaristes s'en tirent, oui, c'est certain, mais à quel prix ? Celui de la souffrance et de la tristesse ?
La chanteuse est morte et pourtant, elle habite les 250 pages de ce roman, comme si elle en était le personnage central. Un petit bout de femme à la voix extraordinaire et au caractère bien trempé. Elle qui a longtemps défié le pouvoir jusqu'à le rejoindre dans son lit, sans pour autant jamais désarmer, jusqu'à ce qu'elle ne se réveille pas, en ce matin fatidique.
Avec la mort de Dulce, c'est un bout d'âme de Couto, du Super Mama Djombo, de Bissau et du pays tout entier qui s'en va. Mais, contrairement à ce que dit le guitariste, certes, les chanteurs meurent, mais leurs voix, gravées sur des disques, vinyles, CD ou même en MP3, désormais, demeurent. Et continueront à donner le frisson. Et donneront, c'est vrai, une vilaine nostalgie qui peut piquer un peu les yeux.
"Les grands" est un roman particulier. Parce qu'il joue habilement avec des éléments qu'on pourrait penser inversés. En effet, si Couto, le personnage que l'on suit au cours de cette longue journée, entre errance, tristesse et désillusion, est un pur personnage de fiction, Dulce, elle, existe bien. Et je rassure tout le monde, elle n'est pas morte, elle va bien et chante certainement encore.
Sylvain Prudhomme a fabriqué ce guitariste nostalgique, héros de l'indépendance et homme vieillissant loin de ses idéaux de jeunesse, l'a intégré à un groupe musical existant, le Super Mama Djombo et permet ainsi de raconter aussi bien son histoire que celle de ce pays qui s'est libéré par la force de son joug colonial.
Et, dans le même temps, il a brodé sur le véritable personnage qu'est Dulce, toute une histoire qui la fait entrer un peu plus dans la légende et, surtout, la lie étroitement à l'Histoire en marche de son pays. La mort de Dulce, en tout cas son annonce, qui ouvre le livre, comme ce coup d'Etat qui se profile, marquent la fin d'une ère.
Un ère à laquelle appartient le Super Mama Djombo, dont les textes étaient en créole, pas en Portugais, la langue du colonisateur. Il y a une scène frappante, d'ailleurs, dans la dernière partie du livre, où Couto parle avec une très jeune femme. Elle entend la musique de Super Mama Djombo et déteste. De la musique de vieux !
Pour elle, la seule musique, c'est le rap et les jeunes groupes actuelles qui remplissent à leur tour les salles que Couto et ses amis faisaient vibrer en leur temps. Mais, quand retentit la voix de Dulce, tout change. La jeune femme, subitement, change de ton. Dulce, non, ce n'est pas pareil, c'est... au-delà des genres musicaux, du temps qui passe. Immortelle et intergénérationnelle.
Couto, qui prend un coup de vieux quand sa jeune interlocutrice parle avec dédain du Super Mama Djombo, de cette musique qu'il a jouée avec ses tripes, revient aussitôt en grâce quand il lui raconte qu'il a bien connu Dulce, très bien connu... La gamine est alors à une main de Dulce dont la voix la transcende, malgré l'écart de temps, de goût, de culture...
Couto, c'est la Guinée d'hier, en tout cas, c'est l'impression qui le gagne peu à peu au fil de cette journée.La Guinée de demain, ce sont ces rappeurs, ces gamins dans la rue, prêts à se joindre aux barricades qui ne manqueront pas de se construire en cas de coup d'Etat, ce sont ces p'tits jeunes qui font revivre le Super Mama Djombo en lui impulsant un sang neuf, mais aussi un regard nouveau.
Has been, Couto ? Je n'ai pas trouvé. Son côté pathétique et sa douleur non-feinte le rende même assez sympathique. Son attachement viscéral à ce pays que tant ont fui, fuient toujours et fuiront encore à l'avenir, pour trouver ailleurs une vie qui ne sera que rarement meilleure, le rend même touchant. Et son côté désabusé, presque fataliste, en fait un vrai personnage romanesque, plein de failles.
De la même façon qu'il l'a fait pour Dulce, Sylvain Prudhomme joue avec le contexte. Le coup d'Etat dont il est question est celui de 2012, le général Gomes est ce favori des urnes qui sera renversé. Mais, là encore, le romancier prend des libertés avec le réel pour donner de la chair à son cadre romanesque et surtout, créer cette relation triangulaire si étrange avec Dulce et Couto.
Et puis, évidemment, il y a la musique. "Les Grands" est un livre qu'on ne peut pas écouter sans aller sur un moteur de recherche pour écouter le son du Super Mama Djombo, la voix de Dulce, les sonorités métissées de la musique bissau-guinéenne... Je ne connaissais pas ce groupe, à la vérité, mais je dois dire que leur musique est au diapason du roman.
Les titres que je vous propose pour conclure ce billet ne sont pas choisis au hasard. Ils sont cités dans le roman, à des moments précis de l'histoire. Leur texte est cité pour l'un d'entre eux, et la chanson est même expliquée pour la replacer dans son contexte. Pour moi qui aime bien lire en musique, c'est parfait...
D'abord "Dissa na mbera", chanson d'opposition au pouvoir et aux classes dominantes...
Et puis "Djan Djan", la chanson de l'exil, dans une version signée par la nouvelle formation...
En tendant l'oreille, je suis certain que derrière les voix, dont celle de Dulce, vous entendrez la guitare de Couto...