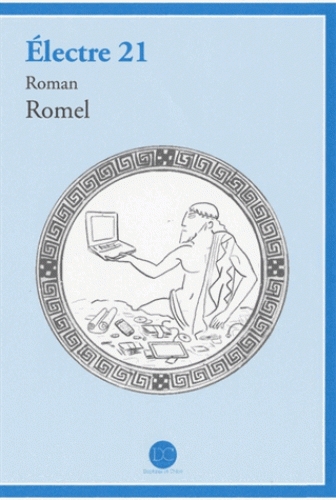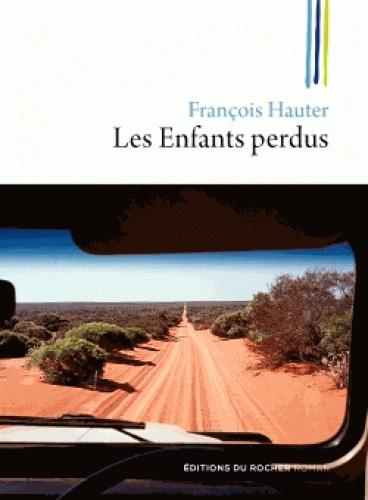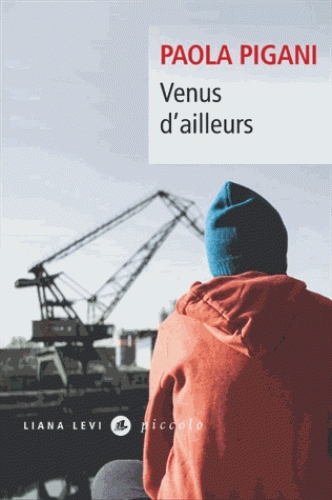En regardant par la fenêtre au moment d'entamer la rédaction de ce billet, j'ai du mal à croire que nous sommes au printemps. Il fait un vrai temps de Toussaint, en cette veille de premier mai ! Alors, autant jouer le décalage à fond et partir en plein hiver, et pas n'importe lequel, celui de l'Illinois, traditionnellement rude. Il ne s'agit pas seulement d'un décor, c'est un élément important de l'intrigue du thriller dont nous allons parler. Et surtout, un contraste saisissant avec le précédent livre de l'auteur, qui se déroulait dans la chaleur kényane. "Quand la neige danse" (qui vient de sortir en poche chez Folio) est le deuxième thriller de Sonja Delzongle, le deuxième mettant en scène son personnage d'Hanah Baxter, profileuse aux méthodes peu orthodoxes et au passé douloureux. De la poussière de "Dust" à la neige, le changement d'univers est radical, mais reste le côté très sombre et très dur que cette romancière développe et entretient et continue d'entretenir (son troisième livre sort chez Denoël). Viendrez-vous jouer à la poupée avec nous ?
Crystal Lake est une petite ville proche de Chicago. Un endroit paisible, à l'écart de l'une des métropoles les plus violentes des Etats-Unis. Une cité endormie sous l'épaisse neige et le froid glacial de ce rude hiver qui, comme chaque année, paralyse tout. Et pourtant, en ce début d'année, la torpeur habituelle est bouleversée par une série de disparitions.
Des enfants, des petites filles, n'ont plus donné signe de vie depuis plusieurs semaines. Toutes se sont évaporées pendant le mois de janvier sans qu'on sache ce qui s'est passé. Les parents sont dans l'attente et dans l'angoisse, à l'image de Joe Lasko, père de Lieserl, la première des fillettes de Crystal Lake à avoir disparu.
Lui qui élève seul sa fille depuis son divorce se démène pour comprendre. Il ne baisse pas les bras, malgré le peu d'indices et le temps qui passe. Impossible pour lui d'accepter l'idée que sa fille ait pu être tuée par son ravisseur, à condition que Lieserl ait bien été kidnappée... Son énergie entraîne dans son sillage les autres parents affligés par la perte de leur enfant, malgré la douleur.
Et puis, un mois environ après la disparition de Lieserl, Joe reçoit un étrange paquet. A l'intérieur, une poupée. Mais pas n'importe quelle poupée, non, une poupée qui a été clairement fabriquée à son attention, car elle ressemble à Lieserl. Pire encore, elle est vêtue exactement comme sa fille le jour de sa disparition !
Même livraison chez les autres parents concernés, à chacun sa poupée représentant sa fillette disparue... De quoi faire renaître l'espoir autant que l'inquiétude : comment interpréter ce nouvel élément ? Le lien avec les enlèvements paraît évident, trop gros pour n'être qu'une coïncidence, mais de qui cela émane-t-il ?
C'est à ce moment que deux personnes sorties du passé de Joe Lasko vont réapparaître. D'abord, son frère, le vilain petit canard de la famille, qui n'était plus revenu à Crystal Lake depuis des années. Curieux timing, non ? L'autre revenante, c'est Eva Sportis... A l'adolescence, Joe était tombé amoureux d'elle, mais c'est avec son frère qu'elle était sortie...
Depuis, chacun a fait son chemin, Joe Lasko est médecin et Eva, détective privé. Alors que la police de Crystal Lake peine à retrouver la trace des enfants disparus, Joe se décide à faire appel aux services d'Eva. Celle-ci, devant l'ampleur de la tâche, contacte discrètement son mentor, la femme qui l'a initiée à la criminologie : la profileuse Hanah Baxter.
Avec ses méthodes spéciales, et en particulier son fameux pendule dont elle ne se sépare jamais et qui lui permet de mettre en évidence des éléments souvent décisifs, Hanah Baxter pourrait faire sortir tout le monde de l'impasse. Mais cela doit se passer presque clandestinement, pour ne pas froisser la police locale.
C'est alors que tout va s'emballer...
Pour les lecteurs qui apprécient qu'une série les balade et lui propose d'un volume à l'autre des situations et des intrigues différentes, les thrillers de Sonja Delzongle sont un must, ou pas loin. Après la chaleur insoutenable et la poussière du Kenya, le sang et un danger omniprésent, le malaise ressenti par les personnages, dans "Quand la neige danse", c'est quasiment tout le contraire.
Le froid, la neige, et pas quelques flocons, non, on parle d'un tapis bien épais, qui nécessite des raquettes pour se déplacer, pas de corps, pas de certitude sur leur situation exacte, l'enquête démarre de rien, ou de très peu... L'angoisse est bien là, mais différente parce qu'elle ne se concentre pas sur Hanah Baxter, elle se répartit entre les personnages impliqués.
On a bien un thriller en main : du rythme, des fils narratifs qui s'entremêlent, des rebondissements, des soupçons, des fausses pistes, du danger, du sang, aussi, c'est qu'on le veuille ou non la règle de ce genre de romans, mais aussi pas mal de ressorts psychologiques mis en branle au fil des événements relatés, de la progression de l'enquête et de la mise en place de l'intrigue centrale.
D'ailleurs, il est intéressant de voir que "Quand la neige danse" ne repose pas entièrement sur les épaules d'Hanah Baxter, censée être le personnage principal de la série mais finalement, presque en retrait. Joe Lasko est le véritable moteur du roman, Hanah, elle, travaille dans l'ombre un bon moment, avant de vraiment prendre les choses en main dans la dernière partie.
On retrouve ce que pouvait faire Maurice Leblanc ou Agatha Christie, dans certaines de leurs enquêtes où le personnage attendu se met en retrait, parfois s'efface carrément. C'est le cas, plus récemment, aussi, dans la série de Sire Cédric, autour d'Alexandre Vauvert, où le flic se fait parfois voler la vedette (comme dans "le Jeu de l'ombre" ou "De fièvre et de sang").
Encore une fois, cela ne veut pas dire qu'Hanah joue les utilités, mais, et c'est peut-être mieux pour elle, la pression n'est pas uniquement sur elle, l'attention non plus, ce qui la libère de certaines de ses angoisses. D'autant que cette affaire de disparition d'enfants, ce père qui se démène pour retrouver sa fille adorée, tout cela la renvoie à son propre passé et à son père (c'est le sujet de "Récidive", qui vient de sortir).
On retrouve donc ce personnage qui affiche à la fois une assurance quand elle se concentre sur son enquête, mais aussi une réelle fragilité dès qu'on entre dans les questions plus personnelles. A elle de gérer cette dichotomie pour laisser parler son incroyable intuition et ses qualités d'enquêtrice. Et comprendre ce qui se passe à Crystal Lake...
Vous le savez, si vous suivez régulièrement ce blog, je suis sensible aux atmosphères et aux couleurs. "Dust" était étouffant et rutilant, le rouge était partout. "Que la neige danse" est noir et blanc, le noir de la nuit qui dure longtemps en cette saison et le blanc de la neige, omniprésente. Par ailleurs, on a la sensation que cet hiver pèse comme une chape et donne presque une sensation de huis clos.
La neige... Elle est un personnage du livre, comme la poussière l'était dans "Dust". Sonja Delzongle excelle dans cette mise en scène des éléments pour venir créer des atmosphères qui nourrissent ses thrillers, un peu comme on arrose une volaille en train de rôtir pour garder son côté moelleux. Euh, oui, ma comparaison est étrange, mais c'est vraiment ça : rien ne peut se faire en dehors de ce contexte précis qui est imposé et est inséparable de l'intrigue.
Et puis, il y a les relations entre les personnages. Parfois, dans les purs thrillers où l'action écrase un peu tout le reste, la psychologie et les liens entre les personnages sont le parents pauvres. On attend juste de savoir quand le héros et l'héroïne vont tomber dans les bras l'un de l'autre pour une scène torride et basta...
J'aime chez Sonja Delzongle son travail sur les personnages : elle examine les relations familiales avec une acuité qu'il convient de signaler : parents et enfants, relations fraternelles, relations de couples, également... Et "Quand la neige danse", croyez-moi, ce n'est pas le pays des Bisounours, ça dysfonctionne gentiment d'un peu partout.
De cette ambiance si spéciale à ces questions familiales tous azimuts, j'en suis arrivé à deux idées... La première, c'est "Psychose", d'ailleurs, il y a un indice qui ne trompe pas (et s'il m'a trompé, alors, l'inconscient de Sonja Delzongle aura parlé). A vous de le trouver, je ne le dis pas ici pour ne pas trop en dire, mais le lien est assez évident.
L'autre référence qui m'est venue est également cinématographique, sans doute moins connue. Je ne vais d'ailleurs là non plus pas entrer dans les détails, juste l'évoquer pour ne pas risquer de dévoiler trop d'éléments et, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore lu "Quand la neige danse", il serait peut-être mieux de ne pas trop approfondir.
Cette référence, c'est "Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?", film de Robert Aldrich qui mettait en scène deux stars de l'âge d'or hollywoodien : Bette Davis et Joan Crawford. Deux stars qui, en 1962, année de sortie du film, ont vieilli et ont leur carrière derrière elles. Dans ce film, elles brisent leur image et offrent au spectateur un affrontement terrible, entre rancune et jalousie.
Pour qui a vu ce film ou en connaît le synopsis, certains éléments devraient vous renvoyer aisément à l'intrigue de "Quand la neige danse", sans qu'il s'agisse d'un copier-coller, évidemment. Ces deux films brillent par leur ambiance pesante et dérangeante, c'est aussi le cas du roman de Sonja Delzongle, qui devrait aussi vous surprendre en sortant de certains sentiers trop souvent battus.
Voilà une romancière qui ne nous épargne pas, qui nous malmène. Pas en utilisant des effets grandiloquents, de la pyrotechnie et une violence débridée. Ici, la violence est d'abord psychologique, même si ce serait réducteur de la limiter à cela. En revanche, le lecteur est régulièrement renvoyé à des situations personnelles qui, pour les besoins de l'intrigue, sont dévoyées.
C'est douloureux, viscéral, ça touche à l'intime et les révélations finales, jusqu'à cette scène de clôture glaçante (et c'est pas peu dire, vu le climat !), devrait vous remuer sérieusement. Avec une transition toute trouvée pour ce qui va venir et la prochaine intrigue mettant en scène Hanah Baxter, qui, si j'en crois la quatrième de couverture de "Récidive", devra affronter ses propres démons familiaux.
Son propre démon, son père...
"Il va falloir un jour qu'enfin je me décide à lire les livres que, depuis trente ans, je conseille à mes amis de lire". (Sacha Guitry)
dimanche 30 avril 2017
"Jamais l'eau ne manque l'ancien chemin de son cours" (Ahmadou Kourouma).
Le titre de notre roman du jour pourrait être le nom d'un méchant dans un film de super-héros ou dans un James Bond. Mais pas du tout. On peut pourtant considérer cet élément comme un personnage central de ce livre, bien plus qu'un simple décor. Et surtout, c'est sur lui que repose le sujet original de ce polar : la géologie. Ouh là, j'en vois qui grimacent, dans l'assemblée ! Mais, ne partez pas, je vous assure que c'est justement ce qui fait l'originalité de ce roman policier, assez classique dans la forme mais passionnant (et assez effrayant, aussi) dans le fond. "Karst" (en grand format aux éditions Liana Levi) est le premier roman de David Humbert, journaliste scientifique spécialisé dans les questions environnementales et c'est une belle découverte, prenante, dépaysante (vous verrez pourquoi) et surtout terriblement d'actualité à plus d'un titre. Le genre de lecture qui vous rappelle utilement pourquoi l'eau qui sort de votre robinet sent parfois un peu, beaucoup le chlore...
Paul Kubler était une des étoiles montantes du 36, quai des Orfèvres, un des prochains cadors de la police judiciaire. Et puis, suite à un incident (que je ne vous expliquerai pas ici, c'est une des interrogations du roman), sa carrière a été brisée nette. Retour dans sa région natale, la Normandie, le voilà muté à un poste dans un commissariat de Rouen, au bas de l'échelle.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accueil de ses nouveaux collègues est frisquet... Paul ressent la méfiance et même un peu plus de la part de ses supérieurs comme de ses subordonnées. Personne ne lui fait confiance et on lui confie des tâches indignes de ce qu'il est. Mais, c'est le jeu, il en a conscience, il l'accepte et prend son mal en patience, réduit à surveiller les manifestations.
Des manifs, il y en a pas mal, en ce moment. Une des grosses entreprises de la ville menace de licencier et les syndicats sont sur les dents. La tension est forte, les risques de débordements aussi. Mais, avec la BAC aussi, l'indépendance de Paul ne passe pas toujours très bien et le jeune lieutenant a un peu trop tendance à se réfugier dans l'alcool pour oublier cette mauvaise passe...
Jusqu'au jour où il se voit confier une affaire qui, à première vue, n'a rien d'excitant. Peut-être pire encore que faire le service d'ordre devant la préfecture. Tout commence un matin, à l'approche du pont de l'Ascension. Dans toute l'agglomération rouennaise, l'eau qui sort des robinets est.. rose. Un rose rappelant le slime, sans la consistance (sinon, décroche le téléphone et appelle SOS Fantôme...).
S'agit-il d'une plaisanterie de mauvais goût, d'un coup d'éclat d'une association qui a voulu défier les autorités en plein plan Vigipirate ou d'un avertissement aux allures de menace ? Les sources qui alimentent la ville et ses environs ont forcément été polluées par un produit heureusement inoffensif, mais jusqu'à quand ?
A Paul de s'occuper de ça, le genre cadeau empoisonné, c'est le cas de le dire. D'abord parce qu'il va devoir faire avec toutes les administrations concernées, à la fois peu enclines à reconnaître leurs torts et incapables de lui fournir des éléments clairs, les élus et leurs intérêts locaux, les scientifiques et leurs savoirs parfois abscons, dans un domaine auquel il ne connaît rien : la géologie...
Mais voilà, le lieutenant Paul Kubler mérite bien mieux que le mépris de sa hiérarchie. C'est un excellent flic, intègre et consciencieux. Et si, au départ, cette affaire ne paraît pas très importante, il va lui consacrer toute son énergie. Surtout quand, quelques jours après la première coloration, l'eau va prendre une couleur vert absinthe aussi peu rassurante que le rose...
Et, avec son flair de flic déjà aguerri malgré son jeune âge, Paul va se lancer dans une enquête délicate, complexe et dangereuse où c'est bientôt le sang qui va couler. Un sang rouge, tout ce qu'il y a de plus normal, cette fois, un fluide vital qui, lui, n'est pas fait pour se répandre... Il y a urgence, et bien peu de monde à qui faire confiance...
Le karst, c'est un phénomène géomorphologique. Sans doute vais-je être réducteur pour être clair, mais tant pis : c'est le décor que sculpte l'eau par l'érosion qu'elle produit, en particulier dans les région où le calcaire est présent. Dans la région de Rouen, c'est le cas. Et l'eau, dont l'écoulement est tout à fait imprévisible, crée alors des parcours tourmentés, sinueux, mais qu'elle suit ensuite inexorablement.
Bétoire, cavités diverses, grottes, le karst, c'est un incroyable circuit éternellement recommencé à chaque pluie pour alimenter les nappes phréatiques auprès desquelles nous nous alimentons en eau. Et c'est cela que Paul Kubler va devoir comprendre pour espérer découvrir ceux qui ont coloré l'eau et, surtout, dans quel but ils ont agi ainsi.
Si "Karst" est un polar à la française assez classique dans sa construction, il faut saluer le travail de vulgarisation de David Humbert qui s'adresse à des béotiens dans mon genre et parvient à expliquer ce cycle de l'eau de manière très claire et, surtout, sans alourdir son récit ni nuire au rythme de son intrigue. Voilà en quoi, pour moi, le karst est un des personnages du livre.
Il n'est pas le seul, évidemment, et on va évoquer Paul Kubler un peu plus en détails. Si l'on comprend d'emblée qu'on a affaire à un excellent flic, pèse longtemps sur lui un doute, lié aux raisons qui lui ont valu d'être aussi brutalement rétrogradé. L'accueil des policiers rouennais, plus que froid, intrigue également : qu'a-t-il donc bien pu faire ?
C'est un jeune homme, la petite trentaine, un poil trop porté sur la bouteille quand les journées ne tournent pas tout à fait rond, roulant plus volontiers au guidon d'une moto japonaise qui a son âge que d'une voiture banalisée. Indépendant, un peu trop, prenant des initiatives, un peu trop, parlant franchement, un peu trop, bref, un adepte du cavalier seul.
Pourtant, dans cette enquête, il va devoir trouver des appuis. D'abord pour acquérir des rudiments de géologie et comprendre le karst et l'eau, parce que, sans cela, impossible de deviner les intentions de ceux qui ont coloré l'eau. Ces appuis s'appelleront Flavio Puppo ou Melody Dornier. Mais, le hic, c'est qu'ils ont tout autant un profil de coupable que les autres intervenants...
Il doit apprendre, et vite, mais peut-il savoir si on lui ment, si on cherche à lui mettre des bâtons dans les roues ? Petit à petit, son enquête va révéler diverses pistes qui, parfois, se recoupent, mais peuvent aussi s'opposer : les intérêts en jeu, les mobiles éventuels, les personnalités impliquées directement ou non, tout cela crée une autre sorte de karst dans lequel doit évoluer Paul Kubler.
A lui d'explorer toutes ces voix, toutes ces galeries qu'il met au jour, à lui de confronter les différents acteurs à des hypothèses souvent bien fragiles. Oui, il va lui falloir cartographier avec la plus grande des précisions ce réseau complexe de pistes à suivre, saisir la personnalité des uns et des autres et les liens qui les unissent ou créent des antagonismes.
Pour cela, il va pouvoir compter sur un renfort important : un vieux flic sur le retour, mis au rancart en attendant la retraite. Rossi, c'est un peu le Kubler de la génération précédente, un vieux cheval en fin de course, oublié dans son coin, blasé et solitaire. Un miroir qui renverrait à Kubler ce qu'il deviendra s'il n'y prend pas garde.
Mais, leurs points communs résident aussi dans leurs compétences et leur capacité de travail, définitivement sous-employées dans ce commissariat de quartier. Leur duo, sur le modèle senior/junior, comme on dirait dans la police américaine, va fonctionner à plein, en marge d'une hiérarchie à qui ils rendent bien son mépris.
Pour le reste, pour les autres personnages et pour les trames secondaires, il va vous falloir lire ce roman. Une vraie découverte, très agréable à lire, avec des personnages qu'on a envie de revoir, Kubler en tête. Ce n'est d'ailleurs pas une évidence, mais la porte n'est pas non plus fermée. Et, vu les premiers échos aperçus sur la toile, pourquoi ne pas envisager tranquillement de nouvelles enquêtes ?
Et puis, il y a Rouen et son agglomération. J'ai évoqué le sous-sol à travers ce terme de karst qui, redisons-le, ne doit pas vous effrayer. Mais, ce décor a lui aussi du potentiel. David Humbert a beau être franc-comtois de naissance, voilà des années qu'il travaille et milite pour l'environnement dans la capitale normande. Et on le sent bien : il fait un excellent guide.
Les plus attentifs parmi vous auront noté que, dans mon introduction, j'ai parlé de dépaysement. Puis, je vous emmène à Rouen... Que les Normands et les Rouennais qui pourraient passer par-là ne se vexent pas, il est vrai que ce n'est pas forcément la première ville qui vient à l'idée lorsqu'on prononce ce mot de dépaysement...
Alors, bien sûr, on croise la cathédrale et les autres monuments de cette ville à la riche histoire, l'ombre de Jeanne d'Arc, évidemment, la Seine, sa colonne vertébrale, mais aussi les symboles d'une modernisation qui parfois, passe mal (comme le fameux et impressionnant pont levant Gustave-Flaubert, mais pas seulement)...
David Humbert nous fait aussi sortir de la cité pour prendre de la hauteur, à Bonsecours, ou plonger dans la Manche, au pied de falaises moins connues que celles d'Etretat, et pourtant remarquables. Enfin, il nous emmène à la découverte des très nombreuses sources que comptent les campagnes environnantes et qui sont le point névralgique de ce roman.
Le dépaysement, le voilà, lorsque, pour appréhender ce qu'est le karst, Paul Kubler va se rendre dans les magnifiques et impressionnantes carrières de Caumont. Encore une fois l'analogie entre le karst et les pistes que suit un enquêteur : il faut les suivre, et parfois, dans des conditions qui n'ont rien d'ordinaire et où l'on ne maîtrise plus grand-chose...
Que dire ? On vient de me dire récemment que mes billets de blog devraient plus souvent comporter des images... Et bien, l'occasion est belle d'en mettre une, avec, par exemple, cette incroyable rivière des Robots, à laquelle on accède via les carrières de Caumont. Une photo, oui, une seule, mais bien plus sur ce lien, qui vous fait visiter ces lieux fabuleux et inattendus :
Si l'homme a imprimé sa marque dans la roche, l'eau a laissé des traces bien plus impressionnantes encore et d'une beauté à couper le souffle. Rien que pour cela, il faut remercier David Humbert qui nous permet de découvrir (eh oui, je suis déjà passé par Rouen, mais pas assez longtemps pour aler crapahuter à Caumont) de tels sites.
On parle souvent de la lecture et de sa puissance, mais face à de tels décors, rien ne vaut la photographie. Difficile de se représenter ces endroits extraordinaires sans quitter les pages et les morts pour voir. Et, pour cela, pour se rendre dans n'importe quel lieu magique de cette planète sans bouger de son canapé, juste en reposant quelques instants son livre, il y a internet, outil aussi haïssable, parfois, qu'utile...
Allez, je sors ma casquette de relou, deux secondes... Bien sûr on peut s'immerger dans la lecture, devenir hermétique au monde jusqu'à la dernière page. Mais, avouez qu'avoir le réflexe internet quand c'est nécessaire (musique, oeuvre d'art, bâtiment, paysage...), c'est aussi l'occasion de faire des découvertes mémorable, comme celle-ci. Je referme la parenthèse moralisatrice, promis.
Et je vous conseille la lecture de "Karst", premier roman qui, espérons-le, en appellera d'autres. Je serai curieux, d'ailleurs, de savoir si David Humbert saura conserver sa facette scientifique et ses connaissances en matière environnementales ou s'il choisira d'aller vers tout autre chose, à Rouen, en Normandie, ou ailleurs.
En attendant, "Karst" a le profil idéal d'une agréable lecture estivale, lorsqu'on marque une pause dans sa vie, son quotidien. Ici, on s'évade tout en gardant à l'esprit des problématiques très fortes et très contemporaines. Des inquiétudes qui sont les nôtres chaque jour, en ces temps bien souvent difficiles.
Les thèmes qu'aborde ce polar au travers des questions géologiques évoquées dans ce billet nous ramène aux questionnements du moment, entre respect de l'environnement, destruction de cette nature sans laquelle nous ne pourrions vivre, relations dangereuses entre pouvoir et argent, et même le terrorisme. Oui, "Karst" est une riche lecture en même temps qu'un bon divertissement.
Paul Kubler était une des étoiles montantes du 36, quai des Orfèvres, un des prochains cadors de la police judiciaire. Et puis, suite à un incident (que je ne vous expliquerai pas ici, c'est une des interrogations du roman), sa carrière a été brisée nette. Retour dans sa région natale, la Normandie, le voilà muté à un poste dans un commissariat de Rouen, au bas de l'échelle.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accueil de ses nouveaux collègues est frisquet... Paul ressent la méfiance et même un peu plus de la part de ses supérieurs comme de ses subordonnées. Personne ne lui fait confiance et on lui confie des tâches indignes de ce qu'il est. Mais, c'est le jeu, il en a conscience, il l'accepte et prend son mal en patience, réduit à surveiller les manifestations.
Des manifs, il y en a pas mal, en ce moment. Une des grosses entreprises de la ville menace de licencier et les syndicats sont sur les dents. La tension est forte, les risques de débordements aussi. Mais, avec la BAC aussi, l'indépendance de Paul ne passe pas toujours très bien et le jeune lieutenant a un peu trop tendance à se réfugier dans l'alcool pour oublier cette mauvaise passe...
Jusqu'au jour où il se voit confier une affaire qui, à première vue, n'a rien d'excitant. Peut-être pire encore que faire le service d'ordre devant la préfecture. Tout commence un matin, à l'approche du pont de l'Ascension. Dans toute l'agglomération rouennaise, l'eau qui sort des robinets est.. rose. Un rose rappelant le slime, sans la consistance (sinon, décroche le téléphone et appelle SOS Fantôme...).
S'agit-il d'une plaisanterie de mauvais goût, d'un coup d'éclat d'une association qui a voulu défier les autorités en plein plan Vigipirate ou d'un avertissement aux allures de menace ? Les sources qui alimentent la ville et ses environs ont forcément été polluées par un produit heureusement inoffensif, mais jusqu'à quand ?
A Paul de s'occuper de ça, le genre cadeau empoisonné, c'est le cas de le dire. D'abord parce qu'il va devoir faire avec toutes les administrations concernées, à la fois peu enclines à reconnaître leurs torts et incapables de lui fournir des éléments clairs, les élus et leurs intérêts locaux, les scientifiques et leurs savoirs parfois abscons, dans un domaine auquel il ne connaît rien : la géologie...
Mais voilà, le lieutenant Paul Kubler mérite bien mieux que le mépris de sa hiérarchie. C'est un excellent flic, intègre et consciencieux. Et si, au départ, cette affaire ne paraît pas très importante, il va lui consacrer toute son énergie. Surtout quand, quelques jours après la première coloration, l'eau va prendre une couleur vert absinthe aussi peu rassurante que le rose...
Et, avec son flair de flic déjà aguerri malgré son jeune âge, Paul va se lancer dans une enquête délicate, complexe et dangereuse où c'est bientôt le sang qui va couler. Un sang rouge, tout ce qu'il y a de plus normal, cette fois, un fluide vital qui, lui, n'est pas fait pour se répandre... Il y a urgence, et bien peu de monde à qui faire confiance...
Le karst, c'est un phénomène géomorphologique. Sans doute vais-je être réducteur pour être clair, mais tant pis : c'est le décor que sculpte l'eau par l'érosion qu'elle produit, en particulier dans les région où le calcaire est présent. Dans la région de Rouen, c'est le cas. Et l'eau, dont l'écoulement est tout à fait imprévisible, crée alors des parcours tourmentés, sinueux, mais qu'elle suit ensuite inexorablement.
Bétoire, cavités diverses, grottes, le karst, c'est un incroyable circuit éternellement recommencé à chaque pluie pour alimenter les nappes phréatiques auprès desquelles nous nous alimentons en eau. Et c'est cela que Paul Kubler va devoir comprendre pour espérer découvrir ceux qui ont coloré l'eau et, surtout, dans quel but ils ont agi ainsi.
Si "Karst" est un polar à la française assez classique dans sa construction, il faut saluer le travail de vulgarisation de David Humbert qui s'adresse à des béotiens dans mon genre et parvient à expliquer ce cycle de l'eau de manière très claire et, surtout, sans alourdir son récit ni nuire au rythme de son intrigue. Voilà en quoi, pour moi, le karst est un des personnages du livre.
Il n'est pas le seul, évidemment, et on va évoquer Paul Kubler un peu plus en détails. Si l'on comprend d'emblée qu'on a affaire à un excellent flic, pèse longtemps sur lui un doute, lié aux raisons qui lui ont valu d'être aussi brutalement rétrogradé. L'accueil des policiers rouennais, plus que froid, intrigue également : qu'a-t-il donc bien pu faire ?
C'est un jeune homme, la petite trentaine, un poil trop porté sur la bouteille quand les journées ne tournent pas tout à fait rond, roulant plus volontiers au guidon d'une moto japonaise qui a son âge que d'une voiture banalisée. Indépendant, un peu trop, prenant des initiatives, un peu trop, parlant franchement, un peu trop, bref, un adepte du cavalier seul.
Pourtant, dans cette enquête, il va devoir trouver des appuis. D'abord pour acquérir des rudiments de géologie et comprendre le karst et l'eau, parce que, sans cela, impossible de deviner les intentions de ceux qui ont coloré l'eau. Ces appuis s'appelleront Flavio Puppo ou Melody Dornier. Mais, le hic, c'est qu'ils ont tout autant un profil de coupable que les autres intervenants...
Il doit apprendre, et vite, mais peut-il savoir si on lui ment, si on cherche à lui mettre des bâtons dans les roues ? Petit à petit, son enquête va révéler diverses pistes qui, parfois, se recoupent, mais peuvent aussi s'opposer : les intérêts en jeu, les mobiles éventuels, les personnalités impliquées directement ou non, tout cela crée une autre sorte de karst dans lequel doit évoluer Paul Kubler.
A lui d'explorer toutes ces voix, toutes ces galeries qu'il met au jour, à lui de confronter les différents acteurs à des hypothèses souvent bien fragiles. Oui, il va lui falloir cartographier avec la plus grande des précisions ce réseau complexe de pistes à suivre, saisir la personnalité des uns et des autres et les liens qui les unissent ou créent des antagonismes.
Pour cela, il va pouvoir compter sur un renfort important : un vieux flic sur le retour, mis au rancart en attendant la retraite. Rossi, c'est un peu le Kubler de la génération précédente, un vieux cheval en fin de course, oublié dans son coin, blasé et solitaire. Un miroir qui renverrait à Kubler ce qu'il deviendra s'il n'y prend pas garde.
Mais, leurs points communs résident aussi dans leurs compétences et leur capacité de travail, définitivement sous-employées dans ce commissariat de quartier. Leur duo, sur le modèle senior/junior, comme on dirait dans la police américaine, va fonctionner à plein, en marge d'une hiérarchie à qui ils rendent bien son mépris.
Pour le reste, pour les autres personnages et pour les trames secondaires, il va vous falloir lire ce roman. Une vraie découverte, très agréable à lire, avec des personnages qu'on a envie de revoir, Kubler en tête. Ce n'est d'ailleurs pas une évidence, mais la porte n'est pas non plus fermée. Et, vu les premiers échos aperçus sur la toile, pourquoi ne pas envisager tranquillement de nouvelles enquêtes ?
Et puis, il y a Rouen et son agglomération. J'ai évoqué le sous-sol à travers ce terme de karst qui, redisons-le, ne doit pas vous effrayer. Mais, ce décor a lui aussi du potentiel. David Humbert a beau être franc-comtois de naissance, voilà des années qu'il travaille et milite pour l'environnement dans la capitale normande. Et on le sent bien : il fait un excellent guide.
Les plus attentifs parmi vous auront noté que, dans mon introduction, j'ai parlé de dépaysement. Puis, je vous emmène à Rouen... Que les Normands et les Rouennais qui pourraient passer par-là ne se vexent pas, il est vrai que ce n'est pas forcément la première ville qui vient à l'idée lorsqu'on prononce ce mot de dépaysement...
Alors, bien sûr, on croise la cathédrale et les autres monuments de cette ville à la riche histoire, l'ombre de Jeanne d'Arc, évidemment, la Seine, sa colonne vertébrale, mais aussi les symboles d'une modernisation qui parfois, passe mal (comme le fameux et impressionnant pont levant Gustave-Flaubert, mais pas seulement)...
David Humbert nous fait aussi sortir de la cité pour prendre de la hauteur, à Bonsecours, ou plonger dans la Manche, au pied de falaises moins connues que celles d'Etretat, et pourtant remarquables. Enfin, il nous emmène à la découverte des très nombreuses sources que comptent les campagnes environnantes et qui sont le point névralgique de ce roman.
Le dépaysement, le voilà, lorsque, pour appréhender ce qu'est le karst, Paul Kubler va se rendre dans les magnifiques et impressionnantes carrières de Caumont. Encore une fois l'analogie entre le karst et les pistes que suit un enquêteur : il faut les suivre, et parfois, dans des conditions qui n'ont rien d'ordinaire et où l'on ne maîtrise plus grand-chose...
Que dire ? On vient de me dire récemment que mes billets de blog devraient plus souvent comporter des images... Et bien, l'occasion est belle d'en mettre une, avec, par exemple, cette incroyable rivière des Robots, à laquelle on accède via les carrières de Caumont. Une photo, oui, une seule, mais bien plus sur ce lien, qui vous fait visiter ces lieux fabuleux et inattendus :
Si l'homme a imprimé sa marque dans la roche, l'eau a laissé des traces bien plus impressionnantes encore et d'une beauté à couper le souffle. Rien que pour cela, il faut remercier David Humbert qui nous permet de découvrir (eh oui, je suis déjà passé par Rouen, mais pas assez longtemps pour aler crapahuter à Caumont) de tels sites.
On parle souvent de la lecture et de sa puissance, mais face à de tels décors, rien ne vaut la photographie. Difficile de se représenter ces endroits extraordinaires sans quitter les pages et les morts pour voir. Et, pour cela, pour se rendre dans n'importe quel lieu magique de cette planète sans bouger de son canapé, juste en reposant quelques instants son livre, il y a internet, outil aussi haïssable, parfois, qu'utile...
Allez, je sors ma casquette de relou, deux secondes... Bien sûr on peut s'immerger dans la lecture, devenir hermétique au monde jusqu'à la dernière page. Mais, avouez qu'avoir le réflexe internet quand c'est nécessaire (musique, oeuvre d'art, bâtiment, paysage...), c'est aussi l'occasion de faire des découvertes mémorable, comme celle-ci. Je referme la parenthèse moralisatrice, promis.
Et je vous conseille la lecture de "Karst", premier roman qui, espérons-le, en appellera d'autres. Je serai curieux, d'ailleurs, de savoir si David Humbert saura conserver sa facette scientifique et ses connaissances en matière environnementales ou s'il choisira d'aller vers tout autre chose, à Rouen, en Normandie, ou ailleurs.
En attendant, "Karst" a le profil idéal d'une agréable lecture estivale, lorsqu'on marque une pause dans sa vie, son quotidien. Ici, on s'évade tout en gardant à l'esprit des problématiques très fortes et très contemporaines. Des inquiétudes qui sont les nôtres chaque jour, en ces temps bien souvent difficiles.
Les thèmes qu'aborde ce polar au travers des questions géologiques évoquées dans ce billet nous ramène aux questionnements du moment, entre respect de l'environnement, destruction de cette nature sans laquelle nous ne pourrions vivre, relations dangereuses entre pouvoir et argent, et même le terrorisme. Oui, "Karst" est une riche lecture en même temps qu'un bon divertissement.
vendredi 28 avril 2017
"Pour leurrer le monde, ressemble au monde ; ressemble à l'innocente fleur, mais sois le serpent qu'elle cache" (Shakespeare).
Lorsqu'on a aimé un premier roman, on attend le second avec impatience et un peu d'inquiétude aussi, forcément : retrouvera-t-on les qualités appréciées dans le premier livre, aura-t-on une histoire capable de nous tenir autant en haleine ? Après la très bonne surprise que fut la découverte de "Criminal Loft" (déjà chez Fleur Sauvage et désormais disponible en poche chez Milady), j'étais très curieux de voir ce que Armelle Carbonel nous réservait pour son deuxième thriller. Paru au mois de janvier aux éditions Fleur Sauvage (dont nous reparlerons en fin de billet), "Majestic Murder" nous emmène une nouvelle fois dans un endroit qu'on n'aurait pas franchement envie de visiter si nous nous trouvions sur le pas de sa porte, et nous offre une intrigue assez complexe mais très intéressante. Avec un hommage au théâtre, celui de Shakespeare, en particulier, mais, en général, à cette gigantesque pièce qu'est la vie. Et d'autres éléments marquants que nous survolerons pour ne pas trop en dire sur cette histoire troublante...
Fanny et Lillian vivent dans un squat miteux quelque part aux Etats-Unis. Enfin vivent... "Survivent" serait plus juste. Leur quotidien se résume à chercher de quoi se payer une prochaine dose, à éviter les embrouilles et les mauvais coups, à dormir dans les conditions les moins désagréables possible. Et, dans cet entrepôt sordide, même en se serrant les coudes, c'est pas un palace...
Malgré les précautions prises par les deux jeunes femmes, Lillian est pourtant victime d'une tentative de viol collectif dans ce même hangar qui n'a décidément rien d'un refuge... Il faut l'intervention d'un inconnu pour empêcher le pire in extremis. Il se présente sous l'identité de Monsieur Seamus et, rapidement, il se rapproche de Lillian.
Bientôt, ils quittent le squat, laissant derrière eux Fanny, pour se rendre dans un autre lieu. En rencontrant Monsieur Seamus, Lillian s'est rappelée qu'elle a toujours voulu devenir actrice et son sauveur lui a proposé un plan qui semble sérieux et prometteur. L'occasion de monter sur les planches et de faire ses preuves, à condition de réussir une audition.
Direction East Saint-Louis, dans l'Illinois, un quartier en déshérence complète, une espèce de désert urbain au milieu duquel se dresse un imposant bâtiment : le Majestic Theatre. Est-ce quartier abandonné ou l'architecture du lieu ? Sans doute l'ensemble des deux, mais ce théâtre désaffecté est d'un macabre qui fait froid dans le dos...
C'est pourtant là qu'une troupe s'est installée et prépare une représentation d'une pièce intitulée "Au commencement était la mort". Une troupe certes accueillante, mais qui possède son mystère, ses zones d'ombre et se compose de personnages plus ou moins patibulaires, à l'image d'Allan, espèce de Monsieur Loyal à qui on donnerait difficilement le bon Dieu sans confession.
Lillian et Monsieur Seamus vont relever le défi (et accepter les cachets afférents), mais pas sans doute. Commence alors pour ces deux marginaux une préparation difficile : Lillian est toujours sous l'emprise de la drogue et Monsieur Seamus n'affiche pas de talent particulier pour la comédie. Quant à la pièce, elle ne manque pas elle aussi de susciter des questions...
Ce sont les trois coups marquant le début d'un bien étrange spectacle...
Disons-le tout net, j'avais adoré l'atmosphère très lourde et très noire de "Criminal Loft" et j'ai retrouvé ces ingrédients dans "Majestic Murder", mais dans un contexte et au service d'une histoire bien différente. Difficile, d'ailleurs, d'aller plus loin que le bref résumé ci-dessus, tant cette intrigue est emberlificotée, tant elle joue avec les apparences et nous enfume.
Commençons par le commencement, avec le véritable point commun entre les deux romans d'Armelle Carbonel : après Waverly Hills, le sinistre sanatorium devenu cadre d'une émission de télévision, c'est dans un théâtre, un véritable théâtre que la romancière nous emmène. Mais, un théâtre bien sinistre, forcément, sinon, c'est pas drôle...
Un théâtre à la riche histoire, construit en 1928 (la date n'est pas anodine) à East Saint-Louis, dans le sud de l'Etat de l'Illinois. Sur la fiche Wikipedia (version anglaise), on apprend que ce fut le premier théâtre de la ville à posséder un système d'air climatisé et le premier lieu dans la région où furent projetés des films parlants. Puis, il a fermé, dans les années 1960, avant de devenir ça :
Avouez que, si vous y arrivez en fin de journée, par temps gris, dans un quartier quasi désert désormais, il y a de quoi ressentir quelques picotements dans la nuque... Et une fois à l'intérieur, ce n'est guère mieux : on est dans une ruine qui conserve pourtant un certain cachet, mais c'est le genre d'endroit qui peut vite prendre des allures de coupe-gorge...
Forcément, ce lieu contribue à l'ambiance angoissante de l'histoire et aux inquiétudes initiales de Lillian et Monsieur Seamus, qui ne s'attendaient sans doute pas à passer une audition dans un tel décor... En revanche, les membres de la compagnie qui les accueillent, eux, s'y trouvent comme des poissons dans l'eau, c'est vous dire si on se sent... rassurés...
Ajoutez quelques détails curieux, vite repérés par les deux petits nouveaux, dont je ne parlerai pas ici, eh non, et vous comprendrez la valse-hésitation qui habite soudain nos deux personnages : le cachet confortable qui a de quoi les sortir de la mouise, ou du moins, améliorer l'ordinaire, contre le fait de rester dans cet endroit sinistre entourés de personnages qui semblent sortis d'un film de série Z...
D'ailleurs, on pourrait presque comparer Lillian et Monsieur Seamus, à leur arrivée au Majestic Theatre, avec le couple que forment Susan Sarandon et Barry Bostwick dans le "Rocky Horror Picture Show", sauf qu'ils n'arrivent pas devant les portes du théâtre par le plus grand des hasards. Pour le reste, oui, il y a de cela, car une fois les portes franchies, ils ne maîtrisent plus rien, et surtout pas leur destin.
Mais le théâtre n'est pas le seul élément réel ayant inspiré Armelle Carbonel pour l'écriture de ce roman. Le cadre, c'est ok, mais il nous faut aussi dire un mot d'un personnage, Peg Entwistle. Ce sera vraiment un mot et, conseil, ne cherchez pas tout de suite qui elle était, lisez d'abord le roman. Toujours est-il que ce destin est un des éléments principaux de ce thriller.
J'ai récemment évoqué James Ellroy, je pourrai recommencer, car il flotte sur "Majestic Murder" un petit air de "Dahlia noir". Certains qui auront lu le livre d'Armelle Carbonnel seront peut-être surpris de cette allusion, mais il y a malgré les différences quelques passerelles possibles, jusque dans la noirceur de ce récit et la manière dont un destin tragique se transmet, devient une légende...
Quant à cette histoire de théâtreux un poil glauque, elle pourrait se ranger aux côtés des récents romans de Patrick Senécal, et particulièrement "Faims", où c'est une troupe de cirque qui était le moteur d'une histoire très inquiétante. Dans "Majestic Murder", le spectacle est l'aboutissement programmé et non le point de départ, comme chez Senécal, mais on retrouve des interrogations proches.
Qui sont donc ces comédiens ayant investi un lieu abandonné pour monter une pièce sulfureuse écrite par un mystérieux Dramaturge (on n'entendra parler de lui que sous ce nom) à destination d'un public prétendument trié sur le volet ? On est vraiment dans un univers qui pourrait faire penser à un film d'horreur, un slasher où un mystérieux personnage pourrait commencer à zigouiller tous les membres de la troupe...
Ce roman est tout en clair-obscur, exactement comme au théâtre, quand les feux de la rampe brillent et illuminent juste la scène, laissant le reste de la salle dans le noir. De la scène aux coulisses, des sous-sols du théâtre aux appartements occupés par les comédiens, on s'attend sans cesse à ce que surgisse de l'ombre quelque créature macabre dont la simple vue nous glace les sangs...
On flirte avec une ambiance très proche du fantastique (c'était d'ailleurs déjà le cas dans "Criminal Loft"), renforcée par la mystérieuse présente aux alentours du Majestic Theatre d'un personnage troublant, car on ne sait absolument pas d'où il vient et ce qu'il fait véritablement là. Jusque dans son identité, il y a cette dimension presque irréelle : Noname.
Comme pour Peg Entwistle, je ne veux pas trop en dire sur ce personnage pour qui, j'ai cru comprendre, Armelle Carbonel a une réelle affection. Il n'empêche que sa présence, les réflexions qu'il nous fait partager, son côté enfant sauvage, tout cela laisse une bizarre impression, quelque chose du domaine du malaise... Mais qui est vraiment Noname ?
Vous aurez noté que ce billet s'évertue à parler de tout, sauf de l'intrigue... Eh oui, c'est une question qui se pose toujours lorsqu'on aborde un roman à intrigue, un polar, un thriller : où placer les limites ? Que doit-on aborder et qu'est-ce qui relève vraiment du spoiler ? Concernant "Majestic Murder", toutes ces questions se posent, et pas qu'un peu...
Armelle Carbonel joue avec nous, pauvres lecteurs, elle nous emmène dans des endroits sinistres où elle nous largue sans aucun repère, où elle nous surprend dans un premier temps avec quelques rebondissements bien sentis puis nous manipule allègrement et joue avec notre paranoïa. Car, bientôt, on se méfie de tout le monde...
Alors, qui mène vraiment la danse ? Pardon, qui est le véritable metteur en scène de la pièce qui se joue sous nos yeux (le roman est divisé en actes et en scènes, avec des entractes) ? Tour l'enjeu est là, dans cette danse macabre où les fils narratifs secondaires ne sont absolument pas à négliger. Au contraire, ils viennent brouiller un peu plus les cartes jusqu'au dénouement.
Un dernier mot sur Shakespeare, cité en ouverture de ce billet. Ce n'est pas un choix fait au hasard, le Barde de Stratford est un peu la figure tutélaire de "Majestic Murder", jusque sur la couverture, discret hommage à Hamlet et à son monologue. Et il y a effectivement quelques chose de Shakespearien, non pas dans le roman lui-même mais dans l'histoire centrale qui y est abordée.
Une tragédie moderne avec, comme moteur, la question plus que contemporaine de la célébrité et du succès, l'incapacité de renoncer à ses rêves quand ils s'avèrent inaccessibles... Et, si vous creusez un peu la question pendant ou après votre lecture, vous verrez à quel point le destin peut se montrer coquin et vicelard...
Allez, j'en termine là. J'attendais de voir ce que Armelle Carbonel nous offrirait dans ce deuxième roman, tellement attendu, presque redouté. Et le résultat est à la hauteur de l'attente, on retrouve ces indéniables qualités pour instaurer des ambiances angoissantes et pleines de noirceur, et une histoire qui tient bien la route, même si elle est très sinueuse. Nul doute que le troisième opus sera meilleur encore !
Et terminons en musique, avec la voix de Mildred Bailey qui rythme le roman et vient ajouter une touche très particulière, comme si, au Majestic Theatre, le temps s'était arrêté... Gramophone, jazz, cire qui grattouille et voix cristalline, pour une chanteuse morte jeune et sans avoir connu d'immense succès... Une musique qui apporte sa touche à l'ambiance du roman, comme ce morceau qui marque son... entrée en scène, disons :
Un dernier mot : "Majestic Murder" paraît aux éditions Fleur Sauvage, qui a déjà publié, entre autres, Fabio M. Mitchelli et Pierre Gaulon. Cette maison basée dans les Hauts-de-France traverse une période très difficile avec de gros soucis financiers. Vous pouvez les aider, évidemment en achetant les livres de leur catalogue (riche et intéressant), mais aussi une participation via Ulule. Pour en savoir plus : https://www.editionsfleursauvage.com/
Fanny et Lillian vivent dans un squat miteux quelque part aux Etats-Unis. Enfin vivent... "Survivent" serait plus juste. Leur quotidien se résume à chercher de quoi se payer une prochaine dose, à éviter les embrouilles et les mauvais coups, à dormir dans les conditions les moins désagréables possible. Et, dans cet entrepôt sordide, même en se serrant les coudes, c'est pas un palace...
Malgré les précautions prises par les deux jeunes femmes, Lillian est pourtant victime d'une tentative de viol collectif dans ce même hangar qui n'a décidément rien d'un refuge... Il faut l'intervention d'un inconnu pour empêcher le pire in extremis. Il se présente sous l'identité de Monsieur Seamus et, rapidement, il se rapproche de Lillian.
Bientôt, ils quittent le squat, laissant derrière eux Fanny, pour se rendre dans un autre lieu. En rencontrant Monsieur Seamus, Lillian s'est rappelée qu'elle a toujours voulu devenir actrice et son sauveur lui a proposé un plan qui semble sérieux et prometteur. L'occasion de monter sur les planches et de faire ses preuves, à condition de réussir une audition.
Direction East Saint-Louis, dans l'Illinois, un quartier en déshérence complète, une espèce de désert urbain au milieu duquel se dresse un imposant bâtiment : le Majestic Theatre. Est-ce quartier abandonné ou l'architecture du lieu ? Sans doute l'ensemble des deux, mais ce théâtre désaffecté est d'un macabre qui fait froid dans le dos...
C'est pourtant là qu'une troupe s'est installée et prépare une représentation d'une pièce intitulée "Au commencement était la mort". Une troupe certes accueillante, mais qui possède son mystère, ses zones d'ombre et se compose de personnages plus ou moins patibulaires, à l'image d'Allan, espèce de Monsieur Loyal à qui on donnerait difficilement le bon Dieu sans confession.
Lillian et Monsieur Seamus vont relever le défi (et accepter les cachets afférents), mais pas sans doute. Commence alors pour ces deux marginaux une préparation difficile : Lillian est toujours sous l'emprise de la drogue et Monsieur Seamus n'affiche pas de talent particulier pour la comédie. Quant à la pièce, elle ne manque pas elle aussi de susciter des questions...
Ce sont les trois coups marquant le début d'un bien étrange spectacle...
Disons-le tout net, j'avais adoré l'atmosphère très lourde et très noire de "Criminal Loft" et j'ai retrouvé ces ingrédients dans "Majestic Murder", mais dans un contexte et au service d'une histoire bien différente. Difficile, d'ailleurs, d'aller plus loin que le bref résumé ci-dessus, tant cette intrigue est emberlificotée, tant elle joue avec les apparences et nous enfume.
Commençons par le commencement, avec le véritable point commun entre les deux romans d'Armelle Carbonel : après Waverly Hills, le sinistre sanatorium devenu cadre d'une émission de télévision, c'est dans un théâtre, un véritable théâtre que la romancière nous emmène. Mais, un théâtre bien sinistre, forcément, sinon, c'est pas drôle...
Un théâtre à la riche histoire, construit en 1928 (la date n'est pas anodine) à East Saint-Louis, dans le sud de l'Etat de l'Illinois. Sur la fiche Wikipedia (version anglaise), on apprend que ce fut le premier théâtre de la ville à posséder un système d'air climatisé et le premier lieu dans la région où furent projetés des films parlants. Puis, il a fermé, dans les années 1960, avant de devenir ça :
Avouez que, si vous y arrivez en fin de journée, par temps gris, dans un quartier quasi désert désormais, il y a de quoi ressentir quelques picotements dans la nuque... Et une fois à l'intérieur, ce n'est guère mieux : on est dans une ruine qui conserve pourtant un certain cachet, mais c'est le genre d'endroit qui peut vite prendre des allures de coupe-gorge...
Forcément, ce lieu contribue à l'ambiance angoissante de l'histoire et aux inquiétudes initiales de Lillian et Monsieur Seamus, qui ne s'attendaient sans doute pas à passer une audition dans un tel décor... En revanche, les membres de la compagnie qui les accueillent, eux, s'y trouvent comme des poissons dans l'eau, c'est vous dire si on se sent... rassurés...
Ajoutez quelques détails curieux, vite repérés par les deux petits nouveaux, dont je ne parlerai pas ici, eh non, et vous comprendrez la valse-hésitation qui habite soudain nos deux personnages : le cachet confortable qui a de quoi les sortir de la mouise, ou du moins, améliorer l'ordinaire, contre le fait de rester dans cet endroit sinistre entourés de personnages qui semblent sortis d'un film de série Z...
D'ailleurs, on pourrait presque comparer Lillian et Monsieur Seamus, à leur arrivée au Majestic Theatre, avec le couple que forment Susan Sarandon et Barry Bostwick dans le "Rocky Horror Picture Show", sauf qu'ils n'arrivent pas devant les portes du théâtre par le plus grand des hasards. Pour le reste, oui, il y a de cela, car une fois les portes franchies, ils ne maîtrisent plus rien, et surtout pas leur destin.
Mais le théâtre n'est pas le seul élément réel ayant inspiré Armelle Carbonel pour l'écriture de ce roman. Le cadre, c'est ok, mais il nous faut aussi dire un mot d'un personnage, Peg Entwistle. Ce sera vraiment un mot et, conseil, ne cherchez pas tout de suite qui elle était, lisez d'abord le roman. Toujours est-il que ce destin est un des éléments principaux de ce thriller.
J'ai récemment évoqué James Ellroy, je pourrai recommencer, car il flotte sur "Majestic Murder" un petit air de "Dahlia noir". Certains qui auront lu le livre d'Armelle Carbonnel seront peut-être surpris de cette allusion, mais il y a malgré les différences quelques passerelles possibles, jusque dans la noirceur de ce récit et la manière dont un destin tragique se transmet, devient une légende...
Quant à cette histoire de théâtreux un poil glauque, elle pourrait se ranger aux côtés des récents romans de Patrick Senécal, et particulièrement "Faims", où c'est une troupe de cirque qui était le moteur d'une histoire très inquiétante. Dans "Majestic Murder", le spectacle est l'aboutissement programmé et non le point de départ, comme chez Senécal, mais on retrouve des interrogations proches.
Qui sont donc ces comédiens ayant investi un lieu abandonné pour monter une pièce sulfureuse écrite par un mystérieux Dramaturge (on n'entendra parler de lui que sous ce nom) à destination d'un public prétendument trié sur le volet ? On est vraiment dans un univers qui pourrait faire penser à un film d'horreur, un slasher où un mystérieux personnage pourrait commencer à zigouiller tous les membres de la troupe...
Ce roman est tout en clair-obscur, exactement comme au théâtre, quand les feux de la rampe brillent et illuminent juste la scène, laissant le reste de la salle dans le noir. De la scène aux coulisses, des sous-sols du théâtre aux appartements occupés par les comédiens, on s'attend sans cesse à ce que surgisse de l'ombre quelque créature macabre dont la simple vue nous glace les sangs...
On flirte avec une ambiance très proche du fantastique (c'était d'ailleurs déjà le cas dans "Criminal Loft"), renforcée par la mystérieuse présente aux alentours du Majestic Theatre d'un personnage troublant, car on ne sait absolument pas d'où il vient et ce qu'il fait véritablement là. Jusque dans son identité, il y a cette dimension presque irréelle : Noname.
Comme pour Peg Entwistle, je ne veux pas trop en dire sur ce personnage pour qui, j'ai cru comprendre, Armelle Carbonel a une réelle affection. Il n'empêche que sa présence, les réflexions qu'il nous fait partager, son côté enfant sauvage, tout cela laisse une bizarre impression, quelque chose du domaine du malaise... Mais qui est vraiment Noname ?
Vous aurez noté que ce billet s'évertue à parler de tout, sauf de l'intrigue... Eh oui, c'est une question qui se pose toujours lorsqu'on aborde un roman à intrigue, un polar, un thriller : où placer les limites ? Que doit-on aborder et qu'est-ce qui relève vraiment du spoiler ? Concernant "Majestic Murder", toutes ces questions se posent, et pas qu'un peu...
Armelle Carbonel joue avec nous, pauvres lecteurs, elle nous emmène dans des endroits sinistres où elle nous largue sans aucun repère, où elle nous surprend dans un premier temps avec quelques rebondissements bien sentis puis nous manipule allègrement et joue avec notre paranoïa. Car, bientôt, on se méfie de tout le monde...
Alors, qui mène vraiment la danse ? Pardon, qui est le véritable metteur en scène de la pièce qui se joue sous nos yeux (le roman est divisé en actes et en scènes, avec des entractes) ? Tour l'enjeu est là, dans cette danse macabre où les fils narratifs secondaires ne sont absolument pas à négliger. Au contraire, ils viennent brouiller un peu plus les cartes jusqu'au dénouement.
Un dernier mot sur Shakespeare, cité en ouverture de ce billet. Ce n'est pas un choix fait au hasard, le Barde de Stratford est un peu la figure tutélaire de "Majestic Murder", jusque sur la couverture, discret hommage à Hamlet et à son monologue. Et il y a effectivement quelques chose de Shakespearien, non pas dans le roman lui-même mais dans l'histoire centrale qui y est abordée.
Une tragédie moderne avec, comme moteur, la question plus que contemporaine de la célébrité et du succès, l'incapacité de renoncer à ses rêves quand ils s'avèrent inaccessibles... Et, si vous creusez un peu la question pendant ou après votre lecture, vous verrez à quel point le destin peut se montrer coquin et vicelard...
Allez, j'en termine là. J'attendais de voir ce que Armelle Carbonel nous offrirait dans ce deuxième roman, tellement attendu, presque redouté. Et le résultat est à la hauteur de l'attente, on retrouve ces indéniables qualités pour instaurer des ambiances angoissantes et pleines de noirceur, et une histoire qui tient bien la route, même si elle est très sinueuse. Nul doute que le troisième opus sera meilleur encore !
Et terminons en musique, avec la voix de Mildred Bailey qui rythme le roman et vient ajouter une touche très particulière, comme si, au Majestic Theatre, le temps s'était arrêté... Gramophone, jazz, cire qui grattouille et voix cristalline, pour une chanteuse morte jeune et sans avoir connu d'immense succès... Une musique qui apporte sa touche à l'ambiance du roman, comme ce morceau qui marque son... entrée en scène, disons :
Un dernier mot : "Majestic Murder" paraît aux éditions Fleur Sauvage, qui a déjà publié, entre autres, Fabio M. Mitchelli et Pierre Gaulon. Cette maison basée dans les Hauts-de-France traverse une période très difficile avec de gros soucis financiers. Vous pouvez les aider, évidemment en achetant les livres de leur catalogue (riche et intéressant), mais aussi une participation via Ulule. Pour en savoir plus : https://www.editionsfleursauvage.com/
mardi 25 avril 2017
"Le monde est rempli de gens en galère, je me suis dit, et trois heures plus tard j'avais retrouvé Brando, Kingo et Caméléon, tous raides défoncés, à s'enfiler des Fernet Coca au Club, calés à la place qui était très exactement la nôtre dans l'univers".
Restons en Amérique latine et prenons la direction de l'Argentine pour évoquer un polar à la fois très noir et complètement déjanté, grand-guignolesque, même, qui avait pas mal fait parler de lui lors de sa sortie en grand format, dans une maison d'édition indépendante basée en Alsace, la Dernière Goutte. Désormais, ce roman est disponible en poche chez Folio et, si vous aimez des auteurs comme James Ellroy ou Jim Thompson, alors, précipitez-vous, vous devriez apprécier "Entre hommes", de German Maggiore (traduction de Nelly Guichard). Un roman surprenant dans la forme, avec des tiroirs, des fils narratifs parallèles, un final elliptique, mais surtout une galerie de personnages, de gueules, aurait-on envie de dire pour reprendre une expression chère au cinéma, où tout le monde il n'est pas beau et tout le monde il n'est pas gentil. Je ne sais pas ce que pense les Argentins de l'image qui est donnée de leur pays dans ce livre, mais on est loin de la plaquette d'un office du tourisme. Attention, ça décape !
Le Tucumano est un voyou qu'on oublie pas : une carrure balèze, des tatouages un peu partout, la tronche couverte de cicatrices peu avenantes, cocaïné jusqu'à la moelle, bref, le genre de mec qui vous fait changer de trottoir si vous devez le croiser, qu'il fasse jour ou nuit, peu importe. Une brute sans état d'âme que la violence n'effraie pas car elle fait partie du job...
Sa mission, cette fois, est de recruter du personnel afin d'organiser une orgie dans les beaux quartiers. Il a opté pour deux travestis et une prostituées qu'il emmène ensuite dans un appartement où les attendent des notables en vue, dont l'homme qui a toutes les chances de devenir le prochain gouverneur de la Province. Que la fête commence !
Alcool, dope, sexe, tout est réuni pour une fiesta d'enfer... jusqu'à ce que cette soirée de rêve ne tourne au cauchemar : Yiyi, la prostituée, clamse en plein ébat, victime d'une overdose. Débandade générale (dans tous les sens du terme) chez les participants à l'orgie, cet accident pourrait avoir de fâcheuses conséquences pour leurs brillantes carrières, alors il faut agir.
Et pendant que les hommes puissants se carapatent discrètement, c'est le Tucumano qui fait le ménage. A la sulfateuse, forcément. Pas de témoins, c'est le deal implicite, et voilà comment les deux travestis rejoignent vite la prostituée décédée. Le truand a ensuite les contacts pour que ces cadavres encombrants ne remontent jamais à la surface, emballé, c'est pesé !
Reste ensuite à s'occuper de la vidéo. Ah, oui, je ne vous en avais pas parlé, de la vidéo... Oui, une caméra subtilement planquée dans la pièce où eut lieu l'orgie. A l'insu du plein gré des participants, bien sûr. Eh oui, c'est ainsi, les paroles s'envolent mais les vidéos restent. Et permettent à leur propriétaire de pratiquer un de ces sports vieux comme le monde : le chantage...
Quand on retrouve, quelques semaines plus tard, le corps en état de décomposition avancée dans un bâtiment en travaux, il n'a pas sur lui la fameuse vidéo... Et sa mort a de quoi intriguer la police. Une police qui envoie certains de ses meilleurs représentants sur place pour enquêter. Enfin, meilleurs, tout est relatif...
Car les policiers en question, l'un surnommé "le Timbré" et l'autre "le Monstre", tout un programme, n'ont rien de flics modèles selon des critères éthiques traditionnels... Le premier est un fondu qui, dit-on, connaît le Code pénal par coeur et le récite le soir pour s'endormir comme d'autres comptent des moutons.
Le second, plus âgé, a fait ses preuves comme tortionnaire pendant la dictature avant de se recaser dans la lutte contre le narcotrafic. Grièvement blessé des années plus tôt, il arbore une impressionnante cicatrice sur le visage comme il porterait une décoration. Un dur, un flic aux méthodes expéditives et violentes, qui cogne d'abord et pose les questions ensuite, et picole sec.
Le Monstre est le mentor du Timbré et leur duo fait des ravages dans les rues de Buenos Aires. Ils incarnent la loi, l'ordre, mais aussi la corruption parce qu'il faut bien vivre. Alors, oui, on chasse les narcotrafiquants qui gangrènent la capitale argentine, mais si on peut arranger les bidons de quelque puissant, pourquoi se gêner ? Surtout cette gênante histoire de vidéo, là...
Mais dans "Entre hommes", on croise aussi des braqueurs qui rêvent d'un gros coup, très risqué, mais qui, s'il réussit, leur remplira les poches de billet et de poudre qui fait planer ; et puis une bonne bande de losers qui vit à fond sa vocation de piliers de bar, entre murges, défonces et pitoyables séances de drague...
Voilà tout le petit monde que met en marche German Maggiori, à coups de surnoms façon romans noires à la française des années 1950-60, de situations glauques, de plans foireux, de neurones grillés par la drogue et l'alcool, de flingues en quantité industrielle, de quiproquos et d'actions d'éclat menées par des cow-boys qui feraient presque passé les flics pourris de "The Shield" pour des agneaux...
Je n'en dis pas plus, car la construction de ce roman très noir est très intéressante et très minutieuse. C'est d'ailleurs une alchimie assez curieuse, car l'histoire réussit à être à la fois très noire, ultra-violente, et, dans le même temps, à être portée par des personnages outranciers, grand-guignolesques, pour reprendre le mot utilisé en introduction de ce billet.
Ces truands et ces flics, on s'attendrait presque à les voir sortir des films de Melville, Verneuil, Lautner, des romans d'Albert Simonin, d'Auguste Le Breton ou de Frédéric Dard... On a une sacrée collection de bras cassés, de voyous de seconde zone, de ripoux et autres hurluberlus (wouah, j'adore l'idée de placer ce mot dans un billet !) à l'espérance de vie limitée et au mode de vie borderline.
Les références de Maggiori, je l'ai dit, c'est Ellroy (dont une phrase est d'ailleurs citée en exergue du romans) et Jim Thompson, mais on pourrait aussi songer à Elmore Leonard ou Donald Westlake pour le mélange de noirceur et de cynisme, pour la violence qu'exercent des personnages complètement largués, dépassés ou recourant à des méthodes peu orthodoxes pour parvenir à leurs fins.
Il n'y a pas l'inventivité de la langue d'Ellroy chez Maggiori, mais sa sinistre comédie fait mouche, avec son espèce de réaction en chaînes qui va aboutir à une fin un peu déroutante, mais presque morale. Avec quelque chose d'implicitement "tarantinesque" (il y avait d'ailleurs sûrement matière à une scène d'anthologie digne du cinéaste, mais il nous faudra l'imaginer nous-mêmes).
Mais au-delà de tout cela, on se retrouve surtout face à une Argentine rongée par la corruption, le trafic de drogue, la délinquance pour ne pas dire le grand banditisme, le chômage, l'inactivité, les addictions et un horizon bien bouché qu'on n'envie pas franchement... Bref, une situation sociale catastrophique qui a de quoi inquiéter le lecteur, malgré l'ironie du texte qui suscite bien souvent de francs sourires.
"Entre hommes" s'insère parfaitement dans le paysage littéraire et, plus largement, culturel argentin, qui connaît, depuis la crise de 2001, un renouveau et une vitalité impressionnante. On retrouve, dans les littératures ou le cinéma de genre de ce pays, une grande créativité, un humour féroce et une critique de la société et du monde politique argentins qui sont à la fois réjouissants et douloureux.
Intéressant, d'ailleurs, de noter qu'on retrouve dans "Entre hommes", des éléments croisés dans un tout autre univers littéraires, celui de Leandro Avalos Blacha, particulièrement "Malicia" (je parle parfois de détails, mais aussi de thèmes qui tiennent une belle place, comme la passion argentine pour les casinos et les jeux d'argent).
Au milieu de ce chaos qui fait de Buenos Aires une espèce d'OK Corral où tout le monde règle ses comptes à sa façon et nourrit des ambitions qu'il entend assouvir à n'importe quel prix, en tout cas pas celui de la vie humaine, qui ne vaut plus grand-chose, de toute manière, on trouve une bande de losers qui en deviennent presque touchants.
J'ai beaucoup aimé la manière dont German Maggiori introduit ces personnages apparemment secondaires et qui vont traverser tout cela sans se douter une seconde qu'ils ont frôlé la catastrophe. Ils sont les seuls à avoir la parole directement, puisque leurs interventions sont racontées à la première personne quand tout le reste nous est narré à la troisième.
Le rythme n'est pas celui d'un thriller effréné, on est clairement dans un polar assez classique, mais son histoire, ses personnages pas ordinaires et la construction audacieuse et ingénieuse lui confèrent une efficacité qui emporte le lecteur. On n'a pas envie de lâcher cette affaire à plusieurs facettes et "Entre hommes" devient vite un page-turner.
J'ai du mal à savoir comment appréhender la fin du roman. Pas le dénouement de la trame polar en tant que telle, car elle est assez logique avec ou sans ellipse. Mais ce dernier chapitre, qui paraît d'une seul coup assez décalé après le bruit et la fureur. Comme si on se retrouvait dans l'oeil du cyclone ou après la tempête, lorsque le calme revient doucement...
La vie est un spectacle qui doit continuer, pour reprendre une fameuse devise. Mais ce calme est aussi assez ambigu : il n'annonce pas de changement véritable dans une Argentine qui a tant d'atouts mais qui ne parvient pas à tourner la page des dérives politiques, économiques et sociales du tournant du XXIe siècle et reste, si ce n'est malade, tout du moins sérieusement convalescente.
Ce roman est une vraie découverte et on espère que ce ne sera pas une réussite sans suite. J'aimerais en tout cas énormément retrouver l'univers littéraire de German Maggiori, j'aimerais qu'il me surprenne sans perdre cette identité et cette écriture qui sont deux éléments majeurs d' "Entre hommes". J'aimerais une nouvelle histoire forte, noire et pleine d'une ironie féroce qui me comble une fois encore. Soyons patients !
Le Tucumano est un voyou qu'on oublie pas : une carrure balèze, des tatouages un peu partout, la tronche couverte de cicatrices peu avenantes, cocaïné jusqu'à la moelle, bref, le genre de mec qui vous fait changer de trottoir si vous devez le croiser, qu'il fasse jour ou nuit, peu importe. Une brute sans état d'âme que la violence n'effraie pas car elle fait partie du job...
Sa mission, cette fois, est de recruter du personnel afin d'organiser une orgie dans les beaux quartiers. Il a opté pour deux travestis et une prostituées qu'il emmène ensuite dans un appartement où les attendent des notables en vue, dont l'homme qui a toutes les chances de devenir le prochain gouverneur de la Province. Que la fête commence !
Alcool, dope, sexe, tout est réuni pour une fiesta d'enfer... jusqu'à ce que cette soirée de rêve ne tourne au cauchemar : Yiyi, la prostituée, clamse en plein ébat, victime d'une overdose. Débandade générale (dans tous les sens du terme) chez les participants à l'orgie, cet accident pourrait avoir de fâcheuses conséquences pour leurs brillantes carrières, alors il faut agir.
Et pendant que les hommes puissants se carapatent discrètement, c'est le Tucumano qui fait le ménage. A la sulfateuse, forcément. Pas de témoins, c'est le deal implicite, et voilà comment les deux travestis rejoignent vite la prostituée décédée. Le truand a ensuite les contacts pour que ces cadavres encombrants ne remontent jamais à la surface, emballé, c'est pesé !
Reste ensuite à s'occuper de la vidéo. Ah, oui, je ne vous en avais pas parlé, de la vidéo... Oui, une caméra subtilement planquée dans la pièce où eut lieu l'orgie. A l'insu du plein gré des participants, bien sûr. Eh oui, c'est ainsi, les paroles s'envolent mais les vidéos restent. Et permettent à leur propriétaire de pratiquer un de ces sports vieux comme le monde : le chantage...
Quand on retrouve, quelques semaines plus tard, le corps en état de décomposition avancée dans un bâtiment en travaux, il n'a pas sur lui la fameuse vidéo... Et sa mort a de quoi intriguer la police. Une police qui envoie certains de ses meilleurs représentants sur place pour enquêter. Enfin, meilleurs, tout est relatif...
Car les policiers en question, l'un surnommé "le Timbré" et l'autre "le Monstre", tout un programme, n'ont rien de flics modèles selon des critères éthiques traditionnels... Le premier est un fondu qui, dit-on, connaît le Code pénal par coeur et le récite le soir pour s'endormir comme d'autres comptent des moutons.
Le second, plus âgé, a fait ses preuves comme tortionnaire pendant la dictature avant de se recaser dans la lutte contre le narcotrafic. Grièvement blessé des années plus tôt, il arbore une impressionnante cicatrice sur le visage comme il porterait une décoration. Un dur, un flic aux méthodes expéditives et violentes, qui cogne d'abord et pose les questions ensuite, et picole sec.
Le Monstre est le mentor du Timbré et leur duo fait des ravages dans les rues de Buenos Aires. Ils incarnent la loi, l'ordre, mais aussi la corruption parce qu'il faut bien vivre. Alors, oui, on chasse les narcotrafiquants qui gangrènent la capitale argentine, mais si on peut arranger les bidons de quelque puissant, pourquoi se gêner ? Surtout cette gênante histoire de vidéo, là...
Mais dans "Entre hommes", on croise aussi des braqueurs qui rêvent d'un gros coup, très risqué, mais qui, s'il réussit, leur remplira les poches de billet et de poudre qui fait planer ; et puis une bonne bande de losers qui vit à fond sa vocation de piliers de bar, entre murges, défonces et pitoyables séances de drague...
Voilà tout le petit monde que met en marche German Maggiori, à coups de surnoms façon romans noires à la française des années 1950-60, de situations glauques, de plans foireux, de neurones grillés par la drogue et l'alcool, de flingues en quantité industrielle, de quiproquos et d'actions d'éclat menées par des cow-boys qui feraient presque passé les flics pourris de "The Shield" pour des agneaux...
Je n'en dis pas plus, car la construction de ce roman très noir est très intéressante et très minutieuse. C'est d'ailleurs une alchimie assez curieuse, car l'histoire réussit à être à la fois très noire, ultra-violente, et, dans le même temps, à être portée par des personnages outranciers, grand-guignolesques, pour reprendre le mot utilisé en introduction de ce billet.
Ces truands et ces flics, on s'attendrait presque à les voir sortir des films de Melville, Verneuil, Lautner, des romans d'Albert Simonin, d'Auguste Le Breton ou de Frédéric Dard... On a une sacrée collection de bras cassés, de voyous de seconde zone, de ripoux et autres hurluberlus (wouah, j'adore l'idée de placer ce mot dans un billet !) à l'espérance de vie limitée et au mode de vie borderline.
Les références de Maggiori, je l'ai dit, c'est Ellroy (dont une phrase est d'ailleurs citée en exergue du romans) et Jim Thompson, mais on pourrait aussi songer à Elmore Leonard ou Donald Westlake pour le mélange de noirceur et de cynisme, pour la violence qu'exercent des personnages complètement largués, dépassés ou recourant à des méthodes peu orthodoxes pour parvenir à leurs fins.
Il n'y a pas l'inventivité de la langue d'Ellroy chez Maggiori, mais sa sinistre comédie fait mouche, avec son espèce de réaction en chaînes qui va aboutir à une fin un peu déroutante, mais presque morale. Avec quelque chose d'implicitement "tarantinesque" (il y avait d'ailleurs sûrement matière à une scène d'anthologie digne du cinéaste, mais il nous faudra l'imaginer nous-mêmes).
Mais au-delà de tout cela, on se retrouve surtout face à une Argentine rongée par la corruption, le trafic de drogue, la délinquance pour ne pas dire le grand banditisme, le chômage, l'inactivité, les addictions et un horizon bien bouché qu'on n'envie pas franchement... Bref, une situation sociale catastrophique qui a de quoi inquiéter le lecteur, malgré l'ironie du texte qui suscite bien souvent de francs sourires.
"Entre hommes" s'insère parfaitement dans le paysage littéraire et, plus largement, culturel argentin, qui connaît, depuis la crise de 2001, un renouveau et une vitalité impressionnante. On retrouve, dans les littératures ou le cinéma de genre de ce pays, une grande créativité, un humour féroce et une critique de la société et du monde politique argentins qui sont à la fois réjouissants et douloureux.
Intéressant, d'ailleurs, de noter qu'on retrouve dans "Entre hommes", des éléments croisés dans un tout autre univers littéraires, celui de Leandro Avalos Blacha, particulièrement "Malicia" (je parle parfois de détails, mais aussi de thèmes qui tiennent une belle place, comme la passion argentine pour les casinos et les jeux d'argent).
Au milieu de ce chaos qui fait de Buenos Aires une espèce d'OK Corral où tout le monde règle ses comptes à sa façon et nourrit des ambitions qu'il entend assouvir à n'importe quel prix, en tout cas pas celui de la vie humaine, qui ne vaut plus grand-chose, de toute manière, on trouve une bande de losers qui en deviennent presque touchants.
J'ai beaucoup aimé la manière dont German Maggiori introduit ces personnages apparemment secondaires et qui vont traverser tout cela sans se douter une seconde qu'ils ont frôlé la catastrophe. Ils sont les seuls à avoir la parole directement, puisque leurs interventions sont racontées à la première personne quand tout le reste nous est narré à la troisième.
Le rythme n'est pas celui d'un thriller effréné, on est clairement dans un polar assez classique, mais son histoire, ses personnages pas ordinaires et la construction audacieuse et ingénieuse lui confèrent une efficacité qui emporte le lecteur. On n'a pas envie de lâcher cette affaire à plusieurs facettes et "Entre hommes" devient vite un page-turner.
J'ai du mal à savoir comment appréhender la fin du roman. Pas le dénouement de la trame polar en tant que telle, car elle est assez logique avec ou sans ellipse. Mais ce dernier chapitre, qui paraît d'une seul coup assez décalé après le bruit et la fureur. Comme si on se retrouvait dans l'oeil du cyclone ou après la tempête, lorsque le calme revient doucement...
La vie est un spectacle qui doit continuer, pour reprendre une fameuse devise. Mais ce calme est aussi assez ambigu : il n'annonce pas de changement véritable dans une Argentine qui a tant d'atouts mais qui ne parvient pas à tourner la page des dérives politiques, économiques et sociales du tournant du XXIe siècle et reste, si ce n'est malade, tout du moins sérieusement convalescente.
Ce roman est une vraie découverte et on espère que ce ne sera pas une réussite sans suite. J'aimerais en tout cas énormément retrouver l'univers littéraire de German Maggiori, j'aimerais qu'il me surprenne sans perdre cette identité et cette écriture qui sont deux éléments majeurs d' "Entre hommes". J'aimerais une nouvelle histoire forte, noire et pleine d'une ironie féroce qui me comble une fois encore. Soyons patients !
dimanche 23 avril 2017
"Et il apprit quelque chose de très important pour son avenir : de même que les choses s'en vont, de même elles doivent nécessairement revenir".
Quelques semaines après l'excellent "Gabacho", les éditions Liana Levi nous emmènent une nouvelle fois au Mexique pour un court roman plein de surprises, à la fois plein d'ironie et de réflexions sur l'histoire et le monde qui nous entoure. Dans la tradition hispanique du roman picaresque, ce livre sort pourtant de l'ordinaire, et vous comprendrez rapidement pourquoi dans les lignes qui viennent. Partons à la découverte du premier roman de Sergio Schmucler, écrivain mexicain originaire d'Argentine (et on va voir que ce n'est pas anodin), "Le Monde depuis ma chaise" (traduction de Dominique Lepreux). Un roman entre chronique historique et fable douce-amère qui s'étend sur un demi-siècle avec un personnage aussi déroutant qu'attachant, mu par un espoir fou : la vie, le monde, les événements, tout n'est en fait qu'une boucle, une espèce d'orbite qui ramène toujours les choses à un point donné...
Galo est né à Mexico, au début des années 1930. Son père est menuisier et voit en Galo son successeur. En fait, pour lui, il n'y a pas d'alternative, Galo sera à son tour menuisier ou ne sera rien. Une petite phrase qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Nous sommes en 1938, Galo n'a pas encore 5 ans et son destin vient de voir ses principales lignes s'écrire.
La vie de Galo suit alors une véritable routine quotidienne : chaque matin, après le petit-déjeuner, il s'assoit sur une chaise devant la maison familiale, à côté d'un bougainvillier, observe son père en se disant que, non, vraiment, il ne sera pas menuisier. Son père, lui aussi, observe un cérémonial bien huilé : allumer une cigarette puis la radio puis se mettre au travail.
Jusqu'au jour où son père s'enfuit avec une de ses clientes. Une jeune femme aux longs cheveux blonds, si différente de la mère de Galo. Alors que les rumeurs d'une nouvelle guerre mondiale ne cessent de croître, la vie du garçon bascule : ses repères disparaissent, sauf cette chaise, fabriquée par ce père volage, et ce bougainvillier récemment planté.
Désobéissant à sa mère qui souhaite ne plus jamais le voir quitter la maison, Galo se lève de sa chaise, sort et part à la découverte du monde. Or, cette fameuse maison est située calle Amsterdam. Une rue dont le tracé reprend en fait celui de la piste d'un ancien hippodrome. Une boucle. Yeux grands ouverts, époustouflés par ce monde bruyant et agité qu'il découvre, Galo observe...
Et finit par se retrouver... devant chez lui ! Revoilà sa chaise, son bougainvillier, sa mère et l'enfant, persuadé qu'il ne sera rien, puisqu'il ne sera pas menuisier, et que le monde se limite à la boucle de la calle Amsterdam, décide que, désormais, sa vie se déroulera là, quoi qu'il arrive. Nous sommes en 1939, Galo a 6 ans et puisqu'il n'ira pas vers le monde, c'est le monde qui viendra à lui.
La vie doit continuer pour la mère de Galo, sans époux, désormais, et flanqué d'un fils que tout le monde croit simple d'esprit. Alors que le quartier évolue (aujourd'hui, on parlerait sans doute de gentrification), alors que le monde entre en guerre, alors que plus rien n'est comme avant, Galo est ancré sur sa chaise.
Malgré tout, Galo s'accroche à cette maison, qui va connaître, au fil des ans, bien des modifications, lorsque sa mère en fait une pension ou en loue une partie pour que s'y établissent des commerces. A chaque époque, qu'elle accueille des locataires de passage, un coiffeur, un glacier, une école de danse, ces changements seront l'occasion pour Galo de faire des rencontres.
Et pas n'importe lesquelles, car, à chaque fois, ces visiteurs, ces connaissances, incarneront le monde tel qu'il est, ses changements durables ou provisoires, ses vicissitudes... Par exemple, lorsque se monte un salon de coiffure, il accueille des exilés européens ayant fui les fascismes : des républicains espagnols et des juifs allemands, cocktail explosif...
Galo, qui ne sort toujours pas de la maison, poursuit son observation, écoute ce qui se dit, en apprend un peu plus sur le monde, vu par le petit bout de la lorgnette, et agit parfois... Provoquant au passage quelques incidents mémorables. On pardonnera le simplet, mais les conséquences seront à chaque fois non négligeables.
Mais Galo s'en fout. Lui sait qu'il n'a rien d'un simple d'esprit, que ses choix découlent de serments et de promesses faites, peu lui chaut que cela ait entraîné un gros malentendu avec sa mère, il trace son sillon... immobile. Avec, toujours, cette certitude que le monde fonctionne en boucle et que ceux qui passent, son père, son premier amour, son ami révolutionnaire pas encore connu, tous finiront par revenir calle Amsterdam.
Avec l'histoire de Galo, l'enfant qui observe le monde depuis sa chaise, posée devant sa maison, Sergio Schmucler invente le roman picaresque immobile. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas Galo qui va vers le monde, comme habituellement dans ce genre littéraire, mais le monde qui vient à lui, passe devant lui. Il en est spectateur et non véritablement acteur.
Autre particularité, c'est que cela va durer bien au-delà de son enfance, puisque l'histoire s'étend de la fin des années 1930 à la fin des années 1980. Mais Galo, lui, conserve sa candeur tout au long de cette période, accréditant l'étiquette de simple d'esprit qu'on lui a collée. L'âge n'a pas de prise, il demeure ce petit garçon uniquement lié à sa chaise et son bougainvillier (qui lui, croît et embellit).
Il y a chez Galo quelque chose de l'Oskar du "Tambour", de Günter Grass, même s'il pourrait être son négatif : un enfant dans un corps d'adulte, affrontant le monde en marche à travers une série de rencontres édifiantes, mettant son grain de sel quand ça lui chante (mais pas de la même voix perçante que le nain du roman de Grass).
Sergio Schmucler ne va sans doute pas aussi loin dans le grotesque que le prix Nobel allemand, même si certaines scènes, je pense à la prestigieuse visite qui scellera le sort du salon de coiffure ou encore, l'étonnante séance de chasse aux chats en compagnie d'un personnage appelé à un destin héroïque, sont férocement drôles.
Mais la filiation m'a paru assez nette, même si Sergio Schmucler ne recourt pas au fantastique pour faire avancer son histoire. En revanche, c'est un roman construit lui aussi en forme de fable, avec cette certitude qu'a Galo que tous ceux qui passent calle Amsterdam y reviendront forcément un jour. Pas de résignation, pas de doute, juste de la patience...
Une patience, et l'on en arrive aux origines argentines de l'auteur, rythmée par la musique, et pas n'importe laquelle : le tango. Cette danse, ces chansons sont omniprésentes dans le livre, sorte de madeleine de Proust de Galo, puisque cela faisait partie de la routine paternelle avant que celui-ci ne disparaisse... pour longtemps.
Le tango n'est jamais très loin dans ce roman, il tient même une place centrale dans la dernière partie du livre, et, si Sergio Schmucler nous propose une play-list tout à fait intéressante, un morceau se détache des autres, car il est à la fois le premier cité, mais aussi celui à la signification la plus lourde de sens. C'est une des plus célèbres chansons de Carlos Gardel, intitulée "Volver"... Revenir...
Eh oui, revenir... Un letimotiv, une devise, une certitude profonde chez Galo qui dépasse l'espoir de voir un jour, alors qu'il ne quitte pas sa chaise, de retrouver les personnes importantes de sa vie. Oui, ils reviendront, avec une vie bien à eux, mobile, mouvementée, troublée, pas forcément heureuse, en tout cas, pas forcément plus heureuse que celle de Galo, vissé sur sa chaise...
Mais tout cela va mener à la morale de cette fable, à sa conclusion qui, dans l'esprit bien naïf d'un Galo devenu un homme d'âge mûr, va prendre une forme tout aussi radicale que celle prise à 5 ans. Mais chut, à vous de voir, à vous de suivre le voyage immobile de Galo, son odyssée à travers l'histoire douloureuse du XXe siècle.
Un mot du titre. Sa version française est cohérente, logique, vous en conviendrez après avoir lu ce billet. Galo observe bien le monde depuis sa chaise. Mais, le titre originale, me semble-t-il, est encore plus fort : "el guardian de la calle Amsterdam", le gardien de la rue Amsterdam. Oui, c'est extrêmement pertinent, car Galo est bien le gardien de ces lieux.
Il est le garant que rien ne change dans cette rue circulaire, alors que le monde autour est en pleine effervescence. Une mission de la plus haute importance, particulièrement sur le plan local, puisque la calle Amsterdam elle aussi évolue, se modernise... Mais aussi face aux bouillonnements du monde qui affectent apparemment peu la calle Amsterdam. Apparemment, seulement.
Sans oublier la société mexicaine, puisque la période concernée est celle de la domination sans partage du Partido Nacional Revolucionario (en particulier la présidence de Lazaro Cardenas, dont le rôle dans le roman est assez insolite), né de la fameuse révolution de 1910 et qui deviendra dans les années 1940 le Parti Révolutionnaire Institutionnel et restera au pouvoir jusqu'en 2000.
Mais, au final, peu importe tout cela, les guerres, les révolutions, les engagements politiques, les aventures idéologiques... Car Galo, témoin passif de tout cela, sera, au final, passé à côté de sa propre existence, les ailes coupées par les mots de ses parents, ces petites phrases inconséquentes prises au pied de la lettre par un gamin certainement pas simplet, mais d'une grande naïveté, comme il sied aux héros picaresques.
Oui, Galo est sans doute passé à côté de sa vie : relations incomplètes avec ses parents, son père, parti très tôt, mais avec qui il ne parviendra pas à renouer véritablement, sa mère, toujours auprès de lui, au contraire, mais avec qui la communication n'est jamais vraiment passée, Ana, jeune fille rencontrée calle Amsterdam, son premier, son seul amour, incomplet, lui aussi...
Pendant 50 ans, la vie de Galo est restée ancrée à cette chaise, à ce bougainvillier, à cette bicoque. Elle a coulé comme le sable dans un sablier, sans que Galo fasse quoi que ce soit... Une vie illusoire à garder une rue qui elle-même change et évolue, à rester assis là, simple spectateur, jamais acteur... Au bout de ce demi-siècle, reste à savoir quelles leçons Gallo tirera de cette expérience immobile...
Reste une réflexion profonde, humaine, touchante sur l'exil, une expérience que Sergio Schmucler a lui-même connue. Né en Argentine, il a quitté ce pays lorsque la junte militaire y a pris le pouvoir en 1976. Il était alors encore adolescent et c'est au Mexique, dans un pays à découvrir, qu'il est entré dans l'âge adulte. Une expérience forcément marquante et douloureuse.
Galo est l'inverse d'un exilé, il est accroché à sa maison natale comme une moule à son rocher, au point de ne même pas en franchir le porche. Mais, tous ceux qu'il va rencontrer, eux, auront connu cet exil, auront vécu ces moments pénibles, ces expériences pas toujours réussies, enrichissantes jusqu'à un certain point, mais génératrice de nostalgie. Ce même sentiment qui imprègne le tango...
Volver... Revenir... Oui, l'objectif de tout exilé... Rentrer chez lui. Avec les cheveux blanchis par les neiges du temps qui passe, comme le dit la chanson. Car la route menant à la terre natale n'est jamais aussi circulaire que la calle Amsterdam, le destin jamais aussi régulièrement tracé que celui que s'est forgé Galo, pour fuir ses frayeurs enfantines...
Galo est né à Mexico, au début des années 1930. Son père est menuisier et voit en Galo son successeur. En fait, pour lui, il n'y a pas d'alternative, Galo sera à son tour menuisier ou ne sera rien. Une petite phrase qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Nous sommes en 1938, Galo n'a pas encore 5 ans et son destin vient de voir ses principales lignes s'écrire.
La vie de Galo suit alors une véritable routine quotidienne : chaque matin, après le petit-déjeuner, il s'assoit sur une chaise devant la maison familiale, à côté d'un bougainvillier, observe son père en se disant que, non, vraiment, il ne sera pas menuisier. Son père, lui aussi, observe un cérémonial bien huilé : allumer une cigarette puis la radio puis se mettre au travail.
Jusqu'au jour où son père s'enfuit avec une de ses clientes. Une jeune femme aux longs cheveux blonds, si différente de la mère de Galo. Alors que les rumeurs d'une nouvelle guerre mondiale ne cessent de croître, la vie du garçon bascule : ses repères disparaissent, sauf cette chaise, fabriquée par ce père volage, et ce bougainvillier récemment planté.
Désobéissant à sa mère qui souhaite ne plus jamais le voir quitter la maison, Galo se lève de sa chaise, sort et part à la découverte du monde. Or, cette fameuse maison est située calle Amsterdam. Une rue dont le tracé reprend en fait celui de la piste d'un ancien hippodrome. Une boucle. Yeux grands ouverts, époustouflés par ce monde bruyant et agité qu'il découvre, Galo observe...
Et finit par se retrouver... devant chez lui ! Revoilà sa chaise, son bougainvillier, sa mère et l'enfant, persuadé qu'il ne sera rien, puisqu'il ne sera pas menuisier, et que le monde se limite à la boucle de la calle Amsterdam, décide que, désormais, sa vie se déroulera là, quoi qu'il arrive. Nous sommes en 1939, Galo a 6 ans et puisqu'il n'ira pas vers le monde, c'est le monde qui viendra à lui.
La vie doit continuer pour la mère de Galo, sans époux, désormais, et flanqué d'un fils que tout le monde croit simple d'esprit. Alors que le quartier évolue (aujourd'hui, on parlerait sans doute de gentrification), alors que le monde entre en guerre, alors que plus rien n'est comme avant, Galo est ancré sur sa chaise.
Malgré tout, Galo s'accroche à cette maison, qui va connaître, au fil des ans, bien des modifications, lorsque sa mère en fait une pension ou en loue une partie pour que s'y établissent des commerces. A chaque époque, qu'elle accueille des locataires de passage, un coiffeur, un glacier, une école de danse, ces changements seront l'occasion pour Galo de faire des rencontres.
Et pas n'importe lesquelles, car, à chaque fois, ces visiteurs, ces connaissances, incarneront le monde tel qu'il est, ses changements durables ou provisoires, ses vicissitudes... Par exemple, lorsque se monte un salon de coiffure, il accueille des exilés européens ayant fui les fascismes : des républicains espagnols et des juifs allemands, cocktail explosif...
Galo, qui ne sort toujours pas de la maison, poursuit son observation, écoute ce qui se dit, en apprend un peu plus sur le monde, vu par le petit bout de la lorgnette, et agit parfois... Provoquant au passage quelques incidents mémorables. On pardonnera le simplet, mais les conséquences seront à chaque fois non négligeables.
Mais Galo s'en fout. Lui sait qu'il n'a rien d'un simple d'esprit, que ses choix découlent de serments et de promesses faites, peu lui chaut que cela ait entraîné un gros malentendu avec sa mère, il trace son sillon... immobile. Avec, toujours, cette certitude que le monde fonctionne en boucle et que ceux qui passent, son père, son premier amour, son ami révolutionnaire pas encore connu, tous finiront par revenir calle Amsterdam.
Avec l'histoire de Galo, l'enfant qui observe le monde depuis sa chaise, posée devant sa maison, Sergio Schmucler invente le roman picaresque immobile. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas Galo qui va vers le monde, comme habituellement dans ce genre littéraire, mais le monde qui vient à lui, passe devant lui. Il en est spectateur et non véritablement acteur.
Autre particularité, c'est que cela va durer bien au-delà de son enfance, puisque l'histoire s'étend de la fin des années 1930 à la fin des années 1980. Mais Galo, lui, conserve sa candeur tout au long de cette période, accréditant l'étiquette de simple d'esprit qu'on lui a collée. L'âge n'a pas de prise, il demeure ce petit garçon uniquement lié à sa chaise et son bougainvillier (qui lui, croît et embellit).
Il y a chez Galo quelque chose de l'Oskar du "Tambour", de Günter Grass, même s'il pourrait être son négatif : un enfant dans un corps d'adulte, affrontant le monde en marche à travers une série de rencontres édifiantes, mettant son grain de sel quand ça lui chante (mais pas de la même voix perçante que le nain du roman de Grass).
Sergio Schmucler ne va sans doute pas aussi loin dans le grotesque que le prix Nobel allemand, même si certaines scènes, je pense à la prestigieuse visite qui scellera le sort du salon de coiffure ou encore, l'étonnante séance de chasse aux chats en compagnie d'un personnage appelé à un destin héroïque, sont férocement drôles.
Mais la filiation m'a paru assez nette, même si Sergio Schmucler ne recourt pas au fantastique pour faire avancer son histoire. En revanche, c'est un roman construit lui aussi en forme de fable, avec cette certitude qu'a Galo que tous ceux qui passent calle Amsterdam y reviendront forcément un jour. Pas de résignation, pas de doute, juste de la patience...
Une patience, et l'on en arrive aux origines argentines de l'auteur, rythmée par la musique, et pas n'importe laquelle : le tango. Cette danse, ces chansons sont omniprésentes dans le livre, sorte de madeleine de Proust de Galo, puisque cela faisait partie de la routine paternelle avant que celui-ci ne disparaisse... pour longtemps.
Le tango n'est jamais très loin dans ce roman, il tient même une place centrale dans la dernière partie du livre, et, si Sergio Schmucler nous propose une play-list tout à fait intéressante, un morceau se détache des autres, car il est à la fois le premier cité, mais aussi celui à la signification la plus lourde de sens. C'est une des plus célèbres chansons de Carlos Gardel, intitulée "Volver"... Revenir...
Eh oui, revenir... Un letimotiv, une devise, une certitude profonde chez Galo qui dépasse l'espoir de voir un jour, alors qu'il ne quitte pas sa chaise, de retrouver les personnes importantes de sa vie. Oui, ils reviendront, avec une vie bien à eux, mobile, mouvementée, troublée, pas forcément heureuse, en tout cas, pas forcément plus heureuse que celle de Galo, vissé sur sa chaise...
Mais tout cela va mener à la morale de cette fable, à sa conclusion qui, dans l'esprit bien naïf d'un Galo devenu un homme d'âge mûr, va prendre une forme tout aussi radicale que celle prise à 5 ans. Mais chut, à vous de voir, à vous de suivre le voyage immobile de Galo, son odyssée à travers l'histoire douloureuse du XXe siècle.
Un mot du titre. Sa version française est cohérente, logique, vous en conviendrez après avoir lu ce billet. Galo observe bien le monde depuis sa chaise. Mais, le titre originale, me semble-t-il, est encore plus fort : "el guardian de la calle Amsterdam", le gardien de la rue Amsterdam. Oui, c'est extrêmement pertinent, car Galo est bien le gardien de ces lieux.
Il est le garant que rien ne change dans cette rue circulaire, alors que le monde autour est en pleine effervescence. Une mission de la plus haute importance, particulièrement sur le plan local, puisque la calle Amsterdam elle aussi évolue, se modernise... Mais aussi face aux bouillonnements du monde qui affectent apparemment peu la calle Amsterdam. Apparemment, seulement.
Sans oublier la société mexicaine, puisque la période concernée est celle de la domination sans partage du Partido Nacional Revolucionario (en particulier la présidence de Lazaro Cardenas, dont le rôle dans le roman est assez insolite), né de la fameuse révolution de 1910 et qui deviendra dans les années 1940 le Parti Révolutionnaire Institutionnel et restera au pouvoir jusqu'en 2000.
Mais, au final, peu importe tout cela, les guerres, les révolutions, les engagements politiques, les aventures idéologiques... Car Galo, témoin passif de tout cela, sera, au final, passé à côté de sa propre existence, les ailes coupées par les mots de ses parents, ces petites phrases inconséquentes prises au pied de la lettre par un gamin certainement pas simplet, mais d'une grande naïveté, comme il sied aux héros picaresques.
Oui, Galo est sans doute passé à côté de sa vie : relations incomplètes avec ses parents, son père, parti très tôt, mais avec qui il ne parviendra pas à renouer véritablement, sa mère, toujours auprès de lui, au contraire, mais avec qui la communication n'est jamais vraiment passée, Ana, jeune fille rencontrée calle Amsterdam, son premier, son seul amour, incomplet, lui aussi...
Pendant 50 ans, la vie de Galo est restée ancrée à cette chaise, à ce bougainvillier, à cette bicoque. Elle a coulé comme le sable dans un sablier, sans que Galo fasse quoi que ce soit... Une vie illusoire à garder une rue qui elle-même change et évolue, à rester assis là, simple spectateur, jamais acteur... Au bout de ce demi-siècle, reste à savoir quelles leçons Gallo tirera de cette expérience immobile...
Reste une réflexion profonde, humaine, touchante sur l'exil, une expérience que Sergio Schmucler a lui-même connue. Né en Argentine, il a quitté ce pays lorsque la junte militaire y a pris le pouvoir en 1976. Il était alors encore adolescent et c'est au Mexique, dans un pays à découvrir, qu'il est entré dans l'âge adulte. Une expérience forcément marquante et douloureuse.
Galo est l'inverse d'un exilé, il est accroché à sa maison natale comme une moule à son rocher, au point de ne même pas en franchir le porche. Mais, tous ceux qu'il va rencontrer, eux, auront connu cet exil, auront vécu ces moments pénibles, ces expériences pas toujours réussies, enrichissantes jusqu'à un certain point, mais génératrice de nostalgie. Ce même sentiment qui imprègne le tango...
Volver... Revenir... Oui, l'objectif de tout exilé... Rentrer chez lui. Avec les cheveux blanchis par les neiges du temps qui passe, comme le dit la chanson. Car la route menant à la terre natale n'est jamais aussi circulaire que la calle Amsterdam, le destin jamais aussi régulièrement tracé que celui que s'est forgé Galo, pour fuir ses frayeurs enfantines...
mardi 18 avril 2017
"C'est l'histoire d'un fantôme qui revient. Il veut reprendre sa place, il serait même prêt à transiger. Mais c'est impossible (...) C'est un non-vivant, un être sans identité. Personne ne l'attend. Il n'existe qu'au passé".
Avouez que si ce titre évoquait un roman, il ferait froid dans le dos... Et c'est un peu le cas malgré tout, je vais tout vous expliquer dans un instant, mais ce n'est pas une fiction qui nous intéressera ce soir. On va plutôt voyager, dans l'espace et dans le temps, à la rencontre de trois personnages centraux : Jean-Paul Kauffmann, Napoléon Ier et le colonel Chabert... Voilà, vous faites le lien ? Près de vingt ans après "la Chambre noire de Longwood" et le récit de son voyage à Sainte-Hélène, Jean-Paul Kauffmann évoque une nouvelle fois la période de l'Empire, avec "Outre-Terre" (désormais disponible en poche chez Folio). Et, cette fois, il nous emmène sur un des champs de bataille les plus méconnus de cette période : Eylau. Une bataille fascinante, puisque, plus de 200 ans après ce terrible massacre, personne n'est vraiment capable de dire qui en est sorti vainqueur... Mais, au-delà de l'Histoire, il y a aussi la peinture et la littérature. Avec ce court roman de Balzac, évidemment incontournable en ces lieux, mais qui entre aussi en résonance avec le parcours de Jean-Paul Kauffmann...
Le 8 février 1807, se déroula la bataille d'Eylau. Un scénario qu'on pourrait presque comparer à celui de Waterloo, le dénouement excepté. Car, plus de huit ans avant la défaite qui précipita sa chute, Napoélon se retrouve en grande difficulté lors de ce combat et ne doit qu'à une magistrale charge de cavalerie d'éviter un échec retentissant.
Par la suite, Napoléon se montrera mitigé quand à cette victoire ; quant aux Russes, les adversaires du jour, ils continuent à célébrer Eylau comme une de leurs victoires. Bizarrement, on sait assez peu de choses de cette bataille qui paraît si importante, peut-être un tournant pour l'Empereur, et elle ne revient jamais lorsque l'on cite les plus célèbres faits d'arme de cette période.
Kauffmann profitera de l'occasion pour raconter un Napoléon assez loin de l'image qu'on peut avoir de l'Empereur, indécis, dans le doute. Peut-être aussi, puisqu'on parle de tournant, Eylau est-elle également le début du déclin, malgré les nombreux succès qui seront glanés par la suite. Cette victoire qui n'en est pas vraiment une marquera longtemps l'esprit d'un Empereur qui commence à se recroqueviller...
En 2007, à l'occasion des célébrations du bicentenaire de la bataille d'Eylau, Jean-Paul Kauffmann a décidé de tenir une promesse faite une dizaine d'années plus tôt à sa famille : et le voilà donc avec sa femme et ses deux fils en route pour aller assister à ces cérémonies et découvrir enfin ce champ de bataille qui a fini par l'obséder.
Mais, au fait, savez-vous où se trouve Eylau ? Si vous cherchez ce nom sur une carte actuelle, vous pourrez chercher longtemps, la ville porte désormais un tout autre nom : Bagrationovsk. Et l'histoire récente de cette ville est tout aussi importante et intéressante que celle sur laquelle on voudrait se concentrer, celle de la bataille napoléonienne.
En effet, Eylau était en Prusse-Orientale, un territoire qui a toujours été âprement disputé. Comme ce nom l'indique, c'était un territoire germanique jusqu'à la chute des nazis. Les Soviétiques s'en sont alors emparés, et ce n'est pas un hasard : cela leur offrait une ouverture sur la mer Baltique, très importante sur le plan géopolitique.
Mais, lorsque l'URSS s'est effondré à son tour, cette région, l'oblast de Kaliningrad, s'est retrouvée séparée du reste du pays, enclavée entre la Baltique, donc, la Lituanie et la Pologne. Désormais, c'est un territoire russe à l'intérieur de l'Union Européenne et un territoire qui continue à faire grincer des dents, en particulier parce que les Russes ont voulu y imprimer profondément leur marque.
C'est donc à Bagrationovsk que se rendent les Kauffmann, en cet hiver 2007. Pas la meilleure saison pour ce rendre dans ce coin d'Europe, on s'en doute, mais les dates sont les dates. Pour Jean-Paul Kauffmann, c'est une seconde visite sur place. La première datait du début des années 1990, avant qu'il ne s'intéresse à Napoléon, mais peu de temps après la chute d'un autre empire, soviétique, celui-là.
C'est donc l'esprit curieux, avide de découvrir ce territoire désormais russe, mais aussi avec l'ambition d'arpenter le champ de bataille et d'essayer de reconstituer l'événement, de le visualiser. Et puis, avec en tête "le Colonel Chabert", ce court roman d'Honoré de Balzac dont le personnage principal a été laissé pour mort lors de cette bataille avant de sortir de la fosse commune tel un mort-vivant.
Le titre de ce billet est d'ailleurs un passage qui fait directement référence à Chabert, qui rentre chez lui pour découvrir que, non seulement, les siens le croient mort, mais qu'il a été remplacé, effacé, et qui va souffrir mille morts pour essayer de retrouver son identité, son statut, sa fortune, sa famille et n'y parviendra pas (oui, je spoile les classiques, et alors ?).
Comme toujours, dans les livres de Jean-Paul Kauffmann, on croit percevoir quelques éléments, souvent inconscients, je pense, et pourtant assez frappants, qui font écho avec sa propre expérience, ces trois années de captivité au Liban dans les années 1980... Comme Chabert, il est revenu du "Royaume des ombres", même si le cas du journaliste n'est pas tout à fait le même.
Chabert, je le redis, n'est pas seulement un fantôme revenu d'entre les morts, le crâne orné d'une magistrale cicatrice, témoignage de ce qu'il a subi à Eylau. C'est un homme que plus personne n'attendait, qu'on a remplacé, qu'on a oublié... Chabert, c'est celui qui n'existe qu'au passé, comme le dit Kauffmann, qui n'existe plus...
Or, en ce qui concerne le journaliste, la situation est toute autre : jamais on ne l'a oublié, surtout pas les siens, mais toute la France, puisque son visage apparaissait, comme ceux des autres otages français, chaque soir, au moment du JT. Kauffmann a été attendu, longtemps, tellement longtemps, et à son retour, il a pu réintégrer sa place. Sans transiger, ce mot si fort, si important dans le roman de Balzac.
Et pourtant, pour comprendre un tout petit peu la situation d'un Chabert, comment ne pas repenser à cette scène tellement troublante et émouvante, cet homme revenant en France après trois années passées dans les geôles du Hezbollah, posant le pied sur le tarmac et voyant se précipiter vers lui des enfants qu'il ne reconnaît pas...
On retrouve dans "Outre-Terre" toute la pudeur de Jean-Paul Kauffmann pour évoquer ces questions, et même une note d'humour, lorsqu'il évoque son absence prolongée. Mais aussi ce traumatisme toujours présent, sa cicatrice à lui, indélébile sous son crâne et non à l'extérieur comme le colonel du roman...
Indépendamment de ce parallèle, "Outre-Terre" est l'occasion d'apprendre plein de choses sur la genèse de ce roman, sur les origines du personnage de Chabert, qui s'inspire de plusieurs véritables participants à la bataille d'Eylau, mais aussi sur cette fameuse charge de cavalerie qui fit basculer le sort de cette bataille, puisque Chabert survécut protégé par un cheval abattu.
Mais la littérature n'est pas la seule source culturelle évoquée dans le récit de Jean-Paul Kauffmann. On ne peut pas ne pas évoquer le tableau d'Antoine-Jean Gros, "Napoléon sur le champ de bataille d'Eylau, le 9 février 1807", tableau monumental de plus de 5 mètres sur près de 8, qu'on peut voir au musée du Louvre.
Kauffmann retrace l'histoire de ce tableau qui est, bien que peint à Paris, ce qu'on peut considérer comme une fidèle représentation du champ de bataille. Un moyen de se repérer une fois sur place. Sauf qu'en deux siècles, bien des choses ont changé et qu'il est fort délicat de se repérer désormais, afin de reconstituer les faits.
Le point de repère, c'est cette église que l'on aperçoit au fond du tableau. L'église et ce fameux cimetière d'Eylau... L'église, elle est l'un des sujets récurrents d' "Outre-Terre", puisqu'elle aussi a connu les vicissitudes de l'histoire et de la géopolitique. Elle existe toujours, mais n'est plus aussi accessible qu'à l'époque où l'on s'entre-tuait sous ses fenêtres...
Or, pour Kauffmann, elle n'est pas juste une sorte de rose des vents grâce à laquelle on peut reconstituer la position des différents corps d'armée, elle est le lieu qui, par son clocher, permettrait d'embrasser du regard la totalité des lieux. Le journaliste n'a qu'une idée en tête : y monter... Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Un vrai fil conducteur de ce séjour...
Et cette église amènera une troisième référence culturelle, plus étonnante : "Sueurs froides", le film d'Alfred Hitchcock, où tout commence et tout se joue dans un autre clocher d'église... Chose très surprenante, cette idée s'est imposée à Kauffmann par association d'idées, jusqu'à ce qu'il remarque un détail tout à fait troublant, mais il faudra lire le livre pour le savoir (ou être fort perspicace...).
Ce billet n'est guère construit, il essaye simplement d'aborder les uns à la suite des autres les thèmes centraux de ce récit, entre voyage, histoire, littérature et témoignage personnel. Il ne faudrait pas pourtant laisser de côté les personnages rencontrés par l'auteur lors de cette virée au bout de l'hiver. Oui, je dis bien personnages.
Ce sont des êtres de chair et de sang, bien sûr, mais Kauffmann, pour différentes raisons et aussi parce qu'ils sont assez hauts en couleur, en fait presque des personnages sortis d'un roman. Qu'ils soient Russes, s'occupant des célébrations et de la conservation du lieu et des musées attenants, ou qu'ils soient de passage, comme ce Français assez excentrique et déroutant, presque comique...
Oui, ne vous fiez pas au sujet de départ, qui peut sembler terrible et un peu austère. "Outre-Terre" est un formidable voyage, érudit, fascinant, dépaysant, entre passé et présent, entre histoire et littérature, entre réalité et fiction. Avec, planant là, les ombres fantomatiques de tous ceux qui, contrairement à Chabert, ne se sont jamais relevé et ont souillé la neige de Prusse-Orientale de leur sang.
Le 8 février 1807, se déroula la bataille d'Eylau. Un scénario qu'on pourrait presque comparer à celui de Waterloo, le dénouement excepté. Car, plus de huit ans avant la défaite qui précipita sa chute, Napoélon se retrouve en grande difficulté lors de ce combat et ne doit qu'à une magistrale charge de cavalerie d'éviter un échec retentissant.
Par la suite, Napoléon se montrera mitigé quand à cette victoire ; quant aux Russes, les adversaires du jour, ils continuent à célébrer Eylau comme une de leurs victoires. Bizarrement, on sait assez peu de choses de cette bataille qui paraît si importante, peut-être un tournant pour l'Empereur, et elle ne revient jamais lorsque l'on cite les plus célèbres faits d'arme de cette période.
Kauffmann profitera de l'occasion pour raconter un Napoléon assez loin de l'image qu'on peut avoir de l'Empereur, indécis, dans le doute. Peut-être aussi, puisqu'on parle de tournant, Eylau est-elle également le début du déclin, malgré les nombreux succès qui seront glanés par la suite. Cette victoire qui n'en est pas vraiment une marquera longtemps l'esprit d'un Empereur qui commence à se recroqueviller...
En 2007, à l'occasion des célébrations du bicentenaire de la bataille d'Eylau, Jean-Paul Kauffmann a décidé de tenir une promesse faite une dizaine d'années plus tôt à sa famille : et le voilà donc avec sa femme et ses deux fils en route pour aller assister à ces cérémonies et découvrir enfin ce champ de bataille qui a fini par l'obséder.
Mais, au fait, savez-vous où se trouve Eylau ? Si vous cherchez ce nom sur une carte actuelle, vous pourrez chercher longtemps, la ville porte désormais un tout autre nom : Bagrationovsk. Et l'histoire récente de cette ville est tout aussi importante et intéressante que celle sur laquelle on voudrait se concentrer, celle de la bataille napoléonienne.
En effet, Eylau était en Prusse-Orientale, un territoire qui a toujours été âprement disputé. Comme ce nom l'indique, c'était un territoire germanique jusqu'à la chute des nazis. Les Soviétiques s'en sont alors emparés, et ce n'est pas un hasard : cela leur offrait une ouverture sur la mer Baltique, très importante sur le plan géopolitique.
Mais, lorsque l'URSS s'est effondré à son tour, cette région, l'oblast de Kaliningrad, s'est retrouvée séparée du reste du pays, enclavée entre la Baltique, donc, la Lituanie et la Pologne. Désormais, c'est un territoire russe à l'intérieur de l'Union Européenne et un territoire qui continue à faire grincer des dents, en particulier parce que les Russes ont voulu y imprimer profondément leur marque.
C'est donc à Bagrationovsk que se rendent les Kauffmann, en cet hiver 2007. Pas la meilleure saison pour ce rendre dans ce coin d'Europe, on s'en doute, mais les dates sont les dates. Pour Jean-Paul Kauffmann, c'est une seconde visite sur place. La première datait du début des années 1990, avant qu'il ne s'intéresse à Napoléon, mais peu de temps après la chute d'un autre empire, soviétique, celui-là.
C'est donc l'esprit curieux, avide de découvrir ce territoire désormais russe, mais aussi avec l'ambition d'arpenter le champ de bataille et d'essayer de reconstituer l'événement, de le visualiser. Et puis, avec en tête "le Colonel Chabert", ce court roman d'Honoré de Balzac dont le personnage principal a été laissé pour mort lors de cette bataille avant de sortir de la fosse commune tel un mort-vivant.
Le titre de ce billet est d'ailleurs un passage qui fait directement référence à Chabert, qui rentre chez lui pour découvrir que, non seulement, les siens le croient mort, mais qu'il a été remplacé, effacé, et qui va souffrir mille morts pour essayer de retrouver son identité, son statut, sa fortune, sa famille et n'y parviendra pas (oui, je spoile les classiques, et alors ?).
Comme toujours, dans les livres de Jean-Paul Kauffmann, on croit percevoir quelques éléments, souvent inconscients, je pense, et pourtant assez frappants, qui font écho avec sa propre expérience, ces trois années de captivité au Liban dans les années 1980... Comme Chabert, il est revenu du "Royaume des ombres", même si le cas du journaliste n'est pas tout à fait le même.
Chabert, je le redis, n'est pas seulement un fantôme revenu d'entre les morts, le crâne orné d'une magistrale cicatrice, témoignage de ce qu'il a subi à Eylau. C'est un homme que plus personne n'attendait, qu'on a remplacé, qu'on a oublié... Chabert, c'est celui qui n'existe qu'au passé, comme le dit Kauffmann, qui n'existe plus...
Or, en ce qui concerne le journaliste, la situation est toute autre : jamais on ne l'a oublié, surtout pas les siens, mais toute la France, puisque son visage apparaissait, comme ceux des autres otages français, chaque soir, au moment du JT. Kauffmann a été attendu, longtemps, tellement longtemps, et à son retour, il a pu réintégrer sa place. Sans transiger, ce mot si fort, si important dans le roman de Balzac.
Et pourtant, pour comprendre un tout petit peu la situation d'un Chabert, comment ne pas repenser à cette scène tellement troublante et émouvante, cet homme revenant en France après trois années passées dans les geôles du Hezbollah, posant le pied sur le tarmac et voyant se précipiter vers lui des enfants qu'il ne reconnaît pas...
On retrouve dans "Outre-Terre" toute la pudeur de Jean-Paul Kauffmann pour évoquer ces questions, et même une note d'humour, lorsqu'il évoque son absence prolongée. Mais aussi ce traumatisme toujours présent, sa cicatrice à lui, indélébile sous son crâne et non à l'extérieur comme le colonel du roman...
Indépendamment de ce parallèle, "Outre-Terre" est l'occasion d'apprendre plein de choses sur la genèse de ce roman, sur les origines du personnage de Chabert, qui s'inspire de plusieurs véritables participants à la bataille d'Eylau, mais aussi sur cette fameuse charge de cavalerie qui fit basculer le sort de cette bataille, puisque Chabert survécut protégé par un cheval abattu.
Mais la littérature n'est pas la seule source culturelle évoquée dans le récit de Jean-Paul Kauffmann. On ne peut pas ne pas évoquer le tableau d'Antoine-Jean Gros, "Napoléon sur le champ de bataille d'Eylau, le 9 février 1807", tableau monumental de plus de 5 mètres sur près de 8, qu'on peut voir au musée du Louvre.
Kauffmann retrace l'histoire de ce tableau qui est, bien que peint à Paris, ce qu'on peut considérer comme une fidèle représentation du champ de bataille. Un moyen de se repérer une fois sur place. Sauf qu'en deux siècles, bien des choses ont changé et qu'il est fort délicat de se repérer désormais, afin de reconstituer les faits.
Le point de repère, c'est cette église que l'on aperçoit au fond du tableau. L'église et ce fameux cimetière d'Eylau... L'église, elle est l'un des sujets récurrents d' "Outre-Terre", puisqu'elle aussi a connu les vicissitudes de l'histoire et de la géopolitique. Elle existe toujours, mais n'est plus aussi accessible qu'à l'époque où l'on s'entre-tuait sous ses fenêtres...
Or, pour Kauffmann, elle n'est pas juste une sorte de rose des vents grâce à laquelle on peut reconstituer la position des différents corps d'armée, elle est le lieu qui, par son clocher, permettrait d'embrasser du regard la totalité des lieux. Le journaliste n'a qu'une idée en tête : y monter... Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Un vrai fil conducteur de ce séjour...
Et cette église amènera une troisième référence culturelle, plus étonnante : "Sueurs froides", le film d'Alfred Hitchcock, où tout commence et tout se joue dans un autre clocher d'église... Chose très surprenante, cette idée s'est imposée à Kauffmann par association d'idées, jusqu'à ce qu'il remarque un détail tout à fait troublant, mais il faudra lire le livre pour le savoir (ou être fort perspicace...).
Ce billet n'est guère construit, il essaye simplement d'aborder les uns à la suite des autres les thèmes centraux de ce récit, entre voyage, histoire, littérature et témoignage personnel. Il ne faudrait pas pourtant laisser de côté les personnages rencontrés par l'auteur lors de cette virée au bout de l'hiver. Oui, je dis bien personnages.
Ce sont des êtres de chair et de sang, bien sûr, mais Kauffmann, pour différentes raisons et aussi parce qu'ils sont assez hauts en couleur, en fait presque des personnages sortis d'un roman. Qu'ils soient Russes, s'occupant des célébrations et de la conservation du lieu et des musées attenants, ou qu'ils soient de passage, comme ce Français assez excentrique et déroutant, presque comique...
Oui, ne vous fiez pas au sujet de départ, qui peut sembler terrible et un peu austère. "Outre-Terre" est un formidable voyage, érudit, fascinant, dépaysant, entre passé et présent, entre histoire et littérature, entre réalité et fiction. Avec, planant là, les ombres fantomatiques de tous ceux qui, contrairement à Chabert, ne se sont jamais relevé et ont souillé la neige de Prusse-Orientale de leur sang.
lundi 17 avril 2017
"Au lieu de lire tes stupides magazines, tu devrais relire tes classiques. Tout notre malheur, y compris le tien, est annoncé dans Sophocle, Shakespeare, Flaubert, Tolstoï".
Encore une relecture d'un classique, mais cette fois, on va carrément remonter à l'Antiquité. Enfin, relecture, le mot n'est peut-être pas tout à fait juste, car entre notre roman du jour et l'Electre de Sophocle, qui en est l'inspiration, il y a pas mal de différences, tout du moins dans la construction, puisque le point de départ de la tragédie arrive assez loin. Vous verrez que j'ai une lecture assez spéciale de "Electre 21", second roman de Romel, publié aux éditions Daphnis et Chloé. Mais, je ne vais pas dévoiler tout de suite mes batteries, il va vous falloir lire la suite de ce billet pour vous faire une idée, hé, hé... En attendant, bienvenue dans la famille Malo, dans laquelle on trouve peu de saints (ah, ah, ah...), aussi puissante que désunie et malheureuse. Une magnifique illustration de l'adage qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais aussi une réflexion sur la famille et ce que cela représente. Un peu à l'image des "Enfants perdus", évoqués récemment, on se concentre sur les étranges relations entre parents et enfants, dans une société du tout numérique assez inquiétante...
Gratien Malo est un homme puissant. Fondateur et dirigeant de GlobalTrotter, un des leaders mondiaux du numérique, il est à la tête d'un empire financier qui possède plus de poids et d'autorité que bien des gouvernements dans le monde. Un acteur incontournable sur les plans économique et politique qu'il convient de ménager, sous peine de gros soucis.
Mais, Gratien Malo ne vit pas tout à fait dans une tour d'ivoire. En tout cas, il conserve quelques habitudes qui effraient les personnes en charge de sa sécurité. Comme, par exemple, aller chiner aux puces de Saint-Ouen, à la recherche de trésors cachés. Et quand je parle de trésors, ce n'est pas au sens figuré : il a l'oeil (et les contacts) pour, de temps en temps, mettre la main sur une perle.
Et justement, en ce début novembre 2020, c'est tout frétillant qu'il revient des puces, persuadés d'avoir mis au jour l'existence d'un de ces trésors. Je n'en dis pas plus, mais la recherche de cette oeuvre est l'un des fils conducteurs du roman. Plus qu'une marotte, cette quête (pourtant déléguée à d'autres, en l'occurrence, son homme de confiance, Virgil) apparaît comme une raison de vivre.
Car Gratien Malo a beau être un homme immensément riche et puissant, difficile de dire s'il est heureux. Derrière la façade de respectabilité et le luxe quotidien, on découvre que la famille Malo part à vau-l'eau depuis un moment et que la pression, sans cesse croissante, menace de plus en plus de la faire imploser.
Amélie-Solène, l'épouse de Gratien, le hait de toutes ses forces, de toutes son âme, et n'attend qu'une chose : devenir le calife de GlobalTrotter à la place du calife, et ce, par tous les moyens. Elle couche avec Sigismond Juphrénal, amant et âme damné qui partage ses ambitions, ses désirs et son absence de scrupule, guettant le moment propice pour se débarrasser de Gratien et faire main basse sur l'empire.
Malgré leur désamour, Gratien et Amélie-Solène ont eu quatre enfants. Et, là encore, on ne peut pas dire que ce soit une réussite... Eugénie est morte d'anorexie quelques années plus tôt, Baudoin, le fils, le dauphin, a subitement disparu sans laisser de trace et l'on ne sait même pas s'il est encore en vie. Deux pertes que vivent très mal Ludovine et Clothilde, les deux autres soeurs.
Deux demoiselles qui affrontent ces tempêtes très différemment : Clothilde, la timide, se renferme et fait le dos rond ; Ludovine, au caractère plus affirmé, mais également plus proche de son père, nourrit une haine farouche envers sa mère. Des sentiments réciproques qui dépassent le simple mépris : entre elles, la guerre est ouverte et ne fait que commencer.
Pour le moment, Gratien semble maîtriser la situation avec une impressionnante sérénité, sans être dupe de ce qui se trame chez lui. Mais qu'adviendrait-il s'il venait à disparaître... plus ou moins accidentellement ? C'est évidemment l'enjeu de cette histoire, l'événement qui mettrait en branle l'inévitable tragédie. Mais c'est à vous de le découvrir...
Première chose, avant tout, Romel, dont la brève biographie en quatrième de couverture nous dit qu'il a bien connu le monde des affaires et les coulisses des gouvernement avant de se lancer en écriture, signe avec "Electre 21" une relecture assez particulière de la tragédie de Sophocle et du mythe de cette héroïne antique.
Dans sa version, c'est Ludovine qui reprend le flambeau. Pour le reste, évidemment, je vous engage, si vous ne connaissez pas l'histoire originelle, à aller y jeter un oeil, avant ou après la lecture du roman. Un livre qui s'ouvre d'ailleurs sur la distribution des rôles, qui permet de ne pas se perdre et de faire les parallèles nécessaires.
"Electre 21", comme tout ce qui s'inspire de la mythologie, c'est "Dallas" puissance 1000. Sans doute parce que nos aïeux grecs avaient un sens de la transgression nettement plus développé que celui de nos prudes cousins d'Amérique... Ici, au sein de la famille Malo, on ne recule devant rien pour arriver à ses fins, y compris tuer, sans aucun état d'âme.
Pouvoir, haines, ambitions, vengeances, tout est là, dans ce roman, comme dans la tragédie antique. Avec un coup de projecteur particulier sur l'absolue détestation de Ludovine/Electre pour sa mère, et réciproquement, d'ailleurs, qui pourrait nous rapprocher de la vision du mythe par Jean Giraudoux (souvenirs lointains de collège, cette tragédie plus contemporaine)...
Chacun a ses vilains petits secrets, chez les Malo. Particulièrement les parents. Les enfants, eux, ne sont que les jouets du destin qui les a fait naître dans un milieu privilégié, certes, mais beaucoup moins prodigue lorsqu'il s'agit d'amour. La mort d'Eugénie et la disparition de Baudouin ont été de lourds tributs payés aux rancunes familiales et leur poids écrase Ludovine et Clothilde un peu plus chaque jour.
Lorsque l'on rencontre les Malo, on comprend vite que la cote d'alerte est atteinte et que le compte à rebours vers l'explosion est lancé. Parce que mère et fille sont au bord de la rupture, Ludovine se posant en incarnation de l'héritière, position laissée vacante par Baudouin, face à Amélie-Solène qui se moque comme de sa première chemise de la famille, aveuglée par sa soif de pouvoir.
Mais, contrairement à ses devanciers, Romel n'aborde pas du tout son histoire sous l'angle classique de la tragédie. On a plutôt l'impression de se retrouver dans une comédie de moeurs, presque dans un vaudeville. A tel point qu'on peut se dire qu'il force franchement le trait, risquant de tomber dans la caricature.
Rien que les prénoms des personnages (et encore, en les appelant Malo, on nous épargne un nom à particule et à rallonge qui eût pu tout à fait se fondre dans le décor) donnent le ton et laisse présager un roman un peu "too much". Je suis passé par là, avant d'envisager ce livre sous un autre angle, qui me plaît bien et m'amuse assez.
Suspense, roulements de tambour...
Et si "Electre 21" n'était pas seulement un clin d'oeil à Sophocle ou Giraudoux, mais... une version du mythe à la Offenbach ? Eh oui, le roman de Romel est un livret pour un opéra bouffe où ne manque que les cancans et les airs que tout le monde finira par connaître. Et d'ailleurs, Gratien n'est autre que le roi bar-bu qui s'avance, bu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon !
D'un seul coup, envisagée sous ce prisme, avec ce soupçon d'ironie qui va bien, cette lecture a pris une nouvelle saveur et je me suis bien amusé, même si tout cela manque par moment un peu de profondeur, en particulier dans la caractérisation des personnages. Mais, ça va barder chez les Malo, vous l'imaginez bien, dans une atmosphère tout de même bien moins légère que chez Offenbach, dans la deuxième partie.
Reste un point dont il faut parler avant de refermer ce billet : le choix de l'époque, 2020, mais surtout du contexte, l'ère du tout numérique. GlobalTrotter, la société de Gratien Malo, est une hydre mondiale, touchant à tous les domaines, aux quatre coins du monde, ayant réponse à tout et capable de s'adapter à la vitesse des autoroutes de l'information.
Bien sûr, il y a énormément d'avantage à ce progrès technique fou. Mais, il y a aussi tout un tas de zones d'ombre et de potentialités qui font froid dans le dos. Dans "Electre 21", Gratien semble être un dirigeant éclairé, tant dans la gestion de son entreprise que dans les limites qu'il fixe à son activité. En revanche, on se dit que Amélie-Solène et Sigismond n'auront pas tant de scrupule...
Prêts à tout pour faire de l'argent, encore plus d'argent, aux dépens de la morale et de la liberté. Mais, plus encore que le couple adultère, il y a un personnage secondaire qui incarne parfaitement ces inquiétudes quant au développement sans tabou des industries 2 voire 3.0. Il s'appelle Anant Lux et son infini pouvoir transparaît à plusieurs reprises, à la fois flippant et terriblement séduisant.
J'évoque ce personnage parce qu'il est une parfaite allégorie de l'ère numérique, entre progrès et tyrannie, entre liberté et contrôle des esprits... Ce n'est sans doute pas un hasard si, derrière Anant Lux, se cache Hadès, le dieu des enfers, à qui il ne serait certainement pas raisonnable de laisser un peu trop de terrain...
Voilà, j'en ai fini avec une lecture que l'on pourra qualifier de légère, malgré les sujets graves qu'on y trouve. Sophocle ou Giraudoux auront plus de poids, c'est certain, mais cette idée d'opéra bouffe me plaît vraiment et pourrait offrir un spectacle tout à fait étonnant. J'espère que l'idée saura faire sourire Romel, dont le premier roman parlait de musique.
Gratien Malo est un homme puissant. Fondateur et dirigeant de GlobalTrotter, un des leaders mondiaux du numérique, il est à la tête d'un empire financier qui possède plus de poids et d'autorité que bien des gouvernements dans le monde. Un acteur incontournable sur les plans économique et politique qu'il convient de ménager, sous peine de gros soucis.
Mais, Gratien Malo ne vit pas tout à fait dans une tour d'ivoire. En tout cas, il conserve quelques habitudes qui effraient les personnes en charge de sa sécurité. Comme, par exemple, aller chiner aux puces de Saint-Ouen, à la recherche de trésors cachés. Et quand je parle de trésors, ce n'est pas au sens figuré : il a l'oeil (et les contacts) pour, de temps en temps, mettre la main sur une perle.
Et justement, en ce début novembre 2020, c'est tout frétillant qu'il revient des puces, persuadés d'avoir mis au jour l'existence d'un de ces trésors. Je n'en dis pas plus, mais la recherche de cette oeuvre est l'un des fils conducteurs du roman. Plus qu'une marotte, cette quête (pourtant déléguée à d'autres, en l'occurrence, son homme de confiance, Virgil) apparaît comme une raison de vivre.
Car Gratien Malo a beau être un homme immensément riche et puissant, difficile de dire s'il est heureux. Derrière la façade de respectabilité et le luxe quotidien, on découvre que la famille Malo part à vau-l'eau depuis un moment et que la pression, sans cesse croissante, menace de plus en plus de la faire imploser.
Amélie-Solène, l'épouse de Gratien, le hait de toutes ses forces, de toutes son âme, et n'attend qu'une chose : devenir le calife de GlobalTrotter à la place du calife, et ce, par tous les moyens. Elle couche avec Sigismond Juphrénal, amant et âme damné qui partage ses ambitions, ses désirs et son absence de scrupule, guettant le moment propice pour se débarrasser de Gratien et faire main basse sur l'empire.
Malgré leur désamour, Gratien et Amélie-Solène ont eu quatre enfants. Et, là encore, on ne peut pas dire que ce soit une réussite... Eugénie est morte d'anorexie quelques années plus tôt, Baudoin, le fils, le dauphin, a subitement disparu sans laisser de trace et l'on ne sait même pas s'il est encore en vie. Deux pertes que vivent très mal Ludovine et Clothilde, les deux autres soeurs.
Deux demoiselles qui affrontent ces tempêtes très différemment : Clothilde, la timide, se renferme et fait le dos rond ; Ludovine, au caractère plus affirmé, mais également plus proche de son père, nourrit une haine farouche envers sa mère. Des sentiments réciproques qui dépassent le simple mépris : entre elles, la guerre est ouverte et ne fait que commencer.
Pour le moment, Gratien semble maîtriser la situation avec une impressionnante sérénité, sans être dupe de ce qui se trame chez lui. Mais qu'adviendrait-il s'il venait à disparaître... plus ou moins accidentellement ? C'est évidemment l'enjeu de cette histoire, l'événement qui mettrait en branle l'inévitable tragédie. Mais c'est à vous de le découvrir...
Première chose, avant tout, Romel, dont la brève biographie en quatrième de couverture nous dit qu'il a bien connu le monde des affaires et les coulisses des gouvernement avant de se lancer en écriture, signe avec "Electre 21" une relecture assez particulière de la tragédie de Sophocle et du mythe de cette héroïne antique.
Dans sa version, c'est Ludovine qui reprend le flambeau. Pour le reste, évidemment, je vous engage, si vous ne connaissez pas l'histoire originelle, à aller y jeter un oeil, avant ou après la lecture du roman. Un livre qui s'ouvre d'ailleurs sur la distribution des rôles, qui permet de ne pas se perdre et de faire les parallèles nécessaires.
"Electre 21", comme tout ce qui s'inspire de la mythologie, c'est "Dallas" puissance 1000. Sans doute parce que nos aïeux grecs avaient un sens de la transgression nettement plus développé que celui de nos prudes cousins d'Amérique... Ici, au sein de la famille Malo, on ne recule devant rien pour arriver à ses fins, y compris tuer, sans aucun état d'âme.
Pouvoir, haines, ambitions, vengeances, tout est là, dans ce roman, comme dans la tragédie antique. Avec un coup de projecteur particulier sur l'absolue détestation de Ludovine/Electre pour sa mère, et réciproquement, d'ailleurs, qui pourrait nous rapprocher de la vision du mythe par Jean Giraudoux (souvenirs lointains de collège, cette tragédie plus contemporaine)...
Chacun a ses vilains petits secrets, chez les Malo. Particulièrement les parents. Les enfants, eux, ne sont que les jouets du destin qui les a fait naître dans un milieu privilégié, certes, mais beaucoup moins prodigue lorsqu'il s'agit d'amour. La mort d'Eugénie et la disparition de Baudouin ont été de lourds tributs payés aux rancunes familiales et leur poids écrase Ludovine et Clothilde un peu plus chaque jour.
Lorsque l'on rencontre les Malo, on comprend vite que la cote d'alerte est atteinte et que le compte à rebours vers l'explosion est lancé. Parce que mère et fille sont au bord de la rupture, Ludovine se posant en incarnation de l'héritière, position laissée vacante par Baudouin, face à Amélie-Solène qui se moque comme de sa première chemise de la famille, aveuglée par sa soif de pouvoir.
Mais, contrairement à ses devanciers, Romel n'aborde pas du tout son histoire sous l'angle classique de la tragédie. On a plutôt l'impression de se retrouver dans une comédie de moeurs, presque dans un vaudeville. A tel point qu'on peut se dire qu'il force franchement le trait, risquant de tomber dans la caricature.
Rien que les prénoms des personnages (et encore, en les appelant Malo, on nous épargne un nom à particule et à rallonge qui eût pu tout à fait se fondre dans le décor) donnent le ton et laisse présager un roman un peu "too much". Je suis passé par là, avant d'envisager ce livre sous un autre angle, qui me plaît bien et m'amuse assez.
Suspense, roulements de tambour...
Et si "Electre 21" n'était pas seulement un clin d'oeil à Sophocle ou Giraudoux, mais... une version du mythe à la Offenbach ? Eh oui, le roman de Romel est un livret pour un opéra bouffe où ne manque que les cancans et les airs que tout le monde finira par connaître. Et d'ailleurs, Gratien n'est autre que le roi bar-bu qui s'avance, bu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon !
D'un seul coup, envisagée sous ce prisme, avec ce soupçon d'ironie qui va bien, cette lecture a pris une nouvelle saveur et je me suis bien amusé, même si tout cela manque par moment un peu de profondeur, en particulier dans la caractérisation des personnages. Mais, ça va barder chez les Malo, vous l'imaginez bien, dans une atmosphère tout de même bien moins légère que chez Offenbach, dans la deuxième partie.
Reste un point dont il faut parler avant de refermer ce billet : le choix de l'époque, 2020, mais surtout du contexte, l'ère du tout numérique. GlobalTrotter, la société de Gratien Malo, est une hydre mondiale, touchant à tous les domaines, aux quatre coins du monde, ayant réponse à tout et capable de s'adapter à la vitesse des autoroutes de l'information.
Bien sûr, il y a énormément d'avantage à ce progrès technique fou. Mais, il y a aussi tout un tas de zones d'ombre et de potentialités qui font froid dans le dos. Dans "Electre 21", Gratien semble être un dirigeant éclairé, tant dans la gestion de son entreprise que dans les limites qu'il fixe à son activité. En revanche, on se dit que Amélie-Solène et Sigismond n'auront pas tant de scrupule...
Prêts à tout pour faire de l'argent, encore plus d'argent, aux dépens de la morale et de la liberté. Mais, plus encore que le couple adultère, il y a un personnage secondaire qui incarne parfaitement ces inquiétudes quant au développement sans tabou des industries 2 voire 3.0. Il s'appelle Anant Lux et son infini pouvoir transparaît à plusieurs reprises, à la fois flippant et terriblement séduisant.
J'évoque ce personnage parce qu'il est une parfaite allégorie de l'ère numérique, entre progrès et tyrannie, entre liberté et contrôle des esprits... Ce n'est sans doute pas un hasard si, derrière Anant Lux, se cache Hadès, le dieu des enfers, à qui il ne serait certainement pas raisonnable de laisser un peu trop de terrain...
Voilà, j'en ai fini avec une lecture que l'on pourra qualifier de légère, malgré les sujets graves qu'on y trouve. Sophocle ou Giraudoux auront plus de poids, c'est certain, mais cette idée d'opéra bouffe me plaît vraiment et pourrait offrir un spectacle tout à fait étonnant. J'espère que l'idée saura faire sourire Romel, dont le premier roman parlait de musique.
dimanche 16 avril 2017
"Les enfants commencent par aimer leurs parents ; en avançant en âge, ils les jugent ; il leur arrive de leur pardonner" (Oscar Wilde).
Encore Wilde, toujours "le portrait de Dorian Gray", mais le roman dont nous allons parler cet après-midi n'a rien à voir avec le "Jugan" de Jérôme Leroy. En fait, ce n'est pas le choix de l'oeuvre qui a motivé le choix de cette citation, mais bien son fond, son sens profond, qui me paraît coller parfaitement avec "les Enfants perdus", deuxième roman de François Hauter (publié aux éditions du Rocher). Tout n'est pas parfait dans ce livre, on y reviendra, mais l'histoire m'a touchée par différents aspects, et particulièrement parce que, comme chantait le poète, "on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille". On pourrait ajouter qu'on ne choisit pas les trottoirs de Strasbourg, de Hong Kong ou Port-au-Prince pour apprendre à marcher. Bref, "les Enfants perdus", ce sont les parcours de trois parents aux destins bien différents et de leurs relations souvent compliquées avec leur progéniture. Parce que, souvent, ce qu'il y a de meilleur en l'homme, ce sont ses enfants (oui, je clichetonne aussi un peu à mes heures perdues...).
Stanislas vit en Alsace où il gère une prospère entreprise familiale. Grand bourgeois aux méthodes paternalistes, il gère ses sociétés en bon père de famille, comme le veut l'expression consacrée. Et ça fonctionne bien, les résultats sont là, Stanislas vit dans l'aisance, sans véritable souci du lendemain. Sa seule inquiétude, en fait, vient de son fils, Alexandre.
Voilà trois mois qu'il n'a plus donné signe de vie. Parti pour faire le tour du monde, il s'est soudainement volatilisé, cessant de donner de ses nouvelles à son père. Quand ces nouvelles arrivent, de la bouche d'un certain Kevin, un ami d'Alexandre qui ressemble plus à un SDF ou un routard qu'aux habituelles fréquentations de son fils, elles sont pour le moins contrastées.
Oui, Alexandre est vivant, il est en Australie, mais... Mais, il est recherché là-bas par toutes les polices du pays. Un fugitif ! Un délinquant ! Avec le risque de se retrouver dans la ligne de mire d'un cow-boy en uniforme... Pour Stanislas, l'idée est insupportable, et le chef d'entreprise décide de quitter son confortable cocon alsacien pour se rendre à l'autre bout du monde afin de rechercher son fils.
Bienaimé est Haïtien et vit dans un village extrêmement pauvre. Si pauvre qu'il s'inquiète de ne pouvoir envoyer sa fille à l'école et lui donner l'éducation qu'elle mérite. Alors, il décide d'aller chercher fortune à la capitale, Port-au-Prince. Enorme désillusion quand il arrive sur place : la grande ville n'est pas en meilleur état que son humble village et l'idée d'y faire fortune se dissipe illico.
Engagé dans une ONG occidentale, Bienaimé réussit pourtant à rassembler un petit pécule. Une somme rondelette, vite dilapidée au retour au village. Car tous les habitants ont des besoins et Bienaimé a un grand coeur... Alors, en quelques jours, l'argent pour sa fille a disparu et Bienaimé est revenu à la case départ, sans toucher les 20 000 francs (oui, je suis vieux).
Alors, il décide de repartir. Mais pas pour Port-au-Prince, pas pour refaire le brancardier pour MSF. Non, il a entendu parler d'un eldorado où, il n'en doute pas une seconde, il amassera assez d'argent pour aider sa fille. Et il entend s'enrôler au plus vite pour ce paradis sur terre, un endroit qu'on appelle... Qatar. Là-bas, le travail sur les chantiers est rémunéré grassement, lui a-t-on dit.
Rose vit à Hong Kong. Partie de rien, elle a su s'élever au sommet d'un groupe multinational qui brasse des milliards et qu'elle dirige d'une poigne de fer. Elle engrange des sommes colossales, mais surtout elle exerce un pouvoir formidable, fruit d'un travail acharné. Elle est l'une des femmes les plus influentes au monde, elle le sait, elle en profite et elle est prête à tout pour que cela continue.
Et puis, brusquement, la machine se grippe... La voilà embarquée dans des luttes intestines qui en font la proie d'ambitieux et non plus celle qui domine les autres. Et c'est à cette période critique qu'une autre mauvaise nouvelle lui parvient : sa fille, Jade, a été arrêtée en possession de drogue en Thaïlande et risque une très lourde peine de prison, peut-être pire...
L'inflexible, l'impitoyable Rose se retrouve face à un dilemme : sauver sa brillante carrière ou sauver sa fille unique. Même si cela s'annonce compliqué, elle se prépare à mener de front ces deux combats et ne doute pas de parvenir à ses fins. Elle a le pouvoir, elle a l'argent, elle ne peut pas échouer. C'est impensable.
Trois destins très différents qui sont au coeur du roman. Trois personnalités très différentes que le hasard (?) va se charger de mettre en contact. Trois manières d'envisager son rôle de parent et la relation avec son enfant. Pour le reste, c'est à vous, lecteurs, si vous le souhaitez, de découvrir comment Stanislas, Bienaimé et Rose (ordre d'apparition dans le livre) vont gérer ces situations.
Je vois une fable, dans ce roman. Une fable assez cruelle, d'ailleurs, car nos personnages sont bien malmenés, chacun à leur façon. Le bémol que je mettrais, c'est qu'à force de vouloir faire de ces personnages des archétypes, il arrive qu'ils basculent dans la caricature et le cliché (à l'image de la soeur de Stanislas).
Dommage, car je ne crois pas qu'on ait besoin de forcer le trait. Des Stanislas et des Rose, il en existe, c'est évident. Des personnes qui ont tous sacrifié à la réussite matérielle et perdu le sens des réalités, du quotidien et des relations humaines les plus basiques. D'ailleurs, on distingue bien Stanislas et Rose qui, tout en étant représentant des classes dominantes sont très différents l'un de l'autre.
Elle n'aime personne, c'est elle qui le dit, sa maternité est une sorte de caprice, quand, au contraire, Stanislas est un père qui a élevé son fils dans un esprit dynastique, attendant de lui qu'il reprenne un jour le flambeau de l'entreprise familiale et pérennise son nom. Mais, dans les deux cas, c'est vrai que le lien filial passe au second plan.
Dans le même ordre d'idée, le personnage de Bienaimé est un peu trop candide pour être vrai, même si l'on peut comprendre que cela colle avec le rôle qui lui est attribué, celui du binôme idéal dans un buddy movie. Il est sympathique et plein de vie quoi qu'il lui arrive (et il lui en arrive des vertes et des pas mûres), mais comme les deux autres, on n'a pas l'impression qu'il soit en phase avec la réalité.
Voilà aussi pourquoi je veux voir une fable dans ce roman, qui pourrait être, à quelques retouches près, un scénario parfait pour une Coline Serreau, par exemple, histoire d'aller gratter là où ça fait mal. Mais, "les Enfants perdus" n'est pas qu'une satire de ces riches déconnectés du monde et simplement obsédés par leur statut social, leur position dominante ou leur compte en banque.
Non, il y a une vraie réflexion moraliste (pas moralisatrice, attention) dans tout cela à travers la question parentale : qu'est-on prêt à faire pour son enfant, la chair de sa chair ? Et que peut-on apprendre de ses enfants, également ? Et là, évidemment, les parcours des personnages seront très différents, les dénouements également.
Le bémol exprimé est de taille, mais pour autant, j'ai apprécié la lecture de ce roman par les réflexions qu'il permet sur l'humain dans une société qui a une fâcheuse tendance à le considérer au second plan (et, si c'est vrai dans le cadre d'un capitalisme outrancier, ce n'est pas le seul type de société qui en arrive à cette situation dommageable).
C'est bien cela, le thème central des "Enfants perdus" : l'humain. L'essentiel, ce qui devrait passer avant tout le reste, avant cette définition en trompe-l'oeil qu'on nous impose de la réussite, phénomène limité à ses dimensions strictement matérielles. Oui, la quête qui est au coeur de cette, de ces histoires, c'est bien celle-là, une quête d'humanité.
On pourrait aussi faire une remarque sur le titre : "les Enfants perdus". On pense à Peter Pan, à ces enfants qui atterrissent au pays imaginaire et y demeurent lorsque leurs parents ne les réclament pas. L'analogie, avec le recul, n'est pas inintéressante, et sans doute finalement assez juste. Mais ce n'est pas tout à fait là que je veux en venir.
En fait, ce roman aurait pu (devrait ?) s'intituler "les Parents perdus", car c'est vraiment ce dont on va se rendre compte au fil des chapitres (des chapitres toujours très courts, qu'on enchaîne rapidement, volant d'un des personnages centraux à l'autre). Oui, ils sont perdus, incapables d'assumer ce rôle de parents, totalement immatures.
François Hauter observe Stanislas et Rosa rattrapés par cette responsabilité qu'ils avaient, plus ou moins sciemment, mise de côté. Il décortique leurs réactions, leurs attitudes, leurs décisions, leur évolution, également, car on ne peut pas rester inerte dans ces circonstances. Fendre l'armure et mettre de l'émotion dans des existences qui ont tendance à bannir tout cela, parce qu'inutile...
En face, je ne vais pas parler des enfants, Alexandre et Jade, car, évidemment, toute l'histoire repose sur ce qu'il leur arrive, mais, à leur façon, ils vont donner de fortes leçons à leurs parents respectifs. C'est l'enjeu de ce livre, on le comprend bien avant la fin, d'ailleurs. Parce que la relation entre parents et enfants ne peut être unilatérale.
Parce qu'une fois grands, les enfants jugent les parents, oui, Oscar Wilde a absolument raison. Et les jugent à travers le prisme de ce qu'ils sont devenus (je parle des enfants), de leur capacité à vivre plus ou moins heureux, ou ce qui s'en rapproche le plus... Quant à pardonner, eh bien, lisez "les Enfants perdus", pour savoir si cela peut arriver...
Stanislas vit en Alsace où il gère une prospère entreprise familiale. Grand bourgeois aux méthodes paternalistes, il gère ses sociétés en bon père de famille, comme le veut l'expression consacrée. Et ça fonctionne bien, les résultats sont là, Stanislas vit dans l'aisance, sans véritable souci du lendemain. Sa seule inquiétude, en fait, vient de son fils, Alexandre.
Voilà trois mois qu'il n'a plus donné signe de vie. Parti pour faire le tour du monde, il s'est soudainement volatilisé, cessant de donner de ses nouvelles à son père. Quand ces nouvelles arrivent, de la bouche d'un certain Kevin, un ami d'Alexandre qui ressemble plus à un SDF ou un routard qu'aux habituelles fréquentations de son fils, elles sont pour le moins contrastées.
Oui, Alexandre est vivant, il est en Australie, mais... Mais, il est recherché là-bas par toutes les polices du pays. Un fugitif ! Un délinquant ! Avec le risque de se retrouver dans la ligne de mire d'un cow-boy en uniforme... Pour Stanislas, l'idée est insupportable, et le chef d'entreprise décide de quitter son confortable cocon alsacien pour se rendre à l'autre bout du monde afin de rechercher son fils.
Bienaimé est Haïtien et vit dans un village extrêmement pauvre. Si pauvre qu'il s'inquiète de ne pouvoir envoyer sa fille à l'école et lui donner l'éducation qu'elle mérite. Alors, il décide d'aller chercher fortune à la capitale, Port-au-Prince. Enorme désillusion quand il arrive sur place : la grande ville n'est pas en meilleur état que son humble village et l'idée d'y faire fortune se dissipe illico.
Engagé dans une ONG occidentale, Bienaimé réussit pourtant à rassembler un petit pécule. Une somme rondelette, vite dilapidée au retour au village. Car tous les habitants ont des besoins et Bienaimé a un grand coeur... Alors, en quelques jours, l'argent pour sa fille a disparu et Bienaimé est revenu à la case départ, sans toucher les 20 000 francs (oui, je suis vieux).
Alors, il décide de repartir. Mais pas pour Port-au-Prince, pas pour refaire le brancardier pour MSF. Non, il a entendu parler d'un eldorado où, il n'en doute pas une seconde, il amassera assez d'argent pour aider sa fille. Et il entend s'enrôler au plus vite pour ce paradis sur terre, un endroit qu'on appelle... Qatar. Là-bas, le travail sur les chantiers est rémunéré grassement, lui a-t-on dit.
Rose vit à Hong Kong. Partie de rien, elle a su s'élever au sommet d'un groupe multinational qui brasse des milliards et qu'elle dirige d'une poigne de fer. Elle engrange des sommes colossales, mais surtout elle exerce un pouvoir formidable, fruit d'un travail acharné. Elle est l'une des femmes les plus influentes au monde, elle le sait, elle en profite et elle est prête à tout pour que cela continue.
Et puis, brusquement, la machine se grippe... La voilà embarquée dans des luttes intestines qui en font la proie d'ambitieux et non plus celle qui domine les autres. Et c'est à cette période critique qu'une autre mauvaise nouvelle lui parvient : sa fille, Jade, a été arrêtée en possession de drogue en Thaïlande et risque une très lourde peine de prison, peut-être pire...
L'inflexible, l'impitoyable Rose se retrouve face à un dilemme : sauver sa brillante carrière ou sauver sa fille unique. Même si cela s'annonce compliqué, elle se prépare à mener de front ces deux combats et ne doute pas de parvenir à ses fins. Elle a le pouvoir, elle a l'argent, elle ne peut pas échouer. C'est impensable.
Trois destins très différents qui sont au coeur du roman. Trois personnalités très différentes que le hasard (?) va se charger de mettre en contact. Trois manières d'envisager son rôle de parent et la relation avec son enfant. Pour le reste, c'est à vous, lecteurs, si vous le souhaitez, de découvrir comment Stanislas, Bienaimé et Rose (ordre d'apparition dans le livre) vont gérer ces situations.
Je vois une fable, dans ce roman. Une fable assez cruelle, d'ailleurs, car nos personnages sont bien malmenés, chacun à leur façon. Le bémol que je mettrais, c'est qu'à force de vouloir faire de ces personnages des archétypes, il arrive qu'ils basculent dans la caricature et le cliché (à l'image de la soeur de Stanislas).
Dommage, car je ne crois pas qu'on ait besoin de forcer le trait. Des Stanislas et des Rose, il en existe, c'est évident. Des personnes qui ont tous sacrifié à la réussite matérielle et perdu le sens des réalités, du quotidien et des relations humaines les plus basiques. D'ailleurs, on distingue bien Stanislas et Rose qui, tout en étant représentant des classes dominantes sont très différents l'un de l'autre.
Elle n'aime personne, c'est elle qui le dit, sa maternité est une sorte de caprice, quand, au contraire, Stanislas est un père qui a élevé son fils dans un esprit dynastique, attendant de lui qu'il reprenne un jour le flambeau de l'entreprise familiale et pérennise son nom. Mais, dans les deux cas, c'est vrai que le lien filial passe au second plan.
Dans le même ordre d'idée, le personnage de Bienaimé est un peu trop candide pour être vrai, même si l'on peut comprendre que cela colle avec le rôle qui lui est attribué, celui du binôme idéal dans un buddy movie. Il est sympathique et plein de vie quoi qu'il lui arrive (et il lui en arrive des vertes et des pas mûres), mais comme les deux autres, on n'a pas l'impression qu'il soit en phase avec la réalité.
Voilà aussi pourquoi je veux voir une fable dans ce roman, qui pourrait être, à quelques retouches près, un scénario parfait pour une Coline Serreau, par exemple, histoire d'aller gratter là où ça fait mal. Mais, "les Enfants perdus" n'est pas qu'une satire de ces riches déconnectés du monde et simplement obsédés par leur statut social, leur position dominante ou leur compte en banque.
Non, il y a une vraie réflexion moraliste (pas moralisatrice, attention) dans tout cela à travers la question parentale : qu'est-on prêt à faire pour son enfant, la chair de sa chair ? Et que peut-on apprendre de ses enfants, également ? Et là, évidemment, les parcours des personnages seront très différents, les dénouements également.
Le bémol exprimé est de taille, mais pour autant, j'ai apprécié la lecture de ce roman par les réflexions qu'il permet sur l'humain dans une société qui a une fâcheuse tendance à le considérer au second plan (et, si c'est vrai dans le cadre d'un capitalisme outrancier, ce n'est pas le seul type de société qui en arrive à cette situation dommageable).
C'est bien cela, le thème central des "Enfants perdus" : l'humain. L'essentiel, ce qui devrait passer avant tout le reste, avant cette définition en trompe-l'oeil qu'on nous impose de la réussite, phénomène limité à ses dimensions strictement matérielles. Oui, la quête qui est au coeur de cette, de ces histoires, c'est bien celle-là, une quête d'humanité.
On pourrait aussi faire une remarque sur le titre : "les Enfants perdus". On pense à Peter Pan, à ces enfants qui atterrissent au pays imaginaire et y demeurent lorsque leurs parents ne les réclament pas. L'analogie, avec le recul, n'est pas inintéressante, et sans doute finalement assez juste. Mais ce n'est pas tout à fait là que je veux en venir.
En fait, ce roman aurait pu (devrait ?) s'intituler "les Parents perdus", car c'est vraiment ce dont on va se rendre compte au fil des chapitres (des chapitres toujours très courts, qu'on enchaîne rapidement, volant d'un des personnages centraux à l'autre). Oui, ils sont perdus, incapables d'assumer ce rôle de parents, totalement immatures.
François Hauter observe Stanislas et Rosa rattrapés par cette responsabilité qu'ils avaient, plus ou moins sciemment, mise de côté. Il décortique leurs réactions, leurs attitudes, leurs décisions, leur évolution, également, car on ne peut pas rester inerte dans ces circonstances. Fendre l'armure et mettre de l'émotion dans des existences qui ont tendance à bannir tout cela, parce qu'inutile...
En face, je ne vais pas parler des enfants, Alexandre et Jade, car, évidemment, toute l'histoire repose sur ce qu'il leur arrive, mais, à leur façon, ils vont donner de fortes leçons à leurs parents respectifs. C'est l'enjeu de ce livre, on le comprend bien avant la fin, d'ailleurs. Parce que la relation entre parents et enfants ne peut être unilatérale.
Parce qu'une fois grands, les enfants jugent les parents, oui, Oscar Wilde a absolument raison. Et les jugent à travers le prisme de ce qu'ils sont devenus (je parle des enfants), de leur capacité à vivre plus ou moins heureux, ou ce qui s'en rapproche le plus... Quant à pardonner, eh bien, lisez "les Enfants perdus", pour savoir si cela peut arriver...
samedi 15 avril 2017
"Moi, je me regarde dans le miroir de la France et je me trouve jolie".
En ces temps troublés (oui, hein, vous avez remarqué aussi ?), voici un court mais passionnant roman qui aborde une question au combien délicate, celle des réfugiés. Et en adoptant leur point de vue, pas celle de la nation accueillante, enfin, si je puis employer ce mot, l'accueil n'étant décidément pas toujours la qualité première de notre cher et vieux pays... En prenant un peu de recul, en jouant sur les caractères des deux personnages centraux, en proposant un récit simplement centré sur l'humain, Paola Pigani nous offre avec "Venus d'ailleurs" (paru chez Liana Levi et désormais disponible dans le collection de poche Piccolo) une lecture profondément touchante, sans pathos, sans misérabilisme. Mais pas sans réfléchir aux difficultés inhérentes à un exil forcé, provoqué par la guerre. Alors, oui, c'est un roman à lire en ce moment, particulièrement en ce moment, car on y trouve des pistes de réflexion sur des sujets, hélas, toujours d'actualité.
Mirko et Simona sont frères et soeur et son originaires du Kosovo. Pour qui l'ignorerait encore, le Kosovo était une enclave albanophone en terre ex-Yougoslave et a été au centre, depuis la fin des années 1990, de plusieurs conflits à caractère ethnique, prolongement des conflits qui ont vu la Yougoslavie éclater.
En 1999, l'OTAN décide de bombarder les troupes serbes qui ont envahi l'enclave afin de leur faire rebrousser chemin. C'est à cette époque que Mirko et Simona vont, contrairement au reste de leur famille, choisir de quitter leur terre natale pour aller tenter leur chance ailleurs. Débute alors un périple dangereux et coûteux vers des terres qu'ils estiment plus accueillantes...
Après s'en être remis à des passeurs, ils se retrouvent au Chambon-sur-Lignon. Eux qui espéraient aller s'installer en Allemagne, c'est la France qu'ils vont découvrir. Et, après le centre de réfugiés, ce sera la ville de Lyon qui les voient arriver, au printemps 2001. Ils ont la petite vingtaine et c'est le premier jour du reste de leur vie.
Oui, mais, une vie dans un autre pays, dans une autre culture, avec une autre langue qu'il faut apprendre... Et puis, une fois accepté, ce qui est déjà parfois bien compliqué, il faut construire une vie : trouver un logement, un travail, créer des liens... S'intégrer, pour employer ce mot qui peut vite prendre un sens très rude...
Alors, Mirko et Simona s'attellent à cela, pour entamer une nouvelle existence, loin des bombes et des tensions ethniques qui perdurent, loin de la misère, aussi. Ils sont assidus, apprennent le français, étudient, trouvent du boulot, lui en travaillant sur des chantiers, elle comme vendeuse dans des magasins de fringues.
Mais, ils sont très différents l'un de l'autre : Simona est une jeune fille pleine de vie qui a bien l'intention de devenir française, définitivement française. Pour elle, le Kosovo appartient au passé et seul compte l'avenir, qu'elle n'imagine pas autrement qu'avec des papiers estampillés République Française, en bonne et due forme.
Elle a adopté le mode de vie à la française presque comme si de rien n'était et affiche sa volonté que rien ne la distingue des jeunes filles de son âge nées en France. C'est elle qui prononce la phrase placée en titre de ce billet et elle ajoute : "Les autres voient pas que je suis kosovare. Mon pays, il se tait". Du passé, elle veut faire table rase et entamer une nouvelle vie, sans remords ni regret.
Mirko est très différent : beaucoup moins expansif que sa jeune soeur, il est taciturne, discret, peine un peu plus à maîtriser le français, à comprendre comment fonctionne ce nouveau pays dans lequel il a atterri. Et puis, surtout, il conserve une terrible nostalgie de sa terre natale, assortie d'une certaine culpabilité à avoir laissé derrière lui la majeure partie de sa famille.
Il se renferme sur lui-même, vit dans un foyer, passe son spleen en taguant les murs des friches à l'abandon... Tout cela ne l'empêche pas de faire des rencontres, au contraire, mais cela ne lui permet pas de trouver l'équilibre et l'apaisement dont il aurait besoin. Bien sûr, la France a ses attraits, mais comment oublier d'où il vient ?
"Venus d'ailleurs", c'est le récit du parcours sur plusieurs années de ces deux personnages, aux caractères et aux aspirations tellement différentes, mais liées par leur fraternité. Deux parcours plein de contrastes qui viennent rappeler que rien n'est jamais acquis, rien n'est facile quand il faut repartir de zéro et loin de sa terre natale.
Paola Pigani, dont c'est le second roman, réussi à parler de ce sujet tellement complexe dans un pays qui n'en finit plus de vouloir se couper du reste du monde avec une immense délicatesse. Le mot qui vient naturellement à l'esprit, c'est humanité. Oui, il y a une grande humanité dans ce texte, simple, sans chichi, sans recherche de polémiques inutiles.
Bien sûr, la caractérisation des personnages n'est pas anodine, mais c'est aussi le jeu de la fiction, pour élargir le champ des possibles, la palette des émotions. Et cela fonctionne, jusqu'à un épilogue qui serre le coeur. On s'attache à Mirko et à Simona, à ce garçon un peu perdu, toujours sur la réserve, et à cette jeune femme déterminée et joyeuse.
On s'attache aussi à Agathe. Je n'ai pas encore parlé d'elle, mais il faut nous arrêter un instant sur cette autre jeune femme qui va rencontrer Mirko et se lier d'amitié avec lui. D'amitié, et sans doute d'un peu plus. Peu lui importe d'où vient ce gaillard pas bavard, elle apprécie sa compagnie. Mais ce qu'elle ressent et qu'elle peine à expliquer peut-il contrebalancer le spleen de Mirko ?
Agathe aussi est touchante. Aux yeux du lecteur, ses sentiments sont transparents mais semble glisser sur Mirko comme l'eau sur le plumage d'un canard. Attention, cela ne veut pas dire que le jeune homme n'a pas de coeur, qu'il ne ressent rien lui non plus, mais simplement que son sens des priorités diffère. Et Agathe, malgré tout, n'est pas au premier rang...
Curieusement, c'est Mirko qui se retrouve confronté à ces questions de sentiments, lui qui demeure un Kosovar et ne parvient pas à s'envisager comme un Français. Déchiré entre sa terre natale et sa terre d'accueil, il est trop indécis pour envisager une seconde de construire quelque chose de solide avec Agathe. Et pourtant, elle devient sa boussole, sa guide dans la ville de Lyon.
Lyon... Voilà le dernier personnage que nous évoquerons. La ville est omniprésente, on la voit sous des jours très différents, des beaux quartiers au bord du Rhône et de la Saône, jusqu'à ces friches industrielles qui renaissent peu à peu ou demeurent à l'abandon, vestiges du passé industriel désormais révolu de la capitale des Gaules.
Un décor que connaît bien Paola Pigani, puisqu'elle vit à Lyon, nous dit la quatrième de couverture. Et elle parle de cette ville avec une grande tendresse. Voilà pourquoi je mets la ville au même rang que les personnages humains : elle a droit au même traitement, bienveillant mais critique, aussi, lorsque, parfois, on aperçoit des zones d'ombre, des côtés plus sombres...
A travers ce roman, Paola Pigani nous emmène aux côtés de ces réfugiés dont, aujourd'hui, notre pays a bien du mal à envisager l'arrivée. Les contextes diffèrent, c'est évident, mais comment ne pas voir dans la démarche de Mirko et Simona celle de tant d'autres qui fuient la Syrie, l'Irak, la Libye, l'Afrique subsaharienne...
Dans bien des régions du globe, la guerre fait rage, la haine détruit l'humain avec un luxe d'imagination qui défie la raison. L'Europe, terre apaisée (le Kosovo est, me semble-t-il, le dernier conflit armé à avoir eu lieu sur notre continent), attire forcément ces hommes et ces femmes qui ne recherchent avant tout qu'un havre où vivre sans craindre que chaque journée soit la dernière.
Mirko et Simona eux aussi, en leur temps, ont quitté leur pays ravagé par la violence, pour s'installer là où ils pourraient vivre, tout simplement vivre. A l'époque de l'arrivée des deux personnages de "Venus d'ailleurs", eut lieu la construction du camp de réfugiés de Sangatte, qui, avant Calais, avant "la Jungle", avant d'autres lieux sinistres et indignes, cristalliserait l'opposition à la présence de ces réfugiés.
Comme la plupart de ces personnes qui souhaitaient traverser la Manche pour les îles britanniques, Mirko et Simona n'envisageaient pas de venir s'installer en France. Mais le destin n'obéit pas toujours. Sans doute existe-t-il nombre d'exemples de ces réfugiés qui ont trouvé leur place au sein de la société française.
Sans doute sont-ils des citoyens comme tant d'autres, peut-être s'apprêtent-ils à voter, eux aussi, dans quelques jours. Mais, parmi eux, il y en a aussi dont l'ambition, l'espoir, est de rentrer un jour dans un pays pacifié pour y poursuivre leur existence en sécurité. C'est le dilemme de Mirko, comme il l'est certainement de nombres des réfugiés qui fuient en ce moment leur pays déchiré...
Au moment où j'écris ces lignes, on célèbre le quarantième anniversaire de la mort de Jacques Prévert. Et, en repensant à "Venus d'ailleurs", c'est un texte du poète qui me revient en mémoire : "Etranges étrangers", qui s"achève ainsi :
Preuve que ces questions ne sont pas nouvelles, qu'elles se sont posées tout au long de l'histoire de notre pays, à chacune des vagues d'immigration qui ont marqué l'histoire contemporaine, depuis la révolution industrielle. Et qu'elles se poseront certainement encore dans les mois, les années à venir, alors que notre monde semble redevenir une vaste poudrière...
Et preuve qu'il est bon de lire "Venus d'ailleurs" et son récit tout en humanité.
Mirko et Simona sont frères et soeur et son originaires du Kosovo. Pour qui l'ignorerait encore, le Kosovo était une enclave albanophone en terre ex-Yougoslave et a été au centre, depuis la fin des années 1990, de plusieurs conflits à caractère ethnique, prolongement des conflits qui ont vu la Yougoslavie éclater.
En 1999, l'OTAN décide de bombarder les troupes serbes qui ont envahi l'enclave afin de leur faire rebrousser chemin. C'est à cette époque que Mirko et Simona vont, contrairement au reste de leur famille, choisir de quitter leur terre natale pour aller tenter leur chance ailleurs. Débute alors un périple dangereux et coûteux vers des terres qu'ils estiment plus accueillantes...
Après s'en être remis à des passeurs, ils se retrouvent au Chambon-sur-Lignon. Eux qui espéraient aller s'installer en Allemagne, c'est la France qu'ils vont découvrir. Et, après le centre de réfugiés, ce sera la ville de Lyon qui les voient arriver, au printemps 2001. Ils ont la petite vingtaine et c'est le premier jour du reste de leur vie.
Oui, mais, une vie dans un autre pays, dans une autre culture, avec une autre langue qu'il faut apprendre... Et puis, une fois accepté, ce qui est déjà parfois bien compliqué, il faut construire une vie : trouver un logement, un travail, créer des liens... S'intégrer, pour employer ce mot qui peut vite prendre un sens très rude...
Alors, Mirko et Simona s'attellent à cela, pour entamer une nouvelle existence, loin des bombes et des tensions ethniques qui perdurent, loin de la misère, aussi. Ils sont assidus, apprennent le français, étudient, trouvent du boulot, lui en travaillant sur des chantiers, elle comme vendeuse dans des magasins de fringues.
Mais, ils sont très différents l'un de l'autre : Simona est une jeune fille pleine de vie qui a bien l'intention de devenir française, définitivement française. Pour elle, le Kosovo appartient au passé et seul compte l'avenir, qu'elle n'imagine pas autrement qu'avec des papiers estampillés République Française, en bonne et due forme.
Elle a adopté le mode de vie à la française presque comme si de rien n'était et affiche sa volonté que rien ne la distingue des jeunes filles de son âge nées en France. C'est elle qui prononce la phrase placée en titre de ce billet et elle ajoute : "Les autres voient pas que je suis kosovare. Mon pays, il se tait". Du passé, elle veut faire table rase et entamer une nouvelle vie, sans remords ni regret.
Mirko est très différent : beaucoup moins expansif que sa jeune soeur, il est taciturne, discret, peine un peu plus à maîtriser le français, à comprendre comment fonctionne ce nouveau pays dans lequel il a atterri. Et puis, surtout, il conserve une terrible nostalgie de sa terre natale, assortie d'une certaine culpabilité à avoir laissé derrière lui la majeure partie de sa famille.
Il se renferme sur lui-même, vit dans un foyer, passe son spleen en taguant les murs des friches à l'abandon... Tout cela ne l'empêche pas de faire des rencontres, au contraire, mais cela ne lui permet pas de trouver l'équilibre et l'apaisement dont il aurait besoin. Bien sûr, la France a ses attraits, mais comment oublier d'où il vient ?
"Venus d'ailleurs", c'est le récit du parcours sur plusieurs années de ces deux personnages, aux caractères et aux aspirations tellement différentes, mais liées par leur fraternité. Deux parcours plein de contrastes qui viennent rappeler que rien n'est jamais acquis, rien n'est facile quand il faut repartir de zéro et loin de sa terre natale.
Paola Pigani, dont c'est le second roman, réussi à parler de ce sujet tellement complexe dans un pays qui n'en finit plus de vouloir se couper du reste du monde avec une immense délicatesse. Le mot qui vient naturellement à l'esprit, c'est humanité. Oui, il y a une grande humanité dans ce texte, simple, sans chichi, sans recherche de polémiques inutiles.
Bien sûr, la caractérisation des personnages n'est pas anodine, mais c'est aussi le jeu de la fiction, pour élargir le champ des possibles, la palette des émotions. Et cela fonctionne, jusqu'à un épilogue qui serre le coeur. On s'attache à Mirko et à Simona, à ce garçon un peu perdu, toujours sur la réserve, et à cette jeune femme déterminée et joyeuse.
On s'attache aussi à Agathe. Je n'ai pas encore parlé d'elle, mais il faut nous arrêter un instant sur cette autre jeune femme qui va rencontrer Mirko et se lier d'amitié avec lui. D'amitié, et sans doute d'un peu plus. Peu lui importe d'où vient ce gaillard pas bavard, elle apprécie sa compagnie. Mais ce qu'elle ressent et qu'elle peine à expliquer peut-il contrebalancer le spleen de Mirko ?
Agathe aussi est touchante. Aux yeux du lecteur, ses sentiments sont transparents mais semble glisser sur Mirko comme l'eau sur le plumage d'un canard. Attention, cela ne veut pas dire que le jeune homme n'a pas de coeur, qu'il ne ressent rien lui non plus, mais simplement que son sens des priorités diffère. Et Agathe, malgré tout, n'est pas au premier rang...
Curieusement, c'est Mirko qui se retrouve confronté à ces questions de sentiments, lui qui demeure un Kosovar et ne parvient pas à s'envisager comme un Français. Déchiré entre sa terre natale et sa terre d'accueil, il est trop indécis pour envisager une seconde de construire quelque chose de solide avec Agathe. Et pourtant, elle devient sa boussole, sa guide dans la ville de Lyon.
Lyon... Voilà le dernier personnage que nous évoquerons. La ville est omniprésente, on la voit sous des jours très différents, des beaux quartiers au bord du Rhône et de la Saône, jusqu'à ces friches industrielles qui renaissent peu à peu ou demeurent à l'abandon, vestiges du passé industriel désormais révolu de la capitale des Gaules.
Un décor que connaît bien Paola Pigani, puisqu'elle vit à Lyon, nous dit la quatrième de couverture. Et elle parle de cette ville avec une grande tendresse. Voilà pourquoi je mets la ville au même rang que les personnages humains : elle a droit au même traitement, bienveillant mais critique, aussi, lorsque, parfois, on aperçoit des zones d'ombre, des côtés plus sombres...
A travers ce roman, Paola Pigani nous emmène aux côtés de ces réfugiés dont, aujourd'hui, notre pays a bien du mal à envisager l'arrivée. Les contextes diffèrent, c'est évident, mais comment ne pas voir dans la démarche de Mirko et Simona celle de tant d'autres qui fuient la Syrie, l'Irak, la Libye, l'Afrique subsaharienne...
Dans bien des régions du globe, la guerre fait rage, la haine détruit l'humain avec un luxe d'imagination qui défie la raison. L'Europe, terre apaisée (le Kosovo est, me semble-t-il, le dernier conflit armé à avoir eu lieu sur notre continent), attire forcément ces hommes et ces femmes qui ne recherchent avant tout qu'un havre où vivre sans craindre que chaque journée soit la dernière.
Mirko et Simona eux aussi, en leur temps, ont quitté leur pays ravagé par la violence, pour s'installer là où ils pourraient vivre, tout simplement vivre. A l'époque de l'arrivée des deux personnages de "Venus d'ailleurs", eut lieu la construction du camp de réfugiés de Sangatte, qui, avant Calais, avant "la Jungle", avant d'autres lieux sinistres et indignes, cristalliserait l'opposition à la présence de ces réfugiés.
Comme la plupart de ces personnes qui souhaitaient traverser la Manche pour les îles britanniques, Mirko et Simona n'envisageaient pas de venir s'installer en France. Mais le destin n'obéit pas toujours. Sans doute existe-t-il nombre d'exemples de ces réfugiés qui ont trouvé leur place au sein de la société française.
Sans doute sont-ils des citoyens comme tant d'autres, peut-être s'apprêtent-ils à voter, eux aussi, dans quelques jours. Mais, parmi eux, il y en a aussi dont l'ambition, l'espoir, est de rentrer un jour dans un pays pacifié pour y poursuivre leur existence en sécurité. C'est le dilemme de Mirko, comme il l'est certainement de nombres des réfugiés qui fuient en ce moment leur pays déchiré...
Au moment où j'écris ces lignes, on célèbre le quarantième anniversaire de la mort de Jacques Prévert. Et, en repensant à "Venus d'ailleurs", c'est un texte du poète qui me revient en mémoire : "Etranges étrangers", qui s"achève ainsi :
Etranges étrangers,
vous êtes de la ville
vous êtes de sa vie
même si mal en vivez
même si vous en mourez.
Preuve que ces questions ne sont pas nouvelles, qu'elles se sont posées tout au long de l'histoire de notre pays, à chacune des vagues d'immigration qui ont marqué l'histoire contemporaine, depuis la révolution industrielle. Et qu'elles se poseront certainement encore dans les mois, les années à venir, alors que notre monde semble redevenir une vaste poudrière...
Et preuve qu'il est bon de lire "Venus d'ailleurs" et son récit tout en humanité.
Inscription à :
Articles (Atom)