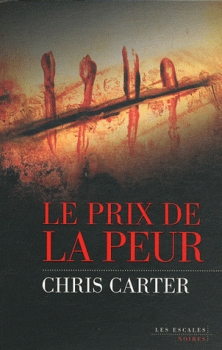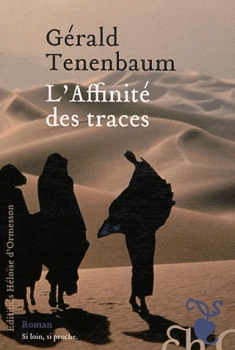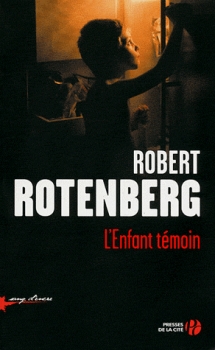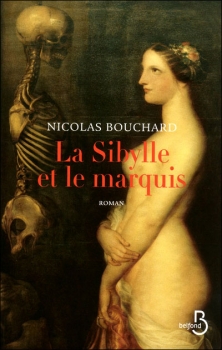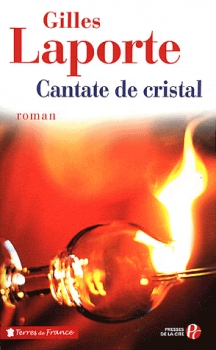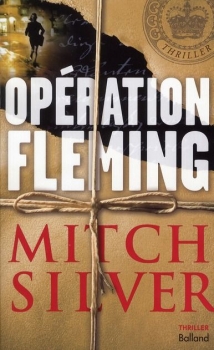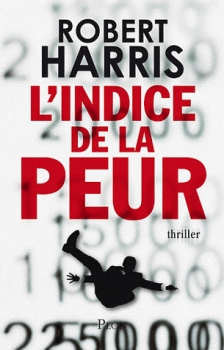
Alexander Hoffmann est un physicien de génie venu travailler au CERN, en Suisse, à la fin des années 1990 quand un des grands programmes scientifiques américains a été abandonné. Accueilli comme une vedette, il a pourtant vite déchanté, quand son ambition dans le domaine de l'Intelligence Artificielle a été lui aussi abandonné, sous la pression de son supérieur, Bob Walton.
Une décision qui a poussé Hoffmann à quitter le CERN pour mettre ses compétences au service de sa propre entreprise. Une société qui touche un domaine d'activités bien différent de celui auquel il se consacrait au CERN : Hoofmann Investments Technologies est en effet un hedge fund, dans lequel ses compétences font merveille.
Au coeur du projet, un algorithme chargé de jouer les traders à la vitesse d'un ordinateur et non d'un humain, si lent, si pataud... Un algorithme qui peut multiplier les opérations boursières avec une efficacité inimitable, c'est-à-dire, dégager un maximum de bénéfices, même lorsque la conjoncture et les tendances des grandes places boursières mondiales ne sont pas au beau fixe.
Ce VIXAL-4 est un projet ultra-secret que Hoffmann, mais surtout son associé, Hugo Quarry, le financier de ce duo en or, comptent bien rentabiliser un peu plus encore auprès d'investisseurs triés sur le volet, des investisseurs qu'ils espèrent de convaincre de mettre la main à la poche devant les résultats exceptionnels obtenus par leur société.
Mais, à la veille de cette réunion, un grain de sable vient se glisser dans la belle machine... Alors que Hoffmann, collectionneur de livres anciens dans leur première édition, a reçu un ouvrage de Darwin qu'il n'a jamais commandé, il est attaqué dans sa luxueuse propriété, proche de Genève, par un inconnu qui le frappe et le laisse inconscient avant de prendre la fuite...
De quoi effrayer un Alex Hoffmann que la paranoïa guette déjà depuis un bail. Hoffmann, ce n'est pas le people bling-bling qu'on voit partout, dans les endroits les plus branchés comme à la une des magazines à paillettes, ce n'est pas un riche philanthrope qui a ses bonnes oeuvres et le fait savoir... Non, c'est tout le contraire, une ombre... Une troublante volonté de n'apparaître nulle part, de s'effacer derrière Quarry et sa société.
Alors, quand il se sent pris au piège, il ne le vit pas bien du tout. Ca le perturbe et c'est peu de le dire. D'autant que les incidents ne s'arrêtent pas là... Des achats faits sur un compte à son nom dont il ignore l'existence, la présence quasi constante de son agresseur, des inquiétudes sur sa santé, après avoir passé une IRM de son cerveau... Sans compter une situation économique qui se dégrade soudain... Des indices partout à la baisse, sauf... le VIXAL-4...
Car, l'idée de génie qu'a eue Alexandre Hoffmann, c'est de baser son indice sur... la peur. Autrement dit, lorsque la société et l'économie va mal, l'algorithme d'Hoffmann trouve les solutions pour miser sur les bons chevaux et multiplier les bénéfices quand tous les autres s'arrachent les cheveux...
De quoi se réjouir ? Peut-être... Car l'abstraction que manipulait Hoffmann au CERN n'avait rien à voir avec celle qu'il gère désormais comme patron de Hedge Fund. Ses actes, ou plutôt ceux de VIXAL-4, ont des conséquences bien concrètes et les résultats se mesurent en devises. Ce qui lui fait penser, à un moment du livre, que ces sommes folles ont sur lui le même effet que le radium sur Marie Curie : elles l'empoisonnent. Tant physiquement que moralement.
Commence une pénible descente aux enfers pour un génie torturé qui s'imagine que quelqu'un lui en veut et que cet inconnu malveillant veut lui faire perdre la raison... Mais, le créateur n'est-il pas surtout en train de perdre le contrôle de sa créature, tel le Dr Frankenstein ?
Avec ce techno-thriller implanté dans une réalité qui est la nôtre au quotidien, Harris parvient à nous effrayer avec un roman sur un thème qui a inspiré nombre de romanciers, de Dick (Philip K., pas Rivers...) à Dan Brown, en passant par Dean Koontz ou encore Eric L. Harry : la prise de pouvoir de la machine sur l'homme...
Je ne veux pas trop en dire, même si la logique du roman de Harris est clair dès le départ, je trouve. Mais c'est toute la construction du roman, qui va crescendo, que j'ai trouvé remarquable. Avec, au coeur du récit, nos peurs contemporaines, notre paranoïa quotidienne, qu'elles soient justifiées ou pas, notre crainte très moderne et presque permanente de ce que sera notre lendemain.
En pariant sur cette ambiance globale plus que morose comme variable à la hausse, Hoffmann a découvert une pierre philosophale virtuelle qui change chaque incident, de la simple baisse des cours à l'accident d'avion (ou bien est-ce un attentat ? en voilà, une autre peur moderne ultra-présente, le terrorisme...) en or. Sans coup férir, imperturbablement...
Après avoir attaqué avec virulence la politique, et même la personnalité de Tony Blair (et de son épouse) dans "the Ghost Writer", dont le personnage central connaît les mêmes affres que Hoffmann (paranoïa ou menace réelle ?), Robert Harris reprend le même type de ressort pour dénoncer les dérives de la haute finance mondiale, qui nous envoie droit dans le mur...
Le dénouement s'appuie, documents et déclarations à l'appui, sur des faits véritables, qui ont eu lieu au moment du dernier krach, puis lors de l'enquête du Congrès américain qui suivit. Et c'est très habilement imbriqué dans la fiction que nous raconte Harris.
Autre thème majeur de ce roman : l'impression constante que nous vivons dans un monde virtuel (euh, pas une chanson de M, vraiment, un monde intangible, quoi...). Hoffmann, lorsqu'il était physicien, traquaient des particules infiniment petites, le voilà accumulant et déplaçant des sommes invisibles, achetant et vendant des titres qu'il ne tiendra jamais en main, échangeant entre terminaux, sans plus aucun contact humain...
Même Gabrielle, sa femme, épouvantée par la déchéance d'Alex, accroît cette sensation d'abstraction : elle est artiste et utilise comme base de son oeuvre, des documents médicaux, en particulier des IRM, qu'elle doit exposer au moment des faits dans une galerie genevoise. Pire encore, ses deux pièces maîtresses sont des IRM d'un condamné à mort exécuté depuis et du foetus que Gabrielle a perdu quelques années plus tôt...
Dans ce monde où rien n'existe vraiment, comment croire que la menace qui pèse sur vous est réelle ? Ou au contraire, n'est-ce pas parce que, contrairement à tout ce qui vous entoure, cette menace a tout d'un phénomène bien réel, qu'elle est aussi effrayante ?
J'ai choisi ce titre évoquant le fameux docteur et sa créature d'abord miraculeuse, puis, bien vite, incontrôlable, parce que le jeu dangereux des financiers, complètement détachés du monde réel pour évoluer dans une abstraction qui, paradoxalement, a des conséquences sur nous tous, ressemble à ce genre d'expérience scientifique passionnante en théorie mais qui tourne à la catastrophe lorsqu'elle prend forme "in real life", comme on dit onne ze oueb...
J'ai failli mettre en titre cette citation de Franklin Delano Roosevelt, phrase prononcée au début de la Grande Dépression qui frappa les Etats-Unis dans la foulée de la crise de 1929 : "la seule chose dont nous devons avoir peur, c'est de la peur elle-même". Cette phrase me semble si bien résumer "l'indice de la peur" que j'ai pensé qu'elle ferait une "merveilleuse" conclusion à ce billet.
Que j'achève non sans vous exhorter à ne pas avoir peur vous-même, cela alimente tant de maux !
Ouh là, on dirait un pape adressant une déclaration Urbi et Orbi, quand j'écris ça, étrange...