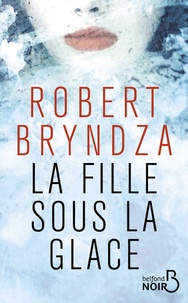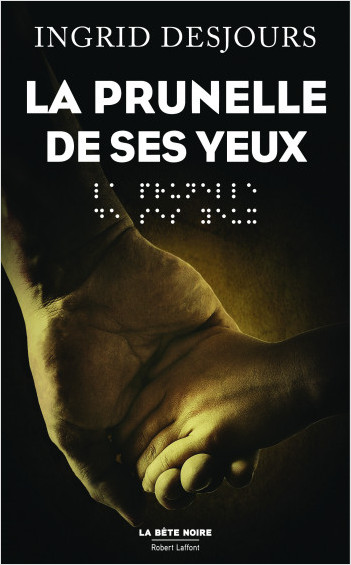Retour à Civilisation aujourd'hui, puisque tel est le nom de l'univers dans lequel se déroule le cycle dont nous allons parler. Un univers composé de cinq baronnies, ce qui devrait logiquement, nous valoir une série de cinq romans. Cinq baronnies qui ont chacune une société particulière, mettant en avant des orientations politiques qui surprennent et dérangent leurs voisins. Après avoir découvert Anasterry et son utopie humaniste, direction Grish-Mère, la plus atypique des baronnies de civilisation, à plus d'un titre. "Grish-Mère", c'est le deuxième volet (en grand format dans la collection Bad Wolf des éditions ActuSF) de la série d'Isabelle Bauthian, "les Rhéteurs", qui met les utopies sur le gril et démontrent les petites et les grandes hypocrisies de ces baronnies si fières de leurs modèles respectifs. Et, à travers elles, les petites et les grandes hypocrisies de notre monde à nous, les progrès qu'il nous faudrait faire toutes et tous pour améliorer notre quotidien... Un second tome très ancré dans l'actualité récente et les débats de fond qui font beaucoup parler sur les réseaux sociaux, dans les médias et ailleurs...
Trop bon, trop con. C'est une définition certes assez lapidaire, mais très juste de ce que ressent Sylve, jeune homme originaire de la baronnie de Landor. Par amour, il s'est laissé embobiner par Lacian, l'être en qui il avait le plus confiance. Il lui a laissé l'accès au temple qu'il était chargé de surveiller et l'autre en a profiter pour voler une statuette votive et se faire la malle...
Il a fallu plusieurs mois avant de se rendre compte de ce méfait et il ne reste que quelques semaines désormais à Sylve pour réparer son erreur et sauver son honneur. Avec bien peu d'indices, sans même savoir à quoi ressemble l'objet qu'il recherche et un gros retard sur le sale traître qui s'est bien payé sa tête. Mais, Sylve a une idée précise de l'endroit où Lacian a pu emporter la statuette et chercher refuge : Grish-Mère.
Mais, avant de vous parler de cette baronnie, prenons les choses dans l'ordre. Laissez-moi vous présenter Sylve, personnage central de ce roman. Alors qu'il était encore enfant, il a été conduit par sa mère jusqu'aux portes de la plus importante et renommée école de Civilisation, située dans la baronnie de Landor.
Cette école forme des serviteurs exceptionnels destinés à devenir les éminences grises des plus importants seigneurs locaux. Et quand je dis exceptionnels, ce n'est pas un mot galvaudé : ils sont aussi doués pour les tâches ménagères que les questions administratives, ils possèdent une culture générale non pas encyclopédique, mais carrément exhaustive, ce sont des combattants hors norme...
Ce n'est pas pour rien qu'on appelle les élèves formés à cette école des factotums. Des hommes à tout faire digne de la plus grande des confiances. Pas uniquement des serviteurs, mais des experts, comme ils se présentent volontiers eux-mêmes, avec, dans la voix, une fierté teintée d'orgueil. Sur eux, reposent le sort des plus grandes familles de Landor.
Dans l'ombre, les factotums agissent, délèguent, ordonnent, espionnent, parfois, défendent, flattent, quand c'est nécessaire. Bref, ils se rendent indispensables en toutes choses à tout moment du jour et de la nuit. La formation d'excellence qu'ils ont reçue confine à la perfection et, une fois retournés à la vie civile, le factotum se doit de faire honneur à ce statut.
C'était le cas de Sylve... jusqu'à ce que Lacian lui plante un couteau dans le dos et n'assassine sa réputation et son honneur... Sylve sait que, quoi qu'il arrive, qu'il réussisse où non à rapporter la statuette avant les fêtes qui lui sont dédiées, il ne sera plus jamais un factotum. On ne lui pardonnera pas son erreur, il se pourrait même qu'à son retour en Landor, on décide de l'exécuter...
Mais quelle importance, puisque Sylve, par amour, par bêtise, a perdu tout ce qui faisait son existence depuis près de 20 ans. Tout ce pourquoi il a souffert jour et nuit pendant tant d'années, apprenant, s'exerçant, s'améliorant, s'enrichissant, se gavant de savoirs divers et variés, bataillant férocement, cherchant à sortir du lot le plus relevé qui soit...
Retrouver la statuette sera sa dernière action d'éclat et ensuite, advienne que pourra ! Il a donc a son tour pris discrètement la route de Grish-Mère, un parcours semé d'embûche, malgré ses talents. Avec le compte à rebours en tête, il cherche à élaborer un plan viable. Car, aller à Grish-Mère n'a rien de simple, bien au contraire.
Eh oui, il est maintenant temps d'évoquer cette baronnie qui donne son nom au roman. Je l'ai dit plus haut, elle est sans doute, et de loin, la plus atypique des cinq baronnies de Civilisation. D'abord, sur le plan géographique : c'est une île. Oh, pas juste une île, ce serait trop restrictif. Grande comme un continent, entièrement urbanisée au détriment de la nature originelle et quasiment inaccessible.
En effet, à Civilisation, on n'a pas vraiment le pied marin. On ne navigue pas et aucun bateau ne fait la navette entre le continent et Grish-Mère. Pour traverser le détroit, il n'y a qu'une seule solution : emprunter un pont. Mais, là encore, pas n'importe quel pont. La plupart du temps, il est sous les eaux et n'est à découvert que lors des deux marées trisannuelles...
Autrement dit, pour rallier Grish-Mère, mieux vaut être à l'heure, sinon, on peut attendre longtemps... Et même si on est bien présent à l'entrée du pont au moment où les eaux refluent, il n'est pas certain qu'on vous laisse passer. Parce que n'entrent à Grish-Mère que ceux qui ont vraiment quelque chose à y faire, et les factotums déchus mijotant un mauvais coup n'entrent pas dans cette catégorie.
Dernière caractéristique de Grish-Mère, cette fois historique et politique, c'est une société matrilinéaire, la seule du genre en civilisation (les quatre autre baronnies étant effectivement patriarcales). Une baronnie créée par les femmes, pour les femmes, comme on la présente souvent, une réponse, justement, aux modèles politiques et religieux continentaux qui relèguent les femmes au second plan.
C'est vous dire si la tâche de Sylve s'annonce compliquée... Gagner Grish-Mère, s'y faire discret tout en y défiant l'autorité... Et en plus, au cours de sa fuite, il a pris un mauvais coup qui le diminue considérablement. Affaibli et fiévreux, le factotum reste un expert capable de se sortir des situations les plus complexes, mais sa lucidité est entamée...
Son plan, c'est de se planquer dans un des convois qui doit se rendre sur l'île. Ces véhicules appartiennent, pour la plupart, aux différentes guildes et Sylve pense pouvoir se glisser au milieu de ce trafic sans se faire remarquer. Sauf qu'il n'est décidément pas au meilleur de sa forme, qu'il commet quelques erreurs...
Et qu'il n'a pas choisi le bon convoi...
Pris sur le fait, le voilà aux mains de la Guilde des Epiciers dont les membres acceptent de le transporter, mais à la condition qu'il se mette à leur service, et à l'oeil, histoire de rembourser les préjudices qu'il a occasionnés. S'il lui reste du temps libre, alors, il pourra mener son enquête, mais sa priorité, ce sera la Guilde.
Cette Guilde, nous la connaissons. Nous l'avons déjà croisée dans "Anasterry", en particulier son jeune patron, Thélban Acremont, qui a, de facto, pris la tête de la Guilde en remplacement de son père, à la santé fragile. A ses côtés, Céleste, la soeur jumelle de Thélban, musicienne de grand talent dont la rumeur dit qu'elle est la maîtresse de son frère, et Constance d'Eminor, guerrière originaire d'Anasterry, épouse légitime de Thélban...
Autour d'eux, les employés de la Guilde, dont Racine, le bras droit de Thélban, et Vigal, son grand ami. A la surprise (un peu dégoûtée) de Sylve, cet entourage est composée aussi bien d'humains que de mi-hommes et même de créatures qui, partout ailleurs, et surtout à Landor, n'occuperaient jamais des emplois dédiés aux humains.
Car, il faut le dire, si la formation suivie par les factotums est exceptionnelle et d'une qualité optimale, elle forme aussi des garçons, quasiment exclusivement, dont la vision du monde est très conservatrice... Alors, entre cette compagnie cosmopolite et cette île dirigée par des femmes, Sylve se retrouve dans une situation pour le moins déroutante...
Son savoir, intellectuel, manuel ou militaire, est d'un seul coup bien moins efficient, parce qu'il ne s'applique plus, comme à Landor, à un contexte immuable, bien rangé, clair et précis. Le logiciel de Sylve patine un peu, et ce n'est qu'un début : cette aventure vers Grish-Mère va se charger de remettre en question tout ce qui fonde l'existence monolithique de Sylve.
Aux factotums, on apprend énormément de choses, mais pas le pragmatisme, l'adaptation au monde tel qu'il est. Ils sont formatés, munis d'oeillères et ne répondent qu'au modèle qu'on leur a inculqué. Ils sont humains, mais on en a fait des espèces de robots de chair. Sylve n'échappe pas à cette règle et son retour sur terre va être brutale.
Le jeune homme se retrouvent en effet entouré de gens rusés, roués, même, dénués de scrupules, capables de jouer tous les coups, même les plus tordus, ayant une vision toute relative de l'honneur et de la règle strictement établie... Et, soudainement, apparaît au grand jour un trait de caractère commun aux factotums, même les plus doués : la naïveté.
Peut-être le pire des défauts d'une cuirasse apparemment invulnérable. Sylve, tellement habitué à tout maîtriser, calculateur sur pattes capable d'anticiper le moindre coup (il fait penser à un Terminator, par moments, on se retrouve dans sa tête et on voit défiler les données en caractères rouges à travers son oeil), de détecter le moindre bruissement... bugue.
Je ne vois pas d'autres mots, c'est exactement ça : lui qui a réponse à tout, pas par forfanterie, mais parce que c'est son métier d'avoir réponse à tout, se retrouve à devoir gérer l'ingérable. La machine redevient humaine, comme le carrosse redevient citrouille et désormais, Sylve, attachant malgré tous ses défauts et sa vision du monde très réac, est pris au piège.
Trop bon trop con, pourtant, il aurait dû se méfier, il était prévenu ! Il s'est fait avoir une fois par un Lacian, il n'allait quand même pas se faire avoir mille fois par mille Lacian (ou un truc dans le genre) ! Eh bien si ! Parce que, en quittant Landor, Sylve se retrouve dans un autre monde qui fonctionne autrement et dans lequel ses immenses talents son inopérants...
Ainsi livré à lui-même, incapable de reprendre les choses en main, il va se retrouver au coeur d'intrigues et de manigances, sur fond de politique et de religion, auxquelles il ne comprend goutte. Qui, d'ailleurs, le manipule ? Et dans quel(s) but(s) ? Le temps qu'il se rende compte qu'on se joue de lui, il est bien trop tard pour éviter le pire.
Difficile de savoir si ce qui provoque le plus l'effroi chez Sylve est cette sensation d'avoir perdu le contrôle ou le fait qu'il découvre un monde inconnu, avec un fonctionnement qui, pour lui, frise l'hérésie à chaque instant. Car, on est dans une série qui s'appelle "les Rhéteurs", rappelons-le. Il y a donc confrontation, débats d'idées, échanges et disputes (dans tous les sens du terme).
Pour dire les choses simplement : la vision de Sylve, c'est celle de notre monde, patriarcal, blanc, dominé par une élite minoritaire en nombres, reposant apparemment sur des classes sociales, mais, dans les faits, sur un véritable système de castes (la formation de factotum étant d'ailleurs l'unique moyen de s'élever dans sa société et de quitter sa "plouquie", comme le disent entre eux les élèves).
Entre le regard des membres de la Guilde des Epiciers, teinté d'humanisme et de tolérance, certes, mais aussi de roublardise et d'affairisme, on le sait depuis "Anasterry", et la société matrilinéaire de Grish-Mère qui impose la domination de la femme sur un homme socialement réduit à la portion congrue, tout juste toléré et devant se faire tout petit, on comprend que Sylve soit proche du burn-out.
Grish-Mère... Ce n'est pas le royaume des Amazones, mais plutôt une sorte de négatif de ce que sont les sociétés patriarcales qui ont l'hégémonie, en fantasy comme dans notre monde vrai de vrai. Tous les codes que nous connaissons y sont renversés, jusque dans la célébration exacerbée du culte de la féminité, vous le découvrirez.
L'homme, je parle du sexe, pas du terme générique pour désigner les humains, y est donc déclassé. Il n'a aucun pouvoir, à peine le droit de l'ouvrir, citoyen de seconde zone (et même moins que ça encore). Il y a des hommes sur Grish-Mère, mais on comprend bien que si cela était possible, alors, on se passerait volontiers d'eux.
Pourtant, le roman d'Isabelle Bauthian va bien au-delà de cette vision manichéenne des choses, toujours simpliste. En opposant une société féministe à l'extrême au modèle masculiniste commun, elle met en place un système utopique qui, sur le papier, devrait être meilleur, merveilleux, allez, disons le mot : parfait.
Or, ce n'est pas le cas. Comme Ansterry, dont l'humanisme flamboyant reposait sur un mensonge abject, le modèle de Grish-Mère a aussi ses facettes plus sombres, ses malfaçons. On pourrait même comparer Sylve et Grish-Mère, chacun à leur échelle : ils sont des utopies, formé ou conçue comme tels, mais lorsqu'on les confronte au réel, les choses se gâtent...
Ici, entre Landor et sa société ultra-conservatrice, la Guilde des Epiciers, nettement plus libérale, et Grish-Mère, exception à toutes les règles, ce sont trois visions du monde qui s'affrontent à travers les mots des uns et des autres. Et de ces débats naît encore une fois que la perfection n'existe pas et qu'il faut d'abord faire de son mieux, dans l'intérêt général.
Quant à Sylve, lui, ce n'est pas juste sa vision du monde qui est remise en cause. Ce n'est pas juste son statut de factotum qui est battu en brèche. C'est carrément ce qu'il est qui est remis en perspective. Et en particulier, sa posture virile qui fait partie intégrante du bagage du factotum. Tout au long du roman, alors qu'on découvre par des flash-backs, son apprentissage en parallèle de sa quête, on voit l'ambiguïté de ce personnage.
Coincé dans ce moule où on l'a balancé pour permettre à sa famille de (sur)vivre, enfermé dans ce carcan social, il a grandi comme un arbre qu'on entoure de grilles pour qu'il pousse bien droit. Dans la norme. Mais, se pourrait-il que dès le départ, Sylve ait été, inconsciemment, anormal, c'est-à-dire hors de cette norme qui régit le Landor depuis toujours ?
Lancé dans une quête pour l'honneur, une mission désespérée, quasiment suicidaire, Sylve va se retrouver malgré lui, sans l'avoir sollicité, mais peut-être pour son bien, dans une quête de soi qui pourrait le métamorphoser de bien des manières possibles. Je ne sais pas si l'on recroisera Sylve dans les prochains épisodes des "Rhéteurs", mais je serais étonné, dans ce cas, qu'il soit le même que dans Grish-Mère".
Avec ce second tome, Isabelle Bauthian remet en place la recette qui présidait dans "Anasterry" : proposer une espèce de fable, en utilisant les outils de la fantasy, pour évoquer la société et ses dysfonctionnements. Les baronnies de Civilisation sont des archétypes de ce qui ne va pas bien dans notre monde, de ce qui propage la haine, l'intolérance et empêche l'harmonie, l'utopie, d'exister.
Après le racisme et le rejet de l'autre et des différences physiques dans "Anasterry", elle s'attaque à la condition féminine, mais aussi à l'homosexualité, elle brise des tabous, bouscule le lecteur autant que ses personnages en faisant vaciller les certitudes, les évidences. Comme elle le fait pour le personnage de Sylve, elle nous impose de décaler notre regard afin d'envisager le monde différemment.
Ne vous attendez pas à de la fantasy épique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action, mais on est plutôt dans une espèce de conte philosophique, de comédie humaine version fantasy, qui va s'attaquer à nos petits travers. Et à révéler et démasquer l'hypocrisie qui, souvent, est tapie dans l'ombre et tire bien des ficelles.
C'est une fantasy qui pousse à la réflexion (Isabelle Bauthian n'est pas la seule à l'envisager ainsi, mais, dans son cas, la réflexion est essentielle, inséparable du récit et des émotions qu'il génère), qui pousse aussi à la remise en question en nous faisant honte, en nous posant devant nos contradictions, nos erreurs de jugement et en nous mettant le nez dedans.
Bon, j'ai fait super long, je n'en dis pas plus. Je vous encourage simplement à découvrir ce cycle très original et très intéressant ("Anasterry" est d'ailleurs désormais disponible en poche, n'hésitez pas). Et le rendez-vous à Montès, troisième étape annoncée de ce périple en Civilisation, est d'ores et déjà pris, tout en souhaitant bon courage à Isabelle Bauthian, dont le cerveau va maintenant devoir turbiner à fond.
Et je suis très curieux de savoir quel angle elle adoptera pour nous présenter cette troisième baronnie.
"Il va falloir un jour qu'enfin je me décide à lire les livres que, depuis trente ans, je conseille à mes amis de lire". (Sacha Guitry)
samedi 24 février 2018
jeudi 22 février 2018
"La soumission à la Loi est le seul rempart qui empêche le monde de basculer dans la folie".
Disons-le tout de suite, afin de tuer dans l'oeuf toute velléité de tollé général, la citation ci-dessus est évidemment faite pour être battue en brèche (c'est le cas de le dire, puisque, dans la suite du passage, il est question de barrage et de lézardes). Dans notre roman du soir, on retrouve des archétypes classiques de fantasy, mais aussi quelques surprises et un univers assez particulier, dans lequel l'humanité est cantonnée aux terres, l'eau étant habitée par des démons... "Le fils de l'acier noir" est le premier volet d'une saga signée Larry Correia (en grand format aux éditions de l'Atalante ; traduction de Mathilde Montier), et nous emmène dans un univers qui, par bien des aspects, rappelle l'Inde. Un royaume qui est donc soumis à cette fameuse Loi, qui cimente absolument tout son fonctionnement. Que se passera-t-il, alors, si elle est remise soudainement en cause ? Et si celui qui cherche à l'abattre était son plus fervent défenseur peu de temps auparavant ? De la fantasy épique qui bastonne et une quête menée pour échapper au désespoir...
Dans des temps immémoriaux, une terrible guerre a opposé les dieux entre eux. A l'issue de ce conflit, les démons ont été vaincus et chassés. Ils ont trouvé refuge sur la terre habitée par les humains, mais, au lieu de s'y tenir calme, ils ont voulu imposer leur pouvoir par la force, ravageant tout sans aucun état d'âme.
Une situation qui ne pouvaient convenir aux dieux : si les démons ont été exilés, ce n'est pas pour qu'ils puissent faire le mal ailleurs ! Ils ont donc dépêché sur terre un de leurs hommes de confiance, un héros, capable de mettre un terme aux agissements démoniaques sur la terre des hommes. Ce héros se nommait Ramrowan, et il a vaincu à son tour les démons.
Contraints de battre en retraite encore une fois, ceux-ci ont investi les mers et les océans, où ils sont cantonnés depuis. Un partage équitable de la terre des hommes, les humains sur la terre ferme, les démons dans les eaux. Chacun chez soi et toute tentative de briser cet équilibre entraîne une répression immédiate.
Mais, le temps a passé. Des siècles, des millénaires, peut-être. Et ces histoires, après être devenus légendes, se sont perdues. L'homme a fini par oublié cette histoire de dieux et de démons, le héors Ramrowan et sa foi. Seul perdure cette situation partagée : les hommes sur terre, les monstres dans les eaux.
Et, pour réguler tout cela : la Loi.
Chaque être vivant y est soumis en tout point de la terre. Un principe inaliénable, inattaquable, enseigné à tous dès le plus jeune âge. C'est en suivant à la lettre cette Loi que la société a été façonnée selon un système de castes également inviolable : on ne passe pas d'une caste à une autre et, au plus bas de l'échelle sociale, ceux qu'on appelle les sans-caste ne sont même pas considérés comme des humains.
S'il prend l'idée à quelqu'un d'enfreindre la Loi, si des sans-castes se révoltent et prennent les armes, ce qui leur est formellement interdit, ou si des démon quittent les eaux pour investir la terre, alors sont envoyés les chevaliers-protecteurs, des soldats d'élite dont la mission est de faire appliquer la loi, coûte que coûte. Le plus souvent par la force.
Parmi ces héros d'un genre nouveau, qui ont suivi une formation extrême dans leur jeunesse pour devenir ces combattants d'exception au service exclusif de la Loi, il y a Ashok Vadal, surnommé Ashok Coeur-de-Pierre. Plus de 20 ans qu'il est ainsi au service de la Loi aux quatre coins du royaume, une légende vivante redoutée par tous, admirée par ses pairs et fierté de sa caste.
Ashok, c'est une machine, formé pour ne pas se poser de question, simplement appliquer la Loi. Pas de doute, pas de remords, pas de peur, ou si peu, une détermination sans faille et des capacités extraordinaires au combat. Ainsi, lorsqu'on le rencontre, renvoie-t-il dans les eaux deux démons qui ont eu le tort de s'aventurer sur terre. Un exploit qui n'avait plus été accompli depuis des lustres.
Il faut dire que Ashok bénéficie d'un atout maître dans son jeu : Angruvadal, une épée extraordinaire, forgée dans de l'acier noir et qui a la particularité de choisir celui qui la porte et celui qui se bat avec elle. Ashok est un élu, à plus d'un titre. Elu aux yeux de tous ceux qui servent la Loi. Il est son plus grand défenseur, le plus acharné et le plus dévoué.
A l'issue de son dernier exploit, il reçoit un message porté par Devedas, son meilleur ami, chevalier-protecteur qui a suivi sa formation à ses côtés. Ashok apprend qu'il est convoqué à Fort-Capitole auprès de Mindarin, le Grand protecteur. Celui-ci et mourant et, avant de disparaître, il a des révélations à faire à Ashok.
Le mot "révélations" est sans doute trop faible : ce qu'apprend Ashok fait s'effondrer toute son existence. Il n'est pas celui qu'il croyait être depuis aussi loin qu'il se souvienne et cette Loi, ce système qu'il a servi aveuglément toute ces années n'est qu'une illusion, un mensonge. Ce qui Mindarin lui propose alors est inacceptable : Ashok ne peut supporter l'idée de faire perdurer cette imposture.
Alors, il quitte tout, dans l'idée de se venger de ceux qui ont fait de lui ce qu'il est sous de faux prétextes. Ensuite, il acceptera son sort et, étant donné ce qu'il envisage de faire, il n'y aura pas beaucoup de sanctions possibles. Mais peu lui importe tout cela, désormais, puisqu'il n'est plus rien. Puisqu'on lui a repris tout ce qu'on lui avait donné.
Sauf Angruvadal...
Et pourtant, la mort devra attendre. Un autre destin, par ailleurs sans doute suicidaire, va être proposé à Ashok. On lui propose de mettre ses talents au service d'une autre personne, quelqu'un que, peu de temps encore, il aurait sans doute souhaité éliminer au nom de la Loi. Mais, désormais, pour Ashok Coeur-de-Pierre, la Loi n'est plus, alors...
Alors oui, il y a beaucoup de choses très classiques dans ce premier volet, mais d'autres qui sont assez intéressantes et font de ce premier tome, fort de tout de même 500 pages, un bon moment de lecture qu'on n'a pas envie de lâcher. Parce que l'on veut essayer de comprendre où va aller Ashok et de quelle nature sont les mystères qui l'entourent.
Ashok, c'est une espèce de mélange bizarre entre le roi Arthur et Judge Dredd. Dit ainsi, ça surprend un peu, je le reconnais, mais regardez : c'est un personnage qui a été choisi, très jeune, par une épée qui est bien plus qu'une simple arme (et, croyez-moi, l'élection de son porteur n'a rien à voir avec le rocher d'Excalibur) et, depuis 20 ans, la Loi, c'est lui. Ah, vous voyez que ça marche !
Bon, d'accord, je force un peu le trait, mais poursuivons : comme Judge Dredd, arrive un moment où Ashok se retrouve en porte-à-faux avec cette Loi qu'il a si bien servi. Le plus célèbre des chevaliers-protecteurs est désormais l'ennemi n°1 de la Loi. C'est la que la comparaison s'arrête, car Ashok n'a aucune intention de prouver son innocence, parce que c'est tout bonnement impossible.
Que faire d'autre, alors ? Car, c'est aussi ce qui fait d'Ashok un personnage hors du commun, sans la Loi, il n'a pas juste perdu un statut, un idéal, une détermination, un but, non, il a perdu tous ses repères ! Il n'est plus rien, plus personne et n'a qu'une idée en tête : mourir. Il ignore tout le reste, et cela lui ne lui importe pas du tout, de toute manière.
Ashok, c'est un héros, un combattant hors pair. Mais, humainement, c'est une coquille vide. Sa raison d'exister, c'était la Loi. Sans cela, c'est comme s'il n'y avait plus de structure pour permettre à son enveloppe corporelle de tenir debout. A part, peut-être, la rage et la soif de vengeance. Mais, ces émotions ne feront qu'un temps. Et ensuite...
Le désarroi de cet homme, invincible, capable d'aller au sacrifice pour son idéal, mais qui n'est finalement qu'une espèce de fanatique lobotomisé et incapable de penser par lui-même, est sincère. Il n'a pas d'existence en dehors de son service, il n'a pas de but en dehors des missions qu'on lui assigne, il n'a pas d'état d'âme, de questionnements, d'idée, de libre arbitre, au contraire d'un Devedas.
Au fil de ce premier volet, on finit par changer de perception au sujet d'Ashok : alors qu'on le voyait comme un héros imbattable, porteur d'un idéal, incarnant des valeurs, on le considère petit à petit comme un antihéros, trompé, bafoué, victime d'un système inique. Pourtant, dire qu'il est victime d'une injustice est impossible.
Ce n'est pas le moindre des paradoxes de ce premier volet, mais ces mensonges lui ont offert un destin qu'il n'aurait jamais pu envisager si, un jour, Angruvadal ne l'avait pas choisi, si on ne lui avait pas fabriqué une vie sur mesure pour correspondre à cette élection. Et c'est à cela qu'il renonce, parce que c'est ce qui lui semble juste...
De sa vie ultérieure, il est difficile de parler, car il faudrait en révéler beaucoup sur les événements qui se produisent dans "le Fils de l'acier noir". Mais, le dénouement de ce premier tome réserve son lot de surprises et présagent d'une suite qu'il sera intéressant de suivre pour comprendre exactement ce qui attend Ashok. Quel est ce véritable destin qui l'attend.
Il y a quelque chose d'un héros tragique chez Ashok Coeur-de-Pierre, car jamais il ne semble avoir en main les rênes de son destin. Il a fait tomber le voile sur son imposture volontaire, mais une fois redevenu libre, si on peut dire, il continue à ne décider de rien, subissant les événements, y répondant avec ce qu'il sait faire de mieux : se battre et tuer ceux qui se dressent sur son chemin.
Car, parallèlement au parcours d'Ashok, on assiste à tout un tas d'intrigues politiques qui sont en train de se mettre en place au sommet du pouvoir. Là encore, l'objectif final n'apparaît pas immédiatement, et la frontière entre le bien et le mal, les gentils et les méchants est franchement flou. Difficile, même, de savoir s'il y a des "gentils" quelque part.
Pendant que Ashok se cherche, que sa trajectoire dévie et qu'il suit un nouveau destin dont il ne sait encore pas grand-chose, les rapports de force se modifient largement et de grandes manoeuvres se préparent, avec leur lot d'ambitions qu'on veut assouvir et de trahisons qu'on est en train de peaufiner. Et, au milieu de tout cela, quelqu'un qui tire certainement les ficelles d'Ashok, mais qui ? Et pourquoi ?
Je me suis laissé entraîné dans cet univers que j'ai trouvé assez original dans la forme, même si, dans le fond, il fonctionne comme bien d'autres univers de fantasy. Je me suis laissé entraîné par ce personnage d'Ashok, apparemment si lisse et pourtant si intrigant bien malgré lui. Je me suis laissé entraîner par ces manigances ourdies dans l'ombre.
Et je dois dire que j'ai été surpris par pas mal de choses dans la dernière partie de ce premier tome, je ne suis pas sûr qu'on puisse tout à fait parler d'une série de cliffhangers, mais en tout cas, de rebondissements qui vont nous laisser dans une grande incertitude, en attendant de pouvoir lire la suite de ce cycle.
J'ai beaucoup axé ce billet sur Ashok, mais on aurait tort de croire que le roman tourne seulement autour de lui. Je crois qu'on le comprend bien, tout en étant le personnage central, c'est aussi un homme manipulé en permanence. Un des éléments forts auquel on peut s'attendre, d'ailleurs, c'est qu'il découvre un concept nouveau pour lui, la liberté, et que cela influe fortement sur la suite de son existence.
Mais, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a pas mal de personnages secondaires qui évoluent autour de lui. J'ai évoqué Devedas, le meilleur ami d'Ashok, son alter ego et pourtant, un personnage si différent du Coeur-de-Pierre. Si Ashok est une coquille vide, ce n'est pas le cas de Devedas, dont les positions sont amenées à changer au fil du cycle et, si l'on se doute que les amis risquent de devenir des frères ennemis à un moment donné, il est intéressant de voir comment.
Et puis, il y a le personnage de Jagdish, qui m'a bien plu. Jagdish, c'est un soldat, pas un chevalier-protecteur, non, un soldat classique, plutôt compétent, d'ailleurs, mais qui a la poisse. Quoi qu'il fasse, ça tourne mal, et pas de son fait ! Comme Ashok, il ne cesse de tomber de Charybde en Scylla, sauf qu'il n'a pas le fatalisme qui caractérise le chevalier-protecteur et qu'il a bien l'intention de prendre les choses en main.
Ce premier tome a donc posé les jalons du cycle avant de quasiment tout balayer pour remettre en cause les rapports de force qui sous-tendent la vie de cet univers. La Loi, ce rempart fragile censé empêcher le monde de basculer dans la folie est désormais remis en cause. Pas publiquement, non, mais des alternatives apparaissent doucement.
Si la Loi s'effondre, et avec elle tout ce qui a été imposé aux hommes depuis si longtemps, un vide va se créer. Reste à savoir ce qui voudra occuper ce vide : peut-on imaginer renouer avec les traditions d'avant la Loi, et donc avec l'âge de a Foi ? Ou bien d'autres intervenants essaieront-ils d'imposer leur vision des choses ?
Quoi qu'il en soit, cela ne devrait pas se dérouler dans le calme et la suite de ce cycle devrait nous réserver encore quelques moments épiques et violents, avec un Ashok qui va devoir se (re)construire entièrement. Et sans doute décider s'il continue à servir des causes dont il n'est qu'un engrenage, ou s'il se montre plus individualiste, pour briser cette succession de destins qu'on lui impose.
Dans des temps immémoriaux, une terrible guerre a opposé les dieux entre eux. A l'issue de ce conflit, les démons ont été vaincus et chassés. Ils ont trouvé refuge sur la terre habitée par les humains, mais, au lieu de s'y tenir calme, ils ont voulu imposer leur pouvoir par la force, ravageant tout sans aucun état d'âme.
Une situation qui ne pouvaient convenir aux dieux : si les démons ont été exilés, ce n'est pas pour qu'ils puissent faire le mal ailleurs ! Ils ont donc dépêché sur terre un de leurs hommes de confiance, un héros, capable de mettre un terme aux agissements démoniaques sur la terre des hommes. Ce héros se nommait Ramrowan, et il a vaincu à son tour les démons.
Contraints de battre en retraite encore une fois, ceux-ci ont investi les mers et les océans, où ils sont cantonnés depuis. Un partage équitable de la terre des hommes, les humains sur la terre ferme, les démons dans les eaux. Chacun chez soi et toute tentative de briser cet équilibre entraîne une répression immédiate.
Mais, le temps a passé. Des siècles, des millénaires, peut-être. Et ces histoires, après être devenus légendes, se sont perdues. L'homme a fini par oublié cette histoire de dieux et de démons, le héors Ramrowan et sa foi. Seul perdure cette situation partagée : les hommes sur terre, les monstres dans les eaux.
Et, pour réguler tout cela : la Loi.
Chaque être vivant y est soumis en tout point de la terre. Un principe inaliénable, inattaquable, enseigné à tous dès le plus jeune âge. C'est en suivant à la lettre cette Loi que la société a été façonnée selon un système de castes également inviolable : on ne passe pas d'une caste à une autre et, au plus bas de l'échelle sociale, ceux qu'on appelle les sans-caste ne sont même pas considérés comme des humains.
S'il prend l'idée à quelqu'un d'enfreindre la Loi, si des sans-castes se révoltent et prennent les armes, ce qui leur est formellement interdit, ou si des démon quittent les eaux pour investir la terre, alors sont envoyés les chevaliers-protecteurs, des soldats d'élite dont la mission est de faire appliquer la loi, coûte que coûte. Le plus souvent par la force.
Parmi ces héros d'un genre nouveau, qui ont suivi une formation extrême dans leur jeunesse pour devenir ces combattants d'exception au service exclusif de la Loi, il y a Ashok Vadal, surnommé Ashok Coeur-de-Pierre. Plus de 20 ans qu'il est ainsi au service de la Loi aux quatre coins du royaume, une légende vivante redoutée par tous, admirée par ses pairs et fierté de sa caste.
Ashok, c'est une machine, formé pour ne pas se poser de question, simplement appliquer la Loi. Pas de doute, pas de remords, pas de peur, ou si peu, une détermination sans faille et des capacités extraordinaires au combat. Ainsi, lorsqu'on le rencontre, renvoie-t-il dans les eaux deux démons qui ont eu le tort de s'aventurer sur terre. Un exploit qui n'avait plus été accompli depuis des lustres.
Il faut dire que Ashok bénéficie d'un atout maître dans son jeu : Angruvadal, une épée extraordinaire, forgée dans de l'acier noir et qui a la particularité de choisir celui qui la porte et celui qui se bat avec elle. Ashok est un élu, à plus d'un titre. Elu aux yeux de tous ceux qui servent la Loi. Il est son plus grand défenseur, le plus acharné et le plus dévoué.
A l'issue de son dernier exploit, il reçoit un message porté par Devedas, son meilleur ami, chevalier-protecteur qui a suivi sa formation à ses côtés. Ashok apprend qu'il est convoqué à Fort-Capitole auprès de Mindarin, le Grand protecteur. Celui-ci et mourant et, avant de disparaître, il a des révélations à faire à Ashok.
Le mot "révélations" est sans doute trop faible : ce qu'apprend Ashok fait s'effondrer toute son existence. Il n'est pas celui qu'il croyait être depuis aussi loin qu'il se souvienne et cette Loi, ce système qu'il a servi aveuglément toute ces années n'est qu'une illusion, un mensonge. Ce qui Mindarin lui propose alors est inacceptable : Ashok ne peut supporter l'idée de faire perdurer cette imposture.
Alors, il quitte tout, dans l'idée de se venger de ceux qui ont fait de lui ce qu'il est sous de faux prétextes. Ensuite, il acceptera son sort et, étant donné ce qu'il envisage de faire, il n'y aura pas beaucoup de sanctions possibles. Mais peu lui importe tout cela, désormais, puisqu'il n'est plus rien. Puisqu'on lui a repris tout ce qu'on lui avait donné.
Sauf Angruvadal...
Et pourtant, la mort devra attendre. Un autre destin, par ailleurs sans doute suicidaire, va être proposé à Ashok. On lui propose de mettre ses talents au service d'une autre personne, quelqu'un que, peu de temps encore, il aurait sans doute souhaité éliminer au nom de la Loi. Mais, désormais, pour Ashok Coeur-de-Pierre, la Loi n'est plus, alors...
Alors oui, il y a beaucoup de choses très classiques dans ce premier volet, mais d'autres qui sont assez intéressantes et font de ce premier tome, fort de tout de même 500 pages, un bon moment de lecture qu'on n'a pas envie de lâcher. Parce que l'on veut essayer de comprendre où va aller Ashok et de quelle nature sont les mystères qui l'entourent.
Ashok, c'est une espèce de mélange bizarre entre le roi Arthur et Judge Dredd. Dit ainsi, ça surprend un peu, je le reconnais, mais regardez : c'est un personnage qui a été choisi, très jeune, par une épée qui est bien plus qu'une simple arme (et, croyez-moi, l'élection de son porteur n'a rien à voir avec le rocher d'Excalibur) et, depuis 20 ans, la Loi, c'est lui. Ah, vous voyez que ça marche !
Bon, d'accord, je force un peu le trait, mais poursuivons : comme Judge Dredd, arrive un moment où Ashok se retrouve en porte-à-faux avec cette Loi qu'il a si bien servi. Le plus célèbre des chevaliers-protecteurs est désormais l'ennemi n°1 de la Loi. C'est la que la comparaison s'arrête, car Ashok n'a aucune intention de prouver son innocence, parce que c'est tout bonnement impossible.
Que faire d'autre, alors ? Car, c'est aussi ce qui fait d'Ashok un personnage hors du commun, sans la Loi, il n'a pas juste perdu un statut, un idéal, une détermination, un but, non, il a perdu tous ses repères ! Il n'est plus rien, plus personne et n'a qu'une idée en tête : mourir. Il ignore tout le reste, et cela lui ne lui importe pas du tout, de toute manière.
Ashok, c'est un héros, un combattant hors pair. Mais, humainement, c'est une coquille vide. Sa raison d'exister, c'était la Loi. Sans cela, c'est comme s'il n'y avait plus de structure pour permettre à son enveloppe corporelle de tenir debout. A part, peut-être, la rage et la soif de vengeance. Mais, ces émotions ne feront qu'un temps. Et ensuite...
Le désarroi de cet homme, invincible, capable d'aller au sacrifice pour son idéal, mais qui n'est finalement qu'une espèce de fanatique lobotomisé et incapable de penser par lui-même, est sincère. Il n'a pas d'existence en dehors de son service, il n'a pas de but en dehors des missions qu'on lui assigne, il n'a pas d'état d'âme, de questionnements, d'idée, de libre arbitre, au contraire d'un Devedas.
Au fil de ce premier volet, on finit par changer de perception au sujet d'Ashok : alors qu'on le voyait comme un héros imbattable, porteur d'un idéal, incarnant des valeurs, on le considère petit à petit comme un antihéros, trompé, bafoué, victime d'un système inique. Pourtant, dire qu'il est victime d'une injustice est impossible.
Ce n'est pas le moindre des paradoxes de ce premier volet, mais ces mensonges lui ont offert un destin qu'il n'aurait jamais pu envisager si, un jour, Angruvadal ne l'avait pas choisi, si on ne lui avait pas fabriqué une vie sur mesure pour correspondre à cette élection. Et c'est à cela qu'il renonce, parce que c'est ce qui lui semble juste...
De sa vie ultérieure, il est difficile de parler, car il faudrait en révéler beaucoup sur les événements qui se produisent dans "le Fils de l'acier noir". Mais, le dénouement de ce premier tome réserve son lot de surprises et présagent d'une suite qu'il sera intéressant de suivre pour comprendre exactement ce qui attend Ashok. Quel est ce véritable destin qui l'attend.
Il y a quelque chose d'un héros tragique chez Ashok Coeur-de-Pierre, car jamais il ne semble avoir en main les rênes de son destin. Il a fait tomber le voile sur son imposture volontaire, mais une fois redevenu libre, si on peut dire, il continue à ne décider de rien, subissant les événements, y répondant avec ce qu'il sait faire de mieux : se battre et tuer ceux qui se dressent sur son chemin.
Car, parallèlement au parcours d'Ashok, on assiste à tout un tas d'intrigues politiques qui sont en train de se mettre en place au sommet du pouvoir. Là encore, l'objectif final n'apparaît pas immédiatement, et la frontière entre le bien et le mal, les gentils et les méchants est franchement flou. Difficile, même, de savoir s'il y a des "gentils" quelque part.
Pendant que Ashok se cherche, que sa trajectoire dévie et qu'il suit un nouveau destin dont il ne sait encore pas grand-chose, les rapports de force se modifient largement et de grandes manoeuvres se préparent, avec leur lot d'ambitions qu'on veut assouvir et de trahisons qu'on est en train de peaufiner. Et, au milieu de tout cela, quelqu'un qui tire certainement les ficelles d'Ashok, mais qui ? Et pourquoi ?
Je me suis laissé entraîné dans cet univers que j'ai trouvé assez original dans la forme, même si, dans le fond, il fonctionne comme bien d'autres univers de fantasy. Je me suis laissé entraîné par ce personnage d'Ashok, apparemment si lisse et pourtant si intrigant bien malgré lui. Je me suis laissé entraîner par ces manigances ourdies dans l'ombre.
Et je dois dire que j'ai été surpris par pas mal de choses dans la dernière partie de ce premier tome, je ne suis pas sûr qu'on puisse tout à fait parler d'une série de cliffhangers, mais en tout cas, de rebondissements qui vont nous laisser dans une grande incertitude, en attendant de pouvoir lire la suite de ce cycle.
J'ai beaucoup axé ce billet sur Ashok, mais on aurait tort de croire que le roman tourne seulement autour de lui. Je crois qu'on le comprend bien, tout en étant le personnage central, c'est aussi un homme manipulé en permanence. Un des éléments forts auquel on peut s'attendre, d'ailleurs, c'est qu'il découvre un concept nouveau pour lui, la liberté, et que cela influe fortement sur la suite de son existence.
Mais, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a pas mal de personnages secondaires qui évoluent autour de lui. J'ai évoqué Devedas, le meilleur ami d'Ashok, son alter ego et pourtant, un personnage si différent du Coeur-de-Pierre. Si Ashok est une coquille vide, ce n'est pas le cas de Devedas, dont les positions sont amenées à changer au fil du cycle et, si l'on se doute que les amis risquent de devenir des frères ennemis à un moment donné, il est intéressant de voir comment.
Et puis, il y a le personnage de Jagdish, qui m'a bien plu. Jagdish, c'est un soldat, pas un chevalier-protecteur, non, un soldat classique, plutôt compétent, d'ailleurs, mais qui a la poisse. Quoi qu'il fasse, ça tourne mal, et pas de son fait ! Comme Ashok, il ne cesse de tomber de Charybde en Scylla, sauf qu'il n'a pas le fatalisme qui caractérise le chevalier-protecteur et qu'il a bien l'intention de prendre les choses en main.
Ce premier tome a donc posé les jalons du cycle avant de quasiment tout balayer pour remettre en cause les rapports de force qui sous-tendent la vie de cet univers. La Loi, ce rempart fragile censé empêcher le monde de basculer dans la folie est désormais remis en cause. Pas publiquement, non, mais des alternatives apparaissent doucement.
Si la Loi s'effondre, et avec elle tout ce qui a été imposé aux hommes depuis si longtemps, un vide va se créer. Reste à savoir ce qui voudra occuper ce vide : peut-on imaginer renouer avec les traditions d'avant la Loi, et donc avec l'âge de a Foi ? Ou bien d'autres intervenants essaieront-ils d'imposer leur vision des choses ?
Quoi qu'il en soit, cela ne devrait pas se dérouler dans le calme et la suite de ce cycle devrait nous réserver encore quelques moments épiques et violents, avec un Ashok qui va devoir se (re)construire entièrement. Et sans doute décider s'il continue à servir des causes dont il n'est qu'un engrenage, ou s'il se montre plus individualiste, pour briser cette succession de destins qu'on lui impose.
"Qu'était-il arrivé à ce site ? Ces jours-ci, les gens s'entretuaient sur MyFace (...) C'était donc fini, l'époque innocente où l'on pokait ses amis ou on leur envoyait des cochons ?"
Ah, les réseaux sociaux ! Le fer de lance de la révolution 2.0 en ce début de XXIe siècle ! On les critique, on les vilipende, mais on les utilise dans notre grande majorité. Pour communiquer, pour échanger, pour se montrer, aussi. Facebook est le site roi, le plus influent, au point qu'on l'accusera bientôt de tous les maux, de faire et défaire les puissants... Notre roman du jour s'inspire de cette situation et offre une satire de la société américaine contemporaine à travers cette idée très amusante et provocante : un tueur en série qui choisit ses victimes au hasard sur un réseau social qui fait fortement penser à Facebook. Au hasard, vraiment ? "Indian Psycho", d'Arun Krishnan (en grand format chez Asphalte Editions ; traduction de Marthe Picard), est un roman sombre et drôle à la fois. Sombre, parce qu'il y a de quoi s'inquiéter des comportements décrits dans le livre ; drôle, parce que le personnage central est haut en couleur, à la fois naïf et retors. Mais c'est surtout une formidable réponse à l' "American Psycho", de Bret Easton Ellis, dont Krishnan reprend bien des codes. Une vision actuelle, portée aussi par les questions du multiculturalisme et du racisme aux Etats-Unis...
Arjun est né en Inde, dans une des plus basses castes de la société. L'assurance d'un avenir sans espoir ni horizon. Mais, ce destin va radicalement changer quand il a été adopté par les Clarkson, un couple d'Américains installé sur le sous-continent. En devenant Arjun Clarkson, il voit de tout autres perspectives s'ouvrir à lui...
Et en particulier, se rendre aux Etats-Unis, ce pays qui le fascine. Le pays de tous les possibles. Eh oui, le bon vieux rêve américain fonctionne encore ! Devenu adulte, il a donc décidé de s'installer aux Etats-Unis, mais pas comme citoyen américain, mais avec un visa de travailleur. Il a été embauché par une agence de publicité dans laquelle il a débuté une carrière très prometteuse.
Son domaine : la gestion des portefeuilles d'entreprise souhaitant faire leur promotion sur internet. De manière innée, Arjun maîtrise parfaitement les arcanes du monde virtuel et les stratégies qu'il élabore débouchent généralement sur de spectaculaires suspects. Et, si les clients de l'agence se montrent encore prudents vis-à-vis du web, le travail du jeune homme fait monter leur confiance.
Tout pourrait donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais la vie américaine d'Arjun n'atteint pas la perfection. D'abord, parce que, malgré ses efforts pour s'intégrer, il reste un Indien et doute qu'on le considère un jour comme un Américain. Dans la vie quotidienne, la vie IRL, comme on dit, il ne maîtrise pas encore tous les codes et la couleur de sa peau n'est pas la seule chose qui fasse de lui un étranger.
En Amérique, Arjun n'est pas un intouchable, comme dans son pays natal, son statut social est nettement plus enviable, désormais. Pourtant, même s'il grimpe échelon après échelon l'échelle sociale, si son salaire connaît une progression régulière qui en fait un membre des classes moyennes supérieures, il se sent toujours un peu à l'écart.
D'autre part, il se sent seul. Arjun est un vrai geek, un timide, un discret, un naïf. Un gentil garçon avec qui on aime rire (parfois à ses dépens, d'ailleurs) ou travailler, mais pas vraiment le genre de garçon que les filles remarquent. A commencer par Emily, son ancienne collègue, qui a séduit Arjun dès son arrivée dans sa boîte de pub.
Des sentiments sur lesquels Arjun peine à mettre des mots, il parle d'estime quand on se dit que cela ressemble beaucoup à de l'amour et du désir. Oui, le jeune homme est amoureux, mais n'a pas su faire partager ce sentiment. Pire, Emily a quitté la boîte pour une autre, plus importante... Désormais, Arjun se contente de la suivre à travers son profil sur le célèbre réseau social MyFace.
Non seulement il y apprend tout ce qu'apprécie et tout ce que déteste la jeune femme, mais le système de géolocalisation du site permet à Arjun de savoir où se trouve Emily en temps réel. Et d'organiser une petite rencontre due... au hasard, bien sûr ! Mais la rencontre ne se passe pas tout à fait comme l'avait prévu Arjun.
Se sentant rejeté par la jeune femme, rongé par la jalousie, le jeune Indien assassine Emily. Puis, sur un nouveau coup de tête, il fait de même avec Raj, son collègue et son rival, celui qui se moquait sans cesse de lui et qui, en plus, avait ravi le coeur d'Emily... Un double meurtre découvert assez rapidement, tout comme le lien entre les victimes.
Dans son impulsivité, Arjun a oublié ces aspects élémentaires. L'agence pour laquelle il travaille se retrouve donc dans le collimateur de la police et l'inspecteur en charge de l'enquête semble s'intéresser particulièrement à Arjun, qui sent se rapprocher de lui le couperet de la justice... Il doit donc trouver un moyen de se disculper.
Et l'idée va lui venir devant une photo : près d'un des corps, un autocollant promotionnel pour MyFace, comme on en trouve partout. Et si... Et si d'autres victimes étaient découvertes et que le tueur expliquait les avoir choisies au hasard en surfant sur le réseau social ? Oh, bien sûr, il va lui falloir tuer, encore et encore...
Ce ne sera pas sans doute pas terrible pour le karma du fervent bouddhiste qu'est Arjun. Mais, il se trouve qu'il a aimé ce qu'il a ressenti en tuant... Ce pouvoir, cette puissance... Jamais il n'a connu cela ! Et, effectivement, depuis qu'il est devenu un tueur, le garçon timide gagne en assurance, en confiance en soi...
"Indian Psycho" est une véritable satire et c'est ce qui fait de ce roman un livre très drôle, malgré sa profonde noirceur. La manière dont Arun (et pas Arjun, ne confondons pas, ce pourrait être embêtant pour l'auteur, même s'il a beaucoup de points commun avec son personnage), dont Arun Krishnan, écrivais-je, fait monter lentement mais sûrement la psychose autour des réseaux sociaux est tout à fait réussie (et assez réjouissante, même).
On a beau le savoir, se le répéter, on continue de mettre notre existence en façade sur les réseau sociaux, d'ouvrir notre intimité à des inconnus, dont certains sont des amis, mot sublime qui ne devient qu'un élément du jargon d'internet. Ce qui est intéressant, c'est la relation très ambivalente du personnage d'Arjun vis-à-vis de MyFace.
Il en maîtrise les codes, les règles, les techniques, puisque c'est son boulot et qu'il est très bon dans son domaine. Et, peut-être d'ailleurs parce qu'il connaît si bien tout cela, il s'en méfie. Il a crée un profil, mais il y est très peu actif et surtout, il n'y livre rien de vraiment personnel, quand d'autres révèlent à peu près tout de leur personnalité, de leurs goûts, de leur vie.
Arjun est un espèce de fantôme qui traverse les murs des abonnés à MyFace, observe, regarde... C'est un voyeur du monde virtuel, bien planqué derrière son écran. Inoffensif, jusqu'à ce que sa vie bascule et qu'il ne s'improvise tueur en série pour ne pas être pris pour ce qu'il est : un assassin. Et sa riche et discrète expérience sur MyFace va alors être un atout précieux dans sa folle stratégie.
MyFace est évidemment un avatar de Facebook, le plus emblématique et le plus puissant des réseaux sociaux. En arrière-plan de l'intrigue, Arun Krishnan critique ce système qui abolit toute intimité, toute barrière entre les êtres avec leur propre consentement. Il y voit l'abolissement d'un libre arbitre, un système absurde où l'exhibitionnisme répond au voyeurisme.
Outil de contrôle dans un meilleur des mondes construit par ceux qui seront soumis ensuite, MyFace est, d'une certaine manière, perverti par le tueur qui utilise à son compte pour choisir ses victimes les données que seuls les grands patrons du réseaux et les tout-puissants annonceurs devraient pouvoir utiliser à leur (gigantesque) profit.
Et puis, il y a l'influence de Bret Easton Ellis, même si le titre en VO, "Antisocial", n'est pas aussi référencé que le titre français... Après Alain Mabanckou, qui l'avait parodié dans son "African Psycho", où il faisait de son personnage le plus maladroit des tueurs en série, voici donc un Patrick Bateman venu du sous-continent indien. Mais, si Mabanckou s'éloignait beaucoup du modèle, Arun Krishnan, lui, a décidé d'y coller.
"American Pyscho" est paru en France en 1992 et, comme partout, ce fut un succès, critique et public, et l'objet de controverses et d'interminables discussions. Des fans, des détracteurs, des visions de l'histoire qui divergent, voire s'opposent... Un roman phénomène qui a marqué une génération, parfois pris au premier degré ou mal compris, mais qui, un quart de siècle après, fait encore parler.
Arun Krishnan en reprend le décor (New York) les codes (le name-dropping, les marques, les fringues, les lieux à la mode...) et la fuite en avant du personnage central (sauf que, dans le cas d'Arjun, aucun doute : il ne fantasme pas ses crimes). Il ne modifie en fait que ce personnage qui n'est plus golden-boy, le job phare des années 1980, mais bosse dans la net-économie.
Il abandonne aussi son WASP triomphant, individualiste et prêt à tout pour réussir, s'enrichir et arracher sa petite part d'un pouvoir matériel somme toute assez dérisoire, pour un immigré indien qui débarque dans une Amérique un peu en panne, pour travailler dans le nouvel eldorado, l'internet, mais pas dans sa dimension libertaire, non, dans sa facette la plus crûment capitaliste.
Le constat est à la fois cruel et amer pour l'Amérique contemporaine (le roman est paru en VO à la fin 2015, avant l'élection de Donald Trump), mais aussi pour New York, souvent décrite comme la ville cosmopolite et tolérante par excellence. A l'image de ces réseaux sociaux et des liens qui s'y nouent, le rêve américain ressemble bien à un miroir aux alouettes.
Arjun souffre de sa situation, du regard des autres. De ne pas être un Américain à part entière. Il n'a pas la nationalité, juste un visa de travail, il ne maîtrise pas tous les codes sociaux ni le langage dans sa totalité, il peine avec l'humour et le second degré, il est encore très imprégné de sa culture d'origine et bien loin de se fondre dans cette société qui ne doit pas tout à fait ressembler à celle qu'il imaginait.
Le racisme est très présent dans "Indian Psycho", parfois de manière inconsciente chez les interlocuteurs du jeune indien. Il en est blessé, mais il encaisse, sans se plaindre, sans entrer dans des discussions interminables. Alors, quand il commence à tuer, c'est aussi une espèce de catharsis pour lui. Une revanche sur cette ville, sur cette société qui le récompense pour son travail mais le laisse soigneusement à l'écart.
"Indian Psycho" ne célèbre pas la réussite individuelle, la gloire matérialiste poussée à l'extrême, comme son modèle, mais bel et bien l'échec d'un jeune homme qui aspirait à vivre ce rêve qu'on lui a sur-vendu, comme on le sur-vend depuis si longtemps dans le monde entier. L'échec d'un pays qui attire les talents, les rémunère certes confortablement, mais les laisse tout de même dans l'antichambre.
Le matérialisme demeure, la superficialité de cette société où le paraître écrase tout impitoyablement aussi. Mais, Arun Krishnan casse l'indifférence terrifiante qu'il y a dans "American Psycho". Le vrai pouvoir d'Arjun Clarkson, c'est la peur qu'inspirent ses actes à toute une ville, tout un pays, et même au-delà. En tuant, il devient un démiurge, un dieu...
Il fait trembler l'Amérique !!
Voilà qui fait de cette lecture un roman très noir, et pourtant, on s'amuse énormément. Arjun est un personnage facétieux, sympathique, touchant par sa maladresse et sa naïveté. Mais n'est-ce pas une image, avec tout ce que cela peut avoir de trompeur ? Arjun est le narrateur du roman, d'une certaine manière, en nous racontant son histoire, il se met en scène. Comme ça l'arrange.
Le gentil garçon un peu perdu, le geek distrait et candide disparaît au fil de ses crimes pour laisser la place à un tout autre personnage. Oh, il n'en est pas forcément moins charmeur, mais il se montre cynique, machiavélique, sans pitié, lancé dans une spirale de violence qui ne semble pas avoir de fin. Il nargue la police, MyFace, ses abonnés, New York, l'Amérique, et bientôt le monde.
Il change, et pourtant, on peut se demander à certains indices si ce profil-là n'est pas en fait sa véritable personnalité. De son passé en Inde, on sait relativement peu de choses, mais ce que l'on en devine laisse imaginer que le hasard n'a décidément rien à faire dans ce roman. Ni pour la rencontre initiale, ni pour le choix des victimes, ni pour la soudaine vocation de tueur d'Arjun...
Et, si chez Bret Easton Ellis, il y avait une réelle ambiguïté construite autour de la réalité des actes commis par Patrick Bateman, chez Arun Krishnan, elle se déplace sur la réelle personnalité d'Arjun Clarkson... On finit par se dire que Krshnan a en fait marié deux personnages mythiques de ce tournant des années 1980-90, Patrick Bateman, donc, et Hannibal Lecter.
D'une certaine manière, on retrouve cette double filiation jusque dans le dénouement du roman d'Arun Krishnan, avec une chute très amusante et très bien vue. La satire est efficace, elle s'étend finalement aussi à la nouvelle polarisation du monde qui est le nôtre, entre "vieilles" puissances asthmatiques et puissances émergentes qui entendent bien tout balayer sur leur passage.
Le dernier mot de ce billet sera musical. "Indian Psycho" est porté par une très agréable bande-son, essentiellement jazzy, mais pas uniquement, de Coltrane à Ellignton, en passant par Miles Davis et Herbie Hancock. En fin d'ouvrage, on trouve une playlist qui reprend en grande partie les morceaux écoutés par les personnages, mais pas uniquement. Et c'est parfait pour accompagner sa lecture...
Arjun est né en Inde, dans une des plus basses castes de la société. L'assurance d'un avenir sans espoir ni horizon. Mais, ce destin va radicalement changer quand il a été adopté par les Clarkson, un couple d'Américains installé sur le sous-continent. En devenant Arjun Clarkson, il voit de tout autres perspectives s'ouvrir à lui...
Et en particulier, se rendre aux Etats-Unis, ce pays qui le fascine. Le pays de tous les possibles. Eh oui, le bon vieux rêve américain fonctionne encore ! Devenu adulte, il a donc décidé de s'installer aux Etats-Unis, mais pas comme citoyen américain, mais avec un visa de travailleur. Il a été embauché par une agence de publicité dans laquelle il a débuté une carrière très prometteuse.
Son domaine : la gestion des portefeuilles d'entreprise souhaitant faire leur promotion sur internet. De manière innée, Arjun maîtrise parfaitement les arcanes du monde virtuel et les stratégies qu'il élabore débouchent généralement sur de spectaculaires suspects. Et, si les clients de l'agence se montrent encore prudents vis-à-vis du web, le travail du jeune homme fait monter leur confiance.
Tout pourrait donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais la vie américaine d'Arjun n'atteint pas la perfection. D'abord, parce que, malgré ses efforts pour s'intégrer, il reste un Indien et doute qu'on le considère un jour comme un Américain. Dans la vie quotidienne, la vie IRL, comme on dit, il ne maîtrise pas encore tous les codes et la couleur de sa peau n'est pas la seule chose qui fasse de lui un étranger.
En Amérique, Arjun n'est pas un intouchable, comme dans son pays natal, son statut social est nettement plus enviable, désormais. Pourtant, même s'il grimpe échelon après échelon l'échelle sociale, si son salaire connaît une progression régulière qui en fait un membre des classes moyennes supérieures, il se sent toujours un peu à l'écart.
D'autre part, il se sent seul. Arjun est un vrai geek, un timide, un discret, un naïf. Un gentil garçon avec qui on aime rire (parfois à ses dépens, d'ailleurs) ou travailler, mais pas vraiment le genre de garçon que les filles remarquent. A commencer par Emily, son ancienne collègue, qui a séduit Arjun dès son arrivée dans sa boîte de pub.
Des sentiments sur lesquels Arjun peine à mettre des mots, il parle d'estime quand on se dit que cela ressemble beaucoup à de l'amour et du désir. Oui, le jeune homme est amoureux, mais n'a pas su faire partager ce sentiment. Pire, Emily a quitté la boîte pour une autre, plus importante... Désormais, Arjun se contente de la suivre à travers son profil sur le célèbre réseau social MyFace.
Non seulement il y apprend tout ce qu'apprécie et tout ce que déteste la jeune femme, mais le système de géolocalisation du site permet à Arjun de savoir où se trouve Emily en temps réel. Et d'organiser une petite rencontre due... au hasard, bien sûr ! Mais la rencontre ne se passe pas tout à fait comme l'avait prévu Arjun.
Se sentant rejeté par la jeune femme, rongé par la jalousie, le jeune Indien assassine Emily. Puis, sur un nouveau coup de tête, il fait de même avec Raj, son collègue et son rival, celui qui se moquait sans cesse de lui et qui, en plus, avait ravi le coeur d'Emily... Un double meurtre découvert assez rapidement, tout comme le lien entre les victimes.
Dans son impulsivité, Arjun a oublié ces aspects élémentaires. L'agence pour laquelle il travaille se retrouve donc dans le collimateur de la police et l'inspecteur en charge de l'enquête semble s'intéresser particulièrement à Arjun, qui sent se rapprocher de lui le couperet de la justice... Il doit donc trouver un moyen de se disculper.
Et l'idée va lui venir devant une photo : près d'un des corps, un autocollant promotionnel pour MyFace, comme on en trouve partout. Et si... Et si d'autres victimes étaient découvertes et que le tueur expliquait les avoir choisies au hasard en surfant sur le réseau social ? Oh, bien sûr, il va lui falloir tuer, encore et encore...
Ce ne sera pas sans doute pas terrible pour le karma du fervent bouddhiste qu'est Arjun. Mais, il se trouve qu'il a aimé ce qu'il a ressenti en tuant... Ce pouvoir, cette puissance... Jamais il n'a connu cela ! Et, effectivement, depuis qu'il est devenu un tueur, le garçon timide gagne en assurance, en confiance en soi...
"Indian Psycho" est une véritable satire et c'est ce qui fait de ce roman un livre très drôle, malgré sa profonde noirceur. La manière dont Arun (et pas Arjun, ne confondons pas, ce pourrait être embêtant pour l'auteur, même s'il a beaucoup de points commun avec son personnage), dont Arun Krishnan, écrivais-je, fait monter lentement mais sûrement la psychose autour des réseaux sociaux est tout à fait réussie (et assez réjouissante, même).
On a beau le savoir, se le répéter, on continue de mettre notre existence en façade sur les réseau sociaux, d'ouvrir notre intimité à des inconnus, dont certains sont des amis, mot sublime qui ne devient qu'un élément du jargon d'internet. Ce qui est intéressant, c'est la relation très ambivalente du personnage d'Arjun vis-à-vis de MyFace.
Il en maîtrise les codes, les règles, les techniques, puisque c'est son boulot et qu'il est très bon dans son domaine. Et, peut-être d'ailleurs parce qu'il connaît si bien tout cela, il s'en méfie. Il a crée un profil, mais il y est très peu actif et surtout, il n'y livre rien de vraiment personnel, quand d'autres révèlent à peu près tout de leur personnalité, de leurs goûts, de leur vie.
Arjun est un espèce de fantôme qui traverse les murs des abonnés à MyFace, observe, regarde... C'est un voyeur du monde virtuel, bien planqué derrière son écran. Inoffensif, jusqu'à ce que sa vie bascule et qu'il ne s'improvise tueur en série pour ne pas être pris pour ce qu'il est : un assassin. Et sa riche et discrète expérience sur MyFace va alors être un atout précieux dans sa folle stratégie.
MyFace est évidemment un avatar de Facebook, le plus emblématique et le plus puissant des réseaux sociaux. En arrière-plan de l'intrigue, Arun Krishnan critique ce système qui abolit toute intimité, toute barrière entre les êtres avec leur propre consentement. Il y voit l'abolissement d'un libre arbitre, un système absurde où l'exhibitionnisme répond au voyeurisme.
Outil de contrôle dans un meilleur des mondes construit par ceux qui seront soumis ensuite, MyFace est, d'une certaine manière, perverti par le tueur qui utilise à son compte pour choisir ses victimes les données que seuls les grands patrons du réseaux et les tout-puissants annonceurs devraient pouvoir utiliser à leur (gigantesque) profit.
Et puis, il y a l'influence de Bret Easton Ellis, même si le titre en VO, "Antisocial", n'est pas aussi référencé que le titre français... Après Alain Mabanckou, qui l'avait parodié dans son "African Psycho", où il faisait de son personnage le plus maladroit des tueurs en série, voici donc un Patrick Bateman venu du sous-continent indien. Mais, si Mabanckou s'éloignait beaucoup du modèle, Arun Krishnan, lui, a décidé d'y coller.
"American Pyscho" est paru en France en 1992 et, comme partout, ce fut un succès, critique et public, et l'objet de controverses et d'interminables discussions. Des fans, des détracteurs, des visions de l'histoire qui divergent, voire s'opposent... Un roman phénomène qui a marqué une génération, parfois pris au premier degré ou mal compris, mais qui, un quart de siècle après, fait encore parler.
Arun Krishnan en reprend le décor (New York) les codes (le name-dropping, les marques, les fringues, les lieux à la mode...) et la fuite en avant du personnage central (sauf que, dans le cas d'Arjun, aucun doute : il ne fantasme pas ses crimes). Il ne modifie en fait que ce personnage qui n'est plus golden-boy, le job phare des années 1980, mais bosse dans la net-économie.
Il abandonne aussi son WASP triomphant, individualiste et prêt à tout pour réussir, s'enrichir et arracher sa petite part d'un pouvoir matériel somme toute assez dérisoire, pour un immigré indien qui débarque dans une Amérique un peu en panne, pour travailler dans le nouvel eldorado, l'internet, mais pas dans sa dimension libertaire, non, dans sa facette la plus crûment capitaliste.
Le constat est à la fois cruel et amer pour l'Amérique contemporaine (le roman est paru en VO à la fin 2015, avant l'élection de Donald Trump), mais aussi pour New York, souvent décrite comme la ville cosmopolite et tolérante par excellence. A l'image de ces réseaux sociaux et des liens qui s'y nouent, le rêve américain ressemble bien à un miroir aux alouettes.
Arjun souffre de sa situation, du regard des autres. De ne pas être un Américain à part entière. Il n'a pas la nationalité, juste un visa de travail, il ne maîtrise pas tous les codes sociaux ni le langage dans sa totalité, il peine avec l'humour et le second degré, il est encore très imprégné de sa culture d'origine et bien loin de se fondre dans cette société qui ne doit pas tout à fait ressembler à celle qu'il imaginait.
Le racisme est très présent dans "Indian Psycho", parfois de manière inconsciente chez les interlocuteurs du jeune indien. Il en est blessé, mais il encaisse, sans se plaindre, sans entrer dans des discussions interminables. Alors, quand il commence à tuer, c'est aussi une espèce de catharsis pour lui. Une revanche sur cette ville, sur cette société qui le récompense pour son travail mais le laisse soigneusement à l'écart.
"Indian Psycho" ne célèbre pas la réussite individuelle, la gloire matérialiste poussée à l'extrême, comme son modèle, mais bel et bien l'échec d'un jeune homme qui aspirait à vivre ce rêve qu'on lui a sur-vendu, comme on le sur-vend depuis si longtemps dans le monde entier. L'échec d'un pays qui attire les talents, les rémunère certes confortablement, mais les laisse tout de même dans l'antichambre.
Le matérialisme demeure, la superficialité de cette société où le paraître écrase tout impitoyablement aussi. Mais, Arun Krishnan casse l'indifférence terrifiante qu'il y a dans "American Psycho". Le vrai pouvoir d'Arjun Clarkson, c'est la peur qu'inspirent ses actes à toute une ville, tout un pays, et même au-delà. En tuant, il devient un démiurge, un dieu...
Il fait trembler l'Amérique !!
Voilà qui fait de cette lecture un roman très noir, et pourtant, on s'amuse énormément. Arjun est un personnage facétieux, sympathique, touchant par sa maladresse et sa naïveté. Mais n'est-ce pas une image, avec tout ce que cela peut avoir de trompeur ? Arjun est le narrateur du roman, d'une certaine manière, en nous racontant son histoire, il se met en scène. Comme ça l'arrange.
Le gentil garçon un peu perdu, le geek distrait et candide disparaît au fil de ses crimes pour laisser la place à un tout autre personnage. Oh, il n'en est pas forcément moins charmeur, mais il se montre cynique, machiavélique, sans pitié, lancé dans une spirale de violence qui ne semble pas avoir de fin. Il nargue la police, MyFace, ses abonnés, New York, l'Amérique, et bientôt le monde.
Il change, et pourtant, on peut se demander à certains indices si ce profil-là n'est pas en fait sa véritable personnalité. De son passé en Inde, on sait relativement peu de choses, mais ce que l'on en devine laisse imaginer que le hasard n'a décidément rien à faire dans ce roman. Ni pour la rencontre initiale, ni pour le choix des victimes, ni pour la soudaine vocation de tueur d'Arjun...
Et, si chez Bret Easton Ellis, il y avait une réelle ambiguïté construite autour de la réalité des actes commis par Patrick Bateman, chez Arun Krishnan, elle se déplace sur la réelle personnalité d'Arjun Clarkson... On finit par se dire que Krshnan a en fait marié deux personnages mythiques de ce tournant des années 1980-90, Patrick Bateman, donc, et Hannibal Lecter.
D'une certaine manière, on retrouve cette double filiation jusque dans le dénouement du roman d'Arun Krishnan, avec une chute très amusante et très bien vue. La satire est efficace, elle s'étend finalement aussi à la nouvelle polarisation du monde qui est le nôtre, entre "vieilles" puissances asthmatiques et puissances émergentes qui entendent bien tout balayer sur leur passage.
Le dernier mot de ce billet sera musical. "Indian Psycho" est porté par une très agréable bande-son, essentiellement jazzy, mais pas uniquement, de Coltrane à Ellignton, en passant par Miles Davis et Herbie Hancock. En fin d'ouvrage, on trouve une playlist qui reprend en grande partie les morceaux écoutés par les personnages, mais pas uniquement. Et c'est parfait pour accompagner sa lecture...
mercredi 21 février 2018
"Le péché a pénétré entre ces murs. Il n'a pas eu besoin d'entrer par le trou de la serrure. Tout simplement parce qu'il avait la clé".
Les murs en questions sont ceux de Notre-Dame de Paris. Pas la version post-apocalyptique d'Arlette de Bodard dans "la Chute de la Maison aux Flèches d'Argent", mais la version actuelle, entre lieu de culte et site touristique. La cathédrale est en fait le cadre d'une série de polars, assez classiques dans le fond, dont voici le premier tome. Une série qui met en scène un improbable duo : un prêtre (et vous verrez que ce personnage en soi est très particulier) et une jeune substitut du procureur, encore un peu verte. Ils vont se rencontrer pour la première fois dans "La Madone de Notre-Dame", d'Alexis Ragougneau (en poche aux éditions Points), autour d'une enquête délicate et d'un suspect un peu trop parfait. Entre Notre-Dame, le palais de justice et le 36, quelques centaines de mètres tout au plus, sur une île de la Cité qui réunit pouvoir terrestre et pouvoir spirituel. Mais, dans les deux cas, le mot important, c'est le pouvoir...
En ce lundi 16 août, qui s'annonce particulièrement chaud, la cathédrale Notre-Dame de Paris se prépare à accueillir une foule importante. D'un côté les fidèles, qui se presseront aux différents offices ; de l'autre, et ils sont de loin les plus nombreux, les touristes qui entendent visiter ce monument incontournable de la capitale.
Il faut donc que tout soit parfait à l'intérieur du bâtiment pour que chaque personne en franchissant le seuil profite au mieux de sa visite. Mais, le personnel se prépare aussi à une dure journée, au cours de laquelle il faudra recadrer quelques touristes un peu trop bruyants ou oubliant la nature du lieu dans lequel ils sont entrés.
Il est encore tôt, ce matin-là, les surveillants ont encore la possibilité de plaisanter, le plus gros de la fréquentation quotidienne n'est pas encore arrivé. L'un d'eux prévient son collègue qu'il a repéré "une bombe" dans le déambulatoire, à hauteur de la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Dans leur jargon, pas très fin, il faut le reconnaître, il s'agit d'évoquer une ravissante visiteuse.
Et, effectivement, devant la chapelle, se trouve une jeune femme en train de prier. Sa posture contraste avec sa tenue : une robe blanche, certes, mais peut-être un peu trop courte pour un lieu de culte. Mais l'image est attendrissante, elle pourrait inspirer n'importe quel peintre voulant réaliser le portrait d'une madone.
Mais, soudain, alors qu'une autre fidèle s'assoit à ses côtés, l'orante bascule et s'écroule au sol. Hurlement de la touriste américaine et stupeur générale... La "bombe" vient d'exploser : la jeune femme est morte, et il semble bien que Dieu ne l'ait pas rappelée à lui alors qu'elle le priait, mais qu'elle ait trépassé suite à un acte bassement humain.
Etranglée. Et installée dans cette macabre mise en scène au mauvais goût certain. D'autres détails sont découverts lors de l'examen médico-légal qui donnent la nausée... La demoiselle a été victime d'un meurtre et son assassin a profané son corps. En pleine cathédrale... Le genre d'histoire qui, même en cette période habituellement très calme de la mi-août, devrait mobiliser tous les médias...
Sur place, la substitut du procureur Claire Kauffmann, flanquée de deux policiers, le commandant Landard et le lieutenant Gombrowicz. Ils n'ont pas eu un long chemin à faire pour arriver sur les lieux du crime, puisque le palais de justice et le 36, quai des Orfèvres se trouvent à deux pas, sur la même rive de l'île de la Cité.
A eux de mener l'enquête avec tact et discrétion, mais aussi avec rapidité car, personne n'est dupe, quelques précautions que l'on prenne, l'information finira forcément par fuiter et par atterrir sur les desks de toutes les rédactions de la capitale. Un meurtre à Notre-Dame, ça devrait faire de l'audience et faire vendre du papier, coco !
Claire Kauffmann est une jeune magistrate, encore inexpérimentée, qui se retrouve face à son premier dossier d'envergure. Mais l'inexpérience n'exclut pas l'ambition et elle sait très bien que cette affaire sera un test très important pour sa carrière à venir. Plutôt petite, avec un physique qui fait penser aux actrices blondes des films d'Alfred Hitchcock, elle reste marquée par un drame personnel intervenu dans sa jeunesse.
Le commandant Landard est un vieux de la vieille du 36, un flic à l'ancienne, comme on n'en fait plus. Et c'est vrai qu'il semble sorti d'un vieux roman de gare corné de partout pour avoir été trimbalé dans trop de poches. Et Landard, aussi, comme le dirait la chanson. Fumeur invétéré, plein de préjugés, raciste et homophobes, toujours si sûr de lui, il fait honneur à sa réputation, celle d'être le plus mauvais flic de Paris...
Dans son ombre, Gombrowicz est un jeune lieutenant qu'on remarque à peine à côté de son truculent supérieur. On ne peut pas dire qu'il ait tiré le meilleur des mentors... Mais, n'est-ce pas justement pour cela qu'il se fait si discret ? Pour mieux conserver son indépendance et son libre arbitre et envisager les faits avec un recul et une intuition qui font cruellement défaut à son chef ?
Voilà pour la loi et l'ordre, comme dirait Dick Wolf. Mais ces trois-là ne sont pas les seuls concernés par cette histoire. Qui dit cathédrale, dit clergé, et, avec le personnel de surveillance de la cathédrale, les prêtres étaient en effet aux premières loges au moment du drame. En particulier le père Kern, qui disait la messe dans une chapelle voisine.
Là encore, voilà quelqu'un qu'on ne doit pas remarquer tout de suite, malgré sa tenue d'ecclésiastique. Et pour cause : avec son 1m48 et ses 43 kilos, le père Kern est un tout petit bonhomme. Ce gabarit s'explique par un traitement médical suivi dans l'enfance qui a interrompu sa croissance. Il souffre d'un mal incurable qui se manifeste par des crises très violentes et seule la pratique de l'horlogerie semble l'apaiser, lui et ses démons intérieurs.
Mais le père Kern n'est pas seulement un homme qui doute et un prêtre à l'écoute de ses ouailles. C'est aussi quelqu'un d'intelligent et de curieux, épris de justice. Se sentant concerné directement par le meurtre de cette femme, il va fureter et chercher à comprendre comment on a pu tuer une jeune femme dans la cathédrale sans que personne ne remarque rien.
L'enquête officielle va vite mettre des éléments importants en évidence : la victime s'était fait remarquer la veille, lors de la procession de l'Assomption. Un comportement provocant, d'une sensualité qui collait mal avec l'ambiance pieuse du moment. Une attitude qui n'a pas plu à un jeune homme, qui a expulsé la fauteuse de trouble manu militari du cortège.
Pour Landard, le voilà, le principal suspect ! Ce jeune homme, là, qui a fait la police au milieu de fidèles avec un zèle évident. Quand le garçon s'avère être un fanatique carrément illuminé et obsédé par l'image de la Vierge, il passe direct du rôle de suspect à celui de coupable. Alléluia, les machines judiciaires et médiatiques vont pouvoir s'emballer, le tueur de Notre-Dame sera vite sous les verrous !
Une thèse qui semble un peu trop simple pour le père Kern. Le jeune homme est peut-être complètement cinglé, mais il ne lui semble pas avoir le profil d'un meurtrier. Et puis, d'autres éléments ne collent pas aux yeux du prêtre, qui est persuadé que la police, que ce bon vieux Landard fait fausse route et court à la catastrophe...
Dans cette série, Alexis Ragougneau met donc en scène une jeune magistrate et un prêtre retors pour mener l'enquête. Mais, on n'est pas à Grantchester dans les années 1950. Non, c'est à Paris de nos jours que ces deux-là, que rien ne semble rapprocher, vont devoir apprendre à travailler ensemble dans un contexte bien délicat.
Dans "la Madone de Notre-Dame", c'est le père Kern qui a la main, Claire Kauffmann semblant un peu en retrait. Il faudra que je lise la seconde enquête disponible, "Evangile pour un gueux" (en attendant que d'autres paraissent ?) pour voir comment ce tandem s'organise et évolue, ainsi que la place qu'occupe les policiers (mais n'en disons pas plus à ce sujet).
Un personnage dont le physique m'a fait penser à celui de l'enquêteur imaginé par Pierre Lemaître, Camille Verhoeven. Deux personnages de petite taille, qui paraissent sans doute insignifiant dans ce monde où le paraître règne en tyran, mais qui compensent ce handicap par une intelligence et une intuition aiguës.
Mais, Kern n'est pas flic, justement. Il est prêtre et sous son costume noir et son col romain cohabitent un homme et un ecclésiastique, deux personnalités qui ne sont pas forcément toujours sous la même longueur d'ondes. Le père Kern est un personnage tourmenté, en souffrance, en quête de quelque chose qui ressemble fort à une rédemption. A un pardon.
Est-il alors prêtre par sincère vocation ou parce que c'est la meilleure voie pour trouver l'impossible apaisement dont il a besoin ? Là, je vais sans doute un peu loin. Mais, en se muant en enquêteur, en travaillant sur un crime sordide qui a profané ce lieu qu'il respecte et aime tant, peut-être a-t-il trouvé une nouvelle manière de calmer le mal qui le ronge.
Et puis, il y a ce personnage incontournable qu'est Notre-Dame. Un tel bâtiment est forcément plus qu'un simple décor. Qu'on croie ou pas, ce site en impose et il représente quelque chose de très particulier, par son histoire, par son historique, par son architecture et par tout ce qu'il renferme. Ailleurs, cette histoire aurait une tonalité, un retentissement forcément différents.
Cet aspect-là m'a un peu laissé sur ma faim, mais peut-être parce que je m'attendais à ce que la cathédrale, les légendes qui l'entourent, son côté imposant soient un peu plus utilisés dans l'intrigue. Qu'on flirte peut-être avec l'irrationnel, le mystique. Alexis Ragougneau a choisi une autre voie (que je ne vais évidemment pas évoquer ici), plus terre à terre. Plus humaine.
Plus largement, j'ai trouvé que ce roman, très court (même pas 220 pages dans sa version poche) manquait un peu de gras. On va à l'essentiel, droit au but, et cela donne un roman efficace qu'on lit d'une traite. On est dans la lignée du roman populaire, de ce que j'appelais plus haut le roman de gare, mais sans le côté péjoratif qu'on y accole.
Les personnages sont très intéressants, ceux que j'ai évoqués, mais d'autres aussi qui valent le coup d'oeil et participent à la mécanique de l'intrigue. C'est sans doute le point fort de ce polar, Alexis Ragougneau jouant volontiers avec les archétypes, s'approchant tout près du gouffre pouvant le précipiter dans la caricature. Il joue les funambules, mais ne chute pas.
Il leur donne une vraie humanité, de ceux qui inspirent le plus l'empathie du lecteur aux plus agaçants. Bien sûr, la brièveté du livre empêche d'aller au fond des choses, mais il semble évident que les personnages appelés à prendre part aux différentes enquêtes gagneront en profondeur au fil des histoires. A commencer par Claire Kauffmann et le père Kern.
Ce premier volet repose sur une mécanique de polar très classique, mais qui va permettre aux deux personnages centraux de prendre la main. Pour la jeune substitut, de faire ses preuves dans un contexte hostile et mouvementé, et donc d'asseoir son autorité à venir ; pour le prêtre, outre sa quête personnelle, de se placer en auxiliaire viable en cas de nouvel incident aux alentours de la cathédrale.
Il y a un moment que j'avais envie de découvrir cette série, car l'idée de prendre Notre-Dame comme cadre et de faire enquêter un prêtre me semblait original et assez ambitieux. Sans être une révolution dans le genre ou un chef d'oeuvre incontournable, j'ai apprécié ce divertissement qui reste aussi ce qui n'est jamais évident à mettre en place : l'entame d'une série.
Il faudra poursuivre l'expérience pour voir l'évolution des personnages, leur organisation dans de futures intrigues, mais aussi la nature de ces intrigues, car, malgré tout, Notre-Dame de Paris reste un cadre à la fois limité, mais offrant pourtant un large champ des possibles. Si la série se prolonge au-delà du deuxième tome, il faudra se renouveler.
Alexis Ragougneau ne s'y consacre toutefois pas entièrement. Il travaille en parallèle sur d'autres projets, comme ce fut le cas pour le dernier roman qu'il a publié, "Niels", qui lui a valu d'apparaître sur la première liste du dernier prix Goncourt. Mais, Kauffmann et Kern sont des personnages qu'on a envie de retrouver en action. Tout comme ces flics si mal assortis qui les accompagnent.
En ce lundi 16 août, qui s'annonce particulièrement chaud, la cathédrale Notre-Dame de Paris se prépare à accueillir une foule importante. D'un côté les fidèles, qui se presseront aux différents offices ; de l'autre, et ils sont de loin les plus nombreux, les touristes qui entendent visiter ce monument incontournable de la capitale.
Il faut donc que tout soit parfait à l'intérieur du bâtiment pour que chaque personne en franchissant le seuil profite au mieux de sa visite. Mais, le personnel se prépare aussi à une dure journée, au cours de laquelle il faudra recadrer quelques touristes un peu trop bruyants ou oubliant la nature du lieu dans lequel ils sont entrés.
Il est encore tôt, ce matin-là, les surveillants ont encore la possibilité de plaisanter, le plus gros de la fréquentation quotidienne n'est pas encore arrivé. L'un d'eux prévient son collègue qu'il a repéré "une bombe" dans le déambulatoire, à hauteur de la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Dans leur jargon, pas très fin, il faut le reconnaître, il s'agit d'évoquer une ravissante visiteuse.
Et, effectivement, devant la chapelle, se trouve une jeune femme en train de prier. Sa posture contraste avec sa tenue : une robe blanche, certes, mais peut-être un peu trop courte pour un lieu de culte. Mais l'image est attendrissante, elle pourrait inspirer n'importe quel peintre voulant réaliser le portrait d'une madone.
Mais, soudain, alors qu'une autre fidèle s'assoit à ses côtés, l'orante bascule et s'écroule au sol. Hurlement de la touriste américaine et stupeur générale... La "bombe" vient d'exploser : la jeune femme est morte, et il semble bien que Dieu ne l'ait pas rappelée à lui alors qu'elle le priait, mais qu'elle ait trépassé suite à un acte bassement humain.
Etranglée. Et installée dans cette macabre mise en scène au mauvais goût certain. D'autres détails sont découverts lors de l'examen médico-légal qui donnent la nausée... La demoiselle a été victime d'un meurtre et son assassin a profané son corps. En pleine cathédrale... Le genre d'histoire qui, même en cette période habituellement très calme de la mi-août, devrait mobiliser tous les médias...
Sur place, la substitut du procureur Claire Kauffmann, flanquée de deux policiers, le commandant Landard et le lieutenant Gombrowicz. Ils n'ont pas eu un long chemin à faire pour arriver sur les lieux du crime, puisque le palais de justice et le 36, quai des Orfèvres se trouvent à deux pas, sur la même rive de l'île de la Cité.
A eux de mener l'enquête avec tact et discrétion, mais aussi avec rapidité car, personne n'est dupe, quelques précautions que l'on prenne, l'information finira forcément par fuiter et par atterrir sur les desks de toutes les rédactions de la capitale. Un meurtre à Notre-Dame, ça devrait faire de l'audience et faire vendre du papier, coco !
Claire Kauffmann est une jeune magistrate, encore inexpérimentée, qui se retrouve face à son premier dossier d'envergure. Mais l'inexpérience n'exclut pas l'ambition et elle sait très bien que cette affaire sera un test très important pour sa carrière à venir. Plutôt petite, avec un physique qui fait penser aux actrices blondes des films d'Alfred Hitchcock, elle reste marquée par un drame personnel intervenu dans sa jeunesse.
Le commandant Landard est un vieux de la vieille du 36, un flic à l'ancienne, comme on n'en fait plus. Et c'est vrai qu'il semble sorti d'un vieux roman de gare corné de partout pour avoir été trimbalé dans trop de poches. Et Landard, aussi, comme le dirait la chanson. Fumeur invétéré, plein de préjugés, raciste et homophobes, toujours si sûr de lui, il fait honneur à sa réputation, celle d'être le plus mauvais flic de Paris...
Dans son ombre, Gombrowicz est un jeune lieutenant qu'on remarque à peine à côté de son truculent supérieur. On ne peut pas dire qu'il ait tiré le meilleur des mentors... Mais, n'est-ce pas justement pour cela qu'il se fait si discret ? Pour mieux conserver son indépendance et son libre arbitre et envisager les faits avec un recul et une intuition qui font cruellement défaut à son chef ?
Voilà pour la loi et l'ordre, comme dirait Dick Wolf. Mais ces trois-là ne sont pas les seuls concernés par cette histoire. Qui dit cathédrale, dit clergé, et, avec le personnel de surveillance de la cathédrale, les prêtres étaient en effet aux premières loges au moment du drame. En particulier le père Kern, qui disait la messe dans une chapelle voisine.
Là encore, voilà quelqu'un qu'on ne doit pas remarquer tout de suite, malgré sa tenue d'ecclésiastique. Et pour cause : avec son 1m48 et ses 43 kilos, le père Kern est un tout petit bonhomme. Ce gabarit s'explique par un traitement médical suivi dans l'enfance qui a interrompu sa croissance. Il souffre d'un mal incurable qui se manifeste par des crises très violentes et seule la pratique de l'horlogerie semble l'apaiser, lui et ses démons intérieurs.
Mais le père Kern n'est pas seulement un homme qui doute et un prêtre à l'écoute de ses ouailles. C'est aussi quelqu'un d'intelligent et de curieux, épris de justice. Se sentant concerné directement par le meurtre de cette femme, il va fureter et chercher à comprendre comment on a pu tuer une jeune femme dans la cathédrale sans que personne ne remarque rien.
L'enquête officielle va vite mettre des éléments importants en évidence : la victime s'était fait remarquer la veille, lors de la procession de l'Assomption. Un comportement provocant, d'une sensualité qui collait mal avec l'ambiance pieuse du moment. Une attitude qui n'a pas plu à un jeune homme, qui a expulsé la fauteuse de trouble manu militari du cortège.
Pour Landard, le voilà, le principal suspect ! Ce jeune homme, là, qui a fait la police au milieu de fidèles avec un zèle évident. Quand le garçon s'avère être un fanatique carrément illuminé et obsédé par l'image de la Vierge, il passe direct du rôle de suspect à celui de coupable. Alléluia, les machines judiciaires et médiatiques vont pouvoir s'emballer, le tueur de Notre-Dame sera vite sous les verrous !
Une thèse qui semble un peu trop simple pour le père Kern. Le jeune homme est peut-être complètement cinglé, mais il ne lui semble pas avoir le profil d'un meurtrier. Et puis, d'autres éléments ne collent pas aux yeux du prêtre, qui est persuadé que la police, que ce bon vieux Landard fait fausse route et court à la catastrophe...
Dans cette série, Alexis Ragougneau met donc en scène une jeune magistrate et un prêtre retors pour mener l'enquête. Mais, on n'est pas à Grantchester dans les années 1950. Non, c'est à Paris de nos jours que ces deux-là, que rien ne semble rapprocher, vont devoir apprendre à travailler ensemble dans un contexte bien délicat.
Dans "la Madone de Notre-Dame", c'est le père Kern qui a la main, Claire Kauffmann semblant un peu en retrait. Il faudra que je lise la seconde enquête disponible, "Evangile pour un gueux" (en attendant que d'autres paraissent ?) pour voir comment ce tandem s'organise et évolue, ainsi que la place qu'occupe les policiers (mais n'en disons pas plus à ce sujet).
Un personnage dont le physique m'a fait penser à celui de l'enquêteur imaginé par Pierre Lemaître, Camille Verhoeven. Deux personnages de petite taille, qui paraissent sans doute insignifiant dans ce monde où le paraître règne en tyran, mais qui compensent ce handicap par une intelligence et une intuition aiguës.
Mais, Kern n'est pas flic, justement. Il est prêtre et sous son costume noir et son col romain cohabitent un homme et un ecclésiastique, deux personnalités qui ne sont pas forcément toujours sous la même longueur d'ondes. Le père Kern est un personnage tourmenté, en souffrance, en quête de quelque chose qui ressemble fort à une rédemption. A un pardon.
Est-il alors prêtre par sincère vocation ou parce que c'est la meilleure voie pour trouver l'impossible apaisement dont il a besoin ? Là, je vais sans doute un peu loin. Mais, en se muant en enquêteur, en travaillant sur un crime sordide qui a profané ce lieu qu'il respecte et aime tant, peut-être a-t-il trouvé une nouvelle manière de calmer le mal qui le ronge.
Et puis, il y a ce personnage incontournable qu'est Notre-Dame. Un tel bâtiment est forcément plus qu'un simple décor. Qu'on croie ou pas, ce site en impose et il représente quelque chose de très particulier, par son histoire, par son historique, par son architecture et par tout ce qu'il renferme. Ailleurs, cette histoire aurait une tonalité, un retentissement forcément différents.
Cet aspect-là m'a un peu laissé sur ma faim, mais peut-être parce que je m'attendais à ce que la cathédrale, les légendes qui l'entourent, son côté imposant soient un peu plus utilisés dans l'intrigue. Qu'on flirte peut-être avec l'irrationnel, le mystique. Alexis Ragougneau a choisi une autre voie (que je ne vais évidemment pas évoquer ici), plus terre à terre. Plus humaine.
Plus largement, j'ai trouvé que ce roman, très court (même pas 220 pages dans sa version poche) manquait un peu de gras. On va à l'essentiel, droit au but, et cela donne un roman efficace qu'on lit d'une traite. On est dans la lignée du roman populaire, de ce que j'appelais plus haut le roman de gare, mais sans le côté péjoratif qu'on y accole.
Les personnages sont très intéressants, ceux que j'ai évoqués, mais d'autres aussi qui valent le coup d'oeil et participent à la mécanique de l'intrigue. C'est sans doute le point fort de ce polar, Alexis Ragougneau jouant volontiers avec les archétypes, s'approchant tout près du gouffre pouvant le précipiter dans la caricature. Il joue les funambules, mais ne chute pas.
Il leur donne une vraie humanité, de ceux qui inspirent le plus l'empathie du lecteur aux plus agaçants. Bien sûr, la brièveté du livre empêche d'aller au fond des choses, mais il semble évident que les personnages appelés à prendre part aux différentes enquêtes gagneront en profondeur au fil des histoires. A commencer par Claire Kauffmann et le père Kern.
Ce premier volet repose sur une mécanique de polar très classique, mais qui va permettre aux deux personnages centraux de prendre la main. Pour la jeune substitut, de faire ses preuves dans un contexte hostile et mouvementé, et donc d'asseoir son autorité à venir ; pour le prêtre, outre sa quête personnelle, de se placer en auxiliaire viable en cas de nouvel incident aux alentours de la cathédrale.
Il y a un moment que j'avais envie de découvrir cette série, car l'idée de prendre Notre-Dame comme cadre et de faire enquêter un prêtre me semblait original et assez ambitieux. Sans être une révolution dans le genre ou un chef d'oeuvre incontournable, j'ai apprécié ce divertissement qui reste aussi ce qui n'est jamais évident à mettre en place : l'entame d'une série.
Il faudra poursuivre l'expérience pour voir l'évolution des personnages, leur organisation dans de futures intrigues, mais aussi la nature de ces intrigues, car, malgré tout, Notre-Dame de Paris reste un cadre à la fois limité, mais offrant pourtant un large champ des possibles. Si la série se prolonge au-delà du deuxième tome, il faudra se renouveler.
Alexis Ragougneau ne s'y consacre toutefois pas entièrement. Il travaille en parallèle sur d'autres projets, comme ce fut le cas pour le dernier roman qu'il a publié, "Niels", qui lui a valu d'apparaître sur la première liste du dernier prix Goncourt. Mais, Kauffmann et Kern sont des personnages qu'on a envie de retrouver en action. Tout comme ces flics si mal assortis qui les accompagnent.
mardi 20 février 2018
"D'accord, Andrea était imparfaite, elle avait des secrets, mais tout ce qu'elle cherchait, c'était de l'amour, de l'amour..."
Retour en Angleterre pour un polar efficace, où l'on retrouve cette veine sociale qui fait la force de ce genre Outre-Manche, mais pas seulement. Une intrigue efficace et oppressante, dans une ville de Londres figée par un hiver très rude, portée par un personnage de femme flic tout à fait intéressant, courageuse, intègre et indépendante, mais aussi meurtrie et encore fragile. Premier volet d'une série policière qui compte déjà cinq enquêtes en VO, "La fille sous la glace" (en grand format chez Belfond ; traduction de Véronique Roland), est le premier polar de Robert Bryndza, un auteur qui, jusqu'ici, s'est d'abord fait connaître dans un genre très différent : la comédie romantique (des romans qui ne sont pas [encore ?] traduits en français). Il nous plonge dans une société britannique à plusieurs vitesses, plus société de castes que société de classes et aborde des questions délicates autour du boulot de policier, de ce qu'il implique et des conditions dans lesquelles il s'exerce, pas toujours simples.
En ce début d'année 2015, Londres est sous la neige. L'hiver a fait une offensive d'une rare rudesse, le froid s'est installé et c'est tout juste si la capitale britannique n'est pas paralysée. Pourtant, même s'il n'a qu'une envie, rester sous la couette, Lee doit sortir et aller bosser. Une absurdité, puisqu'il officie comme jardinier dans le vaste parc du Horniman Museum, situé au sud-ouest de la ville.
Comment faire quoi que ce soit, alors que les allées et les parterres disparaissent sous l'épais manteau blanc ? Lee aurait bien aimé que son téléphone sonne, qu'on lui indique de rester chez lui en attendant que la météo soit plus clémente, mais lorsque cela se produit, il se trouve déjà au milieu de nulle part, gelé et trempé. Il réussit même à se perdre, incapable de se repérer avec toute cette neige !
Et puis, le téléphone sonne encore... Mais, cette fois, ce n'est pas le sien. Une sonnerie qui émane d'une baraque, proche d'un plan d'eau. Sa curiosité aiguisée, Lee s'approche, redoutant qu'un SDF se soit abrité là, mais non, il n'y a personne, rien d'autre qu'un téléphone qui continue de sonner. Un iPhone, rien que ça, le genre d'appareil qu'il pourra revendre contre un peu d'oseille, ni vu ni connu.
A condition, toutefois, de l'attraper, car il faut s'approcher bien près du bord du plan d'eau, de la couche de glace dont on ne sait jamais si elle est solide ou, au contraire, prête à se briser. L'opération s'annonce acrobatique et va s'avérer l'être encore plus quand il va découvrir que le téléphone appartient à quelqu'un.
Quelqu'un dont le corps flotte sous la surface gelée...
Gros coup de flip pour Lee qui, dans la panique, glisse, dérape, finit à moitié dans l'eau glacée et parvient in extremis à sortir de la flotte avant de se noyer... Pour la demoiselle au portable, en revanche, plus rien à faire. Elle est morte et elle a sans doute passé un bon moment dans cet étang. Et, sans son iPhone, elle aurait pu rester là longtemps... Jusqu'à la débâcle, peut-être...
A peine débarquée de Manchester, avec du retard à cause de la neige, la DCI (Detective Chief Inspector) Erika Foster hérite de l'affaire. Il faut dire qu'elle s'annonce très sensible : il est en effet plus que probable que la victime soit Andrea Douglas-Browne, 23 ans, dont la disparition a été signalée quatre jours plus tôt.
Si l'affaire est sensible, c'est parce que Andrea n'est pas une inconnue. Elle est la fille d'un parlementaire conservateur à la réputation sulfureuse, un proche du premier ministre David Cameron, un homme d'affaires qui a fait son beurre dans l'armement en profitant de ses contacts au sommet du pouvoir...
Avant même de prendre cette affaire en main, Erika sait qu'elle devra faire avec l'influence et les relations du père de la victime. Elle qui a toujours pris soin de rester à l'écart de la politique et des jeux de pouvoir, elle s'attend à ce qu'on lui mette une pression énorme. Sans compter l'accueil de sa nouvelle équipe, qui ne la connaît pas du tout.
D'ailleurs, le DCI Sparks, jusque-là en charge du dossier, n'est pas ravi de se voir ainsi voler la vedette. Pour Erika, ça n'a pas d'importance, mais qu'il ne s'avise pas de lui mettre des bâtons dans les roues. Et, pour installer son autorité d'emblée, elle invite Sparks à rester à son bureau tandis qu'elle ira sur la scène de crime accompagné de deux subordonnés, Moss et Peterson.
Et tout de suite, son intuition se met en marche. Un truc la chiffonne : que faisait Andrea dans ce coin mal famé, bien loin de la demeure familiale et des lieux à la mode que fréquentait cette habituée des rubriques people des tabloïds ? Un hasard, une mauvaise rencontre ? Ou bien son assassin l'a-t-il amenée ici avant de la tuer et de la jeter à l'eau ? Voilà une première piste à suivre.
C'est le début d'une enquête compliquée, difficile, douloureuse pour la DCI Foster, qui va devoir se battre contre sa hiérarchie, mais aussi contre elle-même. La piste qu'elle privilégie ne convient pas à Marsh, qui veut une arrestation au plus vite pour satisfaire la presse, en ébullition. Et les fantômes qui la hantent ne cessent de se rappeler à elle...
Beaucoup de choses reposent sur le personnage d'Erika. On sait peu de choses de ce qui s'est passé, dans un premier temps, mais on comprend que ce fut très grave. Un coup d'arrêt brutal à sa carrière très prometteuse, puisqu'elle fut l'un des plus jeunes policiers, hommes et femmes réunis, à devenir DCI. Et un drame personnel dont elle peine à se relever.
L'opération qu'elle dirigeait alors a très mal tourné, plusieurs officiers sont restés sur le carreau, dont le mari d'Erika. Depuis, la culpabilité la ronge, mais aussi le doute : est-elle encore capable de diriger une équipe ? Pour le savoir, elle a donc choisi Londres, un commissariat de quartier... Sans se douter que son retour coïnciderait avec une enquête de cette envergure...
Fragilisée, sans repère, même pas encore installée quelque part, elle va devoir faire ses preuves, et vite. Et tant pis si rien ne tourne comme elle le voudrait. Un témoin qui disparaît sans laisser de trace à son nez et à sa barbe, une autre qui n'a aucune crédibilité parce qu'elle se drogue et se prostitue... Et pourtant, elle a la certitude de tenir quelque chose...
Tandis qu'elle gagne peu à peu la confiance de ses collègues, elle entre en conflit avec ses supérieurs. A peine revenu aux affaires, elle décide de suivre son instinct, en espérant qu'il ne la trompera pas encore une fois. Elle joue les francs-tireurs dans une atmosphère rendue de plus en plus délétère par la pression que le père de la victime met sur Marsh...
Nous sommes dans l'époque de l'instantanéité, l'ère 2.0, le règne du buzz et du scoop à tout prix. Et, ce qui vaut pour la France où la protection de la vie privée est pourtant très importante, est décuplée en Angleterre. Erika se retrouve entre deux feux (pardon, l'expression peut sembler malheureuse, mais c'est bien cela) : la presse qui se déchaîne, les supérieurs qui veulent la satisfaire.
La vérité, dans tout ça, est vite reléguée au second, voire au troisième plan. On veut de l'info, du trash, on veut surtout un coupable, et vite, et tant pis si on bâcle l'enquête et qu'on cloue au pilori le premier suspect un peu crédible venu. Dès qu'une affaire se révèle un tant soit peu médiatique, c'est le même cirque, mais quand une famille en vue est impliquée, c'est encore pire.
Or, ce qu'il faut à Erika, c'est du temps. Du temps pour examiner les pistes qu'elle a mis au jour, trouver des témoins, recouper les informations, examiner les vidéosurveillances (qui sont très nombreuses en Angleterre)... Bref, faire un bon vieux travail de flic, afin d'échafauder des thèses qui tiennent la route, de les étayer solidement et éviter d'être ridiculisé au JT du soir...
Mais ces difficultés vont lui permettre de s'affirmer, de retrouver une confiance vacillante depuis Manchester. Enfin, si elle ne se trompe pas elle aussi. Car cette histoire lui donne un sacré fil à retordre et va surtout devenir bien plus dangereuse au fil des investigations. La DCI Erika Foster reprend du poil de la bête en défiant tout le monde et en recherchant l'assassin d'Andrea...
L'autre revers de ce boulot de flic à l'ère de l'image reine, effet presque pervers de ces enquêtes, c'est de sortir de sous les tapis les vilains petits secrets qu'on y cache. Avec un risque : donner une image très négative de la victime et donc, faire oublier qu'elle est justement une victime et rien d'autre. Dans le cas d'Andrea, c'est particulièrement vrai.
D'Andrea, et de sa famille. Le père, avec ses affaires juteuses, mais flirtant avec le conflit d'intérêts ; la mère, effondrée par la mort de sa fille ; la soeur, Linda, vilain petit canard qui aurait tout pour jalouser Andrea ; le frère, David, celui de la famille qui fait des études... Sans oublier le fiancé, Giles, patron d'une entreprise d'événementiel florissante, mais qui ne cadre pas trop avec Erika...
Sur tous les murs et les meubles de la demeure familiale, les photos du bonheur parfait des Douglas-Brown. Sur les réseaux sociaux, d'autres images, d'autres décors, d'autres impressions, peut-être plus personnelles et qui en disent plus de la victime. A condition de savoir les décrypter... L'image et la réalité ; l'être et le paraître... Où placer le curseur pour ne pas se perdre dans des faux semblants ?
Il y a par moment un curieux lien qui se noue entre Andrea et Erika, entre la victime du crime et la policière chargé de découvrir le meurtrier. Deux femmes fortes, indépendantes, libres et, dans le même temps, fragiles, mal dans leur peau, cherchant à fuir un destin capricieux... Les raisons diffèrent, bien sûr, mais j'ai été frappé par ce lien invisible qui pousse Erika à ne rien lâcher.
Pour sa première expérience dans le polar, Robert Bryndza met en place un polar très efficace, rythmé et porté par le très beau personnage d'Erika qu'on a envie de retrouver et de voir évoluer. Il ne la ménage d'ailleurs pas, pour un retour aux affaires, c'est un retour musclé. Mais, Erika sait encaisser et rendre les coups.
Elle est aussi un vrai leader, son autorité est naturelle et, rapidement, ses subordonnés vont la suivre, lui faire confiance, la soutenir même lorsqu'elle se retrouve sur la sellette. Peu importent la procédure et les règlements, Erika s'est assuré leur respect et surtout leur fidélité. Avec Moss et Peterson, elle a trouvé des auxiliaires sur qui compter.
"La Fille sous la glace" est aussi un polar social, même si ce n'est sans doute pas ce qui frappe en premier. On retrouve d'ailleurs un certain nombre de points qui font penser aux "Chemins de la haine", d'Eva Dolan, dont nous parlions récemment. Difficile de trop développer ces parallèles, car on toucherait à des éléments de l'intrigue que je n'ai pas évoqués ici, mais c'est un fait.
Robert Bryndza met en évidence des différences sociales très marquées. Il faut dire que Londres est une très grande ville, très étendue, avec de nombreux quartiers, et que la sociologie y est très diverse. La mort d'Erika fait entrer en collision deux mondes aux antipodes, ou presque : d'un côté, les classes dominantes, de l'autre, des exclus de la prospérité, dans un des pays les plus riches du monde.
En préambule, je parlais d'un système de castes, je trouve cette idée assez juste (et sans doute pas réservée à l'Angleterre) : Andrea fait tâche dans le quartier où on l'a retrouvée, les pubs du coin sont plus des bouges que des endroits à la mode... Mais, à l'inverse, on imagine mal que ceux qui vivent là puissent un jour franchir toutes les barrières sociales menant à des positions plus élevées.
Deux Angleterre apparaissent dans ce roman, mais deux pays tellement distincts qu'on se demande comment ils peuvent cohabiter. Un terreau propice aux tensions, on l'imagine volontiers. Mais aussi aux préjugés, qui font qu'on n'accorde aucune foi à ce que peuvent dire ceux qui vivent là. Ce n'est pas la Guerre des Deux-Roses, mais cette Angleterre-là, celle de 2015, a des airs de féodalité qui font peur...
Pourtant, l'habileté de Robert Bryndza, c'est de brouiller les limites entre les genres, et donc de brouiller les pistes pour le lecteur. Car, au fil des événements, la situation devient plus complexe, d'autres éléments interviennent et élargissent le champ des possibles en terme de mobiles. Compliquant la tâche de la DCI Foster qui doit convaincre un monde incrédule que c'est le pire des cauchemars envisageables qui s'est produit.
Difficile de proposer, désormais, des polars ou des thrillers qui sortent du lot, tant la production est énorme. Il faut trouver le moyen de se démarquer, et ce n'est jamais évident. Robert Bryndza propose un roman somme toute très classique, mais la force de son personnage central et une intrigue bien ficelée (j'avais une petite idée de l'identité du tueur, mais encore fallait-il le prouver) en fait un livre qu'on ne lâche pas.
Le compromis toujours difficile à trouver entre le travail d'enquête proprement dit et l'action est bon, on ne manque pas de rebondissements et Erika Foster donne de sa personne, sans doute un peu trop à son goût. La voilà de nouveau en selle avec ce retour musclé, et j'ai d'ores et déjà très envie de la retrouver, de la voir mener une nouvelle enquête. De la voir retrouver son assurance perdue lors d'une désastreuse opération.
En ce début d'année 2015, Londres est sous la neige. L'hiver a fait une offensive d'une rare rudesse, le froid s'est installé et c'est tout juste si la capitale britannique n'est pas paralysée. Pourtant, même s'il n'a qu'une envie, rester sous la couette, Lee doit sortir et aller bosser. Une absurdité, puisqu'il officie comme jardinier dans le vaste parc du Horniman Museum, situé au sud-ouest de la ville.
Comment faire quoi que ce soit, alors que les allées et les parterres disparaissent sous l'épais manteau blanc ? Lee aurait bien aimé que son téléphone sonne, qu'on lui indique de rester chez lui en attendant que la météo soit plus clémente, mais lorsque cela se produit, il se trouve déjà au milieu de nulle part, gelé et trempé. Il réussit même à se perdre, incapable de se repérer avec toute cette neige !
Et puis, le téléphone sonne encore... Mais, cette fois, ce n'est pas le sien. Une sonnerie qui émane d'une baraque, proche d'un plan d'eau. Sa curiosité aiguisée, Lee s'approche, redoutant qu'un SDF se soit abrité là, mais non, il n'y a personne, rien d'autre qu'un téléphone qui continue de sonner. Un iPhone, rien que ça, le genre d'appareil qu'il pourra revendre contre un peu d'oseille, ni vu ni connu.
A condition, toutefois, de l'attraper, car il faut s'approcher bien près du bord du plan d'eau, de la couche de glace dont on ne sait jamais si elle est solide ou, au contraire, prête à se briser. L'opération s'annonce acrobatique et va s'avérer l'être encore plus quand il va découvrir que le téléphone appartient à quelqu'un.
Quelqu'un dont le corps flotte sous la surface gelée...
Gros coup de flip pour Lee qui, dans la panique, glisse, dérape, finit à moitié dans l'eau glacée et parvient in extremis à sortir de la flotte avant de se noyer... Pour la demoiselle au portable, en revanche, plus rien à faire. Elle est morte et elle a sans doute passé un bon moment dans cet étang. Et, sans son iPhone, elle aurait pu rester là longtemps... Jusqu'à la débâcle, peut-être...
A peine débarquée de Manchester, avec du retard à cause de la neige, la DCI (Detective Chief Inspector) Erika Foster hérite de l'affaire. Il faut dire qu'elle s'annonce très sensible : il est en effet plus que probable que la victime soit Andrea Douglas-Browne, 23 ans, dont la disparition a été signalée quatre jours plus tôt.
Si l'affaire est sensible, c'est parce que Andrea n'est pas une inconnue. Elle est la fille d'un parlementaire conservateur à la réputation sulfureuse, un proche du premier ministre David Cameron, un homme d'affaires qui a fait son beurre dans l'armement en profitant de ses contacts au sommet du pouvoir...
Avant même de prendre cette affaire en main, Erika sait qu'elle devra faire avec l'influence et les relations du père de la victime. Elle qui a toujours pris soin de rester à l'écart de la politique et des jeux de pouvoir, elle s'attend à ce qu'on lui mette une pression énorme. Sans compter l'accueil de sa nouvelle équipe, qui ne la connaît pas du tout.
D'ailleurs, le DCI Sparks, jusque-là en charge du dossier, n'est pas ravi de se voir ainsi voler la vedette. Pour Erika, ça n'a pas d'importance, mais qu'il ne s'avise pas de lui mettre des bâtons dans les roues. Et, pour installer son autorité d'emblée, elle invite Sparks à rester à son bureau tandis qu'elle ira sur la scène de crime accompagné de deux subordonnés, Moss et Peterson.
Et tout de suite, son intuition se met en marche. Un truc la chiffonne : que faisait Andrea dans ce coin mal famé, bien loin de la demeure familiale et des lieux à la mode que fréquentait cette habituée des rubriques people des tabloïds ? Un hasard, une mauvaise rencontre ? Ou bien son assassin l'a-t-il amenée ici avant de la tuer et de la jeter à l'eau ? Voilà une première piste à suivre.
C'est le début d'une enquête compliquée, difficile, douloureuse pour la DCI Foster, qui va devoir se battre contre sa hiérarchie, mais aussi contre elle-même. La piste qu'elle privilégie ne convient pas à Marsh, qui veut une arrestation au plus vite pour satisfaire la presse, en ébullition. Et les fantômes qui la hantent ne cessent de se rappeler à elle...
Beaucoup de choses reposent sur le personnage d'Erika. On sait peu de choses de ce qui s'est passé, dans un premier temps, mais on comprend que ce fut très grave. Un coup d'arrêt brutal à sa carrière très prometteuse, puisqu'elle fut l'un des plus jeunes policiers, hommes et femmes réunis, à devenir DCI. Et un drame personnel dont elle peine à se relever.
L'opération qu'elle dirigeait alors a très mal tourné, plusieurs officiers sont restés sur le carreau, dont le mari d'Erika. Depuis, la culpabilité la ronge, mais aussi le doute : est-elle encore capable de diriger une équipe ? Pour le savoir, elle a donc choisi Londres, un commissariat de quartier... Sans se douter que son retour coïnciderait avec une enquête de cette envergure...
Fragilisée, sans repère, même pas encore installée quelque part, elle va devoir faire ses preuves, et vite. Et tant pis si rien ne tourne comme elle le voudrait. Un témoin qui disparaît sans laisser de trace à son nez et à sa barbe, une autre qui n'a aucune crédibilité parce qu'elle se drogue et se prostitue... Et pourtant, elle a la certitude de tenir quelque chose...
Tandis qu'elle gagne peu à peu la confiance de ses collègues, elle entre en conflit avec ses supérieurs. A peine revenu aux affaires, elle décide de suivre son instinct, en espérant qu'il ne la trompera pas encore une fois. Elle joue les francs-tireurs dans une atmosphère rendue de plus en plus délétère par la pression que le père de la victime met sur Marsh...
Nous sommes dans l'époque de l'instantanéité, l'ère 2.0, le règne du buzz et du scoop à tout prix. Et, ce qui vaut pour la France où la protection de la vie privée est pourtant très importante, est décuplée en Angleterre. Erika se retrouve entre deux feux (pardon, l'expression peut sembler malheureuse, mais c'est bien cela) : la presse qui se déchaîne, les supérieurs qui veulent la satisfaire.
La vérité, dans tout ça, est vite reléguée au second, voire au troisième plan. On veut de l'info, du trash, on veut surtout un coupable, et vite, et tant pis si on bâcle l'enquête et qu'on cloue au pilori le premier suspect un peu crédible venu. Dès qu'une affaire se révèle un tant soit peu médiatique, c'est le même cirque, mais quand une famille en vue est impliquée, c'est encore pire.
Or, ce qu'il faut à Erika, c'est du temps. Du temps pour examiner les pistes qu'elle a mis au jour, trouver des témoins, recouper les informations, examiner les vidéosurveillances (qui sont très nombreuses en Angleterre)... Bref, faire un bon vieux travail de flic, afin d'échafauder des thèses qui tiennent la route, de les étayer solidement et éviter d'être ridiculisé au JT du soir...
Mais ces difficultés vont lui permettre de s'affirmer, de retrouver une confiance vacillante depuis Manchester. Enfin, si elle ne se trompe pas elle aussi. Car cette histoire lui donne un sacré fil à retordre et va surtout devenir bien plus dangereuse au fil des investigations. La DCI Erika Foster reprend du poil de la bête en défiant tout le monde et en recherchant l'assassin d'Andrea...
L'autre revers de ce boulot de flic à l'ère de l'image reine, effet presque pervers de ces enquêtes, c'est de sortir de sous les tapis les vilains petits secrets qu'on y cache. Avec un risque : donner une image très négative de la victime et donc, faire oublier qu'elle est justement une victime et rien d'autre. Dans le cas d'Andrea, c'est particulièrement vrai.
D'Andrea, et de sa famille. Le père, avec ses affaires juteuses, mais flirtant avec le conflit d'intérêts ; la mère, effondrée par la mort de sa fille ; la soeur, Linda, vilain petit canard qui aurait tout pour jalouser Andrea ; le frère, David, celui de la famille qui fait des études... Sans oublier le fiancé, Giles, patron d'une entreprise d'événementiel florissante, mais qui ne cadre pas trop avec Erika...
Sur tous les murs et les meubles de la demeure familiale, les photos du bonheur parfait des Douglas-Brown. Sur les réseaux sociaux, d'autres images, d'autres décors, d'autres impressions, peut-être plus personnelles et qui en disent plus de la victime. A condition de savoir les décrypter... L'image et la réalité ; l'être et le paraître... Où placer le curseur pour ne pas se perdre dans des faux semblants ?
Il y a par moment un curieux lien qui se noue entre Andrea et Erika, entre la victime du crime et la policière chargé de découvrir le meurtrier. Deux femmes fortes, indépendantes, libres et, dans le même temps, fragiles, mal dans leur peau, cherchant à fuir un destin capricieux... Les raisons diffèrent, bien sûr, mais j'ai été frappé par ce lien invisible qui pousse Erika à ne rien lâcher.
Pour sa première expérience dans le polar, Robert Bryndza met en place un polar très efficace, rythmé et porté par le très beau personnage d'Erika qu'on a envie de retrouver et de voir évoluer. Il ne la ménage d'ailleurs pas, pour un retour aux affaires, c'est un retour musclé. Mais, Erika sait encaisser et rendre les coups.
Elle est aussi un vrai leader, son autorité est naturelle et, rapidement, ses subordonnés vont la suivre, lui faire confiance, la soutenir même lorsqu'elle se retrouve sur la sellette. Peu importent la procédure et les règlements, Erika s'est assuré leur respect et surtout leur fidélité. Avec Moss et Peterson, elle a trouvé des auxiliaires sur qui compter.
"La Fille sous la glace" est aussi un polar social, même si ce n'est sans doute pas ce qui frappe en premier. On retrouve d'ailleurs un certain nombre de points qui font penser aux "Chemins de la haine", d'Eva Dolan, dont nous parlions récemment. Difficile de trop développer ces parallèles, car on toucherait à des éléments de l'intrigue que je n'ai pas évoqués ici, mais c'est un fait.
Robert Bryndza met en évidence des différences sociales très marquées. Il faut dire que Londres est une très grande ville, très étendue, avec de nombreux quartiers, et que la sociologie y est très diverse. La mort d'Erika fait entrer en collision deux mondes aux antipodes, ou presque : d'un côté, les classes dominantes, de l'autre, des exclus de la prospérité, dans un des pays les plus riches du monde.
En préambule, je parlais d'un système de castes, je trouve cette idée assez juste (et sans doute pas réservée à l'Angleterre) : Andrea fait tâche dans le quartier où on l'a retrouvée, les pubs du coin sont plus des bouges que des endroits à la mode... Mais, à l'inverse, on imagine mal que ceux qui vivent là puissent un jour franchir toutes les barrières sociales menant à des positions plus élevées.
Deux Angleterre apparaissent dans ce roman, mais deux pays tellement distincts qu'on se demande comment ils peuvent cohabiter. Un terreau propice aux tensions, on l'imagine volontiers. Mais aussi aux préjugés, qui font qu'on n'accorde aucune foi à ce que peuvent dire ceux qui vivent là. Ce n'est pas la Guerre des Deux-Roses, mais cette Angleterre-là, celle de 2015, a des airs de féodalité qui font peur...
Pourtant, l'habileté de Robert Bryndza, c'est de brouiller les limites entre les genres, et donc de brouiller les pistes pour le lecteur. Car, au fil des événements, la situation devient plus complexe, d'autres éléments interviennent et élargissent le champ des possibles en terme de mobiles. Compliquant la tâche de la DCI Foster qui doit convaincre un monde incrédule que c'est le pire des cauchemars envisageables qui s'est produit.
Difficile de proposer, désormais, des polars ou des thrillers qui sortent du lot, tant la production est énorme. Il faut trouver le moyen de se démarquer, et ce n'est jamais évident. Robert Bryndza propose un roman somme toute très classique, mais la force de son personnage central et une intrigue bien ficelée (j'avais une petite idée de l'identité du tueur, mais encore fallait-il le prouver) en fait un livre qu'on ne lâche pas.
Le compromis toujours difficile à trouver entre le travail d'enquête proprement dit et l'action est bon, on ne manque pas de rebondissements et Erika Foster donne de sa personne, sans doute un peu trop à son goût. La voilà de nouveau en selle avec ce retour musclé, et j'ai d'ores et déjà très envie de la retrouver, de la voir mener une nouvelle enquête. De la voir retrouver son assurance perdue lors d'une désastreuse opération.
"Il existe deux sortes de cécité sur cette terre : les aveugles de la vue et les aveugles de la vie" (Ahmadou Kourouma).
C'est toujours un petit jeu amusant, lorsqu'on n'a pas noté en cours de lecture une citation qui ferait un "bon" titre pour le billet, de chercher des mots qui seront en phase avec le roman. Ici, j'avais un point de départ, avec la cécité, qui tient une place très importante (et à plus d'un titre) dans ce livre. Et, en tombant sur la phrase d'Ahmadou Kourouma (si vous ne connaissez pas cet écrivain ivoirien, lisez-le !), ça a fait tilt. Car cette idée d'un aveuglement aussi bien physique que psychologique m'a semblé très pertinente en ce qui concerne "la Prunelle de ses yeux", d'Ingrid Desjours (en grand format à la Bête Noire, chez Robert Laffont, désormais disponible en poche chez Pocket). Un thriller à la construction narrative très intéressante, qui joue à la fois sur une dimension chorale et sur deux périodes distinctes. Une histoire d'amour(s) qui réunit deux êtres abîmés, cabossés, dont on se dit que la relation pourrait être d'une grande perversité, voire d'une grande toxicité. Une histoire de culpabilité(s) qui ronge(nt), érode(nt) et fragilise(nt)...
Maya vit près de Cork, en Irlande, lorsqu'elle rencontre par hasard Gabriel dans un salon de thé où elle vient régulièrement passer du temps. Elle vient juste de perdre son emploi et l'homme, après avoir engagé la conversation avec elle, finit par lui proposer de travailler pour lui : il est aveugle et il a besoin d'un guide pour l'aider à se déplacer, car il vient de renvoyer le précédent.
Il lui propose donc de l'accompagner, moyennant une rémunération confortable, dans le voyage qu'il accomplit et qu'il entend poursuivre, avant de rentrer à Paris, où il vit. Maya hésite : elle a besoin de cet argent, mais elle ne connaît cet homme que depuis quelques minutes... Cette offre providentielle arrive à point nommé, mais le projet l'inquiète.
Car Gabriel lui propose de rentrer en France, un pays où elle n'a plus mis les pieds depuis 13 ans. Depuis qu'elle... est morte. En tout cas, officiellement. Maya a refait sa vie en Irlande, tant bien que mal, avec des hauts, mais aussi pas mal de bas. Et elle reste rongée par une culpabilité terrible qui la pousse, en particulier, à se noyer un peu trop régulièrement dans l'alcool...
Après tout, le temps a passé, elle a bien changé durant cette période, la probabilité qu'on la reconnaisse est infime. Alors, elle finit par accepter d'accompagner Gabriel, de lui servir de guide. De lui servir d'yeux. Et puis, avec son air charmeur, ce bonhomme-là n'a pas l'air bien méchant. Et sa cécité donne un avantage réel à la jeune femme.
Ce qu'elle ignore, c'est que Gabriel n'était pas à Cork par hasard et qu'il l'a abordée en toute connaissance de cause. Et son offre d'emploi est tout à fait intéressée. L'aveugle a un plan en tête, un plan qui s'organise tout entier autour de la jeune femme. Ce voyage qu'il lui propose n'est pas juste un voyage d'agrément, c'est une quête. Une quête de justice.
Une quête de vengeance.
En 2003, Victor, étudiant dans une école privée de Neuilly, a été assassiné. Un crime d'une rare brutalité qui a plongé Gabriel dans le noir. Car Victor était son fils et, en apprenant son décès, sous la violence du choc, il a perdu la vue. Une cécité aussi soudaine qu'incurable, semble-t-il, qui a bouleversé un peu plus son existence.
Depuis, Gabriel ne vit plus que dans l'idée de retrouver l'assassin de son fils. Il a rompu avec sa femme, reconstruit sa vie en fonction de son handicap. Il a dû réapprendre tous les gestes du quotidien pour les effectuer en dépit de sa cécité. Mais, surtout, il a continué à rechercher la trace de la personne qu'il pense être l'assassin de Victor.
Cette personne, c'est Maya...
Décidément, Ingrid Desjours a une fascination pour les yeux qui, chez une écrivaine de thrillers, a presque quelque chose d'inquiétant... Après le très dur et éprouvant, mais passionnant "Sa vie dans les yeux d'une poupée", la voici donc qui construit toute l'intrigue d'un roman autour de la cécité d'un de ses personnages.
Mais pas n'importe quelle forme de cécité, non, ce serait trop facile. Gabriel souffre de ce qu'on appelle une cécité de conversion, un mal bien réel, mais mal connu et surtout impossible à soigner dans l'état actuel des connaissances. Les organes, yeux, nerfs, ne sont pas endommagés, mais, suite à un traumatisme psychologique, et non physique, le patient ne voit plus.
C'est comme si, soudain, sous l'effet de ce choc, ici, la mort violente de son fils, le cerveau de Gabriel s'était mis en panne et refusait de donner l'ordre aux yeux de voir... Qui sait si, un jour, ce processus s'inversera ? Les médecins ne comprennent pas le phénomène, on ne peut donc rien prédire concernant un possible retour à la normale.
Le personnage de Gabriel, affaibli physiquement, mais possédant une exceptionnelle détermination, s'est donc lancé, malgré son handicap, dans une quête bien particulière. J'écris "une quête", mais en fait, on pourrait dire qu'il chasse plusieurs lièvres à la fois. Consciemment ou non, en plus de la vérité concernant la mort de Victor, Gabriel cherche à retrouver la vue. Et à guérir sa culpabilité...
Ce dernier mot, je l'ai déjà utilisé, à propos de Maya. Entre ces deux âmes déboussolées, c'est un des rares points communs (avec Victor). Oui, les deux personnages qui se rencontrent à Cork et s'apprêtent à faire un bout de chemin ensemble sont rongés par la culpabilité depuis toutes ces années. Depuis que Victor est mort.
Je dois dire qu'on ne sait trop sur quel pied danser au départ avec ces personnages. Je garde de ma lecture de "Sa vie dans les yeux d'une poupée" un souvenir aigu. La noirceur de ce roman, la folie qui l'habitait, le côté malsain des personnages, tout cela reste gravé dans ma mémoire. Aussi, dès la rencontre entre Maya et Gabriel, je me suis senti un peu inquiet...
Et si j'avais, devant moi, deux monstres prêts à se confronter en rivalisant de ruse et de méchanceté ? Franchement, on peut se poser la question, car, de prime abord, sous ses airs d'aveugle plein d'entrain, Gabriel peut sembler presque menaçant aux yeux du lecteur. Son double jeu, qui se révèle petit à petit, laisse transparaître sa soif de vengeance. Oeil pour oeil, sinistre parallèle...
De même, de Maya, on sait bien peu de choses, mais ce que l'on découvre d'elle d'emblée n'inspire pas franchement la confiance : une fugitive, une jeune femme qui a orchestré sa mort pour disparaître dans des conditions assez glauques, une meurtrière... Et, si elle a tué une fois, pourquoi ne recommencerait-elle pas, pour fuir à nouveau, si la nécessité s'en fait sentir ?
L'un des ressorts de l'intrigue, c'est justement cette relation entre cette femme et cet homme, meurtris l'une comme l'autre, en quête d'une certaine rédemption. Comment elle se noue, comment elle va évoluer, les projets de Gabriel et le moment où Maya va comprendre que l'homme qu'elle accompagne lui a caché des choses, et pas des moindres.
Mais, ce n'est pas tout. Car l'un des éléments forts de ce roman, c'est sa construction. "La Prunelle de ses yeux" n'est pas un thriller d'action, c'est un thriller psychologique qui repose essentiellement sur ses personnages. Alors, Ingrid Desjours en fait ses moteurs en mettant en place une construction chorale : à chaque chapitre, son point de vue, si je puis dire.
On passe donc de Maya à Gabriel, sans recourir au "je", ce qui aurait pu être une possibilité. Mais, malgré cette narration à la troisième personne, on change bien d'axe sur les événements, on les perçoit différemment d'un chapitre à l'autre. La détermination de Gabriel qui mène la danse, les questionnements de Maya...
Cela pourrait fonctionner ainsi, mais il y a encore autre chose. Maya et Gabriel ne sont pas les seuls personnages dont nous adopterons le point de vue. Il y a aussi celui de Victor. L'adolescence, lui, s'exprime à la première personne et c'est lui-même qui va nous raconter les événements tragiques qui se sont déroulés en 2003.
Il va surtout remettre ce drame dans son contexte, et ainsi, nous montrer Maya et Gabriel sous un jours différent. Nous montrer comment ils étaient avant que le drame ne bouleverse leurs existences de fond en comble, pousse l'une à fuir et plonge l'autre dans une nuit sans fin. Le roman n'est plus seulement choral, il se divise en deux époques distinctes...
Il y aurait beaucoup à dire sur cette partie qui se passe en 2003, mais ces éléments, il vous faudra les découvrir par vous-mêmes. Petit à petit, l'histoire abstraite qui unit Maya et Gabriel prend forme, prend substance. Et le lecteur va se retrouver, encore une fois, en possession d'un certain nombre d'éléments qu'il est le seul à pouvoir mettre en perspective.
Pour être complet, il faudrait que je vous parle d'un quatrième personnage, qui lui aussi va non seulement intervenir, mais nous offrir son point de vue à certains moments. Il s'appelle Tancrède, mais je ne vais pas en dire plus à son sujet. Il fait partie de ces personnages qui sont à la fois secondaires et essentiels pour l'intrigue du roman. Reste à comprendre son rôle exact dans tout cela.
En alternant les points de vue et les époques, Ingrid Desjours pose les unes après les autres les pièces de son puzzle et elle fait ainsi naître la tension, le suspense. On n'imagine mal cette histoire, quel qu'en soit le fin mot, s'achever sans un affrontement. Sans son lot de révélations qui mèneront à la vérité des faits.
Au coeur de ce récit, la relation difficile entre un père et son fils, entre Gabriel et Victor. Il faut préciser que Gabriel est devenu père très jeune et qu'il manquait certainement de maturité au moment d'assumer ce rôle. Paradoxalement, c'est à la mort de Victor que Gabriel a pris conscience de ses manques, de ses erreurs, de son... aveuglement.
Oui, on en revient au titre de notre billet : qu'il s'agisse de Gabriel concerné au premier chef, ou de Maya, l'aveuglement n'est pas juste physique, dans ce roman. Il est aussi moral et psychologique. Les personnages ont refoulé ce qui pouvait déranger, de passer outre les éléments plus douloureux liés à ce qui s'est passé en 2003.
Preuve qu'ils ont une conscience, ce qui, on le verra, n'est pas le cas de tous les personnages engagés dans cette affaire. Quant à Victor, sans doute le plus lucide de tous, il souffrait justement de l'aveuglement des autres à son égard, et c'est aussi ce qui l'a poussé dans le processus qui aboutira à sa mort...
Peut-être est-ce facile à dire à posteriori, mais ce sont des responsabilités, au pluriel, qui ont abouti à la mort du jeune homme de 17 ans. Oh, bien sûr, il y a un meurtrier, celui qui a ôté la vie à Victor, mais cet événement dramatique est aussi la conséquence d'un faisceau d'éléments né de ces aveuglements, au sens figuré du terme.
Un élément, plein d'ironie, de sarcasme, même, presque de cruauté, est en lien avec tout cela : une maison dans laquelle va se passer une partie du roman, une maison qui porte un nom bien particulier. Il s'agit de la maison des Trois Singes, vous savez, ces Singes de la sagesse, comme on les appelle, un qui se cache les yeux, le deuxième qui se bouche les oreilles, le troisième qui se ferme la bouche.
On ne voit rien, on n'entend rien, on ne dit rien... Trois attitudes hypocrites qui, pourtant, ne permettent pas l'oubli salvateur... Au contraire, de cet aveuglement, de cette surdité et de ce silence naît la culpabilité, un poison douloureux et qui se répand lentement, très lentement... On ne pouvait trouver plus justes symboles pour cette histoire et ses principaux personnages...
Enfin, il faudrait, pour être complet sur la dimension psychologique, évoquer l'expérience de Milgram et d'autres études scientifiques (j'aurais bien envie de mettre des guillemets à ce mot, tiens) cherchant à théoriser l'obéissance et même la soumission à l'ordre et à l'autorité. Ces expériences, terribles, nous sont présentées au fil du livre, dans toute leur violence...
"La Prunelle de ses yeux", c'est un roman sur la culpabilité, sur la douleur et sur la recherche de rédemption, de pardon, même tardif. Une absolution qu'on attend des autres, mais surtout que ces personnages doivent accorder à eux-mêmes. Ils ont une part de responsabilité écrasante dans les événements et ont besoin de ce pardon, même tardif, trop tardif, pour reprendre le fil de leurs existences...
Malgré tout ce que je viens de dire, malgré la cécité et la noirceur du propos, Ingrid Desjours signe pourtant un roman lumineux, plein d'espoir et d'amour qui ne demande qu'à s'exprimer. Il va falloir passer par beaucoup d'embûches et de douleurs avant d'en arriver là. Avant que la vérité de soit révélée et les responsabilités définies.
Oui, comme je le disais plus haut, il y avait certainement matière à faire de ce thriller psychologique un livre très sombre, désespéré, infiniment plus violent que ce que l'on a en main. Ingrid Desjours n'a pas choisi, cette fois, de mener ses personnages sur les chemins de la perdition, mais de leur offrir la possibilité de vivre à nouveau. De laisser le passé derrière eux et de reconstruire un avenir.
La résilience, encore. Encore et toujours...
Et ce billet va s'achever, comme souvent et comme j'aime bien le faire, en musique. Pas seulement parce que la voix et la sensualité de Norah Jones sont un bonheur, mais parce que ce titre, entendu dans "la Prunelle de ses yeux", n'a certainement pas été choisi par hasard par la romancière. Il y est question de vue, de regard. Forcément...
Maya vit près de Cork, en Irlande, lorsqu'elle rencontre par hasard Gabriel dans un salon de thé où elle vient régulièrement passer du temps. Elle vient juste de perdre son emploi et l'homme, après avoir engagé la conversation avec elle, finit par lui proposer de travailler pour lui : il est aveugle et il a besoin d'un guide pour l'aider à se déplacer, car il vient de renvoyer le précédent.
Il lui propose donc de l'accompagner, moyennant une rémunération confortable, dans le voyage qu'il accomplit et qu'il entend poursuivre, avant de rentrer à Paris, où il vit. Maya hésite : elle a besoin de cet argent, mais elle ne connaît cet homme que depuis quelques minutes... Cette offre providentielle arrive à point nommé, mais le projet l'inquiète.
Car Gabriel lui propose de rentrer en France, un pays où elle n'a plus mis les pieds depuis 13 ans. Depuis qu'elle... est morte. En tout cas, officiellement. Maya a refait sa vie en Irlande, tant bien que mal, avec des hauts, mais aussi pas mal de bas. Et elle reste rongée par une culpabilité terrible qui la pousse, en particulier, à se noyer un peu trop régulièrement dans l'alcool...
Après tout, le temps a passé, elle a bien changé durant cette période, la probabilité qu'on la reconnaisse est infime. Alors, elle finit par accepter d'accompagner Gabriel, de lui servir de guide. De lui servir d'yeux. Et puis, avec son air charmeur, ce bonhomme-là n'a pas l'air bien méchant. Et sa cécité donne un avantage réel à la jeune femme.
Ce qu'elle ignore, c'est que Gabriel n'était pas à Cork par hasard et qu'il l'a abordée en toute connaissance de cause. Et son offre d'emploi est tout à fait intéressée. L'aveugle a un plan en tête, un plan qui s'organise tout entier autour de la jeune femme. Ce voyage qu'il lui propose n'est pas juste un voyage d'agrément, c'est une quête. Une quête de justice.
Une quête de vengeance.
En 2003, Victor, étudiant dans une école privée de Neuilly, a été assassiné. Un crime d'une rare brutalité qui a plongé Gabriel dans le noir. Car Victor était son fils et, en apprenant son décès, sous la violence du choc, il a perdu la vue. Une cécité aussi soudaine qu'incurable, semble-t-il, qui a bouleversé un peu plus son existence.
Depuis, Gabriel ne vit plus que dans l'idée de retrouver l'assassin de son fils. Il a rompu avec sa femme, reconstruit sa vie en fonction de son handicap. Il a dû réapprendre tous les gestes du quotidien pour les effectuer en dépit de sa cécité. Mais, surtout, il a continué à rechercher la trace de la personne qu'il pense être l'assassin de Victor.
Cette personne, c'est Maya...
Décidément, Ingrid Desjours a une fascination pour les yeux qui, chez une écrivaine de thrillers, a presque quelque chose d'inquiétant... Après le très dur et éprouvant, mais passionnant "Sa vie dans les yeux d'une poupée", la voici donc qui construit toute l'intrigue d'un roman autour de la cécité d'un de ses personnages.
Mais pas n'importe quelle forme de cécité, non, ce serait trop facile. Gabriel souffre de ce qu'on appelle une cécité de conversion, un mal bien réel, mais mal connu et surtout impossible à soigner dans l'état actuel des connaissances. Les organes, yeux, nerfs, ne sont pas endommagés, mais, suite à un traumatisme psychologique, et non physique, le patient ne voit plus.
C'est comme si, soudain, sous l'effet de ce choc, ici, la mort violente de son fils, le cerveau de Gabriel s'était mis en panne et refusait de donner l'ordre aux yeux de voir... Qui sait si, un jour, ce processus s'inversera ? Les médecins ne comprennent pas le phénomène, on ne peut donc rien prédire concernant un possible retour à la normale.
Le personnage de Gabriel, affaibli physiquement, mais possédant une exceptionnelle détermination, s'est donc lancé, malgré son handicap, dans une quête bien particulière. J'écris "une quête", mais en fait, on pourrait dire qu'il chasse plusieurs lièvres à la fois. Consciemment ou non, en plus de la vérité concernant la mort de Victor, Gabriel cherche à retrouver la vue. Et à guérir sa culpabilité...
Ce dernier mot, je l'ai déjà utilisé, à propos de Maya. Entre ces deux âmes déboussolées, c'est un des rares points communs (avec Victor). Oui, les deux personnages qui se rencontrent à Cork et s'apprêtent à faire un bout de chemin ensemble sont rongés par la culpabilité depuis toutes ces années. Depuis que Victor est mort.
Je dois dire qu'on ne sait trop sur quel pied danser au départ avec ces personnages. Je garde de ma lecture de "Sa vie dans les yeux d'une poupée" un souvenir aigu. La noirceur de ce roman, la folie qui l'habitait, le côté malsain des personnages, tout cela reste gravé dans ma mémoire. Aussi, dès la rencontre entre Maya et Gabriel, je me suis senti un peu inquiet...
Et si j'avais, devant moi, deux monstres prêts à se confronter en rivalisant de ruse et de méchanceté ? Franchement, on peut se poser la question, car, de prime abord, sous ses airs d'aveugle plein d'entrain, Gabriel peut sembler presque menaçant aux yeux du lecteur. Son double jeu, qui se révèle petit à petit, laisse transparaître sa soif de vengeance. Oeil pour oeil, sinistre parallèle...
De même, de Maya, on sait bien peu de choses, mais ce que l'on découvre d'elle d'emblée n'inspire pas franchement la confiance : une fugitive, une jeune femme qui a orchestré sa mort pour disparaître dans des conditions assez glauques, une meurtrière... Et, si elle a tué une fois, pourquoi ne recommencerait-elle pas, pour fuir à nouveau, si la nécessité s'en fait sentir ?
L'un des ressorts de l'intrigue, c'est justement cette relation entre cette femme et cet homme, meurtris l'une comme l'autre, en quête d'une certaine rédemption. Comment elle se noue, comment elle va évoluer, les projets de Gabriel et le moment où Maya va comprendre que l'homme qu'elle accompagne lui a caché des choses, et pas des moindres.
Mais, ce n'est pas tout. Car l'un des éléments forts de ce roman, c'est sa construction. "La Prunelle de ses yeux" n'est pas un thriller d'action, c'est un thriller psychologique qui repose essentiellement sur ses personnages. Alors, Ingrid Desjours en fait ses moteurs en mettant en place une construction chorale : à chaque chapitre, son point de vue, si je puis dire.
On passe donc de Maya à Gabriel, sans recourir au "je", ce qui aurait pu être une possibilité. Mais, malgré cette narration à la troisième personne, on change bien d'axe sur les événements, on les perçoit différemment d'un chapitre à l'autre. La détermination de Gabriel qui mène la danse, les questionnements de Maya...
Cela pourrait fonctionner ainsi, mais il y a encore autre chose. Maya et Gabriel ne sont pas les seuls personnages dont nous adopterons le point de vue. Il y a aussi celui de Victor. L'adolescence, lui, s'exprime à la première personne et c'est lui-même qui va nous raconter les événements tragiques qui se sont déroulés en 2003.
Il va surtout remettre ce drame dans son contexte, et ainsi, nous montrer Maya et Gabriel sous un jours différent. Nous montrer comment ils étaient avant que le drame ne bouleverse leurs existences de fond en comble, pousse l'une à fuir et plonge l'autre dans une nuit sans fin. Le roman n'est plus seulement choral, il se divise en deux époques distinctes...
Il y aurait beaucoup à dire sur cette partie qui se passe en 2003, mais ces éléments, il vous faudra les découvrir par vous-mêmes. Petit à petit, l'histoire abstraite qui unit Maya et Gabriel prend forme, prend substance. Et le lecteur va se retrouver, encore une fois, en possession d'un certain nombre d'éléments qu'il est le seul à pouvoir mettre en perspective.
Pour être complet, il faudrait que je vous parle d'un quatrième personnage, qui lui aussi va non seulement intervenir, mais nous offrir son point de vue à certains moments. Il s'appelle Tancrède, mais je ne vais pas en dire plus à son sujet. Il fait partie de ces personnages qui sont à la fois secondaires et essentiels pour l'intrigue du roman. Reste à comprendre son rôle exact dans tout cela.
En alternant les points de vue et les époques, Ingrid Desjours pose les unes après les autres les pièces de son puzzle et elle fait ainsi naître la tension, le suspense. On n'imagine mal cette histoire, quel qu'en soit le fin mot, s'achever sans un affrontement. Sans son lot de révélations qui mèneront à la vérité des faits.
Au coeur de ce récit, la relation difficile entre un père et son fils, entre Gabriel et Victor. Il faut préciser que Gabriel est devenu père très jeune et qu'il manquait certainement de maturité au moment d'assumer ce rôle. Paradoxalement, c'est à la mort de Victor que Gabriel a pris conscience de ses manques, de ses erreurs, de son... aveuglement.
Oui, on en revient au titre de notre billet : qu'il s'agisse de Gabriel concerné au premier chef, ou de Maya, l'aveuglement n'est pas juste physique, dans ce roman. Il est aussi moral et psychologique. Les personnages ont refoulé ce qui pouvait déranger, de passer outre les éléments plus douloureux liés à ce qui s'est passé en 2003.
Preuve qu'ils ont une conscience, ce qui, on le verra, n'est pas le cas de tous les personnages engagés dans cette affaire. Quant à Victor, sans doute le plus lucide de tous, il souffrait justement de l'aveuglement des autres à son égard, et c'est aussi ce qui l'a poussé dans le processus qui aboutira à sa mort...
Peut-être est-ce facile à dire à posteriori, mais ce sont des responsabilités, au pluriel, qui ont abouti à la mort du jeune homme de 17 ans. Oh, bien sûr, il y a un meurtrier, celui qui a ôté la vie à Victor, mais cet événement dramatique est aussi la conséquence d'un faisceau d'éléments né de ces aveuglements, au sens figuré du terme.
Un élément, plein d'ironie, de sarcasme, même, presque de cruauté, est en lien avec tout cela : une maison dans laquelle va se passer une partie du roman, une maison qui porte un nom bien particulier. Il s'agit de la maison des Trois Singes, vous savez, ces Singes de la sagesse, comme on les appelle, un qui se cache les yeux, le deuxième qui se bouche les oreilles, le troisième qui se ferme la bouche.
On ne voit rien, on n'entend rien, on ne dit rien... Trois attitudes hypocrites qui, pourtant, ne permettent pas l'oubli salvateur... Au contraire, de cet aveuglement, de cette surdité et de ce silence naît la culpabilité, un poison douloureux et qui se répand lentement, très lentement... On ne pouvait trouver plus justes symboles pour cette histoire et ses principaux personnages...
Enfin, il faudrait, pour être complet sur la dimension psychologique, évoquer l'expérience de Milgram et d'autres études scientifiques (j'aurais bien envie de mettre des guillemets à ce mot, tiens) cherchant à théoriser l'obéissance et même la soumission à l'ordre et à l'autorité. Ces expériences, terribles, nous sont présentées au fil du livre, dans toute leur violence...
"La Prunelle de ses yeux", c'est un roman sur la culpabilité, sur la douleur et sur la recherche de rédemption, de pardon, même tardif. Une absolution qu'on attend des autres, mais surtout que ces personnages doivent accorder à eux-mêmes. Ils ont une part de responsabilité écrasante dans les événements et ont besoin de ce pardon, même tardif, trop tardif, pour reprendre le fil de leurs existences...
Malgré tout ce que je viens de dire, malgré la cécité et la noirceur du propos, Ingrid Desjours signe pourtant un roman lumineux, plein d'espoir et d'amour qui ne demande qu'à s'exprimer. Il va falloir passer par beaucoup d'embûches et de douleurs avant d'en arriver là. Avant que la vérité de soit révélée et les responsabilités définies.
Oui, comme je le disais plus haut, il y avait certainement matière à faire de ce thriller psychologique un livre très sombre, désespéré, infiniment plus violent que ce que l'on a en main. Ingrid Desjours n'a pas choisi, cette fois, de mener ses personnages sur les chemins de la perdition, mais de leur offrir la possibilité de vivre à nouveau. De laisser le passé derrière eux et de reconstruire un avenir.
La résilience, encore. Encore et toujours...
Et ce billet va s'achever, comme souvent et comme j'aime bien le faire, en musique. Pas seulement parce que la voix et la sensualité de Norah Jones sont un bonheur, mais parce que ce titre, entendu dans "la Prunelle de ses yeux", n'a certainement pas été choisi par hasard par la romancière. Il y est question de vue, de regard. Forcément...
dimanche 18 février 2018
"L'infini cassé, leur histoire d'amour. L'histoire de leur pays..."
Dernier tour dans le désert et nouveau changement de décor. Après l'Australie et l'Utah, c'est au Chili que nous partons, là où se trouve le désert d'Atacama, l'un des plus hostiles au monde, dit-on. Il est l'un des cadres de notre roman du jour, mais pas le seul, car c'est vraiment le Chili qui est le thème central. Le Chili, et son histoire contemporaine, les séquelles de la dictature Pinochet, des blessures encore à vif. Après l'Argentine, dans "Mapuche", Caryl Férey traverse la Cordillère des Andes pour nous emmener dans le pays voisin, mais sans quitter ce peuple persécuté depuis des siècles et qui voit ses territoires toujours plus menacés. "Condor", qui vient de paraître en poche chez Folio, et "Mapuche" pourraient d'ailleurs former une espèce de diptyque sud-américain, douloureux et violent, porté par des personnages très intéressants, en particulier un avocat excentrique et rebelle, et une construction narrative très riche, très intelligente.
Gabriela est issue de la communauté mapuche (elle est la jeune soeur de Jana, l'héroïne de "Mapuche"), mais elle a quitté les siens quelques années plus tôt pour venir à Santiago, la capitale du Chili, et y faire des études de cinéma. Très engagée à gauche, elle milite pour l'éducation universelle et est de toutes les manifestations sur la Plaza Italia.
Mais, cela ne suffit pas à se loger, se nourrir et financer ses études. Dans un premier temps, elle a vécu chez Cristian, un ami de ses frères, fondateur d'une télévision associative installée dans un des quartiers les plus pauvres de Santiago, la Victoria. Puis, elle a rencontré par hasard Stefano, projectionniste dans le cinéma où l'étudiante allait voir des classiques du cinéma.
Désormais, elle vit dans l'ancienne cabine de projection, file un coup de main à la caisse quand c'est nécessaire, et tourne des reportages pour la télé de Cristian, histoire de se faire la main. Toujours équipée de sa Go Pro, Gabriela filme tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle vit, essayant d'en tirer des documents qui pourraient être pertinents.
Stefano, lui, est un ancien militant du MIR, mouvement révolutionnaire favorable à la lutte armée, mais qui soutint pourtant Allende après son élection. Puis, il y a eu le coup d'Etat. Stefano était à la Moneda, quand le palais a été attaqué. Par la suite, il a connu la torture dans la sinistre Villa Grimaldi et, après avoir miraculeusement survécu, il a pris les chemins de l'exil...
Rentré au Chili dans les années 1990, il a fait profil bas, reprenant ce cinéma abandonné et organisant des projections dans le quartier de la Victoria pour ceux qui ne peuvent pas se payer de billets. Le dimanche, Gabriela l'accompagne souvent dans le quartier, où ils retrouvent le père Patricio, curé de la Victoria qui se dévoue pour ce quartier.
Mais, ce dimanche-là, l'enthousiasme va vite être douché... Alors que Gabriela et Stefano viennent d'arriver, on vient prévenir le prêtre que quelque chose de grave s'est produit. Un corps a été découvert, un adolescent... Gabriela le connaît bien : c'est Enrique, le fils de Cristian, un garçon de tout juste 14 ans, qui gît là, en pleine rue...
Gabriela et Stefano, sous le choc, apprennent alors, horrifiés, que Enrique est le quatrième gamin du quartier à mourir en quelques jours... La découverte de cette nouvelle victime déclenche un début d'émeute, maîtrisé péniblement par les carabiniers, montrés du doigt par la population pour leur peu d'empressement à mener l'enquête.
Selon son habitude, Gabriela a fait tourner sa caméra. Et, lorsqu'elle visionne le film, elle remarque quelque chose : un résidu de poudre blanche sous une narine d'Enrique. De la drogue ? C'est fort possible, et cela pourrait expliquer ces décès soudains... Mais qui pourrait fourguer une telle saloperie dans un quartier comme la Victoria ?
Sa découverte ne suffit pas à réveiller la police. Elle décide alors de faire appel à un avocat, qu'on lui a conseillé. Un certain Esteban Tagle-Roz, qui, ça commence mal, ne répond jamais au téléphone... Alors, elle se rend à son cabinet où elle rencontre Edwards, l'associé d'Esteban, qui l'envoie quasiment bouler.
Mais Gabriela est tenace, elle insiste et finit par rencontrer Esteban : un dandy, excentrique et provocateur, qui se présente lui-même comme un spécialiste des causes perdues. Ca tombe bien, l'affaire que lui apporte l'étudiante y ressemble fort... Et puisque la police ne semble guère motivée pour retrouver les responsables de la mort de quatre garçons, Esteban et Gabriela se lancent dans leur propre enquête...
Avant tout, il faut parler des personnages de "Condor", car ils sont tout très intéressants, les principaux comme les secondaires, les gentils comme les méchants. A commencer par Gabriela, cette jeune femme au caractère bien trempé, engagée, déterminée, passionnée, fière de ses racines et rêvant d'un monde meilleur.
Comme beaucoup de jeunes mapuches de sa génération, elle a quitté les siens, le nord du Chili, où vit son peuple, mais n'a jamais coupé le cordon, bien au contraire, restant fidèle à sa culture, à sa croyance au chamanisme. Révoltée et résistante, comme l'ont été les Mapuches de tous temps, elle ne peut supporter que la mort d'Enrique reste inexpliquée. Et pire : impunie.
Face à elle, Esteban, qui est tout son contraire. Jeune quadra, issue d'une des plus riches familles du pays, propriétaire d'une bonne partie des médias nationaux, c'est le mouton noir de sa famille. Il a fondé son cabinet avec son ami d'enfance pour donner le change, mais il semble exercer en dilettante, provocateur et moqueur, tout en rêvant de devenir écrivain.
Se déplaçant le plus souvent pieds nus, roulant en Aston Martin, comme James Bond, se nourrissant quasiment exclusivement de ceviches et de pisco sour, il est rejeté par sa famille, surtout depuis qu'il a séché l'anniversaire de sa mère et fait un scandale lors d'un baptême... A l'inverse de Gabriela, son idéalisme semble surtout consister à mettre en rogne son père et ses frères et soeurs...
Pourtant, derrière cette façade gentiment agaçante, cette vanité affichée honteusement, on devine un garçon fort sympathique, capable de mettre des coups de pied dans la fourmilière quand c'est nécessaire. A sa manière très spéciale, ce grand bourgeois en rupture de ban va prendre l'enquête en main et la faire avancer considérablement...
Mais, là où Gabriela est un personnage entier, qui ne cache rien de ses émotions, de ses colères ou de ses joies, on va deviner, au fur et à mesure qu'on le découvre, qu'il cache certaines blessures, longtemps indéfinies. Et que sa passion pour Victor Jara, ce célèbre guitariste assassiné par la junte peu après le coup d'Etat de 1973 n'est pas juste une posture provocatrice.
Autour d'eux, des personnages importants, comme Stefano ou le père Patricio, ou encore Edwards, l'associé d'Esteban, miné par les soucis, et en particulier la découverte de l'infidélité de sa femme. De lui, on a une image pathétique qui ne correspond sans doute pas à ce qu'est cet homme en temps ordinaire. Déjà très différent d'Esteban, par son sérieux, le contraste n'en est que plus saisissant.
Tous sont des personnages secondaires, comme on dit, mais leur rôle est tout sauf négligeable dans "Condor". Mais, si l'on doit mettre en avant un autre personnage, il faut évidemment parler du Chili, qui n'est pas juste le cadre de cette histoire. Tout ce qui se déroule dans le roman de Caryl Férey est intrinsèquement lié à ce pays, son histoire ou sa géographie.
Commençons par cette géographie : le Chili, c'est un pays tout en longueur, coincé entre l'océan Pacifique et les Andes. Il a des frontières avec l'Argentine, le géant voisin, mais aussi, au nord, avec le Pérou et la Bolivie. C'est dans cette partie septentrionale du pays que se trouve le fameux désert d'Atacama, ses paysages somptueux, sa nature sauvage et hostile, ses altitudes énormes...
L'essentiel du roman se déroule à Santiago, la capitale, au centre, si l'on peut dire, de ce pays. Quant au territoire des Mapuches, il est un peu plus au sud (sur la carte ci-dessus, les villes de Concepcion et Temuco peuvent servir de repères, sinon cliquez ici). Voilà un vaste terrain de jeu qui, passant aussi par Valparaiso ou la station balnéaire de Quintay, va nous offrir une diversité de paysage formidable.
Mais, la géographie, ce n'est pas juste des décors, même si, pour le lecteur, il n'est pas désagréable de pouvoir visualiser ces endroits, voyager depuis son canapé ou son lit au fil des pages. Si j'évoque tout cela, c'est aussi parce que ce sont des éléments forts de l'intrigue, qui tiennent des rôles qu'on ne cerne pas tout de suite, pour certains.
Et puis, il y a l'histoire. Et au Chili, même de nos jours, tout tourne encore autour de cette date du 11 septembre 1973, date du coup d'Etat militaire qui a vu la chute du président marxiste légitimement élu, Salvador Allende, et l'avènement d'un général quasiment inconnu mais qui allait inscrire son nom en lettres de sang dans l'histoire de son pays : Augusto Pinochet.
Cette période, qui va durer jusqu'en 1990, est une sorte de vortex pour le Chili : près de 30 ans après la fin de cette dictature, elle apparaît encore partout. Dans les mémoires, forcément, en particulier de ceux qui ont souffert des violences policières et des persécutions politiques. Mais aussi dans la vie de tous les jours.
Le Chili, Caryl Férey le rappelle dans le cours de son roman, a été un laboratoire d'idées pour les Etats-Unis, grands soutiens de la dictature Pinochet, en particulier sur le plan économique : l'école de Chicago, chantre du néo-libéralisme, a imposé au pays sa dérégulation totale, dont le pays ressent toujours les effets, pas franchement positifs.
Cette ombre de la dictature, les blessures qu'elle a laissé, mais aussi et surtout l'impunité totale dont bénéficient les bourreaux (condition sine qua non de la réconciliation démocratique) demeurent dans le pays, dans les esprits de tous. Et on le ressent parfaitement, même lorsque l'intrigue n'est pas lancée complètement.
Un exemple : le quartier de la Victoria, qui a énormément souffert pendant le règne de Pinochet pour avoir été farouchement opposé à sa politique. Sur les murs du quartier, de grandes fresques, comme on en voit tant en Amérique du Sud. Aux côtés du Che, d'Allende ou d'autres figures politiques chiliennes, le visage du père André Jarlan, prêtre français adoré dans ce quartier et assassiné en 1984 par la police...
Dans l'intrigue de "Condor" aussi, il y a cet incessant va-et-vient entre présent et passé, à l'image de la fascination d'Esteban pour le musicien Victor Jara, ou du personnage de Stefano, discret, c'est vrai, mais habité par ce passé dont il a été le témoin direct. Il faut vraiment saluer le travail de construction narrative de Caryl Férey, car la réussite de ce roman, c'est aussi ce lien permanent entre les deux époques.
Un construction qui est aussi portée par un crescendo. Certains lecteurs trouveront peut-être que la mise en place est assez longue, et c'est vrai que la première partie ressemble plus à un polar qu'au genre de thrillers auquel nous a habitués Caryl Férey. Mais, il y a effectivement pas mal de choses à mettre en place, tant au niveau des personnages que des situations.
Et puis, soudain, tout va basculer. Et la violence, latente jusque-là, va déferler. On retrouve alors une tonalité qui rappelle les précédents livres de l'auteur, dont "Zulu" et "Mapuche", déjà évoqués sur ce blog. Les choses s'accélèrent et la noirceur s'étend au même rythme de la violence, tandis que les véritables enjeux se dévoilent.
Cette construction, c'est aussi une idée que j'ai trouvée remarquable : jouer sur un malentendu. Bien évidemment, je ne vais pas expliciter cet aspect-là de l'intrigue, cela nous emmènerait trop loin, mais, pendant longtemps, les personnages évoluent dans une situation équivoque sans laquelle, peut-être, les choses n'auraient pas aussi mal tourné...
Caryl Férey est un auteur de thriller, c'est vrai, il a cette capacité à nous offrir des histoires violentes et pourtant belles, douloureuses, aussi, et qui lèvent le voile sur des histoires terriblement plausibles reposant sur des enjeux bien réels. C'est aussi un romancier qui sait façonner de très beaux personnages dont il fait les acteurs du drame qu'il élabore.
Et puis, il y a une écriture qui transcende les genres, dépasse le simple cadre du thriller, parfois très, trop codifié, où l'efficacité doit primer sur l'esthétique du style. La plume de Caryl Férey porte son histoire, ses personnages, mais aussi sa propre révolte. Une colère qu'il nous transmet, comme s'il se faisait, à travers la fiction, lanceur d'alerte.
L'engagement politique qui marque l'oeuvre de ce romancier est toujours très présente dans "Condor" et l'on comprend aussi le dépit qu'il ressent de voir une gauche chilienne incapable de reprendre les choses là où Allende les a laissées, contraint et forcé. Et, comme pour l'Argentine précédemment, comme tous les pays où nous emmène Caryl Férey, on ressent un attachement.
Bien sûr, il y a la beauté et le dépaysement que véhiculent ces lieux. Depuis la Nouvelle-Zélande, où il faudra que j'aille en sa compagnie, jusqu'au Chili, Caryl Férey est devenu un véritable écrivain voyageur qui transmet son regard, mais aussi l'attachement et la tendresse qu'il ressent pour les peuples qu'il côtoie.
La beauté et la rudesse de ces pays, la folie et l'avidité humaines sont des constantes dans le travail de Caryl Férey. Pour "Condor", il avoue une gestation très difficile, peut-être la plus difficile depuis qu'il écrit. Des versions nombreuses qui ont fini à la corbeille avant celle-ci. Pour le lecteur que je suis, en tout cas, cette souffrance en valait la peine, le résultat est enrichissant.
Un dernier mot sur le titre de ce billet, que j'ai mis longtemps à trouver. Pour être tout à fait juste, il faudrait mettre "l'infini cassé" en italique, car c'est un titre de livre. Un livre qui tient une place particulière dans le roman, puisque nous sommes amenés à le lire, pas dans son intégralité, mais dans ses grandes lignes.
Plus que cette allusion au livre, qui nous ramène en fait au personnage, c'est la suite qui m'a plu et m'a poussé à choisir cette citation-là et pas une autre. Parce qu'on y retrouve l'amour, présent dans ce roman au milieu du bruit et de la fureur, de la haine et de la violence, et puis, à cause de la mention (là aussi, pour être exact, il faudrait un saut de ligne) de l'histoire du Chili, je n'y reviens pas.
Je crois qu'on pourrait disserter longtemps sur ce titre, "l'Infini cassé". Je le trouve très beau, très juste. A travers lui, mais aussi à travers "Condor" (bien bel oiseau dont le nom, décidément, ne cesse de servir à de bien vilaines choses...), il y a une transmission. De la génération qui a vécu la chute d'Allende et la dictature Pinochet, à celle qui doit prendre les destinées du pays en main, et dont Gabriela entend être partie prenante.
Gabriela est issue de la communauté mapuche (elle est la jeune soeur de Jana, l'héroïne de "Mapuche"), mais elle a quitté les siens quelques années plus tôt pour venir à Santiago, la capitale du Chili, et y faire des études de cinéma. Très engagée à gauche, elle milite pour l'éducation universelle et est de toutes les manifestations sur la Plaza Italia.
Mais, cela ne suffit pas à se loger, se nourrir et financer ses études. Dans un premier temps, elle a vécu chez Cristian, un ami de ses frères, fondateur d'une télévision associative installée dans un des quartiers les plus pauvres de Santiago, la Victoria. Puis, elle a rencontré par hasard Stefano, projectionniste dans le cinéma où l'étudiante allait voir des classiques du cinéma.
Désormais, elle vit dans l'ancienne cabine de projection, file un coup de main à la caisse quand c'est nécessaire, et tourne des reportages pour la télé de Cristian, histoire de se faire la main. Toujours équipée de sa Go Pro, Gabriela filme tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle vit, essayant d'en tirer des documents qui pourraient être pertinents.
Stefano, lui, est un ancien militant du MIR, mouvement révolutionnaire favorable à la lutte armée, mais qui soutint pourtant Allende après son élection. Puis, il y a eu le coup d'Etat. Stefano était à la Moneda, quand le palais a été attaqué. Par la suite, il a connu la torture dans la sinistre Villa Grimaldi et, après avoir miraculeusement survécu, il a pris les chemins de l'exil...
Rentré au Chili dans les années 1990, il a fait profil bas, reprenant ce cinéma abandonné et organisant des projections dans le quartier de la Victoria pour ceux qui ne peuvent pas se payer de billets. Le dimanche, Gabriela l'accompagne souvent dans le quartier, où ils retrouvent le père Patricio, curé de la Victoria qui se dévoue pour ce quartier.
Mais, ce dimanche-là, l'enthousiasme va vite être douché... Alors que Gabriela et Stefano viennent d'arriver, on vient prévenir le prêtre que quelque chose de grave s'est produit. Un corps a été découvert, un adolescent... Gabriela le connaît bien : c'est Enrique, le fils de Cristian, un garçon de tout juste 14 ans, qui gît là, en pleine rue...
Gabriela et Stefano, sous le choc, apprennent alors, horrifiés, que Enrique est le quatrième gamin du quartier à mourir en quelques jours... La découverte de cette nouvelle victime déclenche un début d'émeute, maîtrisé péniblement par les carabiniers, montrés du doigt par la population pour leur peu d'empressement à mener l'enquête.
Selon son habitude, Gabriela a fait tourner sa caméra. Et, lorsqu'elle visionne le film, elle remarque quelque chose : un résidu de poudre blanche sous une narine d'Enrique. De la drogue ? C'est fort possible, et cela pourrait expliquer ces décès soudains... Mais qui pourrait fourguer une telle saloperie dans un quartier comme la Victoria ?
Sa découverte ne suffit pas à réveiller la police. Elle décide alors de faire appel à un avocat, qu'on lui a conseillé. Un certain Esteban Tagle-Roz, qui, ça commence mal, ne répond jamais au téléphone... Alors, elle se rend à son cabinet où elle rencontre Edwards, l'associé d'Esteban, qui l'envoie quasiment bouler.
Mais Gabriela est tenace, elle insiste et finit par rencontrer Esteban : un dandy, excentrique et provocateur, qui se présente lui-même comme un spécialiste des causes perdues. Ca tombe bien, l'affaire que lui apporte l'étudiante y ressemble fort... Et puisque la police ne semble guère motivée pour retrouver les responsables de la mort de quatre garçons, Esteban et Gabriela se lancent dans leur propre enquête...
Avant tout, il faut parler des personnages de "Condor", car ils sont tout très intéressants, les principaux comme les secondaires, les gentils comme les méchants. A commencer par Gabriela, cette jeune femme au caractère bien trempé, engagée, déterminée, passionnée, fière de ses racines et rêvant d'un monde meilleur.
Comme beaucoup de jeunes mapuches de sa génération, elle a quitté les siens, le nord du Chili, où vit son peuple, mais n'a jamais coupé le cordon, bien au contraire, restant fidèle à sa culture, à sa croyance au chamanisme. Révoltée et résistante, comme l'ont été les Mapuches de tous temps, elle ne peut supporter que la mort d'Enrique reste inexpliquée. Et pire : impunie.
Face à elle, Esteban, qui est tout son contraire. Jeune quadra, issue d'une des plus riches familles du pays, propriétaire d'une bonne partie des médias nationaux, c'est le mouton noir de sa famille. Il a fondé son cabinet avec son ami d'enfance pour donner le change, mais il semble exercer en dilettante, provocateur et moqueur, tout en rêvant de devenir écrivain.
Se déplaçant le plus souvent pieds nus, roulant en Aston Martin, comme James Bond, se nourrissant quasiment exclusivement de ceviches et de pisco sour, il est rejeté par sa famille, surtout depuis qu'il a séché l'anniversaire de sa mère et fait un scandale lors d'un baptême... A l'inverse de Gabriela, son idéalisme semble surtout consister à mettre en rogne son père et ses frères et soeurs...
Pourtant, derrière cette façade gentiment agaçante, cette vanité affichée honteusement, on devine un garçon fort sympathique, capable de mettre des coups de pied dans la fourmilière quand c'est nécessaire. A sa manière très spéciale, ce grand bourgeois en rupture de ban va prendre l'enquête en main et la faire avancer considérablement...
Mais, là où Gabriela est un personnage entier, qui ne cache rien de ses émotions, de ses colères ou de ses joies, on va deviner, au fur et à mesure qu'on le découvre, qu'il cache certaines blessures, longtemps indéfinies. Et que sa passion pour Victor Jara, ce célèbre guitariste assassiné par la junte peu après le coup d'Etat de 1973 n'est pas juste une posture provocatrice.
Autour d'eux, des personnages importants, comme Stefano ou le père Patricio, ou encore Edwards, l'associé d'Esteban, miné par les soucis, et en particulier la découverte de l'infidélité de sa femme. De lui, on a une image pathétique qui ne correspond sans doute pas à ce qu'est cet homme en temps ordinaire. Déjà très différent d'Esteban, par son sérieux, le contraste n'en est que plus saisissant.
Tous sont des personnages secondaires, comme on dit, mais leur rôle est tout sauf négligeable dans "Condor". Mais, si l'on doit mettre en avant un autre personnage, il faut évidemment parler du Chili, qui n'est pas juste le cadre de cette histoire. Tout ce qui se déroule dans le roman de Caryl Férey est intrinsèquement lié à ce pays, son histoire ou sa géographie.
Commençons par cette géographie : le Chili, c'est un pays tout en longueur, coincé entre l'océan Pacifique et les Andes. Il a des frontières avec l'Argentine, le géant voisin, mais aussi, au nord, avec le Pérou et la Bolivie. C'est dans cette partie septentrionale du pays que se trouve le fameux désert d'Atacama, ses paysages somptueux, sa nature sauvage et hostile, ses altitudes énormes...
L'essentiel du roman se déroule à Santiago, la capitale, au centre, si l'on peut dire, de ce pays. Quant au territoire des Mapuches, il est un peu plus au sud (sur la carte ci-dessus, les villes de Concepcion et Temuco peuvent servir de repères, sinon cliquez ici). Voilà un vaste terrain de jeu qui, passant aussi par Valparaiso ou la station balnéaire de Quintay, va nous offrir une diversité de paysage formidable.
Mais, la géographie, ce n'est pas juste des décors, même si, pour le lecteur, il n'est pas désagréable de pouvoir visualiser ces endroits, voyager depuis son canapé ou son lit au fil des pages. Si j'évoque tout cela, c'est aussi parce que ce sont des éléments forts de l'intrigue, qui tiennent des rôles qu'on ne cerne pas tout de suite, pour certains.
Et puis, il y a l'histoire. Et au Chili, même de nos jours, tout tourne encore autour de cette date du 11 septembre 1973, date du coup d'Etat militaire qui a vu la chute du président marxiste légitimement élu, Salvador Allende, et l'avènement d'un général quasiment inconnu mais qui allait inscrire son nom en lettres de sang dans l'histoire de son pays : Augusto Pinochet.
Cette période, qui va durer jusqu'en 1990, est une sorte de vortex pour le Chili : près de 30 ans après la fin de cette dictature, elle apparaît encore partout. Dans les mémoires, forcément, en particulier de ceux qui ont souffert des violences policières et des persécutions politiques. Mais aussi dans la vie de tous les jours.
Le Chili, Caryl Férey le rappelle dans le cours de son roman, a été un laboratoire d'idées pour les Etats-Unis, grands soutiens de la dictature Pinochet, en particulier sur le plan économique : l'école de Chicago, chantre du néo-libéralisme, a imposé au pays sa dérégulation totale, dont le pays ressent toujours les effets, pas franchement positifs.
Cette ombre de la dictature, les blessures qu'elle a laissé, mais aussi et surtout l'impunité totale dont bénéficient les bourreaux (condition sine qua non de la réconciliation démocratique) demeurent dans le pays, dans les esprits de tous. Et on le ressent parfaitement, même lorsque l'intrigue n'est pas lancée complètement.
Un exemple : le quartier de la Victoria, qui a énormément souffert pendant le règne de Pinochet pour avoir été farouchement opposé à sa politique. Sur les murs du quartier, de grandes fresques, comme on en voit tant en Amérique du Sud. Aux côtés du Che, d'Allende ou d'autres figures politiques chiliennes, le visage du père André Jarlan, prêtre français adoré dans ce quartier et assassiné en 1984 par la police...
Dans l'intrigue de "Condor" aussi, il y a cet incessant va-et-vient entre présent et passé, à l'image de la fascination d'Esteban pour le musicien Victor Jara, ou du personnage de Stefano, discret, c'est vrai, mais habité par ce passé dont il a été le témoin direct. Il faut vraiment saluer le travail de construction narrative de Caryl Férey, car la réussite de ce roman, c'est aussi ce lien permanent entre les deux époques.
Un construction qui est aussi portée par un crescendo. Certains lecteurs trouveront peut-être que la mise en place est assez longue, et c'est vrai que la première partie ressemble plus à un polar qu'au genre de thrillers auquel nous a habitués Caryl Férey. Mais, il y a effectivement pas mal de choses à mettre en place, tant au niveau des personnages que des situations.
Et puis, soudain, tout va basculer. Et la violence, latente jusque-là, va déferler. On retrouve alors une tonalité qui rappelle les précédents livres de l'auteur, dont "Zulu" et "Mapuche", déjà évoqués sur ce blog. Les choses s'accélèrent et la noirceur s'étend au même rythme de la violence, tandis que les véritables enjeux se dévoilent.
Cette construction, c'est aussi une idée que j'ai trouvée remarquable : jouer sur un malentendu. Bien évidemment, je ne vais pas expliciter cet aspect-là de l'intrigue, cela nous emmènerait trop loin, mais, pendant longtemps, les personnages évoluent dans une situation équivoque sans laquelle, peut-être, les choses n'auraient pas aussi mal tourné...
Caryl Férey est un auteur de thriller, c'est vrai, il a cette capacité à nous offrir des histoires violentes et pourtant belles, douloureuses, aussi, et qui lèvent le voile sur des histoires terriblement plausibles reposant sur des enjeux bien réels. C'est aussi un romancier qui sait façonner de très beaux personnages dont il fait les acteurs du drame qu'il élabore.
Et puis, il y a une écriture qui transcende les genres, dépasse le simple cadre du thriller, parfois très, trop codifié, où l'efficacité doit primer sur l'esthétique du style. La plume de Caryl Férey porte son histoire, ses personnages, mais aussi sa propre révolte. Une colère qu'il nous transmet, comme s'il se faisait, à travers la fiction, lanceur d'alerte.
L'engagement politique qui marque l'oeuvre de ce romancier est toujours très présente dans "Condor" et l'on comprend aussi le dépit qu'il ressent de voir une gauche chilienne incapable de reprendre les choses là où Allende les a laissées, contraint et forcé. Et, comme pour l'Argentine précédemment, comme tous les pays où nous emmène Caryl Férey, on ressent un attachement.
Bien sûr, il y a la beauté et le dépaysement que véhiculent ces lieux. Depuis la Nouvelle-Zélande, où il faudra que j'aille en sa compagnie, jusqu'au Chili, Caryl Férey est devenu un véritable écrivain voyageur qui transmet son regard, mais aussi l'attachement et la tendresse qu'il ressent pour les peuples qu'il côtoie.
La beauté et la rudesse de ces pays, la folie et l'avidité humaines sont des constantes dans le travail de Caryl Férey. Pour "Condor", il avoue une gestation très difficile, peut-être la plus difficile depuis qu'il écrit. Des versions nombreuses qui ont fini à la corbeille avant celle-ci. Pour le lecteur que je suis, en tout cas, cette souffrance en valait la peine, le résultat est enrichissant.
Un dernier mot sur le titre de ce billet, que j'ai mis longtemps à trouver. Pour être tout à fait juste, il faudrait mettre "l'infini cassé" en italique, car c'est un titre de livre. Un livre qui tient une place particulière dans le roman, puisque nous sommes amenés à le lire, pas dans son intégralité, mais dans ses grandes lignes.
Plus que cette allusion au livre, qui nous ramène en fait au personnage, c'est la suite qui m'a plu et m'a poussé à choisir cette citation-là et pas une autre. Parce qu'on y retrouve l'amour, présent dans ce roman au milieu du bruit et de la fureur, de la haine et de la violence, et puis, à cause de la mention (là aussi, pour être exact, il faudrait un saut de ligne) de l'histoire du Chili, je n'y reviens pas.
Je crois qu'on pourrait disserter longtemps sur ce titre, "l'Infini cassé". Je le trouve très beau, très juste. A travers lui, mais aussi à travers "Condor" (bien bel oiseau dont le nom, décidément, ne cesse de servir à de bien vilaines choses...), il y a une transmission. De la génération qui a vécu la chute d'Allende et la dictature Pinochet, à celle qui doit prendre les destinées du pays en main, et dont Gabriela entend être partie prenante.
Inscription à :
Articles (Atom)