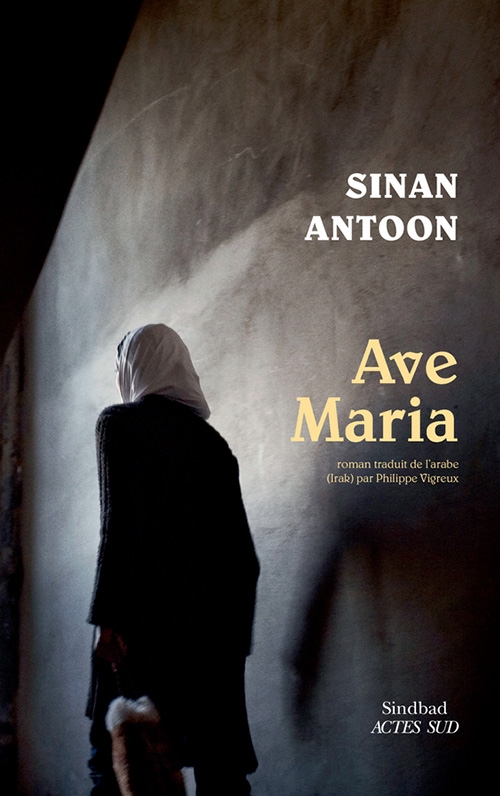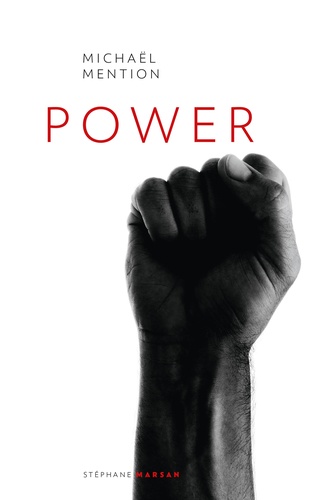Voici un roman qui parvient à parler de sujets extrêmement sérieux, douloureux, même, avec légèreté et humour, mais aussi sensualité. Ne vous fiez pas forcément au titre, qui ne rend pas tout à fait hommage au contenu, je trouve, et nous entraîne à Londres, à la rencontre de la communauté sikhe de cette capitale. "Le Club des veuves qui aimaient la littérature érotique", de Balli Kaur Jaswal (aux éditions Belfond ; traduction de Guillaume-Jean Milan), est écrit par une jeune romancière de nationalité singapourienne, aux racines pendjabies, qui jette un regard critique sur les traditions en vigueur au sein de cette communauté londonienne, et plus particulièrement sur le statut des femmes au sein d'une culture très patriarcale. En soi, les questions abordées sont graves et pourraient tout à fait servir de moteur à un drame, sombre et violent, mais Balli Kaur Jaswal a choisi de l'aborder très différemment, sous l'angle de la comédie de moeurs et de la comédie romantique, avec un soupçon de polar dans le final. Mais surtout, on découvre une formidable galerie de personnages, des femmes en quête d'émancipation, de liberté et de plaisir, dont la démarche, incertaine mais pleine de détermination, est une source d'émotions très variées, du rire aux larmes...
Niki, jeune londonienne d'une vingtaine d'années, est en plein doute. Elle vient tout juste d'abandonner ses études de droit et cherche une nouvelle voie qu'elle peine à trouver. Dire que ces fameuses études lui avaient valu de se fâcher avec son père, aujourd'hui décédé... Car dans sa famille, une femme qui fait des études n'est pas très bien vue.
Niki appartient à une famille originaire du Pendjab, région qui s'étend de l'est du Pakistan au nord-ouest de l'Inde. Une région où la majorité de la population pratique la religion sikhe. Si ses parents et sa soeur demeurent très traditionalistes, attachés à leur culture, à leur religion et à ce qui en découle, Niki, elle, se considère comme une Britannique et entend vivre à l'occidentale.
Elle a quitté le nid pour vivre dans son propre appartement, mène son existence comme elle l'entend, a dont entrepris des études et espère bien pouvoir à moyen terme gagner sa vie. Enfin, si elle trouve quelque chose qui convient mieux à ses goûts et ses attentes. Au contraire, sa soeur cherche à conclure un mariage qui assurera son avenir. Un mariage arrangé, sans aucune certitude qu'il puisse être heureux.
C'est justement en aidant sa soeur dans cette quête que la vie de Niki va basculer. La jeune femme s'est rendu à Southall, un quartier de la banlieue ouest de Londres surnommé Little India parce que la population y est largement originaire d'Inde et du Pakistan. Les Sikhs y sont aussi très nombreux et à Southall, se trouve le plus grand lieu de culte où pratiquer cette religion hors d'Asie.
Niki n'est pas pratiquante, mais elle a accepté d'aller placer une annonce pour sa soeur, sur le panneau réservé à celles et ceux qui recherchent une ou un conjoint. La méthode ne lui plaît guère, mais depuis la mort de son père, Niki essaye d'adoucir les angles avec sa mère et sa soeur, car elle se sent un peu responsable de ce décès prématuré.
C'est une tout autre annonce qui va retenir son attention : une association basée au temple recherche quelqu'un pour animer un atelier d'écriture destiné aux femmes de la communauté sikhe. En pleine réflexion sur son avenir, Niki se dit que l'expérience pourrait être intéressante, une expérience utile pour l'avenir, et elle décide de postuler.
Celle qui a publié cette annonce s'appelle Kulwinder. Elle aussi est quelqu'un d'assez traditionaliste dans son comportement. Une femme que l'on qualifiera de sévère, du moins de prime abord, en tout cas, sensiblement différente de ce qu'est Niki. Mais, on va aussi comprendre que Kulwinder peine à se remettre d'un deuil cruel, intervenu quelques mois plus tôt : celui de sa fille.
Kulwinder accueille Niki avec méfiance, avec hauteur, même, mais si la jeune femme ne correspond pas forcément à la vision de Kulwinder, cette dernière accepte de lui confier l'atelier, en la mettant en garde : elle devra bien rester à sa place. Niki accepte avec enthousiasme et commence à réfléchir à la manière d'organiser cet atelier.
Mais, dès la première séance, elle comprend qu'elle s'est fait berner par Kulwinder : les participantes à l'atelier sont, pour la plupart, analphabètes, incapables d'écrire que ce soit en anglais ou en gurmukhi et, au lieu d'un atelier d'écriture, comme mentionné dans l'annonce, elle se retrouve à animer un atelier d'alphabétisation, ce qui la motive beaucoup moins.
D'autant que les élèves ne sont guère disciplinées. Ces femmes, qui ont pour point communs d'être toutes veuves, n'ont qu'une envie : écrire des histoires. Et pas n'importe lesquelles : elles rêvent toutes (ou presque) d'écrire des histoires à caractère érotique ! Niki, fort surprise, va pourtant vite être convaincue par cette idée, et tant pis si cela va à l'encontre des volontés affichées par Kulwinder...
Je vous mentirais si je disais que ce n'est pas d'abord le titre de ce roman qui a attiré mon attention. Je me suis même demandé si l'éditeur français, Belfond, n'avait pas pondu ce titre pour faire écho à quelques récents succès littéraires, qu'on y épluche ou pas des patates. Pourtant, ce titre français, s'il ajoute la notion de club, reste très fidèle au titre original.
Ensuite, j'étais curieux de lire un roman écrit par une romancière singapourienne, ce n'est pas courant, avec une plongée dans une communauté sikhe qui nous reste finalement assez mystérieuse. Pour le reste, j'étais surtout curieux de voir ce qui résulterait du mélange d'ingrédients qui semblaient bien peu proches les un des autres...
Or, Balli Kaur Jaswal a réservé à ses lecteurs pas mal de surprises. D'abord, une jeune femme libre, qui a délibérément choisi de braver sa communauté et de s'en détacher pour vivre selon les principes du pays dans lequel elle habite. Ce n'est pas le seul point important : Niki ne vit pas dans un quartier à dominante indo-pakistanaise, et on verra que son arrivée à Southall ne s'avérera pas si simple.
Indépendante, mais un peu perdue, aussi. Entre ces études, qui ont symbolisé sa rébellion, mais qu'elle a abandonnées assez vite, faute de s'y épanouir, et la mort de son père pour laquelle elle culpabilise beaucoup, on découvre un personnage qui se cherche, clairement. Mais qui, par orgueil, refuse de rentrer dans le giron familial, de retourner auprès de sa mère et de sa soeur, trop ancrées dans leur culture d'origine.
Or, cette culture est très patriarcale. La place des femmes est à la maison, leur rôle premier est celui de mère et pour dire les choses très clairement, elles n'ont guère leur mot à dire à propos de quoi que ce soit. Même pour ce qui concerne leur vie personnelle, elles n'ont pas le choix, et c'est ce que Niki a refusé en prenant son envol.
A Southall, pourtant, elle retombe sur ce modèle : la communauté sikhe de la ville est importante, elle vit exactement comme en Inde, reproduisant les mêmes modes de fonctionnement sociaux et culturels. Lorsqu'elle rencontre ses "élèves", Niki ne réalise pas tout de suite qu'elle a finalement vécu dans une famille assez libérale, alors que ces femmes, elles, subissent depuis toujours le joug masculin.
Evidemment, l'élément le plus marquant, ce sont ces mariages arrangés, souvent conclus alors que ces femmes étaient encore très jeunes, très, très jeunes, même, pour certaines d'entre elles. Des mariages avec des hommes souvent bien plus âgés, avec lesquels elles n'avaient aucun atome crochu et des unions dans lesquelles elles se fondaient entièrement jusqu'à quasiment y disparaître...
Lorsque les veuves évoquent leur idée de concocter des histoires érotiques, Niki est surprise, et on peut le comprendre, tant ce décalage entre la demande et le conservatisme apparent de ces femmes paraît énorme. C'est saugrenu, a priori, mais une fois l'idée lancée et mise en oeuvre, la jeune femme se rend compte qu'elle a tout faux.
D'abord, elle ignore quasiment tout de cette communauté, dont elle est pourtant proche culturellement parlant. Anglophone, elle maîtrise le pendjabi à l'oral, mais elle peine à écrire en gurmukhi, alors que c'est dans la langue pendjabie que pensent les participantes à l'atelier. Ensuite, elle découvre les codes propres à cette communauté, où tout le monde connaît tout le monde.
Soudain, la voilà qui se sent comme une étrangère parmi ces veuves ! Et, petit à petit, au lieu de tenir les rênes, c'est elle qui va se laisser entraîner dans le sillage de ces femmes qui, en venant à cet atelier, ont ouvert une porte et s'y engouffrent avec détermination et jubilation. Ce que comprend bientôt Niki, ces que le veuvage a rendu ces femmes... libres.
Les participantes sont âgées, pour beaucoup, d'autres sont plus jeunes mais pourraient être la mère de Niki. Mais surtout, elles sont libérées de la tutelle écrasante de leur mari et, pour la première fois de leur vie, elle peuvent choisir de mener leur existence comme elle l'entendent. Et cela va passer par une étonnante libération de la parole.
Vous allez assister à la naissance de ces histoires, à la sensualité débordante, très explicites, racontées par ces femmes comme si elles les mûrissaient de longue date en leur for intérieur. Jusqu'à ce que, avec Niki, on se demande si ces récits ne sont que fantasmes... ou s'ils sont inspirés par des événements bien réels, que la pudeur empêche de présenter comme autre chose que de la fiction...
"La frontière entre imagination est réalité est floue", dit d'ailleurs un des personnages dans le roman. Et c'est vrai qu'au fil des histoires, plus elles se font chaudes, précises, explicites, on se demande comment ces femmes ont pu nourrir leur imaginaire quand leur propre vie se limitait à un train-train bien peu propice à la sensualité et à l'érotisme.
Balli Kaur Jaswal joue admirablement avec cet élément, en proposant à ses lecteurs les récits des élèves de Niki, en jouant sur l'ambiguïté qu'ils recèlent, en l'utilisant aussi pour des gags (je parlais de l'inspiration, pour l'une des apprentis écrivaines, cela donne lieu à une scène très drôle), mais aussi pour faire avancer ses personnages vers une liberté qui leur a été jusque-là refusée : celle de jouir.
"Merci pour le plaisir", dit un des personnages en remerciant Dieu de ces lectures qui ont réveillé ses sens et l'ont mise dans un état qu'elle n'avait peut-être jamais connu, ou alors il y a très longtemps. Cette dimension érotique est un vrai plaisir de lecture et on se sent soudain au coeur d'un livre qui s'inscrit dans la tradition des comédies sociales à la britannique.
De "Quatre mariages et un enterrement" à "Calendar girls" (je parle du film avec Helen Mirren et Julie Walters), en passant par "Joue-là comme Beckham", bien sûr, autre comédie ayant pour cadre la communauté indienne en Angleterre, on retrouve cet esprit caustique mâtiné de tendresse où l'on traite la différence avec humour et finesse, sans perdre de vue le côté critique.
Car, derrière l'érotisme et l'humour, la romancière aborde bel et bien des sujets graves, les mariages forcés, ou tout du moins arrangés, la soumission totale des femmes à leurs époux, la montée, également, d'une frange radicale parmi la jeunesse sikhe, qui se charge de faire appliquer, jusqu'à la brutalité, les principes du dogme...
Non, tout n'est pas rose dans "Le Club des veuves qui aimaient la littérature érotique" et la bouffée d'oxygène dont profitent ces femmes lors de cet espace de liberté sont aussi un risque qu'elles prennent. Niki, elle-même, pourrait se retrouvée menacée dès lors que la nature de ce qui se déroule lors de son atelier va s'ébruiter à Southall, et même au-delà...
Ce côté plus noir va d'ailleurs servir à l'auteur pour instiller dans son récit une trame de polar, qui va vraiment se développer dans le final du livre. Voilà pourquoi je ne vais rien en dire dans ce billet, si ce n'est que Balli Kaur Jaswal joue là encore avec des codes très connus, ceux du polar à l'anglaise, et qu'elle utilise cette dimension pour mettre en évidence un autre fait terrible, hélas encore d'actualité.
Enfin, mais je vais également rester succinct sur le sujet, la dernière trame est celle d'une comédie romantique, toujours dans une veine très britannique, qui renforce l'impression d'influences très diverses dans l'écriture de Balli Kaur Jaswal. Les traditions orientales (dans les récits érotiques, en particulier) et occidentales se mélangent parfaitement pour un résultat très original et intéressant.
Le dernier point fort de ce livre, c'est cette galerie de personnages magnifique, et évidemment les veuves au premier chefs. Ah, ces femmes sont extraordinaires, touchantes et drôles à la fois, coincées entre ces traditions qui les ont si longtemps entravées et cette possibilité de s'en affranchir enfin, coquines et pleines de ressources, mais aussi dans une quête de bonheur qui paraît presque impossible.
Vous allez les découvrir, il y a un noyau dur avec des caractères différents, des relations entre elles aussi qui influent sur les discours, des fantasmes et peut-être des expériences, qui sait, également très variées. Balli Kaur Jaswal va d'ailleurs loin, bousculant tous les tabous possibles à travers ces femmes qui deviennent de vrais exemples pour une Niki parfois dépassée.
Niki, elle, va évoluer à leur contact. Mais aussi changer de regard sur elle-même, sur sa famille, comprendre qu'elle s'est peut-être trompée sur pas mal de choses et ressortir de cette expérience avec un mouchoir posé sur son orgueil et une relation aux siens différente. Sans oublier de nouvelles perspectives personnelles, n'en disons pas plus.
Reste un dernier très beau personnage, celui de Kulwinder, qui va elle aussi être bousculée fortement par les événements provoquées par ces surprenantes veuves. Contre son gré, d'abord, car elle se veut garante de cette morale que viennent remettent en cause ces femmes, sous l'influence, pense-t-elle d'abord, de cette Niki, bien trop occidentalisée.
Mais cette femme rude, qu'on imagine un tant pouvoir devenir "la méchante" de l'histoire, va, comme Niki, évoluer grâce à cette expérience. L'orientation que va donner la romancière à ce personnage est assez inattendue, joue d'abord avec l'humour, mais ensuite surtout avec une immense tendresse pour cette femme incapable de sortir du deuil terrible qui l'a frappée.
J'ai fait quelques références à des films dans ce billet et ce n'est pas un hasard : je ne sais pas si les droits de ce roman ont déjà été achetés, mais si j'étais Gurinder Chadha, Richard Curtis ou Mike Newell, je me précipiterais pour les acquérir. Il y a là matière à faire un film qui mêle comédie et thèmes au combien sérieux, amour, érotisme et amitié... Quel beau cocktail, non ?
"Il va falloir un jour qu'enfin je me décide à lire les livres que, depuis trente ans, je conseille à mes amis de lire". (Sacha Guitry)
lundi 25 juin 2018
dimanche 24 juin 2018
"Est-ce que je fuis vraiment le présent pour me réfugier dans le passé comme elle m'en a fait le reproche ? Même si c'était vrai, quel mal y aurait-il à cela, quand le présent est piégé, bourré d'explosions, de crimes et d'atrocités ?"
Depuis près de 30 ans, l'Irak fait partie de notre actualité, et rarement pour des événements heureux, hélas. Plus récemment, nous découvrons la littérature irakienne, qui nous apparaît très riche et variée (nous aurons, je l'espère, l'occasion d'en reparler très vite). Normal, me direz-vous, cette région est considérée comme le berceau de l'écriture, qu'on y trouve une culture vivace et une littérature forte est assez logique. Mais, cette littérature contemporaine se nourrit des événements traversés dans la deuxième moitié du XXe siècle par le pays, nous offre à nous, Occidentaux, un autre regard pour appréhender cette situation et ces conflits permanents. Premier exemple sur ce blog, avec "Ave Maria", nouveau roman de Sinan Antoon, paru chez Actes Sud (traduction de Philippe Vigreux), qui s'intéresse à la situation des Chrétiens irakiens et, à travers eux, revient sur 70 ans d'histoire qui ont profondément bouleversé la société irakienne et l'ont livrée au chaos, au totalitarisme, à la violence, au fanatisme religieux... Un roman bouleversant, mais qui est aussi une merveilleuse déclaration d'amour à ce pays magifique ravagé par la folie humaine.
Youssef est un vieux Bagdadi qui observe sa ville chérie, son pays dont il est fier, s'effondrer un peu plus chaque jour, sombrer dans un chaos indescriptible. Depuis que Hinna, son épouse, s'est endormie et ne s'est pas réveillée, il attend que son tour arrive, il appellerait presque la mort de ses voeux. Or, pour un chrétien comme lui, la situation est justement devenue très délicate.
Les attentats visant la communauté chrétienne deviennent plus nombreux, visent les lieux de culte ou les endroits où ses membres ont l'habitude de se réunir, les quartiers où ils vivent. Suite à l'un de ces actes barbares, la nièce de Youssouf, Maha, et le mari de cette dernière se sont installés chez Youssef. Si chacun vit dans son coin, à son rythme, ce n'est tout de même plus pareil.
Il y a des frictions entre le vieil homme et la jeune femme, sans doute alimentées par cette peur qui semble ne pas affecter Youssef, résigné, dépité. Chrétien, il ne se reconnaît finalement pas sous cette appellation, lui se considère avant tout comme Irakien. Contrairement à Hinna, qui allait à l'église chaque jour, lui pratique peu, aux jours et grandes fêtes et rien de plus.
Youssef a surtout la nostalgie d'un pays qui n'existe plus, un pays où il n'y avait ni musulmans, ni juifs, ni chrétiens, mais simplement des Irakiens, où chiites et sunnites ne se déchiraient pas avec une immense violence, où on ne cherchait pas à chasser l'autre parce qu'il ne pratique pas la bonne religion, où le politique et le religieux restaient bien séparés...
Au fil de ces journées, Youssef plonge dans ses souvenirs, sa jeunesse, ses amitiés qui se fichaient bien de savoir quel dieu priaient les uns et les autres, sa famille, désormais dispersés aux quatre coins du monde, du moins pour ceux qui n'ont pas perdu la vie en cours de route... Un passé symbolisé par ces photographies rassemblées dans une pièce, comme une sorte de mémorial intime.
Maha considère d'ailleurs cela comme une lubie et lui reproche régulièrement de vivre dans le passé. Cet ancrage dans le passé qui ne résout rien aux problèmes présents. Elle a peur quand lui s'abîme dans ces souvenirs d'un pays de cocagne, si le mot peut convenir pour l'Irak. Une sorte de paradis terrestre, entre Tigre et Euphrate, une terre extrêmement riche et fertile aux portes du désert.
Je vais prolonger la phrase placée en titre de ce billet, car la suite est tout aussi importante pour comprendre l'état d'esprit de Youssef, et à travers cela, le contraste fort que met en évidence Sinan Antoon, la dégradation accélérée sur le dernier quart de siècle de la destruction d'un pays aux traditions et à la culture millénaire.
"Le passé, c'est un peu mon jardin, que j'aime et je soigne comme s'il était ma fille. Je m'y réfugie pour fuir le vacarme et la laideur du monde. Il est mon paradis en plein coeur de l'enfer, "ma région autonome à moi" comme je l'appelle parfois. Je le défendrai de toutes mes forces, car lui et la maison sont tout ce qui me reste".
Youssef poursuit en insistant sur cette différence de génération entre lui et Maha, qui est bien plus qu'une simple question d'âge. C'est une perception du monde, de la vie, des priorités, des appartenances qui a changé entre la jeunesse de Youssef et celle de Maha. Ils ne sont plus du tout sur la même longueur d'ondes, même s'ils voient bien le désastre qui les entoure.
Ils n'en tirent pas les mêmes conclusions. Youssef ne sera jamais autre chose qu'un Irakien, il n'a jamais envisagé de quitter (pire, désormais de fuir) sa terre natale, de rejoindre la diaspora irakienne qui n'a cessé de croître depuis le milieu du XXe siècle. De la même manière, il ne se sent pas concerné par la communautarisation du pays, alors que Maha se trouve au coeur de ce tourbillon.
Youssef est Irakien, un mot en passe de devenir obsolète face aux termes musulmans, chrétiens, chiites, sunnites, kurdes, etc. par lesquels on se définir désormais plus volontiers dans le pays. Des mots qui sont aussi comme des murs qu'on érige entre les uns et les autres, quand on ne dresse pas carrément les uns contre les autres...
Youssef est un homme du passé, et il le revendique. Peu importe que cela ne signifie plus rien pour Maha, pour ceux qui mettent le pays à feu et à sang, qu'ils soient originaires eux-mêmes de la région ou, au contraire, venu de cet Occident chevaleresque qui s'est précipité sans rien comprendre à la culture locale et y a mis le feu.
C'est un homme du passé, parce que le présent est insupportable et qu'il a eu la chance de connaître d'autres époques. Sans doute ces moments avaient-ils aussi des défauts, la perfection n'est pas de ce monde, mais au moins, il faisait bon vivre en Irak. On s'appréciait, on vivait ensemble, on ne cherchait pas sans cesse à tuer son prochain pour des broutilles et des idéologies.
Youssef parle de jardin, le mot est fort, on devine derrière l'idée d'un éden, d'un paradis terrestre, et le palmier, vous le verrez, tient d'ailleurs une place particulière dans cette histoire. En tant que symbole remontant à très loin et réunissant des traditions communes à tous, mais aussi comme ressource économique et quasiment comme un emblème.
En faisant quelques recherches sur Sinan Antoon, je suis tombé sur un entretien passionnant qu'il a donné à l'occasion de la sortie d' "Ave Maria" au quotidien "L'Humanité". Et le titre de l'article, tiré du roman, en dit long sur ce que pense Youssef, son exaspération et son désespoir devant l'évolution de la société irakienne : "même les palmiers sont devenus sunnites ou chiites"...
A travers la longue longue existence de Youssef, à travers ses souvenirs qui pâlissent, mais ne s'effacent pas, c'est l'histoire contemporaine de l'Irak qui se dessine. Depuis les années 1940 et la prise du pouvoir du pro-nazi Rachid Ali al-Gillani jusqu'aux deux guerres menées par l'Amérique, en 1990 puis en 2003, en passant par l'avènement du parti Baas, en 1958...
Autant d'étapes clés qui vont saper petit à petit, ou parfois bien plus violemment, les fondations d'une société pacifique et multiculturelle, jusqu'à la précipiter dans l'actuelle anarchie et une violence qui n'en finit pas de se déchaîner, comme si les puissances occidentales, en faisant tomber Saddam Hussein, avaient en fait ouvert la boîte de Pandore...
On comprend tôt où va nous mener le livre. Une courte note en exergue du roman donne une indication qu'il aurait peut-être mieux valu donner à la fin, je ne sais pas. On n'est certes pas dans un roman à suspense, mais j'aurais peut-être préféré ne pas connaître cette précision d'emblée. Car le récit lui-même fait vite comprendre que, si cela n'arrive pas au début, ce sera à la fin, cqfd.
Ce dont je parle, c'est un événement, un drame, mais peut-on en dissocier certains de la quantité phénoménale d'horreurs qui frappe l'Irak depuis tant et tant d'années ? Le choix de Sinan Antoon se comprend pourtant aisément, pour évoquer le travail de destruction minutieux qui est à l'oeuvre actuellement, facilité par l'ingérence américaine, il opte pour l'angle des actes anti-chrétiens.
Il met en scène des personnages issus de cette communauté, des gens dont les racines sont profondément accrochées au sol irakien, qui sont nés là et y ont toujours vécu, mais qu'on a décidé, comme autrefois, déjà, on avait décidé de chasser les juifs (au passage, Sinan Antoon dénonce tous les travers, vous découvrirez sans doute le rôle d'Israël dans l'exode des juifs irakiens ; peu reluisant), de pousser à l'exil...
Un mot sur l'auteur, Sinan Antoon. Né à Bagdad en 1967, il est né d'un père irakien et d'une mère américaine. C'est à Bagdad qu'il grandit et entame ses études, mais la première Guerre du Golfe survient alors et il choisit de s'installer aux Etats-Unis, sans jamais perdre de vue ce qui se passe dans son pays natal, ni cesser de critiquer la politique américaine dans la région.
J'ai pas mal cherché avant d'entamer la rédaction de ce billet si l'on parlait de l'appartenance religieuse, ou du moins culturelle de Sinan Antoon, mais je ne trouve rien. J'en déduis, peut-être abusivement, qu'il n'appartient pas à la communauté chrétienne qu'il évoque dans "Ave Maria". Et c'est sans doute aussi cela qui donne plus de force encore à ce roman.
Face au chaos irakien, face à cette communautarisation qui est en train de faire s'effondrer une société multiculturelle millénaire, comme ce fut le cas pour l'Andalousie à la fin du XVe siècle sous l'impulsion des Rois catholiques, Sinan Antoon se désole, en appelle à l'histoire, au passé, justement, à cette mémoire qu'on voudrait effacer ou qui périra avec ceux qui la portent encore.
Son point de vue n'apparaît guère optimiste, hélas, plutôt teinté d'une sourde colère qui vise tous les acteurs de cette déliquescence obscurantiste, comme on le comprend bien en lisant cette récente interview à "L'Humanité, déjà évoquée. Extrait :
"La destruction de l’Histoire me hante depuis toujours. Je ne parle pas seulement de la destruction matérielle, ni de celle des êtres humains, mais de la destruction de notre façon de penser. Les gens intériorisent le discours sectaire. On finit par souffrir d’amnésie collective. Ce conflit existe bel et bien là-bas. Il y a d’un côté ceux qui pensent qu’il y a une violence transhistorique reliée à l’islam et ceux qui, de l’autre côté, perçoivent les événements comme étant le résultat d’une politique."
Un autre élément vient parfaitement incarner cette vision. A la fois parce qu'il nous ramène encore au passé qui rassure et réjouit Youssef, mais aussi parce qu'il fait certainement partie de ces pans d'une culture qui l'évolution actuelle de l'Irak va mettre à mal. Il s'agit de musique, du genre le plus populaire en Irak, le Maqâm (je vous renvoie à la fiche wikipédia pour le détail théorique).
J'ai évoqué les photos, si importantes pour Youssef, mais le vieil homme possède aussi de nombreuse cassettes sur lesquels sont enregistrées des chansons, des maqâm. Sinan Antoon cite des paroles de ces chansons et l'on peut alors comprendre aisément pourquoi, là encore, Youssef est à contre-courant, car on se dit que les amateurs de maqam pourraient vite se retrouver dans le collimateur...
C'est donc avec l'une des grandes voix du maqâm que l'on va se quitter, Youssouf Omar, qu'on "entend" dans "Ave Maria". En l'écoutant, songez à Youssef, le personnage central de ce roman puissant, bouleversant. Youssef, vieillard bourru, mais au combien attachant, Irakien et fier de l'être, représentant d'une utopie en voie d'extinction, où les appartenances raciales, religieuses, idéologiques n'auraient qu'une influence mineure sur nos vies...
Et, pour aller encore un peu plus loin, autre interview de Sinan Antoon, à "L'Obs", cette fois, parue au moment de la sortie de son précédent ouvrage, "Seul le grenadier"...
Youssef est un vieux Bagdadi qui observe sa ville chérie, son pays dont il est fier, s'effondrer un peu plus chaque jour, sombrer dans un chaos indescriptible. Depuis que Hinna, son épouse, s'est endormie et ne s'est pas réveillée, il attend que son tour arrive, il appellerait presque la mort de ses voeux. Or, pour un chrétien comme lui, la situation est justement devenue très délicate.
Les attentats visant la communauté chrétienne deviennent plus nombreux, visent les lieux de culte ou les endroits où ses membres ont l'habitude de se réunir, les quartiers où ils vivent. Suite à l'un de ces actes barbares, la nièce de Youssouf, Maha, et le mari de cette dernière se sont installés chez Youssef. Si chacun vit dans son coin, à son rythme, ce n'est tout de même plus pareil.
Il y a des frictions entre le vieil homme et la jeune femme, sans doute alimentées par cette peur qui semble ne pas affecter Youssef, résigné, dépité. Chrétien, il ne se reconnaît finalement pas sous cette appellation, lui se considère avant tout comme Irakien. Contrairement à Hinna, qui allait à l'église chaque jour, lui pratique peu, aux jours et grandes fêtes et rien de plus.
Youssef a surtout la nostalgie d'un pays qui n'existe plus, un pays où il n'y avait ni musulmans, ni juifs, ni chrétiens, mais simplement des Irakiens, où chiites et sunnites ne se déchiraient pas avec une immense violence, où on ne cherchait pas à chasser l'autre parce qu'il ne pratique pas la bonne religion, où le politique et le religieux restaient bien séparés...
Au fil de ces journées, Youssef plonge dans ses souvenirs, sa jeunesse, ses amitiés qui se fichaient bien de savoir quel dieu priaient les uns et les autres, sa famille, désormais dispersés aux quatre coins du monde, du moins pour ceux qui n'ont pas perdu la vie en cours de route... Un passé symbolisé par ces photographies rassemblées dans une pièce, comme une sorte de mémorial intime.
Maha considère d'ailleurs cela comme une lubie et lui reproche régulièrement de vivre dans le passé. Cet ancrage dans le passé qui ne résout rien aux problèmes présents. Elle a peur quand lui s'abîme dans ces souvenirs d'un pays de cocagne, si le mot peut convenir pour l'Irak. Une sorte de paradis terrestre, entre Tigre et Euphrate, une terre extrêmement riche et fertile aux portes du désert.
Je vais prolonger la phrase placée en titre de ce billet, car la suite est tout aussi importante pour comprendre l'état d'esprit de Youssef, et à travers cela, le contraste fort que met en évidence Sinan Antoon, la dégradation accélérée sur le dernier quart de siècle de la destruction d'un pays aux traditions et à la culture millénaire.
"Le passé, c'est un peu mon jardin, que j'aime et je soigne comme s'il était ma fille. Je m'y réfugie pour fuir le vacarme et la laideur du monde. Il est mon paradis en plein coeur de l'enfer, "ma région autonome à moi" comme je l'appelle parfois. Je le défendrai de toutes mes forces, car lui et la maison sont tout ce qui me reste".
Youssef poursuit en insistant sur cette différence de génération entre lui et Maha, qui est bien plus qu'une simple question d'âge. C'est une perception du monde, de la vie, des priorités, des appartenances qui a changé entre la jeunesse de Youssef et celle de Maha. Ils ne sont plus du tout sur la même longueur d'ondes, même s'ils voient bien le désastre qui les entoure.
Ils n'en tirent pas les mêmes conclusions. Youssef ne sera jamais autre chose qu'un Irakien, il n'a jamais envisagé de quitter (pire, désormais de fuir) sa terre natale, de rejoindre la diaspora irakienne qui n'a cessé de croître depuis le milieu du XXe siècle. De la même manière, il ne se sent pas concerné par la communautarisation du pays, alors que Maha se trouve au coeur de ce tourbillon.
Youssef est Irakien, un mot en passe de devenir obsolète face aux termes musulmans, chrétiens, chiites, sunnites, kurdes, etc. par lesquels on se définir désormais plus volontiers dans le pays. Des mots qui sont aussi comme des murs qu'on érige entre les uns et les autres, quand on ne dresse pas carrément les uns contre les autres...
Youssef est un homme du passé, et il le revendique. Peu importe que cela ne signifie plus rien pour Maha, pour ceux qui mettent le pays à feu et à sang, qu'ils soient originaires eux-mêmes de la région ou, au contraire, venu de cet Occident chevaleresque qui s'est précipité sans rien comprendre à la culture locale et y a mis le feu.
C'est un homme du passé, parce que le présent est insupportable et qu'il a eu la chance de connaître d'autres époques. Sans doute ces moments avaient-ils aussi des défauts, la perfection n'est pas de ce monde, mais au moins, il faisait bon vivre en Irak. On s'appréciait, on vivait ensemble, on ne cherchait pas sans cesse à tuer son prochain pour des broutilles et des idéologies.
Youssef parle de jardin, le mot est fort, on devine derrière l'idée d'un éden, d'un paradis terrestre, et le palmier, vous le verrez, tient d'ailleurs une place particulière dans cette histoire. En tant que symbole remontant à très loin et réunissant des traditions communes à tous, mais aussi comme ressource économique et quasiment comme un emblème.
En faisant quelques recherches sur Sinan Antoon, je suis tombé sur un entretien passionnant qu'il a donné à l'occasion de la sortie d' "Ave Maria" au quotidien "L'Humanité". Et le titre de l'article, tiré du roman, en dit long sur ce que pense Youssef, son exaspération et son désespoir devant l'évolution de la société irakienne : "même les palmiers sont devenus sunnites ou chiites"...
A travers la longue longue existence de Youssef, à travers ses souvenirs qui pâlissent, mais ne s'effacent pas, c'est l'histoire contemporaine de l'Irak qui se dessine. Depuis les années 1940 et la prise du pouvoir du pro-nazi Rachid Ali al-Gillani jusqu'aux deux guerres menées par l'Amérique, en 1990 puis en 2003, en passant par l'avènement du parti Baas, en 1958...
Autant d'étapes clés qui vont saper petit à petit, ou parfois bien plus violemment, les fondations d'une société pacifique et multiculturelle, jusqu'à la précipiter dans l'actuelle anarchie et une violence qui n'en finit pas de se déchaîner, comme si les puissances occidentales, en faisant tomber Saddam Hussein, avaient en fait ouvert la boîte de Pandore...
On comprend tôt où va nous mener le livre. Une courte note en exergue du roman donne une indication qu'il aurait peut-être mieux valu donner à la fin, je ne sais pas. On n'est certes pas dans un roman à suspense, mais j'aurais peut-être préféré ne pas connaître cette précision d'emblée. Car le récit lui-même fait vite comprendre que, si cela n'arrive pas au début, ce sera à la fin, cqfd.
Ce dont je parle, c'est un événement, un drame, mais peut-on en dissocier certains de la quantité phénoménale d'horreurs qui frappe l'Irak depuis tant et tant d'années ? Le choix de Sinan Antoon se comprend pourtant aisément, pour évoquer le travail de destruction minutieux qui est à l'oeuvre actuellement, facilité par l'ingérence américaine, il opte pour l'angle des actes anti-chrétiens.
Il met en scène des personnages issus de cette communauté, des gens dont les racines sont profondément accrochées au sol irakien, qui sont nés là et y ont toujours vécu, mais qu'on a décidé, comme autrefois, déjà, on avait décidé de chasser les juifs (au passage, Sinan Antoon dénonce tous les travers, vous découvrirez sans doute le rôle d'Israël dans l'exode des juifs irakiens ; peu reluisant), de pousser à l'exil...
Un mot sur l'auteur, Sinan Antoon. Né à Bagdad en 1967, il est né d'un père irakien et d'une mère américaine. C'est à Bagdad qu'il grandit et entame ses études, mais la première Guerre du Golfe survient alors et il choisit de s'installer aux Etats-Unis, sans jamais perdre de vue ce qui se passe dans son pays natal, ni cesser de critiquer la politique américaine dans la région.
J'ai pas mal cherché avant d'entamer la rédaction de ce billet si l'on parlait de l'appartenance religieuse, ou du moins culturelle de Sinan Antoon, mais je ne trouve rien. J'en déduis, peut-être abusivement, qu'il n'appartient pas à la communauté chrétienne qu'il évoque dans "Ave Maria". Et c'est sans doute aussi cela qui donne plus de force encore à ce roman.
Face au chaos irakien, face à cette communautarisation qui est en train de faire s'effondrer une société multiculturelle millénaire, comme ce fut le cas pour l'Andalousie à la fin du XVe siècle sous l'impulsion des Rois catholiques, Sinan Antoon se désole, en appelle à l'histoire, au passé, justement, à cette mémoire qu'on voudrait effacer ou qui périra avec ceux qui la portent encore.
Son point de vue n'apparaît guère optimiste, hélas, plutôt teinté d'une sourde colère qui vise tous les acteurs de cette déliquescence obscurantiste, comme on le comprend bien en lisant cette récente interview à "L'Humanité, déjà évoquée. Extrait :
"La destruction de l’Histoire me hante depuis toujours. Je ne parle pas seulement de la destruction matérielle, ni de celle des êtres humains, mais de la destruction de notre façon de penser. Les gens intériorisent le discours sectaire. On finit par souffrir d’amnésie collective. Ce conflit existe bel et bien là-bas. Il y a d’un côté ceux qui pensent qu’il y a une violence transhistorique reliée à l’islam et ceux qui, de l’autre côté, perçoivent les événements comme étant le résultat d’une politique."
Un autre élément vient parfaitement incarner cette vision. A la fois parce qu'il nous ramène encore au passé qui rassure et réjouit Youssef, mais aussi parce qu'il fait certainement partie de ces pans d'une culture qui l'évolution actuelle de l'Irak va mettre à mal. Il s'agit de musique, du genre le plus populaire en Irak, le Maqâm (je vous renvoie à la fiche wikipédia pour le détail théorique).
J'ai évoqué les photos, si importantes pour Youssef, mais le vieil homme possède aussi de nombreuse cassettes sur lesquels sont enregistrées des chansons, des maqâm. Sinan Antoon cite des paroles de ces chansons et l'on peut alors comprendre aisément pourquoi, là encore, Youssef est à contre-courant, car on se dit que les amateurs de maqam pourraient vite se retrouver dans le collimateur...
C'est donc avec l'une des grandes voix du maqâm que l'on va se quitter, Youssouf Omar, qu'on "entend" dans "Ave Maria". En l'écoutant, songez à Youssef, le personnage central de ce roman puissant, bouleversant. Youssef, vieillard bourru, mais au combien attachant, Irakien et fier de l'être, représentant d'une utopie en voie d'extinction, où les appartenances raciales, religieuses, idéologiques n'auraient qu'une influence mineure sur nos vies...
Et, pour aller encore un peu plus loin, autre interview de Sinan Antoon, à "L'Obs", cette fois, parue au moment de la sortie de son précédent ouvrage, "Seul le grenadier"...
vendredi 22 juin 2018
"Vous ne comprenez pas, c'est pour cela que vous ne devriez pas faire confiance au premier venu (...) Vous comprenez, nous avons le devoir de protéger le roi, qui appartient au patrimoine national".
Petit jeu avec le verbe comprendre dans le choix de ce titre, et pour cause : c'est bien le principal problème que rencontre l'auteur (et narrateur) de notre livre du jour, découvrant un pays très différent du sien et son fonctionnement, pas toujours simple à cerner. "Le Blanc du roi", de Clemente Bicocchi (aux éditions Liana Levi ; traduction de Samuel Sfez), n'est pas un roman, mais un récit de voyage au Congo Brazzaville qui va prendre des proportions tout à fait inattendues. Construit comme un documentaire, écrit par un homme qui finit par perdre totalement les rênes de son voyage, histoire quasiment kafkaïenne, où les intérêts des uns et des autres restent inaccessibles à l'étranger, ce livre nous entraîne à la découverte d'une région, le domaine royal de Mbé sur lequel règne un monarque appelé Makoko, et du peuple qui y vit selon des coutumes ancestrales, les Tékés. Et, derrière les mésaventures du narrateur, une drôle d'amitié qui se noue et un hommage à une figure importante : Pierre Savorgnan de Brazza...
Clemente Bicocchi est Italien, mais vit en Suisse, pays dans lequel il a suivi sa compagne. Il reprend pour sa part son travail de réalisateur, mais il reconnaît lui-même que les projets ne se bousculent pas et que ses tentatives se soldent presque systématiquement par des échecs... Pas vraiment de quoi se réjouir, plutôt de quoi ressentir un certain vague à l'âme.
Aussi, quand il reçoit une proposition de reportage au Congo Brazzaville, il n'hésite pas longtemps et accepte de partir rapidement dans ce pays, sur le continent africain dont il n'a jamais foulé le sol. La demande émane d'une certaine Idanna, descendante de l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza, qui voudrait recueillir des informations sur le mausolée dédié à son aïeul et érigé récemment à Brazzaville.
Aux abois, le réalisateur ne cherche pas trop à comprendre l'objectif exact de cette demande. Il embarque avec sa caméra dernier cri, qu'il n'a pas encore fini de payer, et s'envole pour Brazzaville, où il doit loger à l'ambassade d'Italie. Premiers contacts un peu froids avec l'ambassadeur et son épouse, mais peu importe, d'ici deux ou trois jours, Clemente sera reparti avec ses images...
Car il n'y a rien de très compliqué dans la commande : simplement filmer le bâtiment, sans chercher à faire de belles images, juste montrer le mausolée. Le temps d'avoir une autorisation du garde de faction, d'installer le matériel, quelques réglages, et hop, emballé, c'est pesé ! Une affaire rondement menée, il ne reste plus qu'à reprendre l'avion.
Et puis, Clemente reçoit un mail d'Idanna, qui lui demande de profiter de sa présence au Congo Brazzaville pour lui rendre un autre service : récupérer un DVD auprès d'un certain Romaric, qui devait lui envoyer des images du roi Makoko actuel, sauf qu'il ne l'a jamais fait... Là encore, rien de bien compliqué a priori, le réalisateur décide de contacter Romaric au plus vite.
Et c'est là que tout va se compliquer sérieusement... Romaric est un drôle de personnage, insaisissable et déroutant, qui va entraîner Clemente dans une étonnante aventure et le pousser à rester au Congo bien plus longtemps que prévu. Car les images attendues par Idanna n'ont jamais été prises, il faut donc partir à la rencontre de ce mystérieux roi Makoko...
Clemente entame un périple jusqu'à Mbé, à environ 150km de Brazzaville, capitale du peuple Téké, là où vit le roi Makoko, sans trop bien savoir où il va. Il n'est pas au bout de ses peines, car manifestement, ce monarque vivant dans un coin perdu d'Afrique représente un enjeu si fort qu'on va se méfier de lui et même lui mettre un paquet de bâtons dans les roues...
Je n'en dis pas plus, vous pourrez découvrir cette histoire qui mêle la découverte un peu candide de l'Afrique par un Européen et des questions de politique intérieure, dont seuls les principaux intéressés possèdent les clés (et encore, on peut se le demander). Un voyage au cours duquel Clemente ne va plus du tout savoir à qui se fier, jusqu'à se croire perdu, abandonné, ruiné...
Avant d'aller plus loin, un mot sur le point de départ de cette histoire : en 1880, le roi Makoko Ier, souverain du peuple Batéké, céda son territoire à la France, après sa rencontre avec le représentant de ce pays lointain, sans doute le premier homme blanc à arriver jusqu'à lui, Pierre Savorgnan de Brazza, explorateur idéaliste et humaniste.
En 2003, le successeur de Makoko Ier prend contact avec les descendants de la famille Savorgnan de Brazza et leur propose de faire construise un monument en hommage à l'explorateur dans la forêt, tout près du lieu où repose l'ancien souverain téké, afin de réunir les deux amis. Une idée loin d'être facile à réaliser, car Savorgnan de Brazza, mort à Dakar en 1905, repose dans un cimetière d'Alger...
A Brazzaville, le chef de l'Etat Sassou Nguesso a vent de la proposition et décide de s'en emparer, histoire de profiter de la popularité de l'explorateur, toujours importante dans la région, à des fins très personnelles. Il fait donc construire un mausolée imposant dans la capitale et organise le transfert des cendres de Savorgnan de Brazza, de son épouse et de leurs quatre enfants depuis Alger.
Une cérémonie en grande pompe, qui a débuté en 2005 avec la pose de la première pierre (en présence de plusieurs chefs d'Etat, dont Jacques Chirac) et s'achève avec ce transfert, en 2006, vers ce bâtiment que vous allez découvrir ci-dessous, devant lequel est érigée une statue monumentale de Pierre Savorgnan de Brazza...
Sassou Nguesso a obtenu l'accord des descendants de Savorgnan de Brazza, sous certaines conditions (voir cet article du Monde), et c'est cet accord que Idanna, désignée représentante de la famille de l'explorateur, dénonce en 2008, lorsqu'elle prend contact avec Clemente Bicocchi. Débute alors un combat judiciaire qui durera des années et aboutira à un ordre de restitutions des restes à la famille...
Pardon pour cette parenthèse un peu longue, mais on est au coeur du sujet. Car les demandes de la famille de l'explorateur concernait le peuple téké : d'abord, la volonté de voir le mausolée installé à Mbé et pas à Brazzaville. Et puis, tout un tas de mesures plus matérielles, certes, mais visant à désenclaver la région où vivent les Tékés et à leur venir en aide.
Ce sont ces dernières mesures que le pouvoir congolais n'a pas respectées, provoquant la colère des descendants de Savorgnan de Brazza. La venue de Clemente Bicocchi dans la capitale congolaise marque le début de cette remise en cause de l'accord passé et, ainsi remis dans le contexte (que Bicocchi cernait mal à son départ), on comprend mieux pourquoi rien n'a été fait pour faciliter son voyage.
Dans "Le Blanc du roi", paru en 2017 (et cette année en France), Clemente Bicocchi choisit de raconter l'histoire telle qu'elle a eu lieu en 2008. Mais, l'affaire s'est prolongée bien après son séjour, et une annexe vient donner quelques informations supplémentaires, mais un peu trop succinctes et incomplètes (on n'y parle pas, par exemple, du classement du domaine royal de Mbé au patrimoine mondial de l'UNESCO, décision à double tranchant).
Dans le livre, Clemente Bicocchi expose une partie de la documentation sur laquelle il a planché pour préparer son voyage, mais il cite aussi assez régulièrement des passages de la main de Pierre Savorgnan de Brazza, issus de sa correspondance ou de son journal, qui évoquent évidemment cette rencontre et cette amitié nouée avec Makoko Ier...
En revanche, dans "Le Blanc du roi", l'auteur apporte d'autres éléments polémiques autour de ce fameux mausolée : le prix du chantier, exorbitant (on parle de plus de 5 millions d'euros) et financé par... les compagnies pétrolières possédant de forts intérêts dans le pays... Une situation qui a provoqué la colère des opposants au régime, jusqu'à demander qu'on débaptise la capitale !
Non seulement on dépense des sommes folles qu'on pourrait utiliser à meilleur escient, mais en plus, ceux qui versent cet argent sont ceux-là même que Savorgnan de Brazza dénonça très tôt, ceux qui vinrent conquérir l'Afrique pour l'exploiter, se l'approprier aux dépens des populations locales... Vous parlez d'un hommage...
Voilà pour le volet sans doute le plus tragique de ce livre. Car ensuite, les tribulations de Clemente Bicocchi au pays téké sont racontées avec un certain humour (comme la présence spectrale de Werner Herzog aux côtés du narrateur), un côté presque picaresque, entre totale incompréhension, résignation et volonté de se sortir de là au mieux. Je ne suis pas certain que, sur le moment, il ait pris les choses avec tant de philosophie et de recul...
Car, il ne s'agit pas seulement d'un voyage effectué dans des conditions improbables, entre véhicule bringuebalant et pistes peu carrossables, décalage culturel et mode de vie très différent. Il y a bien sûr tout cela (à l'image de l'étonnante scène racontée dans le prologue), mais ce n'est pas forcément là que le bât va blesser. Ce que Bicocchi a sous-estimé, c'est les luttes de pouvoir qui entourent, malgré eux, le peuple téké et la figure de Savorgnant de Brazza.
Clemente Bicocchi se retrouve comme un chien dans un jeu de quilles, quasiment considéré comme un espion, voire un ennemi, menacé d'emprisonnement sans autre forme de procès, de confiscation de ses biens (dont sa fameuse caméra, si importante à ses yeux), privé de tout contact extérieur et incapable de savoir à qui s'adresser.
Au coeur de l'imbroglio, il y a le personnage de Romaric, fantasque et confiant, dont on ne sait finalement que très peu de choses. Et si ces motivations n'étaient pas celles évoquées par Idanna puis lors de leur rencontre ? Et si Clemente Bicocchi avait été instrumentalisé malgré lui pour défendre une cause dont il ignore tout ?
Manifestement, le fait qu'un Européen veuille faire un reportage sur le Makoko pose problème. Mais à qui, exactement ? Aux Tékés, au pouvoir en place ou à l'opposition à ce dernier ? Qui tire véritablement les rênes de tout cela, dans un pays où règne une dictature, où la liberté d'expression est très contrôlée et les disgrâces peuvent se produire du jour au lendemain ?
Voilà pourquoi j'ai choisi cette citation comme titre de ce billet, parce que le mot important y est cité deux fois : comprendre. Une fois à la forme positive, une fois à la forme négative. Exactement l'état d'esprit de Clemente Bicocchi, qui n'a pas toutes les cartes en main pour se lancer dans une telle expédition et qui ne comprend pas grand-chose à ce qui lui arrive...
Livré à lui-même au coeur de l'Afrique, perdu entre des interlocuteurs dont il ne sait pas s'ils sont des amis, des ennemis ou l'inverse, en fonction des moments, Clemente Bicocchi va passer au Congo Brazzaville la semaine sans doute la plus longue de son existence, la plus folle aussi. Son récit donne une impression de rythme effréné, mais aussi le sentiment d'une certaine absurdité.
Oui, j'ai utilisé l'adjectif kafkaïen en introduction, il y a vraiment de cela, par moments, quand on se demande, et le narrateur avec nous, ce qu'il va advenir de cet homme, à qui l'Afrique semble faire subir un véritable examen de passage, un bizutage, même. Clemente Bicocchi y met aussi son grain de sel en prenant quelques décisions étonnantes, et on en oublie parfois la dimension qui pourrait virer au tragique.
Au-delà de l'aspect rocambolesque de cette histoire, qui se terminera bien, heureusement, et inspirera à Clemente Bicocchi, outre ce livre, un documentaire, "Afrique noire, marbre blanc", c'est aussi un livre qui rappelle l'aura que conserve encore Pierre Savorgnan de Brazza en Afrique. Au risque qu'il devienne un instrument de propagande par ceux mêmes qu'il essaya de dénoncer.
J'en profite pour signaler deux ouvrages récents où l'on retrouve ce personnage. Le premier est un roman, dont nous avons parlé sur ce blog, "Il est à toi, ce beau pays", de Jennifer Richard, où Savorgnan de Brazza apparaît certes au second plan, mais comme le négatif du Britannique Stanley, dans le sillage duquel la colonisation la plus brutale s'est développée.
Le second ouvrage est une bande dessinée qui vient de paraître aux éditions Futuropolis, "le Rapport Brazza", de Tristan Thil (scénariste) et Vincent Bailly (dessinateur). Un album qui revient sur le travail effectué à la fin de sa vie par Savorgnan de Brazza à la tête d'une mission d'enquête commandité par le parlement, dans lequel il voulait dénoncer les débordements français en Afrique...
Il y a sans doute encore bien des livres autour de ce personnage, adulé ou critiqué, dont la mort brutale a donné lieu à de nombreuses rumeurs quant à un possible assassinat. Un homme qui, tout humaniste qu'il fut, reste une figure de la colonisation, et se retrouve donc au centre de vives controverses ces dernières années...
"Le Blanc du roi", c'est en tout cas l'occasion pour beaucoup, je pense, de découvrir l'histoire du peuple téké et sa situation difficile face au pouvoir en place au Congo Brazzaville, de mesurer à quel point ce sujet est fort et sensible dans le pays (comme on le voit à plusieurs reprises avec des réactions rapportées par l'auteur).
Ce n'est pas pour autant un documentaire sur ce thème, mais bien sur l'aventure vécue par Clemente Bicocchi au cours de cette semaine congolaise, folle, délirante (le mot n'est pas de moi), pleine de points d'interrogation et de zones d'ombre, mais également fort enrichissante sur un plan personnel, et sans doute professionnel. Et certainement, une manière de se sensibiliser à la complexité de la situation congolaise.
Clemente Bicocchi est Italien, mais vit en Suisse, pays dans lequel il a suivi sa compagne. Il reprend pour sa part son travail de réalisateur, mais il reconnaît lui-même que les projets ne se bousculent pas et que ses tentatives se soldent presque systématiquement par des échecs... Pas vraiment de quoi se réjouir, plutôt de quoi ressentir un certain vague à l'âme.
Aussi, quand il reçoit une proposition de reportage au Congo Brazzaville, il n'hésite pas longtemps et accepte de partir rapidement dans ce pays, sur le continent africain dont il n'a jamais foulé le sol. La demande émane d'une certaine Idanna, descendante de l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza, qui voudrait recueillir des informations sur le mausolée dédié à son aïeul et érigé récemment à Brazzaville.
Aux abois, le réalisateur ne cherche pas trop à comprendre l'objectif exact de cette demande. Il embarque avec sa caméra dernier cri, qu'il n'a pas encore fini de payer, et s'envole pour Brazzaville, où il doit loger à l'ambassade d'Italie. Premiers contacts un peu froids avec l'ambassadeur et son épouse, mais peu importe, d'ici deux ou trois jours, Clemente sera reparti avec ses images...
Car il n'y a rien de très compliqué dans la commande : simplement filmer le bâtiment, sans chercher à faire de belles images, juste montrer le mausolée. Le temps d'avoir une autorisation du garde de faction, d'installer le matériel, quelques réglages, et hop, emballé, c'est pesé ! Une affaire rondement menée, il ne reste plus qu'à reprendre l'avion.
Et puis, Clemente reçoit un mail d'Idanna, qui lui demande de profiter de sa présence au Congo Brazzaville pour lui rendre un autre service : récupérer un DVD auprès d'un certain Romaric, qui devait lui envoyer des images du roi Makoko actuel, sauf qu'il ne l'a jamais fait... Là encore, rien de bien compliqué a priori, le réalisateur décide de contacter Romaric au plus vite.
Et c'est là que tout va se compliquer sérieusement... Romaric est un drôle de personnage, insaisissable et déroutant, qui va entraîner Clemente dans une étonnante aventure et le pousser à rester au Congo bien plus longtemps que prévu. Car les images attendues par Idanna n'ont jamais été prises, il faut donc partir à la rencontre de ce mystérieux roi Makoko...
Clemente entame un périple jusqu'à Mbé, à environ 150km de Brazzaville, capitale du peuple Téké, là où vit le roi Makoko, sans trop bien savoir où il va. Il n'est pas au bout de ses peines, car manifestement, ce monarque vivant dans un coin perdu d'Afrique représente un enjeu si fort qu'on va se méfier de lui et même lui mettre un paquet de bâtons dans les roues...
Je n'en dis pas plus, vous pourrez découvrir cette histoire qui mêle la découverte un peu candide de l'Afrique par un Européen et des questions de politique intérieure, dont seuls les principaux intéressés possèdent les clés (et encore, on peut se le demander). Un voyage au cours duquel Clemente ne va plus du tout savoir à qui se fier, jusqu'à se croire perdu, abandonné, ruiné...
Avant d'aller plus loin, un mot sur le point de départ de cette histoire : en 1880, le roi Makoko Ier, souverain du peuple Batéké, céda son territoire à la France, après sa rencontre avec le représentant de ce pays lointain, sans doute le premier homme blanc à arriver jusqu'à lui, Pierre Savorgnan de Brazza, explorateur idéaliste et humaniste.
En 2003, le successeur de Makoko Ier prend contact avec les descendants de la famille Savorgnan de Brazza et leur propose de faire construise un monument en hommage à l'explorateur dans la forêt, tout près du lieu où repose l'ancien souverain téké, afin de réunir les deux amis. Une idée loin d'être facile à réaliser, car Savorgnan de Brazza, mort à Dakar en 1905, repose dans un cimetière d'Alger...
A Brazzaville, le chef de l'Etat Sassou Nguesso a vent de la proposition et décide de s'en emparer, histoire de profiter de la popularité de l'explorateur, toujours importante dans la région, à des fins très personnelles. Il fait donc construire un mausolée imposant dans la capitale et organise le transfert des cendres de Savorgnan de Brazza, de son épouse et de leurs quatre enfants depuis Alger.
Une cérémonie en grande pompe, qui a débuté en 2005 avec la pose de la première pierre (en présence de plusieurs chefs d'Etat, dont Jacques Chirac) et s'achève avec ce transfert, en 2006, vers ce bâtiment que vous allez découvrir ci-dessous, devant lequel est érigée une statue monumentale de Pierre Savorgnan de Brazza...
#VuDans "Le Blanc du Roi", de Clemente Bicocchi...— Joyeux Drille (@JoyeuxDrilleCdj) 6 mai 2018
Le mausolée dédié à Pierre Savorgnan de Brazza, construit en 2005 à Brazzaville pour y accueillir les cendres de l'explorateur... pic.twitter.com/vi3N34VskE
Sassou Nguesso a obtenu l'accord des descendants de Savorgnan de Brazza, sous certaines conditions (voir cet article du Monde), et c'est cet accord que Idanna, désignée représentante de la famille de l'explorateur, dénonce en 2008, lorsqu'elle prend contact avec Clemente Bicocchi. Débute alors un combat judiciaire qui durera des années et aboutira à un ordre de restitutions des restes à la famille...
Pardon pour cette parenthèse un peu longue, mais on est au coeur du sujet. Car les demandes de la famille de l'explorateur concernait le peuple téké : d'abord, la volonté de voir le mausolée installé à Mbé et pas à Brazzaville. Et puis, tout un tas de mesures plus matérielles, certes, mais visant à désenclaver la région où vivent les Tékés et à leur venir en aide.
Ce sont ces dernières mesures que le pouvoir congolais n'a pas respectées, provoquant la colère des descendants de Savorgnan de Brazza. La venue de Clemente Bicocchi dans la capitale congolaise marque le début de cette remise en cause de l'accord passé et, ainsi remis dans le contexte (que Bicocchi cernait mal à son départ), on comprend mieux pourquoi rien n'a été fait pour faciliter son voyage.
Dans "Le Blanc du roi", paru en 2017 (et cette année en France), Clemente Bicocchi choisit de raconter l'histoire telle qu'elle a eu lieu en 2008. Mais, l'affaire s'est prolongée bien après son séjour, et une annexe vient donner quelques informations supplémentaires, mais un peu trop succinctes et incomplètes (on n'y parle pas, par exemple, du classement du domaine royal de Mbé au patrimoine mondial de l'UNESCO, décision à double tranchant).
Dans le livre, Clemente Bicocchi expose une partie de la documentation sur laquelle il a planché pour préparer son voyage, mais il cite aussi assez régulièrement des passages de la main de Pierre Savorgnan de Brazza, issus de sa correspondance ou de son journal, qui évoquent évidemment cette rencontre et cette amitié nouée avec Makoko Ier...
En revanche, dans "Le Blanc du roi", l'auteur apporte d'autres éléments polémiques autour de ce fameux mausolée : le prix du chantier, exorbitant (on parle de plus de 5 millions d'euros) et financé par... les compagnies pétrolières possédant de forts intérêts dans le pays... Une situation qui a provoqué la colère des opposants au régime, jusqu'à demander qu'on débaptise la capitale !
Non seulement on dépense des sommes folles qu'on pourrait utiliser à meilleur escient, mais en plus, ceux qui versent cet argent sont ceux-là même que Savorgnan de Brazza dénonça très tôt, ceux qui vinrent conquérir l'Afrique pour l'exploiter, se l'approprier aux dépens des populations locales... Vous parlez d'un hommage...
Voilà pour le volet sans doute le plus tragique de ce livre. Car ensuite, les tribulations de Clemente Bicocchi au pays téké sont racontées avec un certain humour (comme la présence spectrale de Werner Herzog aux côtés du narrateur), un côté presque picaresque, entre totale incompréhension, résignation et volonté de se sortir de là au mieux. Je ne suis pas certain que, sur le moment, il ait pris les choses avec tant de philosophie et de recul...
Car, il ne s'agit pas seulement d'un voyage effectué dans des conditions improbables, entre véhicule bringuebalant et pistes peu carrossables, décalage culturel et mode de vie très différent. Il y a bien sûr tout cela (à l'image de l'étonnante scène racontée dans le prologue), mais ce n'est pas forcément là que le bât va blesser. Ce que Bicocchi a sous-estimé, c'est les luttes de pouvoir qui entourent, malgré eux, le peuple téké et la figure de Savorgnant de Brazza.
Clemente Bicocchi se retrouve comme un chien dans un jeu de quilles, quasiment considéré comme un espion, voire un ennemi, menacé d'emprisonnement sans autre forme de procès, de confiscation de ses biens (dont sa fameuse caméra, si importante à ses yeux), privé de tout contact extérieur et incapable de savoir à qui s'adresser.
Au coeur de l'imbroglio, il y a le personnage de Romaric, fantasque et confiant, dont on ne sait finalement que très peu de choses. Et si ces motivations n'étaient pas celles évoquées par Idanna puis lors de leur rencontre ? Et si Clemente Bicocchi avait été instrumentalisé malgré lui pour défendre une cause dont il ignore tout ?
Manifestement, le fait qu'un Européen veuille faire un reportage sur le Makoko pose problème. Mais à qui, exactement ? Aux Tékés, au pouvoir en place ou à l'opposition à ce dernier ? Qui tire véritablement les rênes de tout cela, dans un pays où règne une dictature, où la liberté d'expression est très contrôlée et les disgrâces peuvent se produire du jour au lendemain ?
Voilà pourquoi j'ai choisi cette citation comme titre de ce billet, parce que le mot important y est cité deux fois : comprendre. Une fois à la forme positive, une fois à la forme négative. Exactement l'état d'esprit de Clemente Bicocchi, qui n'a pas toutes les cartes en main pour se lancer dans une telle expédition et qui ne comprend pas grand-chose à ce qui lui arrive...
Livré à lui-même au coeur de l'Afrique, perdu entre des interlocuteurs dont il ne sait pas s'ils sont des amis, des ennemis ou l'inverse, en fonction des moments, Clemente Bicocchi va passer au Congo Brazzaville la semaine sans doute la plus longue de son existence, la plus folle aussi. Son récit donne une impression de rythme effréné, mais aussi le sentiment d'une certaine absurdité.
Oui, j'ai utilisé l'adjectif kafkaïen en introduction, il y a vraiment de cela, par moments, quand on se demande, et le narrateur avec nous, ce qu'il va advenir de cet homme, à qui l'Afrique semble faire subir un véritable examen de passage, un bizutage, même. Clemente Bicocchi y met aussi son grain de sel en prenant quelques décisions étonnantes, et on en oublie parfois la dimension qui pourrait virer au tragique.
Au-delà de l'aspect rocambolesque de cette histoire, qui se terminera bien, heureusement, et inspirera à Clemente Bicocchi, outre ce livre, un documentaire, "Afrique noire, marbre blanc", c'est aussi un livre qui rappelle l'aura que conserve encore Pierre Savorgnan de Brazza en Afrique. Au risque qu'il devienne un instrument de propagande par ceux mêmes qu'il essaya de dénoncer.
J'en profite pour signaler deux ouvrages récents où l'on retrouve ce personnage. Le premier est un roman, dont nous avons parlé sur ce blog, "Il est à toi, ce beau pays", de Jennifer Richard, où Savorgnan de Brazza apparaît certes au second plan, mais comme le négatif du Britannique Stanley, dans le sillage duquel la colonisation la plus brutale s'est développée.
Le second ouvrage est une bande dessinée qui vient de paraître aux éditions Futuropolis, "le Rapport Brazza", de Tristan Thil (scénariste) et Vincent Bailly (dessinateur). Un album qui revient sur le travail effectué à la fin de sa vie par Savorgnan de Brazza à la tête d'une mission d'enquête commandité par le parlement, dans lequel il voulait dénoncer les débordements français en Afrique...
Il y a sans doute encore bien des livres autour de ce personnage, adulé ou critiqué, dont la mort brutale a donné lieu à de nombreuses rumeurs quant à un possible assassinat. Un homme qui, tout humaniste qu'il fut, reste une figure de la colonisation, et se retrouve donc au centre de vives controverses ces dernières années...
"Le Blanc du roi", c'est en tout cas l'occasion pour beaucoup, je pense, de découvrir l'histoire du peuple téké et sa situation difficile face au pouvoir en place au Congo Brazzaville, de mesurer à quel point ce sujet est fort et sensible dans le pays (comme on le voit à plusieurs reprises avec des réactions rapportées par l'auteur).
Ce n'est pas pour autant un documentaire sur ce thème, mais bien sur l'aventure vécue par Clemente Bicocchi au cours de cette semaine congolaise, folle, délirante (le mot n'est pas de moi), pleine de points d'interrogation et de zones d'ombre, mais également fort enrichissante sur un plan personnel, et sans doute professionnel. Et certainement, une manière de se sensibiliser à la complexité de la situation congolaise.
mercredi 20 juin 2018
"Continuez donc à nous interpréter votre rôle de fou qui vit sous une cloche à fromage dans laquelle se rejouent constamment les mêmes cinq ou six mois de l'époque, afin de ne pas comprendre que ce présent-là est révolu depuis longtemps et que vous vous déplacez comme dans un labyrinthe sans issue".
Au moment de commencer ce billet, je me sens comme un cycliste au pied du Ventoux ou de l'Alpe d'Huez. Vaguement inquiet, ne sachant pas si les jambes (ou ici, les neurones) répondront, espérant arriver au sommet (ici, à la fin du billet) sans trop avoir souffert. Prêt à faire un saut dans l'inconnu, sachant que les spectateurs jugeront cette prestation... Pourquoi ce sentiment ? Eh bien, parce que nous allons parler d'un roman monstre, j'assume le mot, un pavé de près de 1000 pages, et c'est sans doute la moindre de ses particularités. Un roman déroutant, exigeant, puissant, musical... Et à l'image de son personnage central, soumis en permanence à des hauts et des bas, à des moments d'abattement ou d'effervescence, à des questionnements intimes autant qu'à des réflexions touchant au monde tel qu'il va... "Comment un adolescent maniaco-dépressif inventa la Fraction Armée Rouge au cours de l'été 1969", de Frank Witzel (paru aux éditions Grasset ; traduction d'Olivier Mannoni), est un OLNI, un objet littéraire non-identifié, qu'il faut prendre le temps de lire en acceptant de se laisser porter par le flot de mots, sans se soucier vraiment de où il nous emmènera. Un récit d'une immense richesse, sur la nostalgie de l'adolescence et de cette folle période des années 1960, sur l'Allemagne de l'après-nazisme, sur la foi, la philosophie, la pop musique, étrange trinité, sur l'amour, le sexe et la folie...
Comment vous parler de ce livre ? Dès le début de ce billet, je suis hésitant, incertain... Le personnage central, qu'on appelle Witzel, tiens, tiens, allait sur ses 14 ans en 1969. Enfant de choeur, fils d'un couple de la bourgeoisie de province, il vit à Biebrich et, comme tous les enfants de son âge, il va à l'école, fait des bêtises, s'amuse avec ses copains et découvre ses premiers émois.
Fan des Beatles depuis la première heure, mais ne dédaignant pas écouter les Stones, les Kinks ou les Who, parmi tant d'autres groupes nés dans ces swinging sixties, il a une passion pour les farces et attrapes, ce qui va lui valoir quelques ennuis : en effet, le livre s'ouvre sur une scène de poursuite. Witzel et ses amis, Claudia et Bernd, ont les policiers aux trousses.
Qu'ont-ils fait ? On ne le sait pas vraiment, mais ce que l'on comprend, c'est que tous les indices, les fameuses farces et attrapes, mènent au jeune garçon, dont on commence à découvrir l'univers... un peu particulier. Une famille où le père dirige une usine et la mère souffre d'un handicap, ce qui oblige à recourir aux services d'une gouvernante appartenant à l'association Caritas.
Mais le jeune homme va bientôt apparaître sous un tout autre jour : à cette époque, il commence à manifester les signes de ce qui sera diagnostiqué comme un trouble maniaco-dépressif. Et, désormais, on va plonger dans son esprit, à travers une construction narrative très inventive, surprenante, troublante, déroutante, et voyager dans les méandres de cet esprit.
Une quarantaine d'années après cet été-là, on le retrouve en consultation chez le psy et l'on comprend que, tout au long de cette période, il a connu des moments difficiles, des séjours plus ou moins longs à l'hôpital, et que son récit sera nourri de souvenirs, certes, de connaissances acquises au fil des ans, mais tout cela passé à la moulinette de cet esprit torturé...
Le mieux, c'est peut-être de prendre le titre de ce roman (je précise que sa longueur n'est pas une lubie de l'éditeur français pour surfer sur une quelconque mode éditoriale, il s'agit de la traduction du titre original) et de le décortiquer, de prendre élément par élément pour essayer d'évoquer le contenu de cette histoire complètement foutraque.
Adolescent : j'ai déjà un peu évoqué le sujet, mais allons un peu plus loin. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un adolescent, mais celle d'un adulte qui n'a jamais vraiment grandi. Un descendant de l'Oskar du "Tambour", même s'il ne semble pas que sa croissance ait été affectée par son choix de rester, volontairement ou non, ancré dans cette période, dans cette fin de l'enfance et l'entrée dans autre chose.
Car oui, c'est un gamin que l'on suit, même si par moment, il s'emporte dans des envolées incroyables, entre histoire, politique, philosophie, théologie, musique, et là encore, le tout mélangé comme passé au mixeur. Ne nous fions pas à ces soudains pics de maturité, le personnage central de ce roman est loin d'être mûr, à quelque époque qu'on le prenne...
C'est aussi le cas lorsqu'on parle de ses relations à l'autre : ses parents, contre qui il est en révolte, pas bien grave, mais ça tangue, et plus encore contre cette femme de la Caritas, dont il n'accepte pas la présence, au point de lui donner, dans son histoire, un rôle très particulier. C'est son ennemi intime, sa némésis, la cause de tous ses maux, dirait-on.
Et puis, il y a aussi les sentiments et le désir, qui commencent à se manifester. Les premiers, sans doute non exprimés (l'adolescent est timide, aussi) envers Claudia, vont se reporter sur celle qu'il appelle Gernika, et qui semble être son amie imaginaire, en tout cas, on ne la croise qu'au cours de dialogues sans aucune contextualisation véritable.
Pour le désir, il y a des fantasmes très adolescents, encore loin d'un monde qui se libère au plan des moeurs à cette époque. On mate gentiment, surtout les adultes, on imagine la nudité plus qu'on ne la connaît, on désire, mais sans forcément aller plus loin que quelques rêveries ou quelques gestes bien innocents.
Maniaco-dépressif : ah... C'est sans doute le mot important... Frank Witzel n'a pas choisi de nous raconter une simple histoire (la sienne ?), celle d'un jeune Allemand né 10 ans après la fin de la IIe Guerre Mondiale et grandissant dans une Allemagne divisée, une société et un monde bipolaires (eux aussi), et de manière linéaire.
Non, il a explosé tous les codes narratifs pour nous offrir un livre qui ne ressemble à aucun autre. Car, comment rendre efficacement ce trouble dont souffre l'adolescent ? Par exemple, en proposant 98 chapitres n'ayant aucun lien entre eux. Ce n'est pas tout à fait les "Exercices de styles" de Queneau, mais il y a un peu de ça.
Outre l'histoire de l'adolescent, on trouve pêle-mêle des dialogues avec différents interlocuteurs, dont on ne connaît presque jamais le nom ou le rôle, des souvenirs de différentes époques, mais principalement de la fin des années 1960, des digressions historiques, philosophiques, théologiques, également, qui semblent n'avoir aucun rapport avec l'histoire de l'ado...
Ce côté patchwork n'est pas le seul élément qui vise à rappeler la maladie dont souffre l'adolescent : à chacun de ces chapitres son style, par moment lapidaires, syncopés, éteints, à d'autres, frénétiques, enthousiastes, logorrhéiques, partant dans tous les sens. Dans les premiers, des phrases et des chapitres très courts ; dans les seconds, une cascade de mots qui ne semble plus vouloir s'arrêter.
Bien sûr, tout cela demande au lecteur un certain effort, parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre d'histoire complètement déstructurée, avec des épisodes qui vont du picaresque à l'absurde, en passant par une littérature plus intimiste, des discours philosophiques et même linguistiques (impressionnante découverte du "NWF", le Nazi Word Factor) et jusqu'à des techniques proches de l'Oulipo.
On est ici dans le coeur de ce qui fait la spécificité du roman de Frank Witzel et je suis conscient que cela pourrait en décourager certains. Pourtant, c'est aussi ce qui fait le charme de ce livre complètement dingue, que l'auteur a mis près de 15 ans à écrire, et on comprend mieux pourquoi une fois lancé dans cette lecture. Un boulot ahurissant, ébouriffant, fascinant, mais déroutant, oui.
Qui inventa la Fraction Armée Rouge : ah, forcément, c'est un aspect qui attire aussitôt l'occasion. Disons-le d'emblée, le roman de Frank Witzel n'a qu'un lointain rapport avec le groupe terroriste qui a marqué l'Allemagne une décennie durant. En fait, là encore, on ne sait pas trop ce qui tient de la réalité, de la coïncidence ou du délire de l'adolescent (si tant est qu'il délire, d'ailleurs).
Au départ, il y a ce groupe de copains qui commet quelques broutilles dans son petit coin d'Allemagne et, semble-t-il, décide de se trouver une signature. Witzel cherche un truc qui claque, et ce sera cette expression de Fraction Armée Rouge, à laquelle il va associer un logo et une date, sur le modèle des emblèmes des clubs sportifs.
Petit point historique : les premiers actes attribués à la bande à Baader datent de 1968, mais la première mention du nom Fraction Armée Rouge, elle, remonte à 1970. Dans le roman, on évoque quelques fois Baader, Meinhof et les autres membres du groupe révolutionnaire, mais leur présence n'est que fugace.
Au contraire, on se demande si ne sommeillait pas en Witzel, Claudia, Bernd et leurs copains une graine révolutionnaire qui a germé en cet été 1969. Entre actes de vandalisme, crimes plus sérieux et même passage de l'autre côté du mur, en RDA, les tribulations de la petite bande, si elles restent obscures, toujours entre réalité et imagination, ne paraissent pas bien graves, mais peut-on se fier aux déclarations de l'adolescent ?
Au-delà des actes de la RAF, ce qui se pose là, c'est la question de l'Allemagne de l'après-guerre. Ou plutôt, de l'après-nazisme. Le roman de Frank Witzel a pour sujet, bien plus que les souvenirs d'un gamin né au milieu des années 1950, l'histoire de l'Allemagne après la chute du Reich et la destruction qui l'a accompagnée.
Une Allemagne désormais coupée en deux, reproduction locale de la polarisation du monde en deux blocs édifiés autour d'une superpuissance. Il y a la République Fédérale et la République Démocratique, la première où se développe de manière très rapide la société de consommation, où se diffuse de plus en plus largement la culture anglo-saxonne ; la seconde, paradis socialiste, mais société peut-être pas si idéale...
Au gré de ses discours, l'adolescent évoque différents aspects liés à l'évolution historique de l'Allemagne, au tournant des années 1960-1970. Une période où les enfants nés pendant ou après la guerre atteignent l'âge adulte, où un renouvellement doit se produire qui pourrait être la reproduction d'un modèle. Car l'impossible dénazification (impossible, car visant trop de monde) a échoué...
Ce roman, c'est aussi l'histoire d'une rupture générationnelle, avec le Reich comme séparateur. Il y a cette jeunesse qui veut se désamarrer de leurs parents, tous plus ou moins impliqués dans l'essor et les ravages du nazisme et qui, pour cela, opte vers tout autre chose, vers une utopie remettant en cause l'ordre établi, hérité de la période honnie.
Il y a, derrière le discours de l'adolescent, toute une réflexion sur la destruction et la (re)construction, exemples à l'appui, comme s'il fallait déconstruire cette Allemagne et tout son passé pour en faire émerger une autre, comme neuve, débarrasser de cet encombrant et néfaste passé. Et pour cela, quoi de mieux que cette génération montante, innocente et sans tache ?
L'été 1969 : le roman de Frank Witzel n'est pas une version ouest-allemande de "Goodbye Lenine !", mais c'est en revanche une chronique de la vie en RFA à la fin des années 1960. On y trouve de nombreuses références à la vie quotidienne, à la culture de cette époque et bien sûr à la musique, avec l'arrivée des groupes anglais et américains, tels une déferlante.
On est à l'affût des nouveaux titres diffusés sur les transistors, on recherche les nouveaux 45 et 33 tours, qu'on enregistre parfois sur les K7 qui font leur apparition, afin de les réécouter à volonté ou de les diffuser lors des surprises-parties. La play-list qui accompagne le roman, emmenée en priorité par les Beatles, est d'une très grande richesse et agrémente remarquablement la lecture.
Au-delà de ces questions, le choix de cette année (érotique, mais ici, pas tant que ça) colle avec l'évolution du personnage, qui quitte vraiment l'enfance cet été-là, bon an mal an, sans vraiment le vouloir, par la force des choses. C'est aussi un roman sur la nostalgie de cette période, autant pour ce contexte évoqué à l'instant que pour cet âge si particulier qui est peut-être le plus agréable.
D'autant que c'est aussi à ce moment que la maladie de l'adolescent va se déclarer et changer son existence en profondeur, lui imposer des ruptures avec tout ce qu'il a connu jusque-là, la vie d'enfant de choeur, la famille, l'école, les amis... La fin de l'insouciance et le début d'une période qui sera bien moins agréable, et pas seulement parce qu'on le suspecte d'être un terroriste en herbe.
Evidemment, on ressort de cette lecture avec un sentiment bizarre : a-t-on réellement lu une histoire ? Sans doute, sauf que ce n'est certainement pas celle à laquelle on s'attendait. En brouillant sans cesse les pistes, en jouant aussi avec son propre parcours (il y a d'évidents clins d'oeil autobiographiques, sans qu'on sache où cela s'arrête), Frank Witzel nous raconte une histoire de l'Allemagne contemporaine.
Les thématiques paraissent dramatiques, mais là encore on passe sans arrêt d'une émotion à une autre, de passages très drôles à d'autres bien plus sombres. Au gré des digressions, des histoires, des personnages que l'on rencontre, des musiques que l'on écoute, se dessine une fresque étonnante, surréaliste, folle, mais éblouissante.
On voit surtout un personnage qui s'est construit sur une étonnante trinité : la religion qui a baigné son enfance, la philosophie qu'il semble avoir étudié en profondeur, et la pop music, qui a modelé sa culture. Or, dans sa folie, les trois éléments s'assemblent, fusionnent, se marient pour donner un discours dans lequel les popstars deviennent l'équivalent de saints, où la philosophie se penche sur des textes de chansons...
Et où un album, en l'occurrence le "Rubber Soul" des Beatles, devient carrément une espèce d'évangile, mais aussi de petit livre rouge. Où chaque élément prend un sens nouveau lorsqu'il est éclairé par les autres. Là encore, il faut adhérer à tout cela, mais lorsque ça fonctionne, c'est tout à fait inattendu et surprenant, mais également passionnant, à la fois délirant et truculent.
Entre la naïveté de l'enfant entrant dans l'adolescence et le désenchantement d'un adulte qui a tout fait pour ne pas vraiment le devenir, on a un personnage attachant, touchant, qu'on ne sait pas vraiment par quel bout prendre : est-il vraiment malade ? Simule-t-il ? Est-il un révolutionnaire ou simplement un idéaliste qui rêvait de construire un monde meilleur ?
Pour un de ses interlocuteurs, sans doute un psy (ajoutez ce que vous voulez derrière ce préfixe), il est un puer aeterus, un éternel enfant, ou en tout cas, c'est ce qu'il affecte d'être. Mais l'adolescent est aussi tiraillé par les sermons d'un prêtre... Il incarne alors une sorte d'allégorie de l'Allemagne, travaillée par sa mauvaise conscience, en quête perpétuelle de l'apaisement ou de l'absolution.
Voilà, j'arrive au sommet du col, essoufflé, fatigué mais pas si mécontent que ça de moi. J'ai abordé ce roman monstre avec enthousiasme, car cette lecture, aussi exigeante et déroutante soit-elle, elle ne peut pas laisser indifférent. Oh, je sais que certains hésiteront et même renonceront à cette lecture après avoir lu ce billet, c'est dommage.
Parce que des livres qui sortent à ce point de l'ordinaire, qui conjuguent une ambition narrative autant que littéraire, qui jouent avec tant d'ingrédients et jonglent avec tant de genres, il n'y en a pas beaucoup. Mais, il faut accepter le parti pris d'un auteur qui recours sans cesse au trompe-l'oeil et n'hésite pas à se lancer dans des envolées qu'il faut dompter.
D'ailleurs, l'avantage de "Comment un adolescent maniaco-dépressif inventa la Fraction Armée Rouge au cours de l'été 1969", c'est qu'on peut le lire à son rythme, faire des pauses entre les chapitres, y retourner... Sans jamais perdre de vue que, malgré les apparences, cet "adolescent adulte" porte un regard fort lucide sur son pays, la société qui l'a vu grandir, le monde...
Comment vous parler de ce livre ? Dès le début de ce billet, je suis hésitant, incertain... Le personnage central, qu'on appelle Witzel, tiens, tiens, allait sur ses 14 ans en 1969. Enfant de choeur, fils d'un couple de la bourgeoisie de province, il vit à Biebrich et, comme tous les enfants de son âge, il va à l'école, fait des bêtises, s'amuse avec ses copains et découvre ses premiers émois.
Fan des Beatles depuis la première heure, mais ne dédaignant pas écouter les Stones, les Kinks ou les Who, parmi tant d'autres groupes nés dans ces swinging sixties, il a une passion pour les farces et attrapes, ce qui va lui valoir quelques ennuis : en effet, le livre s'ouvre sur une scène de poursuite. Witzel et ses amis, Claudia et Bernd, ont les policiers aux trousses.
Qu'ont-ils fait ? On ne le sait pas vraiment, mais ce que l'on comprend, c'est que tous les indices, les fameuses farces et attrapes, mènent au jeune garçon, dont on commence à découvrir l'univers... un peu particulier. Une famille où le père dirige une usine et la mère souffre d'un handicap, ce qui oblige à recourir aux services d'une gouvernante appartenant à l'association Caritas.
Mais le jeune homme va bientôt apparaître sous un tout autre jour : à cette époque, il commence à manifester les signes de ce qui sera diagnostiqué comme un trouble maniaco-dépressif. Et, désormais, on va plonger dans son esprit, à travers une construction narrative très inventive, surprenante, troublante, déroutante, et voyager dans les méandres de cet esprit.
Une quarantaine d'années après cet été-là, on le retrouve en consultation chez le psy et l'on comprend que, tout au long de cette période, il a connu des moments difficiles, des séjours plus ou moins longs à l'hôpital, et que son récit sera nourri de souvenirs, certes, de connaissances acquises au fil des ans, mais tout cela passé à la moulinette de cet esprit torturé...
Le mieux, c'est peut-être de prendre le titre de ce roman (je précise que sa longueur n'est pas une lubie de l'éditeur français pour surfer sur une quelconque mode éditoriale, il s'agit de la traduction du titre original) et de le décortiquer, de prendre élément par élément pour essayer d'évoquer le contenu de cette histoire complètement foutraque.
Adolescent : j'ai déjà un peu évoqué le sujet, mais allons un peu plus loin. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un adolescent, mais celle d'un adulte qui n'a jamais vraiment grandi. Un descendant de l'Oskar du "Tambour", même s'il ne semble pas que sa croissance ait été affectée par son choix de rester, volontairement ou non, ancré dans cette période, dans cette fin de l'enfance et l'entrée dans autre chose.
Car oui, c'est un gamin que l'on suit, même si par moment, il s'emporte dans des envolées incroyables, entre histoire, politique, philosophie, théologie, musique, et là encore, le tout mélangé comme passé au mixeur. Ne nous fions pas à ces soudains pics de maturité, le personnage central de ce roman est loin d'être mûr, à quelque époque qu'on le prenne...
C'est aussi le cas lorsqu'on parle de ses relations à l'autre : ses parents, contre qui il est en révolte, pas bien grave, mais ça tangue, et plus encore contre cette femme de la Caritas, dont il n'accepte pas la présence, au point de lui donner, dans son histoire, un rôle très particulier. C'est son ennemi intime, sa némésis, la cause de tous ses maux, dirait-on.
Et puis, il y a aussi les sentiments et le désir, qui commencent à se manifester. Les premiers, sans doute non exprimés (l'adolescent est timide, aussi) envers Claudia, vont se reporter sur celle qu'il appelle Gernika, et qui semble être son amie imaginaire, en tout cas, on ne la croise qu'au cours de dialogues sans aucune contextualisation véritable.
Pour le désir, il y a des fantasmes très adolescents, encore loin d'un monde qui se libère au plan des moeurs à cette époque. On mate gentiment, surtout les adultes, on imagine la nudité plus qu'on ne la connaît, on désire, mais sans forcément aller plus loin que quelques rêveries ou quelques gestes bien innocents.
Maniaco-dépressif : ah... C'est sans doute le mot important... Frank Witzel n'a pas choisi de nous raconter une simple histoire (la sienne ?), celle d'un jeune Allemand né 10 ans après la fin de la IIe Guerre Mondiale et grandissant dans une Allemagne divisée, une société et un monde bipolaires (eux aussi), et de manière linéaire.
Non, il a explosé tous les codes narratifs pour nous offrir un livre qui ne ressemble à aucun autre. Car, comment rendre efficacement ce trouble dont souffre l'adolescent ? Par exemple, en proposant 98 chapitres n'ayant aucun lien entre eux. Ce n'est pas tout à fait les "Exercices de styles" de Queneau, mais il y a un peu de ça.
Outre l'histoire de l'adolescent, on trouve pêle-mêle des dialogues avec différents interlocuteurs, dont on ne connaît presque jamais le nom ou le rôle, des souvenirs de différentes époques, mais principalement de la fin des années 1960, des digressions historiques, philosophiques, théologiques, également, qui semblent n'avoir aucun rapport avec l'histoire de l'ado...
Ce côté patchwork n'est pas le seul élément qui vise à rappeler la maladie dont souffre l'adolescent : à chacun de ces chapitres son style, par moment lapidaires, syncopés, éteints, à d'autres, frénétiques, enthousiastes, logorrhéiques, partant dans tous les sens. Dans les premiers, des phrases et des chapitres très courts ; dans les seconds, une cascade de mots qui ne semble plus vouloir s'arrêter.
Bien sûr, tout cela demande au lecteur un certain effort, parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre d'histoire complètement déstructurée, avec des épisodes qui vont du picaresque à l'absurde, en passant par une littérature plus intimiste, des discours philosophiques et même linguistiques (impressionnante découverte du "NWF", le Nazi Word Factor) et jusqu'à des techniques proches de l'Oulipo.
On est ici dans le coeur de ce qui fait la spécificité du roman de Frank Witzel et je suis conscient que cela pourrait en décourager certains. Pourtant, c'est aussi ce qui fait le charme de ce livre complètement dingue, que l'auteur a mis près de 15 ans à écrire, et on comprend mieux pourquoi une fois lancé dans cette lecture. Un boulot ahurissant, ébouriffant, fascinant, mais déroutant, oui.
Qui inventa la Fraction Armée Rouge : ah, forcément, c'est un aspect qui attire aussitôt l'occasion. Disons-le d'emblée, le roman de Frank Witzel n'a qu'un lointain rapport avec le groupe terroriste qui a marqué l'Allemagne une décennie durant. En fait, là encore, on ne sait pas trop ce qui tient de la réalité, de la coïncidence ou du délire de l'adolescent (si tant est qu'il délire, d'ailleurs).
Au départ, il y a ce groupe de copains qui commet quelques broutilles dans son petit coin d'Allemagne et, semble-t-il, décide de se trouver une signature. Witzel cherche un truc qui claque, et ce sera cette expression de Fraction Armée Rouge, à laquelle il va associer un logo et une date, sur le modèle des emblèmes des clubs sportifs.
Petit point historique : les premiers actes attribués à la bande à Baader datent de 1968, mais la première mention du nom Fraction Armée Rouge, elle, remonte à 1970. Dans le roman, on évoque quelques fois Baader, Meinhof et les autres membres du groupe révolutionnaire, mais leur présence n'est que fugace.
Au contraire, on se demande si ne sommeillait pas en Witzel, Claudia, Bernd et leurs copains une graine révolutionnaire qui a germé en cet été 1969. Entre actes de vandalisme, crimes plus sérieux et même passage de l'autre côté du mur, en RDA, les tribulations de la petite bande, si elles restent obscures, toujours entre réalité et imagination, ne paraissent pas bien graves, mais peut-on se fier aux déclarations de l'adolescent ?
Au-delà des actes de la RAF, ce qui se pose là, c'est la question de l'Allemagne de l'après-guerre. Ou plutôt, de l'après-nazisme. Le roman de Frank Witzel a pour sujet, bien plus que les souvenirs d'un gamin né au milieu des années 1950, l'histoire de l'Allemagne après la chute du Reich et la destruction qui l'a accompagnée.
Une Allemagne désormais coupée en deux, reproduction locale de la polarisation du monde en deux blocs édifiés autour d'une superpuissance. Il y a la République Fédérale et la République Démocratique, la première où se développe de manière très rapide la société de consommation, où se diffuse de plus en plus largement la culture anglo-saxonne ; la seconde, paradis socialiste, mais société peut-être pas si idéale...
Au gré de ses discours, l'adolescent évoque différents aspects liés à l'évolution historique de l'Allemagne, au tournant des années 1960-1970. Une période où les enfants nés pendant ou après la guerre atteignent l'âge adulte, où un renouvellement doit se produire qui pourrait être la reproduction d'un modèle. Car l'impossible dénazification (impossible, car visant trop de monde) a échoué...
Ce roman, c'est aussi l'histoire d'une rupture générationnelle, avec le Reich comme séparateur. Il y a cette jeunesse qui veut se désamarrer de leurs parents, tous plus ou moins impliqués dans l'essor et les ravages du nazisme et qui, pour cela, opte vers tout autre chose, vers une utopie remettant en cause l'ordre établi, hérité de la période honnie.
Il y a, derrière le discours de l'adolescent, toute une réflexion sur la destruction et la (re)construction, exemples à l'appui, comme s'il fallait déconstruire cette Allemagne et tout son passé pour en faire émerger une autre, comme neuve, débarrasser de cet encombrant et néfaste passé. Et pour cela, quoi de mieux que cette génération montante, innocente et sans tache ?
L'été 1969 : le roman de Frank Witzel n'est pas une version ouest-allemande de "Goodbye Lenine !", mais c'est en revanche une chronique de la vie en RFA à la fin des années 1960. On y trouve de nombreuses références à la vie quotidienne, à la culture de cette époque et bien sûr à la musique, avec l'arrivée des groupes anglais et américains, tels une déferlante.
On est à l'affût des nouveaux titres diffusés sur les transistors, on recherche les nouveaux 45 et 33 tours, qu'on enregistre parfois sur les K7 qui font leur apparition, afin de les réécouter à volonté ou de les diffuser lors des surprises-parties. La play-list qui accompagne le roman, emmenée en priorité par les Beatles, est d'une très grande richesse et agrémente remarquablement la lecture.
Au-delà de ces questions, le choix de cette année (érotique, mais ici, pas tant que ça) colle avec l'évolution du personnage, qui quitte vraiment l'enfance cet été-là, bon an mal an, sans vraiment le vouloir, par la force des choses. C'est aussi un roman sur la nostalgie de cette période, autant pour ce contexte évoqué à l'instant que pour cet âge si particulier qui est peut-être le plus agréable.
D'autant que c'est aussi à ce moment que la maladie de l'adolescent va se déclarer et changer son existence en profondeur, lui imposer des ruptures avec tout ce qu'il a connu jusque-là, la vie d'enfant de choeur, la famille, l'école, les amis... La fin de l'insouciance et le début d'une période qui sera bien moins agréable, et pas seulement parce qu'on le suspecte d'être un terroriste en herbe.
Evidemment, on ressort de cette lecture avec un sentiment bizarre : a-t-on réellement lu une histoire ? Sans doute, sauf que ce n'est certainement pas celle à laquelle on s'attendait. En brouillant sans cesse les pistes, en jouant aussi avec son propre parcours (il y a d'évidents clins d'oeil autobiographiques, sans qu'on sache où cela s'arrête), Frank Witzel nous raconte une histoire de l'Allemagne contemporaine.
Les thématiques paraissent dramatiques, mais là encore on passe sans arrêt d'une émotion à une autre, de passages très drôles à d'autres bien plus sombres. Au gré des digressions, des histoires, des personnages que l'on rencontre, des musiques que l'on écoute, se dessine une fresque étonnante, surréaliste, folle, mais éblouissante.
On voit surtout un personnage qui s'est construit sur une étonnante trinité : la religion qui a baigné son enfance, la philosophie qu'il semble avoir étudié en profondeur, et la pop music, qui a modelé sa culture. Or, dans sa folie, les trois éléments s'assemblent, fusionnent, se marient pour donner un discours dans lequel les popstars deviennent l'équivalent de saints, où la philosophie se penche sur des textes de chansons...
Et où un album, en l'occurrence le "Rubber Soul" des Beatles, devient carrément une espèce d'évangile, mais aussi de petit livre rouge. Où chaque élément prend un sens nouveau lorsqu'il est éclairé par les autres. Là encore, il faut adhérer à tout cela, mais lorsque ça fonctionne, c'est tout à fait inattendu et surprenant, mais également passionnant, à la fois délirant et truculent.
Entre la naïveté de l'enfant entrant dans l'adolescence et le désenchantement d'un adulte qui a tout fait pour ne pas vraiment le devenir, on a un personnage attachant, touchant, qu'on ne sait pas vraiment par quel bout prendre : est-il vraiment malade ? Simule-t-il ? Est-il un révolutionnaire ou simplement un idéaliste qui rêvait de construire un monde meilleur ?
Pour un de ses interlocuteurs, sans doute un psy (ajoutez ce que vous voulez derrière ce préfixe), il est un puer aeterus, un éternel enfant, ou en tout cas, c'est ce qu'il affecte d'être. Mais l'adolescent est aussi tiraillé par les sermons d'un prêtre... Il incarne alors une sorte d'allégorie de l'Allemagne, travaillée par sa mauvaise conscience, en quête perpétuelle de l'apaisement ou de l'absolution.
Voilà, j'arrive au sommet du col, essoufflé, fatigué mais pas si mécontent que ça de moi. J'ai abordé ce roman monstre avec enthousiasme, car cette lecture, aussi exigeante et déroutante soit-elle, elle ne peut pas laisser indifférent. Oh, je sais que certains hésiteront et même renonceront à cette lecture après avoir lu ce billet, c'est dommage.
Parce que des livres qui sortent à ce point de l'ordinaire, qui conjuguent une ambition narrative autant que littéraire, qui jouent avec tant d'ingrédients et jonglent avec tant de genres, il n'y en a pas beaucoup. Mais, il faut accepter le parti pris d'un auteur qui recours sans cesse au trompe-l'oeil et n'hésite pas à se lancer dans des envolées qu'il faut dompter.
D'ailleurs, l'avantage de "Comment un adolescent maniaco-dépressif inventa la Fraction Armée Rouge au cours de l'été 1969", c'est qu'on peut le lire à son rythme, faire des pauses entre les chapitres, y retourner... Sans jamais perdre de vue que, malgré les apparences, cet "adolescent adulte" porte un regard fort lucide sur son pays, la société qui l'a vu grandir, le monde...
lundi 18 juin 2018
"Nous voulons la liberté. Nous voulons le pouvoir de déterminer la destinée de notre communauté noire. Nous croyons que le peuple noir ne sera pas libre tant qu'il ne pourra pas décider de sa propre destinée".
Jusqu'ici, lorsqu'on disait Stéphane Marsan, on pensait à Bragelonne, la maison d'édition qu'il a fondée avec Alain Névant en 2000 et qui est devenue depuis un des principaux acteurs indépendants du secteur de l'imaginaire. Et puis, voilà qu'en ce printemps 2018, le nom de Stéphane Marsan devient un label littéraire. Et pas en SFFF (science-fiction, fantasy, fantastique), mais bien en littérature blanche... Surprise ! Deux premiers titres paru en avril, dont un roman français qui fera l'objet de ce billet : "Power", de Michael Mention, dont la couverture donne le ton d'une charte graphique résolument sobre. Entre littérature blanche et roman historique, mais aussi roman noir, le genre dans lequel on connaît Michael Mention, ce livre nous plonge dans une époque en plein bouillonnement, du milieu des années 1960 au début de la décennie suivante, à peine quelques années, à la rencontre de personnages dont le destin sera irrésistiblement bousculés par un vent de révolte. Une tornade qui a pour nom le Black Panther Party...
Le 21 février 1965, Malcolm X est assassiné en pleine intervention publique, à New York. Mille rumeurs courent sur les meurtriers et leurs éventuels commanditaires, mais au-delà de ces questionnements légitimes, le choc est immense dans tout le pays. Et la communauté noire, vingt millions d'Américains ayant bien souvent l'impression d'être des citoyens de seconde zone, se désespère et se tend.
La solution non-violente prônée par le révérend Martin Luther King ne convainc plus ; la violence menace d'éclater à chaque instant, à chaque nouvelle injustice. Et, lorsqu'une escarmouche ou un début d'émeute se produit dans le pays, la répression est terrible et laisse derrière elle de nombreuses victimes. Des victimes à la peau noire.
Deux jeunes hommes aux trajectoires bien différentes se retrouvent à ce moment-là sur un campus d'Oakland : Bobby Stills et Huey Norton. A 29 ans, le premier a déjà pas mal roulé sa bosse, ex-militaire, renvoyé pour avoir frappé un supérieur, désormais muni d'un diplôme d'ingénieur ; le second, étudiant en droit, a fait de la prison.
Ils se sont connus quelques années plus tôt, à travers leur engagement politique et idéologique fort pour la défense des droits des Noirs, avant de se perdre de vue. De ces retrouvailles, va naître la volonté de prendre un peu plus le destin des Afro-Américains en main, ce qui va aboutir à la création d'un nouveau mouvement : le Black Panther Party for Self-Defense.
Avec, pour marquer le coup, un manifeste (le titre de ce billet est son premier article), une structure gouvernementale pour affirmer la volonté de pouvoir et pas simplement de défense des droits, mais aussi des accessoires qui vont leur permettre de se montrer partout et de s'imposer : les gants noirs, le béret, une arme et un livre de droit.
Car ce nouveau parti repose sur un principe simple : utiliser la loi des Blancs, celle qui entrave et opprime tant les Noirs, et la retourner à leur propre avantage. Cela passe d'emblée par le fameux deuxième amendement, celui qui autorise la détention et le port d'arme pour les citoyens. Il ne s'agit pas d'en faire usage, mais de l'utiliser pour réaffirmer sa citoyenneté à part entière...
Dans le sillage de Bobby et Huey, se met en place un mouvement qui va, très vite, se faire remarquer par des actions d'éclat, plaçant les autorités, et en particulier les forces de l'ordre, mais aussi le pouvoir politique, dans une position fort inconfortable. Ils ne sont pas hors-la-loi, mais leur activisme marque les esprits, aussi bien parmi la communauté noire que dans la population blanche...
Et le succès est fulgurant, on se bouscule pour intégrer ce mouvement, d'abord en Californie puis à travers le pays. C'est le cas de Charlene, adolescente en rupture avec son père. Idéaliste, déterminée, motivée pour se faire sa place au sein du jeune mouvement, mais aussi pour que le mouvement s'installe dans la société américaine et qu'enfin, elle se sente considérée. Une militante enthousiaste et exemplaire.
A l'autre bout du spectre, il y a Neil. Policier, blanc de peau, fervent catholique, pratiquant son métier comme un sacerdoce, avec à l'esprit et au coeur la mission de servir et protéger, comme le veut la devise de son corps. Un homme intègre, en rébellion à sa façon lui aussi contre son père, même s'il a choisi une autre voie pour l'exprimer.
Flic en uniforme, faisant des tournées dans les rues de Los Angeles, et pas dans les quartiers les plus favorisés, il connaît bien le terrain et cherche toujours l'équité, contrairement à de nombreux de ses collègues, racistes et aimant affirmer leur force. Neil est sans doute un peu trop timide pour imposer ses vues, il subit souvent les événements, laissant finalement agir ses coéquipiers, même lorsque cela lui déplaît...
Enfin, il y a Tyrone. Jeune homme noir, il purge une peine de prison quand on vient lui proposer de le remettre en liberté, à une condition : jouer les mouchards au sein d'un mouvement en plein essor et dont on se méfie de plus en plus en haut lieu, le Black Panther Party. Infiltrer l'entourage de ses leaders et rapporter au FBI leurs intentions...
Tyrone refuse, d'abord, persuadé qu'il n'est pas l'homme de la situation, qu'il sera démasqué en quelques instants. Mais son interlocuteur sait habilement faire pression sur lui et mettre en avant des arguments que le garçon ne peut rejeter... Piégé, il finit par céder, se lance dans l'aventure, entre trouillomètre à zéro et mauvaise conscience...
"Power" débute donc par une première partie, "What we want", qui retrace la naissance du BPP et décrit son cadre, ses statuts, ses objectifs. En fait, cette première partie assez courte est plutôt un long prologue qui va permettre de planter le décor pour entrer, dans la seconde, "What we believe", dans le vif du sujet.
Car "Power" n'est pas stricto sensu un roman historique. Il ne s'agit pas de raconter l'histoire du BPP, même si cela constitue l'arrière-plan des histoires que l'on va découvrir ensuite. D'ailleurs, si Michaël Mention reste au plus proche de la chronologie et des faits, il se donne une marge de manoeuvre fictionnelle, par exemple en changeant les noms des fondateurs du parti, Bobby Seale et Huey P. Newton.
Si "ses" Bobby et Huey sont sur le devant de la scène durant "What we want", ils apparaissent plus en retrait durant "What we believe", les rôles principaux étant alors occupés par des personnages totalement imaginaires, ceux-là, les trois que j'ai évoqués plus haut : Charlene, Neil et Tyrone. Leur présentation dans ce billet est volontairement succincte, car le coeur de ce roman, c'est ce qui va leur arriver...
On retrouve dans "Power" une technique classique des fictions à caractère historique, appelons cela ainsi : mettre des personnages imaginés face à l'histoire en marche et raconter comment les événements vont influer sur leur existence, leur destin. On retrouve des archétypes vieux comme les tragédies antiques, et ce sera encore le cas avec nos trois protagonistes, qui vont être emportés par un tourbillon terrible...
Ainsi présentés, ils ne semblent rien avoir d'extraordinaire, ce sont des anonymes qui auraient pu le rester, mais croyez-moi, entre le moment où vous allez faire leur connaissance et celui où vous les quitterez, ils ne paraîtront plus être tout à fait la même personne. Voilà aussi ce qui rapproche "Power" d'un roman noir : les événements peuvent aussi bien vous profiter que vous broyer, mais la seconde solution est la plus courante...
Michaël Mention s'appuie sur l'histoire fulgurante de ce Black Panther Party, officiellement dissout en 1982, mais qui va imploser véritablement dès le début des années 1970, victime des dissensions entre ses leaders, de leurs ambitions divergentes en matière de gouvernance et d'idéologie, d'une propension de plus en plus nette à la violence...
Pourtant, le mouvement, à ses débuts, repose sur la volonté claire de fonder son action sur le social et l'éducation. Pour devenir Black Panther, on doit se former, intellectuellement, mais aussi idéologiquement (l'orientation marxiste est très nette). Ensuite, on soutient la communauté par des gestes parfois très simples, ainsi que par une présence qui se veut constante.
Un exemple : à un carrefour d'un quartier noir, se produisent régulièrement des accidents de la circulation. On ne compte plus les enfants fauchés par des voitures à cet endroit. On réclame une signalisation, un feu tricolore, mais rien n'est fait. Pas même une présence policière pour réguler la circulation. Qu'à cela ne tienne, puisque les autorités ne le font pas, les Black Panthers le feront !
Et voilà comment, petit à petit, entre activisme et provocation pacifiques envers le pouvoir et actions de terrain assidues et ciblées, le BPP a gagné les coeurs et les esprits. Au début, tout cela paraît si simple, si facile, et puis les choses vont se gâter, peu à peu, jusqu'à gangrener le mouvement et le conduire à sa perte.
Le contexte aussi n'a rien facilité : la communauté noire, terme générique et un peu trompe-l'oeil, est en fait très diverse et même très divisée. Pas seulement sur un plan idéologique, entre partisans de Malcolm X et de Luther King, entre marxistes et musulmans, entre partisans de la violence et adeptes de la non-violence...
Non, ça, ce sont les divisions de la frange politique de la communauté. Mais, il y a aussi une autre voie en plein développement, celle des gangs. Ceux qui ont renoncé à trouver une place au sein de la société et ont décidé de vivre hors cette loi qui les opprime et les entrave. Leur loi, c'est celle du plus fort, de celui qui dégaine le plus vite. Mais aussi celle du billet vert.
Entre le BPP et les gangs, s'instaure une véritable rivalité, les objectifs des uns et des autres, tout comme les moyens mis en oeuvre pour y parvenir, semblant radicalement opposés. Malgré les efforts des dirigeants du BPP pour trouver des terrains d'entente, forger des alliances, rappeler que l'ennemi, c'est le pouvoir blanc, le capital, également, cette opposition va tourner à l'affrontement...
Enfin, il y a la pression policière. Paradoxalement, elle n'est pas tant symbolisé par Neil, vous comprendrez vite pourquoi, mais par Tyrone. En effet, rapidement, le BPP va être considéré comme un danger à rapidement cerner et éliminer par J. Edgar Hoover en personne. Et pour cela, il existe un programme, créé au milieu des années 1950 : le COINTELPRO.
Tyrone, malgré lui, devient l'un de ses agents. Le but du COINTELPRO, c'est de discréditer par tous les moyens à disposition les mouvements jugés trop radicaux ou remettant un peu trop en cause les bases de la société américaine. Infiltrations, intoxication et désinformation, divisions et exacerbation des rivalités entre entités, et sans doute bien pire encore... Tous les moyens sont bons, et God bless America !
Hoover, au plan fédéral, comme le gouverneur de Californie, un certain Ronald Reagan, sur un plan plus local, sera l'ennemi acharné du BPP. On le croise brièvement dans "Power", mais c'est l'un de ses "petits soldats" que l'on va suivre au fil du roman. Un brave gars, sans doute, mais sans scrupule ni état d'âme, obéissant aux ordres et les appliquant à la lettre, sans se soucier des conséquences.
A l'inverse d'un Tyrone, rongé par le rôle que Clark lui a imposé, ce dernier laisse son boulot au bureau et, le soir, reprend sa petite vie tranquille, sans histoire. Un personnage qui n'en est que plus glaçant, par ce distinguo qu'il parvient à faire entre son job, instrument de l'oppression, et sa vie privée, mais qui est peut-être aussi celui qui est le moins impliqué dans le fameux tourbillon...
"Power" est évidemment un roman très politique, même si Michaël Mention n'oublie pas les dérives idéologiques qui ont aussi provoqué l'implosion du BPP. De même, il ne ménage pas les personnages inspirés de véritables personnages historiques. Certains avaient déjà un parcours judiciaire chargé avant d'adhérer, et pas lié à des actions militantes, mais à de véritables crimes.
La première page du livre est d'ailleurs édifiante, cela débute par un court texte, presque une exergue, en forme d'aveu : "Ca a foiré à cause de nous. Pas à cause du FBI, de la came, des gangs. Ils nous ont pourri la vie, mais le vrai problème, c'était nous. Trop pressés (...) L'envie, c'est ce qui nous a tués". Comme souvent, l'utopie était séduisante, mais elle a échoué...
C'est aussi cela, "Power", une utopie qui naît, se met en place, se développe, s'impose, petit à petit. Oh, elle ne fait pas plaisir à tout le monde, parce que l'utopie remet trop de choses en cause pour faire l'unanimité. Et puis, l'humain reprend le dessus et les belles idées sont écrasées par l'ambition, la soif de pouvoir, la folie humaine...
La folie... Elle est très présente dans le roman, sous différentes formes, éclatante ou insidieuse, virulente et douloureuse. Et ceux qui parviennent à rester lucides sont vite dépassés par les événements. Cette époque fut folle, elle aussi, dans sa démesure comme dans les passions qu'elle a engendrées, par le vent de liberté qui a soufflé, comme par l'incroyable violence qui en a découlé.
Je l'ai dit plus haut, Michaël Mention s'appuie sur l'histoire des Black Panthers, comme par exemple leur extraordinaire manifestation devant, puis à l'intérieur du Capitole de Sacramento, siège de l'exécutif de l'Etat de Californie, le 2 mai 1967. Et puis, plus généralement, il intègre d'autres événements phares de la période pour nourrir son récit, faire évoluer ses personnages.
Sans oublier la musique, ingrédient omniprésent dans la bibliographie de l'auteur, et même de plus en plus présente. Car, si elle était d'abord un élément de décor, une manière de colorer l'arrière-plan et de faire revivre une époque, elle s'impose de plus en plus au coeur du récit, comme un élément à part entière du récit.
C'était déjà le cas dans "Fils de Sam", où les paroles commençaient à s'immiscer dans le texte. Mais, dans "Power", les textes des chansons (on trouve une play-list en fin d'ouvrage, qui rassemble des tubes immortels, aussi bien que des raretés) font partie de la narration, parfois comme transition, comme une ligne de séparation sur un split-screen, ou comme un fondu.
A d'autres moments, ils illustrent, et pas seulement musicalement, l'action qui est en cours. Il y a un joli travail d'écriture pour que ces textes, évidemment jamais choisis au hasard, ou juste parce que c'est ce qu'on entendait sur toutes les ondes à ce moment-là, collent vraiment à l'histoire et ajoutent leur pierre à l'édifice.
C'est bien sûr un roman qui paraît dans un contexte sensible, douloureux, et pas seulement aux Etats-Unis, où les questions raciales sont revenues brutalement à la une ces dernières années, où des sportifs noirs ont défié le pouvoir blanc avant même l'avènement de Donald Trump. En France aussi, ces questions perdurent face à une libération des paroles racistes...
"Power", c'est une parenthèse enchantée, un rêve non pas de paix et d'amour, mais de respect, comme le chantait Aretha Franklin, un rêve de pouvoir vivre comme on l'entendait, sans que la couleur de peau ne ferme toutes les portes... Ils et elles voulaient la liberté, ils et elles l'ont touchée du doigt et elle s'est rétractée... Toujours tant désirée, et pourtant toujours aussi rétive... Réservée à ceux qui en décident...
lundi 11 juin 2018
Nan, mais Harlow, quoi !
Je crois que la première fois que j'ai entendu parler de Jean Harlow, c'était dans "Hollywood", chanson de David McNeil qu'Yves Montand avait reprise à l'occasion de son retour sur scène au début des années 1980. Pas certain que ce nom évoque grand-chose à la majeure partie d'entre vous... Et pourtant, pour beaucoup, elle est la première très grande star hollywoodienne, le premier sex symbol, une idole qui influencera nombre de stars futures, dont Marilyn Monroe. Dans "Platine" (en grand format aux éditions Actes Sud), Régine Detambel dresse le portrait de cette jeune femme à la trajectoire fulgurante et au destin tragique, coincée entre une carrière qui en demandait toujours plus, une vie privée chaotique et une relation compliquée avec sa mère. Un roman servi par une plume superbe, où est mis en valeur le paradoxe du corps, qui apporte la gloire mais détruit l'être (tiens, ça me rappelle un classique littéraire, non ?).
Elle fut la première blonde incendiaire du cinéma hollywoodien, une chevelure à la couleur platine qui nourrit bien des discussions et des débats : était-ce sa couleur naturelle, avait-elle trouvé la teinture parfaite ou s'agissait-il d'une perruque ? Cette chevelure éclatante est l'un des traits physiques marquants de cette jeune femme née Harlean Carpenter à Kansas City, en 1911, dans un milieu sans rapport avec le cinéma.
Pour être franc, les cheveux de celle qui va faire carrière sous le pseudonyme de Jean Harlow ne sont pas son unique atout. Sa plastique y est aussi pour beaucoup, et en particulier une poitrine qui a fait fantasmer toute l'Amérique au début des années 1930. "Platine" débute d'ailleurs sur une véritable ode aux seins de Jean Harlow...
Mais ne soyez pas si terre à terre : le physique seul de Jean Harlow n'explique pas l'incroyable succès qui va être le sien jusqu'à sa mort prématurée. Découverte par Howard Hugues (elle a d'ailleurs un petit rôle non crédité dans l'adaptation de "Scarface" qu'il produit), elle va enchaîner les succès à partir de 1932 et tourner aux côtés de William Powell et Clark Gable, qui joueront un rôle particulier dans sa vie.
Etait-elle préparée à cette incroyable spirale vers la gloire ? En tout cas, derrière la carrière prolifique, la gloire et les cachets de plus en plus importants, la réalité fut nettement moins reluisante : un beau-père aux activités louches, un peu trop attiré par sa ravissante belle-fille et réclamant sans cesse de l'argent, une mère excessive, possessive, fusionnelle... et bigote.
Côté sentimental, pas plus de succès, ses trois mariages seront des échecs cuisants, le second, avec Paul Bern, cadre de la MGM, lui vaudra bien des peines et des douleurs et manquera de ruiner sa carrière en débouchant sur un scandale et des soupçons terribles... Actrice à qui tout réussit, elle ne trouve pas le bonheur tant recherché et qui lui permettrait de couper le cordon avec sa mère.
Enfin, professionnellement, si son engagement avec la MGM va lui apporter la gloire et la célébrité, sa relation avec Louis B. Mayer (l'un des M du sigle) ressemblera plus à de l'esclavage qu'à autre chose... Le producteur sera odieux avec sa star montante et sa conduite à la mort de l'actrice ne le rachètera pas, bien au contraire.
A l'heure où Harvey Weinstein vient de plaider non-coupable des accusations portées contre lui par plusieurs actrices, on lit "Platine" avec un pur dégoût devant le comportement de la plupart des hommes qui vont croiser la route de Jean Harlow. Elle ne fut sans doute pas la première à subir cette oppression de la part des magnats du cinéma, et hélas, elle ne fut pas la dernière...
L'histoire de Jean Harlow, c'est cela : une carrière extraordinaire, un vrai talent d'actrice, une des plus belles femmes de son temps, mais une vie loin d'être heureuse, dont elle n'aura jamais vraiment eu les rênes. On le sait, l'argent, comme la gloire, ne fait pas le bonheur et cette jeune femme en fut la parfaite illustration.
Jusqu'à cette mort absurde, tellement injuste, qui semble pourtant s'inscrire dans la droite ligne de tout ce qu'elle a connu au cours de sa brève existence. Et un effrayant paradoxe : ce corps parfait sur lequel s'est érigée sa renommée et son mythe, est aussi l'instrument de sa perte par ses dysfonctionnements internes.
Foudroyée par la maladie dans des conditions effarantes, presque sauvée, et puis finalement non, elle s'éteint à seulement 26 ans. Une vie à peine entamée, une carrière brisée net et pourtant, un statut de mythe hollywoodien acquis en quelques années... Et l'impression que tout, chez Jean Harlow, allait plus vite que chez le commun des mortels.
Régine Detambel choisit le portrait plutôt que la pure biographie, y compris la biographie romanesque. Elle ne se glisse pas dans la peau du personnage, mais l'observe, la décrypte, raconte cette femme si belle qui ne s'aimait sans doute pas autant qu'on la désirait, menant une impossible quête d'amour sincère et de bonheur simple.
"Tout tourne autour de Jean Harlow, et pourtant Jean Harlow c'est personne", écrit Régine Detambel, qui évoque, pour parler de l'actrice, la figure de l'ange. "Un ange aux cheveux d'or (...) mais en larmes la plupart du temps (...) Un ange quelconque, il est vrai, un ange sans ambition (...) qui veut juste qu'on l'aime".
Elle qui a tant fait fantasmer les hommes n'aura jamais pu jouir de ce corps que lui enviait toutes les femmes. Cette beauté, savamment entretenue par les équipes de maquilleurs des studios, aura été un boulet plus que tout autre chose, l'instrument de sa célébrité, c'est vrai, mais aussi ce qui l'a asservie, entravée... Une véritable souffrance, la chevelure et la peau terriblement abîmées par les cosmétiques.
"Platine" est le deuxième roman de Régine Detambel que je lis après "Son corps extrême", dans lequel, comme son titre l'indique, la question du corps était déjà centrale. Un corps détruit qu'il fallait reconstruire, patiemment, au prix de grande souffrance et de moments de désespoir. Le contexte de "Platine" est très différent, le dénouement également, mais les thèmes sont très proches.
On retrouve également la plume de Régine Detambel, aiguisée, précise, pouvant tirer parfois vers un certain lyrisme. Il est question de beauté et de noirceur, dans "Platine", d'ombres et de lumière, et le style de la romancière s'accorde avec ces variations, ces contrastes. Une histoire reposant sur la dualité, entre la femme et l'actrice, la jeune personne idéaliste et la star façonnée pour briller...
Entre la mère et la fille, enfin... Il y aurait tant de choses à dire sur ce thème, depuis le choix du pseudonyme de Jean Harlow, nom de jeune fille de sa propre mère, jusqu'aux circonstances de son décès, dans lesquelles cette dernière tiendra le plus mauvais des rôles (et ce n'est pas du cinéma). Mère et fille, indissociables, comme sur cette célèbre photo, qui en dit si long...
Baby Jean et Mama Jean, comme elles s'appelaient l'une l'autre... La mère et la petite fille qui n'a finalement jamais vraiment grandi. L'immaturité de Harlean Carpenter, cette même candeur qui a donné tant de charme au personnage de Jean Harlow, voilà sans doute une des causes de ces catastrophes à répétition qui ne pouvaient déboucher que sur une fin tragique.
Bien sûr, ce n'est pas le personnage de Jean Poe, Mama Jean, que l'on suit, mais il est troublant, dérangeant, fascinant aussi. Maternelle, un peu trop, même, et pourtant bien peu digne de confiance, profitant du succès de sa fille, laissant son compagnon se comporter de manière bien inconvenante avec sa fille, elle est la seule vers qui Harlean peut se tourner...
Une mère qui précipitera la mort de sa fille... Terrible situation, qui mettra certainement plus mal à l'aise les lecteurs du roman de Régine Detambel que l'intéressée elle-même : jamais le rôle qu'elle a tenu dans le décès de sa star de fille ne lui occasionnera la moindre culpabilité... Elle entretiendra même le souvenir de cette jeune femme qui aurait dû vivre et devenir une plus grande star encore.
Jean Harlow, c'est le cliché de la ravissante actrice qu'on juge, un peu hâtivement, sotte et creuse. Les critiques éreintèrent ses premières apparitions, avec des mots très durs, d'une grande méchanceté, alors qu'elle-même ne connaissait pas ce sentiment. A sa mort, alors que quelques années avaient passé, elle n'obtenaient plus que des louanges et son jeu retenait autant l'attention que ses cheveux ou ses seins parfaits.
Des "Anges de l'enfer" jusqu'à "Saratoga", film dont elle ne pourra terminer le tournage et pour lequel elle sera remplacée approximativement, Jean Harlow a su dépasser l'emploi dans lequel on aurait voulu sans doute la cantonner et devenir l'une des premières incarnations de l'âge d'or Hollywoodien, à l'avènement du cinéma parlant.
Elle incarne surtout le mythe hollywoodien, dans sa totalité : le succès, la beauté et le sex appeal, mais aussi l'envers du décor, nettement moins gracieux, l'avidité des studios, l'insatiable bruissement des rumeurs, de son vivant comme après sa mort, et l'objet de scandales, sans lesquels une star n'en serait sans doute pas vraiment une.
Régine Detambel, avec cet hommage vibrant, comme si elle-même était sous le charme de la "Platinium Blonde", comme on la surnommait, fera sans doute découvrir ce personnage, pardon, cette femme, à bon nombre de lecteurs. Et leur donnera sans doute l'envie de regarder certains de ses films, qu'on doit facilement trouver sur internet.
Car c'est aussi le propre des mythes hollywoodiens de ne jamais s'éteindre complètement. Il reste leur image imprimée sur la pellicule, l'expression de leur talent, ce charisme particulier qui contribue aussi au statut de star... Mais le mythe est comme le cinéma, une illusion qui fait oublier l'être humain derrière la star, avec son lot de malheurs et des destins peut-être romanesques, mais tragiques...
Elle fut la première blonde incendiaire du cinéma hollywoodien, une chevelure à la couleur platine qui nourrit bien des discussions et des débats : était-ce sa couleur naturelle, avait-elle trouvé la teinture parfaite ou s'agissait-il d'une perruque ? Cette chevelure éclatante est l'un des traits physiques marquants de cette jeune femme née Harlean Carpenter à Kansas City, en 1911, dans un milieu sans rapport avec le cinéma.
Pour être franc, les cheveux de celle qui va faire carrière sous le pseudonyme de Jean Harlow ne sont pas son unique atout. Sa plastique y est aussi pour beaucoup, et en particulier une poitrine qui a fait fantasmer toute l'Amérique au début des années 1930. "Platine" débute d'ailleurs sur une véritable ode aux seins de Jean Harlow...
Mais ne soyez pas si terre à terre : le physique seul de Jean Harlow n'explique pas l'incroyable succès qui va être le sien jusqu'à sa mort prématurée. Découverte par Howard Hugues (elle a d'ailleurs un petit rôle non crédité dans l'adaptation de "Scarface" qu'il produit), elle va enchaîner les succès à partir de 1932 et tourner aux côtés de William Powell et Clark Gable, qui joueront un rôle particulier dans sa vie.
Etait-elle préparée à cette incroyable spirale vers la gloire ? En tout cas, derrière la carrière prolifique, la gloire et les cachets de plus en plus importants, la réalité fut nettement moins reluisante : un beau-père aux activités louches, un peu trop attiré par sa ravissante belle-fille et réclamant sans cesse de l'argent, une mère excessive, possessive, fusionnelle... et bigote.
Côté sentimental, pas plus de succès, ses trois mariages seront des échecs cuisants, le second, avec Paul Bern, cadre de la MGM, lui vaudra bien des peines et des douleurs et manquera de ruiner sa carrière en débouchant sur un scandale et des soupçons terribles... Actrice à qui tout réussit, elle ne trouve pas le bonheur tant recherché et qui lui permettrait de couper le cordon avec sa mère.
Enfin, professionnellement, si son engagement avec la MGM va lui apporter la gloire et la célébrité, sa relation avec Louis B. Mayer (l'un des M du sigle) ressemblera plus à de l'esclavage qu'à autre chose... Le producteur sera odieux avec sa star montante et sa conduite à la mort de l'actrice ne le rachètera pas, bien au contraire.
A l'heure où Harvey Weinstein vient de plaider non-coupable des accusations portées contre lui par plusieurs actrices, on lit "Platine" avec un pur dégoût devant le comportement de la plupart des hommes qui vont croiser la route de Jean Harlow. Elle ne fut sans doute pas la première à subir cette oppression de la part des magnats du cinéma, et hélas, elle ne fut pas la dernière...
L'histoire de Jean Harlow, c'est cela : une carrière extraordinaire, un vrai talent d'actrice, une des plus belles femmes de son temps, mais une vie loin d'être heureuse, dont elle n'aura jamais vraiment eu les rênes. On le sait, l'argent, comme la gloire, ne fait pas le bonheur et cette jeune femme en fut la parfaite illustration.
Jusqu'à cette mort absurde, tellement injuste, qui semble pourtant s'inscrire dans la droite ligne de tout ce qu'elle a connu au cours de sa brève existence. Et un effrayant paradoxe : ce corps parfait sur lequel s'est érigée sa renommée et son mythe, est aussi l'instrument de sa perte par ses dysfonctionnements internes.
Foudroyée par la maladie dans des conditions effarantes, presque sauvée, et puis finalement non, elle s'éteint à seulement 26 ans. Une vie à peine entamée, une carrière brisée net et pourtant, un statut de mythe hollywoodien acquis en quelques années... Et l'impression que tout, chez Jean Harlow, allait plus vite que chez le commun des mortels.
Régine Detambel choisit le portrait plutôt que la pure biographie, y compris la biographie romanesque. Elle ne se glisse pas dans la peau du personnage, mais l'observe, la décrypte, raconte cette femme si belle qui ne s'aimait sans doute pas autant qu'on la désirait, menant une impossible quête d'amour sincère et de bonheur simple.
"Tout tourne autour de Jean Harlow, et pourtant Jean Harlow c'est personne", écrit Régine Detambel, qui évoque, pour parler de l'actrice, la figure de l'ange. "Un ange aux cheveux d'or (...) mais en larmes la plupart du temps (...) Un ange quelconque, il est vrai, un ange sans ambition (...) qui veut juste qu'on l'aime".
Elle qui a tant fait fantasmer les hommes n'aura jamais pu jouir de ce corps que lui enviait toutes les femmes. Cette beauté, savamment entretenue par les équipes de maquilleurs des studios, aura été un boulet plus que tout autre chose, l'instrument de sa célébrité, c'est vrai, mais aussi ce qui l'a asservie, entravée... Une véritable souffrance, la chevelure et la peau terriblement abîmées par les cosmétiques.
"Platine" est le deuxième roman de Régine Detambel que je lis après "Son corps extrême", dans lequel, comme son titre l'indique, la question du corps était déjà centrale. Un corps détruit qu'il fallait reconstruire, patiemment, au prix de grande souffrance et de moments de désespoir. Le contexte de "Platine" est très différent, le dénouement également, mais les thèmes sont très proches.
On retrouve également la plume de Régine Detambel, aiguisée, précise, pouvant tirer parfois vers un certain lyrisme. Il est question de beauté et de noirceur, dans "Platine", d'ombres et de lumière, et le style de la romancière s'accorde avec ces variations, ces contrastes. Une histoire reposant sur la dualité, entre la femme et l'actrice, la jeune personne idéaliste et la star façonnée pour briller...
Entre la mère et la fille, enfin... Il y aurait tant de choses à dire sur ce thème, depuis le choix du pseudonyme de Jean Harlow, nom de jeune fille de sa propre mère, jusqu'aux circonstances de son décès, dans lesquelles cette dernière tiendra le plus mauvais des rôles (et ce n'est pas du cinéma). Mère et fille, indissociables, comme sur cette célèbre photo, qui en dit si long...
Baby Jean et Mama Jean, comme elles s'appelaient l'une l'autre... La mère et la petite fille qui n'a finalement jamais vraiment grandi. L'immaturité de Harlean Carpenter, cette même candeur qui a donné tant de charme au personnage de Jean Harlow, voilà sans doute une des causes de ces catastrophes à répétition qui ne pouvaient déboucher que sur une fin tragique.
Bien sûr, ce n'est pas le personnage de Jean Poe, Mama Jean, que l'on suit, mais il est troublant, dérangeant, fascinant aussi. Maternelle, un peu trop, même, et pourtant bien peu digne de confiance, profitant du succès de sa fille, laissant son compagnon se comporter de manière bien inconvenante avec sa fille, elle est la seule vers qui Harlean peut se tourner...
Une mère qui précipitera la mort de sa fille... Terrible situation, qui mettra certainement plus mal à l'aise les lecteurs du roman de Régine Detambel que l'intéressée elle-même : jamais le rôle qu'elle a tenu dans le décès de sa star de fille ne lui occasionnera la moindre culpabilité... Elle entretiendra même le souvenir de cette jeune femme qui aurait dû vivre et devenir une plus grande star encore.
Jean Harlow, c'est le cliché de la ravissante actrice qu'on juge, un peu hâtivement, sotte et creuse. Les critiques éreintèrent ses premières apparitions, avec des mots très durs, d'une grande méchanceté, alors qu'elle-même ne connaissait pas ce sentiment. A sa mort, alors que quelques années avaient passé, elle n'obtenaient plus que des louanges et son jeu retenait autant l'attention que ses cheveux ou ses seins parfaits.
Des "Anges de l'enfer" jusqu'à "Saratoga", film dont elle ne pourra terminer le tournage et pour lequel elle sera remplacée approximativement, Jean Harlow a su dépasser l'emploi dans lequel on aurait voulu sans doute la cantonner et devenir l'une des premières incarnations de l'âge d'or Hollywoodien, à l'avènement du cinéma parlant.
Elle incarne surtout le mythe hollywoodien, dans sa totalité : le succès, la beauté et le sex appeal, mais aussi l'envers du décor, nettement moins gracieux, l'avidité des studios, l'insatiable bruissement des rumeurs, de son vivant comme après sa mort, et l'objet de scandales, sans lesquels une star n'en serait sans doute pas vraiment une.
Régine Detambel, avec cet hommage vibrant, comme si elle-même était sous le charme de la "Platinium Blonde", comme on la surnommait, fera sans doute découvrir ce personnage, pardon, cette femme, à bon nombre de lecteurs. Et leur donnera sans doute l'envie de regarder certains de ses films, qu'on doit facilement trouver sur internet.
Car c'est aussi le propre des mythes hollywoodiens de ne jamais s'éteindre complètement. Il reste leur image imprimée sur la pellicule, l'expression de leur talent, ce charisme particulier qui contribue aussi au statut de star... Mais le mythe est comme le cinéma, une illusion qui fait oublier l'être humain derrière la star, avec son lot de malheurs et des destins peut-être romanesques, mais tragiques...
dimanche 10 juin 2018
"Pour Tony, la seule chose qui distinguait un policier d'un gangster, c'était l'insigne du premier".
J'ai profité de la réédition d'un classique dont le titre parle à tout le monde pour me jeter dessus. Comme souvent, avec des romans qui ont marqué leur époque et sont considérés comme des précurseurs, il faut s'y plonger en n'oubliant pas que ce qui pourrait nous paraître sans grande originalité était alors d'une grande force. Deux films restés dans l'histoire du cinéma ont été inspirés par ce roman, le second adapté très librement, mais le personnage principal, inspiré par Al Capone en personne, a su traverser le XXe siècle. Eh oui, peut-être l'ignoriez-vous, mais avant que Howard Hawks et Brian de Palma le fassent vivre à l'écran, Scarface était un personnage de roman... "Scarface" est le deuxième et dernier roman d'Armitage Trail et il vient de reparaître en poche aux éditions Rivages (traduction de Frank Reichert), avec une nouvelle couverture qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'affiche du film qu'en a tiré Brian de Palma. L'occasion pour les lecteurs actuels de redécouvrir ce livre considéré comme l'un des tout premiers chefs d'oeuvre de ce qu'on appelle aux Etats-Unis le "hardboiled"...
Très jeune Tony Guarino a choisi de ne pas suivre le droit chemin. Contrairement à son frère, qui a décidé de devenir policier, lui va embrasser une carrière de hors-la-loi. Et il le fait par un coup d'éclat : défier le chef d'un des pus redoutables gangs de Chicago, Al Spingola, pour lui prendre sa maîtresse, Vyvyan Lovejoy.
Par la violence, il entre de plain-pied dans le monde des gangsters et rejoins un clan irlandais pour lequel il pratique le racket. La vie est belle, l'argent coule à flots, Vyvyan vient s'installer chez lui... Mais, bientôt, le clan Spingola décide de se venger et Tony se retrouve dans la ligne de mire. Sans oublier les flics, qui aimeraient bien faire tomber quelques gangsters réputés...
Alors, il décide de disparaître un moment, le temps de se faire oublier. Et il trouve un moyen parfait pour cela : les Etats-Unis viennent d'entrer en guerre en Europe, direction les tranchées ! Quoi de mieux que la violence légitime d'une guerre pour assouvir des penchants et perfectionner son art de tuer ?
A son retour au pays, Tony est un héros, décoré pour avoir tué. Mais il n'est plus le même homme, non plus. Plus dur, sans doute, un véritable tueur sans état d'âme prêt à reprendre sa vie où il l'a laissé. Mais, celui qui revient est aussi méconnaissable : une blessure lui a laissé une sévère balafre sur le côté du visage, au point qu'on ne le reconnaît plus...
A Chicago aussi, les choses ont bien changé. En l'absence de Tony, les rapports de force ont évolué et ce qui faisait sa vie d'avant a, comme lui, disparu. Alors, Tony décide de faire table rase et de redémarrer sa vie à zéro : il devient Antonio Camonte, rapidement surnommé Tony le Balafré, et entame une nouvelle carrière en même temps qu'une nouvelle vie.
Seule son ambition reste la même, peut-être même a-t-elle gagné en ampleur. Il ne veut plus seulement réussir, il veut le pouvoir... Dans un premier temps, il offre ses services à Johnny Lovo, un des chefs de gang les plus puissants de la ville. Plus puissant encore depuis que la Prohibition est entrée en vigueur et que les gangs font leur beurre en trafiquant l'alcool...
Il fait vite ses preuves, avec une férocité glaçante, et grimpe rapidement les échelons. Mais, ses actions coups de poing vont mettre le feu aux poudres et déclencher une véritable guerre des gangs, sans aucune limite. L'ascension de Tony le Balafré ne fait que commencer, et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin...
La première chose, c'est l'extrême violence de ce roman. Oh, bien sûr, en 2018, on en a vu d'autres, dans les romans, à la télévision, au cinéma... La violence, réelle ou fictive, fait partie de nos vies quotidiennes, et même d'une certaine routine. En revanche, lorsque "Scarface" sort, en 1930, je ne suis pas certains que les lecteurs soient vraiment habitués à une telle succession de fusillades.
Il y a très peu de temps morts dans le roman de Trail Armitage, à chaque chapitre, il faut affirmer sa force, soit pour monter dans l'échelle sociale des gangs, soit pour rester au sommet. La loi du plus fort, du plus audacieux, aussi, devient la règle d'or, et à ce petit jeu, Tony assure, lancé dans une course folle, comme si, à chaque instant, ce pouvait être la fin.
Mais, attention ! Tony reste un personnage réglo, fidèle à sa parole, appliquant un code de l'honneur certes très personnel, mais qui ne varie pas d'un pouce quelles que soient les circonstances. Intransigeant, mais juste, voilà l'image que Tony veut imposer. Un chef, un vrai, sans état d'âme, mais sachant se montrer magnanime et même généreux, autant qu'il sait être impitoyable.
J'ai vu le "Sacrface" de Brian de Palma il y a longtemps, déjà. Je me souviens d'un contexte très différent, puisque son Tony (en fait créé par le scénariste, Oliver Stone) est un émigré cubain qui construit sa puissance sur le trafic de cocaïne, une substance dont il use et abuse lui-même. Rien à voir, a priori, avec le Tony de Trail Armitage, et pourtant des liens apparaissent.
Bien sûr, le caractère très violent du personnage, que rien n'impressionne et qui résout ses problèmes avec de très efficaces traitements au plomb... Tony Camonte est tout aussi orgueilleux et sûr de lui que Tony Montana, mais sans doute bien moins mégalo. Cela ne veut pas dire qu'il ne s'affiche pas, au contraire, mais avec un sens du tape-à-l'oeil un peu moins poussé...
En fait, ce que j'ai retrouvé chez les deux personnages, c'est la même impression de solitude et de fatalisme. La solitude, parce que gangster est un "métier" difficile, et plus on se situe haut dans la hiérarchie, moins on peut faire confiance à ceux qui vous entoure. On n'est jamais seul, en fait, mais c'est tout comme, car derrière chaque proche, il y a peut-être un traître.
Tony Camonte est dans cette position, lui qui a toujours été réglo. Que ce soit avant ou après la guerre, à chaque fois, il a gagné ses galons sans trahir quiconque, en agissant bien en face, sur ses simples... compétences. On pourrait dire que ses méthodes sont particulières et ont mis Chicago à feu et à sang pour servir ses intérêts. C'est vrai, mais il assume totalement.
La solitude, c'est celle du pouvoir, ensuite. Sur son Olympe, on ne peut habiter que seul. Et même si les proches ne trahissent pas, il suffit de savoir qu'ils pourraient en arriver là pour ne ressentir que méfiance à leur égard. Tout au long de la deuxième partie, on ressent cela, même les plus proches de Tony, à tort ou à raison, suscitent le doute et le poussent à s'isoler de plus en plus.
Et puis, le fatalisme. Tony n'est pas cynique, il est simplement réaliste. Il sait qu'un jour sa bonne étoile pâlira, qu'un piège se refermera sur lui, qu'on l'abandonnera pour un plus ambitieux que lui, que la chute se produira, sans espoir de se relever et que ce jour se rapproche inexorablement. En attendant, il fait tout pour être l'homme le plus puissant de la ville et renforcer ce pouvoir.
Il y a là une sorte de défi, un bras d'honneur lancé au destin de la part d'un fils d'immigré italien, né dans une famille pauvre et au sein d'une fratrie nombreuse. Voué à la pauvreté ou à une triste vie bien rangée, comme son frère policier, il a choisi d'envoyer tout cela aux orties pour croquer la vie à pleines dents, durant le temps qu'on voudra bien lui laisser.
Et comme l'orgueil est un de ses moteurs, alors son ultime pied-de-nez sera de choisir le moment et le contexte de cette chute. Les épreuves qui jalonnent le roman lui donnent l'occasion de montrer sa ténacité, son courage, sa chance, aussi, mais lorsqu'on est chef de gang à Chicago dans les années 1920, on a plus d'ennemis qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel...
"Scarface" est un roman qui va vite, pas aussi survolté que le film de De Palma (mais l'absence de cocaïne explique peut-être cela), multipliant les scènes d'action, faisant de Tony un héros capable de se sortir de toutes les situations. On ressent l'influence du pulp, où Trail Armitage a fait ses preuves en y publiant des nouvelles.
Peu importe la vraisemblance, ce qui compte, c'est l'adrénaline, la tension et, d'une certaine façon, l'héroïsme de ce gangster atypique, un tueur, certes, il le revendique même sans remords, mais agissant malgré tout avec un certain panache (j'ai failli écrire une certaine noblesse, mais il ne faut peut-être pas exagérer).
Il est fascinant, cet homme qui semble être immortel ou posséder plus de vies qu'une meute de chats. Lui seul sait qu'il finira par tomber, parce que c'est le destin des hommes dans son genre. Ils sont comme Icare, ils finissent par approcher trop près du soleil et par s'y brûler les ailes. Légende de leur vivant, ils deviennent alors des mythes...
Laissons le contenu du roman, parlons du livre et de son auteur. Trail Armitage était l'un des pseudonymes choisis par Maurice Coonts. A 16 ans, il quitte l'école avec l'ambition de devenir écrivain et publie donc des nouvelles dans des pulps, parfois tous les textes d'un numéro, mais en les signant de différents noms.
En 1929, il a 27 ans quand paraît son premier roman, "The 13th guest", qui reste apparemment inédit en français, et connaît le succès l'année suivante avec "Scarface". On dit qu'il s'est inspiré du parcours d'Al Capone en personne pour créer son personnage, ce qui n'est pas tout à fait vrai, et cela valait sans doute mieux, car le gangster, que Trail n'a jamais rencontré, a semble-t-il peu goûté le portrait fait de lui dans le film de Howard Hawks...
Ce n'est donc pas un portrait du plus fameux des gangsters de Chicago, en revanche, c'est apparemment, une formidable photographie de ce qu'était la vie dans cette ville au temps de la Prohibition et des gangs rois. Trail, qui a vécu à Chicago, a enquête longuement sur ces questions avant d'écrire "Scarface" et a su retranscrire sur le papier cette époque avec réalisme.
Trail n'aura pas le temps de profiter de ce succès naissant. Appelé à New York pour y écrire pour le théâtre, puis à Hollywood, il meurt à l'automne 1930 d'une crise cardiaque... Etoile filante de la littérature noire, il fait partie de ceux qui ont contribué à poser les codes d'un genre devenu par la suite très fameux, le "hardboiled", dans lequel s'illustreront Dashell Hammett, Raymond Chandler ou Chester Himes, par exemple.
Littéralement, on pourrait traduire "hardboiled" par dur à cuire, mais on n'a pas vraiment d'équivalent français pour ce genre littéraire. Le plus proche, c'est sans doute le roman noir, pourtant bien loin de couvrir toutes les spécificités de ce type de romans, véritable pendant américain à notre littérature populaire, que le hardboiled contribuera à révolutionner au lendemain de la IIe Guerre Mondiale.
Ainsi, retrouve-t-on dans "Scarface" la violence très cru, mais aussi le personnage, bientôt sublimé par Hollywood, de la femme fatale. Il n'y a pas de détective privé, usé, blasé et cynique, dans le roman d'Armitage Trail, cet archétype s'imposera par la suite, mais c'est aussi à remarquer : c'est avec un "méchant" que le romancier va signer un roman appelé à devenir culte.
Dernier détail amusant : lorsque les deux Howard, Hugues, le producteur, et Hawks, le réalisateur, ont lancé l'idée d'adapter Scarface au cinéma, leur premier choix pour incarner Tony s'est porté sur Edward G. Robinson, précisément pour sa ressemblance avec Capone. Mais, à Hollywood, ou on a eu un peu peur de la réaction du mafieux, ou on a pensé autrement...
C'est donc finalement Paul Muni, acteur aux allures de jeune premier, qui décroche le rôle-titre de "Scarface", ce qui n'empêchera pas Ben Hecht, qui adapta le roman pour le grand écran, de recevoir la visite des sbires du vrai balafré... Quant à Edward G. Robinson, il obtiendra le premier rôle dans "Little Caesar", autre film de gangster culte, également adapté d'un roman... Etonnant, non ?
Allez, peu importe tout cela, reste un livre, un pur livre de gangster comme on n'en lit plus beaucoup de nos jours, violent et mouvementé, porté par un personnage flamboyant et vénéneux, brillant et lancé dans une époustouflante fuite en avant, jalonné de scènes magnifiques qui inspireront bien d'autres romanciers et cinéastes par la suite.
Bien sûr, près de 90 ans après sa publication, on pourra trouver que tout cela a un peu vieilli, mais finalement, pas tant que cela. Avec ses 220 pages, il se lit quasiment d'une traite, jusqu'à un dénouement magnifique, bouleversant, mais qui fait de Tony le Balafré un personnage hors norme, un antihéros plein de panache, pour reprendre ce mot.
Très jeune Tony Guarino a choisi de ne pas suivre le droit chemin. Contrairement à son frère, qui a décidé de devenir policier, lui va embrasser une carrière de hors-la-loi. Et il le fait par un coup d'éclat : défier le chef d'un des pus redoutables gangs de Chicago, Al Spingola, pour lui prendre sa maîtresse, Vyvyan Lovejoy.
Par la violence, il entre de plain-pied dans le monde des gangsters et rejoins un clan irlandais pour lequel il pratique le racket. La vie est belle, l'argent coule à flots, Vyvyan vient s'installer chez lui... Mais, bientôt, le clan Spingola décide de se venger et Tony se retrouve dans la ligne de mire. Sans oublier les flics, qui aimeraient bien faire tomber quelques gangsters réputés...
Alors, il décide de disparaître un moment, le temps de se faire oublier. Et il trouve un moyen parfait pour cela : les Etats-Unis viennent d'entrer en guerre en Europe, direction les tranchées ! Quoi de mieux que la violence légitime d'une guerre pour assouvir des penchants et perfectionner son art de tuer ?
A son retour au pays, Tony est un héros, décoré pour avoir tué. Mais il n'est plus le même homme, non plus. Plus dur, sans doute, un véritable tueur sans état d'âme prêt à reprendre sa vie où il l'a laissé. Mais, celui qui revient est aussi méconnaissable : une blessure lui a laissé une sévère balafre sur le côté du visage, au point qu'on ne le reconnaît plus...
A Chicago aussi, les choses ont bien changé. En l'absence de Tony, les rapports de force ont évolué et ce qui faisait sa vie d'avant a, comme lui, disparu. Alors, Tony décide de faire table rase et de redémarrer sa vie à zéro : il devient Antonio Camonte, rapidement surnommé Tony le Balafré, et entame une nouvelle carrière en même temps qu'une nouvelle vie.
Seule son ambition reste la même, peut-être même a-t-elle gagné en ampleur. Il ne veut plus seulement réussir, il veut le pouvoir... Dans un premier temps, il offre ses services à Johnny Lovo, un des chefs de gang les plus puissants de la ville. Plus puissant encore depuis que la Prohibition est entrée en vigueur et que les gangs font leur beurre en trafiquant l'alcool...
Il fait vite ses preuves, avec une férocité glaçante, et grimpe rapidement les échelons. Mais, ses actions coups de poing vont mettre le feu aux poudres et déclencher une véritable guerre des gangs, sans aucune limite. L'ascension de Tony le Balafré ne fait que commencer, et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin...
La première chose, c'est l'extrême violence de ce roman. Oh, bien sûr, en 2018, on en a vu d'autres, dans les romans, à la télévision, au cinéma... La violence, réelle ou fictive, fait partie de nos vies quotidiennes, et même d'une certaine routine. En revanche, lorsque "Scarface" sort, en 1930, je ne suis pas certains que les lecteurs soient vraiment habitués à une telle succession de fusillades.
Il y a très peu de temps morts dans le roman de Trail Armitage, à chaque chapitre, il faut affirmer sa force, soit pour monter dans l'échelle sociale des gangs, soit pour rester au sommet. La loi du plus fort, du plus audacieux, aussi, devient la règle d'or, et à ce petit jeu, Tony assure, lancé dans une course folle, comme si, à chaque instant, ce pouvait être la fin.
Mais, attention ! Tony reste un personnage réglo, fidèle à sa parole, appliquant un code de l'honneur certes très personnel, mais qui ne varie pas d'un pouce quelles que soient les circonstances. Intransigeant, mais juste, voilà l'image que Tony veut imposer. Un chef, un vrai, sans état d'âme, mais sachant se montrer magnanime et même généreux, autant qu'il sait être impitoyable.
J'ai vu le "Sacrface" de Brian de Palma il y a longtemps, déjà. Je me souviens d'un contexte très différent, puisque son Tony (en fait créé par le scénariste, Oliver Stone) est un émigré cubain qui construit sa puissance sur le trafic de cocaïne, une substance dont il use et abuse lui-même. Rien à voir, a priori, avec le Tony de Trail Armitage, et pourtant des liens apparaissent.
Bien sûr, le caractère très violent du personnage, que rien n'impressionne et qui résout ses problèmes avec de très efficaces traitements au plomb... Tony Camonte est tout aussi orgueilleux et sûr de lui que Tony Montana, mais sans doute bien moins mégalo. Cela ne veut pas dire qu'il ne s'affiche pas, au contraire, mais avec un sens du tape-à-l'oeil un peu moins poussé...
En fait, ce que j'ai retrouvé chez les deux personnages, c'est la même impression de solitude et de fatalisme. La solitude, parce que gangster est un "métier" difficile, et plus on se situe haut dans la hiérarchie, moins on peut faire confiance à ceux qui vous entoure. On n'est jamais seul, en fait, mais c'est tout comme, car derrière chaque proche, il y a peut-être un traître.
Tony Camonte est dans cette position, lui qui a toujours été réglo. Que ce soit avant ou après la guerre, à chaque fois, il a gagné ses galons sans trahir quiconque, en agissant bien en face, sur ses simples... compétences. On pourrait dire que ses méthodes sont particulières et ont mis Chicago à feu et à sang pour servir ses intérêts. C'est vrai, mais il assume totalement.
La solitude, c'est celle du pouvoir, ensuite. Sur son Olympe, on ne peut habiter que seul. Et même si les proches ne trahissent pas, il suffit de savoir qu'ils pourraient en arriver là pour ne ressentir que méfiance à leur égard. Tout au long de la deuxième partie, on ressent cela, même les plus proches de Tony, à tort ou à raison, suscitent le doute et le poussent à s'isoler de plus en plus.
Et puis, le fatalisme. Tony n'est pas cynique, il est simplement réaliste. Il sait qu'un jour sa bonne étoile pâlira, qu'un piège se refermera sur lui, qu'on l'abandonnera pour un plus ambitieux que lui, que la chute se produira, sans espoir de se relever et que ce jour se rapproche inexorablement. En attendant, il fait tout pour être l'homme le plus puissant de la ville et renforcer ce pouvoir.
Il y a là une sorte de défi, un bras d'honneur lancé au destin de la part d'un fils d'immigré italien, né dans une famille pauvre et au sein d'une fratrie nombreuse. Voué à la pauvreté ou à une triste vie bien rangée, comme son frère policier, il a choisi d'envoyer tout cela aux orties pour croquer la vie à pleines dents, durant le temps qu'on voudra bien lui laisser.
Et comme l'orgueil est un de ses moteurs, alors son ultime pied-de-nez sera de choisir le moment et le contexte de cette chute. Les épreuves qui jalonnent le roman lui donnent l'occasion de montrer sa ténacité, son courage, sa chance, aussi, mais lorsqu'on est chef de gang à Chicago dans les années 1920, on a plus d'ennemis qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel...
"Scarface" est un roman qui va vite, pas aussi survolté que le film de De Palma (mais l'absence de cocaïne explique peut-être cela), multipliant les scènes d'action, faisant de Tony un héros capable de se sortir de toutes les situations. On ressent l'influence du pulp, où Trail Armitage a fait ses preuves en y publiant des nouvelles.
Peu importe la vraisemblance, ce qui compte, c'est l'adrénaline, la tension et, d'une certaine façon, l'héroïsme de ce gangster atypique, un tueur, certes, il le revendique même sans remords, mais agissant malgré tout avec un certain panache (j'ai failli écrire une certaine noblesse, mais il ne faut peut-être pas exagérer).
Il est fascinant, cet homme qui semble être immortel ou posséder plus de vies qu'une meute de chats. Lui seul sait qu'il finira par tomber, parce que c'est le destin des hommes dans son genre. Ils sont comme Icare, ils finissent par approcher trop près du soleil et par s'y brûler les ailes. Légende de leur vivant, ils deviennent alors des mythes...
Laissons le contenu du roman, parlons du livre et de son auteur. Trail Armitage était l'un des pseudonymes choisis par Maurice Coonts. A 16 ans, il quitte l'école avec l'ambition de devenir écrivain et publie donc des nouvelles dans des pulps, parfois tous les textes d'un numéro, mais en les signant de différents noms.
En 1929, il a 27 ans quand paraît son premier roman, "The 13th guest", qui reste apparemment inédit en français, et connaît le succès l'année suivante avec "Scarface". On dit qu'il s'est inspiré du parcours d'Al Capone en personne pour créer son personnage, ce qui n'est pas tout à fait vrai, et cela valait sans doute mieux, car le gangster, que Trail n'a jamais rencontré, a semble-t-il peu goûté le portrait fait de lui dans le film de Howard Hawks...
Ce n'est donc pas un portrait du plus fameux des gangsters de Chicago, en revanche, c'est apparemment, une formidable photographie de ce qu'était la vie dans cette ville au temps de la Prohibition et des gangs rois. Trail, qui a vécu à Chicago, a enquête longuement sur ces questions avant d'écrire "Scarface" et a su retranscrire sur le papier cette époque avec réalisme.
Trail n'aura pas le temps de profiter de ce succès naissant. Appelé à New York pour y écrire pour le théâtre, puis à Hollywood, il meurt à l'automne 1930 d'une crise cardiaque... Etoile filante de la littérature noire, il fait partie de ceux qui ont contribué à poser les codes d'un genre devenu par la suite très fameux, le "hardboiled", dans lequel s'illustreront Dashell Hammett, Raymond Chandler ou Chester Himes, par exemple.
Littéralement, on pourrait traduire "hardboiled" par dur à cuire, mais on n'a pas vraiment d'équivalent français pour ce genre littéraire. Le plus proche, c'est sans doute le roman noir, pourtant bien loin de couvrir toutes les spécificités de ce type de romans, véritable pendant américain à notre littérature populaire, que le hardboiled contribuera à révolutionner au lendemain de la IIe Guerre Mondiale.
Ainsi, retrouve-t-on dans "Scarface" la violence très cru, mais aussi le personnage, bientôt sublimé par Hollywood, de la femme fatale. Il n'y a pas de détective privé, usé, blasé et cynique, dans le roman d'Armitage Trail, cet archétype s'imposera par la suite, mais c'est aussi à remarquer : c'est avec un "méchant" que le romancier va signer un roman appelé à devenir culte.
Dernier détail amusant : lorsque les deux Howard, Hugues, le producteur, et Hawks, le réalisateur, ont lancé l'idée d'adapter Scarface au cinéma, leur premier choix pour incarner Tony s'est porté sur Edward G. Robinson, précisément pour sa ressemblance avec Capone. Mais, à Hollywood, ou on a eu un peu peur de la réaction du mafieux, ou on a pensé autrement...
C'est donc finalement Paul Muni, acteur aux allures de jeune premier, qui décroche le rôle-titre de "Scarface", ce qui n'empêchera pas Ben Hecht, qui adapta le roman pour le grand écran, de recevoir la visite des sbires du vrai balafré... Quant à Edward G. Robinson, il obtiendra le premier rôle dans "Little Caesar", autre film de gangster culte, également adapté d'un roman... Etonnant, non ?
Allez, peu importe tout cela, reste un livre, un pur livre de gangster comme on n'en lit plus beaucoup de nos jours, violent et mouvementé, porté par un personnage flamboyant et vénéneux, brillant et lancé dans une époustouflante fuite en avant, jalonné de scènes magnifiques qui inspireront bien d'autres romanciers et cinéastes par la suite.
Bien sûr, près de 90 ans après sa publication, on pourra trouver que tout cela a un peu vieilli, mais finalement, pas tant que cela. Avec ses 220 pages, il se lit quasiment d'une traite, jusqu'à un dénouement magnifique, bouleversant, mais qui fait de Tony le Balafré un personnage hors norme, un antihéros plein de panache, pour reprendre ce mot.
Inscription à :
Articles (Atom)