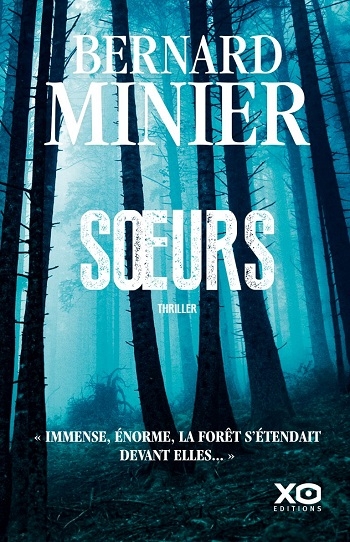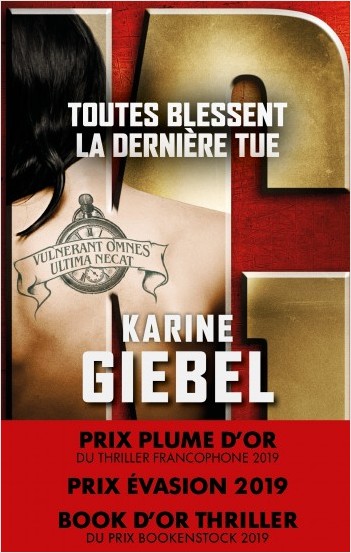Si vous cherchez notre livre du jour dans les rayons d'une librairie, vous devriez apercevoir d'abord un bandeau éclatant avec en grosses lettres noires la mention "Par le créateur de la série Fargo". Pour être franc, je n'avais pas fait le lien entre l'auteur et cette excellente série (qui devrait avoir une quatrième saison, d'ailleurs) au moment où j'ai eu envie de lire ce roman. Non, c'est l'histoire qui a éveillé ma curiosité avant toute autre chose et je n'ai qu'à me réjouir de ce choix. "Le Bon père", de Noah Hawley (vous savez, le créateur de la série "Fargo", mais aussi d'une autre série "Légion", tiens), vient de reparaître en poche chez Folio (traduction de Clément Baude), quelques années après sa première édition à la Série Noire. Un pur roman noir, comme les auteurs américains savent si bien nous en proposer, sombre, douloureux, et traitant de sujets très forts, la relation entre un père et son fils et la longue litanie des meurtriers ayant marqué la jeune histoire des Etats-Unis, qu'il s'agisse de tueurs de masse ou d'assassins ayant pris pour cible des personnalités marquantes. L'histoire d'un deuil, celui d'une paternité, d'une partie de vie...
Paul Allen est médecin. Rhumatologue et diagnosticien (on vient le consulter en dernier ressort, quand on n'arrive pas cerner le mal qui touche le patient ; une espèce de Dr House en plus sympa, quoi), il consulte dans un hôpital new-yorkais et enseigne à la prestigieuse université de Columbia. Une belle carrière qui permet une vie aisée.
Avec son épouse et ses deux enfants, des jumeaux d'une dizaine d'années, Paul Allen vit dans la jolie petite ville de Westport, Connecticut, porte de beaux costumes, profite de belles vacances, mène un train de vie confortable. Une vie de famille harmonieuse, parfait complément d'une carrière professionnelle réussie. Jusqu'à ce soir-là...
Un soir de juin, alors que la famille prépare son traditionnel menu du jeudi, des pizzas faites maison, le jeu télévisé qui passe en sourdine à la télé est brusquement interrompu. Affairés, Paul et son épouse, Fran, n'y prêtent pas vraiment attention. Pourtant, ce qui se passe à l'écran va bouleverser leur vie, et plus particulièrement celle de Paul...
Le flash spécial annonce une nouvelle terrible : lors du meeting que tenait le sénateur Jay Seagram dans les bâtiments de l'université de Californie, à Los Angeles, un homme a sorti une arme et tiré sur celui qui allait être investi par le Parti Démocrate pour la prochaine élection présidentielle et en serait le favori logique.
Jay Seagram, c'est une sorte de JFK en moins sulfureux. Un candidat réputé pour sa conscience sociale, son sens de l'intérêt public, sa détermination à aborder frontalement les sujets de société les plus délicats, sans se laisser impressionner par les lobbys. Un homme que beaucoup imaginent déjà comme un très grand président.
Le choc est réel dans tout le pays, et chez les Allen comme ailleurs. Mais, à Westport, Paul et Fran ne sont que spectateurs de cet événement dramatique. Quand on frappe à leur porte... Sur le seuil, des agents du FBI qui veulent voir Paul Allen séance tenante. Incrédule, le médecin se demande ce qu'on lui veut. C'est Fran qui lui apprend la consternante nouvelle...
L'homme qui a tiré s'appelle Daniel ; c'est le fils de Paul Allen...
Avant de rencontrer Fran et de l'épouser, Paul avait été marié, en Californie. Un amour de jeunesse, une grossesse pas vraiment prévue, un mariage qui flanche rapidement... Lorsqu'il s'est séparé de sa première femme, Paul est parti sur la côte Est, laissant Daniel aux bons soins de sa mère, un peu dépassée par les événements et peinant à se remettre de la rupture.
Trois ans plus tôt, Daniel était venu vivre avec Paul, dans cette nouvelle famille que ce dernier avait construit. Puis, au bout d'une année, il était reparti chez sa mère. Ensuite, il avait choisi d'étudier à Vassar, une université de l'Etat de New York, qu'il avait abandonnée au bout de six mois pour se lancer dans une période d'errance dont Paul ne savait pas grand-chose.
Et voilà qu'il le retrouvait par écrans interposés, devenu le sujet de toutes les conversations, de tous les débats, de toutes les supputations... Les images sont là, certes, elles ne sont pas d'une clarté absolu, panique oblige, mais tout semble montrer que c'est bien son fils qui a tiré à trois reprises sur le sénateur Seagram...
Paul Allen ne peut croire à cette évidence : pour lui, son fils ne peut avoir commis cet acte. Il ne peut être ce tueur froid qui a abattu l'homme le plus populaire du pays sans sourciller. Et il décide de se battre pour lui, de l'aider à montrer qu'il n'est pas coupable, ou du moins, qu'il n'a pas agi seul, qu'il n'est que le rouage d'un complot, qu'il a été manipulé...
Mais, rapidement, il se rend compte qu'il ignore presque tout de ce fils (dont il découvre qu'il a même changé de nom au cours de son errance) avec qui il a vécu très peu de temps et avec qui il n'a plus eu de véritable contact depuis un bon moment. Et si le vrai responsable de ce drame, c'était lui, ce père absent, parti fonder une autre famille à l'autre bout du pays, et si ce geste lui était adressé ?
"Le Bon père" est la traduction littérale du titre original, "The Good father", et donne une idée très précise de ce qu'est ce roman, centré sur la personne de ce père désemparé face aux actes de ce fils devenu quasiment un étranger. La culpabilité profonde de Paul Allen occupe une grande partie du récit et, d'une certaine façon, on suit le médecin affrontant les étapes du deuil, un deuil annoncé.
Ce deuil, c'est celui de Daniel, bien sûr, qui encourt la peine de mort. C'est surtout le deuil de cette première paternité, de cette première partie de vie, de l'homme qu'il est devenu, aussi. Alors, Paul va se lancer dans des démarches désespérées pour prouver l'innocence de son fils, atténuer sa responsabilité, prouver qu'il y a eu un malentendu ou une conspiration...
Tout pour ne pas accepter l'inacceptable : la culpabilité de ce garçon, de son garçon. Et, pour y parvenir, il doit reconstituer la vie de Daniel, ces derniers mois où il était devenu une espèce de hobo, voyageant à travers les Etats-Unis sans véritable but, faisant étape quelques mois, vivant de petits boulots puis allant se poser ailleurs...
Mais, il ne va pas s'arrêter à ces derniers mois, il va reconsidérer entièrement l'existence de son fils, cette vingtaine d'années qu'il n'a pas vu passer, où il n'a peut-être pas prêté suffisamment attention à certains signes. Déboussolé, Paul ne sait plus, ne comprend plus et s'en veut. S'en veut tellement, au point de fragiliser sa famille, de s'éloigner de sa femme et de ses jumeaux... Effroyable dilemme...
Père et fils... Il y a cette phrase terrible de Daniel, découverte par Paul, "Je suis l'ombre de fils", qui vient lézarder un peu plus le coeur d'un père plus coupable que jamais. En miroir, on croise dans le livre une autre citation, qui ne concerne pas les personnages du roman, mais fait un écho sinistre avec la situation : "Il y aura toujours un père".
Père et fils... Indissociable. Sans le premier, le second n'existe pas (c'est presque un pléonasme, mais allons au-delà des évidences biologiques, s'il vous plaît). Sans le second, le premier est un homme totalement différent. Et, dans le même temps, un fils peut aussi bien être le reflet du père que son négatif, porté par une volonté de révolte.
Une précision d'importance : ce n'est pas un hasard si j'ai parlé de roman noir pour qualifier "le Bon père". Noah Hawley joue avec une certaine ambiguïté au début du livre : d'autres auteurs, un Morrell, un Grisham, un Baldacci, auraient pu traiter le même sujet sous un angle de thriller conspirationniste, avec une enquête pleine de rebondissements, un mystérieux ennemi dérangé et qui réagit violemment.
Ce n'est pas du tout la voie que Noah Hawley a choisi d'emprunter. Il se concentre vraiment sur le personnage du père, comme l'indique le titre, sur le choc qu'il doit affronter, les décisions qu'il prend, mais aussi les conséquences de cet acte, car c'est toute la vie des Allen qui va en être affectée, faisant de Paul un pestiféré, quelqu'un qu'on évite désormais...
Pour le lecteur, ce chemin de croix passera par un deuxième fil narratif, le long voyage de Danny depuis Vassar jusqu'à Los Angeles, ses rencontres, ses découvertes, ses jobs... On découvre ces derniers moi, petit à petit, racontés à la troisième personne, contrairement à la partie du récit mettant en scène Paul, comme si c'est ce dernier qui nous racontait ce qu'il a pu apprendre sur son fils...
C'est là que se trouve le véritable suspense, en fait : comprendre les raisons qui ont poussé Daniel à tuer le sénateur Seagram. Comprendre, pour essayer d'accepter, si tant est que cela soit possible. Comprendre pour assumer. Comprendre pour mesurer quelle part de responsabilité a Paul dans ce drame. Comprendre pour espérer tourner la page...
Tout ce processus personnel, intime, égocentrique, presque, que va mener Paul va passer par un autre élément très fort : tout au long de ces mois terriblement difficiles, dans sa quête pour comprendre l'acte de son fils, le médecin va chercher dans le passé, plus ou moins récent, des exemples qui pourraient lui donner des indices décisifs.
On croise ainsi des figures incontournables de l'histoire américaine contemporaine, Lee Harvey Oswald, Sirhan Sirhan, Timothy McVeigh ou John Hinckley, par exemple, d'autres que l'on connaît peut-être un peu moins de ce côté de l'Atlantique, mais qui ont eu un impact énorme sur leur époque par la violence et la folie de leurs actes.
A travers son narrateur, Noah Hawley retrace ces faits marquants, en corrélation avec l'histoire de Daniel Allen. Des histoires qui vont évoluer en même temps que l'état d'esprit de Paul Allen, en même temps qu'il avance et retrace le parcours de son fils, sans vraiment trouver les réponses qui lui manquent.
Et quand je dis que cela évolue, c'est très net, car le premier réflexe de Paul en apprenant le geste de Daniel, c'est de crier au complot, de se pencher sur des affaires de premier plan ayant donné lieu à des versions officielles un peu floues et, dans le même temps, à une multitude de théorie du complot. Ensuite, il changera son fusil d'épaule, explorant d'autres options, d'autres exemples...
Tout cela est passionnant, certaines histoires sont connues, mais apparaissent des détails supplémentaires ou des angles différents, d'autres ont été pour moi de glaçantes découvertes, comme la tuerie perpétuée par Charles Whitman en 1966, preuve que les événements qui défraient régulièrement la chronique US ne sont pas un phénomène récent, hélas...
Voilà pourquoi il ne faut pas forcément se fier au bandeau qui ceint le livre. Noah Hawley a publié ce roman en 2012, il est sorti l'année suivante à la Série Noire, et Noah Hawley n'était pas encore le créateur de "Fargo" et de "Légion". On le connaissait alors surtout comme scénariste sur les trois premières saisons d'une autre série bien connue, "Bones".
Et c'est trompeur : "Bones" comme "Fargo" (je n'ai pas encore vu "Légion", mais on sort du noir pour aller vers les super-héros) brillent par un côté humoristique, et même très grinçant pour la deuxième, qui contrebalance le côté polar ou noir. Or, ce n'est pas du tout le cas de "Le Bon père", qui est un roman d'une profonde noirceur, sans aucun contraste.
Au contraire, plus on avance et plus on s'enfonce dans ce côté désespéré qu'impose la situation. J'ai parlé de chemin de croix plus haut, c'est vraiment l'impression que j'ai eu, car à chaque nouvelle station franchie, Paul Allen perd certaines illusions, refusant farouchement de se résigner, mais perdant du terrain face à l'évidence...
Je suis entré dans ce livre avec comme information ce que j'avais lu en quatrième de couverture : un extrait tiré du prologue du roman et quelques lignes en forme de pitch, comme on dit, rien de plus. Je ne savais donc pas vraiment à quoi m'attendre et, comme dit plus haut, on pouvait aussi bien aller vers un thriller surfant sur le thème de la conspiration, comme vers un roman noir ou un polar.
En fait, loin de Morrell, Grisham ou Baldacci, "Le Bon père" est plutôt à rapprocher d'une lignée de romans qui privilégient une puissante dimension psychologique au suspense pur et au roman d'action. En lisant le livre de Noah Hawley, j'ai repensé à "Il faut qu'on parle de Kevin", de Lionel Shriver ou à "Défendre Jacob", de William Landay.
Les contextes de ces trois livres sont très différents, entendons-nous bien, mais le point commun qui saute aux yeux, c'est le thème de ces parents qui se retrouvent désemparés face à leurs enfants, face à ce qu'ils commettent et face aux questions que cela pose quant à l'éducation qu'il leur ont donnée. Ces doutes terribles, cette culpabilité immense sont des sujets romanesques fertiles.
Noah Hawley propose un roman d'une très grande force, porté par une douleur incommensurable, superbement construit pour jouer avec les ambiguïtés évoquées ci-dessus, qui font douter, un peu, laissent malgré tout quelques zones d'ombre susceptibles d'alimenter les théories alternatives, on nous cache tout, on nous dit rien, et centré sur un personnage qui remet toute son existence en question.
On assiste à la métamorphose de Paul Allen, qui se dépouille de sa personnalité initiale, sans doute un peu hautaine, placé dans une tour d'ivoire, aveuglé par la réussite évidente qu'est son existence. C'est ce qui fait sa force, je trouve, cette remise en cause générale, parce que ces événements marquent la fin d'une période et que, pour vivre la suivante, il faudra muer.
J'ai refermé ce livre dans un maelstrom d'émotions, car, vous le verrez, "le Bon père" s'achève par un épilogue bouleversant, et plus encore parce que ce n'est pas du tout à cette fin-là qu'on s'attend. C'est la fin d'une quête, la dernière étape d'un voyage atrocement déchirant. Le moment où la cruelle réalité s'impose enfin.
"Il va falloir un jour qu'enfin je me décide à lire les livres que, depuis trente ans, je conseille à mes amis de lire". (Sacha Guitry)
mardi 24 avril 2018
lundi 23 avril 2018
"La tête de la Vénus de Milo sur la Victoire de Samothrace" (Antoine Blondin).
Clin d'oeil à l'auteur de "Un singe en hiver", qui fut aussi journaliste sportif et éditorialiste à la plume inimitable pour le journal "l'Equipe". La formule ci-dessus (reprise dans notre livre du jour) évoque une championne, une nageuse au palmarès exceptionnel, et pourtant assez méconnue. Sans doute parce que le point d'orgue de sa carrière eut lieu à Montréal, lors des Jeux olympiques de 1976, dont la reine fut une gymnaste, Nadia Comaneci. Et pourtant, avec quatre médailles d'or et une en argent lors de cette Olympiade, Kornelia Ender est une immense championne qui a marqué son sport et son époque. Et aussi l'esprit de Vincent Duluc, journaliste spécialisé dans le foot pour "l'Equipe", mais qui, en 1976, était un adolescent charmé par cette nageuse hors norme. Une quarantaine d'années a passé depuis ces exploits, Kornelia Ender est retournée à l'anonymat, l'Allemagne de l'Est a disparu, son système de dopage d'Etat a été révélé et d'autres championnes ont fasciné d'autres générations de jeunes gens... Avec "Kornelia" (en grand format chez Stock), Vincent Duluc poursuit sa démarche nostalgique, après "le Cinquième Beatles" et "Un printemps 76", mais cette fois, ses souvenirs d'ado entrent en collision avec son regard de journaliste et il revient sur la carrière de la nageuse, devenue malgré elle un symbole de la Guerre froide.
En 1973, aux championnats du monde de natation qui se déroulent à Belgrade, une jeune nageuse de 15 ans à peine, Kornelia Ender, crève l'écran : quatre titre assortis de trois records du monde. Mais, c'est vraiment lors des Jeux olympiques de Montréal, sa dernière compétition, qu'elle entre dans l'histoire de son sport, avec quatre titre et une médaille d'argent.
A cette époque, Vincent Duluc est un jeune adolescent vivant du côté de Bourg-en-Bresse et la sculpturale nageuse est-allemande devient une de ses idoles sportives, allez, disons-le, il a le béguin, et même un peu plus, pour cette jeune femme qui collectionne les succès, mais demeure si lointaine, à une époque où les médias ne sont pas aussi omniprésents qu'ils le sont devenus.
Difficile de suivre les Jeux olympiques de Montréal, par exemple, et pas seulement parce que le décalage horaire se heurte au couvre-feu imposé par ses parents, mais aussi parce que les quelques chaînes de télévision et stations de radio n'ont pas forcément la possibilité de diffuser l'événement en continu et de proposer au public toutes les disciplines.
Peu importe la difficulté, le jeune Vincent se démène pour suivre les performances de cette jeune femme, à peine plus âgée que lui, qui enchaîne les longueurs de bassin et les victoires. Il n'est pas encore journaliste, il ne pige pas encore pour "le Progrès", il n'est pas encore l'une des figures de "l'Equipe", mais il est fasciné par ce personnage de Kornelia Ender.
Quatre décennies ont passé. Vincent est quinquagénaire, Kornelia approche de la soixantaine, mais son souvenir reste si vivace que le journaliste a eu envie de savoir ce qu'elle était devenue. Il s'est rendu en Allemagne, à Schnorsheim, en Rhénanie-Palatinat, où elle exerce désormais comme kinésithérapeute et mène une vie bien loin des lumières olympiques.
Vincent Duluc est passé devant le cabinet, mais il ne s'est pas arrêté. Au moment d'entrer en contact avec elle, il n'a pas osé. Pour ne pas la déranger, sans doute, peut-être aussi pour conserver la part de rêve et d'adolescence qu'incarne celle qui reste pour lui la nageuse d'exception qui raflait tous les titres majeurs dans la première moitié des années 1970.
Un rêve que la réalité n'a pas réussi à écorner, malgré les scandales de dopage entourant son pays natal, la R.D.A, malgré le temps qui passe, malgré le mystère entourant cette championne à propos de laquelle on n'a jamais su que ce que les autorités est-allemandes souhaitaient montrer, comme son idylle avec un autre remarquable nageur, Roland Matthes.
Bien sûr, avec "Kornelia", Vincent Duluc explore encore une fois sa jeunesse et sa passion naissante pour le sport, dont il fera une carrière professionnelle, mais pour ce livre-ci, celui où il s'implique le plus, où la part d'autofiction est la plus importante, il va évoquer une époque où le sport était une arme de propagande pour les deux superpuissances : Etats-Unis d'un côté et U.R.S.S. et ses satellites de l'autre.
Ainsi, le portrait qu'il nous offre de Kornelia Ender va s'étoffer. Peu importe qui elle est aujourd'hui, finalement, ce qui devient passionnant, intriguant, c'est celle qu'elle a été, une adolescente au talent phénoménal, une jeune femme un peu perdue aux prises avec un système qui contrôle tout, une personne discrète qui aspirait sans doute plus à une vie paisible qu'aux impératifs de la gloire olympique.
Pour Vincent Duluc, Kornelia Ender, c'était d'abord des photos. Mais, désormais, c'est bien sur un être humain qu'il travaille, sur ce qu'on ne voit pas quand la championne évolue dans son élément, cette eau qu'elle fend avec une technique parfaite, innovante, moderne, laissant ses concurrentes plusieurs longueurs derrière elle.
Kornelia Ender, c'est un mystère. Est-elle Greta Garbo ou Odile Toutlemonde, se demande l'auteur ?
A l'époque, dans les années 1970, elle ressemble plus à un Pantin qu'à une jeune femme de son temps. Pardon, la comparaison n'est pas flatteuse, mais c'est vraiment le sentiment qu'on a : adolescente manifestement très réservée, elle est mise en avant par son pays, la R.D.A, pour des raisons qui dépassent largement le cadre du sport, comme on dit.
Elle est l'emblème d'un pays tout entier, mais aussi de son idéologie, alors qu'on est en pleine Guerre froide. Elle est le visage de la R.D.A., "sa petite fiancée". Elle ne dit rien (il faut dire qu'on lui donne à peine la parole ; et c'est peut-être mieux ainsi, d'ailleurs), elle se contente d'apparaître, outil de propagande malgré elle.
Elle est alors docile, acceptant ce qu'on lui impose, mais cela ne durera pas : après sa carrière, dans les années 1980, elle se rebellera contre le carcan étatique, à ses risques et périls. Difficile de ne pas mettre son parcours en parallèle de celui de Nadia Comaneci, d'ailleurs, qui subit la folie du régime de Ceaucescu. Elles sont très différentes, mais leur histoire se ressemblent.
Après avoir été utilisée sa carrière durant, Kornelia Ender sera ensuite sous surveillance permanente, ciblée par la Stasi, la police politique du régime est-allemand, qui n'avait pas franchement confiance en elle. La nageuse a repris son destin en main après avoir quitté les bassins, mais il faudra encore du temps avant qu'elle puisse choisir sa vie...
"Kornelia", c'est aussi l'histoire d'une rivalité. Une rivalité sportive, qui prend d'autres proportions, toujours en raison de ce contexte si spécial des années 1970. La rivale s'appelle Shirley Babashoff, elle est californienne et a quelques mois de plus que Kornelia Ender. Leur carrière suivra une trajectoire parallèle.
Le palmarès de la jeune américaine est tout à fait remarquable, avec huit médailles olympiques (pour deux titres), dix médailles mondiales (dont deux en or) et six records du monde. Pourtant, l'histoire de Shirley, c'est l'histoire d'une frustration : elle a obtenu ses titres en relais, mais jamais dans les courses individuelles, toujours devancée par Kornelia Ender...
Elle est la petite sirène américaine apparaissant en couverture des magazines, mais battue sans cesse par la solide est-allemande et on sent bien la rancoeur qui s'est installée et qui va empirer quand les rumeurs de dopage vont commencer à circuler. Vincent Duluc ne sépare pas ces deux adversaires (le mot n'est pas trop fort), elles sont indissociables, jusque dans les retrouvailles organisées près de 20 ans après...
Ce portrait croisé est passionnant, comme le sont souvent les portraits de rivaux sportifs, toujours très différents, par leur physique, leur style, leurs origines sociales et géographique... Une rivalité que les médias s'empressent d'alimenter et qui, dans le cas présent, va trouver un terrain formidablement favorable, puisque, à l'instar de Rocky et Drago, ce sont les deux blocs qui s'affrontent à travers elles.
Et puis, il y a la facette la plus énigmatique de Kornelia Ender, celle qui concerne le dopage. Car, oui, la question se pose à son sujet et, à travers ces interrogations, apparaît le véritable dilemme entourant les sportifs de très haut niveau et leurs performances... En clair : peut-on faire d'un mulet un étalon en recourant au dopage ?
Le cas Ender est passionnant : elle fait une entrée en fanfare dans les palmarès mondiaux à Belgrade, en 1973. Elle a 15 ans et casse la baraque. Pour ceux qui observent sa technique, il est clair que Kornelia Ender innove, dans la coulée, dans la manière de respirer, autant de petits trucs qui vont lui permettre de gagner du temps sur ses concurrentes.
Mais, en 1976, elle s'est métamorphosée, comme la plupart de ses coéquipières au sein de l'équipe est-allemande. Elle a pris du muscle, c'en est presque effrayant. Dans les coulisses, on se moque des nageuses venues de l'autre côté du Mur de Berlin, dont la voix semble bien trop grave et la pilosité bien trop abondante...
On saura plus tard que c'est en 1974 que l'Allemagne de l'Est a lancé son programme de dopage généralisé, qui va faire des "merveilles" en natation ou en athlétisme, par exemple (on apprend d'ailleurs dans le livre de Vincent Duluc que l'U.R.S.S. et ses pays frères s'étaient partagés les disciplines).
Plus tard, c'est une fois le Mur démoli et l'Allemagne réunifiée. Les dossiers de la Stasi vont se montrer extrêmement riches et complets, détaillant les méthodes et le suivi des athlètes, des pratiques absolument révoltantes, en particulier pour les sportives, au mépris de leur santé et de leur avenir. Aucun choix possible et des athlètes sans doute pas dupes, mais soigneusement tenus dans l'ignorance de ce qu'on leur infligeait.
Or, nulle part dans ces dossiers n'apparaît le nom de Kornelia Ender. Dans cette masse de documents sans équivoque qu'on peut estimer exhaustive, dans les différents protocoles mis en place, on ne trouve pas la nageuse... Comment imaginer que ce soit un oubli, tant tout cela paraît méticuleux ? Alors, Kornelia Ender, dopée ou pas ? La question se pose.
Bien sûr, si vous n'aimez pas trop le sport, si vous n'avez pas cette passion qui anime Vincent Duluc, ces questions paraissent accessoires. Mais, pour le journaliste, qui consacre une partie de son livre à cette effarante politique organisée au plus haut d'un Etat (ce qu'on semble retrouver ces temps-ci, suivez mon regard à l'est), c'est fondamental.
Car on en revient à cette notion de rêve et d'idéal qu'incarnait aux yeux du jeune Vincent Duluc Kornelia Ender. La nostalgie est le trait commun des romans publiés par le journaliste, ils renvoient tous à cette adolescence où ces champions, footballeurs ou nageuse, ont allumé des étoiles dans ses yeux, sans limite, sans restriction particulière. Un regard qui est celui de l'enfance.
Découvrir que Kornelia Ender était dopée, qu'elle a triché pour réaliser ses performances, alors, c'est une part d'enfance qui s'envolerait, une figure idéale, fantasmée, même, dans tous les sens du terme, qui serait ternie irrémédiablement. Alors, on voit Vincent Duluc, malgré l'évidence, s'accrocher à cette idée qu'elle aurait échappé à ce système...
J'avais aimé la folie douce qui émanait du portrait de George Best, dans "le Cinquième Beatles", une star qui a assumé ce statut jusqu'à l'autodestruction, j'avais aimé la vision du "football de papa", qui était déjà un peu le mieux, incarnée par les Verts stéphanois, finalistes malheureux de la Coupe d'Europe des Clubs champions en 1976.
Avec "Kornelia", j'ai eu l'impression d'entrer plus avant dans le jardin secret de Vincent Duluc, d'abord parce qu'on ne l'imagine pas forcément se passionner pour la natation, ensuite, parce qu'il se dégage de ce livre une vraie sincérité dans le sentiment qui l'unit à Kornelia Ender, dans ce côté adolescent qui a traversé les ans, sans demeurer intact, mais sans se faner non plus complètement.
On retrouve un sens de la formule qui fait mouche, digne émule du Blondin de la grande époque, et on est touché par cette timidité qui s'empare de lui au moment de se retrouver face à celle qu'il idolâtrait tant d'années plus tôt, par cette quête d'une championne qui demeure mystérieuse à plus d'un titre.
On ne referme pas "Kornelia" en se disant qu'on est incollable à son sujet, il ne s'agit pas d'une biographie, plus d'un portrait, d'un long reportage qui remet une carrière en perspective et s'intéresse à la femme derrière les championnes, qui déborde du sport pour s'intéresser à la politique et même la géopolitique.
Je ne connaissais pas Kornelia Ender, je l'avoue humblement. Montréal 1976 pour moi, c'était les 10 de Nadia Comaneci ou le 110m haies victorieux de Guy Drut. J'ai donc découvert cette championne, victime d'une situation mondiale qui ne la concernait pas vraiment et a influé sur sa carrière, jusqu'à jeter la suspicion sur ses performances.
Mais, peu importe, Vincent Duluc m'a convaincu : Kornelia Ender fait partie des plus grandes championnes de son sport, le fait qu'elle ait pu bénéficier de ce programme de dopage général ne doit pas faire oublier quelle formidable athlète elle était à l'origine. Elle n'est pas Lance Armstrong, pour dire les choses clairement, elle est avant tout une victime.
En 1973, aux championnats du monde de natation qui se déroulent à Belgrade, une jeune nageuse de 15 ans à peine, Kornelia Ender, crève l'écran : quatre titre assortis de trois records du monde. Mais, c'est vraiment lors des Jeux olympiques de Montréal, sa dernière compétition, qu'elle entre dans l'histoire de son sport, avec quatre titre et une médaille d'argent.
A cette époque, Vincent Duluc est un jeune adolescent vivant du côté de Bourg-en-Bresse et la sculpturale nageuse est-allemande devient une de ses idoles sportives, allez, disons-le, il a le béguin, et même un peu plus, pour cette jeune femme qui collectionne les succès, mais demeure si lointaine, à une époque où les médias ne sont pas aussi omniprésents qu'ils le sont devenus.
Difficile de suivre les Jeux olympiques de Montréal, par exemple, et pas seulement parce que le décalage horaire se heurte au couvre-feu imposé par ses parents, mais aussi parce que les quelques chaînes de télévision et stations de radio n'ont pas forcément la possibilité de diffuser l'événement en continu et de proposer au public toutes les disciplines.
Peu importe la difficulté, le jeune Vincent se démène pour suivre les performances de cette jeune femme, à peine plus âgée que lui, qui enchaîne les longueurs de bassin et les victoires. Il n'est pas encore journaliste, il ne pige pas encore pour "le Progrès", il n'est pas encore l'une des figures de "l'Equipe", mais il est fasciné par ce personnage de Kornelia Ender.
Quatre décennies ont passé. Vincent est quinquagénaire, Kornelia approche de la soixantaine, mais son souvenir reste si vivace que le journaliste a eu envie de savoir ce qu'elle était devenue. Il s'est rendu en Allemagne, à Schnorsheim, en Rhénanie-Palatinat, où elle exerce désormais comme kinésithérapeute et mène une vie bien loin des lumières olympiques.
Vincent Duluc est passé devant le cabinet, mais il ne s'est pas arrêté. Au moment d'entrer en contact avec elle, il n'a pas osé. Pour ne pas la déranger, sans doute, peut-être aussi pour conserver la part de rêve et d'adolescence qu'incarne celle qui reste pour lui la nageuse d'exception qui raflait tous les titres majeurs dans la première moitié des années 1970.
Un rêve que la réalité n'a pas réussi à écorner, malgré les scandales de dopage entourant son pays natal, la R.D.A, malgré le temps qui passe, malgré le mystère entourant cette championne à propos de laquelle on n'a jamais su que ce que les autorités est-allemandes souhaitaient montrer, comme son idylle avec un autre remarquable nageur, Roland Matthes.
Bien sûr, avec "Kornelia", Vincent Duluc explore encore une fois sa jeunesse et sa passion naissante pour le sport, dont il fera une carrière professionnelle, mais pour ce livre-ci, celui où il s'implique le plus, où la part d'autofiction est la plus importante, il va évoquer une époque où le sport était une arme de propagande pour les deux superpuissances : Etats-Unis d'un côté et U.R.S.S. et ses satellites de l'autre.
Ainsi, le portrait qu'il nous offre de Kornelia Ender va s'étoffer. Peu importe qui elle est aujourd'hui, finalement, ce qui devient passionnant, intriguant, c'est celle qu'elle a été, une adolescente au talent phénoménal, une jeune femme un peu perdue aux prises avec un système qui contrôle tout, une personne discrète qui aspirait sans doute plus à une vie paisible qu'aux impératifs de la gloire olympique.
Pour Vincent Duluc, Kornelia Ender, c'était d'abord des photos. Mais, désormais, c'est bien sur un être humain qu'il travaille, sur ce qu'on ne voit pas quand la championne évolue dans son élément, cette eau qu'elle fend avec une technique parfaite, innovante, moderne, laissant ses concurrentes plusieurs longueurs derrière elle.
Kornelia Ender, c'est un mystère. Est-elle Greta Garbo ou Odile Toutlemonde, se demande l'auteur ?
A l'époque, dans les années 1970, elle ressemble plus à un Pantin qu'à une jeune femme de son temps. Pardon, la comparaison n'est pas flatteuse, mais c'est vraiment le sentiment qu'on a : adolescente manifestement très réservée, elle est mise en avant par son pays, la R.D.A, pour des raisons qui dépassent largement le cadre du sport, comme on dit.
Elle est l'emblème d'un pays tout entier, mais aussi de son idéologie, alors qu'on est en pleine Guerre froide. Elle est le visage de la R.D.A., "sa petite fiancée". Elle ne dit rien (il faut dire qu'on lui donne à peine la parole ; et c'est peut-être mieux ainsi, d'ailleurs), elle se contente d'apparaître, outil de propagande malgré elle.
Elle est alors docile, acceptant ce qu'on lui impose, mais cela ne durera pas : après sa carrière, dans les années 1980, elle se rebellera contre le carcan étatique, à ses risques et périls. Difficile de ne pas mettre son parcours en parallèle de celui de Nadia Comaneci, d'ailleurs, qui subit la folie du régime de Ceaucescu. Elles sont très différentes, mais leur histoire se ressemblent.
Après avoir été utilisée sa carrière durant, Kornelia Ender sera ensuite sous surveillance permanente, ciblée par la Stasi, la police politique du régime est-allemand, qui n'avait pas franchement confiance en elle. La nageuse a repris son destin en main après avoir quitté les bassins, mais il faudra encore du temps avant qu'elle puisse choisir sa vie...
"Kornelia", c'est aussi l'histoire d'une rivalité. Une rivalité sportive, qui prend d'autres proportions, toujours en raison de ce contexte si spécial des années 1970. La rivale s'appelle Shirley Babashoff, elle est californienne et a quelques mois de plus que Kornelia Ender. Leur carrière suivra une trajectoire parallèle.
Le palmarès de la jeune américaine est tout à fait remarquable, avec huit médailles olympiques (pour deux titres), dix médailles mondiales (dont deux en or) et six records du monde. Pourtant, l'histoire de Shirley, c'est l'histoire d'une frustration : elle a obtenu ses titres en relais, mais jamais dans les courses individuelles, toujours devancée par Kornelia Ender...
Elle est la petite sirène américaine apparaissant en couverture des magazines, mais battue sans cesse par la solide est-allemande et on sent bien la rancoeur qui s'est installée et qui va empirer quand les rumeurs de dopage vont commencer à circuler. Vincent Duluc ne sépare pas ces deux adversaires (le mot n'est pas trop fort), elles sont indissociables, jusque dans les retrouvailles organisées près de 20 ans après...
Ce portrait croisé est passionnant, comme le sont souvent les portraits de rivaux sportifs, toujours très différents, par leur physique, leur style, leurs origines sociales et géographique... Une rivalité que les médias s'empressent d'alimenter et qui, dans le cas présent, va trouver un terrain formidablement favorable, puisque, à l'instar de Rocky et Drago, ce sont les deux blocs qui s'affrontent à travers elles.
Et puis, il y a la facette la plus énigmatique de Kornelia Ender, celle qui concerne le dopage. Car, oui, la question se pose à son sujet et, à travers ces interrogations, apparaît le véritable dilemme entourant les sportifs de très haut niveau et leurs performances... En clair : peut-on faire d'un mulet un étalon en recourant au dopage ?
Le cas Ender est passionnant : elle fait une entrée en fanfare dans les palmarès mondiaux à Belgrade, en 1973. Elle a 15 ans et casse la baraque. Pour ceux qui observent sa technique, il est clair que Kornelia Ender innove, dans la coulée, dans la manière de respirer, autant de petits trucs qui vont lui permettre de gagner du temps sur ses concurrentes.
Mais, en 1976, elle s'est métamorphosée, comme la plupart de ses coéquipières au sein de l'équipe est-allemande. Elle a pris du muscle, c'en est presque effrayant. Dans les coulisses, on se moque des nageuses venues de l'autre côté du Mur de Berlin, dont la voix semble bien trop grave et la pilosité bien trop abondante...
On saura plus tard que c'est en 1974 que l'Allemagne de l'Est a lancé son programme de dopage généralisé, qui va faire des "merveilles" en natation ou en athlétisme, par exemple (on apprend d'ailleurs dans le livre de Vincent Duluc que l'U.R.S.S. et ses pays frères s'étaient partagés les disciplines).
Plus tard, c'est une fois le Mur démoli et l'Allemagne réunifiée. Les dossiers de la Stasi vont se montrer extrêmement riches et complets, détaillant les méthodes et le suivi des athlètes, des pratiques absolument révoltantes, en particulier pour les sportives, au mépris de leur santé et de leur avenir. Aucun choix possible et des athlètes sans doute pas dupes, mais soigneusement tenus dans l'ignorance de ce qu'on leur infligeait.
Or, nulle part dans ces dossiers n'apparaît le nom de Kornelia Ender. Dans cette masse de documents sans équivoque qu'on peut estimer exhaustive, dans les différents protocoles mis en place, on ne trouve pas la nageuse... Comment imaginer que ce soit un oubli, tant tout cela paraît méticuleux ? Alors, Kornelia Ender, dopée ou pas ? La question se pose.
Bien sûr, si vous n'aimez pas trop le sport, si vous n'avez pas cette passion qui anime Vincent Duluc, ces questions paraissent accessoires. Mais, pour le journaliste, qui consacre une partie de son livre à cette effarante politique organisée au plus haut d'un Etat (ce qu'on semble retrouver ces temps-ci, suivez mon regard à l'est), c'est fondamental.
Car on en revient à cette notion de rêve et d'idéal qu'incarnait aux yeux du jeune Vincent Duluc Kornelia Ender. La nostalgie est le trait commun des romans publiés par le journaliste, ils renvoient tous à cette adolescence où ces champions, footballeurs ou nageuse, ont allumé des étoiles dans ses yeux, sans limite, sans restriction particulière. Un regard qui est celui de l'enfance.
Découvrir que Kornelia Ender était dopée, qu'elle a triché pour réaliser ses performances, alors, c'est une part d'enfance qui s'envolerait, une figure idéale, fantasmée, même, dans tous les sens du terme, qui serait ternie irrémédiablement. Alors, on voit Vincent Duluc, malgré l'évidence, s'accrocher à cette idée qu'elle aurait échappé à ce système...
J'avais aimé la folie douce qui émanait du portrait de George Best, dans "le Cinquième Beatles", une star qui a assumé ce statut jusqu'à l'autodestruction, j'avais aimé la vision du "football de papa", qui était déjà un peu le mieux, incarnée par les Verts stéphanois, finalistes malheureux de la Coupe d'Europe des Clubs champions en 1976.
Avec "Kornelia", j'ai eu l'impression d'entrer plus avant dans le jardin secret de Vincent Duluc, d'abord parce qu'on ne l'imagine pas forcément se passionner pour la natation, ensuite, parce qu'il se dégage de ce livre une vraie sincérité dans le sentiment qui l'unit à Kornelia Ender, dans ce côté adolescent qui a traversé les ans, sans demeurer intact, mais sans se faner non plus complètement.
On retrouve un sens de la formule qui fait mouche, digne émule du Blondin de la grande époque, et on est touché par cette timidité qui s'empare de lui au moment de se retrouver face à celle qu'il idolâtrait tant d'années plus tôt, par cette quête d'une championne qui demeure mystérieuse à plus d'un titre.
On ne referme pas "Kornelia" en se disant qu'on est incollable à son sujet, il ne s'agit pas d'une biographie, plus d'un portrait, d'un long reportage qui remet une carrière en perspective et s'intéresse à la femme derrière les championnes, qui déborde du sport pour s'intéresser à la politique et même la géopolitique.
Je ne connaissais pas Kornelia Ender, je l'avoue humblement. Montréal 1976 pour moi, c'était les 10 de Nadia Comaneci ou le 110m haies victorieux de Guy Drut. J'ai donc découvert cette championne, victime d'une situation mondiale qui ne la concernait pas vraiment et a influé sur sa carrière, jusqu'à jeter la suspicion sur ses performances.
Mais, peu importe, Vincent Duluc m'a convaincu : Kornelia Ender fait partie des plus grandes championnes de son sport, le fait qu'elle ait pu bénéficier de ce programme de dopage général ne doit pas faire oublier quelle formidable athlète elle était à l'origine. Elle n'est pas Lance Armstrong, pour dire les choses clairement, elle est avant tout une victime.
dimanche 22 avril 2018
"Tout allait bien. Il ne manquait personne. Les murs étaient hauts et solides, infiniment profondes les strates de l'encyclopédie. Le monde entier se trouvait là".
Un titre, quelques lignes en quatrième de couverture, une couverture, ce sont souvent les premiers éléments qui mènent à une lecture. Je n'oublie pas l'auteur, bien sûr, mais lorsqu'on le découvre, on peut s'intéresser à sa nationalité et à la culture qui l'accompagne. Voici comment je me suis lancé dans la lecture de notre roman du jour, un livre très intéressant, beau et triste à la fois (c'est mon point de vue, mais sera-t-il partagé ? Je n'en sais rien...), porté par cette fascinante aptitude des écrivains japonais à instiller le merveilleux dans la réalité et à mêler à la poésie une bonne dose de noirceur. "Instantanés d'Ambre", de Yôko Ogawa (en grand format aux éditions Actes Sud ; traduction de Rose-Marie Makino-Fayolle), est une histoire déroutante, un huis clos plein de vie et pourtant terriblement étouffant dès qu'on observe les détails. Une éducation très étrange inculquée par une mère à ses enfants, une jeunesse recluse, mais heureuse. L'histoire d'une famille soudée, par la force des choses, mais plus forte que le monde alentour...
Lorsque la famille déménage dans une nouvelle maison, la mère organise la nouvelle existence des siens complètement en marge de la société. Elle commence par demander à ses enfants de se choisir un nouveau nom et d'oublier celui qu'ils portaient jusque-là. C'est dans une encyclopédie illustrée que les trois enfants vont tirer au sort leur nouveau prénom.
Et comme le thème de cette encyclopédie, ce sont les minéraux, voilà pourquoi l'aînée s'appellera désormais Opale, le cadet Ambre et le benjamin Agate. A chacun la pierre qui correspond à cette nouvelle identité. A chacun une nouvelle existence commune dans un univers clairement délimité par la mère. Le seul univers qui vaille pour la famille.
En effet, désormais, les trois enfants vivront dans la nouvelle propriété acquise par la mère. Interdiction pour eux de quitter l'enceinte, enclose derrière un mur de briques, la maison et le jardin seront leur monde, leur monde rien qu'à eux, à l'écart de l'autre monde, plus vaste, mais tellement plus dangereux, qu'il vaut mieux s'en passer.
Ce monde, il n'existera pour Opale, Ambre et Agate qu'à travers l'impressionnante bibliothèque qu'ils ont à portée de main. Elle leur a été laissée par leur père, qui n'est plus là, désormais. Ces livres, il les éditait et les diffusait, jusqu'à ce que son affaire périclite. Il s'agit donc de tout un tas d'encyclopédies thématiques dans lesquelles les enfants découvriront la vie à travers un savoir essentiellement théorique.
Car les enfants étudient, chaque jour, dans ces livres. Leurs journées sont réglées à la minute près entre loisirs, découverte, apprentissage, chant... Un rythme que les enfants respectent méticuleusement, sans que leur mère, qui leur fait entièrement confiance, n'ait à intervenir pour leur rappeler leurs devoirs.
Et pour cause : si les enfants ont interdiction de sortir de la propriété, mais aussi de laisser entrer quiconque venu du monde extérieur, la mère, elle, n'est pas astreinte à ces règles. Chaque jour, elle part travailler et revient le soir, non sans un certain cérémonial chargé d'entretenir la peur de ce qui se trouve au-delà du mur de briques qu'elle a inculquée à sa fille et ses fils...
Voilà les conditions dans lesquelles grandissent Opale, Ambre et Agate, dans une véritable harmonie, heureux et bien traités, si l'on excepte cette réclusion imposée par la mère, qui ne semble pas peser comme une contrainte, puisque c'est pour leur bien. Voilà comment s'organise le petit monde de cette famille pas comme les autres...
Il y a quelque chose d'un paradis terrestre, dans cet immense jardin plein de mystères et de curiosités, dans cette maison qu'on devine assez impressionnante, mais qui pour eux, est un havre protégé des dangers extérieurs, dans l'imaginaire fertile de ces gamins livrés à eux-mêmes, mais éveillés, dans cette vie détachée de toute contrainte sociale autre que celles dictées par la mère, dans cette famille, unie mais recroquevillée, heureuse mais isolée...
Jusqu'à ce qu'un colporteur réussisse à entrer et fasse la connaissance des enfants...
J'ai essayé dans ce résumé de faire passer une partie de mon état d'esprit à propos de ce livre, à la fois émerveillé et troublé. Emerveillé par ce roman d'apprentissage, troublé par le contexte que ne perçoivent pas ces enfants, qui n'ont pour référence que leur mère, qu'ils aiment et respectent, et qui leur rend bien. Du moins en apparence...
Oui, je le redis, il y a quelque chose d'idéal dans la vie d'Opale, Ambre et Agate, dans cette vie partagée entre la maison et le jardin, sans autre horizon que cette frontière de briques qui est bien plus que cela, puisque, au-delà, se trouvent le danger, la mort, la séparation, la solitude... Tout ce qui achèverait de détruire une famille déjà très éprouvée.
Pour bien parler d' "Instantanés d'Ambre", il faudrait entrer dans les détails, ceux qui attendrissent et bouleversent, mais aussi ceux qui mettent franchement mal à l'aise et font grincer des dents, de l'autre. Un seul exemple : les trois enfants parlent tout doucement, même lorsqu'ils sont entre eux, ordre maternel, il ne faut surtout pas qu'on les entende au-delà du mur... Protection ou contrôle absolu ?
Voilà toute l'ambivalence de cette situation : le bonheur simple d'une famille harmonieuse, mais qui repose sur un sale mensonge et la tyrannie d'une mère extrêmement possessive. C'est un point de vue, je ne suis pas sûr que tous les lecteurs le partageront, il y aura sans doute des avis très différents du mien, des perceptions autres, voire opposées.
"Instantanés d'Ambre", c'est un magnifique roman sur la famille, sur l'importance de cette cellule pour affronter le destin. Parce qu'on est plus fort à plusieurs, parce que l'union et l'harmonie sont une manière de mener au bonheur, dans un monde où tout, potentiellement, peut s'y opposer. Et, vous le verrez, c'est sans doute là qu'il faut chercher les raisons des choix de la mère.
D'un côté, il y a cette fratrie où chacun déploie des qualités qui lui sont propres, des aptitudes, des goûts, mais aussi un imaginaire particulier. On le voit à travers les jeux qu'ils inventent et pratiquent entre eux, mais aussi dans les autres activités du quotidien. Opale, Ambre et Agate sont attendrissants, des enfants que rien ne distinguent finalement des autres.
S'il n'y avait cette réclusion, il n'y aurait rien à redire, quasiment. Et comme elle ne pèse pas sur eux, puisque c'est une mesure de protection, dixit leur mère, unique autorité reconnue et bienveillante présence, ils évoluent librement. Voilà, c'est ça, ils sont paradoxalement à la fois libres et prisonniers, ces enfants. N'est-ce pas troublant, une telle situation ?
Et puis, il y a la mère... Là encore, dans l'absolu, il faudrait longuement évoquer ce personnage, si particulier, assez insaisissable, il faut bien le dire. Je me suis interrogé longuement à son sujet, je m'interroge encore au moment de rédiger ce billet. Est-elle folle ou ultra-possessive ? Je l'ai dit, les causes de cette situation sont rationnelles, mais vu à travers le prisme de cette femme, elles plongent dans l'irrationalité...
Bien sûr, elle veut protéger ses enfants, elle assume son rôle de mère célibataire avec une force et un courage qui forcent le respect, mais en appliquant des méthodes qui font passer un frisson le long de l'échine. Elle ne fait pas régner la terreur, c'est même tout le contraire, mais ses mensonges sont flagrants pour nous qui les observons avec distance, et son comportement intrigue, inquiète.
Je n'entre pas dans les détails, il vous faudra lire le roman. J'ai vraiment du mal à cerner ce personnage, car elle sort de tous les archétypes habituels, elle n'a pas de véritable équivalent dans notre culture collective. Elle n'est ni une Folcoche, ni une marâtre de conte de fée, non, car à aucun moment on ne peut remettre en cause son amour pour ses enfants. Mais, dans le même temps, elle les enferme dans un monde virtuel...
Enfin, il y a Ambre, dont le prénom (j'ai failli mettre des guillemets...) est dans le titre du roman et qui, d'une certaine manière, en est le personnage central. Il s'en dégage par un biais de narration qui l'extrait de sa famille et le fait apparaître dans un second fil narratif dont je n'ai pas parlé jusque-là. Il est surtout le dépositaire de l'éducation familiale, celui qui va la faire perdurer. A sa façon.
N'en disons pas plus, il faut garder un certain mystère sur ce livre. Mais, Ambre est aussi un personnage ambivalent : à la fois profondément touchant par sa naïveté, son adhésion au monde créé à l'instigation de sa mère, mais aussi un garçon qui suscite la compassion, car il est celui qui ne va jamais quitter ce monde.
Il porte si bien ce prénom choisi par hasard, Ambre : il est comme ces morceaux d'ambre qu'on retrouve parfois avec, à l'intérieur, emprisonné depuis des temps immémoriaux, des insectes ou de petites créatures prises au piège et conservées intactes, imperméables au temps qui passe et au monde qui change...
Mais il est bien vivant, lui, et il est surtout heureux comme un poisson dans l'eau, lorsqu'il évolue dans ce monde à lui. En dehors, en revanche, on le sent gauche, pas à sa place, étranger aux conventions sociales en vigueur, solitaire et doux... Comme souvent dans la littérature japonaise, Yôko Ogawa nous donne des indices, des pistes à suivre, mais n'impose rien au lecteur qui se fait sa propre idée.
C'est valable pour la personnalité d'Ambre (à propos duquel le mot autisme n'est jamais prononcé, par exemple, alors qu'on pourrait y songer), pour le monde crée par sa mère pour sa soeur, son frère et lui, pour la mère et pour ce deuxième fil narratif, très peu contextualisé, qui ne prend forme que par ce que l'on devine ou ce que l'on imagine...
Dernier personnage dont il faut parler, toujours aussi succinctement pour les raisons diverses évoquées à propos des autres : ce fameux colporteur, seule présence étrangère auprès des enfants, présence régulière bien que fugace, il passe à intervalle régulier, mais ne s'attarde pas. Là encore, on ne peut que l'envisager que sous un angle ambigu.
Je n'irai pas jusqu'à remettre son existence en cause, il n'est pas, je pense, le fruit de l'imagination des enfants. Non, il existe, il joue le rôle de la fissure dans le mur dressé farouchement par la mère pour protéger ses enfants. Il apporte un souffle extérieur, il incarne l'existence même de ce monde au-delà des briques.
Il découvre cette espèce de robinsonnade sans paraître plus surpris que cela, sans paraître plus choqué que cela non plus. En tout cas, la révolution qu'il suscite dans le quotidien des enfants est une révolution douce qui ne remet rien en cause de ce mode de vie. Il entre dans leur jeu, d'une certaine façon, tout en offrant à la fratrie un nouveau point de vue...
En réfléchissant à propos d' "Instantanés d'Ambre", je me suis demandé s'il ne fallait pas voir dans ce roman une allégorie de l'histoire du Japon : un pays longtemps clos, replié sur lui-même, n'acceptant qu'une présence étrangère minimale, puis, finalement, cédant à la pression du monde extérieur et relevant le défi de faire cohabiter ses traditions ancestrales et la plus extrême modernité.
Là encore, il faudrait développer à partir d'exemples qui, je pense, seraient malvenus dans ce billet, car ils en révéleraient un peu trop sur l'histoire et son évolution. Mais, Ambre, à sa façon, est le garant des traditions familiales, jusque dans ces fameux instantanés qui servent de titre au roman dans sa version française (je ne sais pas s'il s'agit d'une traduction fidèle, et je ne vais pas trop me fier à Google Trad pour le savoir !).
Ces instantanés, avouez que l'expression même est assez mystérieuse et aiguise la curiosité, on les découvre au fil du livre et ils prennent une place de plus en plus importante quand on approche du dénouement. Longtemps avant d'attaquer ce livre, je me suis demandé si je devais expliquer ce titre, vous raconter ce que sont ces instantanés...
J'ai choisi finalement de ne pas le faire, parce que je crois que c'est un élément d'une beauté mystérieuse qu'il vous faut découvrir par vous-mêmes. Peut-être peut-on juste dire qu'ils sont la confrontation de ce monde familial particulier au monde réel, ou plus exactement, à la vision qu'ont les enfants de ce monde réel.
C'est surtout, parmi tant d'autres éléments, un aspect qui fait que l'histoire frôle le fantastique, qui symbolise le souffle de l'imaginaire qui attise cette histoire si particulière. Qui lui donne une dimension d'une incroyable poésie quand cette histoire pourrait basculer rapidement dans le drame, le sordide ou le malheur.
Ces instantanés d'Ambre, c'est une espèce de béatitude, tout en naïveté, l'expression d'un bonheur simple mais inaccessible pour tout autre personne que les membres de la famille, une sorte de légende familiale dans laquelle Ambre inscrit énormément de choses, très émouvantes, très troublantes aussi, je me répète, mais que voulez-vous, c'est l'essence de ce livre.
En lisant "Instantanés d'Ambre", j'ai repensé à un film japonais, "Nobody knows", qui s'inspirait d'un fait divers réel, l'histoire d'une mère célibataire qui vit dans un appartement avec ses quatre enfants, jusqu'au jour où elle disparaît, les laissant vivre par eux-mêmes. Je précise que le roman de Yôko Ogawa n'est pas un décalque de cette histoire, c'est mon association d'idées.
L'histoire racontée dans "Noobody knows" avait fait grand bruit au Japon, choquant profondément tout le pays, et certains détails glanés dans "Instantanés d'Ambre" laissent penser qu'il en est de même pour l'histoire de cette famille pas comme les autres. Avec cette notoriété un peu bizarre, presque malsaine, qui est le lot de notre monde contemporain, ultra-médiatique et oublieux d'une certaine pudeur.
Tout le contraire de ce livre, où Yôko Ogawa raconte cette histoire avec énormément de pudeur, justement, de douceur, aussi. C'est également cela qui crée l'ambiguïté : il n'y a pas de jugement, ce n'est pas l'objet du livre, juste une réflexion sur cette quête du bonheur qui est proche d'aboutir en choisissant de se couper du monde... Vais-je redire que c'est troublant ? C'est bien possible...
Cette histoire, en apparence joyeuse et insouciante, m'a paru finalement très sombre, par tout ce qu'elle implique, entre mensonges et amour maternels, entre imagination et réalité... Pour vivre heureux, vivons cachés, dit l'adage, c'en est l'illustration, mais cachés à ce point, en faisant peser sur ces enfants une épée de Damoclès effrayante, est-ce bien ?
Douceur et noirceur, poésie et douleur, imaginaire et réalité, on retrouve beaucoup de composantes habituelles de ce que nous offre la culture japonaise à travers sa littérature et son cinéma, par exemple. Et je me disais, au fil des pages, que ce roman pourrait faire un beau scénario pour un film d'animation tels que le studio Ghibli et Hayao Miyazaki nous en proposent régulièrement.
Ce billet s'achève, et je n'arrive toujours pas à savoir si doit primer l'émerveillement ou le trouble. Je crois que c'est aussi la force de ce livre marquant, ce mariage des deux émotions presque opposées. C'est sa base, une sorte de merveilleux désenchantement, pour finir sur un oxymore, qui nous interroge en tout cas profondément sur ce qu'est notre monde, le vrai, qu'il faudrait fuir pour espérer tutoyer le bonheur...
Lorsque la famille déménage dans une nouvelle maison, la mère organise la nouvelle existence des siens complètement en marge de la société. Elle commence par demander à ses enfants de se choisir un nouveau nom et d'oublier celui qu'ils portaient jusque-là. C'est dans une encyclopédie illustrée que les trois enfants vont tirer au sort leur nouveau prénom.
Et comme le thème de cette encyclopédie, ce sont les minéraux, voilà pourquoi l'aînée s'appellera désormais Opale, le cadet Ambre et le benjamin Agate. A chacun la pierre qui correspond à cette nouvelle identité. A chacun une nouvelle existence commune dans un univers clairement délimité par la mère. Le seul univers qui vaille pour la famille.
En effet, désormais, les trois enfants vivront dans la nouvelle propriété acquise par la mère. Interdiction pour eux de quitter l'enceinte, enclose derrière un mur de briques, la maison et le jardin seront leur monde, leur monde rien qu'à eux, à l'écart de l'autre monde, plus vaste, mais tellement plus dangereux, qu'il vaut mieux s'en passer.
Ce monde, il n'existera pour Opale, Ambre et Agate qu'à travers l'impressionnante bibliothèque qu'ils ont à portée de main. Elle leur a été laissée par leur père, qui n'est plus là, désormais. Ces livres, il les éditait et les diffusait, jusqu'à ce que son affaire périclite. Il s'agit donc de tout un tas d'encyclopédies thématiques dans lesquelles les enfants découvriront la vie à travers un savoir essentiellement théorique.
Car les enfants étudient, chaque jour, dans ces livres. Leurs journées sont réglées à la minute près entre loisirs, découverte, apprentissage, chant... Un rythme que les enfants respectent méticuleusement, sans que leur mère, qui leur fait entièrement confiance, n'ait à intervenir pour leur rappeler leurs devoirs.
Et pour cause : si les enfants ont interdiction de sortir de la propriété, mais aussi de laisser entrer quiconque venu du monde extérieur, la mère, elle, n'est pas astreinte à ces règles. Chaque jour, elle part travailler et revient le soir, non sans un certain cérémonial chargé d'entretenir la peur de ce qui se trouve au-delà du mur de briques qu'elle a inculquée à sa fille et ses fils...
Voilà les conditions dans lesquelles grandissent Opale, Ambre et Agate, dans une véritable harmonie, heureux et bien traités, si l'on excepte cette réclusion imposée par la mère, qui ne semble pas peser comme une contrainte, puisque c'est pour leur bien. Voilà comment s'organise le petit monde de cette famille pas comme les autres...
Il y a quelque chose d'un paradis terrestre, dans cet immense jardin plein de mystères et de curiosités, dans cette maison qu'on devine assez impressionnante, mais qui pour eux, est un havre protégé des dangers extérieurs, dans l'imaginaire fertile de ces gamins livrés à eux-mêmes, mais éveillés, dans cette vie détachée de toute contrainte sociale autre que celles dictées par la mère, dans cette famille, unie mais recroquevillée, heureuse mais isolée...
Jusqu'à ce qu'un colporteur réussisse à entrer et fasse la connaissance des enfants...
J'ai essayé dans ce résumé de faire passer une partie de mon état d'esprit à propos de ce livre, à la fois émerveillé et troublé. Emerveillé par ce roman d'apprentissage, troublé par le contexte que ne perçoivent pas ces enfants, qui n'ont pour référence que leur mère, qu'ils aiment et respectent, et qui leur rend bien. Du moins en apparence...
Oui, je le redis, il y a quelque chose d'idéal dans la vie d'Opale, Ambre et Agate, dans cette vie partagée entre la maison et le jardin, sans autre horizon que cette frontière de briques qui est bien plus que cela, puisque, au-delà, se trouvent le danger, la mort, la séparation, la solitude... Tout ce qui achèverait de détruire une famille déjà très éprouvée.
Pour bien parler d' "Instantanés d'Ambre", il faudrait entrer dans les détails, ceux qui attendrissent et bouleversent, mais aussi ceux qui mettent franchement mal à l'aise et font grincer des dents, de l'autre. Un seul exemple : les trois enfants parlent tout doucement, même lorsqu'ils sont entre eux, ordre maternel, il ne faut surtout pas qu'on les entende au-delà du mur... Protection ou contrôle absolu ?
Voilà toute l'ambivalence de cette situation : le bonheur simple d'une famille harmonieuse, mais qui repose sur un sale mensonge et la tyrannie d'une mère extrêmement possessive. C'est un point de vue, je ne suis pas sûr que tous les lecteurs le partageront, il y aura sans doute des avis très différents du mien, des perceptions autres, voire opposées.
"Instantanés d'Ambre", c'est un magnifique roman sur la famille, sur l'importance de cette cellule pour affronter le destin. Parce qu'on est plus fort à plusieurs, parce que l'union et l'harmonie sont une manière de mener au bonheur, dans un monde où tout, potentiellement, peut s'y opposer. Et, vous le verrez, c'est sans doute là qu'il faut chercher les raisons des choix de la mère.
D'un côté, il y a cette fratrie où chacun déploie des qualités qui lui sont propres, des aptitudes, des goûts, mais aussi un imaginaire particulier. On le voit à travers les jeux qu'ils inventent et pratiquent entre eux, mais aussi dans les autres activités du quotidien. Opale, Ambre et Agate sont attendrissants, des enfants que rien ne distinguent finalement des autres.
S'il n'y avait cette réclusion, il n'y aurait rien à redire, quasiment. Et comme elle ne pèse pas sur eux, puisque c'est une mesure de protection, dixit leur mère, unique autorité reconnue et bienveillante présence, ils évoluent librement. Voilà, c'est ça, ils sont paradoxalement à la fois libres et prisonniers, ces enfants. N'est-ce pas troublant, une telle situation ?
Et puis, il y a la mère... Là encore, dans l'absolu, il faudrait longuement évoquer ce personnage, si particulier, assez insaisissable, il faut bien le dire. Je me suis interrogé longuement à son sujet, je m'interroge encore au moment de rédiger ce billet. Est-elle folle ou ultra-possessive ? Je l'ai dit, les causes de cette situation sont rationnelles, mais vu à travers le prisme de cette femme, elles plongent dans l'irrationalité...
Bien sûr, elle veut protéger ses enfants, elle assume son rôle de mère célibataire avec une force et un courage qui forcent le respect, mais en appliquant des méthodes qui font passer un frisson le long de l'échine. Elle ne fait pas régner la terreur, c'est même tout le contraire, mais ses mensonges sont flagrants pour nous qui les observons avec distance, et son comportement intrigue, inquiète.
Je n'entre pas dans les détails, il vous faudra lire le roman. J'ai vraiment du mal à cerner ce personnage, car elle sort de tous les archétypes habituels, elle n'a pas de véritable équivalent dans notre culture collective. Elle n'est ni une Folcoche, ni une marâtre de conte de fée, non, car à aucun moment on ne peut remettre en cause son amour pour ses enfants. Mais, dans le même temps, elle les enferme dans un monde virtuel...
Enfin, il y a Ambre, dont le prénom (j'ai failli mettre des guillemets...) est dans le titre du roman et qui, d'une certaine manière, en est le personnage central. Il s'en dégage par un biais de narration qui l'extrait de sa famille et le fait apparaître dans un second fil narratif dont je n'ai pas parlé jusque-là. Il est surtout le dépositaire de l'éducation familiale, celui qui va la faire perdurer. A sa façon.
N'en disons pas plus, il faut garder un certain mystère sur ce livre. Mais, Ambre est aussi un personnage ambivalent : à la fois profondément touchant par sa naïveté, son adhésion au monde créé à l'instigation de sa mère, mais aussi un garçon qui suscite la compassion, car il est celui qui ne va jamais quitter ce monde.
Il porte si bien ce prénom choisi par hasard, Ambre : il est comme ces morceaux d'ambre qu'on retrouve parfois avec, à l'intérieur, emprisonné depuis des temps immémoriaux, des insectes ou de petites créatures prises au piège et conservées intactes, imperméables au temps qui passe et au monde qui change...
Mais il est bien vivant, lui, et il est surtout heureux comme un poisson dans l'eau, lorsqu'il évolue dans ce monde à lui. En dehors, en revanche, on le sent gauche, pas à sa place, étranger aux conventions sociales en vigueur, solitaire et doux... Comme souvent dans la littérature japonaise, Yôko Ogawa nous donne des indices, des pistes à suivre, mais n'impose rien au lecteur qui se fait sa propre idée.
C'est valable pour la personnalité d'Ambre (à propos duquel le mot autisme n'est jamais prononcé, par exemple, alors qu'on pourrait y songer), pour le monde crée par sa mère pour sa soeur, son frère et lui, pour la mère et pour ce deuxième fil narratif, très peu contextualisé, qui ne prend forme que par ce que l'on devine ou ce que l'on imagine...
Dernier personnage dont il faut parler, toujours aussi succinctement pour les raisons diverses évoquées à propos des autres : ce fameux colporteur, seule présence étrangère auprès des enfants, présence régulière bien que fugace, il passe à intervalle régulier, mais ne s'attarde pas. Là encore, on ne peut que l'envisager que sous un angle ambigu.
Je n'irai pas jusqu'à remettre son existence en cause, il n'est pas, je pense, le fruit de l'imagination des enfants. Non, il existe, il joue le rôle de la fissure dans le mur dressé farouchement par la mère pour protéger ses enfants. Il apporte un souffle extérieur, il incarne l'existence même de ce monde au-delà des briques.
Il découvre cette espèce de robinsonnade sans paraître plus surpris que cela, sans paraître plus choqué que cela non plus. En tout cas, la révolution qu'il suscite dans le quotidien des enfants est une révolution douce qui ne remet rien en cause de ce mode de vie. Il entre dans leur jeu, d'une certaine façon, tout en offrant à la fratrie un nouveau point de vue...
En réfléchissant à propos d' "Instantanés d'Ambre", je me suis demandé s'il ne fallait pas voir dans ce roman une allégorie de l'histoire du Japon : un pays longtemps clos, replié sur lui-même, n'acceptant qu'une présence étrangère minimale, puis, finalement, cédant à la pression du monde extérieur et relevant le défi de faire cohabiter ses traditions ancestrales et la plus extrême modernité.
Là encore, il faudrait développer à partir d'exemples qui, je pense, seraient malvenus dans ce billet, car ils en révéleraient un peu trop sur l'histoire et son évolution. Mais, Ambre, à sa façon, est le garant des traditions familiales, jusque dans ces fameux instantanés qui servent de titre au roman dans sa version française (je ne sais pas s'il s'agit d'une traduction fidèle, et je ne vais pas trop me fier à Google Trad pour le savoir !).
Ces instantanés, avouez que l'expression même est assez mystérieuse et aiguise la curiosité, on les découvre au fil du livre et ils prennent une place de plus en plus importante quand on approche du dénouement. Longtemps avant d'attaquer ce livre, je me suis demandé si je devais expliquer ce titre, vous raconter ce que sont ces instantanés...
J'ai choisi finalement de ne pas le faire, parce que je crois que c'est un élément d'une beauté mystérieuse qu'il vous faut découvrir par vous-mêmes. Peut-être peut-on juste dire qu'ils sont la confrontation de ce monde familial particulier au monde réel, ou plus exactement, à la vision qu'ont les enfants de ce monde réel.
C'est surtout, parmi tant d'autres éléments, un aspect qui fait que l'histoire frôle le fantastique, qui symbolise le souffle de l'imaginaire qui attise cette histoire si particulière. Qui lui donne une dimension d'une incroyable poésie quand cette histoire pourrait basculer rapidement dans le drame, le sordide ou le malheur.
Ces instantanés d'Ambre, c'est une espèce de béatitude, tout en naïveté, l'expression d'un bonheur simple mais inaccessible pour tout autre personne que les membres de la famille, une sorte de légende familiale dans laquelle Ambre inscrit énormément de choses, très émouvantes, très troublantes aussi, je me répète, mais que voulez-vous, c'est l'essence de ce livre.
En lisant "Instantanés d'Ambre", j'ai repensé à un film japonais, "Nobody knows", qui s'inspirait d'un fait divers réel, l'histoire d'une mère célibataire qui vit dans un appartement avec ses quatre enfants, jusqu'au jour où elle disparaît, les laissant vivre par eux-mêmes. Je précise que le roman de Yôko Ogawa n'est pas un décalque de cette histoire, c'est mon association d'idées.
L'histoire racontée dans "Noobody knows" avait fait grand bruit au Japon, choquant profondément tout le pays, et certains détails glanés dans "Instantanés d'Ambre" laissent penser qu'il en est de même pour l'histoire de cette famille pas comme les autres. Avec cette notoriété un peu bizarre, presque malsaine, qui est le lot de notre monde contemporain, ultra-médiatique et oublieux d'une certaine pudeur.
Tout le contraire de ce livre, où Yôko Ogawa raconte cette histoire avec énormément de pudeur, justement, de douceur, aussi. C'est également cela qui crée l'ambiguïté : il n'y a pas de jugement, ce n'est pas l'objet du livre, juste une réflexion sur cette quête du bonheur qui est proche d'aboutir en choisissant de se couper du monde... Vais-je redire que c'est troublant ? C'est bien possible...
Cette histoire, en apparence joyeuse et insouciante, m'a paru finalement très sombre, par tout ce qu'elle implique, entre mensonges et amour maternels, entre imagination et réalité... Pour vivre heureux, vivons cachés, dit l'adage, c'en est l'illustration, mais cachés à ce point, en faisant peser sur ces enfants une épée de Damoclès effrayante, est-ce bien ?
Douceur et noirceur, poésie et douleur, imaginaire et réalité, on retrouve beaucoup de composantes habituelles de ce que nous offre la culture japonaise à travers sa littérature et son cinéma, par exemple. Et je me disais, au fil des pages, que ce roman pourrait faire un beau scénario pour un film d'animation tels que le studio Ghibli et Hayao Miyazaki nous en proposent régulièrement.
Ce billet s'achève, et je n'arrive toujours pas à savoir si doit primer l'émerveillement ou le trouble. Je crois que c'est aussi la force de ce livre marquant, ce mariage des deux émotions presque opposées. C'est sa base, une sorte de merveilleux désenchantement, pour finir sur un oxymore, qui nous interroge en tout cas profondément sur ce qu'est notre monde, le vrai, qu'il faudrait fuir pour espérer tutoyer le bonheur...
mardi 17 avril 2018
"Les cérébrations (...) connurent un engouement immédiat, qui rappelait aux plus anciens le boom de la chirurgie esthétique, quarante ans plus tôt".
Non, pas de faute de frappe dans ce titre, c'est bien le mot "cérébration" qu'il faut y lire, explication dans le courant de ce billet, évidemment. L'anticipation, une des branches de la science-fiction, diffuse de plus en plus vers la littérature blanche, qui n'hésite plus à s'emparer de ces thématiques. On souhaiterait qu'en retour, les littératures de l'imaginaire gagnent en visibilité, en légitimité, ce qui serait juste, mais il faudra sans doute encore du temps. Voici un nouvel exemple de cette tendance, avec "Ce qui nous guette", de Laurent Quintreau (aux éditions Rivages). Un roman choral, presque un recueil de nouvelles, mais que rassemble une thématique bien précise : le contrôle. Le contrôle de soi, dans un premier temps, mais qui devient vite une forme de contrôle tout court, posant bien des questions. Sur le papier, une excellente idée peut vite être dévoyée et devenir un danger. Un livre en forme d'avertissement qui évoque avec inquiétude, mais pas sans humour, une situation chaque jour un peu plus proche...
Une jeune femme s'apprête à présenter des travaux scientifiques révolutionnaires lors d'un colloque réunissant nombre de sommités. Soudain, un accident, le truc bête, et la scientifique craque soudain. Une réaction tout à fait inappropriée, mais impossible à contrôler, qui pourrait remettre tout en cause en quelques secondes...
Un père de famille accompagne sa petite fille chez ses parents. Ensemble, ils vont prendre le TGV. L'homme est nerveux, tendu, redoutant de perdre la garde de la fillette à l'issue de la procédure de divorce qu'il entame. Aussi, quand son téléphone sonne et qu'il voit le numéro de son avocat s'afficher, décroche-t-il aussitôt et en oublie ses obligations paternelles...
La directrice administrative et financière d'une grosse entreprise est convoquée de bon matin dans le bureau de son patron. Elle s'y rend d'un bon pas, sans se douter qu'une terrible nouvelle l'y attend : non seulement elle est virée, mais en plus, elle va servir de bouc émissaire aux stratégies douteuses de la boîte. Ca fait un peu beaucoup et elle a beau être du genre zen, là, elle craque...
Pendant que sa baby-sitter se focalise sur son portable au lieu de garder un oeil sur lui, un bébé doit affronter seul un événement qui sort de l'ordinaire et qui voit son doudou, oui, son doudou adoré, terriblement malmené. Comment empêcher le pire quand on ne peut guère s'exprimer que par des cris, des babillements et que l'on est témoin de l'horreur à l'état pur ?
Une jeune femme prend un verre à la terrasse d'un café parisien avec des amies. A une table voisine, un jeune homme qui lui plaît bien... Une douce soirée, jusqu'à ce qu'un drame abominable, plus abominable encore parce que rien ne le laissait présager, se déroule... Et notre jeune femme qui se retrouve comme paralysée, incapable de quelque réaction que ce soit...
Cinq situations très différentes, certaines assez futiles, aux conséquences tragi-comiques, d'autres beaucoup plus graves ou qui auraient pu dégénérer... Et un point commun : à chaque fois, la personne concernée a perdu le contrôle. Le contrôle d'elle-même, le contrôle des événements, le contrôle sur les conséquences...
Quelques dizaines d'années plus tard, ce genre de problématique appartient au passé. En effet, grâce à la cérébration, on peut échapper à ces réactions dépourvues de maîtrise et pouvant entraîner des conséquences funestes. Grâce à cette opération, en fait, la greffe de cellules gliales (vous savez, ce sont celles qui se trouvent dans l'entourage des neurones), on ne perdra plus jamais le contrôle.
De cette manière, on saura rester calme et serein en toute circonstance, capable d'affronter sereinement n'importe quelle situation, mais aussi de renforcer certaines capacités cognitives essentiellement qui permettront à ceux qui choisiront de recourir à cette méthode de se démarquer. En un mot, d'être le ou la meilleur(e).
Mais, la contrepartie, c'est le risque aussi de perdre certaines émotions, de ne plus savoir réagir avec spontanéité, de ne plus être capable de lâcher prise quand la pression est trop forte... Bref, de faire sérieusement perdre à ceux qui ont eu recours à la cérébration une grande partie de ce qui fait d'eux des êtres humains.
La deuxième partie du livre met en scène de nouveaux personnages qui ont bénéficié de cette innovation technologique, pas toujours à leur demande, d'ailleurs, et qui se retrouvent dans des situations de tension ou de crise, ainsi armés. Ou étant en principe mieux armer pour faire face, sans que l'émotivité naturelle de l'être humain ne vienne tout gâcher...
Entre les deux parties, quelques dizaines d'années ont passés. Les cinq personnages que j'ai évoqués, ce sont nos voisins, nos amis, nos collègues, les gens que l'on croise dans la rue ou à la caisse d'un commerce. Bref, ces gens-là, ils sont nous, aujourd'hui, en 2018, dans une société qui ne pardonne aucun écart et peut se montrer très dure, très violente.
Laurent Quintreau n'invente rien : les recherches autour des cellules gliales existent et l'on envisage sérieusement ces greffes, à la manière des cellules souches dont on fait une panacée. En revanche, ce qu'il imagine, c'est la société d'après, quand la découverte d'aujourd'hui est devenue une réalité, et une méthode répandue, même si elle n'est peut-être pas accessible à tous.
Mais que changera-t-on vraiment en jouant ce petit jeu ? Voilà la question que pose le romancier, avec une inquiétude teintée de pessimisme qu'on retrouve jusque dans le titre de son livre : "Ce qui nous guette". Ouch, voilà qui a le mérite d'être clair, on entre dans la même zone de turbulence que celle qui entoure les Intelligences Artificielles, on dirait...
Autre interrogation de Laurent Quintreau à travers ces histoires entrecroisées : peut-on changer l'homme en l'améliorant, ou ne fait-on que renforcer ses bons, mais aussi ses mauvais côtés ? En quelque mots : rendre l'homme meilleur, est-ce vraiment le rendre meilleur ? Ah, oui, je joue avec les mots, mais c'est pourtant le noeud du problème.
D'un côté, rendre l'homme meilleur en termes de capacités, physiques et cognitives, un peu à l'image de ce que vit (subit ?) Charlie, le narrateur du roman de Daniel Keyes "Des fleurs pour Algernon" ; de l'autre, rendre l'homme meilleur sur le plan de la sociabilité, du rapport à l'autre, en essayant d'atténuer ses vilains défauts qui font monter la pression et le stress au quotidien.
L'exemple de Charlie rejoint d'ailleurs ceux de Laurent Quintreau, puisque, au fur et à mesure que l'expérience le rend plus intelligent, cultivé, génial, elle en fait un personnage odieux et égoïste, solitaire et malheureux... Impossible alors d'évacuer la pression, comme par la soupape d'une cocotte-minute, de lâcher prise, comme le chantaient les Massilia Sound System...
Comme la première partie, la seconde comprend donc plusieurs chapitres qui sont autant d'histoires individuelles, cette fois d'après la cérébration. Où l'on constate vite que les cellules gliales ne font pas le bonheur, que cette quête est plus complexe que cela. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi ce titre pour le billet, car le parallèle m'a semblé très pertinent.
La chirurgie esthétique avait pour but initial d'être une technique réparatrice, on se souvient qu'elle a énormément progressé suite aux terribles blessures issues de la Première Guerre mondiale. Mais, ensuite, lorsque cette discipline s'est répandu, elle a vite perdu de son côté essentiel pour devenir une espèce de cure de jouvence, de quête de l'immortelle beauté...
Ce que Laurent Quintreau décrit au sujet des cellules gliales, c'est peu ou prou un phénomène identique : d'abord répondre à une réelle problématique, du moins sur un plan scientifique, le genre de découverte qui vaut un Nobel, probablement. Mais, par la suite, cela devient un moyen de rechercher l'impossible bonheur, du moins, de laisser le moins de prise au malheur.
Il est d'ailleurs intéressant de noter que, une fois la technique banalisée, la personne qui s'y oppose le plus fortement est la scientifique même qui l'a mise au point. Et, puisqu'il y a une portée universelle à cette situation, Laurent Quintreau ne se contente pas des destins particuliers, mais envisage toute la société, jusque dans les questions idéologiques (politiques et religieuses) qui vont se poser.
Voilà pour le fond de ce livre, qui vaut aussi beaucoup par sa forme. J'ai déjà évoqué le côté atomisé du récit, puisqu'on a de multiples personnages qui se croisent, ou pas, d'ailleurs. On pourrait penser aux livres de Raymond Carver, et à ce qu'en a tiré Robert Altman pour le grand écran, c'est-à-dire "Short cuts", où des destins suivant des chemins très différents s'entremêlent.
Si j'en crois ce que j'ai lu concernant Laurent Quintreau, que je découvre, cette manière de faire est habituelle chez lui. "Ce qui guette" est son quatrième roman, le deuxième chez Rivages (il faut également ajouter un recueil de portraits, "Le Moi au pays du travail"), et il a toujours employé ce type de construction.
Mais, ce n'est pas la seule chose qui frappe, dans "Ce qui nous guette". La narration elle-même est tout à fait intéressante, puisqu'elle reprend à chaque chapitre le même vouvoiement qui peut s'adresser aussi bien au personnage qu'au lecteur, comme si l'auteur nous prenait à partie, nous lançait cet avertissement directement.
Un vouvoiement qui peut aussi donner une impression d'oralité, de discours direct, sans la distance que peut mettre l'écrit. Cela donne par moment quelques digressions, quelques détails qui donnent de la chair, font penser à celui qui raconte une histoire à ses postes en l'enjolivant avec une certaine truculence.
Mais, dans le même temps, la langue de Laurent Quintreau est riche, soutenue, sans devenir trop complexe, et ce n'est pas le langage qu'on emploierait justement autour d'une table, du comptoir d'un bistrot ou dans une réunion entre amis ou membres d'une famille. On est bien dans une oeuvre littéraire et cela se voit rapidement.
L'ensemble donne un cocktail assez troublant, entre réflexion politique (Laurent Quintreau occupe des fonctions dirigeantes à la CFDT) et philosophique, regard inquiet sur l'avenir, mais également une satire, servie par un humour pince-sans-rire que j'ai bien aimé, parce qu'il donne un peu de légèreté, un peu de recul au propos. Ok, c'est ce qui nous guette, mais il y a plus grave.
Ou alors, c'est une politesse du désespoir (amis des clichés, bonjour !)...
Cet humour, il permet d'ailleurs à l'auteur de finir son livre sur une note pleine d'ironie (ou de cynisme, même), avec une dernière histoire en forme de morale. Derrière le décalage, derrière le côté drôle et grinçant, pas mal de sujets de réflexion, allant de la rébellion à une nouvelle vision de l'existence (qui n'est pas sans rappeler Keyes, encore une fois, même si le contexte est différent).
Et j'aurais tort d'oublier une scène d'ouverture absolument irrésistible, où l'on a l'impression d'assister à la scène comme si on y était et où l'état d'esprit du personnage, prise d'un fou rire irrépressible, incontrôlable, devient contagieux. Si vous ne devez lire que ces premières pages, cette première histoire, n'hésitez pas, ça fait un bien fou (même si on se sent un peu coupable)...
Au coeur de cette histoire, l'humanité, coincée entre son essence animale, son évolution vers une espèce qu'on dit intelligente, et la tentation du progrès permanent qui, par la science, entend lancer une nouvelle évolution, engendrer ce qui pourrait devenir une nouvelle espèce, sans pour autant résoudre les problèmes posés par les spécimens actuels.
La littérature se veut une manière de penser le monde, et nous voilà sans doute à un moment très important, où les observateurs du monde tel qu'il est et les rêveurs qui imaginent ce qu'il pourrait devenir se rejoignent autour d'interrogations et d'inquiétudes communes. Autour aussi de l'idée qu'il n'est pas trop tard pour raisonner tout cela et éviter que n'advienne ce qui nous guette...
Une jeune femme s'apprête à présenter des travaux scientifiques révolutionnaires lors d'un colloque réunissant nombre de sommités. Soudain, un accident, le truc bête, et la scientifique craque soudain. Une réaction tout à fait inappropriée, mais impossible à contrôler, qui pourrait remettre tout en cause en quelques secondes...
Un père de famille accompagne sa petite fille chez ses parents. Ensemble, ils vont prendre le TGV. L'homme est nerveux, tendu, redoutant de perdre la garde de la fillette à l'issue de la procédure de divorce qu'il entame. Aussi, quand son téléphone sonne et qu'il voit le numéro de son avocat s'afficher, décroche-t-il aussitôt et en oublie ses obligations paternelles...
La directrice administrative et financière d'une grosse entreprise est convoquée de bon matin dans le bureau de son patron. Elle s'y rend d'un bon pas, sans se douter qu'une terrible nouvelle l'y attend : non seulement elle est virée, mais en plus, elle va servir de bouc émissaire aux stratégies douteuses de la boîte. Ca fait un peu beaucoup et elle a beau être du genre zen, là, elle craque...
Pendant que sa baby-sitter se focalise sur son portable au lieu de garder un oeil sur lui, un bébé doit affronter seul un événement qui sort de l'ordinaire et qui voit son doudou, oui, son doudou adoré, terriblement malmené. Comment empêcher le pire quand on ne peut guère s'exprimer que par des cris, des babillements et que l'on est témoin de l'horreur à l'état pur ?
Une jeune femme prend un verre à la terrasse d'un café parisien avec des amies. A une table voisine, un jeune homme qui lui plaît bien... Une douce soirée, jusqu'à ce qu'un drame abominable, plus abominable encore parce que rien ne le laissait présager, se déroule... Et notre jeune femme qui se retrouve comme paralysée, incapable de quelque réaction que ce soit...
Cinq situations très différentes, certaines assez futiles, aux conséquences tragi-comiques, d'autres beaucoup plus graves ou qui auraient pu dégénérer... Et un point commun : à chaque fois, la personne concernée a perdu le contrôle. Le contrôle d'elle-même, le contrôle des événements, le contrôle sur les conséquences...
Quelques dizaines d'années plus tard, ce genre de problématique appartient au passé. En effet, grâce à la cérébration, on peut échapper à ces réactions dépourvues de maîtrise et pouvant entraîner des conséquences funestes. Grâce à cette opération, en fait, la greffe de cellules gliales (vous savez, ce sont celles qui se trouvent dans l'entourage des neurones), on ne perdra plus jamais le contrôle.
De cette manière, on saura rester calme et serein en toute circonstance, capable d'affronter sereinement n'importe quelle situation, mais aussi de renforcer certaines capacités cognitives essentiellement qui permettront à ceux qui choisiront de recourir à cette méthode de se démarquer. En un mot, d'être le ou la meilleur(e).
Mais, la contrepartie, c'est le risque aussi de perdre certaines émotions, de ne plus savoir réagir avec spontanéité, de ne plus être capable de lâcher prise quand la pression est trop forte... Bref, de faire sérieusement perdre à ceux qui ont eu recours à la cérébration une grande partie de ce qui fait d'eux des êtres humains.
La deuxième partie du livre met en scène de nouveaux personnages qui ont bénéficié de cette innovation technologique, pas toujours à leur demande, d'ailleurs, et qui se retrouvent dans des situations de tension ou de crise, ainsi armés. Ou étant en principe mieux armer pour faire face, sans que l'émotivité naturelle de l'être humain ne vienne tout gâcher...
Entre les deux parties, quelques dizaines d'années ont passés. Les cinq personnages que j'ai évoqués, ce sont nos voisins, nos amis, nos collègues, les gens que l'on croise dans la rue ou à la caisse d'un commerce. Bref, ces gens-là, ils sont nous, aujourd'hui, en 2018, dans une société qui ne pardonne aucun écart et peut se montrer très dure, très violente.
Laurent Quintreau n'invente rien : les recherches autour des cellules gliales existent et l'on envisage sérieusement ces greffes, à la manière des cellules souches dont on fait une panacée. En revanche, ce qu'il imagine, c'est la société d'après, quand la découverte d'aujourd'hui est devenue une réalité, et une méthode répandue, même si elle n'est peut-être pas accessible à tous.
Mais que changera-t-on vraiment en jouant ce petit jeu ? Voilà la question que pose le romancier, avec une inquiétude teintée de pessimisme qu'on retrouve jusque dans le titre de son livre : "Ce qui nous guette". Ouch, voilà qui a le mérite d'être clair, on entre dans la même zone de turbulence que celle qui entoure les Intelligences Artificielles, on dirait...
Autre interrogation de Laurent Quintreau à travers ces histoires entrecroisées : peut-on changer l'homme en l'améliorant, ou ne fait-on que renforcer ses bons, mais aussi ses mauvais côtés ? En quelque mots : rendre l'homme meilleur, est-ce vraiment le rendre meilleur ? Ah, oui, je joue avec les mots, mais c'est pourtant le noeud du problème.
D'un côté, rendre l'homme meilleur en termes de capacités, physiques et cognitives, un peu à l'image de ce que vit (subit ?) Charlie, le narrateur du roman de Daniel Keyes "Des fleurs pour Algernon" ; de l'autre, rendre l'homme meilleur sur le plan de la sociabilité, du rapport à l'autre, en essayant d'atténuer ses vilains défauts qui font monter la pression et le stress au quotidien.
L'exemple de Charlie rejoint d'ailleurs ceux de Laurent Quintreau, puisque, au fur et à mesure que l'expérience le rend plus intelligent, cultivé, génial, elle en fait un personnage odieux et égoïste, solitaire et malheureux... Impossible alors d'évacuer la pression, comme par la soupape d'une cocotte-minute, de lâcher prise, comme le chantaient les Massilia Sound System...
Comme la première partie, la seconde comprend donc plusieurs chapitres qui sont autant d'histoires individuelles, cette fois d'après la cérébration. Où l'on constate vite que les cellules gliales ne font pas le bonheur, que cette quête est plus complexe que cela. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi ce titre pour le billet, car le parallèle m'a semblé très pertinent.
La chirurgie esthétique avait pour but initial d'être une technique réparatrice, on se souvient qu'elle a énormément progressé suite aux terribles blessures issues de la Première Guerre mondiale. Mais, ensuite, lorsque cette discipline s'est répandu, elle a vite perdu de son côté essentiel pour devenir une espèce de cure de jouvence, de quête de l'immortelle beauté...
Ce que Laurent Quintreau décrit au sujet des cellules gliales, c'est peu ou prou un phénomène identique : d'abord répondre à une réelle problématique, du moins sur un plan scientifique, le genre de découverte qui vaut un Nobel, probablement. Mais, par la suite, cela devient un moyen de rechercher l'impossible bonheur, du moins, de laisser le moins de prise au malheur.
Il est d'ailleurs intéressant de noter que, une fois la technique banalisée, la personne qui s'y oppose le plus fortement est la scientifique même qui l'a mise au point. Et, puisqu'il y a une portée universelle à cette situation, Laurent Quintreau ne se contente pas des destins particuliers, mais envisage toute la société, jusque dans les questions idéologiques (politiques et religieuses) qui vont se poser.
Voilà pour le fond de ce livre, qui vaut aussi beaucoup par sa forme. J'ai déjà évoqué le côté atomisé du récit, puisqu'on a de multiples personnages qui se croisent, ou pas, d'ailleurs. On pourrait penser aux livres de Raymond Carver, et à ce qu'en a tiré Robert Altman pour le grand écran, c'est-à-dire "Short cuts", où des destins suivant des chemins très différents s'entremêlent.
Si j'en crois ce que j'ai lu concernant Laurent Quintreau, que je découvre, cette manière de faire est habituelle chez lui. "Ce qui guette" est son quatrième roman, le deuxième chez Rivages (il faut également ajouter un recueil de portraits, "Le Moi au pays du travail"), et il a toujours employé ce type de construction.
Mais, ce n'est pas la seule chose qui frappe, dans "Ce qui nous guette". La narration elle-même est tout à fait intéressante, puisqu'elle reprend à chaque chapitre le même vouvoiement qui peut s'adresser aussi bien au personnage qu'au lecteur, comme si l'auteur nous prenait à partie, nous lançait cet avertissement directement.
Un vouvoiement qui peut aussi donner une impression d'oralité, de discours direct, sans la distance que peut mettre l'écrit. Cela donne par moment quelques digressions, quelques détails qui donnent de la chair, font penser à celui qui raconte une histoire à ses postes en l'enjolivant avec une certaine truculence.
Mais, dans le même temps, la langue de Laurent Quintreau est riche, soutenue, sans devenir trop complexe, et ce n'est pas le langage qu'on emploierait justement autour d'une table, du comptoir d'un bistrot ou dans une réunion entre amis ou membres d'une famille. On est bien dans une oeuvre littéraire et cela se voit rapidement.
L'ensemble donne un cocktail assez troublant, entre réflexion politique (Laurent Quintreau occupe des fonctions dirigeantes à la CFDT) et philosophique, regard inquiet sur l'avenir, mais également une satire, servie par un humour pince-sans-rire que j'ai bien aimé, parce qu'il donne un peu de légèreté, un peu de recul au propos. Ok, c'est ce qui nous guette, mais il y a plus grave.
Ou alors, c'est une politesse du désespoir (amis des clichés, bonjour !)...
Cet humour, il permet d'ailleurs à l'auteur de finir son livre sur une note pleine d'ironie (ou de cynisme, même), avec une dernière histoire en forme de morale. Derrière le décalage, derrière le côté drôle et grinçant, pas mal de sujets de réflexion, allant de la rébellion à une nouvelle vision de l'existence (qui n'est pas sans rappeler Keyes, encore une fois, même si le contexte est différent).
Et j'aurais tort d'oublier une scène d'ouverture absolument irrésistible, où l'on a l'impression d'assister à la scène comme si on y était et où l'état d'esprit du personnage, prise d'un fou rire irrépressible, incontrôlable, devient contagieux. Si vous ne devez lire que ces premières pages, cette première histoire, n'hésitez pas, ça fait un bien fou (même si on se sent un peu coupable)...
Au coeur de cette histoire, l'humanité, coincée entre son essence animale, son évolution vers une espèce qu'on dit intelligente, et la tentation du progrès permanent qui, par la science, entend lancer une nouvelle évolution, engendrer ce qui pourrait devenir une nouvelle espèce, sans pour autant résoudre les problèmes posés par les spécimens actuels.
La littérature se veut une manière de penser le monde, et nous voilà sans doute à un moment très important, où les observateurs du monde tel qu'il est et les rêveurs qui imaginent ce qu'il pourrait devenir se rejoignent autour d'interrogations et d'inquiétudes communes. Autour aussi de l'idée qu'il n'est pas trop tard pour raisonner tout cela et éviter que n'advienne ce qui nous guette...
Pour finir, une ITW de Laurent Quintreau.
samedi 14 avril 2018
"Le seul homme honnête dans tout ce bordel s'excuse d'être honnête".
Pour Bénabar, l'homme honnête est le plus bizarres des phénomènes de foire, et cela semble se confirmer dans notre roman du jour, hélas. A l'époque des "fake news", des "alternative facts" et autres expressions apparues récemment dans notre quotidien, le mensonge semble nous cerner de toutes parts. A qui peut-on encore faire confiance ? Iain Levison, auteur de "Arrêtez-moi là !" et "Ils savent tout de vous", s'empare de ce sujet avec gourmandise, cynisme, mais sans doute aussi un brin d'inquiétude, pour en faire un élément central de son dernier livre en date, "Pour services rendus", qui vient de sortir en grand format aux éditions Liana Levi (traduction de Fanchita Gonzalez Batlle). Ou comment un petit arrangement de rien du tout avec la vérité se transforme en une énorme boule de mensonges bien embarrassants et qu'on ne peut plus glisser discrètement sous le tapis... Moralité, à l'ère des réseaux sociaux, surveillez ce que vous dites, tout pourra être retenu contre vous !
Fremantle est le chef de la police d'une petite ville du Michigan, Kearns, où il doit se débattre entre une criminalité en hausse et un budget en baisse. Septuagénaire, il a eu une longue carrière de flic avant d'occuper ces responsabilités et il commence à réfléchir à sa succession, car l'envie de couler une paisible retraite aux côtés de son épouse, Cara, commence à le tarauder.
Jusqu'à ce jour d'automne 2016 où il reçoit une curieuse visite. Deux hommes qui débarquent du Nouveau-Mexique (si vous n'avez pas en tête la carte des Etats-Unis, cela représente un voyage de 2500km du sud-ouest au nord-est) et voudraient le rencontrer. Fremantle accepte de les recevoir, mais il n'a pas l'intention de perdre trop de temps avec ces zigotos.
Et pourtant...
Les deux visiteurs, en prononçant un simple nom, vont renvoyer Fremantle à sa lointaine jeunesse, presque cinquante ans plus tôt, lorsqu'il était sergent au Vietnam... Ce nom, c'est celui de Wilson Drake. Un jeune homme que Fremantle a connu à son arrivée en Asie, alors qu'il n'était qu'un bleu, maladroit comme toutes les recrues, mais pas vraiment fait pour la vie militaire.
Fremantle n'a aucune nostalgie de cette époque et, depuis son retour aux Etats-Unis, il n'a jamais vraiment cherché à reprendre contact avec les hommes qu'il a côtoyé au feu. Aussi est-il très surpris d'apprendre que Wilson Drake, qu'il appelait alors Billy, est devenu sénateur et qu'il brigue actuellement un nouveau mandat.
Surpris, mais pas impressionné, encore moins concerné. Tant mieux pour lui ! Oui, mais voilà, cette réélection est loin d'être acquise et Fremantle pourrait, s'il acceptait un voyage-éclair au Nouveau-Mexique, donner un sacré coup de pouce à son ancien subalterne. Car, ce qui menace Drake en ce moment, c'est justement une histoire remontant à sa présence au Vietnam...
Que s'est-il passé ? Eh bien, lors d'une rencontre comme on en fait tant au cours d'une campagne électorale, le sénateur Wilson Drake a raconté une anecdote croustillante dans laquelle il était impliqué, provoquant l'hilarité générale. L'intervention a été filmée et, comme c'est souvent le cas, désormais, elle a fini sur YouTube.
Or, un autre ancien combattant, Peterson, a tiqué en entendant cette histoire : Drake s'est donné le beau rôle et, ce faisant, il a menti. Un mensonge de rien, qui n'a pas arrangé une anecdote à sa sauce en prenant quelque liberté avec la vérité pour faire marrer la galerie ? Oui, mais là, c'est un peu embêtant, car cela concerne la vie militaire, et des compétences que ne possédaient pas Drake...
Alors, Peterson a fait connaître son indignation et l'équipe du concurrent de Drake à l'élection s'en est emparé. Voilà Drake accusé d'un mensonge, certes véniel, mais qui est presque pire qu'un crime pour un homme politique aux Etats-Unis (souvenez-vous de Bill Clinton), et il faut au plus vite désamorcer la bombe pour éviter une chute dans les sondages, à quelques jours du scrutin...
Le démineur, c'est Fremantle : il était le supérieur de Drake, il était présent au moment des faits, il doit forcément s'en souvenir, il lui suffit d'aller dans le sens de Drake et de lui apporter son soutien et ensuite, il pourra rentrer tranquillement à Kearns... Même si Fremantle sait que Drake a menti (et le lecteur aussi), il accepte.
Et il met ainsi le doigt dans un engrenage terrible...
Avant d'aller plus loin, un mot sur les titres de ce roman. "Les", parce qu'on va évoquer le titre de la version française et le titre original. Commençons par le titre français, "Pour services rendus". Il est plutôt malins, joue avec une expression militaire, mais aussi avec le fait que Drake pourrait remercier son ancien sergent pour son aide.
On retrouve dans ces trois mots un certain cynisme qui ne dépare pas l'esprit du roman de Iain Levison, bien au contraire. Car ce n'est qu'à la toute fin du livre, dans ses dernières pages, que l'on mesure la véritable ironie qui accompagne ce titre, à la lumière de la chute, aussi inattendue que dérangeante, de cette histoire.
Et puis, il y a le titre original : "Version of events", qu'on pourrait traduire par "version des faits". On est au coeur de cette histoire : des versions différentes d'une même situation qui s'affrontent, sans aucun autre élément de preuve que les paroles des uns et des autres. Le mensonge (même bénin, je le redis) contre la vérité...
Là où Iain Levison est très malin, c'est dans la mécanique qu'il met en place, implacable, terrible, un peu sordide, au final, mais que rien n'obligeait à mettre en branle. La première scène du livre nous emmène donc au Vietnam, à la fin des années 1960, pour nous faire découvrir des événements somme toute assez banals dans une période de guerre.
A ce moment-là, le lecteur ne sait pas encore de quoi il va s'agir. Il le comprend quelques pages plus tard en voyant la fameuse vidéo et Drake mettre les rieurs de son côté en se donnant le beau rôle. Nous sommes dans la position de Peterson, nous savons qu'il ment. Mais, ment-il consciemment ou, avec le temps, a-t-il fini par croire à sa version de l'histoire ?
Lorsque la réponse de Peterson déclenche un début de polémique, il aurait certainement suffi de reconnaître l'erreur, de plaider la bonne foi, de dire que la mémoire peut jouer des tous après cinquante ans... Mais, Drake et son équipe, emmenée par un conseiller nommé Devlin, un homme de l'ombre qui sait faire gagner les élections, à sa manière, ne vont pas réagir ainsi.
Ils vont donc vouloir contredire Peterson, s'enferrer dans le mensonge qui, d'un seul coup, devient nettement moins véniel. Et qui, aussi insignifiant soit-il, va devenir un enjeu important de cette élection. Ensuite, comme Iain Levison sait remarquablement le faire, de ce point de départ sans grand relief, va naître une boule de neige menaçant de se transformer en avalanche...
Au milieu de tout cela, le pauvre Fremantle. Un gars sans histoire, à la carrière exemplaire, aux états de service immaculés, un bon sergent quand il était au Vietnam, un bon flic ensuite. Fremantle déteste les menteurs, nous dit-on. Il devrait donc détester Drake, même pour cette histoire sans intérêt qui lui vaut des ennuis.
Pourtant, il va accepter de l'aider. Puis accepter certaines contreparties. Et se retrouver embarqué dans une histoire qui devait être étouffée dans l'oeuf et qui va prendre des proportions aussi inattendues que désagréables... Mais qu'allait faire Fremantle dans cette galère, se demande-t-on aussitôt, sans qu'on ait de réponse très claire à cette question.
Le mensonge... La force du roman de Iain Levison, c'est vraiment de jouer sur ces histoires absolument sans importance. Rien qui puisse disqualifier un homme dans des fonctions qu'il exercerait un demi-siècle plus tard. Mais Drake est un politique, un malin, un machiavélique, prêt à tout pour le pouvoir.
Cette histoire de vidéo sur YouTube ressemble plus à une maladresse qu'à autre chose : le sénateur et son équipe ont oublié que notre époque était celle de l'image en continu, des portables qui se transforment en caméra et des réseaux sociaux où tout se répand comme une traînée de poudre. Aux Etats-Unis, on ne rigole pas avec la guerre et avec l'héroïsme. Et encore moins avec le mensonge.
Je ne suis pas certain, même dans le climat actuel, qu'une telle histoire occasionnerait les mêmes situations de notre côté de l'Atlantique. Je me dis même qu'avec ce point de départ, on pourrait imaginer un scénario de comédie, une espèce de vaudeville à bases de quiproquo et malentendus. Une satire du monde politique, certes, mais d'abord pour en rire.
Mais, la démarche de Iain Levison n'est pas celle-là, et on peut le comprendre, eu égard au contexte politique aux Etats-Unis depuis la dernière élection présidentielle : il n'y a plus de mensonge véniels, tous peuvent avoir des conséquences néfastes, pas pour celui qui les profèrent, mais pour ceux qui les croix. La morale de ce roman, c'est qu'il est temps d'inverser cette tendance.
Il y a aussi l'impression que plus c'est gros et plus ça passe, pardon pour la trivialité du propos, mais on se dit que Drake pourrait enquiller les mensonges les plus énormes, il serait sans doute moins embarrassé que face à ce témoignage sorti de nulle part ou presque à propos d'un événement mineur qui n'aurait jamais dû refaire surface.
Reste qu'on ne voit pas bien la finalité de cette histoire. On se demande quelle direction va prendre cette histoire et, petit à petit, on se dit qu'en jouant avec cette anecdote, Drake a pris un risque qu'il n'a sans doute pas mesuré : celui de voir resurgir d'autres souvenirs beaucoup moins anecdotiques, justement, que l'histoire qui a tout déclenché...
"Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille", avait coutume de dire Jacques Chirac quand il était en fonction, et ce roman en est la démonstration. Pour Audiard, c'était les cons, et pour Levison, ce sont les mensonges. On tire sur un bout de fil et, sans même le faire exprès, on fait apparaître une série de faits qui, là, sont carrément gênants...
Gênants pour Drake, qui se dirigeait jusque-là vers une réélection en père peinard, mais aussi pour Fremantle. Car c'est bien sur lui que le roman est centré, pas sur Drake. Il semble n'être qu'un spectateur de cette tragi-comédie politicienne, ce théâtre qu'est cette campagne (car ne croyez pas que le concurrent de Drake soit un saint, ce serait trop facile), à moins que...
"Pour services rendus" est un court roman, 220 pages tout au plus, mais d'une grande densité, construit autour de la situation de plus en plus intenable de Fremantle, qui se laisse emberlificoter assez naïvement dans ces mensonges. C'est en tout cas l'impression que l'on a dans un premier temps. Mais qu'en est-il une fois le livre refermé ?
Iain Levison joue avec des valeurs importantes que sont la vérité, la sincérité, la loyauté, l'honnêteté, on y revient puisqu'on a entamé ce billet avec ce thème. Il s'en amuse, mais le sourire est bien jaune, on le ressent aussi. La satire est sévère, mais touche dans le mille et rappelle qu'il n'y a pas de prescription pour les menteurs.
Son récit est un vrai jeu de quilles, la première qui tombe entraîne les autres dans un strike imparable. En une espèce d'effet papillon (ah non, pas encore Bénabar !), le mensonge de départ va chambouler plusieurs existences et avoir des conséquences dont on peut se demander si elles ne seront pas pires encore que le statu quo...
On referme ce roman sur une dernière phrase qui résonne, résonne... Et qui sonne assez désagréablement aux oreilles, car on se retrouve d'un seul coup avec une situation qu'on subodorait, mais sans pouvoir la comprendre, et qui, soudain, s'éclaire. Avec ces derniers mots, on a enfin la vérité au bout de la pelote de fil, la seule version des faits qui vaille.
Et elle n'est pas très glorieuse...
Fremantle est le chef de la police d'une petite ville du Michigan, Kearns, où il doit se débattre entre une criminalité en hausse et un budget en baisse. Septuagénaire, il a eu une longue carrière de flic avant d'occuper ces responsabilités et il commence à réfléchir à sa succession, car l'envie de couler une paisible retraite aux côtés de son épouse, Cara, commence à le tarauder.
Jusqu'à ce jour d'automne 2016 où il reçoit une curieuse visite. Deux hommes qui débarquent du Nouveau-Mexique (si vous n'avez pas en tête la carte des Etats-Unis, cela représente un voyage de 2500km du sud-ouest au nord-est) et voudraient le rencontrer. Fremantle accepte de les recevoir, mais il n'a pas l'intention de perdre trop de temps avec ces zigotos.
Et pourtant...
Les deux visiteurs, en prononçant un simple nom, vont renvoyer Fremantle à sa lointaine jeunesse, presque cinquante ans plus tôt, lorsqu'il était sergent au Vietnam... Ce nom, c'est celui de Wilson Drake. Un jeune homme que Fremantle a connu à son arrivée en Asie, alors qu'il n'était qu'un bleu, maladroit comme toutes les recrues, mais pas vraiment fait pour la vie militaire.
Fremantle n'a aucune nostalgie de cette époque et, depuis son retour aux Etats-Unis, il n'a jamais vraiment cherché à reprendre contact avec les hommes qu'il a côtoyé au feu. Aussi est-il très surpris d'apprendre que Wilson Drake, qu'il appelait alors Billy, est devenu sénateur et qu'il brigue actuellement un nouveau mandat.
Surpris, mais pas impressionné, encore moins concerné. Tant mieux pour lui ! Oui, mais voilà, cette réélection est loin d'être acquise et Fremantle pourrait, s'il acceptait un voyage-éclair au Nouveau-Mexique, donner un sacré coup de pouce à son ancien subalterne. Car, ce qui menace Drake en ce moment, c'est justement une histoire remontant à sa présence au Vietnam...
Que s'est-il passé ? Eh bien, lors d'une rencontre comme on en fait tant au cours d'une campagne électorale, le sénateur Wilson Drake a raconté une anecdote croustillante dans laquelle il était impliqué, provoquant l'hilarité générale. L'intervention a été filmée et, comme c'est souvent le cas, désormais, elle a fini sur YouTube.
Or, un autre ancien combattant, Peterson, a tiqué en entendant cette histoire : Drake s'est donné le beau rôle et, ce faisant, il a menti. Un mensonge de rien, qui n'a pas arrangé une anecdote à sa sauce en prenant quelque liberté avec la vérité pour faire marrer la galerie ? Oui, mais là, c'est un peu embêtant, car cela concerne la vie militaire, et des compétences que ne possédaient pas Drake...
Alors, Peterson a fait connaître son indignation et l'équipe du concurrent de Drake à l'élection s'en est emparé. Voilà Drake accusé d'un mensonge, certes véniel, mais qui est presque pire qu'un crime pour un homme politique aux Etats-Unis (souvenez-vous de Bill Clinton), et il faut au plus vite désamorcer la bombe pour éviter une chute dans les sondages, à quelques jours du scrutin...
Le démineur, c'est Fremantle : il était le supérieur de Drake, il était présent au moment des faits, il doit forcément s'en souvenir, il lui suffit d'aller dans le sens de Drake et de lui apporter son soutien et ensuite, il pourra rentrer tranquillement à Kearns... Même si Fremantle sait que Drake a menti (et le lecteur aussi), il accepte.
Et il met ainsi le doigt dans un engrenage terrible...
Avant d'aller plus loin, un mot sur les titres de ce roman. "Les", parce qu'on va évoquer le titre de la version française et le titre original. Commençons par le titre français, "Pour services rendus". Il est plutôt malins, joue avec une expression militaire, mais aussi avec le fait que Drake pourrait remercier son ancien sergent pour son aide.
On retrouve dans ces trois mots un certain cynisme qui ne dépare pas l'esprit du roman de Iain Levison, bien au contraire. Car ce n'est qu'à la toute fin du livre, dans ses dernières pages, que l'on mesure la véritable ironie qui accompagne ce titre, à la lumière de la chute, aussi inattendue que dérangeante, de cette histoire.
Et puis, il y a le titre original : "Version of events", qu'on pourrait traduire par "version des faits". On est au coeur de cette histoire : des versions différentes d'une même situation qui s'affrontent, sans aucun autre élément de preuve que les paroles des uns et des autres. Le mensonge (même bénin, je le redis) contre la vérité...
Là où Iain Levison est très malin, c'est dans la mécanique qu'il met en place, implacable, terrible, un peu sordide, au final, mais que rien n'obligeait à mettre en branle. La première scène du livre nous emmène donc au Vietnam, à la fin des années 1960, pour nous faire découvrir des événements somme toute assez banals dans une période de guerre.
A ce moment-là, le lecteur ne sait pas encore de quoi il va s'agir. Il le comprend quelques pages plus tard en voyant la fameuse vidéo et Drake mettre les rieurs de son côté en se donnant le beau rôle. Nous sommes dans la position de Peterson, nous savons qu'il ment. Mais, ment-il consciemment ou, avec le temps, a-t-il fini par croire à sa version de l'histoire ?
Lorsque la réponse de Peterson déclenche un début de polémique, il aurait certainement suffi de reconnaître l'erreur, de plaider la bonne foi, de dire que la mémoire peut jouer des tous après cinquante ans... Mais, Drake et son équipe, emmenée par un conseiller nommé Devlin, un homme de l'ombre qui sait faire gagner les élections, à sa manière, ne vont pas réagir ainsi.
Ils vont donc vouloir contredire Peterson, s'enferrer dans le mensonge qui, d'un seul coup, devient nettement moins véniel. Et qui, aussi insignifiant soit-il, va devenir un enjeu important de cette élection. Ensuite, comme Iain Levison sait remarquablement le faire, de ce point de départ sans grand relief, va naître une boule de neige menaçant de se transformer en avalanche...
Au milieu de tout cela, le pauvre Fremantle. Un gars sans histoire, à la carrière exemplaire, aux états de service immaculés, un bon sergent quand il était au Vietnam, un bon flic ensuite. Fremantle déteste les menteurs, nous dit-on. Il devrait donc détester Drake, même pour cette histoire sans intérêt qui lui vaut des ennuis.
Pourtant, il va accepter de l'aider. Puis accepter certaines contreparties. Et se retrouver embarqué dans une histoire qui devait être étouffée dans l'oeuf et qui va prendre des proportions aussi inattendues que désagréables... Mais qu'allait faire Fremantle dans cette galère, se demande-t-on aussitôt, sans qu'on ait de réponse très claire à cette question.
Le mensonge... La force du roman de Iain Levison, c'est vraiment de jouer sur ces histoires absolument sans importance. Rien qui puisse disqualifier un homme dans des fonctions qu'il exercerait un demi-siècle plus tard. Mais Drake est un politique, un malin, un machiavélique, prêt à tout pour le pouvoir.
Cette histoire de vidéo sur YouTube ressemble plus à une maladresse qu'à autre chose : le sénateur et son équipe ont oublié que notre époque était celle de l'image en continu, des portables qui se transforment en caméra et des réseaux sociaux où tout se répand comme une traînée de poudre. Aux Etats-Unis, on ne rigole pas avec la guerre et avec l'héroïsme. Et encore moins avec le mensonge.
Je ne suis pas certain, même dans le climat actuel, qu'une telle histoire occasionnerait les mêmes situations de notre côté de l'Atlantique. Je me dis même qu'avec ce point de départ, on pourrait imaginer un scénario de comédie, une espèce de vaudeville à bases de quiproquo et malentendus. Une satire du monde politique, certes, mais d'abord pour en rire.
Mais, la démarche de Iain Levison n'est pas celle-là, et on peut le comprendre, eu égard au contexte politique aux Etats-Unis depuis la dernière élection présidentielle : il n'y a plus de mensonge véniels, tous peuvent avoir des conséquences néfastes, pas pour celui qui les profèrent, mais pour ceux qui les croix. La morale de ce roman, c'est qu'il est temps d'inverser cette tendance.
Il y a aussi l'impression que plus c'est gros et plus ça passe, pardon pour la trivialité du propos, mais on se dit que Drake pourrait enquiller les mensonges les plus énormes, il serait sans doute moins embarrassé que face à ce témoignage sorti de nulle part ou presque à propos d'un événement mineur qui n'aurait jamais dû refaire surface.
Reste qu'on ne voit pas bien la finalité de cette histoire. On se demande quelle direction va prendre cette histoire et, petit à petit, on se dit qu'en jouant avec cette anecdote, Drake a pris un risque qu'il n'a sans doute pas mesuré : celui de voir resurgir d'autres souvenirs beaucoup moins anecdotiques, justement, que l'histoire qui a tout déclenché...
"Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille", avait coutume de dire Jacques Chirac quand il était en fonction, et ce roman en est la démonstration. Pour Audiard, c'était les cons, et pour Levison, ce sont les mensonges. On tire sur un bout de fil et, sans même le faire exprès, on fait apparaître une série de faits qui, là, sont carrément gênants...
Gênants pour Drake, qui se dirigeait jusque-là vers une réélection en père peinard, mais aussi pour Fremantle. Car c'est bien sur lui que le roman est centré, pas sur Drake. Il semble n'être qu'un spectateur de cette tragi-comédie politicienne, ce théâtre qu'est cette campagne (car ne croyez pas que le concurrent de Drake soit un saint, ce serait trop facile), à moins que...
"Pour services rendus" est un court roman, 220 pages tout au plus, mais d'une grande densité, construit autour de la situation de plus en plus intenable de Fremantle, qui se laisse emberlificoter assez naïvement dans ces mensonges. C'est en tout cas l'impression que l'on a dans un premier temps. Mais qu'en est-il une fois le livre refermé ?
Iain Levison joue avec des valeurs importantes que sont la vérité, la sincérité, la loyauté, l'honnêteté, on y revient puisqu'on a entamé ce billet avec ce thème. Il s'en amuse, mais le sourire est bien jaune, on le ressent aussi. La satire est sévère, mais touche dans le mille et rappelle qu'il n'y a pas de prescription pour les menteurs.
Son récit est un vrai jeu de quilles, la première qui tombe entraîne les autres dans un strike imparable. En une espèce d'effet papillon (ah non, pas encore Bénabar !), le mensonge de départ va chambouler plusieurs existences et avoir des conséquences dont on peut se demander si elles ne seront pas pires encore que le statu quo...
On referme ce roman sur une dernière phrase qui résonne, résonne... Et qui sonne assez désagréablement aux oreilles, car on se retrouve d'un seul coup avec une situation qu'on subodorait, mais sans pouvoir la comprendre, et qui, soudain, s'éclaire. Avec ces derniers mots, on a enfin la vérité au bout de la pelote de fil, la seule version des faits qui vaille.
Et elle n'est pas très glorieuse...
mercredi 11 avril 2018
"Les romanciers sont des menteurs, (...) ils finissent par prendre leurs mensonges pour la réalité".
Aïe, après Olivier Barde-Cabuçon, nouveau flagrant délit d'infidélité à une série (mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa), mais grand plaisir de retrouver un personnage de flic que j'ai apprécié dès sa première enquête et qui a fait depuis un sacré chemin. Une série dont j'aime aussi l'atmosphère sombre et les décors, puisque nous allons dans la région toulousaine. "Soeurs" (qui vient de sortir en grand format aux éditions XO) est le cinquième volet de la série de Bernard Minier mettant en scène le capitaine Servaz. Un tome qui marque un tournant, après les événements intervenus lors de la précédente enquête, "Nuit" (qui vient de sortir en poche, et qu'il faudra que je lise, promis), mais aussi un roman un peu particulier. D'abord, parce qu'il contient deux histoires en une, ensuite, parce qu'on va découvrir le jeune Servaz, enfin, parce qu'il y est question d'écriture, d'écrivain et de romans, avec une intéressante mise en abyme...
Printemps 1993. Un rameur aperçoit sur l'île du Ramier, en plein coeur de Toulouse, une scène qui le glace d'effroi. Pensant avoir rêvé, il va voir de plus près et découvre une scène effroyable. Deux corps, placés face à face, ligotés chacun à un arbre... Une mise en scène macabre que renforce encore la tenue des victimes : elles portent une aube, comme si elles venaient de faire leur communion.
Le groupe de l'inspecteur principal Kowalski se retrouve chargé de l'enquête, dans des conditions un peu particulières, puisque l'Hôtel de police de la Ville rose est en plein déménagement. Parmi les hommes concernés par cette enquête, un jeune homme, tout juste muté à Toulouse : Martin Servaz, frais émoulu de l'école d'officier.
Quatre ans pile après le suicide de son père, il revient dans le sud-ouest, avec son épouse et sa fillette. Un couple qui bat déjà de l'aile, même si Alexandra et lui n'osent pas encore affronter le problème. Il doit faire abstraction de ces soucis personnels pour trouver sa place dans son nouvel environnement professionnel. Pour sa première enquête, il n'aurait pas pu trouver pire...
Les premières investigations permettent d'identifier les victimes : Ambre, 21 ans, Alice, 20 ans, deux soeurs dont la famille vit dans le Gers et qui faisaient leurs études à Toulouse. Pas vraiment le genre d'information qui allège une atmosphère bien lourde depuis la découverte des cadavres. Mais, peut-être aussi un élément qui pourrait faciliter la tâche des policiers.
Rapidement, un lien apparaît : les deux soeurs appréciaient apparemment beaucoup les romans d'un écrivains de thrillers, Erik Lang, qu'elles ont rencontré quelques années plus tôt et avec qui elles ont entretenu une correspondance assez explicite depuis... De quoi le rendre suspect en soi, mais plus encore parce que son roman le plus connu s'intitule "la Communiante"...
Kowalski semble persuadé qu'il tient le coupable, et tout son groupe aussi, Servaz compris. Encore faut-il le prouver, ou obtenir des aveux. Les flics vont "travailler" leur suspect principal en garde à vue, mais un rebondissement inattendu va couper leur élan. Et va surtout mettre brusquement fin à cette enquête.
Pour sa première enquête, Servaz garde un goût amer. Non seulement ce dénouement ne le convainc pas du tout, mais surtout, il a laissé un peu de son innocence en salle d'interrogatoire, dégoûté par les méthodes employés par Kowalski et ses autres collègues pour faire parler Erik Lang... Servaz l'idéaliste s'est déjà placé en marge pour ses débuts...
Hiver 2018. Servaz est désormais capitaine, et non plus commandant (conséquence des événements racontés dans les précédents tomes), et toujours en poste à Toulouse. Un matin très tôt, on l'appelle pour un meurtre, presque la routine. Mais, lorsqu'il réalise où on le conduit, un désagréable sentiment l'envahit...
Il se confirme bien vite : c'est chez Erik Lang que les policiers ont rendez-vous. L'épouse de l'écrivain vient d'être retrouvée morte, et tout indique qu'elle a été assassinée. Là encore, la scène de crime est du genre qui marque les esprits. Mais surtout, un élément glace Servaz : la victime porte elle aussi un vêtement de communiante...
En quelques instants, voilà le policier projeté 25 ans en arrière, et ses soupçons d'hier resurgissent au grand galop. Comment ne pas soupçonner Erik Lang, encore une fois ? Comment résister à l'envie de le coincer, coûte que coûte ? Une enquête complexe débute, avec un Servaz sur les nerfs qui n'envisage aucune autre piste et s'entête, jusqu'à retomber dans ses travers...
Des romans, thrillers ou non, qui se déroulent à deux époques différentes, ce n'est pas une nouveauté, on en trouve beaucoup, par exemple, qui font s'entrecroiser ces deux fils narratifs en faisant alterner un chapitre dans une époque, le suivant dans l'autre. Mais, ce n'est pas ce qu'a choisi de faire Bernard Minier pour "Soeurs".
Les deux époques sont clairement séparées et on découvre donc deux enquêtes distinctes à 25 ans d'écart qui se succèdent. Avec deux dénominateurs communs : Martin Servaz, le policier, et Erik Lang, l'écrivain. Comme si Servaz, privé de son habituelle Némésis, Julian Hirtmann, devait se trouver un nouvel adversaire à qui se mesurer.
Mais, et c'est un des grands intérêts de la construction en deux parties distinctes de "Soeurs", on va vite comprendre que le Servaz de 2018 n'a plus grand-chose à voir avec celui de 1993. Le temps a fait son oeuvre, bien sûr, le jeune flic que tout le monde prenait pour un étudiant, avec ses cheveux un peu trop longs, est désormais un officier expérimenté, approchant la cinquantaine.
Pourtant, le revoilà jeune père. Ce n'est plus Margot qu'il élève, mais Gustav, encore sujet à de rudes cauchemars, même s'il semble s'adapter à son nouvel environnement familial. Les cauchemars, Servaz en fait aussi, comme si cette enquête qui le renvoie au passé réveillait certains traumatismes pas encore complètement guéris...
Pourtant, les changements qui frappent le plus sont ailleurs. Ils vont apparaître petit à petit, dans la deuxième partie, jusqu'au final où cela devient patent : le Servaz idéaliste des débuts est loin, le Servaz de 2018 ressemble à ce Kowalski qui lui avait tant déplu... Comme si l'usure de l'âge, l'érosion due aux horreurs accumulées, au stress, professionnel et personnel, avaient dénaturé ses principes...
J'ai qualifié ce tome de tournant, en introduction, et cela se confirme. Mais, il ne faut pas limiter cette impression à l'unique question Hirtmann. Dans "Soeurs", c'est tout son passé que Servaz solde une bonne fois pour toutes. Il y a une prise de conscience de la part du policier autant que de l'homme, il y a une sorte de libération et l'annonce d'une nouvelle ère.
En fait, il me vient (c'est pas vrai, c'est longuement mûri...) une métaphore : c'est comme si Servaz se défaisait d'une mue, comme un reptile. Bon, si vous n'avez pas lu le livre, vous aurez du mal à saisir ce raisonnement qui me semble à la fois subtil et pertinent (oui, je m'envoie quelques fleurs, il n'y a pas de raison).
J'ignore ce que va faire Bernard Minier, quelle suite il envisage de donner à sa série construite autour de Servaz. Je crois savoir qu'il y a un projet de one-shot dans le même décor que "Une putain d'histoire", et ensuite ? Je serais en tout cas très curieux de retrouver Martin Servaz, un Servaz délivré d'un poids conséquent.
Je ne l'imagine pas métamorphosé du tout au tout, devenu un joyeux luron et un optimiste forcené, on aurait du mal à y croire. Mais, un personnage un peu moins tourmenté, moins tiraillé entre ses états d'âme personnel, qu'ils concernent sa famille ou sa relation ambiguë avec Hirtmann ; un personnage apaisé, là, voilà, je lâche le mot, apaisé, ce qui aurait forcément quelques répercussions sur sa carrière et sa vie.
Je referme la parenthèse Servaz pour parler de l'autre protagoniste central de "Soeurs", Erik Lang. En fait, ce n'est pas temps du personnage lui-même qu'on va parler, mais de son rôle d'écrivain, comme vous l'aurez compris en lisant le titre de ce billet. La personnalité d'Erik Lang, je vous la laisse découvrir, tout comme je vous laisse vous forger une opinion à son sujet.
"Soeurs" est un roman où il est beaucoup question d'écriture, de livres, d'écrivains, mais aussi de lecteurs, eh oui, nous sommes aussi, vous qui me lisez et moi, concernés. Bernard Minier, en plaçant au coeur de son intrigue un auteur, et un auteur de thrillers, en profite pour poser des problématiques qui l'intéressent au premier chef.
D'abord, il s'amuse, avec quelques clins d'oeil. A certains de ses petits camarades, comme beaucoup d'autres le font. Dans la bibliographie d'Erik Lang, certains titres devraient vous rappeler d'autres livres que vous avez peut-être dans vos bibliothèques. Mais, il y a aussi quelque chose de Bernard Minier chez lui, le parallèle est évident.
On pourrait penser qu'on est dans le jeu, et rien de plus. Pourtant, c'est un peu plus que cela, car la relation entre Servaz et Lang, pour le moins tendue, va aussi se nourrir de cette mise en abyme. Un jeu de miroirs qui fait sourire, mais qui intervient aussi à un moment très important de l'intrigue, lorsque la tension est à son comble.
On retrouve l'importance de cette double histoire à deux époques, puisque, d'une certaine manière, Servaz et Lang sont restés liés tout ce temps, plus ou moins consciemment, et que l'écriture a nourri ce lien invisible. Je n'en dis pas plus, ce n'est d'ailleurs pas forcément ce qui est le plus important dans tout ça.
En revanche, j'ai retrouvé certains questionnement chez Bernard Minier qui apparaissent régulièrement chez d'autres auteurs de thrillers, à commencer par Maxime Chattam, qui en a fait une de ses marques de fabrique : l'influence de ces histoires qui recourt à la violence, une violence exacerbée, spectaculaire, qu'on cherche à exorciser, mais qui laisse bien quelques traces.
Cauchemardez-vous aussi, Monsieur Minier ? Je plaisante, mais c'est vrai qu'on ne manipule pas ces sujets au quotidien (surtout quand on sait qu'un écrivain qui a une idée s'y accroche jour et nuit) sans qu'il y ait quelques effets secondaires. En cela, Erik Lang est un cas intéressant, puisqu'on le soupçonne d'être passé de l'autre côté du miroir. D'avoir pris ses mensonges pour la réalité...
La question de l'inspiration, la frontière entre la réalité et la fiction, la distance qu'on place entre les deux et qui fait que ce qui nous horrifie dans un thriller reste un événement "pour de faux", toute cette mécanique que construisent les écrivains et que les lecteurs mettent en mouvement, tout cela repose finalement sur des conventions.
Heureusement que les auteurs de thrillers ne sont pas adeptes de l'autofiction et qu'ils racontent ce qui leur passe par la tête, ce qui nourrit leur imaginaire et non ce qu'ils ont accompli ! Mais l'idée de romans policiers utilisés comme modes d'emploi pour perpétrer des crimes est une idée très classique, que l'on retrouve régulièrement traitée.
Il y a une espèce de mouvement perpétuel qui s'instaure entre écrivains et lecteurs, les idées des uns touchant les autres, tandis que l'inspiration se saisit des opportunités portées par l'actualité, l'air du temps, les histoires qu'on entend ici ou là, parfois de la part de lecteurs... Un phénomène qu'il faut accepter tel quel, et ne surtout pas chercher à expliquer.
Et puis, au centre de "Soeurs", il y a aussi la relation entre les auteurs et les lecteurs. Et, là encore, la construction double du roman permet de mesurer son incroyable évolution en très peu de temps. Pendant très longtemps, cette relation était exceptionnel et le plus souvent indirecte. L'écrivain écrivait, le lecteur lisait, chacun dans son coin, et basta.
Alice et Ambre ont la chance, si on peut dire, d'avoir rencontré en chair et en os l'écrivain qu'elles adoraient. Une intimité s'est formée, on est dans de la littérature noire, donc ce n'est forcément pas très, très clair, tout ça, mais le fait est que cela reste alors quelque chose de peu fréquent, pour des personnes qui ne sont liées que par cette passion commune.
Mais, en 2018, tout a changé. Désormais, les écrivains sont bien plus accessibles, en tout cas ceux qui jouent le jeu. Il y a les salons, les rencontres, les cafés littéraires, la promo, parfois, autant d'occasions de sortir de son bureau et de se montrer, d'entrer en contact avec les lecteurs, directement ou indirectement. Mais, la distance s'est raccourcie.
Et c'est encore plus criant avec les réseaux sociaux. Le lecteur devient vite le meilleur ami de l'auteur, en tout cas virtuellement. Mais, du virtuel au réel, il y a-t-il si loin que ça ? Je ne vais pas vous expliquer ce que pense Bernard Minier de tout cela, et "Soeurs" reste un roman, mais ces questionnements sont aussi présents dans ce livre.
La question des fans, le mot est utilisé par Bernard Minier,qui sont chaleureux, attachants, valorisants, agréables pour l'ego... Mais peut-être aussi, quelquefois, envahissants et oubliant de conserver une certaine retenue. On pourrait aller encore plus loin avec leur influence croissante pour faire et défaire les carrières des livres...
Je referme ce chapitre et le billet par la même occasion, avec toutefois une dernière réflexion en lien avec ce qui vient d'être dit : nous sommes largement nourris, nous qui aimons les polars et les thrillers, par la littérature, mais aussi par les films, les séries, jusqu'aux informations, les faits divers... On se pose vite en spécialistes...
Il y a quelque chose d'amusant dans "Soeurs", c'est qu'on lit la première partie avec notre regard de lecteur de 2018. Et vous, je ne sais pas, mais moi, je me suis fait quelques remarques. Je me suis senti subitement plus flic que les flics eux-mêmes. Une position qui permet de commencer à échafauder des théories, en attendant de voir si ça va coller ensuite.
Ca n'enlève rien au côté efficace de ce roman (460 pages dévorées en moins de 24 heures, c'est plutôt un bon signe, non ?), mais c'est aussi assez effrayant de se retrouver, moi, lecteur, dans une position de démiurge qui ne devrait pas être la mienne. Ces réflexes acquis, j'en ai déjà parlé dans de précédents billets, c'est le syndrome "Experts", et j'ai l'impression qu'ils se déclenchent dès que je quitte l'époque récente, ça devient flippant !
Mais assez parlé de moi, au-delà de la double intrigue et d'un final auquel, pour le coup, on ne s'attend pas du tout, vous voyez que cette cinquième enquête de Martin Servaz offre bien des pistes de réflexion. Il y en a sûrement d'autres, chacun son regard sur les livres et chacun sa perception, mais voilà ce que je voulais partager.
J'ai aimé retrouver Servaz, mais il faudra que je comble mes manques pour espérer mieux le cerner encore. J'ai aimé retrouver son côté sombre, ces ténèbres qui semblent menacer de l'engloutir à chaque instant, sa quête de rédemption. L'écriture de Bernard Minier est toujours posée, assez clinique, jamais survoltée, et pourtant elle sait captiver pour nous emmener d'un rebondissement à l'autre.
Printemps 1993. Un rameur aperçoit sur l'île du Ramier, en plein coeur de Toulouse, une scène qui le glace d'effroi. Pensant avoir rêvé, il va voir de plus près et découvre une scène effroyable. Deux corps, placés face à face, ligotés chacun à un arbre... Une mise en scène macabre que renforce encore la tenue des victimes : elles portent une aube, comme si elles venaient de faire leur communion.
Le groupe de l'inspecteur principal Kowalski se retrouve chargé de l'enquête, dans des conditions un peu particulières, puisque l'Hôtel de police de la Ville rose est en plein déménagement. Parmi les hommes concernés par cette enquête, un jeune homme, tout juste muté à Toulouse : Martin Servaz, frais émoulu de l'école d'officier.
Quatre ans pile après le suicide de son père, il revient dans le sud-ouest, avec son épouse et sa fillette. Un couple qui bat déjà de l'aile, même si Alexandra et lui n'osent pas encore affronter le problème. Il doit faire abstraction de ces soucis personnels pour trouver sa place dans son nouvel environnement professionnel. Pour sa première enquête, il n'aurait pas pu trouver pire...
Les premières investigations permettent d'identifier les victimes : Ambre, 21 ans, Alice, 20 ans, deux soeurs dont la famille vit dans le Gers et qui faisaient leurs études à Toulouse. Pas vraiment le genre d'information qui allège une atmosphère bien lourde depuis la découverte des cadavres. Mais, peut-être aussi un élément qui pourrait faciliter la tâche des policiers.
Rapidement, un lien apparaît : les deux soeurs appréciaient apparemment beaucoup les romans d'un écrivains de thrillers, Erik Lang, qu'elles ont rencontré quelques années plus tôt et avec qui elles ont entretenu une correspondance assez explicite depuis... De quoi le rendre suspect en soi, mais plus encore parce que son roman le plus connu s'intitule "la Communiante"...
Kowalski semble persuadé qu'il tient le coupable, et tout son groupe aussi, Servaz compris. Encore faut-il le prouver, ou obtenir des aveux. Les flics vont "travailler" leur suspect principal en garde à vue, mais un rebondissement inattendu va couper leur élan. Et va surtout mettre brusquement fin à cette enquête.
Pour sa première enquête, Servaz garde un goût amer. Non seulement ce dénouement ne le convainc pas du tout, mais surtout, il a laissé un peu de son innocence en salle d'interrogatoire, dégoûté par les méthodes employés par Kowalski et ses autres collègues pour faire parler Erik Lang... Servaz l'idéaliste s'est déjà placé en marge pour ses débuts...
Hiver 2018. Servaz est désormais capitaine, et non plus commandant (conséquence des événements racontés dans les précédents tomes), et toujours en poste à Toulouse. Un matin très tôt, on l'appelle pour un meurtre, presque la routine. Mais, lorsqu'il réalise où on le conduit, un désagréable sentiment l'envahit...
Il se confirme bien vite : c'est chez Erik Lang que les policiers ont rendez-vous. L'épouse de l'écrivain vient d'être retrouvée morte, et tout indique qu'elle a été assassinée. Là encore, la scène de crime est du genre qui marque les esprits. Mais surtout, un élément glace Servaz : la victime porte elle aussi un vêtement de communiante...
En quelques instants, voilà le policier projeté 25 ans en arrière, et ses soupçons d'hier resurgissent au grand galop. Comment ne pas soupçonner Erik Lang, encore une fois ? Comment résister à l'envie de le coincer, coûte que coûte ? Une enquête complexe débute, avec un Servaz sur les nerfs qui n'envisage aucune autre piste et s'entête, jusqu'à retomber dans ses travers...
Des romans, thrillers ou non, qui se déroulent à deux époques différentes, ce n'est pas une nouveauté, on en trouve beaucoup, par exemple, qui font s'entrecroiser ces deux fils narratifs en faisant alterner un chapitre dans une époque, le suivant dans l'autre. Mais, ce n'est pas ce qu'a choisi de faire Bernard Minier pour "Soeurs".
Les deux époques sont clairement séparées et on découvre donc deux enquêtes distinctes à 25 ans d'écart qui se succèdent. Avec deux dénominateurs communs : Martin Servaz, le policier, et Erik Lang, l'écrivain. Comme si Servaz, privé de son habituelle Némésis, Julian Hirtmann, devait se trouver un nouvel adversaire à qui se mesurer.
Mais, et c'est un des grands intérêts de la construction en deux parties distinctes de "Soeurs", on va vite comprendre que le Servaz de 2018 n'a plus grand-chose à voir avec celui de 1993. Le temps a fait son oeuvre, bien sûr, le jeune flic que tout le monde prenait pour un étudiant, avec ses cheveux un peu trop longs, est désormais un officier expérimenté, approchant la cinquantaine.
Pourtant, le revoilà jeune père. Ce n'est plus Margot qu'il élève, mais Gustav, encore sujet à de rudes cauchemars, même s'il semble s'adapter à son nouvel environnement familial. Les cauchemars, Servaz en fait aussi, comme si cette enquête qui le renvoie au passé réveillait certains traumatismes pas encore complètement guéris...
Pourtant, les changements qui frappent le plus sont ailleurs. Ils vont apparaître petit à petit, dans la deuxième partie, jusqu'au final où cela devient patent : le Servaz idéaliste des débuts est loin, le Servaz de 2018 ressemble à ce Kowalski qui lui avait tant déplu... Comme si l'usure de l'âge, l'érosion due aux horreurs accumulées, au stress, professionnel et personnel, avaient dénaturé ses principes...
J'ai qualifié ce tome de tournant, en introduction, et cela se confirme. Mais, il ne faut pas limiter cette impression à l'unique question Hirtmann. Dans "Soeurs", c'est tout son passé que Servaz solde une bonne fois pour toutes. Il y a une prise de conscience de la part du policier autant que de l'homme, il y a une sorte de libération et l'annonce d'une nouvelle ère.
En fait, il me vient (c'est pas vrai, c'est longuement mûri...) une métaphore : c'est comme si Servaz se défaisait d'une mue, comme un reptile. Bon, si vous n'avez pas lu le livre, vous aurez du mal à saisir ce raisonnement qui me semble à la fois subtil et pertinent (oui, je m'envoie quelques fleurs, il n'y a pas de raison).
J'ignore ce que va faire Bernard Minier, quelle suite il envisage de donner à sa série construite autour de Servaz. Je crois savoir qu'il y a un projet de one-shot dans le même décor que "Une putain d'histoire", et ensuite ? Je serais en tout cas très curieux de retrouver Martin Servaz, un Servaz délivré d'un poids conséquent.
Je ne l'imagine pas métamorphosé du tout au tout, devenu un joyeux luron et un optimiste forcené, on aurait du mal à y croire. Mais, un personnage un peu moins tourmenté, moins tiraillé entre ses états d'âme personnel, qu'ils concernent sa famille ou sa relation ambiguë avec Hirtmann ; un personnage apaisé, là, voilà, je lâche le mot, apaisé, ce qui aurait forcément quelques répercussions sur sa carrière et sa vie.
Je referme la parenthèse Servaz pour parler de l'autre protagoniste central de "Soeurs", Erik Lang. En fait, ce n'est pas temps du personnage lui-même qu'on va parler, mais de son rôle d'écrivain, comme vous l'aurez compris en lisant le titre de ce billet. La personnalité d'Erik Lang, je vous la laisse découvrir, tout comme je vous laisse vous forger une opinion à son sujet.
"Soeurs" est un roman où il est beaucoup question d'écriture, de livres, d'écrivains, mais aussi de lecteurs, eh oui, nous sommes aussi, vous qui me lisez et moi, concernés. Bernard Minier, en plaçant au coeur de son intrigue un auteur, et un auteur de thrillers, en profite pour poser des problématiques qui l'intéressent au premier chef.
D'abord, il s'amuse, avec quelques clins d'oeil. A certains de ses petits camarades, comme beaucoup d'autres le font. Dans la bibliographie d'Erik Lang, certains titres devraient vous rappeler d'autres livres que vous avez peut-être dans vos bibliothèques. Mais, il y a aussi quelque chose de Bernard Minier chez lui, le parallèle est évident.
On pourrait penser qu'on est dans le jeu, et rien de plus. Pourtant, c'est un peu plus que cela, car la relation entre Servaz et Lang, pour le moins tendue, va aussi se nourrir de cette mise en abyme. Un jeu de miroirs qui fait sourire, mais qui intervient aussi à un moment très important de l'intrigue, lorsque la tension est à son comble.
On retrouve l'importance de cette double histoire à deux époques, puisque, d'une certaine manière, Servaz et Lang sont restés liés tout ce temps, plus ou moins consciemment, et que l'écriture a nourri ce lien invisible. Je n'en dis pas plus, ce n'est d'ailleurs pas forcément ce qui est le plus important dans tout ça.
En revanche, j'ai retrouvé certains questionnement chez Bernard Minier qui apparaissent régulièrement chez d'autres auteurs de thrillers, à commencer par Maxime Chattam, qui en a fait une de ses marques de fabrique : l'influence de ces histoires qui recourt à la violence, une violence exacerbée, spectaculaire, qu'on cherche à exorciser, mais qui laisse bien quelques traces.
Cauchemardez-vous aussi, Monsieur Minier ? Je plaisante, mais c'est vrai qu'on ne manipule pas ces sujets au quotidien (surtout quand on sait qu'un écrivain qui a une idée s'y accroche jour et nuit) sans qu'il y ait quelques effets secondaires. En cela, Erik Lang est un cas intéressant, puisqu'on le soupçonne d'être passé de l'autre côté du miroir. D'avoir pris ses mensonges pour la réalité...
La question de l'inspiration, la frontière entre la réalité et la fiction, la distance qu'on place entre les deux et qui fait que ce qui nous horrifie dans un thriller reste un événement "pour de faux", toute cette mécanique que construisent les écrivains et que les lecteurs mettent en mouvement, tout cela repose finalement sur des conventions.
Heureusement que les auteurs de thrillers ne sont pas adeptes de l'autofiction et qu'ils racontent ce qui leur passe par la tête, ce qui nourrit leur imaginaire et non ce qu'ils ont accompli ! Mais l'idée de romans policiers utilisés comme modes d'emploi pour perpétrer des crimes est une idée très classique, que l'on retrouve régulièrement traitée.
Il y a une espèce de mouvement perpétuel qui s'instaure entre écrivains et lecteurs, les idées des uns touchant les autres, tandis que l'inspiration se saisit des opportunités portées par l'actualité, l'air du temps, les histoires qu'on entend ici ou là, parfois de la part de lecteurs... Un phénomène qu'il faut accepter tel quel, et ne surtout pas chercher à expliquer.
Et puis, au centre de "Soeurs", il y a aussi la relation entre les auteurs et les lecteurs. Et, là encore, la construction double du roman permet de mesurer son incroyable évolution en très peu de temps. Pendant très longtemps, cette relation était exceptionnel et le plus souvent indirecte. L'écrivain écrivait, le lecteur lisait, chacun dans son coin, et basta.
Alice et Ambre ont la chance, si on peut dire, d'avoir rencontré en chair et en os l'écrivain qu'elles adoraient. Une intimité s'est formée, on est dans de la littérature noire, donc ce n'est forcément pas très, très clair, tout ça, mais le fait est que cela reste alors quelque chose de peu fréquent, pour des personnes qui ne sont liées que par cette passion commune.
Mais, en 2018, tout a changé. Désormais, les écrivains sont bien plus accessibles, en tout cas ceux qui jouent le jeu. Il y a les salons, les rencontres, les cafés littéraires, la promo, parfois, autant d'occasions de sortir de son bureau et de se montrer, d'entrer en contact avec les lecteurs, directement ou indirectement. Mais, la distance s'est raccourcie.
Et c'est encore plus criant avec les réseaux sociaux. Le lecteur devient vite le meilleur ami de l'auteur, en tout cas virtuellement. Mais, du virtuel au réel, il y a-t-il si loin que ça ? Je ne vais pas vous expliquer ce que pense Bernard Minier de tout cela, et "Soeurs" reste un roman, mais ces questionnements sont aussi présents dans ce livre.
La question des fans, le mot est utilisé par Bernard Minier,qui sont chaleureux, attachants, valorisants, agréables pour l'ego... Mais peut-être aussi, quelquefois, envahissants et oubliant de conserver une certaine retenue. On pourrait aller encore plus loin avec leur influence croissante pour faire et défaire les carrières des livres...
Je referme ce chapitre et le billet par la même occasion, avec toutefois une dernière réflexion en lien avec ce qui vient d'être dit : nous sommes largement nourris, nous qui aimons les polars et les thrillers, par la littérature, mais aussi par les films, les séries, jusqu'aux informations, les faits divers... On se pose vite en spécialistes...
Il y a quelque chose d'amusant dans "Soeurs", c'est qu'on lit la première partie avec notre regard de lecteur de 2018. Et vous, je ne sais pas, mais moi, je me suis fait quelques remarques. Je me suis senti subitement plus flic que les flics eux-mêmes. Une position qui permet de commencer à échafauder des théories, en attendant de voir si ça va coller ensuite.
Ca n'enlève rien au côté efficace de ce roman (460 pages dévorées en moins de 24 heures, c'est plutôt un bon signe, non ?), mais c'est aussi assez effrayant de se retrouver, moi, lecteur, dans une position de démiurge qui ne devrait pas être la mienne. Ces réflexes acquis, j'en ai déjà parlé dans de précédents billets, c'est le syndrome "Experts", et j'ai l'impression qu'ils se déclenchent dès que je quitte l'époque récente, ça devient flippant !
Mais assez parlé de moi, au-delà de la double intrigue et d'un final auquel, pour le coup, on ne s'attend pas du tout, vous voyez que cette cinquième enquête de Martin Servaz offre bien des pistes de réflexion. Il y en a sûrement d'autres, chacun son regard sur les livres et chacun sa perception, mais voilà ce que je voulais partager.
J'ai aimé retrouver Servaz, mais il faudra que je comble mes manques pour espérer mieux le cerner encore. J'ai aimé retrouver son côté sombre, ces ténèbres qui semblent menacer de l'engloutir à chaque instant, sa quête de rédemption. L'écriture de Bernard Minier est toujours posée, assez clinique, jamais survoltée, et pourtant elle sait captiver pour nous emmener d'un rebondissement à l'autre.
mardi 10 avril 2018
"Je ne suis pas assez forte, pas assez courageuse. Je suis une petite esclave résignée, une enfant apeurée. Je ne suis rien".
Comme souvent, le choix de ce titre a été précédé d'une période de réflexion. Et si c'est celle-ci qui a finalement obtenu mon suffrage, c'est parce que tout le roman (et un gros bouquin, 740 pages) va nous démontrer le contraire : non, cette héroïne, bien malgré elle, n'est pas rien, ni apeurée, ni résignée, au contraire, et c'est ce qui fait sa force, face à un destin qui lui sera toujours contraire. "Toutes blessent, la dernière tue" est le nouveau thriller signé Karine Giebel (en grand format aux éditions Belfond) et, avec cette histoire dont le thème central est l'esclavage moderne, elle retrouve un personnage féminin d'une grande puissance, qui marquera certainement lecteur, comme ce fut le cas avec Marianne, dans "Meurtres pour rédemption". La rédemption, on le sait, c'est l'un des thèmes chers à la romancière, et elle tient encore une place importante dans ce nouvel opus, à la construction inattendue, avec un fil narratif secondaire entouré d'un certain mystère...
A 5 ans, sa mère est décédée. Trois ans plus tard, son père, qui a refait sa vie, la confie à une femme pour qu'elle prenne soin d'elle et l'emmène en France. En fait, il serait plus juste de dire que l'homme a vendu sa fille... A 8 ans, elle est rebaptisée Tama et se retrouve dans une famille, les Charadon, où l'on attend d'elle qu'elle s'occupe des tâches ménagères et des enfants du couple.
En échange, elle est nourrie (de restes), logée (dans la buanderie, sur un grabat), blanchie (c'est elle qui fait la lessive, de toute façon, et on lui renouvelle de temps en temps les deux tenues qui lui sont "généreusement" octroyées). Sans savoir rien du monde qui l'entourent, sans comprendre ce qui lui arrive, Tama est devenue une esclave.
Et une esclave, on ne la traite pas comme une personne à part entière. Brimée, frappée, maltraitée, regardée d'un peu trop près par le pater familias, Tama grandit dans la souffrance et la violence, elle n'a droit à rien, juste celui de se taire et d'obéir, sinon sanction. Si quelque chose cloche, c'est forcément de sa faute, et dans ce cas, il y a sanction.
Il en faut peu pour que les sanctions tombent, et elle est bien souvent battue. Chez Medja, la femme qui l'a achetée au Maroc, cela continue : corvées, maltraitances, vie quotidienne qui n'est que douleur... C'est même Tama qui fait le ménage de nuit dans des bureaux, fonction pour laquelle c'est Medja qui est payée...
Clandestine, sans existence légale et même sans existence tout court, agressée sans cesse, privée des droits élémentaires d'un enfant à l'enseignement, privée tout simplement d'amour (aux maltraitances physiques s'ajoutent des tortures morales tout aussi rudes), Tama tient pourtant bon, faisant preuve d'un caractère bien trempé.
Mais toute rébellion, toute tentative de révolte est rapidement matée et Tama comprend que, si elle veut moins souffrir, elle va devoir renoncer à ces coups d'éclat. Renoncer, sans se résigner pour autant. Et espérer qu'un jour, on la sortira de là. Car à quoi bon chercher à s'enfuir, puisque, elle ignore tout du monde extérieur, pour lequel elle n'est... rien.
Au fil du temps, Tama va bien lier quelques relations qui vont lui mettre du baume au coeur, lui apporter un peu de chaleur et d'affection. Mais rien qui puisse lui laisser entrevoir un destin différent, celui d'une esclave ayant un statut plus proche de l'objet que de l'humain, obligée de travailler sans être jamais rémunérée en retour, privée de liberté et atrocement maltraitée...
Quel espoir peut-elle nourrir, dans ces conditions ?
Je vais être franc, j'ai repris plusieurs fois ce résumé. Je l'ai modifié, raccourci, réécrit, j'ai modifié le début, le milieu et la fin... Parce que j'avais l'impression d'en dire trop, de donner des détails et d'évoquer des personnages qu'il faut vous laisser découvrir... Pourtant, l'envie de parler de Tama est forte, de parler de ce drame hélas bien plus courant qu'on ne le croit.
Tama est un personnage magnifique, je sais, le mot est douloureux à écrire, car son histoire est effroyable. Mais Karine Giebel décide d'en faire une antihéroïne qui ne renonce jamais, qui ne perd jamais espoir. Elle est l'innocence même, l'innocence sans cesse bafouée, juste pour le bien-être et le confort de certains, que les scrupules et la décence n'étouffent pas.
La violence n'est qu'une cerise pourrie sur cet immonde gâteau. A la perversité, on ajoute le sadisme, la cruauté, des travers qui vont bien souvent ensemble et qui trouve là le terrain idéal pour s'exprimer. Qui écoutera les plaintes de la victime ? Qui interviendra, puisqu'elle n'existe pas ? Et pourquoi chercher à s'échapper, puisqu'il n'existe aucun refuge extérieur ?
Tama a été piégée et ce piège ne semble avoir aucune issue. Pourtant, et bien qu'elle ne soit qu'une enfant déracinée et maltraitée, elle va faire preuve d'un caractère remarquable, mais aussi d'un esprit d'initiative tout à fait exceptionnels. Ainsi va-t-elle réussir à s'ouvrir une fenêtre sur le monde grâce à la lecture, qu'elle va découvrir seule, en cachette.
Tout le parcours de Tama sera ensuite jalonné de livres et de moments de lecture. Malgré la précarité de sa situation, lire deviendra une activité incontournable, indispensable, une manière de combler tant bien que mal les manques occasionnés par sa cruelle destinée. Le savoir contre l'arbitraire et la violence, la culture contre l'inhumanité...
Je l'ai dit en ouverture de ce billet, au cours de ce voyage douloureux aux côtés de Tama, il est difficile de ne pas songer à un autre personnage imaginé par Karine Giebel : Marianne, personnage principal de "Meurtres pour rédemption". Toutefois, si le parallèle est assez évident, les deux personnages ont beaucoup de différences.
Passons sur l'âge, Tama (lorsqu'on la rencontre, n'est qu'une enfant) ou les origines sociales. Ce qui les rapproche, c'est la réclusion et les violences subies. Mais, là encore, il y a des distinctions : Marianne est incarcérée après un procès, condamnée pour meurtre, quand Tama est enfermée de manière arbitraire et sans motif.
Marianne n'est pas innocente, mais elle a pris conscience de ses fautes et décide d'entamer un périlleux chemin vers la rédemption, jalonné de souffrances et qui va bifurquer lorsqu'elle va signer un pacte avec le diable contre un mince espoir de libération... Tama, elle, est une innocente frappée par la méchanceté et la violence humaines, une innocente que l'on rend coupable de tout, jusqu'à ce qu'elle intègre cela.
On retrouve chez Tama ce trait si particulier qu'ont nombre de victimes de maltraitances : leur culpabilité, comme si elle acceptaient l'idée qu'elles ont mérité leur sort, aussi absurde cela puisse-t-il paraître, avec le recul qui est le nôtre. La culpabilité, mais aussi cet effrayant réflexe pavlovien qui associe la révolte à la souffrance. La désobéissance à la punition...
A son âge, celui où l'on se forme, où l'on apprend, où l'on acquiert les repères sociaux élémentaires, où l'éducation nous façonne, Tama a droit à un traitement qui bat toutes les valeurs en brèche, qui la réduit à moins que rien, moins qu'un animal de compagnie, qu'on traiterait mieux qu'elle ne l'est, moins qu'un objet.
Esclave, Tama l'est, de fait. Résignée et apeurée, oui, par instants, quand le découragement gagne du terrain, insidieusement. Lorsque la souffrance, d'abord physique, mais aussi morale, a raison de la volonté. La phrase titre de ce billet est prononcée par Tama dans un de ces moments de creux, justement. Car sa force et son courage éclaboussent le livre des premières aux dernières pages.
Parce qu'elle va résister de toutes ces forces pour refuser d'être rien, justement, et s'affirmer comme être humain, comme jeune femme en devenir, comme une personne à part entière, comme un être digne d'aimer et d'être aimé. Une femme dont la vie est fragilisée par bien des handicaps, le premier étant sa non-existence sur un plan strictement légal, ce qui en fait une proie assez facile.
Mais ce roman, c'est le récit de la farouche lutte de Tama pour redevenir ce qu'elle fut jusqu'au moment où on l'a vendue pour quelques pièces, une somme dérisoire, ce qui est plus choquant encore. Une lutte de chaque instant où, aux rares plages de calme et, oserais-je l'écrire ? De bonheur, succéderont de nouvelles périodes très dures...
Un mot du titre : "Toutes blessent, la dernière tue". En latin, "Omnia vulnerant, ultima necat". Je suis de la génération qui, enfant, feuilletait le dictionnaire et pouvait se perdre dans le livret central, aux pages roses, qui recensaient les expressions latines... Cette sentence-là devait s'y trouver, forcément, avec une brève explication sur son sens.
Pour la comprendre, il faut la remettre dans son contexte. Car, en la lisant littéralement, on se demande de quoi on parle : qu'est-ce qui blesse, puis tue ? En fait, cette phrase apparaissait sur les cadrans solaires (puis, par la suite, sur les instruments mesurant le temps qui passe). Ce sont les heures qui blessent toutes et dont la dernière tue...
Tama, bien plus que la majorité des gens, répond à cette sentence. La dernière heure nous tuera tous, c'est notre lot commun, mais, pour la jeune esclave, c'est la première moitié qui est à prendre à la lettre, car chaque heure de sa vie l'aura cruellement blessée. Et l'un des éléments qui donnent un certain suspense à ce thriller, c'est justement de savoir si Tama sortira de cet épouvantable engrenage.
Le moment est venu d'évoquer un élément très important de "Toutes blessent, la dernière tue", que j'ai volontairement laissé dans l'ombre pour le moment. Cet élément, je ne vais que très peu le développer, tout simplement parce qu'on ne s'attend pas du tout à cette trame-là et qu'elle va tenir un moment le lecteur en haleine, car il fait naître bien des questions.
Entre les deux trames, celle relatant le parcours de Tama, et l'autre, un lien qui paraît évident. Trop, même. La probabilité est grande que ces deux récits ne soient pas parallèles, mais comment les relier l'un à l'autre ? Ce sera bien sûr un des enjeux de cette lecture, un autre ressort à suspense. Mais aussi un autre vecteur de violence...
Je ne vous dis rien de cette deuxième histoire, si ce n'est que l'on y retrouve un personnage giebélien typique, si je puis dire, un homme coincé entre le bien et le mal, entre la soif de vengeance et l'hypothèse de la rédemption. Un homme "bien", peut-être, en tout cas, certainement plus que la plupart des personnage croisés jusque-là, Tama exceptée.
Et pourtant, un homme violent, impitoyable. Un tueur, mot à prendre dans son sens premier. Un solitaire qui semble s'être résigné à la violence et avoir perdu tout espoir. Qu'adviendra-t-il de lui, quand s'achèvera sa quête ? Ne sera-t-il pas alors arrivé au bout de sa vie, faute d'avoir simplement envie de poursuivre ?
L'idée de rédemption lui est étrangère, elle semble même contraire à sa philosophie, puisqu'il ne l'envisage absolument pas pour les autres. Pas de rédemption, donc pas de pardon... C'est un personnage assez effrayant, mais intègre, puisqu'il ne considère pas non plus avoir droit à la rédemption et au pardon. Et qu'il applique une justice toute personnelle...
Il y aurait beaucoup à dire sur les personnages secondaires, ceux qui entourent Tama, ceux qu'elles croisent, rencontrent, ceux avec qui elle se lie, pour le pire plus souvent que pour le meilleur. Etant donné le contexte, leur appliquer le traditionnel clivage bien-mal paraît difficile, car ce sont tout de même des esclavagistes...
Sur les personnages de la deuxième trame aussi, puisqu'un doute persiste, au moins pour l'un d'entre eux, sur leur identité, mais cela nous entraînerait un peu loin, cela obligerait à lever un peu trop le voile. Mais, comme souvent dans les romans de Karine Giebel, ce qu'on va surveiller, c'est leur évolution, leur combat personnel, contre eux-mêmes bien souvent.
"Toutes blessent, la dernière tue" est à ranger au rayon thriller, même si on pourrait hésiter à le placer en roman noir. Car, si la construction du roman, des chapitres brefs, eux-mêmes subdivisés, avec des changements de narration et de point de vue, correspond aux techniques du thriller, le rythme du livre est finalement plutôt lent.
Karine Giebel nous raconte des tranches de vie, pas une intrigue à rebondissements comme on pourrait l'entendre traditionnellement. C'est un livre un peu hybride, qui place dans une trame qu'on aurait plutôt tendance à classer en roman noir, mais au cours duquel les moments de tension et de violence se succèdent et font froid dans le dos.
La violence est l'un des ingrédients importants de ce livre, vous vous en doutez, et Karine Giebel montre une nouvelle fois son talent et sa "créativité" pour exprimer la cruauté et la méchanceté. Va-t-elle trop loin ? Y en a-t-il trop ? Chaque lecteur aura sans doute son idée sur cette question, même si le sujet se prête aux mauvais traitements.
On retrouve surtout ce contexte dans lequel les personnages qu'elle met en scène évolue toujours, quelque part entre l'immoralité et l'amoralité. On s'affranchit des règles traditionnelles mises en place par la société et Tama, par exemple, évolue dans une zone grise où ne s'applique que la loi du plus fort, où c'est celui qui porte les coups qui a le dessus...
Avec "Toutes blessent, la dernière tue", Karine Giebel s'attaque à un phénomène en recrudescence, ce qu'on appelle l'esclavage moderne, qu'on appelle aussi servitude domestique. En sont le plus souvent victime, des jeunes filles ou des jeunes femmes, à l'image de Tama, et c'est une pratique qu'on trouve dans la plupart des pays occidentaux, et dans la plupart des couches sociales.
Je termine le billet avec un lien, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ce crime, que le code pénal français ne prend en compte que depuis 2013... Il s'agit du site de l'OICEM, que Karine Giebel donne elle-même à la fin du livre, l'Organisation Internationale Contre l'Esclavage Moderne, et auprès de laquelle la romancière s'est documentée...
A 5 ans, sa mère est décédée. Trois ans plus tard, son père, qui a refait sa vie, la confie à une femme pour qu'elle prenne soin d'elle et l'emmène en France. En fait, il serait plus juste de dire que l'homme a vendu sa fille... A 8 ans, elle est rebaptisée Tama et se retrouve dans une famille, les Charadon, où l'on attend d'elle qu'elle s'occupe des tâches ménagères et des enfants du couple.
En échange, elle est nourrie (de restes), logée (dans la buanderie, sur un grabat), blanchie (c'est elle qui fait la lessive, de toute façon, et on lui renouvelle de temps en temps les deux tenues qui lui sont "généreusement" octroyées). Sans savoir rien du monde qui l'entourent, sans comprendre ce qui lui arrive, Tama est devenue une esclave.
Et une esclave, on ne la traite pas comme une personne à part entière. Brimée, frappée, maltraitée, regardée d'un peu trop près par le pater familias, Tama grandit dans la souffrance et la violence, elle n'a droit à rien, juste celui de se taire et d'obéir, sinon sanction. Si quelque chose cloche, c'est forcément de sa faute, et dans ce cas, il y a sanction.
Il en faut peu pour que les sanctions tombent, et elle est bien souvent battue. Chez Medja, la femme qui l'a achetée au Maroc, cela continue : corvées, maltraitances, vie quotidienne qui n'est que douleur... C'est même Tama qui fait le ménage de nuit dans des bureaux, fonction pour laquelle c'est Medja qui est payée...
Clandestine, sans existence légale et même sans existence tout court, agressée sans cesse, privée des droits élémentaires d'un enfant à l'enseignement, privée tout simplement d'amour (aux maltraitances physiques s'ajoutent des tortures morales tout aussi rudes), Tama tient pourtant bon, faisant preuve d'un caractère bien trempé.
Mais toute rébellion, toute tentative de révolte est rapidement matée et Tama comprend que, si elle veut moins souffrir, elle va devoir renoncer à ces coups d'éclat. Renoncer, sans se résigner pour autant. Et espérer qu'un jour, on la sortira de là. Car à quoi bon chercher à s'enfuir, puisque, elle ignore tout du monde extérieur, pour lequel elle n'est... rien.
Au fil du temps, Tama va bien lier quelques relations qui vont lui mettre du baume au coeur, lui apporter un peu de chaleur et d'affection. Mais rien qui puisse lui laisser entrevoir un destin différent, celui d'une esclave ayant un statut plus proche de l'objet que de l'humain, obligée de travailler sans être jamais rémunérée en retour, privée de liberté et atrocement maltraitée...
Quel espoir peut-elle nourrir, dans ces conditions ?
Je vais être franc, j'ai repris plusieurs fois ce résumé. Je l'ai modifié, raccourci, réécrit, j'ai modifié le début, le milieu et la fin... Parce que j'avais l'impression d'en dire trop, de donner des détails et d'évoquer des personnages qu'il faut vous laisser découvrir... Pourtant, l'envie de parler de Tama est forte, de parler de ce drame hélas bien plus courant qu'on ne le croit.
Tama est un personnage magnifique, je sais, le mot est douloureux à écrire, car son histoire est effroyable. Mais Karine Giebel décide d'en faire une antihéroïne qui ne renonce jamais, qui ne perd jamais espoir. Elle est l'innocence même, l'innocence sans cesse bafouée, juste pour le bien-être et le confort de certains, que les scrupules et la décence n'étouffent pas.
La violence n'est qu'une cerise pourrie sur cet immonde gâteau. A la perversité, on ajoute le sadisme, la cruauté, des travers qui vont bien souvent ensemble et qui trouve là le terrain idéal pour s'exprimer. Qui écoutera les plaintes de la victime ? Qui interviendra, puisqu'elle n'existe pas ? Et pourquoi chercher à s'échapper, puisqu'il n'existe aucun refuge extérieur ?
Tama a été piégée et ce piège ne semble avoir aucune issue. Pourtant, et bien qu'elle ne soit qu'une enfant déracinée et maltraitée, elle va faire preuve d'un caractère remarquable, mais aussi d'un esprit d'initiative tout à fait exceptionnels. Ainsi va-t-elle réussir à s'ouvrir une fenêtre sur le monde grâce à la lecture, qu'elle va découvrir seule, en cachette.
Tout le parcours de Tama sera ensuite jalonné de livres et de moments de lecture. Malgré la précarité de sa situation, lire deviendra une activité incontournable, indispensable, une manière de combler tant bien que mal les manques occasionnés par sa cruelle destinée. Le savoir contre l'arbitraire et la violence, la culture contre l'inhumanité...
Je l'ai dit en ouverture de ce billet, au cours de ce voyage douloureux aux côtés de Tama, il est difficile de ne pas songer à un autre personnage imaginé par Karine Giebel : Marianne, personnage principal de "Meurtres pour rédemption". Toutefois, si le parallèle est assez évident, les deux personnages ont beaucoup de différences.
Passons sur l'âge, Tama (lorsqu'on la rencontre, n'est qu'une enfant) ou les origines sociales. Ce qui les rapproche, c'est la réclusion et les violences subies. Mais, là encore, il y a des distinctions : Marianne est incarcérée après un procès, condamnée pour meurtre, quand Tama est enfermée de manière arbitraire et sans motif.
Marianne n'est pas innocente, mais elle a pris conscience de ses fautes et décide d'entamer un périlleux chemin vers la rédemption, jalonné de souffrances et qui va bifurquer lorsqu'elle va signer un pacte avec le diable contre un mince espoir de libération... Tama, elle, est une innocente frappée par la méchanceté et la violence humaines, une innocente que l'on rend coupable de tout, jusqu'à ce qu'elle intègre cela.
On retrouve chez Tama ce trait si particulier qu'ont nombre de victimes de maltraitances : leur culpabilité, comme si elle acceptaient l'idée qu'elles ont mérité leur sort, aussi absurde cela puisse-t-il paraître, avec le recul qui est le nôtre. La culpabilité, mais aussi cet effrayant réflexe pavlovien qui associe la révolte à la souffrance. La désobéissance à la punition...
A son âge, celui où l'on se forme, où l'on apprend, où l'on acquiert les repères sociaux élémentaires, où l'éducation nous façonne, Tama a droit à un traitement qui bat toutes les valeurs en brèche, qui la réduit à moins que rien, moins qu'un animal de compagnie, qu'on traiterait mieux qu'elle ne l'est, moins qu'un objet.
Esclave, Tama l'est, de fait. Résignée et apeurée, oui, par instants, quand le découragement gagne du terrain, insidieusement. Lorsque la souffrance, d'abord physique, mais aussi morale, a raison de la volonté. La phrase titre de ce billet est prononcée par Tama dans un de ces moments de creux, justement. Car sa force et son courage éclaboussent le livre des premières aux dernières pages.
Parce qu'elle va résister de toutes ces forces pour refuser d'être rien, justement, et s'affirmer comme être humain, comme jeune femme en devenir, comme une personne à part entière, comme un être digne d'aimer et d'être aimé. Une femme dont la vie est fragilisée par bien des handicaps, le premier étant sa non-existence sur un plan strictement légal, ce qui en fait une proie assez facile.
Mais ce roman, c'est le récit de la farouche lutte de Tama pour redevenir ce qu'elle fut jusqu'au moment où on l'a vendue pour quelques pièces, une somme dérisoire, ce qui est plus choquant encore. Une lutte de chaque instant où, aux rares plages de calme et, oserais-je l'écrire ? De bonheur, succéderont de nouvelles périodes très dures...
Un mot du titre : "Toutes blessent, la dernière tue". En latin, "Omnia vulnerant, ultima necat". Je suis de la génération qui, enfant, feuilletait le dictionnaire et pouvait se perdre dans le livret central, aux pages roses, qui recensaient les expressions latines... Cette sentence-là devait s'y trouver, forcément, avec une brève explication sur son sens.
Pour la comprendre, il faut la remettre dans son contexte. Car, en la lisant littéralement, on se demande de quoi on parle : qu'est-ce qui blesse, puis tue ? En fait, cette phrase apparaissait sur les cadrans solaires (puis, par la suite, sur les instruments mesurant le temps qui passe). Ce sont les heures qui blessent toutes et dont la dernière tue...
Tama, bien plus que la majorité des gens, répond à cette sentence. La dernière heure nous tuera tous, c'est notre lot commun, mais, pour la jeune esclave, c'est la première moitié qui est à prendre à la lettre, car chaque heure de sa vie l'aura cruellement blessée. Et l'un des éléments qui donnent un certain suspense à ce thriller, c'est justement de savoir si Tama sortira de cet épouvantable engrenage.
Le moment est venu d'évoquer un élément très important de "Toutes blessent, la dernière tue", que j'ai volontairement laissé dans l'ombre pour le moment. Cet élément, je ne vais que très peu le développer, tout simplement parce qu'on ne s'attend pas du tout à cette trame-là et qu'elle va tenir un moment le lecteur en haleine, car il fait naître bien des questions.
Entre les deux trames, celle relatant le parcours de Tama, et l'autre, un lien qui paraît évident. Trop, même. La probabilité est grande que ces deux récits ne soient pas parallèles, mais comment les relier l'un à l'autre ? Ce sera bien sûr un des enjeux de cette lecture, un autre ressort à suspense. Mais aussi un autre vecteur de violence...
Je ne vous dis rien de cette deuxième histoire, si ce n'est que l'on y retrouve un personnage giebélien typique, si je puis dire, un homme coincé entre le bien et le mal, entre la soif de vengeance et l'hypothèse de la rédemption. Un homme "bien", peut-être, en tout cas, certainement plus que la plupart des personnage croisés jusque-là, Tama exceptée.
Et pourtant, un homme violent, impitoyable. Un tueur, mot à prendre dans son sens premier. Un solitaire qui semble s'être résigné à la violence et avoir perdu tout espoir. Qu'adviendra-t-il de lui, quand s'achèvera sa quête ? Ne sera-t-il pas alors arrivé au bout de sa vie, faute d'avoir simplement envie de poursuivre ?
L'idée de rédemption lui est étrangère, elle semble même contraire à sa philosophie, puisqu'il ne l'envisage absolument pas pour les autres. Pas de rédemption, donc pas de pardon... C'est un personnage assez effrayant, mais intègre, puisqu'il ne considère pas non plus avoir droit à la rédemption et au pardon. Et qu'il applique une justice toute personnelle...
Il y aurait beaucoup à dire sur les personnages secondaires, ceux qui entourent Tama, ceux qu'elles croisent, rencontrent, ceux avec qui elle se lie, pour le pire plus souvent que pour le meilleur. Etant donné le contexte, leur appliquer le traditionnel clivage bien-mal paraît difficile, car ce sont tout de même des esclavagistes...
Sur les personnages de la deuxième trame aussi, puisqu'un doute persiste, au moins pour l'un d'entre eux, sur leur identité, mais cela nous entraînerait un peu loin, cela obligerait à lever un peu trop le voile. Mais, comme souvent dans les romans de Karine Giebel, ce qu'on va surveiller, c'est leur évolution, leur combat personnel, contre eux-mêmes bien souvent.
"Toutes blessent, la dernière tue" est à ranger au rayon thriller, même si on pourrait hésiter à le placer en roman noir. Car, si la construction du roman, des chapitres brefs, eux-mêmes subdivisés, avec des changements de narration et de point de vue, correspond aux techniques du thriller, le rythme du livre est finalement plutôt lent.
Karine Giebel nous raconte des tranches de vie, pas une intrigue à rebondissements comme on pourrait l'entendre traditionnellement. C'est un livre un peu hybride, qui place dans une trame qu'on aurait plutôt tendance à classer en roman noir, mais au cours duquel les moments de tension et de violence se succèdent et font froid dans le dos.
La violence est l'un des ingrédients importants de ce livre, vous vous en doutez, et Karine Giebel montre une nouvelle fois son talent et sa "créativité" pour exprimer la cruauté et la méchanceté. Va-t-elle trop loin ? Y en a-t-il trop ? Chaque lecteur aura sans doute son idée sur cette question, même si le sujet se prête aux mauvais traitements.
On retrouve surtout ce contexte dans lequel les personnages qu'elle met en scène évolue toujours, quelque part entre l'immoralité et l'amoralité. On s'affranchit des règles traditionnelles mises en place par la société et Tama, par exemple, évolue dans une zone grise où ne s'applique que la loi du plus fort, où c'est celui qui porte les coups qui a le dessus...
Avec "Toutes blessent, la dernière tue", Karine Giebel s'attaque à un phénomène en recrudescence, ce qu'on appelle l'esclavage moderne, qu'on appelle aussi servitude domestique. En sont le plus souvent victime, des jeunes filles ou des jeunes femmes, à l'image de Tama, et c'est une pratique qu'on trouve dans la plupart des pays occidentaux, et dans la plupart des couches sociales.
Je termine le billet avec un lien, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ce crime, que le code pénal français ne prend en compte que depuis 2013... Il s'agit du site de l'OICEM, que Karine Giebel donne elle-même à la fin du livre, l'Organisation Internationale Contre l'Esclavage Moderne, et auprès de laquelle la romancière s'est documentée...
Inscription à :
Articles (Atom)