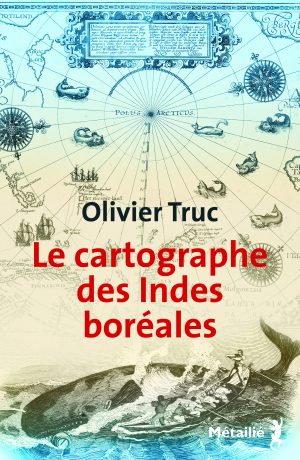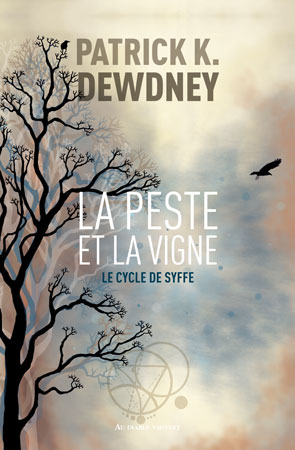Après le long voyage dans les 7 Royaumes et son heptalogie du
"Sang de 7 Rois", revoilà Régis Goddyn, cette fois avec un projet qui apparaît fort différent, ne serait-ce que dans son ampleur, puisque c'est un tome unique, cette fois. Un roman au titre intrigant, qui donne envie d'en savoir plus sur ce nouvel univers et les personnages qui l'habitent : "L'Ensorceleur des choses menues" (en grand format aux éditions de L'Atalante). Mais ce qui ne change pas, c'est la capacité de Régis Goddyn à emmener ses lecteurs là où ils ne s'attendent pas du tout à aller et à développer un univers qui, au fil des pages, change sensiblement. Pour ce roman, il ajoute un autre aspect très agréable et intéressant, en bousculant tous les codes du genre, imposant des antihéros inattendus, qui vont non seulement se découvrir une nouvelle vocation, qu'on pourrait qualifier de révolutionnaire... Attention, un univers peut en cacher un autre !

Depuis des années, des décennies, Barnabéüs exerce modestement, mais avec compétence et intégrité, la profession d'ensorceleur des choses menues, à Kiomar-Balatok. Mais, peu après la mort de son père, il a décidé de ne plus exercer et de prendre sa retraite afin de se consacrer entièrement à la rédaction de ses mémoires.
Dans ce but, il s'est offert un cabinet d'écriture, lui qui n'avait jamais cédé au luxe superflu jusque-là, et n'hésite pas à s'enfermer pour écrire, afin qu'on ne le dérange pas. Pourtant, un soir, Gélinas, la servante restée à son service malgré la retraite de l'ensorceleur, vient frapper à sa porte alors qu'il planche sur son manuscrit.
Si elle a enfreint la règle, c'est pour avertir Barnabéüs qu'une jeune fille veut absolument le voir. Lui, et personne d'autre. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'elle vient et, même éconduite, elle n'en démord pas... Et ce soir-là, lassée de s'entendre dire de revenir le lendemain, comme la veille, et le jour d'avant, elle force l'entrée de la maison de l'ensorceleur...
Surpris, Barnabéüs découvre une adolescente, presque une enfant, encore ! Elle dit s'appeler Prune et avoir 17 ans ; elle explique être en passe elle-même de devenir ensorceleuse des choses menues. Barnabéüs pense qu'elle veut devenir son élève, ce qui est hors de question, mais la demoiselle n'a pas fini de le surprendre...
Car son projet est bien plus complexe : elle veut se rendre à Agraam-Dilith, la cité secrète, dont personne ne connaît l'emplacement, à l'exception des mages et des initiés. Ce que ne sont pas les ensorceleurs des choses menues, qui ne quittent jamais leur cité. Et, si elle souhaite entreprendre cet improbable voyage, et embarquer Barnabéüs au passage, c'est pour une bonne raison.
Son fiancé, Arlanis, a entrepris le voyage vers Agraam-Dilith, en compagnie de son père, afin d'effectuer ce qu'on appelle le Haut Voyage, une sorte de rite initiatique pour les jeunes destinés à devenir à leur tour mage. Mais ni Arlanis ni son père ne sont rentrés de ce périple et Prune redoute qu'il leur soit arrivé malheur en chemin.
Mais Barnabéüs, inflexible, refuse d'aider Prune. Il s'ouvre même de cette histoire à son frère, Palpoternim, qui est le mage de la famille, désormais, mais celui-ci n'est pas d'un grand secours : seuls les initiés ont accès aux informations sur le Haut Voyage, Barnabéüs et Prune sont des évincés, ils doivent rester à leur place, et c'est tout...
Même s'il a repoussé Prune, le vieil ensorceleur est taraudé par cette histoire, au point de ne plus parvenir à se concentrer sur ses mémoires. C'est pour cela qu'il décide d'aller au marché, faire quelques courses, ignorant que cette balade va bouleverser son existence modeste d'ensorceleur des choses menues, et pas seulement ça...
Il découvre que Prune a été attaquée, apparemment par des soldats, auxquels elle a pu échapper de justesse. Lorsqu'il parvient à la retrouver afin de lui venir en aide (mais aussi de comprendre ce qui se passe), elle s'apprête à monter sur un bateau, dans le but évident d'entreprendre coûte que coûte l'impossible voyage... Barnabéüs va hésiter, mais pas longtemps, et finalement la suivre...
Il y a toujours quelques chose d'amusant et d'instructif à écrire ce résumé en s'appuyant non pas sur a quatrième de couverture ou sur ses souvenirs de lecture, mais en reprenant le début du roman. On y remarque certains détails, insignifiants lors de la première lecture, mais qui prennent un relief nouveau lorsqu'on y revient en sachant ce qui va se passer. C'est le cas ici.
Dans ce premier chapitre, eh oui, je ne suis pas allé plus loin, pas besoin, il y a une foule d'informations sur l'univers et sur les personnages. Une foule, oui, mais pas les tenants et les aboutissants de cette histoire, juste pas mal de questions, que l'on partage avec Barnabéüs et Prune. Et ce n'est qu'un début, car le mystère va aller en s'épaississant...
Mais, d'emblée, j'ai retrouvé ce qui m'a immédiatement donné envie de lire ce roman après avoir lu la quatrième de couverture : ce monde particulier où la magie nous apparaît sous un jour un peu particulier. Oh, bien sûr, j'ai évoqué, les mages, mais on ne les voit pas en action, ceux-là, et la magie se limite donc à ces fameuses "choses menues" (aucun double sens, m'enfin !).
A Kiomar-Balatok, la magie est au service du quotidien. Les sorts que connaît et utilise Barnabéüs chaque jour depuis tant d'années n'ont absolument rien de spectaculaire, en tout cas pas au sens où on entend ce mot (mais celui qui permet au cabas plein de courses de flotter derrière soi, je dois dire qu'il me plairait bien, quelquefois...). Ce sont avant tout des actes pratiques.
En fait, ce qu'on comprend petit à petit, c'est que les ensorceleurs des choses menues remplacent les artisans, dans cet univers. Ils s'occupent de toutes ces tâches bien utiles, du chauffage à la serrurerie, en passant par la plomberie, j'en oublie, mais je n'ai évoqué que les spécialités de Barnabéüs... Si la magie est extraordinaire, c'est parce que tout le monde ne la possède pas, mais elle sert à faire peu.
De même, c'est un monde minuscule : il se limite à Kiomar-Balatok. Entendons-nous bien, ce n'est pas réellement le cas, mais l'ensorceleur des choses menues ne quitte jamais sa vallée. Il est comme ancré dans une ville et a suffisamment à s'occuper pour ne pas penser à voyager. Il en va de même dans les autres villes des autres vallées de cet univers.
Autrement dit, Barnabéüs, malgré son âge avancé, ignore tout du monde dans lequel il vit. Seuls les mages, mais aussi les marchands, peuvent aller d'une ville à l'autre. Les premiers, pour le Haut Voyage, on l'a dit, les seconds, parce qu'il en va comme partout : chaque ville a ses spécialités que ses voisins n'ont pas forcément.
Mais, lorsqu'on entre dans le livre, c'est donc un monde quasiment clos. Oh, bien sûr, un roman de fantasy se limitant à une unité de lieu, en l'occurrence une ville, ce n'est pas rare, mais c'est plus la situation et l'action qui l'imposent, et non, comme dans "L'Ensorceleur des choses menues", des questions sociales, en l'occurrence l'appartenance à une caste.
Car ce que l'on découvre aussi, c'est que Kiomar-Balatok est une ville fonctionnant selon des règles très strictes, et apparemment immuables depuis très longtemps. Il y a une aristocratie, avec de grandes familles ayant en leur sein des mages. Ou plutôt, un mage par génération, que l'on désigne avant de partir pour le Haut Voyage. L'élu en reviendra formé pour affronter l'avenir...
On n'en sait guère plus sur ces mages. On en apprend un peu plus sur les autres, ceux qui ne sont pas choisis pour cet enseignement, et qu'on appelle donc les évincés. Eux aussi possèdent un savoir magique, mais il sera consacré aux choses menues. C'est le cas de Barnabéüs, pourtant aîné de sa fratrie, mais aussi de Prune.
Et finalement, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, chacun semblant accepter son rôle, sa place dans la société. Oh, tout juste peut-on percevoir une petite pointe de regret, voire d'aigreur, dans les mémoires que Barnabéüs a entrepris de coucher sur le papier. Lui, l'aîné, rabaissé au rang d'évincé, ça laisse une blessure d'orgueil...
Mais point de sentiment de révolte, ni même d'interrogation sur le fonctionnement des castes supérieures, c'est une espèce de mouvement perpétuel qu'on accepte avec un fatalisme désarmant... Jusqu'à ce que Prune entre en scène et ne vienne secouer sérieusement tout cela pour la plus belle des raisons : par amour !
Avec son histoire de fiancé disparu, Prune a instillé le doute chez Barnabéüs. Oh, on est encore au stade embryonnaire du questionnement... Mais, telle l'aile de papillon déclenchant une tempête, l'adolescente a enclenché un processus tout à fait inattendu, qui va changer radicalement le destin des deux ensorceleurs des choses menues...
Je dois dire que l'idée de ce voyage avec des magiciens aux pouvoirs dignes d'un McGyver (mais sans couteau suisse) m'amusait fortement, que j'aimais l'idée de ce minimalisme appliqué à la fantasy. Et surtout, je me demandais vers quoi cela allait nous mener... Je suis entré avec prudence dans cette lecture, m'attendant à tout ou presque, de la part de Régis Goddyn...
Et je me suis fait avoir, comme il se doit... Du voyage et de ses conséquences, on ne va évidemment dire que très peu de choses. Je ne suis même pas sûr que vous me croiriez si je vous le disais, de toute manière... Mais oui, encore une fois, il n'est pas la peine de s'attaquer à ce livre en échafaudant des hypothèses, il est fort peu probable que vous tombiez juste.
Ce qui est amusant, c'est donc de faire de la magie une activité sans envergure, très quotidienne, je me répète, mais pas seulement. Régis Goddyn met en scène deux antihéros, un vieil homme et une jeune fille, deux candides, par la force des choses, puisqu'ils sont évincés et que leur horizon se limite à leur vallée, deux personnages peu préparés à se lancer dans une grande bagarre...
Là encore, l'auteur joue avec les codes du genre, car ces deux personnages non-prédestinés, vont se lancer dans un véritable voyage initiatique. J'ajoute l'adjectif véritable, car l'expression voyage initiatique est un tel archétype qu'on finit par la galvauder, par oublier son sens réel et par en faire quelque chose de très commun.
Or, ici, ce n'est absolument pas le cas, et c'est encore plus frappant, puisque cela concerne un vieil homme, au crépuscule de son existence... Un vieil homme qui ne sait rien, si ce n'est de la vie, du moins du monde qui l'entoure. Et qui, jusqu'à ce moment, s'en est fort peu préoccupé, il est vrai. Mais, le voilà lancé sur un coup de tête, sans arrière-pensée à cet instant.
Pour Prune, c'est l'amour, mais aussi la colère et le désespoir qui l'animent. Mais là encore, à une échelle fort restreinte : la sienne. N'y voyez pas d'égoïsme, il n'y a pas non plus d'idée subversive dans la démarche de Prune, juste le besoin de savoir ce qui a pu arriver à son fiancé. On pourrait croire à une espèce d'enquête policière, menée par un improbable tandem...
Et pourtant, Mesdames et Messieurs, chers amis lecteurs qui passez par-là, vous venez d'assister à la première étape d'une révolution... L'ordinaire, qui se prolonge un moment, dans la première partie du voyage de Prune et Barnabéüs, va brusquement basculer dans l'extraordinaire. Attention, ordinaire ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais au regard de ce qui va se dérouler ensuite, ça l'est.
Peut-être en ai-je déjà dit un peu trop, donc je vais en rester là sur la manière dont cette révolution va se mettre en place, ses causes et ses conséquences, bien sûr, mais aussi ce que tout cela va faire apparaître... Parce qu'on ne le voit pas venir, on ne s'y attend pas, et surtout on n'imagine pas l'ampleur de ce qui va se mettre en place...
Régis Goddyn nous livre avec "L'Ensorceleur des choses menues" sa version de la lutte des castes et sa Bastille n'a rien d'une banale forteresse, telle qu'on pourrait dessiner dans son esprit la cité secrète d'Agraam-Dilith. Mais il y a un esprit assez proche de cela, la révolte des menus contre ceux qui profitent d'eux et les écrasent, les méprisent.
On retrouve dans ce roman quelques thèmes qui étaient déjà présents dans "Le Sang des 7 Rois", et en particulier l'idée de succession, de lignée. Ici, cela se passe par des liens plus classiques, une filiation, et par un choix, une désignation, qui va faire d'un des enfants, à chaque génération, un mage. Une fonction qui doit s'apprendre, rien n'est finalement inné dans cet univers.
Mais cette succession, que l'on prépare, que l'on assure, est aussi une garantie de reproduire sans fin la même société, c'est ce qui assoit le système de castes, puisque les mages sont choisis par les leurs, puis cooptés et même escortés au cours du Haut Voyage... L'ascension sociale est donc impossible et ce déterminisme, on l'a dit, semble non seulement accepté, mais assimilé par tous.
Jusqu'à quel point ? Que faudrait-il pour que tout cela soit remis en question, et même dénoncé et renversé ? C'est certainement l'enjeu majeur de ce roman, où la magie n'est pas la seule bizarrerie : de 7, dans l'heptalogie, on passe à zéro roi, dans "L'Ensorceleur des choses menues". On n'y croise ni épée ni chevaux, même si l'on va recourir à quelques moyens de locomotion originaux en cours de voyage...
Bref, c'est un univers complètement atypique, et pourtant, il va vous apparaître encore plus étonnant, déroutant peut-être (si je vous racontais les effets qu'il a eu sur mon imaginaire ! Dingue !) au fil des pages et des rebondissements. Mais il est certain que ce petit monde n'aura plus du tout la même allure une fois que vous aurez terminé les 480 pages de ce roman.
Ah, un dernier truc, tiens : je me suis beaucoup interrogé, comme souvent avec les romans de fantasy, mais pas seulement, sur l'onomastique. Pour être franc, j'ai lamentablement échoué à percer les mystères de Régis Goddyn, SAUF pour un personnage, au rôle-clé dans cette histoire, dont je ne dirai rien de plus ici : celle qu'on appelle l'Ellierim.
J'ai bien ri, je dois dire, en me rendant compte (mais il m'a fallu un moment) que ce titre était en fait un clin d'oeil, et pas destiné à n'importe qui... Sans doute le cadeau d'anniversaire de l'auteur pour les 30 ans de sa maison d'édition... Mais un cadeau plein de malice, puisqu'on ne peut pas dire qu'il ait choisi le personnage le plus sympathique pour incarner ce clin d'oeil !