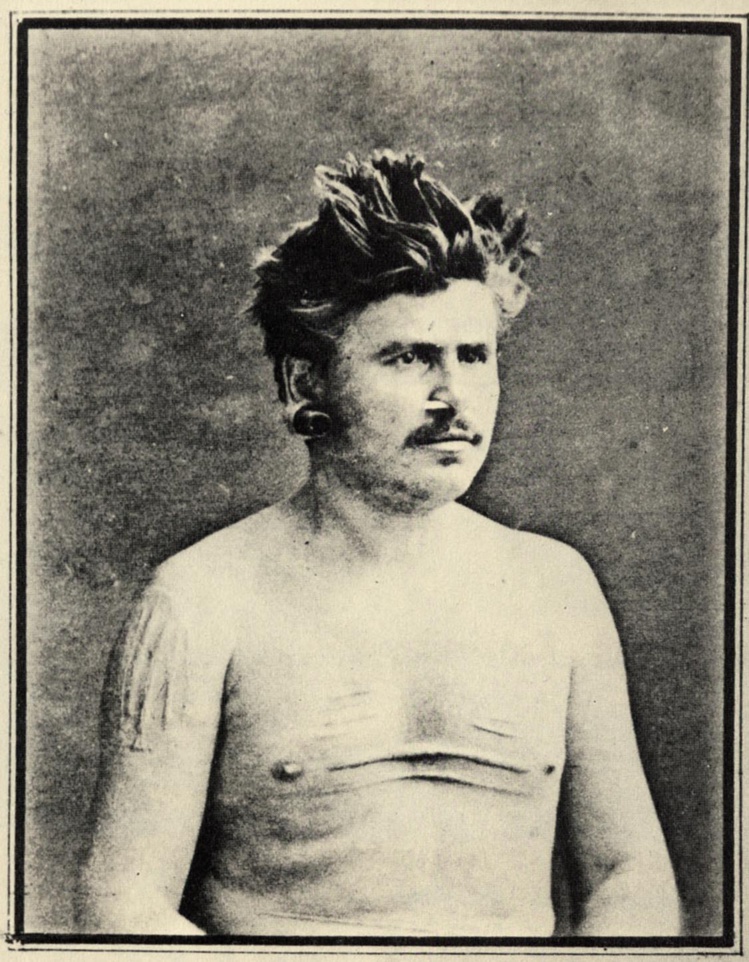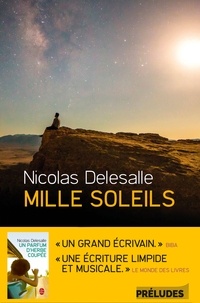L'Histoire est écrite par les vainqueurs, cela pourrait être le sous-titre de notre roman du jour, avec ce corollaire : les vainqueurs ne sont pas forcément ceux que l'on voudrait voir l'emporter... Dans ce domaine, l'Espagne franquiste est un triste exemple, puisque la dictature s'est imposée pendant près de 40 ans après un conflit sanglant et ce souvenir demeure vivace encore aujourd'hui, alors que la dictature n'a jamais été condamnée officiellement... "Je peux me passer de l'aube", le nouveau roman d'Isabelle Alonso (aux éditions Héloïse d'Ormesson), est le premier volet d'un cycle qui s'inspire de l'histoire du père de la romancière. Un homme qui s'est engagé à 15 ans dans les troupes républicaines, rapidement balayées. Cette première partie nous plonge dans une Espagne écrasée sous le double joug (mot choisi à dessein) du sabre et du goupillon, où chaque parole doit être mesurée pour ne pas devenir un motif de dénonciation ou d'accusation, où l'on se résigne à vivre selon cette oppression d'Etat... Mais pas Angel...
A l'été 1939, la Guerre d'Espagne est officiellement terminée. C'est Franco lui-même qui en a fait l'annonce, entérinant de fait la victoire des Nationalistes et la défaite des Républicains. La vie peut donc reprendre son cours normal, sauf que ce n'est pas tout à fait le cas : désormais, le pays est placé sous un impitoyable Etat policier, qui a décidé d'éliminer tout ceux qui voudraient s'opposer à son pouvoir...
Angel Alcala Llach n'a alors que 16 ans et il a pourtant déjà connu bien des dangers, et bien des désillusions. Un an plus tôt, il a fui sa famille pour rejoindre les rangs de l'armée républicaine et combattre les troupes franquistes. Il a connu l'épreuve du feu, mais surtout, la débandade... Une retrait qui l'a emmené, comme des milliers d'autres, de l'autre côté de la frontière française.
Là, l'accueil a été loin d'être enthousiaste... Les Républicains espagnols ont été rassemblés sur des plages dans ce qu'il faut bien appeler des camps de concentration, détenus dans des conditions atroces pendant de longs mois. Maintenant que la guerre est officiellement terminée, ceux qui le souhaitent peuvent rentrer chez eux. On va les appeler "Los que Vuelven", ceux qui reviennent.
Parmi ces vas-nus-pieds misérables et dépenaillés, il y a Angel, qui conserve, sans doute du fait de son jeune âge, un idéalisme auquel tant d'autres ont d'ores et déjà renoncé. Pour lui, la guerre n'est pas terminée, non, la lutte contre le franquisme doit se poursuivre, sous d'autres formes, mais il ne faut surtout pas renoncer...
Pourtant, d'emblée, Angel connaît un nouveau coup dur : on ne le laisse pas rentrer chez lui, comme si de rien n'était. Son appartenance aux armées républicaines lui vaut une condamnation de fait, et sans aucun procès, aux travaux forcés. Les vaincus sont reconnus responsables des destructions occasionnées au cours des trois années de conflit, à eux de réparer...
Et même si Angel est plutôt doué pour éviter les corvées et se faire oublier, il n'en reste pas moins prisonnier, éloigné des siens... De nouveaux mois à patienter avant, enfin, d'être rendu à la vie civile. Et toujours la même foi dans les idées républicaines, la même volonté de se battre pour un idéal désormais interdit.
Mais, lorsqu'il retrouve les siens, beaucoup de choses ont changé et Angel constate avec amertume que le franquisme a bel et bien balayé toute opposition, pire, toute volonté de s'opposer à lui. La peur et la résignation domine chez ceux qui étaient de farouches partisans de la République. Une situation que le jeune homme, malgré le danger que cela représente, ne peut accepter...
Oui, l'Histoire est écrite par les vainqueurs et, en Espagne, contrairement à la majeure partie de l'Europe où il a fini par s'effondrer, c'est le fascisme qui a triomphé. Et imposé ses idées, sa visions de la société. Par la force et la coercition. Un pouvoir politique qui n'a plus de rival, qui met son pays en marge du reste du monde, comme toute dictature, quel que soit son idéologie, mais avec un allié de taille : l'Eglise.
On retrouve, sous cette férule terrible, cette Espagne austère et puritaine telle qu'on l'a connue sous les Habsbourg, puis sous les premiers Bourbons. L'Espagne des pénitents qui se flagellent dans les processions religieuses, l'Espagne des femmes tout de noir vêtues, qui rasent les murs jusqu'à s'y effacer... Une austérité tellement contraire à la flamboyance et à la joie qui émanent de cette culture.
Contrairement à l'Italie ou l'Allemagne (alliées de Franco), le fascisme s'est imposé en Espagne par la force brute, après une effroyable guerre civile. On croit connaître cette période historique, on croise des romans qui évoque d'ailleurs le plus souvent la lutte des Républicains, mais, ensuite, on referme la parenthèse. Et pour cause : dès l'automne 1939, on va se focaliser sur d'autres événements...
Oui, bien sûr, pour nous, Français, les années qui vont venir focalisent notre attention. La défaite, lamentable, honteuse, bien moins glorieuse que celles des Républicains espagnols qui ont tenu trois ans avec bien moins de moyens... Puis l'Occupation, la Collaboration, la Résistance, etc. Autant de thèmes dont la littérature abonde...
Mais, pendant ce temps, on perd de vue ce qui se passe en Espagne (et n'oublions pas le Portugal de Salazar !), cette vie qui reprend son cours, comme je le disais plus haut, mais un cours dévié pour aller dans le sens unique de la pensée franquiste... En lisant "Je peux me passer de l'aube", on se dit qu'on pourrait être en France occupée, on reconnaît tout cela... Mais, en Espagne, cela va durer quatre décennies !
Le roman d'Isabelle Alonso n'est pas aussi noir qu'on pourrait l'imaginer de prime abord. Elle sait donner une luminosité certaine à l'histoire d'Angel et de sa famille. Mais, autour d'eux, ce n'est pas la même chose. A travers les yeux de l'adolescent, qui découvre cette situation que ses proches subissent depuis déjà trop longtemps, on conserve une flamme, un optimisme, une foi (pas au sens religieux) que le pouvoir s'acharne à éteindre.
Angel, et c'est ce qui en fait un formidable personnage, ne renonce pas, ne se résigne pas. Jamais. C'est hors de question pour lui. Ni l'exil, ni la détention, ni les travaux forcés n'ont atténué sa résolution. Mais, alors qu'il mesure l'ampleur des problèmes qui se posent désormais à ceux qui, comme lui, croient encore à l'idéal républicain et à sa victoire, il prend aussi conscience des risques qu'encourent ses proches.
Il y a sa mère, son frère Queno, en âge de se débrouiller, mais aussi une petite soeur qui n'a pas encore 10 ans et un dernier frère qui n'est encore qu'un bébé... Ils sont fragiles et surtout, ils vont grandir sous cette coupe, cette chape franquiste. Tenez, un exemple : pour Angel, l'éducation doit être une priorité, il faut que ses jeunes frère et soeur aillent à l'école...
Sauf que celle-ci est devenu une machine à embrigader les enfants, à fabriquer de bons petits franquistes. Pire, dans leur candeur, leur innocence, ils pourraient révéler sans le vouloir l'appartenance de leur famille au camp républicain, ce qui pourrait mettre tout le monde en danger. Un effroyable cercle vicieux...
Imaginez ce que cela doit être de devoir saluer, le bras tendu, en bon fasciste, les militaires qu'on croise, de devoir faire le signe de croix quand on tombe sur une des innombrables processions organiser, de devoir ruser pour ne pas aller à la messe alors qu'on est athée... De risquer de se trahir, faute d'avoir appris les prières...
Imaginez la difficulté que représente le fait de devoir montrer patte blanche en toutes circonstances, pour s'approvisionner, travailler, s'instruire, se loger... Les "Rojos", les Rouges, terme fourre-tout sous lequel le pouvoir franquiste regroupe non seulement ses opposants, mais toute personne ne rentrant pas dans les normes qu'il a fixées, n'ont aucune chance. On les étouffe, et leur espoir avec...
D'une certaine manière, découvrir tout cet environnement, ces dangers constants, cette menace latente, le désenchantement et la résignation qui s'étendent, tout cela concourt à renforcer la détermination d'Angel, son engagement pour la cause républicaine, qu'il entend servir encore et encore, sous des formes différentes de ce que faisait son père avant la guerre.
L'espoir... En 1937, c'était le titre d'un roman d'André Malraux soutenant la cause républicaine, mais à peine deux ans plus tard, ces mêmes Républicains sont abandonnés par le reste de l'Europe, trop occupée à s'auto-détruire. Ce renoncement international est aussi ce qui entérine la victoire franquiste, pire, lui donne les coudées franches pour resserrer son emprise...
Un des aspects les plus durs du roman d'Isabelle Alonso, c'est la succession de désillusions auxquelles doit faire face Angel. Oh, il a déjà l'habitude, les couleuvres à avaler et les trahisons, jusque dans son propre camp, il connaît, depuis que l'éphémère et légitime République espagnole a été renversée.
Mais, Angel a l'espoir chevillé au corps, chaque fois qu'il parvient à se procurer des journaux étrangers, la presse espagnole étant à la botte du pouvoir, qu'il y lit des nouvelles encourageantes, il espère. Il espère que ces jours meilleurs arrivent jusqu'en Espagne. Puis, il déchante lorsqu'il se rend compte que ce ne sera pas le cas. Et c'est alors comme un coup au foie...
Angel est un boxeur qui encaisse, encaisse... Les coups pleuvent, au visage, au corps, il y a même des coups bas, puisque son adversaire a le droit d'y recourir, contre toute forme de morale... Mais Angel ne tombe pas, où lorsque ça lui arrive, il se relève et tient bon. Pas de K.O. pour Angel Alcala Llach qui, dans les cordes, attend le moment idéal pour riposter...
"Je peux me passer de l'aube", c'est un premier round. Aux points, l'avantage est très net pour le pouvoir franquiste ; malgré son courage et sa détermination, Angel a subi les premiers assauts. Mais, il s'organise aussi, pour trouver la faille. C'est aussi l'enjeu de ce roman, voir comment Angel va poursuivre la lutte, sous quelles nouvelles formes, et avec qui...
Une gageure que d'organiser une lutte clandestine quand chaque personne que l'on croise peut s'avérer être un traître, un mouchard... Mais, cette quête, car c'est aussi une quête initiatique, est également celle d'un jeune homme, devenu adulte par la force des choses, mais qui a encore beaucoup à découvrir de la vie.
Il a commencé, sous l'uniforme, à découvrir les liens qui peuvent unir les hommes, une fraternité qui n'est pas qu'un mot. Il entend bien la retrouver et ces nouvelles rencontres, que le lecteur fait aux côtés d'Angel, en sont l'occasion. Avant d'entamer une nouvelle aventure, celle qui sera au coeur du prochain tome, j'imagine.
"Je peux me passer de l'aube" est un beau roman sur l'idéalisme, celui de la jeunesse, certainement, mais pas seulement. Celui qui est animé par une volonté de justice et de respect. On peut ne pas partager toutes les idées d'Angel, mais on ne peut que reconnaître son courage, sa force, sa sincérité. La certitude qu'il a d'oeuvrer pour un monde meilleur, quand autour de lui, c'est le Meilleur des Mondes qui se déploie.
On ressent évidemment tout l'amour, toute la tendresse d'Isabelle Alonso pour ce personnage inspiré du parcours de son père. Elle réussit surtout à traiter un sujet lourd, douloureux, dur, oppressant, avec une certaine légèreté de ton, en laissant une place pour le sourire, la joie de vivre, qu'on voudrait pourtant elle aussi mettre sous le boisseau.
Cela donne une lecture qui pourrait être pesante, difficile, mais qui est tout le contraire. On suit Angel avec la sensation qu'il est invincible, lui qui appartient pourtant au camp des vaincus. Dans cette société réduite au fatalisme et à l'inexorabilité de la dictature, il entretient une minuscule étincelle qu'il entend bien attiser...
"Il va falloir un jour qu'enfin je me décide à lire les livres que, depuis trente ans, je conseille à mes amis de lire". (Sacha Guitry)
lundi 29 janvier 2018
"Il y a peu de difficultés insurmontables pour celui qui les combat avec un courage opiniâtre" (Pierre-Claude-Victor Boiste).
J'ai choisi la citation originale pour le titre de ce billet, mais dans notre roman du jour, l'auteur la fait varier, et la différence est sensible, puisque "il y a peu" devient "il n'y a pas". Et il faut dire que la principale actrice de ce livre va être confrontée à une terrible série d'événements qui vont faire basculer son destin, confortable et tout tracé, vers les abîmes dont seule la vengeance pourra, peut-être, la sortir. Presque cinq ans après l'énorme succès d' "Au revoir là-haut", que vient de relancer l'adaptation cinématographique d'Albert Dupontel, Pierre Lemaître poursuit ce cycle historique entamé avec la fin de la Ie Guerre mondiale. On retrouve un certain nombre de personnages présents dans le premier roman, mais les deux histoires ne sont pas directement connectées. En revanche, il est certain que les événements précédents ont durement ébranlé la maison Péricourt, dont la chute est au coeur de "Couleurs de l'incendie" (en grand format chez Albin Michel). Un roman qui conserve l'esprit d' "Au revoir là-haut", mais en y insufflant une tonalité assez différente, peut-être pas moins sombre, mais bien plus ironique...
Marcel Péricourt est mort. Le patriarche à la tête de la modeste mais prospère banque d'affaires portant son nom s'est éteint, plongeant la famille dans une situation délicate. En effet, après la mort de son fils, Edouard, et l'incarcération de son gendre, Henri, l'héritière de la fortune familiale, celle qui va devoir prendre les rênes de l'entreprise, c'est Madeleine.
Nous sommes en février 1927 et, pour l'instant, ces questions ne se posent pas. Les obsèques de Marcel Péricourt vont se dérouler à la Madeleine et le cortège sera suivi par une foule nombreuse. Au premier rang, le gratin de la politique et de l'économie françaises, car la banque Péricourt est un établissement qui compte.
Mais, un événement va tout bouleverser : alors que le corbillard s'apprête à quitter l'hôtel particulier où vit la famille Péricourt, Paul, le fils de Madeleine, alors âgé de 7 ans, chute par une fenêtre. Dans un étrange et morbide parallèle avec son oncle, il s'écrase sur le cercueil de son grand-père, provoquant un mouvement de panique.
A-t-il sauté ou bien l'a-t-on poussé ? C'est en tout cas un nouveau drame qui frappe la famille déjà durement éprouvée. L'enfant survit, mais il ne pourra plus jamais marcher. Madeleine, déjà bien seule depuis la mort de son père, se retrouve donc dans une situation très délicate : chef de famille malgré elle, gestionnaire d'une entreprise alors qu'elle n'est pas formée pour cela, mère d'un enfant paralysé...
Elle va avoir besoin du soutien de ceux qui l'entourent, en particulier Gustave Joubert, le fondé de pouvoir de la Banque Péricourt, l'homme de confiance de Marcel, celui qui connaît le fonctionnement de l'entreprise et le monde de la finance comme sa poche, et Léonce Picard, sa dame de compagnie, à son service depuis des années.
Il y aurait bien aussi Charles Péricourt, son oncle, le frère de Marcel, mais celui-ci a beau être député de la République depuis un bail, c'est le vilain petit canard de la famille. Il a toujours vécu aux crochets de son aîné qui a fait sa carrière et c'est un panier percé, toujours en demande d'argent pour permettre à son épouse et à ses jumelles de conserver un train de vie très confortable...
La pauvre Madeleine, si l'on peut parler ainsi, n'est pas préparée à cette situation et elle est bien naïve. La fortune des Péricourt attire les convoitises, l'argent, mais aussi le statut social, et l'on sent bien que l'héritière n'est pas à la hauteur... Sans compter son inquiétude légitime pour son fils, bien mal en point...
"Quand le lion est mort, les chacals se disputent l'empire", faisait dire Michel Audiard à l'un des personnages des "Tontons flingueurs", et c'est exactement ce qui va se passer. Alors que le monde entre dans une nouvelle phase de turbulences, entre la crise de 1929 et la montée des idéologies fascistes et nazies, Madeleine va devoir devenir lionne, si elle ne veut pas tout perdre au profit des chacals...
Si les références littéraires d' "Au revoir là-haut" étaient diverses et rendaient hommage aux écrivains qui avaient connu les tranchées et raconté cette terrifiante expérience, pour "Couleurs de l'incendie", Pierre Lemaître n'en revendique qu'un seule : Alexandre Dumas. Et il est effectivement difficile de ne pas penser au "Comte de Monte-Cristo" en lisant le roman et en découvrant le parcours de Madeleine.
Il faut donc une chute, et plus elle sera dure, mieux c'est, et une vengeance machiavélique dans laquelle l'héroïne, ingénue et malléable au début, se montre inflexible et impitoyable envers ses ennemis. Un plan qui doit s'organiser dans le contexte particulier de ce cycle historique, donc dans le cadre de l'histoire de la famille Péricourt et dans cette période du tournant des années 1920 et 1930.
Et puis, parce que "Au revoir là-haut" était une histoire d'arnaques, eh bien, on remet ça. Il y a sans doute moins d'originalité dans les méthodes des personnages pour dépouiller leur prochain que dans le premier volet de la série, mais cela reste un roman qui se lit avec beaucoup de plaisir et de fluidité, où l'on attend de voir quelle sera la réponse de la bergère aux bergers.
Moins original, parce qu'il y avait dans "Au revoir là-haut" le magnifique personnage d'Edouard, qui dynamitait tout par la folie de son désespoir. Et qui jouait avec ces masques qu'il fabriquait pour cacher son visage démoli. Dans "Couleurs de l'incendie", les masques sont toujours là, même s'il faut prendre ce terme au sens figuré.
Entre l'être et le paraître, entre les apparences et les intentions, le décalage est très net. Le lecteur le comprend rapidement, avant de prendre conscience de l'ampleur du problème. D'une certaine manière, Madeleine est la seule à ne pas jouer ce double jeu. Du moins, au début de l'histoire : elle est réellement abattue (et on la comprend) et n'a pas du tout été préparée à prendre la direction de l'entreprise portant son nom.
Mais, quand elle va déchoir, et plus que brutalement, elle va changer. Et à son tour, elle va apprendre à tromper les autres, à cacher ses émotions, à jouer avec des masques. Elle va se défaire de sa pureté, de sa posture de grande bourgeoise, de son éducation et accepter de jouer avec les règles du jeu qui lui ont tout coûté. A malins, maligne et demie...
On retrouve donc, dans "Couleurs de l'incendie", un point de départ commun à "Au revoir là-haut" : la perte de l'innocence. Comme son frère avant elle, Madeleine a été élevée dans un cocon, déconnectée du monde tel qu'il va, assurée d'un avenir sans nuage. Oh, bien sûr, son mariage avec Aulnay-Pradelle l'a déjà fait chuter de quelques étages pour l'installer sur un nuage moins élevé.
Mais, dans l'ensemble, jusqu'à la mort de son père, la vie de Madeleine est sans problème. Elle est ultra-protégée, sous l'aile d'un père respecté, et sans doute plus craint encore. A sa mort, elle est comme un oisillon jeté du nid, à la merci des prédateurs de tout poil. Et comme elle est dans un milieu où le nombre d'ambitieux est inversement proportionnel à celui des scrupules...
Puisqu'on évoque ce contexte particulier, il y a des choses à dire. D'abord, sur le plan historique. Lorsque le roman s'ouvre, en 1927, on se dit que l'échéance de 1929 (privilège du lecteur qui connaît l'avenir, au contraire des personnages) va jouer un rôle clé dans l'histoire. C'est vrai, mais pas comme on pourrait l'imaginer, Pierre Lemaître sait nous prendre à contre-pied...
Pourtant, et même sans ces péripéties et ces drames, l'avenir de la Banque Péricourt aurait été délicat : on est au début d'un changement d'ère, et celle qui s'ouvre ne laisse plus de place aux établissements familiaux. Après 1929, les grands groupes concentrant ressources et pouvoirs vont définitivement s'imposer et se partager le marché.
La seconde partie de "Couleurs de l'incendie" se déroule à partir de 1933. Cette fois, c'est la politique qui domine, avec la montée du fascisme italien et l'avènement de Hitler en Allemagne. La situation dans laquelle évolue les personnages se tend, des enjeux nouveaux apparaissent, des priorités nouvelles, aussi, et l'on retrouve tout cela dans le roman.
Alors, si le nouveau roman de Pierre Lemaître se revendique ouvertement de Dumas, on peut aussi y voir une dimension très balzacienne, dans l'évolution de cette famille, de son entreprise et des vautours qui cherchent chacun à en retirer quelque chose. Un aspect renforcé par la présence autour de Madeleine d'un véritable Rastignac.
Je n'évoque pas trop les personnages du roman, car ce sont les actes de ceux que j'ai évoqués jusque-là qui priment. Pour André Delcourt, c'est un peu différent, car on suit, en parallèle de la chute de Madeleine, son ascension sociale. Se rêvant journaliste, il est prêt à tout pour réussir, se faire une place, y compris à travailler pour rien, dans un premier temps, du moins.
Dans ce roman qui fourmille d'ambitieux, André se démarque, car ce qu'il recherche, c'est la célébrité. Et pour cela, tout les coups sont permis. La référence à Rastignac me semble juste : il part de rien, ou presque, se lance grâce à son talent, mais son idéal est encore au-dessus, en jouant sur l'air du temps, plus encore que sur ses convictions propres.
Tous les choix qu'il fait lorsqu'il doit voler de ses propres ailes sont marqués par cette idée force. Ce n'est d'ailleurs sans doute pas pour rien que, lorsqu'il signe ses éditoriaux, c'est sous le pseudonyme de Kairos, dieu de l'opportunité... Ou des opportunistes ? Lui aussi est un personnage qui porte un masque, et ce que l'on va découvrir derrière le sien est particulièrement monstrueux...
Pierre Lemaître profite du parcours de ce personnage pour s'attaquer au monde de la presse, dans une satire très violente : des journalistes près à tout pour permettre à leurs journaux de vivre et de prospérer, sans se soucier de vérité ou d'information. Guilloteaux, le patron sans scrupule d'André, est un personnage formidable, veule et soumis, bien loin d'incarner le contre-pouvoir médiatique...
Plus j'avançais dans la lecture de "Couleurs de l'incendie", et plus une idée s'est imposée : ce roman, c'est une critique féroce de la France d'aujourd'hui, la France du président Macron. Derrière chaque personnage, chaque situation, on peut voir transparaître des équivalents dans notre actualité du moment. C'est fait avec malice et humour, souvent, mais aussi avec virulence.
J'ai évoqué, même brièvement, la plupart des personnages les plus importants, mais je ne peux pas ne pas parler de deux personnages secondaires absolument formidables, Vladi et Solange. La première, jeune femme arrivée de Pologne et embauchée pour être la nurse de Paul Péricourt, est d'un naturel désarmant, d'une prolixité intarissable que complique le fait qu'elle ne s'exprime que dans sa langue maternelle.
D'elle, on sait bien peu de choses, mais ce qu'on en découvre, petit à petit, ne la rend que plus sympathique. Sa relation avec Paul, en particulier, mais aussi avec Madeleine, qui lui fait toute confiance, va en embellissant au fil du temps et la complicité de l'enfant avec cette femme, va durer lorsque le paralytique va devenir adolescent. Jusque dans une certaine ambiguïté sexuelle.
Solange est cantatrice. C'est l'idole de Paul, une star du monde lyrique qui a connu la gloire et une longue éclipse avant de revenir dans la lumière. Difficile de se détacher, quand on pense à elle, de l'image ancrée dans notre culture collective de Bianca Castafiore. Pierre Lemaître joue avec cette référence, s'en sert, puis la détourne, jusqu'à un final formidable où la diva assoit pour l'éternité sa réputation de provocatrice...
Ces deux femmes font partie des ressorts comiques ou plus légers, dirons-nous, de "Couleurs de l'incendie", car, malgré les drames, malgré les complots, malgré la déchéance et le malheur qui frappent Madeleine, malgré un contexte historique bien sombre, on s'amuse beaucoup à cette lecture. Sans doute plus que dans "Au revoir là-haut".
On en revient aux masques, ceux qui représentent la tragédie et la comédie. Je me souviens les avoir déjà cités dans le billet sur "Au revoir là-haut", on les retrouve dans ce deuxième volet, avec la comédie qui prend un peu le dessus sur la tragédie. Il y a d'ailleurs, dans la première partie du roman, un esprit qui rappelle les pièces de Courteline, par exemple.
Sans être forcément plus léger dans le fond, "Couleurs de l'incendie" laisse tout de même plus de place à l'humour et au sourire. On est dans une farce et certains, je pense à Charles et à sa famille, vont en prendre pour leur grade... Cela crée un équilibre avec la vengeance ourdie par Madeleine (avec l'aide de Dupré, déjà croisé dans "Au revoir là-haut"), qui sera particulièrement sombre.
En tout cas, débarrassée de toute inhibition morale intempestive. Et c'est ce qui rend ce roman jubilatoire : il est délicieusement amoral, y compris du côté des personnages qui, d'emblée, pourraient paraître incarner pureté, candeur et honnêteté. Je pense à Madeleine, bien sûr, mais aussi, et c'est plus étonnant, à Paul, qui va se révéler être un petit malin. A croire qu'il a aussi hérité de certains traits paternels...
Je regarde ce billet, déjà long, j'ai l'impression d'avoir tout survolé ou presque et d'avoir certainement oublié plein de choses... Encore une fois, si j'ai pu trouver "Couleurs de l'incendie" un peu moins original que "Au revoir là-haut", cela reste un excellent moment de lecture, plein de pistes de réflexions, un divertissement, mais pas seulement, car elle dénonce bien des travers de notre société.
Le cycle de Pierre Lemaître ne va pas s'arrêter là, je suis curieux de voir ce qu'il nous concocte pour la suite, à quelle époque, avec quels personnages principaux et dans quel contexte. La saga Péricourt ne fait que commencer et elle va continuer à jouer son rôle de révélateur de nos petits arrangements avec la morale, hier comme aujourd'hui.
Ce second volet est un hommage à toute la littérature du XIXe, celle qui a fondé la littérature populaire. Le lecteur, lui, s'amuse des frasques, s'attriste des drames ou se révolte des injustices dans lesquels sont impliqués les différents personnages, comme s'il assistait à une pièce de théâtre dont la scène serait le monde...
Marcel Péricourt est mort. Le patriarche à la tête de la modeste mais prospère banque d'affaires portant son nom s'est éteint, plongeant la famille dans une situation délicate. En effet, après la mort de son fils, Edouard, et l'incarcération de son gendre, Henri, l'héritière de la fortune familiale, celle qui va devoir prendre les rênes de l'entreprise, c'est Madeleine.
Nous sommes en février 1927 et, pour l'instant, ces questions ne se posent pas. Les obsèques de Marcel Péricourt vont se dérouler à la Madeleine et le cortège sera suivi par une foule nombreuse. Au premier rang, le gratin de la politique et de l'économie françaises, car la banque Péricourt est un établissement qui compte.
Mais, un événement va tout bouleverser : alors que le corbillard s'apprête à quitter l'hôtel particulier où vit la famille Péricourt, Paul, le fils de Madeleine, alors âgé de 7 ans, chute par une fenêtre. Dans un étrange et morbide parallèle avec son oncle, il s'écrase sur le cercueil de son grand-père, provoquant un mouvement de panique.
A-t-il sauté ou bien l'a-t-on poussé ? C'est en tout cas un nouveau drame qui frappe la famille déjà durement éprouvée. L'enfant survit, mais il ne pourra plus jamais marcher. Madeleine, déjà bien seule depuis la mort de son père, se retrouve donc dans une situation très délicate : chef de famille malgré elle, gestionnaire d'une entreprise alors qu'elle n'est pas formée pour cela, mère d'un enfant paralysé...
Elle va avoir besoin du soutien de ceux qui l'entourent, en particulier Gustave Joubert, le fondé de pouvoir de la Banque Péricourt, l'homme de confiance de Marcel, celui qui connaît le fonctionnement de l'entreprise et le monde de la finance comme sa poche, et Léonce Picard, sa dame de compagnie, à son service depuis des années.
Il y aurait bien aussi Charles Péricourt, son oncle, le frère de Marcel, mais celui-ci a beau être député de la République depuis un bail, c'est le vilain petit canard de la famille. Il a toujours vécu aux crochets de son aîné qui a fait sa carrière et c'est un panier percé, toujours en demande d'argent pour permettre à son épouse et à ses jumelles de conserver un train de vie très confortable...
La pauvre Madeleine, si l'on peut parler ainsi, n'est pas préparée à cette situation et elle est bien naïve. La fortune des Péricourt attire les convoitises, l'argent, mais aussi le statut social, et l'on sent bien que l'héritière n'est pas à la hauteur... Sans compter son inquiétude légitime pour son fils, bien mal en point...
"Quand le lion est mort, les chacals se disputent l'empire", faisait dire Michel Audiard à l'un des personnages des "Tontons flingueurs", et c'est exactement ce qui va se passer. Alors que le monde entre dans une nouvelle phase de turbulences, entre la crise de 1929 et la montée des idéologies fascistes et nazies, Madeleine va devoir devenir lionne, si elle ne veut pas tout perdre au profit des chacals...
Si les références littéraires d' "Au revoir là-haut" étaient diverses et rendaient hommage aux écrivains qui avaient connu les tranchées et raconté cette terrifiante expérience, pour "Couleurs de l'incendie", Pierre Lemaître n'en revendique qu'un seule : Alexandre Dumas. Et il est effectivement difficile de ne pas penser au "Comte de Monte-Cristo" en lisant le roman et en découvrant le parcours de Madeleine.
Il faut donc une chute, et plus elle sera dure, mieux c'est, et une vengeance machiavélique dans laquelle l'héroïne, ingénue et malléable au début, se montre inflexible et impitoyable envers ses ennemis. Un plan qui doit s'organiser dans le contexte particulier de ce cycle historique, donc dans le cadre de l'histoire de la famille Péricourt et dans cette période du tournant des années 1920 et 1930.
Et puis, parce que "Au revoir là-haut" était une histoire d'arnaques, eh bien, on remet ça. Il y a sans doute moins d'originalité dans les méthodes des personnages pour dépouiller leur prochain que dans le premier volet de la série, mais cela reste un roman qui se lit avec beaucoup de plaisir et de fluidité, où l'on attend de voir quelle sera la réponse de la bergère aux bergers.
Moins original, parce qu'il y avait dans "Au revoir là-haut" le magnifique personnage d'Edouard, qui dynamitait tout par la folie de son désespoir. Et qui jouait avec ces masques qu'il fabriquait pour cacher son visage démoli. Dans "Couleurs de l'incendie", les masques sont toujours là, même s'il faut prendre ce terme au sens figuré.
Entre l'être et le paraître, entre les apparences et les intentions, le décalage est très net. Le lecteur le comprend rapidement, avant de prendre conscience de l'ampleur du problème. D'une certaine manière, Madeleine est la seule à ne pas jouer ce double jeu. Du moins, au début de l'histoire : elle est réellement abattue (et on la comprend) et n'a pas du tout été préparée à prendre la direction de l'entreprise portant son nom.
Mais, quand elle va déchoir, et plus que brutalement, elle va changer. Et à son tour, elle va apprendre à tromper les autres, à cacher ses émotions, à jouer avec des masques. Elle va se défaire de sa pureté, de sa posture de grande bourgeoise, de son éducation et accepter de jouer avec les règles du jeu qui lui ont tout coûté. A malins, maligne et demie...
On retrouve donc, dans "Couleurs de l'incendie", un point de départ commun à "Au revoir là-haut" : la perte de l'innocence. Comme son frère avant elle, Madeleine a été élevée dans un cocon, déconnectée du monde tel qu'il va, assurée d'un avenir sans nuage. Oh, bien sûr, son mariage avec Aulnay-Pradelle l'a déjà fait chuter de quelques étages pour l'installer sur un nuage moins élevé.
Mais, dans l'ensemble, jusqu'à la mort de son père, la vie de Madeleine est sans problème. Elle est ultra-protégée, sous l'aile d'un père respecté, et sans doute plus craint encore. A sa mort, elle est comme un oisillon jeté du nid, à la merci des prédateurs de tout poil. Et comme elle est dans un milieu où le nombre d'ambitieux est inversement proportionnel à celui des scrupules...
Puisqu'on évoque ce contexte particulier, il y a des choses à dire. D'abord, sur le plan historique. Lorsque le roman s'ouvre, en 1927, on se dit que l'échéance de 1929 (privilège du lecteur qui connaît l'avenir, au contraire des personnages) va jouer un rôle clé dans l'histoire. C'est vrai, mais pas comme on pourrait l'imaginer, Pierre Lemaître sait nous prendre à contre-pied...
Pourtant, et même sans ces péripéties et ces drames, l'avenir de la Banque Péricourt aurait été délicat : on est au début d'un changement d'ère, et celle qui s'ouvre ne laisse plus de place aux établissements familiaux. Après 1929, les grands groupes concentrant ressources et pouvoirs vont définitivement s'imposer et se partager le marché.
La seconde partie de "Couleurs de l'incendie" se déroule à partir de 1933. Cette fois, c'est la politique qui domine, avec la montée du fascisme italien et l'avènement de Hitler en Allemagne. La situation dans laquelle évolue les personnages se tend, des enjeux nouveaux apparaissent, des priorités nouvelles, aussi, et l'on retrouve tout cela dans le roman.
Alors, si le nouveau roman de Pierre Lemaître se revendique ouvertement de Dumas, on peut aussi y voir une dimension très balzacienne, dans l'évolution de cette famille, de son entreprise et des vautours qui cherchent chacun à en retirer quelque chose. Un aspect renforcé par la présence autour de Madeleine d'un véritable Rastignac.
Je n'évoque pas trop les personnages du roman, car ce sont les actes de ceux que j'ai évoqués jusque-là qui priment. Pour André Delcourt, c'est un peu différent, car on suit, en parallèle de la chute de Madeleine, son ascension sociale. Se rêvant journaliste, il est prêt à tout pour réussir, se faire une place, y compris à travailler pour rien, dans un premier temps, du moins.
Dans ce roman qui fourmille d'ambitieux, André se démarque, car ce qu'il recherche, c'est la célébrité. Et pour cela, tout les coups sont permis. La référence à Rastignac me semble juste : il part de rien, ou presque, se lance grâce à son talent, mais son idéal est encore au-dessus, en jouant sur l'air du temps, plus encore que sur ses convictions propres.
Tous les choix qu'il fait lorsqu'il doit voler de ses propres ailes sont marqués par cette idée force. Ce n'est d'ailleurs sans doute pas pour rien que, lorsqu'il signe ses éditoriaux, c'est sous le pseudonyme de Kairos, dieu de l'opportunité... Ou des opportunistes ? Lui aussi est un personnage qui porte un masque, et ce que l'on va découvrir derrière le sien est particulièrement monstrueux...
Pierre Lemaître profite du parcours de ce personnage pour s'attaquer au monde de la presse, dans une satire très violente : des journalistes près à tout pour permettre à leurs journaux de vivre et de prospérer, sans se soucier de vérité ou d'information. Guilloteaux, le patron sans scrupule d'André, est un personnage formidable, veule et soumis, bien loin d'incarner le contre-pouvoir médiatique...
Plus j'avançais dans la lecture de "Couleurs de l'incendie", et plus une idée s'est imposée : ce roman, c'est une critique féroce de la France d'aujourd'hui, la France du président Macron. Derrière chaque personnage, chaque situation, on peut voir transparaître des équivalents dans notre actualité du moment. C'est fait avec malice et humour, souvent, mais aussi avec virulence.
J'ai évoqué, même brièvement, la plupart des personnages les plus importants, mais je ne peux pas ne pas parler de deux personnages secondaires absolument formidables, Vladi et Solange. La première, jeune femme arrivée de Pologne et embauchée pour être la nurse de Paul Péricourt, est d'un naturel désarmant, d'une prolixité intarissable que complique le fait qu'elle ne s'exprime que dans sa langue maternelle.
D'elle, on sait bien peu de choses, mais ce qu'on en découvre, petit à petit, ne la rend que plus sympathique. Sa relation avec Paul, en particulier, mais aussi avec Madeleine, qui lui fait toute confiance, va en embellissant au fil du temps et la complicité de l'enfant avec cette femme, va durer lorsque le paralytique va devenir adolescent. Jusque dans une certaine ambiguïté sexuelle.
Solange est cantatrice. C'est l'idole de Paul, une star du monde lyrique qui a connu la gloire et une longue éclipse avant de revenir dans la lumière. Difficile de se détacher, quand on pense à elle, de l'image ancrée dans notre culture collective de Bianca Castafiore. Pierre Lemaître joue avec cette référence, s'en sert, puis la détourne, jusqu'à un final formidable où la diva assoit pour l'éternité sa réputation de provocatrice...
Ces deux femmes font partie des ressorts comiques ou plus légers, dirons-nous, de "Couleurs de l'incendie", car, malgré les drames, malgré les complots, malgré la déchéance et le malheur qui frappent Madeleine, malgré un contexte historique bien sombre, on s'amuse beaucoup à cette lecture. Sans doute plus que dans "Au revoir là-haut".
On en revient aux masques, ceux qui représentent la tragédie et la comédie. Je me souviens les avoir déjà cités dans le billet sur "Au revoir là-haut", on les retrouve dans ce deuxième volet, avec la comédie qui prend un peu le dessus sur la tragédie. Il y a d'ailleurs, dans la première partie du roman, un esprit qui rappelle les pièces de Courteline, par exemple.
Sans être forcément plus léger dans le fond, "Couleurs de l'incendie" laisse tout de même plus de place à l'humour et au sourire. On est dans une farce et certains, je pense à Charles et à sa famille, vont en prendre pour leur grade... Cela crée un équilibre avec la vengeance ourdie par Madeleine (avec l'aide de Dupré, déjà croisé dans "Au revoir là-haut"), qui sera particulièrement sombre.
En tout cas, débarrassée de toute inhibition morale intempestive. Et c'est ce qui rend ce roman jubilatoire : il est délicieusement amoral, y compris du côté des personnages qui, d'emblée, pourraient paraître incarner pureté, candeur et honnêteté. Je pense à Madeleine, bien sûr, mais aussi, et c'est plus étonnant, à Paul, qui va se révéler être un petit malin. A croire qu'il a aussi hérité de certains traits paternels...
Je regarde ce billet, déjà long, j'ai l'impression d'avoir tout survolé ou presque et d'avoir certainement oublié plein de choses... Encore une fois, si j'ai pu trouver "Couleurs de l'incendie" un peu moins original que "Au revoir là-haut", cela reste un excellent moment de lecture, plein de pistes de réflexions, un divertissement, mais pas seulement, car elle dénonce bien des travers de notre société.
Le cycle de Pierre Lemaître ne va pas s'arrêter là, je suis curieux de voir ce qu'il nous concocte pour la suite, à quelle époque, avec quels personnages principaux et dans quel contexte. La saga Péricourt ne fait que commencer et elle va continuer à jouer son rôle de révélateur de nos petits arrangements avec la morale, hier comme aujourd'hui.
Ce second volet est un hommage à toute la littérature du XIXe, celle qui a fondé la littérature populaire. Le lecteur, lui, s'amuse des frasques, s'attriste des drames ou se révolte des injustices dans lesquels sont impliqués les différents personnages, comme s'il assistait à une pièce de théâtre dont la scène serait le monde...
dimanche 28 janvier 2018
"Je suis Narcisse Pelletier, matelot de la goélette Saint-Paul".
Après avoir lu "Massacre des Innocents", de Marc Biancarelli, je me suis dit que je repartirais volontiers pour une histoire de fortune de mer. Suis-je un lecteur charitable, moi qui prends tant plaisir au malheur des autres ! Je me suis alors souvenu que dormais dans ma liseuse depuis un bon moment un roman qui pourrait faire l'affaire. Là encore, à l'origine, une histoire vraie, qu'un romancier a choisi de raconter à sa façon, en ne proposant pas une simple relation de cette histoire extraordinaire, mais en en faisant une vraie trame romanesque. "Ce qu'il advint du sauvage blanc" (disponible en poche chez Folio), est le premier roman de François Garde, énarque et haut fonctionnaire, s'il vous plaît, et c'est une réflexion sur la rencontre inattendue de deux modes de vie extrêmement différents et comment on s'y adapte, comment on s'y fond, ou pas. Mais c'est aussi un questionnement sur le racisme des sociétés européennes, leur certitude d'être la civilisation supérieure et comment démonter cela par l'observation scientifique...
Octave de Vallombrun, jeune et ambitieux géographe, aspire à entrer à la Société de Géographie, la plus ancienne au monde et dont le prestige dépasse les frontières hexagonales. Après une première expérience insatisfaisante en Islande, il a choisi un nouveau cap et a décidé de se rendre dans une région du monde encore très mal connue : l'Océanie.
Il a donc quitté Paris via Bordeaux pour se rendre à Sydney, où il découvre qu'il s'est trompé et qu'il n'existe plus vraiment de territoire encore à découvrir. Pourtant, il persévère et, depuis la ville australienne, il se rend dans de nombreuses îles du Pacifique pour y mener des observations anthropologiques (terme que l'on commence tout juste à employer à cette époque).
Mais, le destin du jeune homme va basculer au début de l'année 1861. Alors qu'il sombre peu à peu dans le doute et songe sérieusement à renoncer à sa vocation, qui ne l'épanouit pas, il entend par hasard parler du "sauvage blanc". Ce n'est pas le cas, mais l'expression aiguise la curiosité du jeune scientifique qui cherche à en savoir plus.
Il apprend alors que, peu de temps auparavant, un bateau faisant escale sur la côte nord de l'Australie, a découvert avec une grande surprise un homme blanc au milieu de la population aborigène. Il ne s'agit pas d'un cas d'albinisme, non, par sa taille, sa chevelure autant que par sa couleur de peau, il se démarquait du reste de la population autochtone...
Pourtant, il semble parfaitement intégré à cette société, semble ne parler que la langue des aborigènes, porte des tatouages et des scarifications sur tout le corps et vit dans une parfaite nudité... L'équipage occidental est parvenu à l'embarquer et à le ramener jusqu'à Sydney où l'on cherche, en vain, à comprendre d'où il vient...
Incapable de communiquer avec cet homme dans sa langue, le gouverneur local l'a fait placer dans une prison et s'est mis en quête de citoyens d'autres origines afin de faire entendre d'autres langues que l'anglais à cet homme, dont la rumeur a déjà fait une légende qui court de port en port, transmise par les marins les uns aux autres.
Pour Octave, tout cela semble absurde, jusqu'à ce que le gouverneur l'invite à son tour à venir parler français à l'inconnu, pour voir si cela le fera réagir. Octave accepte et se retrouve face à cet énigmatique et impressionnant personnage. Aucun des autres invités n'a obtenu de réaction, mais, lorsque Octave s'adresse à lui, l'inconnu s'exprime enfin.
Ainsi, il serait Français... Octave va donc se voir confier la charge de ce "sauvage blanc" et se passionner pour son cas. Il possède là un formidable cas qu'il va pouvoir observer de près et à sa guise et, tout en reconstituant son histoire, en tirer des conclusions qui lui assureront une place, et pas la dernière, au sein de la Société de Géographie...
Mon résumé est imparfait, j'ai volontairement choisi un angle qui n'est pas tout à fait celui de François Garde, mais, au fil de ce billet, nous allons revenir sur l'histoire elle-même, sur ce fameux "sauvage blanc", mais aussi sur la construction narrative très importante de ce roman et sur le travail de l'auteur.
Lorsqu'on entame la lecture de "Ce qu'il advint du sauvage blanc", on découvre deux fils narratifs proposés en parallèle. Le premier, celui par lequel commence le livre, met en scène Narcisse Pelletier, jeune matelot originaire de Saint-Gilles-sur-Vie, en Vendée, engagé sur une goélette du nom de Saint-Paul, mais ça, on l'a déjà dit dans notre titre.
Ce cadre-là, on ne le possède pas immédiatement, car l'histoire commence sur une plage australienne, lorsque Narcisse découvre que son bateau... a disparu... Le voyage depuis l'Europe s'était bien passé et pourtant, faute d'avoir suivi le cap exact, l'eau est venue à manquer. Le capitaine de la goélette a donc choisi de faire une brève escale sur une plage, en espérant trouver de quoi ravitailler.
L'équipage a donc mis pied à terre, sans grand succès. Narcisse, lui, a eu l'intuition qu'il fallait peut-être s'éloigner du rivage pour trouver une source. Il a donc entrepris une exploration plus approfondie et il laisse derrière lui ses camarades. Erreur funeste, puisque, en son absence, tout le monde à embarqué à nouveau et, considérant qu'il était perdu, sans trop s'embêter à savoir comment, la goélette a repris la mer...
Voilà comment Narcisse s'est retrouvé sur cette plage, sans aucune ressource, Robinson malgré lui. Il va devoir apprendre à survivre dans des conditions extrêmes, dans ce pays dont il ne sait rien, sous un soleil de plomb et dans une nature qu'il considère comme hostile. Comprenant que la goélette ne reviendrait pas, il reprend donc son exploration et va rencontrer une tribu aborigène.
Ce premier fil, c'est le récit, à la troisième personne, de cette incroyable aventure humaine. Pardon, je ne veux pas trop en dire, mais il ignore encore qu'il va rester là... 17 ans ! Jusqu'à ce que le hasard joue, cette fois, dans l'autre sens, et que Narcisse retrouve la civilisation européenne à laquelle il est devenu complètement étranger.
Le second fil narratif est donc celui qui met en scène Octave de Vallombrun, à travers sa correspondance avec le président de la Société de Géographie qu'il tient au courant de ses découvertes, de ses observations et de l'évolution de l'homme qu'il a en face de lui et dont il ignore encore tout lorsqu'on fait sa connaissance.
Les chapitres alternent, le récit de l'aventure (quel autre mot employer) de Narcisse et les lettres d'Octave) et permettent ainsi de reconstituer la vie de Narcisse Pelletier, avec comme point de rencontre le jour de sa "découverte" et de sa "capture". Deux points de vue complémentaires et finalement parallèles, car Narcisse ne répondra jamais directement aux questions d'Octave.
Précision : si Narcisse Pelletier a réellement existé et a vécu cette incroyable histoire, François Garde n'a pas décidé d'écrire une biographie. Son objectif est ailleurs et le romancier s'affranchit des dates et de certains faits pour façonner son propre personnage. Cela donne, par exemple, un roman ancré sous le Second Empire, et non sous la IIIe République naissante...
Je vous engage d'ailleurs, en parallèle au roman, à lire la véritable histoire de Narcisse Pelletier, non pas pour la mettre en parallèle avec ce qu'écrit François Garde, mais parce que cela reste une histoire hors du commun, fascinante et troublante qui, paradoxalement, est paraît-il bien plus connue en Australie qu'en France...
Alors, qu'a voulu faire François Garde ? Eh bien, il pose une question très troublante sur la manière dont Narcisse est... devenu un aborigène, je crois qu'on peut dire les choses ainsi. Comment il s'est fondu dans cette civilisation, cette culture qui lui était totalement étrangère, jusqu'à en oublier complètement sa culture natale, son éducation, sa langue maternelle, etc.
On connaît le thème de l'enfant sauvage, largement développé en littérature, de Mowgli à Tarzan (ou encore récemment sur ce blog, avec le dernier roman de Xavier-Marie Bonnot). Mais, l'histoire de Narcisse Pelletier est bien différente, puisqu'il est adulte lorsqu'il rencontre cette nouvelle civilisation et pourtant, à ce contact, il va devenir... un autre.
En lisant le roman de François Garde, je songeais à une autre lecture de ces derniers mois : "Mercy Mary Patty", de Lola Lafon, dans lequel la romancière évoque, outre l'histoire de Patty Hearst, celles de Mercy Short et Mary Jamison, ravies par des tribus indiennes et qui, par la suite, refuseront de revenir au sein de leur famille.
Entre les deux romans, entre les visions des deux auteurs, peu de choses en commun, si ce n'est qu'on retrouve le même phénomène impliquant non pas des enfants en très bas âge, mais des adolescents ou de jeunes adultes, qui se dépouillent littéralement de tout ce qui constituait leur identité pour intégrer pleinement un tout autre univers.
Comme Patty Hearst, Narcisse Pelletier va d'ailleurs rejoindre sa civilisation d'origine et redevenir ce qu'il était avant, un peu malgré lui, et sans jamais retrouver totalement cette personne qu'il fut, on y reviendra. Mais, l'un des moments forts du livre, c'est quand il explique que, pour lui, tout cela revient à être mort deux fois...
Le côté passionnant du double récit, l'un direct, même si la narration est neutre, et l'autre à travers les yeux d'un tiers, c'est la description du processus qui va mener le jeune matelot à devenir un aborigène puis à redevenir un citoyen français. C'est aussi un aspect troublant et bouleversant, car, par deux fois, on va arracher cet homme à ses racines, sans qu'il puisse avoir son mot à dire...
Cette histoire aurait parfaitement pu être racontée de manière linéaire, à la première personne du singulier, à la manière d'un Robinson Crusoë, mais l'optique de François Garde, encore une fois, est ailleurs. En introduisant auprès de Narcisse le personnage d'Octave, il offre un regard différent sur Narcisse et sur ce qu'il est devenu.
Ignorant tout du passé de Narcisse, Octave le regarde sans être influencé. Et ses observations font apparaître des choses fascinantes : l'absence totale d'inhibition et de tabous, ce qui est au coeur d'un certain nombres de situations particulières, une fois Narcisse de retour en Europe (et même, dès le voyage du retour) ; l'ignorance de ce qu'est la valeur de l'argent ou, plus anecdotiquement, l'alcool, son goût et ses effets...
Oui, ce que voit Octave, ce sont les acquis de Narcisse, ce qui ne peut avoir été appris qu'au cours de ces presque deux décennies au sein de la tribu aborigène. Ce sont ces comportement nouveaux chez le matelot vendéen qui montrent au scientifique les différences fondamentales qui existent entre les deux civilisations, qui n'en apparaissent que plus inconciliables.
Cela nous amène à un aspect que l'on voit (à juste titre) apparaître un peu partout lorsqu'on regarde ce qui se dit sur ce roman : la vision que donne François Garde de la civilisation aborigène. Là encore, comme pour les faits concernant Narcisse lui-même, le romancier explique qu'il n'a pas chercher à décrire l'exacte civilisation, mais une civilisation qui soit aux antipodes, c'est le cas de le dire, de la nôtre.
Cette vision lui a valu énormément de critiques, en particulier celle de faire renaître le mythe du bon sauvage. Et, soyons franc, c'est un peu vrai, même si je crois qu'il est important de donner aussi quelques nuances. Attention, on entre dans des territoires extrêmement sensibles, et il ne s'agit pas ici de convaincre, de fâcher, d'ouvrir des polémiques, juste de parler de cette lecture.
Le premier élément, c'est qu'on est dans un roman se déroulant au XIXe siècle. C'est donc à travers les yeux de personnages de cette époque que l'on regarde les faits. Or, la France du Second Empire est une nation qui revendique sa volonté colonisatrice et prône une supériorité de la race blanche, pour dire les choses très clairement.
Cela nous choque, nous qui vivons au XXIe siècle, c'est une évidence. Que ce soit Narcisse dans la période qui suit sa rencontre avec cette tribu ou Octave, que ce soit les personnages secondaires qu'ils sont amenés à croiser, tous ont effectivement ce regard raciste envers la civilisation auprès de laquelle le marin a vécu.
L'expression "Sauvage blanc" n'est pas une invention de François Garde, c'est bien ainsi qu'on a surnommé Narcisse, en particulier dans la presse. On raconte qu'il a reçu des propositions pour devenir un phénomène de foire, un freak, qu'on aurait payé pour venir le voir dans un sordide décor de pacotille, comme cela arrivera bien après sa mort avec d'autres civilisations au cours de l'exposition coloniale de 1931...
Ensuite, c'est un point de vue personnel, mais je trouve que les observations d'Octave le font changer, lentement, mais sûrement. Au contact de Narcisse, de ce drôle de bonhomme devenu totalement imprévisible, le scientifique évolue et sent un respect croissant pour cette civilisation, certes très différentes, mais peut-être meilleure que la nôtre par certains points.
Ainsi, l'absence d'argent dans cette société est quelque chose qui intrigue Octave (ce point aurait d'ailleurs pu être plus développé). La cupidité, l'avidité sont inconnues de ces populations, tout comme l'ambition, en tout cas telle que nous envisageons ces questions et avec tout ce que cela peut entraîner.
Vraiment, si je comprends les critiques faites au livre, si je les partage en grande partie, je trouve tout de même que ces échanges amènent Octave à devenir plus ouvert, plus tolérant. A envisager les populations aborigènes comme une civilisation, avec le sens qu'on lui donne, justement par opposition aux sauvages.
On le voit bien lors de la présentation de son travail devant la Société de Géographie, avec un débat houleux où les préjugés sont bien ancrés, y compris chez les personnalités les plus en vue et les plus respectées (ce que n'est pas Octave). Ce qu'avance Vallombrun est battu en brèche, moqué, dénoncé, et sa réputation irrémédiablement ternie.
Mais, lui a fait ce que ses détracteurs ne se donneront jamais la peine de faire, enfoncés dans leurs certitudes et leur sentiment de supériorité : observer ces civilisations, chercher à les comprendre, sans a priori... Ce qui ne l'empêche pas d'agir ou d'envisager des actions tout à fait révoltantes (y compris sous couvert d'observation scientifique), montrant qu'il y a encore un long chemin à parcourir...
J'en reste là, chaque lecteur se fera son opinion sur ces questions et je comprendrai qu'on puisse ne pas partager mon point de vue. Je vais terminer en évoquant Narcisse, personnage bringuebalé par un destin compliqué, et qui se retrouve écartelé entre ces deux mondes, ces deux vies tellement différentes. Repères brouillés, identité rendue floue, sentiment d'être étranger partout...
Narcisse n'est pas un homme heureux, je ne le pense pas. C'est aussi un des aspects forts de ce roman : comment s'épanouir dans de telles conditions ? De son récit (qui ne couvre pas les 17 années passées en Australie), on retient cette lutte farouche pour rester lui-même, qui débouche sur son incapacité à comprendre la nouvelle société dans laquelle il se retrouve.
"Ce qu'il advint du sauvage blanc", et c'est assez douloureux, c'est un livre sur le renoncement, sur la résignation d'un homme qui comprend qu'il ne retrouvera plus son monde originel et qui lâche prise. Et, en lâchant prise, alors, il peut se fondre dans cette nouvelle existence, l'accepter au point d'effacer tout le reste...
Un processus qui va se reproduire dans l'autre sens, lorsqu'on va le "rapatrier". Il n'y a pas de réjouissance chez Narcisse à retrouver ce monde qu'il avait laissé derrière lui. Il y a une vraie souffrance parallèle, j'évoquais cette idée de "mort deux fois", chez cet homme qui ne sait plus qui il est véritablement.
Un être double, par la force des choses, qui se retrouve avec deux personnalités qu'on ne place pas au même niveau pour des raisons qui lui sont étrangères. Avec deux univers qui se télescopent sans se mélanger. Avec un déracinement permanent et une nostalgie qui peut vite devenir de la mélancolie... Narcisse est un personnage bouleversant, si riche de ce métissage, mais en décalage d'un monde où cette question ne se pose même pas...
Narcisse Pelletier, un Robinson ? Et si le "sauvage blanc" était plutôt un Vendredi ?
Octave de Vallombrun, jeune et ambitieux géographe, aspire à entrer à la Société de Géographie, la plus ancienne au monde et dont le prestige dépasse les frontières hexagonales. Après une première expérience insatisfaisante en Islande, il a choisi un nouveau cap et a décidé de se rendre dans une région du monde encore très mal connue : l'Océanie.
Il a donc quitté Paris via Bordeaux pour se rendre à Sydney, où il découvre qu'il s'est trompé et qu'il n'existe plus vraiment de territoire encore à découvrir. Pourtant, il persévère et, depuis la ville australienne, il se rend dans de nombreuses îles du Pacifique pour y mener des observations anthropologiques (terme que l'on commence tout juste à employer à cette époque).
Mais, le destin du jeune homme va basculer au début de l'année 1861. Alors qu'il sombre peu à peu dans le doute et songe sérieusement à renoncer à sa vocation, qui ne l'épanouit pas, il entend par hasard parler du "sauvage blanc". Ce n'est pas le cas, mais l'expression aiguise la curiosité du jeune scientifique qui cherche à en savoir plus.
Il apprend alors que, peu de temps auparavant, un bateau faisant escale sur la côte nord de l'Australie, a découvert avec une grande surprise un homme blanc au milieu de la population aborigène. Il ne s'agit pas d'un cas d'albinisme, non, par sa taille, sa chevelure autant que par sa couleur de peau, il se démarquait du reste de la population autochtone...
Pourtant, il semble parfaitement intégré à cette société, semble ne parler que la langue des aborigènes, porte des tatouages et des scarifications sur tout le corps et vit dans une parfaite nudité... L'équipage occidental est parvenu à l'embarquer et à le ramener jusqu'à Sydney où l'on cherche, en vain, à comprendre d'où il vient...
Incapable de communiquer avec cet homme dans sa langue, le gouverneur local l'a fait placer dans une prison et s'est mis en quête de citoyens d'autres origines afin de faire entendre d'autres langues que l'anglais à cet homme, dont la rumeur a déjà fait une légende qui court de port en port, transmise par les marins les uns aux autres.
Pour Octave, tout cela semble absurde, jusqu'à ce que le gouverneur l'invite à son tour à venir parler français à l'inconnu, pour voir si cela le fera réagir. Octave accepte et se retrouve face à cet énigmatique et impressionnant personnage. Aucun des autres invités n'a obtenu de réaction, mais, lorsque Octave s'adresse à lui, l'inconnu s'exprime enfin.
Ainsi, il serait Français... Octave va donc se voir confier la charge de ce "sauvage blanc" et se passionner pour son cas. Il possède là un formidable cas qu'il va pouvoir observer de près et à sa guise et, tout en reconstituant son histoire, en tirer des conclusions qui lui assureront une place, et pas la dernière, au sein de la Société de Géographie...
Mon résumé est imparfait, j'ai volontairement choisi un angle qui n'est pas tout à fait celui de François Garde, mais, au fil de ce billet, nous allons revenir sur l'histoire elle-même, sur ce fameux "sauvage blanc", mais aussi sur la construction narrative très importante de ce roman et sur le travail de l'auteur.
Lorsqu'on entame la lecture de "Ce qu'il advint du sauvage blanc", on découvre deux fils narratifs proposés en parallèle. Le premier, celui par lequel commence le livre, met en scène Narcisse Pelletier, jeune matelot originaire de Saint-Gilles-sur-Vie, en Vendée, engagé sur une goélette du nom de Saint-Paul, mais ça, on l'a déjà dit dans notre titre.
Ce cadre-là, on ne le possède pas immédiatement, car l'histoire commence sur une plage australienne, lorsque Narcisse découvre que son bateau... a disparu... Le voyage depuis l'Europe s'était bien passé et pourtant, faute d'avoir suivi le cap exact, l'eau est venue à manquer. Le capitaine de la goélette a donc choisi de faire une brève escale sur une plage, en espérant trouver de quoi ravitailler.
L'équipage a donc mis pied à terre, sans grand succès. Narcisse, lui, a eu l'intuition qu'il fallait peut-être s'éloigner du rivage pour trouver une source. Il a donc entrepris une exploration plus approfondie et il laisse derrière lui ses camarades. Erreur funeste, puisque, en son absence, tout le monde à embarqué à nouveau et, considérant qu'il était perdu, sans trop s'embêter à savoir comment, la goélette a repris la mer...
Voilà comment Narcisse s'est retrouvé sur cette plage, sans aucune ressource, Robinson malgré lui. Il va devoir apprendre à survivre dans des conditions extrêmes, dans ce pays dont il ne sait rien, sous un soleil de plomb et dans une nature qu'il considère comme hostile. Comprenant que la goélette ne reviendrait pas, il reprend donc son exploration et va rencontrer une tribu aborigène.
Ce premier fil, c'est le récit, à la troisième personne, de cette incroyable aventure humaine. Pardon, je ne veux pas trop en dire, mais il ignore encore qu'il va rester là... 17 ans ! Jusqu'à ce que le hasard joue, cette fois, dans l'autre sens, et que Narcisse retrouve la civilisation européenne à laquelle il est devenu complètement étranger.
Le second fil narratif est donc celui qui met en scène Octave de Vallombrun, à travers sa correspondance avec le président de la Société de Géographie qu'il tient au courant de ses découvertes, de ses observations et de l'évolution de l'homme qu'il a en face de lui et dont il ignore encore tout lorsqu'on fait sa connaissance.
Les chapitres alternent, le récit de l'aventure (quel autre mot employer) de Narcisse et les lettres d'Octave) et permettent ainsi de reconstituer la vie de Narcisse Pelletier, avec comme point de rencontre le jour de sa "découverte" et de sa "capture". Deux points de vue complémentaires et finalement parallèles, car Narcisse ne répondra jamais directement aux questions d'Octave.
Précision : si Narcisse Pelletier a réellement existé et a vécu cette incroyable histoire, François Garde n'a pas décidé d'écrire une biographie. Son objectif est ailleurs et le romancier s'affranchit des dates et de certains faits pour façonner son propre personnage. Cela donne, par exemple, un roman ancré sous le Second Empire, et non sous la IIIe République naissante...
Je vous engage d'ailleurs, en parallèle au roman, à lire la véritable histoire de Narcisse Pelletier, non pas pour la mettre en parallèle avec ce qu'écrit François Garde, mais parce que cela reste une histoire hors du commun, fascinante et troublante qui, paradoxalement, est paraît-il bien plus connue en Australie qu'en France...
Alors, qu'a voulu faire François Garde ? Eh bien, il pose une question très troublante sur la manière dont Narcisse est... devenu un aborigène, je crois qu'on peut dire les choses ainsi. Comment il s'est fondu dans cette civilisation, cette culture qui lui était totalement étrangère, jusqu'à en oublier complètement sa culture natale, son éducation, sa langue maternelle, etc.
On connaît le thème de l'enfant sauvage, largement développé en littérature, de Mowgli à Tarzan (ou encore récemment sur ce blog, avec le dernier roman de Xavier-Marie Bonnot). Mais, l'histoire de Narcisse Pelletier est bien différente, puisqu'il est adulte lorsqu'il rencontre cette nouvelle civilisation et pourtant, à ce contact, il va devenir... un autre.
En lisant le roman de François Garde, je songeais à une autre lecture de ces derniers mois : "Mercy Mary Patty", de Lola Lafon, dans lequel la romancière évoque, outre l'histoire de Patty Hearst, celles de Mercy Short et Mary Jamison, ravies par des tribus indiennes et qui, par la suite, refuseront de revenir au sein de leur famille.
Entre les deux romans, entre les visions des deux auteurs, peu de choses en commun, si ce n'est qu'on retrouve le même phénomène impliquant non pas des enfants en très bas âge, mais des adolescents ou de jeunes adultes, qui se dépouillent littéralement de tout ce qui constituait leur identité pour intégrer pleinement un tout autre univers.
Comme Patty Hearst, Narcisse Pelletier va d'ailleurs rejoindre sa civilisation d'origine et redevenir ce qu'il était avant, un peu malgré lui, et sans jamais retrouver totalement cette personne qu'il fut, on y reviendra. Mais, l'un des moments forts du livre, c'est quand il explique que, pour lui, tout cela revient à être mort deux fois...
Le côté passionnant du double récit, l'un direct, même si la narration est neutre, et l'autre à travers les yeux d'un tiers, c'est la description du processus qui va mener le jeune matelot à devenir un aborigène puis à redevenir un citoyen français. C'est aussi un aspect troublant et bouleversant, car, par deux fois, on va arracher cet homme à ses racines, sans qu'il puisse avoir son mot à dire...
Cette histoire aurait parfaitement pu être racontée de manière linéaire, à la première personne du singulier, à la manière d'un Robinson Crusoë, mais l'optique de François Garde, encore une fois, est ailleurs. En introduisant auprès de Narcisse le personnage d'Octave, il offre un regard différent sur Narcisse et sur ce qu'il est devenu.
Ignorant tout du passé de Narcisse, Octave le regarde sans être influencé. Et ses observations font apparaître des choses fascinantes : l'absence totale d'inhibition et de tabous, ce qui est au coeur d'un certain nombres de situations particulières, une fois Narcisse de retour en Europe (et même, dès le voyage du retour) ; l'ignorance de ce qu'est la valeur de l'argent ou, plus anecdotiquement, l'alcool, son goût et ses effets...
Oui, ce que voit Octave, ce sont les acquis de Narcisse, ce qui ne peut avoir été appris qu'au cours de ces presque deux décennies au sein de la tribu aborigène. Ce sont ces comportement nouveaux chez le matelot vendéen qui montrent au scientifique les différences fondamentales qui existent entre les deux civilisations, qui n'en apparaissent que plus inconciliables.
Cela nous amène à un aspect que l'on voit (à juste titre) apparaître un peu partout lorsqu'on regarde ce qui se dit sur ce roman : la vision que donne François Garde de la civilisation aborigène. Là encore, comme pour les faits concernant Narcisse lui-même, le romancier explique qu'il n'a pas chercher à décrire l'exacte civilisation, mais une civilisation qui soit aux antipodes, c'est le cas de le dire, de la nôtre.
Cette vision lui a valu énormément de critiques, en particulier celle de faire renaître le mythe du bon sauvage. Et, soyons franc, c'est un peu vrai, même si je crois qu'il est important de donner aussi quelques nuances. Attention, on entre dans des territoires extrêmement sensibles, et il ne s'agit pas ici de convaincre, de fâcher, d'ouvrir des polémiques, juste de parler de cette lecture.
Le premier élément, c'est qu'on est dans un roman se déroulant au XIXe siècle. C'est donc à travers les yeux de personnages de cette époque que l'on regarde les faits. Or, la France du Second Empire est une nation qui revendique sa volonté colonisatrice et prône une supériorité de la race blanche, pour dire les choses très clairement.
Cela nous choque, nous qui vivons au XXIe siècle, c'est une évidence. Que ce soit Narcisse dans la période qui suit sa rencontre avec cette tribu ou Octave, que ce soit les personnages secondaires qu'ils sont amenés à croiser, tous ont effectivement ce regard raciste envers la civilisation auprès de laquelle le marin a vécu.
L'expression "Sauvage blanc" n'est pas une invention de François Garde, c'est bien ainsi qu'on a surnommé Narcisse, en particulier dans la presse. On raconte qu'il a reçu des propositions pour devenir un phénomène de foire, un freak, qu'on aurait payé pour venir le voir dans un sordide décor de pacotille, comme cela arrivera bien après sa mort avec d'autres civilisations au cours de l'exposition coloniale de 1931...
Ensuite, c'est un point de vue personnel, mais je trouve que les observations d'Octave le font changer, lentement, mais sûrement. Au contact de Narcisse, de ce drôle de bonhomme devenu totalement imprévisible, le scientifique évolue et sent un respect croissant pour cette civilisation, certes très différentes, mais peut-être meilleure que la nôtre par certains points.
Ainsi, l'absence d'argent dans cette société est quelque chose qui intrigue Octave (ce point aurait d'ailleurs pu être plus développé). La cupidité, l'avidité sont inconnues de ces populations, tout comme l'ambition, en tout cas telle que nous envisageons ces questions et avec tout ce que cela peut entraîner.
Vraiment, si je comprends les critiques faites au livre, si je les partage en grande partie, je trouve tout de même que ces échanges amènent Octave à devenir plus ouvert, plus tolérant. A envisager les populations aborigènes comme une civilisation, avec le sens qu'on lui donne, justement par opposition aux sauvages.
On le voit bien lors de la présentation de son travail devant la Société de Géographie, avec un débat houleux où les préjugés sont bien ancrés, y compris chez les personnalités les plus en vue et les plus respectées (ce que n'est pas Octave). Ce qu'avance Vallombrun est battu en brèche, moqué, dénoncé, et sa réputation irrémédiablement ternie.
Mais, lui a fait ce que ses détracteurs ne se donneront jamais la peine de faire, enfoncés dans leurs certitudes et leur sentiment de supériorité : observer ces civilisations, chercher à les comprendre, sans a priori... Ce qui ne l'empêche pas d'agir ou d'envisager des actions tout à fait révoltantes (y compris sous couvert d'observation scientifique), montrant qu'il y a encore un long chemin à parcourir...
J'en reste là, chaque lecteur se fera son opinion sur ces questions et je comprendrai qu'on puisse ne pas partager mon point de vue. Je vais terminer en évoquant Narcisse, personnage bringuebalé par un destin compliqué, et qui se retrouve écartelé entre ces deux mondes, ces deux vies tellement différentes. Repères brouillés, identité rendue floue, sentiment d'être étranger partout...
Narcisse n'est pas un homme heureux, je ne le pense pas. C'est aussi un des aspects forts de ce roman : comment s'épanouir dans de telles conditions ? De son récit (qui ne couvre pas les 17 années passées en Australie), on retient cette lutte farouche pour rester lui-même, qui débouche sur son incapacité à comprendre la nouvelle société dans laquelle il se retrouve.
"Ce qu'il advint du sauvage blanc", et c'est assez douloureux, c'est un livre sur le renoncement, sur la résignation d'un homme qui comprend qu'il ne retrouvera plus son monde originel et qui lâche prise. Et, en lâchant prise, alors, il peut se fondre dans cette nouvelle existence, l'accepter au point d'effacer tout le reste...
Un processus qui va se reproduire dans l'autre sens, lorsqu'on va le "rapatrier". Il n'y a pas de réjouissance chez Narcisse à retrouver ce monde qu'il avait laissé derrière lui. Il y a une vraie souffrance parallèle, j'évoquais cette idée de "mort deux fois", chez cet homme qui ne sait plus qui il est véritablement.
Un être double, par la force des choses, qui se retrouve avec deux personnalités qu'on ne place pas au même niveau pour des raisons qui lui sont étrangères. Avec deux univers qui se télescopent sans se mélanger. Avec un déracinement permanent et une nostalgie qui peut vite devenir de la mélancolie... Narcisse est un personnage bouleversant, si riche de ce métissage, mais en décalage d'un monde où cette question ne se pose même pas...
Narcisse Pelletier, un Robinson ? Et si le "sauvage blanc" était plutôt un Vendredi ?
lundi 22 janvier 2018
"Que de vilenie en ce monde. Que de lâcheté devant la mort. Et que de suffocante beauté dans l'accomplissement inéluctable du désastre".
Après nous avoir emmené en Corse pour un véritable western, avec "Orphelins de Dieu", Marc Biancarelli nous propose en ce début d'année un nouveau voyage. Mais, on délaisse les maquis de l'île de Beauté et même les rivages de la Méditerranée pour un périple bien plus lointain. Et bien plus périlleux, encore. Direction l'Australie, ou plutôt un archipel bien peu accueillant au large des côtes australiennes. S'inspirant d'une histoire vraie, Marc Biancarelli signe une fresque dure, violente et pourtant, d'une âpre beauté avec "Massacre des Innocents" (en grand format chez Actes Sud). Et le mot fresque est choisi à dessein, car la peinture, et particulièrement la peinture flamande tient une place importante dans ce roman d'aventures, aussi bien au sens propre, puisque le titre du livre lui-même renvoie à une fameuse toile, mais aussi parce que la construction du roman fait penser à une exposition... Le style riche, presque lyrique, de Marc Biancarelli est toujours présent, moins sec que dans son précédent livre, mais avec la même puissance évocatrice qui nous transporte sur l'archipel Abrolhos de Houtman (sortez vos atlas !) en plein XVIIe siècle...
Construit en 1628, le Batavia, un trois-mâts affrété par la puissante Compagnie néerlandaise des Indes orientales, a quitté l'Europe à la fin du mois d'octobre de cette année pour un voyage inaugural qui doit le mener dans les territoires d'Asie dirigés par les Néerlandais. Les principaux objectifs sont commerciaux, bien sûr, mais aussi un certain nombre de passagers devant s'installer dans ces colonies.
A la barre, le capitaine Jacobz. Mais, le véritable maître du navire après Dieu, c'est François Pelsaert. Il est le subrécargue du Batavia, c'est-à-dire le représentant de la VOC, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. A ses côtés, un intendant adjoint, Jeronymus Cornelisz, qui a récemment rejoint les rangs de la Compagnie.
Jusqu'au Cap, tout se passe bien, le Batavia fait partie d'une flotte de plusieurs navires commerciaux qui suivent cette route maritime de plus en plus fréquentée. Mais ensuite, une fois l'Afrique laissé derrière lui, les choses se gâtent. Au début du mois de juin 1629, le voyage va prendre une toute autre tournure...
Laissant les autres navires de la flotte qui prennent la direction de l'Inde, le Batavia prend une route plus au sud, habituelle pour un bateau se rendant à Java. Mais une erreur de navigation se produit et le nouveau fleuron de la VOC fait naufrage sur un récif de corail, situé au large de la côte ouest australienne, un endroit qu'on appelle Morning Reef, près de Beacon Island, une des îles des Abrolhos de Houtman.
Le choc est violent, le navire est irrémédiablement endommagé et on compte déjà un important nombre de victimes. Une partie de l'équipage et des passagers parvient à s'extraire de l'épave, mais se retrouve coincé sur ce récif bien inhospitalier, bientôt rebaptisé le cimetière, tandis que d'autres sont encore à l'intérieur, prisonniers d'un bâtiment à l'agonie.
Une grande partie des provisions est perdue, il n'y a pas d'eau et sans doute bien peu de nourriture sur ce récif. L'exploration des alentours montrent qu'il y a plus de végétations sur certaines îles voisines, mais sans doute pas de quoi permettre de faire vivre tous les survivants. Quelques jours après le naufrage, Pelsaert décide de partir chercher du secours avec quelques hommes et quelques passagers.
Derrière lui, il laisse près de 200 personnes qui vont devoir vivre tant bien que mal en attendant qu'on viennent les délivrer de cet endroit hostile... Parmi eux, son second, Cornelisz, un temps bloqué à l'intérieur de l'épave. Hiérarchiquement, en l'absence du capitaine et du subrécargue, qui ont quitté l'archipel, il est le chef des rescapés.
Et très vite, cet ancien apothicaire au passé bien trouble, va diriger cette colonie improvisée d'une main de fer. Les règles en vigueur sont les siennes et celles de ses sbires, qui possèdent les armes et n'hésitent pas à en faire usage. Cornelisz et ses hommes terrorisent le reste des survivants et commencent même à en massacrer une partie...
Face à lui, se dressent quelques hommes, à la tête desquels se trouve un soldat, Weybbe Hayes (je reprends l'orthographe du roman, on pourra en trouvé une autre pour le prénom de cet homme). Ils sont désarmés, mais, parti en quête de ravitaillement sur une autre île, ils ont trouvé de quoi manger et surtout de l'eau potable...
Entre les deux camps, débute alors une véritable guerre, avec des moyens rudimentaires, c'est vrai, mais d'une grande violence. Chacun des camps se montre impitoyable à sa manière, la force brute et aveugle d'un côté, la ruse et la légitime défense de l'autre. Hayes et ses amis cherchent un moyen de faire plier Cornelisz, avant qu'il ne massacre tous ceux qu'il a mis sous sa coupe...
Et en particulier une femme : Lucretia Jansdochter, appelée aussi par son diminutif, Creesjie. Elle est certainement, parmi tous les passagers et membres d'équipage du Batavia, celle qui occupe le plus haut rang social. Elle partait pour Java retrouver son riche époux, qui est négociant dans toute la vaste région pacifique.
Sa beauté et son évidente prestance en ont fait une cible idéale pour un Cornelisz qui affiche de plus en plus sa folie des grandeurs. Il se rêve roi de Morning Reef, et sans doute de tout l'archipel, et il a besoin, à ses côtés, d'une reine digne de lui. Creesje est "l'épouse" idéale, ce qu'elle accepte à contre-coeur, pour éviter de nouveaux drames. Mais aussi, essayer d'influencer l'intendant, gorgé de son importance nouvelle...
Voilà donc l'histoire que nous raconte Marc Biancarelli. Soyons bien clairs, il ne s'agit pas d'un documentaire historique, mais bien d'un roman, d'une fiction inspirée par ces événements. Et, si l'on retrouve dans "Massacre des Innocents" l'essentiel des faits tels qu'on les connaît, l'auteur retravaille les situations et fait des protagonistes de ce drame de vrais personnages.
Il fait de ce naufrage et de la mutinerie qui suit un récit romanesque digne des grands romans maritimes, avec son lot de personnages à noms fleuris, gueules tordues, les justes et les méchants. On n'est pas loin d'assister à un western sur ces îles minuscules, sur lesquelles on ne peut pas vivre, dans une région que l'on connaît encore très mal.
Il reprend d'ailleurs des archétypes de ce genre, avec le héros sans peur et sans reproche (enfin, pas tout à fait, on va y revenir) et le méchant cruel et déterminé. Entre eux, une femme, qui n'est pas l'unique enjeu de cette lutte à distance, mais qui attise cette rivalité où la pitié n'a pas sa place. Hayes et Cornelisz n'auront cesse d'abattre cet ennemi devenu soudainement intime, eux qui ne se connaissaient pas quelques jours plus tôt.
Ce qui est troublant, c'est le parcours de ces deux hommes qui est exactement inverse. Biancarelli nous raconte la vie de ces deux hommes que tout sépare et qui se retrouvent face à face, à l'occasion d'un drame déjà terrible, sans que la folie humaine vienne s'y greffer. Deux trajectoires dirigées à l'opposé l'une de l'autres.
Alors que Hayes, ancien soldat qui a connu la guerre et ses horreurs, est parti vers l'Asie en quête d'une rédemption qui semble bien fragile, Cornelisz, lui, s'éloigne un peu plus chaque jour de son paisible destin d'apothicaire, d'époux et de père. Alors que Hayes porte en lui les monstruosités dont il a été témoin ou qu'il a commise, Cornelisz poursuit une descente aux enfers sans retour possible.
C'est un manichéisme assumé que l'on a là, mais qui correspond assez bien aux faits. Pour ce qui est des parcours des deux rivaux, là encore, il est important de rappeler qu'il s'agit d'un roman, certes étayé par des éléments historiques, mais Biancarelli conserve une marge de manoeuvre littéraire, afin de mettre en scène ces deux destins qui se croisent dans ce déferlement de violence.
Creesje, malgré les horreurs auxquelles elle est confrontée, malgré le sort que lui réserve Cornelisz, ne se résigne pas. Au contraire, son rôle est essentiel dans cette histoire et son courage remarquable. Au milieu d'un groupe de brutes épaisses enivrées de violence et gorgées de leur pouvoir nouveau acquis les armes à la main, mais avec une grande lâcheté, elle est un personnage lumineux.
L'histoire du Batavia, c'est donc aussi l'histoire d'une mutinerie qui va prendre un tour assez extraordinaire. Je ne vais pas développer, mais on comprend que, si l'occasion a fait de Cornelisz un terrible larron, ce qui s'est passé était déjà en germe avant le naufrage. Pour qu'il y ait mutinerie, il faut des officiers et des supérieurs à abattre et à destituer.
Et il faut bien reconnaître que, à côté des trois personnages centraux que je viens d'évoquer, ils font bien pâle figue... Jacobsz comme Pelsaert sont des êtres falots, sans autorité ni grand courage. Et l'on pourrait même évoquer leur 'absence de) compétence... Il n'y a pas de William Bligh sur le Batavia, et c'est justement sans doute cette faiblesse insigne du subrécargue qui va conduire à la mutinerie.
il n'y a pas non plus de Fletcher Christian, en tout cas, pas là où on l'attend. Oui, j'évoque le Bounty, qui est une référence naturelle lorsqu'on pense mutinerie sur des navires voguant dans ces régions du globe. Comme pour le Batavia, c'est une histoire vraie qui est passée à la postérité à travers les fictions qu'elle a inspirées.
Bligh y apparaît comme un tyran que Christian, intègre et juste, renverse pour le bien de la majorité de l'équipage. Sur le Batavia, c'est un peu l'inverse qui se produit : les mutins n'ont rien de justiciers, tout au contraire, et c'est finalement au sein des passagers que va surgir un Christian, en l'occurrence Hayes, dont l'expérience militaire sera un indéniable atout.
Mais, les notions de bien et de mal sont sacrément mises à mal quand on lit "Massacre des Innocents". Car c'est d'abord la cruauté qui domine. Elle est partout, ou presque. Ceux qui incarnent le bien y recourent comme ceux qu'on qualifiera de méchants. En cette époque, on châtie impitoyablement les coupables et la justice elle-même, idéal si noble, se pare volontiers de cruauté, quand elle le juge nécessaire.
Oui, c'est un monde violent que l'on découvre, ce qui n'a rien de surprenant, Jan Coen, qui dirige alors les territoires néerlandais des Indes orientales étant lui-même un homme cruel, voire sadique (on l'avait déjà croisé dans "la Guerre de la noix muscade", de Giles Milton). On a donc une histoire effroyable, y compris une fois la mutinerie matée...
Marc Biancarelli n'épargne aucun détail, cela fait partie de son style, de sa manière de racontée les histoires. Son écriture, si visuelle, si riche, moins sèche, je l'ai dit, que dans "Orphelins de Dieu", mais c'est sans doute dû au contexte sensiblement différent, est un bonheur de lecture. Il faut dire qu'il a derrière la tête un projet assez dingue, défi remarquablement relevé, je trouve.
D'emblée, on a la puce à l'oreille : on ne trouve pas de chapitres dans ce roman, mais des tableaux. Chacune des parties composant l'histoire est un tableau à part entière et l'on trouve même, dans le court de la narration, des indications sur sa composition, l'agencement des scènes, la position et les attitudes des personnages...
C'est, je dois dire, assez impressionnant et tout cela ne doit rien au hasard. Car, au coeur de ce livre, on trouve un tableau, un vrai, cette fois. Un tableau qui représente le Massacre des Innocents, l'assassinat des enfants de moins de deux ans en Judée, ordonné par Hérode peu de temps après la naissance du Christ.
Un épisode que l'on retrouve au chapitre 2 de l'évangile selon saint Matthieu, qui reste historiquement très contesté, mais qui a beaucoup inspiré les peintres, dont Rubens ou Poussin, pour les plus célèbres. Le tableau sur lequel repose en grande partie le roman de Marc Biancarelli est l'oeuvre d'un peintre moins connu, Cornelis Cornelisz van Haarlem (on notera la concordance des noms avec le "méchant" de notre histoire.
Ce tableau, on le croise à un moment clé de l'histoire. Il en est même, d'une certaine façon, le moteur. A la fois en ce qui concerne les événements, mais aussi sur un plan plus littéraire. Car il influe sur l'écriture de l'auteur. Le titre de ce billet y fait également indirectement référence, en particulier cette "suffocante beauté" dont il est question.
Dans cette scène d'une très grande violence, le peintre insuffle également une forte sensualité, celle des corps, des nus, mais pas uniquement. Cette rencontre picturale entre Eros et Thanatos est un déclic dans le livre. Une inspiration, même, et rassurez-vous, je suis tout aussi choqué que vous d'écrire ça. Je me demande même comment la si puritaine Hollande du XVIIe siècle a reçu cette peinture...
Oui, c'est ce mélange de violence très crue et de sensualité exacerbée que l'on retrouve par la suite dans l'écriture et la narration de Marc Biancarelli. Chaque tableau composant sa fresque historique répond à ces impératifs en apparence contradictoire, et pourtant si proches. A la scène biblique, il superpose les événements entourant le naufrage et la mutinerie du Batavia, comme si c'était une série de tableaux dans la veine de Van Haarlem.
Mais, comme pour la cruauté, qui devient légitime lorsqu'elle s'exerce sous la férule de la justice, la question picturale, et ce qu'elle entraîne, repose aussi beaucoup sur la personnalité du peintre. Van Haarlem est un artiste légitime, académique, peintre officiel de la ville de Haarlem qui n'aura aucun souci avec les autorités, politiques ou religieuses.
Face à lui, à ce profil impeccable, se dresse un autre peintre, bien moins sage, le très sulfureux (ou du moins désigné comme tel) Torrentius. Lui sera condamné pour hérésie, il échappera de peu à la peine de mort et souffrira torture et exil. Quant à ses tableaux, ceux peints en Hollande, ils seront brûlés dans leur quasi totalité.
Dans "Massacre des Innocents", le roman de Marc Biancarelli, on retrouve cette opposition de fait entre ces deux peintres, l'un qui offense la morale et pas l'autre. Et dans cette bataille picturale, on retrouve déjà ce qui opposera par la suite Cornelisz et Hayes dans leur archipel perdu, oubliés de Dieu, mais pas des hommes.
Je vois que ce billet est déjà très long, je ne vais pas aller plus loin, mais ce lien que crée Marc Biancarelli entre peinture et littérature est vraiment passionnant, jusqu'au clin d'oeil final, dans un épilogue malicieux, où le romancier ne s'amuse pas seulement à broder un destin à ses personnages (alors que l'Histoire ne l'a pas retenu), mais le relie encore à celui d'un peintre...
"Massacre des Innocents" se lit donc comme on visite une exposition. Les personnages et les événements sont racontés comme s'ils sortaient de toiles accrochées au mur devant nous. Certaines scènes, qu'on a l'impression de voir, peuvent être tout à fait impressionnantes, dans la précision du détail, et ce sont tous les sens qui sont sollicités, au-delà de l'oeil.
J'avais déjà apprécié dans "Orphelins de Dieu" cette écriture qui donne à voir et plus encore, voici une nouvelle preuve du talent de raconteur d'histoires (bon, pas des plus gaies, reconnaissons-le) de Marc Biancarelli. Il donne vie à cette histoire, qui n'est pas très connue en France, mais qui continue à marquer les esprits aux Pays-Bas, où une réplique a été construite et mise à l'eau dans les années 2000.
dimanche 21 janvier 2018
"Les grues innombrables sont des seringues ; le béton une drogue. Plus la ville se pique, mieux elle se sent. Et pourtant, c'est par là qu'elle meurt".
Qui habite en ville, petite, grande ou en pleine expansion, est régulièrement le témoin de chantiers de construction qui donnent naissance à de nouveaux immeubles flambant neufs. La ville ne cesse de grignoter l'espace, avec son sillage de béton. Notre roman du jour s'attaque à ce phénomène avec humour, mais non sans férocité. Et non sans recourir aux codes du fantastique (avec un clin d'oeil appuyé à un maître du genre), bien qu'il s'agisse, ah, ces querelles de chapelles, d'un roman de littérature générale. Dans "l'Affaire Mayerling", de Bernard Quiriny (aux éditions Rivages), pas de princes et de princesses dansant la valse, pas de Catherine Deneuve et d'Omar Sharif se suicidant dans un pavillon de chasse, mais un immeuble, que dis-je, une résidence de standing qui en fait voir de toutes les couleurs, et pas seulement du gris béton, à ses habitants... On rit, mais un peu jaune, et quand on vit dans un immeuble, comme c'est mon cas, on regarde son propre quotidien avec un tout autre regard...
Le narrateur et son ami Braque sont des fondus d'urbanisme, des amateurs éclairés de bâtiments divers et de monuments variés, des collectionneurs de brochures d'agence immobilières et des spécialistes du décryptage de panneaux publicitaires vantant les mérites de la prochaine résidence bientôt en construction.
C'est donc en toute logique, et avec l'oeil des experts qu'ils sont devenus, qu'ils s'intéressent à l'histoire du Mayerling, une résidence de standing qui voit le jour à Rouvières, une ville de 250 000 habitants hors agglomération (l'équivalent de Strasbourg ou de Bordeaux, tout de même), au croisement de la rue Mayerling et du boulevard Voltaire.
Ce nouveau bâtiment qui s'annonce magnifique doit être érigé à l'emplacement où se dressait jusque-là un petit manoir à la riche histoire, au milieu d'un parc bucolique à souhait. Mais cela faisait longtemps que cette perle était laissés à l'abandon, aiguisant l'appétit des promoteurs. Aussi, lorsque, enfin, ses propriétaires acceptèrent de vendre, ce fut la ruée...
C'est une entreprise espagnole qui a décroché la timbale, à la grande surprise de tous, y compris celle de Braque et de son narrateur, car personne ne connaissait cette société. Mais, cela n'a pas empêché cet énigmatique maître d'oeuvre de construire un immeuble de fort belle allure, dont les appartements ont rapidement trouvé preneurs.
Et tant pis si c'est tout un quartier qui change subitement de décor, perdant le cachet incomparable du vieux manoir pour se retrouver avec un immeuble de plus, qui ressemble tout de même beaucoup aux autres, de plus en plus nombreux, à Rouvières, comme dans la plupart des villes... Le béton, cette matière première hégémonique, s'impose et personne n'a rien à dire...
Bientôt (enfin, avec un peu de retard sur les délais initiaux, mais c'est toujours comme ça, non ?), une partie des heureux propriétaires s'installent dans leur nouvel home, sweet home qui sent encore le neuf. Les autres louent leur nouvelle acquisition, moyennant des loyers confortables, couvrant les charges et laissant une bonne marge.
Jusqu'ici, rien d'extraordinaire, le Mayerling ne se distingue guère des autres résidences, barres d'immeubles ou autres constructions à forte densité de population qui ont poussé à Rouvières ces dernières années comme partout ailleurs. Mais, très vite, ceux qui y habitent vont être dérangés par des phénomènes plus ou moins explicables. Plus ou moins agréables, enfin, surtout moins que plus...
Quelques malfaçons apparaissent, des places de parking trop étroites, quelques fissures, une isolation sonore qui fait défaut, surtout quand le voisin du dessus aime écouter de la musique à fond les enceintes, des odeurs méphitiques atteignent des narines sensibles... Les petits désagréments de la vie en communauté, quand tout le monde ne vit pas au même rythme, quand tout le monde n'attend pas la même chose de ses soirées...
Mais, il y a plus grave, plus inquiétant, aussi. Les Lemoine, couple tellement amoureux qui rêvait d'un nid d'amour rien qu'à lui, ne se supportent plus depuis qu'ils ont passé le seuil de leur nouvel appartement. Mme Chopard croit voir des fantômes, et il n'est pas certain qu'ils lui veuillent du bien... Quant à la si sage Mme Camy, elle semble atteinte d'une dévorante envie de séduire et plus si affinités...
Rien ne va plus au Mayerling : le rêve qui a été vendu aux propriétaires (et loué aux autres) prend des allures de cauchemars. A tous les étages, des vies sont allègrement gâchées par des événements qu'on ne parvient pas à régler. En très peu de temps, les tensions entre habitants montent et certains n'en peuvent déjà plus. Au Mayerling, on est sur les nefs...
Les copropriétaires essayent bien de s'organiser, de faire appel à un syndic étonnamment discret, d'un seul coup. On cherche à régler les différends à l'amiable, souvent en vain, ou alors, on se résigne, en attendant des jours meilleurs. Au fil des jours, des semaines, l'atmosphère se dégrade, les phénomènes se renforcent et une question commence à poindre :
Et si c'était l'immeuble qui en voulait à ses habitants ?
Un mot, avant d'aller plus loin, sur Bernard Quiriny, romancier pas encore quadragénaire (il est né en 1978), mais à la bibliographie déjà bien remplie. De nationalité belge, possédant un riche cursus universitaire, il a reçu de nombreux prix, dont le Rossel (équivalent belge de notre Goncourt) et un Grand Prix de l'Imaginaire, eh oui, pour son recueil de nouvelles "Une collection très particulière".
Car Bernard Quiriny a beau être présenté comme un auteur de littérature générale, son travail comme ses influences lorgnent sérieusement vers le fantastique. A son sujet, on évoque Borges, Poe, Aymé et d'autres noms tout aussi flatteurs, ce n'est quand même pas rien. A quoi il faut ajouter un humour qui oscille entre la satire et l'humour noir, comme dans "l'Affaire Mayerling", d'ailleurs.
Ce ne sont d'ailleurs pas les références littéraires qui manquent dans ce roman très amusant, où les lecteurs qui vivent dans des immeubles devraient se reconnaître à un moment ou à un autre (mais pas dans tous les habitants non plus, ou alors...). On croise Paul Guth, J.G. Ballard, Georges Perec, Jean-Jacques Rousseau, Marcel Aymé, encore lui, et quelques autres (les titres en lien).
Car la ville, l'urbanisme, la concentration des populations dans une zone géographique de plus en plus réduite, tout cela a inspiré, et depuis longtemps, les philosophes, les historiens, les romanciers (on pourrait ajouter les cinéastes, bien sûr, mais restons à l'écrit, pour l'instant). Et Bernard Quiriny, lui aussi, vient mettre son grain de sel dans tout cela. Critique, forcément critique, mais très drôle, aussi.
L'accumulation de catastrophes qui entoure la construction et les premiers mois d'existence du Mayerling font forcément sourire le lecteur, qui compatit, mais pas trop, il ne faudrait pas que lui tombe sur le coin du crâne le même genre de malheurs... A chacun ses soucis particuliers qu'on cherche à résoudre isolément, avant de trouver LE coupable et de se liguer contre lui...
Il y a, dans le ton employé par Quiriny, un détachement et une légèreté qui contrastent avec la situation de plus en plus précaires des habitants du Mayerling. La narration est très particulière, avec des chapitres très courts, qui font penser à des articles qu'on aurait collectés au fil du temps pour constituer un dossier quelconque.
De temps en temps, on digresse, on retrouve Braque, le narrateur et leurs lubies. Ils ont un petit côté Bouvard et Pécuchet des villes, ces deux-là, avec le regard débonnaire, mais plein de curiosité pour les événements qui frappent le coin de la rue Mayerling et du boulevard Voltaire, à Rouvières, craignant la théorie des dominos, la contagion, la pandémie...
Mais quel vent de folie souffle donc sur cet immeuble de standing (et s'il y a bien quelque chose qui garantit que tout ne soit qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, c'est bien la mention "de standing", non ?), quelle malédiction pèse-t-elle sur ce lieu pourtant tranquille ? Et que faire pour contrarier cette insupportable situation ?
Oui, on s'amuse bien, car la gamme de misères qui s'abat sur le Mayerling est variée, souvent originale, un mélange de soucis domestiques hélas très courants et d'autres beaucoup moins, franchissant allègrement les limites de la rationalité. Que cela aboutisse à des situations dangereuses ou pouvant le devenir, ou que cela reste certes pénible, mais sans risque, la coupe est vite pleine...
On regrette presque que les architectes n'aient pas doté le Mayerling d'une salle de bal, si vous me voyez venir. Eh oui, en introduction, j'ai évoqué une référence évidente qui vient naturellement à l'esprit lorsqu'on avance dans la lecture de "l'Affaire Mayerling", il est temps d'en parler : l'immeuble rouviérois ressemble fort à un lointain cousin de l'Overlook, le sinistre hôtel de "Shining".
Et ce n'est pas juste une impression. Pas besoin de soeurs jumelles, de tricycle, de vagues de sang ou de buissons animés, mais les clins d'oeil sont là, jusqu'au coeur même de l'intrigue, vous le verrez, où il n'est plus possible d'ignorer la référence à l'un des plus célèbres romans de Stephen King. Mais, pas le King qui fiche les chocottes et vous fait trembler sous la couette.
Non, le King de Quiriny est croisé avec un autre personnage pour donner quelque chose de tout à fait inattendu, puisqu'il s'agit de Jacques Tati. Dans "Mon Oncle" en particulier (qui a pour décor une maison ultramoderne), puis dans "Playtime", l'interprète du mythique personnage de Monsieur Hulot s'intéressait justement à l'urbanisme, à la ville et à l'immobilier pour mieux le tourner en dérision.
On retrouve chez Bernard Quiriny un même sens de l'absurde et de la déraison dans "L'Affaire Mayerling". Entre King et Tati, on oscille sans cesse au long des 300 pages, ne sachant pas vraiment lequel des deux l'emportera : l'horreur ou la folie douce ? La violence ou la rêverie désenchantée ? Le tragique ou le comique ?
Au-delà des péripéties liées au Mayerling, on voit se dégager dans ce roman différents thèmes, dont l'un est diffus avant de prendre forme jusqu'au dénouement. Il s'agit des relations de voisinage. Quand je dis diffus, c'est parce qu'au départ, c'est un peu chacun pour soi au Mayerling, rien de plus normal, puisque c'est un immeuble neuf et que personne ne se connaît encore.
Mais, ensuite, les premières relations sont loin d'être cordiales. On a plus d'occasions de se frictionner, de s'expliquer, voire plus, que d'occasions de fraterniser et de célébrer la fête des voisins autour d'un banquet façon village d'Astérix. La cordialité (ne devrais-je pas écrire l'urbanité ?) ne fait pas partie du règlement de la copropriété, dirait-on.
Et puis, au fil des événements, alors que se passent des incidents à gravité variable, forcément, on se rapproche (sauf les Lemoine, qui n'en finissent plus de se déchirer) et lorsque l'ennemi commun est identifié, aussi fou cela puisse-t-il paraisse, alors, l'union pourrait faire la force... Au final, on a sans doute, grâce au Mayerling, des liens inattendus qui se sont noués, et durablement...
De mon point de vue, outre la dimension écologique (le béton, cette bête noire de Bernard Quiriny !), c'est l'un des aspects les plus intéressants de ce roman que cette question des relations humaines. Avec cette maxime qui en dit long : "la barbarie surgit dans deux types d'endroits : là où la densité démographique est très basse, et là où elle est très forte".
La ville déshumanise, désintègre le lien social, alors qu'elle rassemble, mot si fort, si riche, des populations très différentes. La ville, c'est une émulsion, ses composantes ne se mélangent jamais harmonieusement, chacun reste à sa place, dans son coin, dans sa classe sociale, etc. Et dans un immeuble, c'est un peu pareil (et je sais de quoi je parle...).
La satire de Bernard Quiriny concerne donc aussi ce qu'on appelle, ah, la belle expression fourre-tout, "le vivre-ensemble"... A la fois dans des cadres de plus en plus stéréotypés, aseptisés, souvent très laids et moyennement fonctionnels (sans aller jusqu'aux folies à la Le Corbusier), mais aussi dans la manière dont nous acceptons l'autre, en l'occurrence cette espèce nuisible qu'est le voisin (ce n'est pas de moi, mais de Desproges).
Et ce qui se passe au Mayerling concerne bien sûr tout le quartier alentour, toute la ville, sans doute, et probablement n'importe quelle autre ville, aussi importante que Rouvières ou de bien moindre envergure, mais cherchant à s'étendre. L'un des ressorts comiques est d'ailleurs la manière dont les habitants du Mayerling gèrent leur lutte et ce qui en filtre à l'extérieur, où l'on se demande ce qui se passe derrière ces grilles...
Je me suis énormément amusé à cette lecture, qui m'a permis de découvrir un auteur dont j'avais déjà entendu le nom, mais que je n'avais encore jamais lu. Et c'est un tort, car "L'Affaire Mayerling", si c'est bien un one-shot, est tout de même directement lié à un précédent roman de l'auteur, "le village évanoui", qui était paru chez Flammarion (et qu'on trouve en poche, chez J'ai Lu).
En fait, ce sont les deux volets d'un diptyque, un roman des champs et donc, avec "l'Affaire Mayerling", un roman des villes, avec, à chaque fois, un regard acerbe porté sur la modernité qui s'étend insidieusement et engloutit tout, et pas toujours avec de bons côtés. Partisan du "c'était mieux avant", Bernard Quiriny ? C'est peut-être un peu simpliste, comme vision des choses, mais adversaire d'une globalisation à outrance qui fait perdre de vue l'essentiel et la proximité, certainement.
Sur des sujets qui apparaissent donc très sérieux, il choisit l'option de la satire et de l'humour, sans méchanceté, avec tendresse pour ses personnages, même s'ils ne les ménagent pas. Il fait du quotidien une aventure extraordinaire, débordant dans l'irrationnel, mais c'est une façon de nous rappeler, à nous, lecteurs, que c'est dans notre monde bien réel qu'on sombre dans la folie et l'absurde et qu'il est encore le temps de dire stop.
Alors, on peut se poser une question, de plus en plus tendance : et si, sous ces airs de dystopie, le dernier roman en date de Bernard Quiriny, avec ses phénomènes surnaturels et sa folie contagieuse, son montée dramatique, réelle malgré le comique de situation, était en fait une utopie ? Et s'il nous indiquait la voie à suivre vers plus d'humanité, vers des eaux plus tranquilles ?
Le narrateur et son ami Braque sont des fondus d'urbanisme, des amateurs éclairés de bâtiments divers et de monuments variés, des collectionneurs de brochures d'agence immobilières et des spécialistes du décryptage de panneaux publicitaires vantant les mérites de la prochaine résidence bientôt en construction.
C'est donc en toute logique, et avec l'oeil des experts qu'ils sont devenus, qu'ils s'intéressent à l'histoire du Mayerling, une résidence de standing qui voit le jour à Rouvières, une ville de 250 000 habitants hors agglomération (l'équivalent de Strasbourg ou de Bordeaux, tout de même), au croisement de la rue Mayerling et du boulevard Voltaire.
Ce nouveau bâtiment qui s'annonce magnifique doit être érigé à l'emplacement où se dressait jusque-là un petit manoir à la riche histoire, au milieu d'un parc bucolique à souhait. Mais cela faisait longtemps que cette perle était laissés à l'abandon, aiguisant l'appétit des promoteurs. Aussi, lorsque, enfin, ses propriétaires acceptèrent de vendre, ce fut la ruée...
C'est une entreprise espagnole qui a décroché la timbale, à la grande surprise de tous, y compris celle de Braque et de son narrateur, car personne ne connaissait cette société. Mais, cela n'a pas empêché cet énigmatique maître d'oeuvre de construire un immeuble de fort belle allure, dont les appartements ont rapidement trouvé preneurs.
Et tant pis si c'est tout un quartier qui change subitement de décor, perdant le cachet incomparable du vieux manoir pour se retrouver avec un immeuble de plus, qui ressemble tout de même beaucoup aux autres, de plus en plus nombreux, à Rouvières, comme dans la plupart des villes... Le béton, cette matière première hégémonique, s'impose et personne n'a rien à dire...
Bientôt (enfin, avec un peu de retard sur les délais initiaux, mais c'est toujours comme ça, non ?), une partie des heureux propriétaires s'installent dans leur nouvel home, sweet home qui sent encore le neuf. Les autres louent leur nouvelle acquisition, moyennant des loyers confortables, couvrant les charges et laissant une bonne marge.
Jusqu'ici, rien d'extraordinaire, le Mayerling ne se distingue guère des autres résidences, barres d'immeubles ou autres constructions à forte densité de population qui ont poussé à Rouvières ces dernières années comme partout ailleurs. Mais, très vite, ceux qui y habitent vont être dérangés par des phénomènes plus ou moins explicables. Plus ou moins agréables, enfin, surtout moins que plus...
Quelques malfaçons apparaissent, des places de parking trop étroites, quelques fissures, une isolation sonore qui fait défaut, surtout quand le voisin du dessus aime écouter de la musique à fond les enceintes, des odeurs méphitiques atteignent des narines sensibles... Les petits désagréments de la vie en communauté, quand tout le monde ne vit pas au même rythme, quand tout le monde n'attend pas la même chose de ses soirées...
Mais, il y a plus grave, plus inquiétant, aussi. Les Lemoine, couple tellement amoureux qui rêvait d'un nid d'amour rien qu'à lui, ne se supportent plus depuis qu'ils ont passé le seuil de leur nouvel appartement. Mme Chopard croit voir des fantômes, et il n'est pas certain qu'ils lui veuillent du bien... Quant à la si sage Mme Camy, elle semble atteinte d'une dévorante envie de séduire et plus si affinités...
Rien ne va plus au Mayerling : le rêve qui a été vendu aux propriétaires (et loué aux autres) prend des allures de cauchemars. A tous les étages, des vies sont allègrement gâchées par des événements qu'on ne parvient pas à régler. En très peu de temps, les tensions entre habitants montent et certains n'en peuvent déjà plus. Au Mayerling, on est sur les nefs...
Les copropriétaires essayent bien de s'organiser, de faire appel à un syndic étonnamment discret, d'un seul coup. On cherche à régler les différends à l'amiable, souvent en vain, ou alors, on se résigne, en attendant des jours meilleurs. Au fil des jours, des semaines, l'atmosphère se dégrade, les phénomènes se renforcent et une question commence à poindre :
Et si c'était l'immeuble qui en voulait à ses habitants ?
Un mot, avant d'aller plus loin, sur Bernard Quiriny, romancier pas encore quadragénaire (il est né en 1978), mais à la bibliographie déjà bien remplie. De nationalité belge, possédant un riche cursus universitaire, il a reçu de nombreux prix, dont le Rossel (équivalent belge de notre Goncourt) et un Grand Prix de l'Imaginaire, eh oui, pour son recueil de nouvelles "Une collection très particulière".
Car Bernard Quiriny a beau être présenté comme un auteur de littérature générale, son travail comme ses influences lorgnent sérieusement vers le fantastique. A son sujet, on évoque Borges, Poe, Aymé et d'autres noms tout aussi flatteurs, ce n'est quand même pas rien. A quoi il faut ajouter un humour qui oscille entre la satire et l'humour noir, comme dans "l'Affaire Mayerling", d'ailleurs.
Ce ne sont d'ailleurs pas les références littéraires qui manquent dans ce roman très amusant, où les lecteurs qui vivent dans des immeubles devraient se reconnaître à un moment ou à un autre (mais pas dans tous les habitants non plus, ou alors...). On croise Paul Guth, J.G. Ballard, Georges Perec, Jean-Jacques Rousseau, Marcel Aymé, encore lui, et quelques autres (les titres en lien).
Car la ville, l'urbanisme, la concentration des populations dans une zone géographique de plus en plus réduite, tout cela a inspiré, et depuis longtemps, les philosophes, les historiens, les romanciers (on pourrait ajouter les cinéastes, bien sûr, mais restons à l'écrit, pour l'instant). Et Bernard Quiriny, lui aussi, vient mettre son grain de sel dans tout cela. Critique, forcément critique, mais très drôle, aussi.
L'accumulation de catastrophes qui entoure la construction et les premiers mois d'existence du Mayerling font forcément sourire le lecteur, qui compatit, mais pas trop, il ne faudrait pas que lui tombe sur le coin du crâne le même genre de malheurs... A chacun ses soucis particuliers qu'on cherche à résoudre isolément, avant de trouver LE coupable et de se liguer contre lui...
Il y a, dans le ton employé par Quiriny, un détachement et une légèreté qui contrastent avec la situation de plus en plus précaires des habitants du Mayerling. La narration est très particulière, avec des chapitres très courts, qui font penser à des articles qu'on aurait collectés au fil du temps pour constituer un dossier quelconque.
De temps en temps, on digresse, on retrouve Braque, le narrateur et leurs lubies. Ils ont un petit côté Bouvard et Pécuchet des villes, ces deux-là, avec le regard débonnaire, mais plein de curiosité pour les événements qui frappent le coin de la rue Mayerling et du boulevard Voltaire, à Rouvières, craignant la théorie des dominos, la contagion, la pandémie...
Mais quel vent de folie souffle donc sur cet immeuble de standing (et s'il y a bien quelque chose qui garantit que tout ne soit qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, c'est bien la mention "de standing", non ?), quelle malédiction pèse-t-elle sur ce lieu pourtant tranquille ? Et que faire pour contrarier cette insupportable situation ?
Oui, on s'amuse bien, car la gamme de misères qui s'abat sur le Mayerling est variée, souvent originale, un mélange de soucis domestiques hélas très courants et d'autres beaucoup moins, franchissant allègrement les limites de la rationalité. Que cela aboutisse à des situations dangereuses ou pouvant le devenir, ou que cela reste certes pénible, mais sans risque, la coupe est vite pleine...
On regrette presque que les architectes n'aient pas doté le Mayerling d'une salle de bal, si vous me voyez venir. Eh oui, en introduction, j'ai évoqué une référence évidente qui vient naturellement à l'esprit lorsqu'on avance dans la lecture de "l'Affaire Mayerling", il est temps d'en parler : l'immeuble rouviérois ressemble fort à un lointain cousin de l'Overlook, le sinistre hôtel de "Shining".
Et ce n'est pas juste une impression. Pas besoin de soeurs jumelles, de tricycle, de vagues de sang ou de buissons animés, mais les clins d'oeil sont là, jusqu'au coeur même de l'intrigue, vous le verrez, où il n'est plus possible d'ignorer la référence à l'un des plus célèbres romans de Stephen King. Mais, pas le King qui fiche les chocottes et vous fait trembler sous la couette.
Non, le King de Quiriny est croisé avec un autre personnage pour donner quelque chose de tout à fait inattendu, puisqu'il s'agit de Jacques Tati. Dans "Mon Oncle" en particulier (qui a pour décor une maison ultramoderne), puis dans "Playtime", l'interprète du mythique personnage de Monsieur Hulot s'intéressait justement à l'urbanisme, à la ville et à l'immobilier pour mieux le tourner en dérision.
On retrouve chez Bernard Quiriny un même sens de l'absurde et de la déraison dans "L'Affaire Mayerling". Entre King et Tati, on oscille sans cesse au long des 300 pages, ne sachant pas vraiment lequel des deux l'emportera : l'horreur ou la folie douce ? La violence ou la rêverie désenchantée ? Le tragique ou le comique ?
Au-delà des péripéties liées au Mayerling, on voit se dégager dans ce roman différents thèmes, dont l'un est diffus avant de prendre forme jusqu'au dénouement. Il s'agit des relations de voisinage. Quand je dis diffus, c'est parce qu'au départ, c'est un peu chacun pour soi au Mayerling, rien de plus normal, puisque c'est un immeuble neuf et que personne ne se connaît encore.
Mais, ensuite, les premières relations sont loin d'être cordiales. On a plus d'occasions de se frictionner, de s'expliquer, voire plus, que d'occasions de fraterniser et de célébrer la fête des voisins autour d'un banquet façon village d'Astérix. La cordialité (ne devrais-je pas écrire l'urbanité ?) ne fait pas partie du règlement de la copropriété, dirait-on.
Et puis, au fil des événements, alors que se passent des incidents à gravité variable, forcément, on se rapproche (sauf les Lemoine, qui n'en finissent plus de se déchirer) et lorsque l'ennemi commun est identifié, aussi fou cela puisse-t-il paraisse, alors, l'union pourrait faire la force... Au final, on a sans doute, grâce au Mayerling, des liens inattendus qui se sont noués, et durablement...
De mon point de vue, outre la dimension écologique (le béton, cette bête noire de Bernard Quiriny !), c'est l'un des aspects les plus intéressants de ce roman que cette question des relations humaines. Avec cette maxime qui en dit long : "la barbarie surgit dans deux types d'endroits : là où la densité démographique est très basse, et là où elle est très forte".
La ville déshumanise, désintègre le lien social, alors qu'elle rassemble, mot si fort, si riche, des populations très différentes. La ville, c'est une émulsion, ses composantes ne se mélangent jamais harmonieusement, chacun reste à sa place, dans son coin, dans sa classe sociale, etc. Et dans un immeuble, c'est un peu pareil (et je sais de quoi je parle...).
La satire de Bernard Quiriny concerne donc aussi ce qu'on appelle, ah, la belle expression fourre-tout, "le vivre-ensemble"... A la fois dans des cadres de plus en plus stéréotypés, aseptisés, souvent très laids et moyennement fonctionnels (sans aller jusqu'aux folies à la Le Corbusier), mais aussi dans la manière dont nous acceptons l'autre, en l'occurrence cette espèce nuisible qu'est le voisin (ce n'est pas de moi, mais de Desproges).
Et ce qui se passe au Mayerling concerne bien sûr tout le quartier alentour, toute la ville, sans doute, et probablement n'importe quelle autre ville, aussi importante que Rouvières ou de bien moindre envergure, mais cherchant à s'étendre. L'un des ressorts comiques est d'ailleurs la manière dont les habitants du Mayerling gèrent leur lutte et ce qui en filtre à l'extérieur, où l'on se demande ce qui se passe derrière ces grilles...
Je me suis énormément amusé à cette lecture, qui m'a permis de découvrir un auteur dont j'avais déjà entendu le nom, mais que je n'avais encore jamais lu. Et c'est un tort, car "L'Affaire Mayerling", si c'est bien un one-shot, est tout de même directement lié à un précédent roman de l'auteur, "le village évanoui", qui était paru chez Flammarion (et qu'on trouve en poche, chez J'ai Lu).
En fait, ce sont les deux volets d'un diptyque, un roman des champs et donc, avec "l'Affaire Mayerling", un roman des villes, avec, à chaque fois, un regard acerbe porté sur la modernité qui s'étend insidieusement et engloutit tout, et pas toujours avec de bons côtés. Partisan du "c'était mieux avant", Bernard Quiriny ? C'est peut-être un peu simpliste, comme vision des choses, mais adversaire d'une globalisation à outrance qui fait perdre de vue l'essentiel et la proximité, certainement.
Sur des sujets qui apparaissent donc très sérieux, il choisit l'option de la satire et de l'humour, sans méchanceté, avec tendresse pour ses personnages, même s'ils ne les ménagent pas. Il fait du quotidien une aventure extraordinaire, débordant dans l'irrationnel, mais c'est une façon de nous rappeler, à nous, lecteurs, que c'est dans notre monde bien réel qu'on sombre dans la folie et l'absurde et qu'il est encore le temps de dire stop.
Alors, on peut se poser une question, de plus en plus tendance : et si, sous ces airs de dystopie, le dernier roman en date de Bernard Quiriny, avec ses phénomènes surnaturels et sa folie contagieuse, son montée dramatique, réelle malgré le comique de situation, était en fait une utopie ? Et s'il nous indiquait la voie à suivre vers plus d'humanité, vers des eaux plus tranquilles ?
samedi 20 janvier 2018
"Le jour n'a qu'un soleil mais la nuit de la mort a des milliards de soleils" (Elie Delamare-Deboutteville).
Le soleil... Omniprésent, indispensable, écrasant, parfois ; un astre qui nous remonte le moral quand il brille, dont on se languit quand il se cache... Notre pourvoyeur de lumière, sans qui la vie serait impossible. Et la lumière, ce sont des particules invisibles qui nous tombent dessus en permanence. Comme tout ce qui compose notre univers, notre planète, des scientifiques étudient le soleil pour comprendre son fonctionnement, ses bienfaits et ses dangers. Mais c'est aussi un élément auquel nous sommes tellement habitué qu'on n'y prête guère attention. Il est là, nous savons que demain, il se lèvera une nouvelle fois, et ainsi de suite... Comme les gens que nous côtoyons sans vraiment les connaître, que nous croisons sans les voir, jusqu'à ce qu'un événement extraordinaire vienne bousculer ces habitudes... "Mille soleils", le nouveau roman de Nicolas Delesalle (à qui l'on doit "Un parfum d'herbe coupée" et "Le Goût du large", désormais en poche), vient de paraître en grand format aux éditions Préludes. Cinq personnages, un accident, une onde de choc, des révélations... Ou comment ces humains, simples particules à l'échelle de l'univers, vont voir leurs destins irrémédiablement bouleversés en pleine pampa argentine...
La ville de Malargüe se trouve en Argentine, au pied de la Cordillère des Andes, tout au sud de la province de Mendoza. C'est là qu'est installé l'observatoire Pierre-Auger, un centre scientifique international où des chercheurs du monde entier travaillent sur les différents rayons cosmiques et étudient, entre autre, le soleil.
Vadim, taciturne, discret, est un spécialiste de la physique des particules et amateurs de death metal (il en a d'ailleurs le look) ; Alexandre, séducteur et macho, mais brisé par une récente rupture avec une femme qu'il aimait sincèrement, a présidé à l'installation les 1600 panneaux solaires de l'observatoire ; Wolfgang, le poissard qui a appris à vivre avec sa malchance proverbiale, étudie les rayons cosmiques d'ultra-haute énergie.
Ces trois scientifiques de grande valeur doivent prendre un avion, ce jour-là. Ils se sont donc levés tôt pour pouvoir préparer leurs bagages, prendre un petit-déjeuner et faire le long trajet en voiture jusqu'à l'aéroport de Mendoza, à plusieurs centaines de kilomètres de là. Et pas au bout d'une autoroute, mais d'une longue piste, digne d'un rallye-raid.
Un quatrième homme les accompagne : il s'appelle Simon et il est venu jusqu'à Malargüe afin d'écrire un article de vulgarisation scientifique pour le magazine du CNRS. Sa visite à l'observatoire s'achève et il va rentrer au pays, avec les informations qu'il a collectées. Et auxquelles, il faut bien le dire, il ne comprend pas grand-chose, mais ce sujet est vraiment cool !
Il détonne un peu, au milieu de ces trois grosses têtes, lui qui est superficiel, fan de Clint Eastwood qu'il interroge avant de prendre chaque décision, sans cesse branché sur son smartphone ou sa tablette, immortalisant sur les réseaux sociaux chaque moment de sa vie susceptible de lui rapporter des "likes". Une vie virtuelle, par procuration, presque plus importante à ses yeux que sa vie IRL.
Les voilà donc en route pour Mendoza, Vadim au volant du 4x4, et une ambiance particulière dans cet habitacle. Comme si chacun vivait dans son propre monde, s'abîmait dans ses propres pensées et qu'il ne pouvait les partager avec les autres. Quatre univers distincts sans aucune intersection, quatre vies qui se sépareront naturellement lorsqu'ils seront arrivés à l'aéroport.
Dans ce décor somptueux, près de la Lagune du Diamant et du volcan Maipo qui la surplombe, dans ce désert qui ne semble pas avoir de limite, Vadim se laisse emporter par ses rêveries, griser par la vitesse. Et soudaine, une ornière, une courbe, un dévers, il n'en sait rien, il perd le contrôle du véhicule qui sort de la piste et part en tonneaux...
L'accident est très spectaculaire, très violent... La voiture est complètement détruite et, à l'intérieur, les passagers ont souffert. A des degrés divers. Et les voilà mal en point, au milieu de nulle part, le long d'une route très peu fréquentée, avec ce soleil, objet de toutes leurs attentions habituellement, qui pourrait devenir un problème supplémentaire...
Comment vont-ils réagir dans cette extraordinaire situation ?
Il nous faut parler de Mathilda, la cinquième protagoniste de ce roman, malgré elle. A près de 60 ans, elle a envoyé balader sa vie en Afrique du Sud, sa famille, un mari, des enfants, son métier de chirurgien-dentiste qui lui sortait par les yeux. Du jour au lendemain, elle a tout plaqué et s'est envolée pour l'Alaska.
Et de là, elle s'est lancée dans une incroyable aventure : rejoindre le point le plus haut sud du continent américain, au fin fond de la Terre de Feu, équipée seulement d'un vélo... Pourquoi ce défi qui semble surhumain ? Elle ne saurait sans doute même pas l'expliquer, il s'agissait juste de se fixer un but dans l'existence...
Voilà comment, ce matin-là, Mathilda s'est retrouvé sur une route argentine, entre Mendoza et Malargüe, en direction du sud. Voilà comment, ce matin-là, elle a croisé la voiture conduisant Vadim, Alexandre, Wolfgang et Simon à l'aéroport, sans savoir ce qui allait se passer quelques instants plus tard, sans prêter une grande attention à ce véhicule.
Ce contact uniquement visuel a duré quelques secondes à peine, le temps pour la cycliste de regarder passer le 4x4 et de se retrouver enveloppé par un nuage de poussière, le temps pour les passagers de la voiture de remarquer cette femme, dont la présence en pleine pampa leur a semblé certes incongrue, mais qu'ils ont vite oubliée ensuite...
Pourtant, cette fugace rencontre va influer sur le destin des uns et des autres, sans même qu'ils en aient conscience. Exactement comme les rayons du soleil viennent nous réchauffer, et on poursuit ce que l'on est en train de faire, et exactement comme d'innombrables autres particules dont nous ignorons tout viennent nous frapper, parfois sans effet, et parfois avec des conséquences...
Une sorte d'effet papillon à l'échelle de l'infiniment petit... Et une réflexion sur ces particules d'humanité que nous nous échangeons sans en avoir conscience et qui, dans la plus parfaite discrétion, changent nos existences, parfois pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Parce que les relations entre les êtres n'ont pas besoin d'être visibles pour bousculer nos destins...
Après les voyages au long cours et les souvenirs des quatre coins du monde qui étaient au coeur du "Goût du large", Nicolas Delesalle nous invite à une lecture très différente, car, même si le cadre de la pampa argentine est majestueux et dépaysant à souhait, il est l'unique cadre de cette histoire. Et, d'une certaine manière, entre la voiture et cette piste interminable et très peu fréquentée, on est proche du huis clos.
En effet, nos personnages sont livrés à eux-mêmes et ne peuvent compter que sur leur sang froid, leur bon sens. Peut-être aussi sur leur chance, même si, dans de telles circonstances, on hésite à l'évoquer... De leurs réactions dépendra la suite de leur existence, une existence qui va, de toute manière, changer de trajectoire après les événements de ce jour.
De même, l'unité de temps : quelques secondes pour que se noue le drame, façon "les Choses de la vie", une journée pour que l'action se déroule. C'est à la fois long, vous comprendrez pourquoi, et court, à l'échelle de nos existences et plus encore, à celle du temps. Tout est relatif, on y revient sans cesse, à ce constat...
Entre les êtres humains et ces particules gorgées d'énergie qu'étudient les scientifiques de l'observatoire Pierre-Auger, le parallèle est alors saisissant. Nous aussi sommes porteurs d'une énergie qui influe, consciemment ou non, sur ceux que nous rencontrons, par hasard ou non, ou que nous croisons simplement.
Au coeur de cette nature sauvage, imposante, mais qui peut vite se montrer hostile, ces personnes vont toucher à l'essentiel. Les préoccupations qu'ils ressassaient pendant ce voyage vont s'envoler et ils vont se rendre compte de la fragilité de l'existence, de ce qui la rend précieuse et de ce qu'il faut savoir apprécier.
Comme le pense Simon, "il faut se montrer plus modeste, accepter l'évidence et arrêter de vivre plus haut que son cul". Bon, c'est formulé de manière un peu brusque, ça colle parfaitement au jeune journaliste, il faudrait sans doute imaginer des variantes plus... modérées pour les autres, mais c'est valable pour tous, y compris Mathilda.
L'homme n'est pas le centre de l'univers, faut-il encore le rappeler ? Pour ces hommes, le rappel est brutal, sept tonneaux, si je ne me trompe pas... Dans leur comportement, il y a de l'égocentrisme et de l'égoïsme, aussi, à différents degrés. En tout cas, on est bien loin de leurs recherches scientifiques, si profondes, pointues, excitantes. Et même, à leur façon, poétiques.
Chacun, mais ils ne sont pas les seuls, nous sommes tous comme cela, est le soleil de son propre système, une existence qui tourne autour de soi, comme les planètes. Voilà ce qui nous préoccupe principalement, une vision à courte vue à l'échelle de l'univers. Et c'est ce qui nous fait oublier de nous préoccuper des autres, sauf circonstances exceptionnelles.
Chaque personnage de ce roman a une personnalité bien marquée, sensiblement différente de celles des autres, des goûts, des aspirations, des ambitions, des regards différents. En fait, chacun a sa vision du monde, sa philosophie de l'existence, mais une seule vie, fugace, brève, trop pour ne pas en faire quelque chose d'autre qu'un jouet qu'on ne garde que pour soi.
L'altruisme, le désintéressement, des valeurs qui ont tendance à s'effacer dans nos sociétés modernes, sont au coeur de cette histoire. Mais, pour en arriver là, il faut qu'ils se révèlent, et pour cela, il faut que ces êtres soient frappés par ces particules d'humanité à haute énergie, renforcées par d'intenses émotions, encore une fois selon un large spectre.
Il y a beaucoup à apprendre de ce roman, pour le lecteur, qui n'est pas au coeur des événements, mais seulement le témoin. Pour nous aussi, comme pour Vadim, Alexandre, Wolfgang, Simon et Mathilda, cette lecture a des conséquences, doit avoir des conséquences. Nous aussi sommes frappés par ces particules d'humanité émises par ce qui se passe sur cette piste argentine.
Nicolas Delesalle nous met face à nos responsabilités, face à nos existences, face à notre indifférence quotidienne, et nous demande de tirer les enseignements pour notre propre vie, sans avoir à passer par un drame, un choc, une révélation tragique ou existentielle. Oui, à nous d'influer sur nos propres trajectoires, sur celle des particules que nous émettons et qui iront en irradier d'autres, et ainsi de suite...
On passe au cours de cette lecture par de nombreux états d'esprit, du rire aux larmes, selon la formule consacrée. Certains des personnages ont un côté tragique, au contraire d'un Simon, qui incarne le ressort comique (léger, le comique, mais qui apporte un peu de légèreté dans ces moments terribles). On constate les dégâts, on s'inquiète pour eux, on craint le pire...
Quant à Mathilda, je me suis longtemps interrogé à son sujet. Sur ses choix radicaux, sur ce ras-le-bol qui l'a poussée à prendre ses distances et à tout envoyer valser, à se libérer d'un quotidien trop monotone... Que venait-elle faire dans cette histoire ? Elle ne ressemble pas aux autres, à ces quatre hommes enfermés dans leur grosse voiture.
Au contraire des hommes, noyés dans leur quotidien, elle a rejeté son existence, elle a choisi de fuir sa vie. Elle est en quête d'un absolu qui, pour les autres personnages, se limite à leur vie professionnelle. Elle est en quête de quelque chose, un accomplissement, peut-être, dont elle ignore ce qu'il est exactement.
Elle incarne une forme de résilience, d'acceptation de soi. Elle est en quête d'estime de soi, alors qu'elle entre dans la dernière partie de son existence. Pardon d'évoquer son âge, mais c'est sa croix. Ce vieillissement est l'un des éléments qui la minent, son adversaire, c'est le temps, qui avance, inexorable, qui la broie et qui l'érode, à la fois...
Cinq visions du monde et de l'existence, et tant d'autres encore. Cinq destins qui se jouent en quelques instants. Et la confrontation du rêve et de la réalité. Le rêve, quand l'homme relève la tête vers les étoiles, et la plus brillante d'entre elle. La réalité qui enferme, inhibe, écrase, et dont il faut aussi chercher à se libérer...
La ville de Malargüe se trouve en Argentine, au pied de la Cordillère des Andes, tout au sud de la province de Mendoza. C'est là qu'est installé l'observatoire Pierre-Auger, un centre scientifique international où des chercheurs du monde entier travaillent sur les différents rayons cosmiques et étudient, entre autre, le soleil.
Vadim, taciturne, discret, est un spécialiste de la physique des particules et amateurs de death metal (il en a d'ailleurs le look) ; Alexandre, séducteur et macho, mais brisé par une récente rupture avec une femme qu'il aimait sincèrement, a présidé à l'installation les 1600 panneaux solaires de l'observatoire ; Wolfgang, le poissard qui a appris à vivre avec sa malchance proverbiale, étudie les rayons cosmiques d'ultra-haute énergie.
Ces trois scientifiques de grande valeur doivent prendre un avion, ce jour-là. Ils se sont donc levés tôt pour pouvoir préparer leurs bagages, prendre un petit-déjeuner et faire le long trajet en voiture jusqu'à l'aéroport de Mendoza, à plusieurs centaines de kilomètres de là. Et pas au bout d'une autoroute, mais d'une longue piste, digne d'un rallye-raid.
Un quatrième homme les accompagne : il s'appelle Simon et il est venu jusqu'à Malargüe afin d'écrire un article de vulgarisation scientifique pour le magazine du CNRS. Sa visite à l'observatoire s'achève et il va rentrer au pays, avec les informations qu'il a collectées. Et auxquelles, il faut bien le dire, il ne comprend pas grand-chose, mais ce sujet est vraiment cool !
Il détonne un peu, au milieu de ces trois grosses têtes, lui qui est superficiel, fan de Clint Eastwood qu'il interroge avant de prendre chaque décision, sans cesse branché sur son smartphone ou sa tablette, immortalisant sur les réseaux sociaux chaque moment de sa vie susceptible de lui rapporter des "likes". Une vie virtuelle, par procuration, presque plus importante à ses yeux que sa vie IRL.
Les voilà donc en route pour Mendoza, Vadim au volant du 4x4, et une ambiance particulière dans cet habitacle. Comme si chacun vivait dans son propre monde, s'abîmait dans ses propres pensées et qu'il ne pouvait les partager avec les autres. Quatre univers distincts sans aucune intersection, quatre vies qui se sépareront naturellement lorsqu'ils seront arrivés à l'aéroport.
Dans ce décor somptueux, près de la Lagune du Diamant et du volcan Maipo qui la surplombe, dans ce désert qui ne semble pas avoir de limite, Vadim se laisse emporter par ses rêveries, griser par la vitesse. Et soudaine, une ornière, une courbe, un dévers, il n'en sait rien, il perd le contrôle du véhicule qui sort de la piste et part en tonneaux...
L'accident est très spectaculaire, très violent... La voiture est complètement détruite et, à l'intérieur, les passagers ont souffert. A des degrés divers. Et les voilà mal en point, au milieu de nulle part, le long d'une route très peu fréquentée, avec ce soleil, objet de toutes leurs attentions habituellement, qui pourrait devenir un problème supplémentaire...
Comment vont-ils réagir dans cette extraordinaire situation ?
Il nous faut parler de Mathilda, la cinquième protagoniste de ce roman, malgré elle. A près de 60 ans, elle a envoyé balader sa vie en Afrique du Sud, sa famille, un mari, des enfants, son métier de chirurgien-dentiste qui lui sortait par les yeux. Du jour au lendemain, elle a tout plaqué et s'est envolée pour l'Alaska.
Et de là, elle s'est lancée dans une incroyable aventure : rejoindre le point le plus haut sud du continent américain, au fin fond de la Terre de Feu, équipée seulement d'un vélo... Pourquoi ce défi qui semble surhumain ? Elle ne saurait sans doute même pas l'expliquer, il s'agissait juste de se fixer un but dans l'existence...
Voilà comment, ce matin-là, Mathilda s'est retrouvé sur une route argentine, entre Mendoza et Malargüe, en direction du sud. Voilà comment, ce matin-là, elle a croisé la voiture conduisant Vadim, Alexandre, Wolfgang et Simon à l'aéroport, sans savoir ce qui allait se passer quelques instants plus tard, sans prêter une grande attention à ce véhicule.
Ce contact uniquement visuel a duré quelques secondes à peine, le temps pour la cycliste de regarder passer le 4x4 et de se retrouver enveloppé par un nuage de poussière, le temps pour les passagers de la voiture de remarquer cette femme, dont la présence en pleine pampa leur a semblé certes incongrue, mais qu'ils ont vite oubliée ensuite...
Pourtant, cette fugace rencontre va influer sur le destin des uns et des autres, sans même qu'ils en aient conscience. Exactement comme les rayons du soleil viennent nous réchauffer, et on poursuit ce que l'on est en train de faire, et exactement comme d'innombrables autres particules dont nous ignorons tout viennent nous frapper, parfois sans effet, et parfois avec des conséquences...
Une sorte d'effet papillon à l'échelle de l'infiniment petit... Et une réflexion sur ces particules d'humanité que nous nous échangeons sans en avoir conscience et qui, dans la plus parfaite discrétion, changent nos existences, parfois pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Parce que les relations entre les êtres n'ont pas besoin d'être visibles pour bousculer nos destins...
Après les voyages au long cours et les souvenirs des quatre coins du monde qui étaient au coeur du "Goût du large", Nicolas Delesalle nous invite à une lecture très différente, car, même si le cadre de la pampa argentine est majestueux et dépaysant à souhait, il est l'unique cadre de cette histoire. Et, d'une certaine manière, entre la voiture et cette piste interminable et très peu fréquentée, on est proche du huis clos.
En effet, nos personnages sont livrés à eux-mêmes et ne peuvent compter que sur leur sang froid, leur bon sens. Peut-être aussi sur leur chance, même si, dans de telles circonstances, on hésite à l'évoquer... De leurs réactions dépendra la suite de leur existence, une existence qui va, de toute manière, changer de trajectoire après les événements de ce jour.
De même, l'unité de temps : quelques secondes pour que se noue le drame, façon "les Choses de la vie", une journée pour que l'action se déroule. C'est à la fois long, vous comprendrez pourquoi, et court, à l'échelle de nos existences et plus encore, à celle du temps. Tout est relatif, on y revient sans cesse, à ce constat...
Entre les êtres humains et ces particules gorgées d'énergie qu'étudient les scientifiques de l'observatoire Pierre-Auger, le parallèle est alors saisissant. Nous aussi sommes porteurs d'une énergie qui influe, consciemment ou non, sur ceux que nous rencontrons, par hasard ou non, ou que nous croisons simplement.
Au coeur de cette nature sauvage, imposante, mais qui peut vite se montrer hostile, ces personnes vont toucher à l'essentiel. Les préoccupations qu'ils ressassaient pendant ce voyage vont s'envoler et ils vont se rendre compte de la fragilité de l'existence, de ce qui la rend précieuse et de ce qu'il faut savoir apprécier.
| La Laguna del Diamante et le volcan Maipo. |
Comme le pense Simon, "il faut se montrer plus modeste, accepter l'évidence et arrêter de vivre plus haut que son cul". Bon, c'est formulé de manière un peu brusque, ça colle parfaitement au jeune journaliste, il faudrait sans doute imaginer des variantes plus... modérées pour les autres, mais c'est valable pour tous, y compris Mathilda.
L'homme n'est pas le centre de l'univers, faut-il encore le rappeler ? Pour ces hommes, le rappel est brutal, sept tonneaux, si je ne me trompe pas... Dans leur comportement, il y a de l'égocentrisme et de l'égoïsme, aussi, à différents degrés. En tout cas, on est bien loin de leurs recherches scientifiques, si profondes, pointues, excitantes. Et même, à leur façon, poétiques.
Chacun, mais ils ne sont pas les seuls, nous sommes tous comme cela, est le soleil de son propre système, une existence qui tourne autour de soi, comme les planètes. Voilà ce qui nous préoccupe principalement, une vision à courte vue à l'échelle de l'univers. Et c'est ce qui nous fait oublier de nous préoccuper des autres, sauf circonstances exceptionnelles.
Chaque personnage de ce roman a une personnalité bien marquée, sensiblement différente de celles des autres, des goûts, des aspirations, des ambitions, des regards différents. En fait, chacun a sa vision du monde, sa philosophie de l'existence, mais une seule vie, fugace, brève, trop pour ne pas en faire quelque chose d'autre qu'un jouet qu'on ne garde que pour soi.
L'altruisme, le désintéressement, des valeurs qui ont tendance à s'effacer dans nos sociétés modernes, sont au coeur de cette histoire. Mais, pour en arriver là, il faut qu'ils se révèlent, et pour cela, il faut que ces êtres soient frappés par ces particules d'humanité à haute énergie, renforcées par d'intenses émotions, encore une fois selon un large spectre.
Il y a beaucoup à apprendre de ce roman, pour le lecteur, qui n'est pas au coeur des événements, mais seulement le témoin. Pour nous aussi, comme pour Vadim, Alexandre, Wolfgang, Simon et Mathilda, cette lecture a des conséquences, doit avoir des conséquences. Nous aussi sommes frappés par ces particules d'humanité émises par ce qui se passe sur cette piste argentine.
Nicolas Delesalle nous met face à nos responsabilités, face à nos existences, face à notre indifférence quotidienne, et nous demande de tirer les enseignements pour notre propre vie, sans avoir à passer par un drame, un choc, une révélation tragique ou existentielle. Oui, à nous d'influer sur nos propres trajectoires, sur celle des particules que nous émettons et qui iront en irradier d'autres, et ainsi de suite...
On passe au cours de cette lecture par de nombreux états d'esprit, du rire aux larmes, selon la formule consacrée. Certains des personnages ont un côté tragique, au contraire d'un Simon, qui incarne le ressort comique (léger, le comique, mais qui apporte un peu de légèreté dans ces moments terribles). On constate les dégâts, on s'inquiète pour eux, on craint le pire...
Quant à Mathilda, je me suis longtemps interrogé à son sujet. Sur ses choix radicaux, sur ce ras-le-bol qui l'a poussée à prendre ses distances et à tout envoyer valser, à se libérer d'un quotidien trop monotone... Que venait-elle faire dans cette histoire ? Elle ne ressemble pas aux autres, à ces quatre hommes enfermés dans leur grosse voiture.
Au contraire des hommes, noyés dans leur quotidien, elle a rejeté son existence, elle a choisi de fuir sa vie. Elle est en quête d'un absolu qui, pour les autres personnages, se limite à leur vie professionnelle. Elle est en quête de quelque chose, un accomplissement, peut-être, dont elle ignore ce qu'il est exactement.
Elle incarne une forme de résilience, d'acceptation de soi. Elle est en quête d'estime de soi, alors qu'elle entre dans la dernière partie de son existence. Pardon d'évoquer son âge, mais c'est sa croix. Ce vieillissement est l'un des éléments qui la minent, son adversaire, c'est le temps, qui avance, inexorable, qui la broie et qui l'érode, à la fois...
Cinq visions du monde et de l'existence, et tant d'autres encore. Cinq destins qui se jouent en quelques instants. Et la confrontation du rêve et de la réalité. Le rêve, quand l'homme relève la tête vers les étoiles, et la plus brillante d'entre elle. La réalité qui enferme, inhibe, écrase, et dont il faut aussi chercher à se libérer...
lundi 15 janvier 2018
"Et une chose était claire : si partir était une grande opportunité, ceux qui restaient étaient des nuls".
L'adolescence est un sujet inépuisable pour la littérature, et sous différents angles. Voici un roman italien qui se penche de façon très habile, mais aussi très dérangeante, sur le mal-être d'un groupe d'ados originaires de la région milanaise et sur les réponses qu'ils y apportent. Avec "Manquent à l'appel" (en grand format aux éditions Liana Levi ; traduction de Marianne Faurobert), Giorgio Scianna traite avec un regard très contemporain, plein d'empathie, mais aussi d'inquiétude, un sujet finalement très classique. Si la construction narrative de ce roman (qui ne facilite pas la tâche de celui qui veut en parler) lui donne un côté roman noir très marqué, il y a en filigrane un regard politique acéré et critique envers une société qui ne prend pas assez soin de sa jeunesse, des forces vives qui seront son avenir... Et cette dimension-là ne vaut pas uniquement pour l'Italie, mais pour l'ensemble des pays occidentaux.
En ce jour de rentrée des classes, quatre sièges restent vide dans une salle de ce lycée proche de Milan. Quatre places qui devraient, normalement, être occupées par les quatre garçons de la classe, majoritairement féminine. Aucun de ces jeunes n'est donc présents, ils ont disparu depuis le mois de juillet, sans aucune explication et laissant leurs familles dans l'angoisse.
Ils s'appellent Anto, Roberto, Ivan et Lorenzo et, depuis leur plus jeune âge, ils sont inséparables. Ils étaient même cinq, mais Simone, le dernier membre de la bande, a quitté l'Italie pour poursuivre ses études en Angleterre, première fissure parmi ces inséparables. Et puis, l'été est arrivé, et les quatre adolescents ont mis les voiles.
Depuis, silence radio, les téléphones portables sonnent dans le vide et les parents sont aux cent coups. La vie de ces famille ne tournent plus qu'autour de ces incertitudes, ces craintes, leur emploi du temps comprend des rendez-vous réguliers au commissariat ou au tribunal, et de douloureuses réunions où tous se retrouvent avec l'espoir de voir les fugueurs revenir.
Vivre sans rien savoir, en imaginant les pires situations, en échafaudant les hypothèses les plus terrifiantes, c'est usant. La tension est forte, et c'est toute la ville qui ressent l'inquiétude des parents. Les autres élèves de la classe sont obnubilées par la situation et les cours se finissent bien souvent en sessions de questions-réponses avec des enseignants, eux aussi impuissants et dépassés...
Une situation qui n'évolue guère jusqu'à un soir de novembre où, à la surprise générale, l'un des garçons rentre au bercail. Il s'appelle Lorenzo et il ne veut rien dire de ce qu'il a vécu ces derniers mois. Enfin, plus exactement, il ne parle pas aux autorités, à ses parents et à ceux de ses amis, à ses camarades de classe... Il ne parle à personne, sauf au lecteur, puisqu'il est le principal narrateur du livre.
Mais ne croyez pas pour autant qu'il va tout vous déballer tout de suite sur les tribulations de son groupe d'amis, non, il va tout de même falloir lui laisser un peu de temps. Ou que ce produise un déclic. Il va arriver, ce déclic, mais pas un déclic heureux, hélas. Alors, il ne peut plus garder pour lui ce qu'il sait et se livre à nous.
Tout en conservant soigneusement les secrets qui unissent ces quatre garçons sans repère...
Qu'il est difficile de parler de ce livre sans trop en dévoiler ! Soyons franc, dans la suite de ce billet, il est fort probable qu'on aborde des aspects du livre et de l'intrigue qui révèlent quelques points clés. Mais, difficile de faire complètement l'impasse sur ces questions centrales et ce qu'elles soulèvent en termes de réflexion.
Je me permets de le faire d'autant plus tranquillement que la quatrième de couverture aussi donne certains éléments qui n'apparaissent pas tout de suite lorsqu'on lit le livre. Alors, allons-y, parlons de ce "Manquent à l'appel" et de ce climat lourd, oppressant, qui entoure la disparition de ces garçons, dans un premier temps, le retour de Lorenzo ensuite...
Où sont-ils, c'est le premier réflexe que le lecteur a devant cette histoire. On est d'abord aussi désemparé que les parents, aussi déboussolé que leurs amis et leurs profs... S'agit-il d'une fugue ? Ou bien de quelque chose de bien plus terrible, encore. Des rentrées scolaires qui se déroulent sous de tels auspices, hélas, il y en a, et trop souvent. Mais cela ne rend pas le malaise moins palpable.
Et puis, les premières informations apparaissent et, aussitôt, on commence à sentir où va nous mener cette histoire. Pourtant, là encore, difficile d'être tout de suite dans cette optique, les signes avants-coureurs n'existent pas, en tout cas, personne ne les a remarqués. Mais bon, personne n'a pressenti que ces jeunes gens allaient disparaître...
L'indice est géographique, et la direction prise par le groupe de quatre mène dans un coin du monde certes renommé pour son tourisme, mais pas uniquement... Car, depuis la Grèce, et selon des témoignages très sûrs, ils sont passés en Turquie. Mais ensuite, on perd définitivement leur trace et l'on ne peut plus faire que des hypothèses.
Allez, mettons les pieds dans le plat : Grèce, Turquie... Et si la suite logique, c'était la Syrie ? L'idée fait grincer des dents, d'autant qu'à aucun moment, on ne parle de religion, dans le livre. Sous quelque forme que ce soit. S'ils ont suivi ce chemin, on voit mal de quelle manière ils auraient pu se radicaliser, comme on dit.
Alors, qu'en est-il ? Plus on avance dans le récit, dans les confidences de Lorenzo lorsque, enfin, il lâche quelques informations, et plus tout cela devient inquiétant, flippant. Absurde, surtout. Ajoutez à cela l'attitude de celui qui est revenu, renfermé, dur, la boule à zéro... Ce n'est plus le même garçon qu'avant sa disparition. Il a changé... Grandi ou mûri ? Rien n'est moins sûr...
"Manquent à l'appel", un récit sur la radicalisation d'un groupe d'ados sans histoire ? Oui, plus ça va, plus l'hypothèse gagne en crédibilité. A condition qu'on se mette d'accord sur ce terme de radicalisation. Et c'est certainement cette question qui fait le plus froid dans le dos quand on referme le roman de Giorgio Scianna...
Oh, bien sûr, il aurait pu aller dans le sens du courant, donner une version italienne de la mini-série britannique "The State" ou réfléchir sur le basculement vers une idéologie mortifère de garçons que rien ne prédisposaient à devenir des fondamentalistes religieux en graine, comme le fit Bessora, avec "le Testament de Nicolas".
Dans une Europe ébranlée par le terrorisme, qui se replie sur elle-même et se méfie jusqu'au rejet de ceux qui fuient les guerres et les persécutions sur d'autres continents, le sujet reste extrêmement sensible et, on peut le comprendre, plutôt romanesque. Utiliser la fiction pour essayer de comprendre, pour décortiquer une mécanique, c'est classique.
Mais, Giorgio Scianna n'a pas non plus choisi cette optique, il prend une voie différente et elle n'est pas plus rassurante. Elle pourrait presque m'effrayer plus encore, d'ailleurs. Religion et idéologie ne sont pas en cause dans le choix des quatre garçons de quitter leurs familles et de tout laisser derrière eux sans se retourner.
Le mal-être adolescent est bien au coeur de ce roman. Un mal-être qui se caractérise par une espèce de vide effrayant. Un sentiment, qu'il soit justifié ou non, d'ailleurs, qu'il n'y a pas d'avenir dans le monde qui est le leur, qu'on ne leur propose aucune perspective, qu'on les livre à l'inconnu, qu'on ne leur fournit ni les repères ni les armes nécessaires pour progresser dans leur existence, dans la société dont ils sont issus.
Le départ de Simone, qui peut sembler anodin a priori, est à mes yeux l'élément clé de toute l'histoire. Son départ pour l'Angleterre est un paradoxe : il ne l'a pas décidé par lui-même, c'est son père qui décide pour lui et contrôle son destin, mais, dans le même temps, cela lui ouvre des perspectives dont ne bénéficient pas les autres, enracinés peut-être à jamais dans ce coin d'Italie...
Et eux, comment voient-ils leur avenir ? Avec si peu de certitude, si peu d'envie... Ils arrivent à l'heure des choix qui décideront, peut-être, de ce que sera leur vie d'adulte et... rien, ou si peu. En tout cas, pas de projet construit, comme des gamins qui rêveraient d'être pompiers ou vétérinaires. Un vide qui laisse une profonde angoisse existentielle.
Le départ de ces gamins, c'est leur réponse à ce vide. Vous verrez que cette réponse est complètement folle, absurde, presque délirante. L'immaturité de ces adolescents sautent soudain aux yeux et elle fait mal : comment des parents, mais aussi une société peut se montrer aussi incapable de prendre soin de sa jeunesse, de lui inculquer des bases solides pour les amener à des choix aussi irrationnels ?
Dans une brève conclusion, après la fin du roman, l'auteur explique comment lui est venue l'idée de cette histoire et, en quelques lignes, il fait comprendre son incompréhension, son incrédulité, mais aussi sa révolte. Car, et il est évident qu'il a raison sur ce point, ces enfants sont des victimes. Comme la plupart de ceux qui prennent le chemin de la Syrie, qu'il s'agisse ou non d'un embrigadement.
Giorgio Scianna insiste sur la puissance de nuisance d'internet dans ce domaine, quelque chose qui, à mon avis, a toujours été largement sous-estimé. On préfère évoquer les lieux de culte, les prisons, des lieux bien concrets, facilement identifiables, mais qui font aussi de belles cibles électoralistes. Mais le virtuel, avec sa puissance quasi hypnotique, on l'oublie sans cesse.
En lisant "Manquent à l'appel", j'ai ressenti un vrai malaise, moi aussi. Comme l'auteur, je peine à comprendre le raisonnement de ces jeunes. Et, d'une certaine manière, le dénouement du livre renforce cette incompréhension. Leur quête est tout à fait normale, saine, même, mais les réponses qu'ils y apportent, elles, sont à côté de la plaque !
C'est facile à dire depuis mon canapé, moi qui ne suis plus un ado depuis longtemps, qui ne suis pas père de famille, qui ne suis pas un homme politique, un décideur... Reste que Giorgio Scianna mériterait qu'on l'écoute attentivement, parce qu'il touche un point extrêmement sensible avec ce roman, un point qu'on laissera certainement de côté parce qu'il donne moins prise aux polémiques et aux scandales.
Mais c'est aussi un symptôme fort d'un mal profond, qui touche une, des générations, mais qui ronge plus certainement encore nos sociétés occidentales et nos modes de vie désormais incapables de générer de l'espoir, de la passion, de l'enthousiasme, du plaisir, de faire briller les yeux des gamins autrement qu'en leur promettant un statut de star de la chanson ou du sport...
A ce point, un mot du titre original, qui n'a pas été conservé dans la version française, mais qu'on retrouve tout de même sur la couverture : "la regola dei pesci", traduit dans le livre par "la loi des poissons". Tout est là : accepter de suivre docilement le ban là où son instinct, le mouvement, les courants, mais pas sa volonté, le mènent, ou alors, chercher à sortir du rang, à imprimer sa propre trajectoire, à fonder son propre ban qui, lui, suivrait un but précis...
Oui, j'ai ressenti un malaise qui m'a rappelé celui qui m'étreignait lorsque j'ai vu "Elephant", le film de Gus Van Sandt, et plus encore quand j'ai lu "Il faut qu'on parle de Kevin", l'extraordinaire roman de Lionel Shriver. Deux références qui ont d'ailleurs un sujet commun, une autre réponse tout aussi déroutante et angoissante au mal-être adolescent.
Je termine en évoquant une autre Palme d'Or cannoise. En quatrième de couverture de "Manquent à l'appel", on dit qu'un projet d'adaptation cinématographique est envisagé en Italie. Je n'en sais pas plus, mais je trouverais extraordinaire qu'un réalisateur de la trempe de Nanni Moretti prenne en charge ce projet.
Je garde un souvenir bouleversé de "la Chambre du fils", histoire où la famille tient une place centrale, mais dans des circonstances qui l'amènent près de l'implosion. Or, il y a aussi de ça, dans "Manquent à l'appel" : comment ressouder ce qui ne l'est plus ? Comment gérer ce besoin de fuite que ressentent ces garçons, leur rejet du creuset dans lequel ils ont été formés ?
Bon, je me suis un peu écarté du roman avec ces références qui valent ce qu'elles valent. Reste que ce court roman italien (moins de 200 pages et qui se lisent d'une traite) mérite qu'on s'y intéresse, à la fois pour ces quatre personnages et ce qui leur arrive, pour leur persévérance et leur totale déconnexion de la réalité.
Pour l'atmosphère, lourde, pesante, que renforce le choix de Giorgio Scianna de dévoiler au compte-gouttes les motivations de ces jeunes, ainsi que ce qui leur est arrivé au cours de ces mois de fugue. Sans oublier ce pacte qui les unit et qu'ils se refusent à rompre. Je dois dire que la tension est nourrie par ce qu'on imagine, ce qu'on redoute à ce sujet.
Et qu'on ne dise pas que cela retombe comme un soufflé, non, c'est justement ce côté dérisoire des choses qui est le plus effrayant et qui devrait nous questionner plus profondément encore. Parce que ces gamins ne sont pas des monstres, parce que leur ambition n'est pas mortifère, mais, aussi bizarre que cela puisse paraître, elle est porteuse de vie...
En ce jour de rentrée des classes, quatre sièges restent vide dans une salle de ce lycée proche de Milan. Quatre places qui devraient, normalement, être occupées par les quatre garçons de la classe, majoritairement féminine. Aucun de ces jeunes n'est donc présents, ils ont disparu depuis le mois de juillet, sans aucune explication et laissant leurs familles dans l'angoisse.
Ils s'appellent Anto, Roberto, Ivan et Lorenzo et, depuis leur plus jeune âge, ils sont inséparables. Ils étaient même cinq, mais Simone, le dernier membre de la bande, a quitté l'Italie pour poursuivre ses études en Angleterre, première fissure parmi ces inséparables. Et puis, l'été est arrivé, et les quatre adolescents ont mis les voiles.
Depuis, silence radio, les téléphones portables sonnent dans le vide et les parents sont aux cent coups. La vie de ces famille ne tournent plus qu'autour de ces incertitudes, ces craintes, leur emploi du temps comprend des rendez-vous réguliers au commissariat ou au tribunal, et de douloureuses réunions où tous se retrouvent avec l'espoir de voir les fugueurs revenir.
Vivre sans rien savoir, en imaginant les pires situations, en échafaudant les hypothèses les plus terrifiantes, c'est usant. La tension est forte, et c'est toute la ville qui ressent l'inquiétude des parents. Les autres élèves de la classe sont obnubilées par la situation et les cours se finissent bien souvent en sessions de questions-réponses avec des enseignants, eux aussi impuissants et dépassés...
Une situation qui n'évolue guère jusqu'à un soir de novembre où, à la surprise générale, l'un des garçons rentre au bercail. Il s'appelle Lorenzo et il ne veut rien dire de ce qu'il a vécu ces derniers mois. Enfin, plus exactement, il ne parle pas aux autorités, à ses parents et à ceux de ses amis, à ses camarades de classe... Il ne parle à personne, sauf au lecteur, puisqu'il est le principal narrateur du livre.
Mais ne croyez pas pour autant qu'il va tout vous déballer tout de suite sur les tribulations de son groupe d'amis, non, il va tout de même falloir lui laisser un peu de temps. Ou que ce produise un déclic. Il va arriver, ce déclic, mais pas un déclic heureux, hélas. Alors, il ne peut plus garder pour lui ce qu'il sait et se livre à nous.
Tout en conservant soigneusement les secrets qui unissent ces quatre garçons sans repère...
Qu'il est difficile de parler de ce livre sans trop en dévoiler ! Soyons franc, dans la suite de ce billet, il est fort probable qu'on aborde des aspects du livre et de l'intrigue qui révèlent quelques points clés. Mais, difficile de faire complètement l'impasse sur ces questions centrales et ce qu'elles soulèvent en termes de réflexion.
Je me permets de le faire d'autant plus tranquillement que la quatrième de couverture aussi donne certains éléments qui n'apparaissent pas tout de suite lorsqu'on lit le livre. Alors, allons-y, parlons de ce "Manquent à l'appel" et de ce climat lourd, oppressant, qui entoure la disparition de ces garçons, dans un premier temps, le retour de Lorenzo ensuite...
Où sont-ils, c'est le premier réflexe que le lecteur a devant cette histoire. On est d'abord aussi désemparé que les parents, aussi déboussolé que leurs amis et leurs profs... S'agit-il d'une fugue ? Ou bien de quelque chose de bien plus terrible, encore. Des rentrées scolaires qui se déroulent sous de tels auspices, hélas, il y en a, et trop souvent. Mais cela ne rend pas le malaise moins palpable.
Et puis, les premières informations apparaissent et, aussitôt, on commence à sentir où va nous mener cette histoire. Pourtant, là encore, difficile d'être tout de suite dans cette optique, les signes avants-coureurs n'existent pas, en tout cas, personne ne les a remarqués. Mais bon, personne n'a pressenti que ces jeunes gens allaient disparaître...
L'indice est géographique, et la direction prise par le groupe de quatre mène dans un coin du monde certes renommé pour son tourisme, mais pas uniquement... Car, depuis la Grèce, et selon des témoignages très sûrs, ils sont passés en Turquie. Mais ensuite, on perd définitivement leur trace et l'on ne peut plus faire que des hypothèses.
Allez, mettons les pieds dans le plat : Grèce, Turquie... Et si la suite logique, c'était la Syrie ? L'idée fait grincer des dents, d'autant qu'à aucun moment, on ne parle de religion, dans le livre. Sous quelque forme que ce soit. S'ils ont suivi ce chemin, on voit mal de quelle manière ils auraient pu se radicaliser, comme on dit.
Alors, qu'en est-il ? Plus on avance dans le récit, dans les confidences de Lorenzo lorsque, enfin, il lâche quelques informations, et plus tout cela devient inquiétant, flippant. Absurde, surtout. Ajoutez à cela l'attitude de celui qui est revenu, renfermé, dur, la boule à zéro... Ce n'est plus le même garçon qu'avant sa disparition. Il a changé... Grandi ou mûri ? Rien n'est moins sûr...
"Manquent à l'appel", un récit sur la radicalisation d'un groupe d'ados sans histoire ? Oui, plus ça va, plus l'hypothèse gagne en crédibilité. A condition qu'on se mette d'accord sur ce terme de radicalisation. Et c'est certainement cette question qui fait le plus froid dans le dos quand on referme le roman de Giorgio Scianna...
Oh, bien sûr, il aurait pu aller dans le sens du courant, donner une version italienne de la mini-série britannique "The State" ou réfléchir sur le basculement vers une idéologie mortifère de garçons que rien ne prédisposaient à devenir des fondamentalistes religieux en graine, comme le fit Bessora, avec "le Testament de Nicolas".
Dans une Europe ébranlée par le terrorisme, qui se replie sur elle-même et se méfie jusqu'au rejet de ceux qui fuient les guerres et les persécutions sur d'autres continents, le sujet reste extrêmement sensible et, on peut le comprendre, plutôt romanesque. Utiliser la fiction pour essayer de comprendre, pour décortiquer une mécanique, c'est classique.
Mais, Giorgio Scianna n'a pas non plus choisi cette optique, il prend une voie différente et elle n'est pas plus rassurante. Elle pourrait presque m'effrayer plus encore, d'ailleurs. Religion et idéologie ne sont pas en cause dans le choix des quatre garçons de quitter leurs familles et de tout laisser derrière eux sans se retourner.
Le mal-être adolescent est bien au coeur de ce roman. Un mal-être qui se caractérise par une espèce de vide effrayant. Un sentiment, qu'il soit justifié ou non, d'ailleurs, qu'il n'y a pas d'avenir dans le monde qui est le leur, qu'on ne leur propose aucune perspective, qu'on les livre à l'inconnu, qu'on ne leur fournit ni les repères ni les armes nécessaires pour progresser dans leur existence, dans la société dont ils sont issus.
Le départ de Simone, qui peut sembler anodin a priori, est à mes yeux l'élément clé de toute l'histoire. Son départ pour l'Angleterre est un paradoxe : il ne l'a pas décidé par lui-même, c'est son père qui décide pour lui et contrôle son destin, mais, dans le même temps, cela lui ouvre des perspectives dont ne bénéficient pas les autres, enracinés peut-être à jamais dans ce coin d'Italie...
Et eux, comment voient-ils leur avenir ? Avec si peu de certitude, si peu d'envie... Ils arrivent à l'heure des choix qui décideront, peut-être, de ce que sera leur vie d'adulte et... rien, ou si peu. En tout cas, pas de projet construit, comme des gamins qui rêveraient d'être pompiers ou vétérinaires. Un vide qui laisse une profonde angoisse existentielle.
Le départ de ces gamins, c'est leur réponse à ce vide. Vous verrez que cette réponse est complètement folle, absurde, presque délirante. L'immaturité de ces adolescents sautent soudain aux yeux et elle fait mal : comment des parents, mais aussi une société peut se montrer aussi incapable de prendre soin de sa jeunesse, de lui inculquer des bases solides pour les amener à des choix aussi irrationnels ?
Dans une brève conclusion, après la fin du roman, l'auteur explique comment lui est venue l'idée de cette histoire et, en quelques lignes, il fait comprendre son incompréhension, son incrédulité, mais aussi sa révolte. Car, et il est évident qu'il a raison sur ce point, ces enfants sont des victimes. Comme la plupart de ceux qui prennent le chemin de la Syrie, qu'il s'agisse ou non d'un embrigadement.
Giorgio Scianna insiste sur la puissance de nuisance d'internet dans ce domaine, quelque chose qui, à mon avis, a toujours été largement sous-estimé. On préfère évoquer les lieux de culte, les prisons, des lieux bien concrets, facilement identifiables, mais qui font aussi de belles cibles électoralistes. Mais le virtuel, avec sa puissance quasi hypnotique, on l'oublie sans cesse.
En lisant "Manquent à l'appel", j'ai ressenti un vrai malaise, moi aussi. Comme l'auteur, je peine à comprendre le raisonnement de ces jeunes. Et, d'une certaine manière, le dénouement du livre renforce cette incompréhension. Leur quête est tout à fait normale, saine, même, mais les réponses qu'ils y apportent, elles, sont à côté de la plaque !
C'est facile à dire depuis mon canapé, moi qui ne suis plus un ado depuis longtemps, qui ne suis pas père de famille, qui ne suis pas un homme politique, un décideur... Reste que Giorgio Scianna mériterait qu'on l'écoute attentivement, parce qu'il touche un point extrêmement sensible avec ce roman, un point qu'on laissera certainement de côté parce qu'il donne moins prise aux polémiques et aux scandales.
Mais c'est aussi un symptôme fort d'un mal profond, qui touche une, des générations, mais qui ronge plus certainement encore nos sociétés occidentales et nos modes de vie désormais incapables de générer de l'espoir, de la passion, de l'enthousiasme, du plaisir, de faire briller les yeux des gamins autrement qu'en leur promettant un statut de star de la chanson ou du sport...
A ce point, un mot du titre original, qui n'a pas été conservé dans la version française, mais qu'on retrouve tout de même sur la couverture : "la regola dei pesci", traduit dans le livre par "la loi des poissons". Tout est là : accepter de suivre docilement le ban là où son instinct, le mouvement, les courants, mais pas sa volonté, le mènent, ou alors, chercher à sortir du rang, à imprimer sa propre trajectoire, à fonder son propre ban qui, lui, suivrait un but précis...
Oui, j'ai ressenti un malaise qui m'a rappelé celui qui m'étreignait lorsque j'ai vu "Elephant", le film de Gus Van Sandt, et plus encore quand j'ai lu "Il faut qu'on parle de Kevin", l'extraordinaire roman de Lionel Shriver. Deux références qui ont d'ailleurs un sujet commun, une autre réponse tout aussi déroutante et angoissante au mal-être adolescent.
Je termine en évoquant une autre Palme d'Or cannoise. En quatrième de couverture de "Manquent à l'appel", on dit qu'un projet d'adaptation cinématographique est envisagé en Italie. Je n'en sais pas plus, mais je trouverais extraordinaire qu'un réalisateur de la trempe de Nanni Moretti prenne en charge ce projet.
Je garde un souvenir bouleversé de "la Chambre du fils", histoire où la famille tient une place centrale, mais dans des circonstances qui l'amènent près de l'implosion. Or, il y a aussi de ça, dans "Manquent à l'appel" : comment ressouder ce qui ne l'est plus ? Comment gérer ce besoin de fuite que ressentent ces garçons, leur rejet du creuset dans lequel ils ont été formés ?
Bon, je me suis un peu écarté du roman avec ces références qui valent ce qu'elles valent. Reste que ce court roman italien (moins de 200 pages et qui se lisent d'une traite) mérite qu'on s'y intéresse, à la fois pour ces quatre personnages et ce qui leur arrive, pour leur persévérance et leur totale déconnexion de la réalité.
Pour l'atmosphère, lourde, pesante, que renforce le choix de Giorgio Scianna de dévoiler au compte-gouttes les motivations de ces jeunes, ainsi que ce qui leur est arrivé au cours de ces mois de fugue. Sans oublier ce pacte qui les unit et qu'ils se refusent à rompre. Je dois dire que la tension est nourrie par ce qu'on imagine, ce qu'on redoute à ce sujet.
Et qu'on ne dise pas que cela retombe comme un soufflé, non, c'est justement ce côté dérisoire des choses qui est le plus effrayant et qui devrait nous questionner plus profondément encore. Parce que ces gamins ne sont pas des monstres, parce que leur ambition n'est pas mortifère, mais, aussi bizarre que cela puisse paraître, elle est porteuse de vie...
Inscription à :
Articles (Atom)