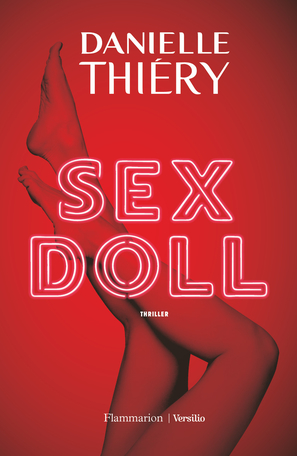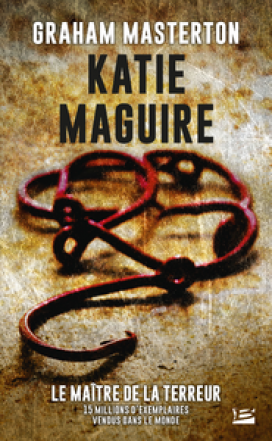Le slogan n'est pas mal, mais ce qui se cache derrière fait nettement moins envie, croyez-moi. Voici un polar français signé par une romancière qui sait de quoi elle parle, puisqu'elle a été commissaire divisionnaire avant d'entamer une carrière d'écrivain. Et il est certain qu'on retrouve forcément un peu (beaucoup ?) de Danielle Thiéry dans Edwige Marion, sa commissaire de papier et d'encre. Je précise que "Sex Doll", co-édité en grand format par Flammarion et Versilio, dont nous allons parler dans ce billet, n'est pas la première enquête du commissaire Marion, mais c'est la première que je lis. Il faut dire que le point de départ de cette intrigue a de quoi éveiller la curiosité : le développement, dans le sillage du Japon, de maisons closes assez particulières, puisque elles hébergent... des poupées de silicone, qui se veulent des répliques parfaites d'êtres humains. Ah, la perfection... Vous savez ce qu'on en dit : elle n'existe pas ! Vraiment ?
Martin Brand est un jeune chef d'entreprise plein d'ambition, une sorte de start-upper pour reprendre un vocable très à la mode, le pur produit d'une école de commerce qui imagine déjà tout le profit qu'il va pouvoir tirer d'un investissement avisé grâce à un "business plan" impeccable et une stratégie commerciale audacieuse.
Bon, dit plus clairement, il est sûr d'avoir trouvé un créneau super original qui va faire un carton en très peu de temps, porté par le buzz, et aussi un parfum de scandale bienvenu... Ainsi a-t-il ouvert rue de Nemours, dans le 11e arrondissement de Paris, le XDoll, le premier établissement d'une nouvelle génération de bordels ouvert en France.
Au XDoll, on ne met pas à la disposition des clients des êtres humains, mais des poupées. Pas les banales poupées gonflables, non, des poupées ayant l'apparence la plus proche possible d'un être humain. Visuellement, mais aussi au toucher, grâce au silicone, une matière bien plus agréable que le vulgaire caoutchouc...
Mais, si Brand est un hommes d'affaires, il n'est pas un maquereau. Aucune étude de marché, aucune courbe prévisionnelle, aucun savoir théorique ne l'a préparé à devenir tenancier de maison close... Et surtout, à gérer une clientèle sensiblement différente de celles des commerces plus... traditionnels... Tout cela lui met les nerfs à vif...
Cerise sur le gâteau, ce client qui lui a laissé une de ses poupées dans un état ! Un vrai massacre ! C'est un fou furieux, ce mec-là, même s'il vaut mieux qu'il ait fait ça à une sex doll qu'à un être de chair et de sang, mais quand même... Il va lui falloir faire disparaître tout ça, et il ne parle même pas de ce que ça va lui coûter !
En partant, outre une poupée dans un état irrécupérable, le client cinglé a laissé derrière lui ce qui semble être un numéro de téléphone. Lorsque Brand compose le numéro, il tombe sur une femme à qui il ne sait pas quoi dire, jusqu'à ce qu'elle lui apprenne qu'elle est de la police. Affolé, Brand raccroche aussitôt...
La police, il y a un contacte de confiance, à la brigade de répression du proxénétisme, son interlocuteur naturel, en quelque sorte. Un capitaine, Albert Fréguin, un flic à l'ancienne, comme on en fait plus. On le croirait sorti d'un film noir, et peut-être même pas en couleurs, avec le surnom qui va bien : l'Elégant. Et lui, il saura quoi faire.
Ce même vendredi soir, la commissaire Edwige Marion est encore à son bureau. Elle dirige L'Office, ou de son appellation complète, l'Office de répression des violences aux personnes. Les dossiers s'accumulent autour d'elle, difficile de savoir par où commencer. Il va lui falloir se concentrer, et ce n'est pas ce bizarre appel téléphonique qui va l'aider.
Bah, le gêneur lui a élégamment raccroché au nez sans rien lui dire d'intéressant, elle peut donc se replonger dans la paperasse. Mais le téléphone sonne encore, et cette fois, c'est du sérieux. La nouvelle qu'elle redoutait. Doublement. On lui annonce qu'un meurtre a été commis, assorti d'un message adressé à quelqu'un que connaît la commissaire Marion...
C'est en effet le mode opératoire d'un tueur en série qui a déjà frappé plusieurs fois dans Paris, avec un mode opératoire très particulier, qui abandonne ses victimes à des endroits fort évocateurs et qui joue avec les nerfs de la commissaire en lui envoyant des messages par le biais de proches. Et cette fois, c'est quelqu'un de très proche... De trop proche...
Il devient urgent de trouver une piste pour mettre ce tueur hors d'état de nuire. La commissaire Marion compte sur l'aide et l'analyse d'Alix de Clavery, une psycho-criminologue. Retrouvailles sur une scène de crime sordide, on a trouvé mieux pour commencer le weekend... Mais Edwige Marion n'est pas au bout de ses surprises, car peu après, Alix de Clavery s'évapore mystérieusement...
Pas facile de respecter la construction du début de ce roman, très éclatée, pas facile non plus de donner des explications, mais pas trop de détails, de choisir ce qu'il faut mettre en avant et ce qu'il faut vous laisser découvrir. Mais l'essentiel est là, où presque, pour le reste, c'est à vous de jouer, enfin à vous de lire.
Evacuons tout de suite une question, disons, pratique : "Sex Doll" est loin d'être la première enquête mettant en scène la commissaire Edwige Marion, que dans le roman on appelle d'ailleurs le plus souvent Marion. C'est même une série déjà conséquente, près d'une quinzaine de titres, ce qui peut poser quelques petits soucis au lecteur qui entre dans la série par ce tome.
Ces problèmes ne concernent pas, comme souvent, l'intrigue centrale, qui est indépendante et compréhensible sans nécessité de tout connaître de la série, mais plutôt ce qui entoure tout ça. Autrement dit, les liens entre les personnages, leurs relations et leur passé, qui ne va pas être répété, et c'est heureux, à chaque tome.
Pour prendre l'exemple de "Sex Doll", la relation entre Edwige Marion et sa fille, Nina. On comprend les choses, on n'est pas complètement largué, bien sûr, mais il manque des éléments implicites, qui seraient compréhensibles naturellement si on avait lu les précédents tomes. Je sais qu'il y a des lecteurs qui sont très sensibles à ces aspects, qu'ils commencent donc la série par le début !
Refermons la parenthèse, et intéressons-nous à ce polar dont le point de départ n'est pas banal : des poupées dédiées au sexe... Nous avions sur ce blog croisé ce genre de poupées, dans "Les corps inutiles", de Delphine Bertholon, où l'usage de ces poupées grandeur nature censés remplacer des êtres humains n'était tout de même pas aussi explicite que dans "Sex Doll".
Ici, il ne s'agit pas de combler des solitudes, mais bel et bien d'une branche nouvelle d'un marché toujours florissant, celui du sexe. Danielle Thiéry n'invente rien, des établissements de ce genre ont ouvert à Paris et au Mans, connaissant des fortunes diverses, d'ailleurs. Autant dire que ce qui arrive à Martin Brand ressemble pas mal à ce qui se passe en réalité : c'est un secteur compliqué !
Reconnaissons tout de même que ce lieu, dans lequel on entre en même temps que dans le roman, puisque les premières scènes s'y déroulent, est surtout un point de départ à cette étrange histoire, qui semble partir dans plusieurs directions différentes. Il va falloir comprendre comment tout ce qui se produit ce vendredi-là peut s'agencer...
C'est Edwige Marion elle-même qui va devoir faire le tri dans tout ça, ou plus exactement y mettre de l'ordre, car elle se retrouve face à plusieurs lièvres, certains appartenant à sa vie professionnelle, d'autres à sa vie personnelle, sans oublier des passerelles qui relient ces deux mondes qu'on imagine en temps normal assez séparés.
On l'a dit : dans le mode opératoire du tueur en série, il y a un élément qui vise depuis le début à provoquer le commissaire Edwige Marion. Des messages laissés à des proches, des connaissances de la commissaire. Sans doute une manière de montrer sa toute-puissance, sa capacité à s'approcher de ces gens, à qui il aurait pu faire on ne sait quoi...
Lorsque pour la première fois, ce sinistre vendredi, c'est sa fille qui est la récipiendaire du message fatidique, sorte de revendication, la commissaire comprend qu'il y a urgence et que tout cela devient trop menaçant. Sans compter les corps de ces femmes que le tueur laisse derrière lui... Et qu'il a mutilées, mais pas uniquement. Comme s'il avait voulu remplacer ce qu'il avait retiré...
Il y a donc un tueur très dangereux dans la nature, qui se moque de la police, la nargue à chacun de ses crimes, et pourrait s'en prendre aux proches de la commissaire... Mais cela comprend-il Alix de Clavery ? Ou bien a-t-elle disparu pour d'autres raisons, impliquant d'autres personnes ? Cela ouvre un second front à un moment bien peu propice...
Il y aurait bien des choses à dire, en particulier sur les premières apparitions d'Alix dans "Sex Doll", car il faut reconnaître qu'on s'interroge aussitôt, et que ces questions vont forcément durer un moment... C'est le jeu du polar, mon brave lecteur ! En ce qui me concerne, c'est un aspect du roman qui m'a laissé un peu dubitatif. Ca m'a paru un peu tiré par les cheveux et pas forcément utile...
"Sex Doll" est un roman où il est question de beauté, d'une beauté parfaite, jusqu'à l'artifice, jusqu'à la folie... Il y a quelque chose de très étrange, mais aussi de très inquiétant dans le contexte du livre. A commencer par ces poupées, je ne me place pas sur un plan moral, attention, mais parce que cela a quelque chose de glauque, de triste... De pathétique.
Il y a une course, et "Sex Doll" n'est pas le seul roman à aborder ces questions, c'est aussi un sujet de science-fiction, souvent en lien avec les questionnements autour des intelligences artificielles, pour parvenir à créer des représentations les plus fidèles possibles de l'être humain. Et comme souvent, cela se fait en appliquant des canons très précis, qui sont paradoxalement bien peu réalistes...
Mais cette quête de perfection, ici, va encore au-delà de ça. Comme une quête impossible, une inaccessible étoile, l'ultime accomplissement d'un esprit totalement dérangé, une sorte de savant fou qui aurait débarqué dans "la vraie vie" (oui, je sais, c'est un roman, mais on est dans une littérature réaliste), avec une ambition qu'il va falloir comprendre pour mieux l'arrêter...
Cette quête, cette folie, qui devient meurtrière, fait là encore écho à des tendances que Danielle Thiéry n'invente pas. Nous vivons dans une société de l'apparence qui recherche aussi sans cesse cette hypothétique perfection. Instagram ou certaines chaînes Youtube vont dans ce sens, la télé-réalité aussi, avec des émissions de chirurgie esthétique, aux Etats-Unis...
Être beau, même pas parfait, simplement beau, devient un objectif, presque une raison de vivre, un atout social, une ligne de plus sur un CV, une qualité humaine supérieure à la plupart des autres. Un fonds de commerce, aussi. Eh oui, c'est rentable, d'être beau, très probablement plus que de louer pour quelques instants fugaces de plaisir des poupées grandeur nature...
Pourtant, derrière le parcours sanglant du tueur que poursuit la commissaire Edwige Marion, il y a certainement autre chose. Peut-être même quelque chose de pire, de plus inavouable, de plus immoral... De plus effrayant, aussi... Oui, la beauté, la perfection sont les enjeux de "Sex Doll", mais pas du tout là où on s'y attend.
Un dernier mot sur Paris, décor de ce livre, mais décor choisi. Les lieux dans lesquels se déroulent bon nombre de scènes clés de ce roman ont une signification particulière. Ce sont, pour certains, des endroits étonnants, qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, la scène de crime sur laquelle se rend Marion au début du roman est glaçante une fois qu'on comprend où on se trouve.
Le jeu de piste macabre orchestré par le tueur est plein de surprise. Mais l'enquête va aussi nous entraîner dans un lieu très spécial, glauque à souhait. Dans le roman, Danielle Théry en fait un lieu fictif, sans doute pour s'offrir une marge de manoeuvre romanesque plus importante. Mais, en grattant un peu, on arrive à trouver l'endroit qui l'a inspirée et à découvrir quelques photos sur des sites d'urbex.
Il y a, dans ces lieux abandonnés, quelque chose de très impressionnant, avec ce sentiment que la vie s'y est arrêtée d'un coup, instantanément, comme par magie... Cet endroit est glaçant, et pas seulement en raison de ce qui s'y déroule. C'est un décor d'apocalypse, qui contraste en tous points avec l'idéal de beauté et de perfection dont nous venons de parler, puisque tout y est chaos...
Avec "Sex Doll", j'ai donc découvert et Danielle Thiéry et son alter ego romanesques Edwige Marion. Une expérience intéressante et divertissante qui méritera qu'on y revienne. Qu'il s'agisse des prochaines enquêtes, ou de plus anciennes. D'autant que le passé, et je n'en dirai pas plus, tient aussi un rôle important dans ce livre...
Et peut-être au-delà de cet épisode de la série...
"Il va falloir un jour qu'enfin je me décide à lire les livres que, depuis trente ans, je conseille à mes amis de lire". (Sacha Guitry)
jeudi 29 août 2019
"J'en ai marre qu'on me sous-estime. Qu'on me piétine. Qu'on m'insulte. Je ne suis PAS FAIBLE. Je suis REDOUTABLE. Mentalement et physiquement. Il n'y a pas plus puissant que moi".
Le polar se féminise et c'est une excellente nouvelle. Je ne parle pas des écrivains de polar, mais des personnages : de plus en plus de séries mettent en scène des héroïnes, des femmes flics à des postes et des fonctions importantes et qui sont tout aussi douées que leurs homologues masculins. Ce blog vous a déjà proposé quelques exemples ces derniers jours, en voici un nouveau, avec la deuxième enquête de la DCI Erika Foster, imaginée par Robert Bryndza. Après une arrivée mouvementée à Londres dans "La Fille sous la glace", il va encore lui falloir donner de son temps et de sa personne pour comprendre une série de crimes à la mise en scène bien particulière... "Oiseau de nuit" (aux éditions Belfond ; traduction de Chloé Royer) se déroule dans une atmosphère bien différente de la première enquête, avec une DCI Foster qui, petit à petit, trouve sa place, s'impose, mais reste fragile... A elle de s'affirmer, de montrer qu'elle est à sa place, mais pas de la même manière que le tueur qu'elle traque...
Par une soirée de juin chaude et moite jusqu'à en paraître étouffante, Estelle Munro se rend chez son fils, un médecin, dont elle surveille la maison et nourrit le chat en son absence. A l'intérieur, la chaleur est insupportable et l'électricité est coupée. Sans doute les plombs, ce n'est pas la première fois qu'ils sautent quand Gregory n'est pas là.
Estelle remet le courant, découvrant, un peu surprise, que le disjoncteur principal avait été volontairement débranché. Mais, le plus étrange, c'est l'odeur bizarre qu'elle sent, lorsque la clim se remet en marche... Une puanteur qui vient manifestement de l'étage et que la vieille dame ne parvient pas à identifier.
Jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte de la chambre de son fils...
La DCI Erika Foster est appelée sur place, alors qu'elle dîne chez Isaac Strong, le légiste. Ca tombe bien, ils se rendent ensemble à l'adresse du docteur Gregroy Munro, où il découvre le cadavre d'un homme allongé sur un lit. Il est nu, ses poignets sont attachés à la tête de lit et un sac plastique couvre son visage... Sa mère l'a reconnu avant de se trouver mal : c'est bien son fils.
Médecin généraliste, connu et apprécié dans son quartier, récemment séparé de son épouse, Gregory Munro est donc mort dans des conditions un peu... particulières. Si la première impression laisse penser à un jeu sexuel qui aurait mal tourné (volontairement ou non, cela reste à déterminer), il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions.
Car certains détails ne collent pas, d'autres indices pourraient indiquer que le Dr Munro avait quelques secrets, y compris pour sa mère... Et puis, il y a de possibles traces d'infraction... Rapidement, l'idée que Gregory Munro était homosexuel et qu'il a été tué pour cette raison apparaît comme une évidence pour la plupart des enquêteurs. Avec les préjugés qui vont avec...
Mais Erika Foster n'est pas d'accord avec cette interprétation trop hâtive de la scène de crime. Ou du moins, elle voudrait avoir des éléments plus substantiels pour parvenir à cette conclusion. Quant à son supérieur, le superintendant Marsh, il est déjà dans tous ses états : un crime homophobe dans un quartier résidentiel, c'est le scandale assuré, le buzz, la une partout, le truc ingérable...
Tandis que Erika et son équipe, Moss et Peterson, qui sont aussi ses deux principaux alliés depuis sont retour délicat à Londres quelques mois auparavant, essaye de dresser le portrait de Gregory Munro et que rien ne colle avec ce qu'ils ont découvert chez lui sur la scène de crime, un événement va changer radicalement la donne.
Jack Hart est une célébrité. Un animateur de talk show, émue de Jerry Springer, dont l'émission quotidienne à la télé fait régulièrement parlé d'elle. Pardon, "faisait"... Car si Hart va faire la une cette fois, ce n'est pas pour une énième provocation grotesque, mais parce qu'il est mort. On l'a retrouvé sur son lit et, à quelques détails près, cette nouvelle scène de crime ressemble à celle du Dr Munro...
Pour Marsh, qui ne craignait rien plus que l'effervescence médiatique, voilà la pire des nouvelles ! Une victime médiatique et sulfureuse, une scène de crime choquante, une situation qui va forcément devenir une intarissable source de ragots... Et des paparazzi près à toutes les acrobaties (et accessoirement les délits) pour obtenir un scoop...
Pour cette nouvelle enquête (qui date un peu, oui, je sais, j'ai plein de retard, mais je rattrape, je rattrape, et la nouvelle nouvelle enquête arrive dans quelques jours), Erika Foster va donc devoir traquer ce qui semble bien être un tueur en série. Oui, mais voilà, s'il y a un mode opératoire apparemment commun, la victimologie, elle, paraît sans queue ni tête.
Et comme vous l'aurez compris, les conditions particulières de ces crimes ne vont pas faciliter l'enquête, en tout cas la sérénité nécessaire à sa conduite. Une nouvelle fois, Erika Foster doit faire face à des pressions dont elle n'a que faire, mais qui pourraient lui coûter cher. La DCI a des comptes à rendre, même si cela ne correspond pas vraiment à son côté électron libre.
Dans "La Fille sous la glace", Erika Foster revenait aux affaires après un drame personnel. Sa mutation à Londres s'était passé difficilement, la jeune femme doutait beaucoup d'elle-même, souffrant encore beaucoup d'un traumatisme récent, l'accueil qu'on lui avait réservé n'était guère rassurant et ses méthodes pas franchement appréciées...
Dans "Oiseau de nuit", la situation a évolué, mais on ne va pas dire qu'elle est encore parfaite. La douleur s'atténue, Erika Foster a retrouvé un certain équilibre dans sa vie personnelle, mais aussi professionnelle. Cela reste fragile, elle est encore assez isolée, comptant ses amis, dont Isaac Strong, sur les doigts d'une main, mais elle a gagné en confiance de la part de ses collègues.
La relation avec le superintendant Marsh connaît des hauts et des bas. Elle est un flic de terrain, dont le seul objectif est de mener des enquêtes, de découvrir la vérité et d'arrêter les coupables. Tout le reste, la gestion du temps, des médias, des politiques, ce n'est pas son problème, mais celui de Marsh, et ces deux visions sont forcément incompatibles.
On le voit d'ailleurs très vite dans "Oiseau de nuit", lorsque Erika revient de la maison du Dr Munro. Marsh a lu les premiers rapports et son opinion est déjà faite : crime de haine à caractère homophobe... Mais, derrière ces mots, ce qui semble l'ennuyer plus particulièrement, c'est le ramdam que tout cela va entraîner, et non le sens de ces mots...
Erika n'est pas sur la même longueur d'ondes. D'abord parce que l'empathie fait partie de son métier, mais aussi parce qu'elle n'est pas du tout persuadée que le meurtre du Dr Munro soit effectivement un crime homophobe... Elle l'a d'ailleurs clairement indiqué dans son, mais cela a visiblement échappé à Marsh lorsqu'il l'a lu (s'il l'a lu)...
Pour Erika, le temps est une ressource indispensable pour mener à bien une enquête. Mais, ce temps est conditionné au contexte, au bruit que fait l'affaire, aux ordres que reçoit Marsh... A chaque nouveau crime, le délai se réduit, alors qu'au contraire, il faudrait plus de temps pour recouper les indices et les témoignages. Situation insoluble...
Il va falloir du flegme et de la ténacité pour réussir à découvrir le fin mot de cette affaire. Et aussi quelques risques, mais Erika Foster devient coutumière du fait... Parce que les apparences sont toujours trompeuses, les préjugés aveuglent et les certitudes empêchent de réfléchir. Autant d'obstacles qui nuisent au travail des policiers...
Entre les deux premières enquêtes de Robert Bryndza, un autre élément change, et du tout au tout : le climat. Dans "La Fille sous la glace", l'hiver glacial jouait un rôle important, pour "Oiseau de nuit", c'est cette canicule interminable et arrivée très tôt cet été-là, qui ne facilitent pas les choses. C'est pénible, épuisant et ça aliment la nervosité...
Je n'ai pas encore évoqué la construction du roman, il faut le faire, sans trop entrer dans le détail. L'enquête menée par Erika Foster n'est pas le seul fil que l'on suit. Apparaissent des conversations en ligne, dans lesquelles on découvre le pseudo "Night Owl", qui va donner son titre à la version française du roman.
Et puis, il y a un autre fil narratif que je signale sans en dire plus. Tout simplement parce qu'il arrive sans qu'on sache comment l'interpréter et quel sera sa finalité. Je la laisse donc dans l'ombre, et vous verrez par vous-mêmes comment tout cela s'agencera, comment chaque élément va se placer au coeur de l'intrigue principale.
J'ai évoqué le titre français, mais le titre original apporte d'autres éléments : "the night stalker". Ce dernier mot, les habitués d'internet le connaissent, puisqu'il est entré dans le jargon, c'est un harceleur. Il y a dans "Oiseau de nuit" une dimension voyeuriste très importante, qu'on pourrait rapprocher de pas mal de films d'Alfred Hitchcock ou Brian de Palma.
Il y a ce qu'on montre et ce qu'on cache. Il y a ce qu'on perçoit et il y a ce qu'on déniche lorsqu'on observe d'un peu plus près... Lorsque les policiers découvrent la première scène de crime, Erika Foster a l'impression de passer à côté de quelque chose. L'enquête de personnalité ne donne pas grand-chose, en tout cas rien de très pertinent.
Se pourrait-il que l'assassin connaisse mieux sa victime, ses victimes, que tout leur entourage ou bien ce mode opératoire n'est-il qu'une affreuse mise en scène, chargée de mettre les enquêteurs sur de fausses pistes, tout en choquant les bien-pensants ? Oui, il y a ce qu'on voit, ce qu'on nous donne à voir et la vérité... Et tout ça ne coïncide pas toujours...
Dernier point que je voulais aborder, c'est une espèce de petit jeu à l'intérieur du livre, un clin d'oeil que Robert Bryndza fait à son personnage, Erika Foster, en la mettant en scène dans un jeu de miroirs taquin. Isaac Strong, le médecin légiste, sans doute le meilleur ami d'Erika Foster, peut-être le seul, en fait, vit en couple avec un écrivain, Stephen Linley.
Ce dernier est l'auteur d'une série de polar mettant en scène le DCI Bartholomew, "un anti-héros, un génie imparfait", dit Stephen, un personnage "plus complexe et plus intéressant" que Erika Foster, et vlan ! Autour de cette série dans la série, se met en place un parallèle entre Foster et Bartholomew, que semble surtout séparer le mépris avec lequel Stephen considère Erika...
En retour, les livres de Linley font l'objet de critiques acerbes, en particulier sur son écriture apparemment très complaisante envers la violence. Des descriptions détaillées de ce que subissent les victimes, comme s'il y prenait un certain plaisir... Re-vlan, mais dans l'autre sens, cette fois, comme un retour de manivelle...
Le jeu se poursuit avec les titres des romans de Linley, qui font penser à ceux de Bryndza (vous me suivez toujours ?) en une espèce de mise en abyme qui peut, de prime abord, paraître anecdotique, mais va jouer un rôle dans cette histoire, en particulier dans l'influence que cela va avoir sur le lecteur. Cet aspect-là m'a amusé et m'a planté, aussi !
"Oiseau de nuit" est un polar sur la vanité, qui nous anime tous dans notre société de l'image, où chacun peut, grâce aux réseaux sociaux, se mettre en avant, avec plus ou moins de succès. C'est une réflexion sur la notoriété, parfois trompeuse ou construite sur des bases malsaines, et sur le quart d'heure de gloire warholien.
C'est une deuxième enquête qui confirme que cette série est à suivre, pour qui aime le polar anglais. Robert Bryndza ne révolutionne pas le genre, mais il trace son sillon à travers ce personnage attachant d'Erika Foster, si douée pour débusquer les meurtriers, mais si décalée dans ce monde, esseulée et peinant à trouver sa place.
Confirmation de tout cela dans quelques jours, puisque les éditions Belfond annoncent la parution de la troisième enquête de la DCI Erika Foster pour le début du mois de septembre. Cela va s'appeler "Liquide inflammable" et la quatrième de couverture laisse envisager une nouvelle histoire difficile, dans laquelle Erika Foster va s'impliquer... Peut-être trop... Affaire à suivre !
Par une soirée de juin chaude et moite jusqu'à en paraître étouffante, Estelle Munro se rend chez son fils, un médecin, dont elle surveille la maison et nourrit le chat en son absence. A l'intérieur, la chaleur est insupportable et l'électricité est coupée. Sans doute les plombs, ce n'est pas la première fois qu'ils sautent quand Gregory n'est pas là.
Estelle remet le courant, découvrant, un peu surprise, que le disjoncteur principal avait été volontairement débranché. Mais, le plus étrange, c'est l'odeur bizarre qu'elle sent, lorsque la clim se remet en marche... Une puanteur qui vient manifestement de l'étage et que la vieille dame ne parvient pas à identifier.
Jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte de la chambre de son fils...
La DCI Erika Foster est appelée sur place, alors qu'elle dîne chez Isaac Strong, le légiste. Ca tombe bien, ils se rendent ensemble à l'adresse du docteur Gregroy Munro, où il découvre le cadavre d'un homme allongé sur un lit. Il est nu, ses poignets sont attachés à la tête de lit et un sac plastique couvre son visage... Sa mère l'a reconnu avant de se trouver mal : c'est bien son fils.
Médecin généraliste, connu et apprécié dans son quartier, récemment séparé de son épouse, Gregory Munro est donc mort dans des conditions un peu... particulières. Si la première impression laisse penser à un jeu sexuel qui aurait mal tourné (volontairement ou non, cela reste à déterminer), il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions.
Car certains détails ne collent pas, d'autres indices pourraient indiquer que le Dr Munro avait quelques secrets, y compris pour sa mère... Et puis, il y a de possibles traces d'infraction... Rapidement, l'idée que Gregory Munro était homosexuel et qu'il a été tué pour cette raison apparaît comme une évidence pour la plupart des enquêteurs. Avec les préjugés qui vont avec...
Mais Erika Foster n'est pas d'accord avec cette interprétation trop hâtive de la scène de crime. Ou du moins, elle voudrait avoir des éléments plus substantiels pour parvenir à cette conclusion. Quant à son supérieur, le superintendant Marsh, il est déjà dans tous ses états : un crime homophobe dans un quartier résidentiel, c'est le scandale assuré, le buzz, la une partout, le truc ingérable...
Tandis que Erika et son équipe, Moss et Peterson, qui sont aussi ses deux principaux alliés depuis sont retour délicat à Londres quelques mois auparavant, essaye de dresser le portrait de Gregory Munro et que rien ne colle avec ce qu'ils ont découvert chez lui sur la scène de crime, un événement va changer radicalement la donne.
Jack Hart est une célébrité. Un animateur de talk show, émue de Jerry Springer, dont l'émission quotidienne à la télé fait régulièrement parlé d'elle. Pardon, "faisait"... Car si Hart va faire la une cette fois, ce n'est pas pour une énième provocation grotesque, mais parce qu'il est mort. On l'a retrouvé sur son lit et, à quelques détails près, cette nouvelle scène de crime ressemble à celle du Dr Munro...
Pour Marsh, qui ne craignait rien plus que l'effervescence médiatique, voilà la pire des nouvelles ! Une victime médiatique et sulfureuse, une scène de crime choquante, une situation qui va forcément devenir une intarissable source de ragots... Et des paparazzi près à toutes les acrobaties (et accessoirement les délits) pour obtenir un scoop...
Pour cette nouvelle enquête (qui date un peu, oui, je sais, j'ai plein de retard, mais je rattrape, je rattrape, et la nouvelle nouvelle enquête arrive dans quelques jours), Erika Foster va donc devoir traquer ce qui semble bien être un tueur en série. Oui, mais voilà, s'il y a un mode opératoire apparemment commun, la victimologie, elle, paraît sans queue ni tête.
Et comme vous l'aurez compris, les conditions particulières de ces crimes ne vont pas faciliter l'enquête, en tout cas la sérénité nécessaire à sa conduite. Une nouvelle fois, Erika Foster doit faire face à des pressions dont elle n'a que faire, mais qui pourraient lui coûter cher. La DCI a des comptes à rendre, même si cela ne correspond pas vraiment à son côté électron libre.
Dans "La Fille sous la glace", Erika Foster revenait aux affaires après un drame personnel. Sa mutation à Londres s'était passé difficilement, la jeune femme doutait beaucoup d'elle-même, souffrant encore beaucoup d'un traumatisme récent, l'accueil qu'on lui avait réservé n'était guère rassurant et ses méthodes pas franchement appréciées...
Dans "Oiseau de nuit", la situation a évolué, mais on ne va pas dire qu'elle est encore parfaite. La douleur s'atténue, Erika Foster a retrouvé un certain équilibre dans sa vie personnelle, mais aussi professionnelle. Cela reste fragile, elle est encore assez isolée, comptant ses amis, dont Isaac Strong, sur les doigts d'une main, mais elle a gagné en confiance de la part de ses collègues.
La relation avec le superintendant Marsh connaît des hauts et des bas. Elle est un flic de terrain, dont le seul objectif est de mener des enquêtes, de découvrir la vérité et d'arrêter les coupables. Tout le reste, la gestion du temps, des médias, des politiques, ce n'est pas son problème, mais celui de Marsh, et ces deux visions sont forcément incompatibles.
On le voit d'ailleurs très vite dans "Oiseau de nuit", lorsque Erika revient de la maison du Dr Munro. Marsh a lu les premiers rapports et son opinion est déjà faite : crime de haine à caractère homophobe... Mais, derrière ces mots, ce qui semble l'ennuyer plus particulièrement, c'est le ramdam que tout cela va entraîner, et non le sens de ces mots...
Erika n'est pas sur la même longueur d'ondes. D'abord parce que l'empathie fait partie de son métier, mais aussi parce qu'elle n'est pas du tout persuadée que le meurtre du Dr Munro soit effectivement un crime homophobe... Elle l'a d'ailleurs clairement indiqué dans son, mais cela a visiblement échappé à Marsh lorsqu'il l'a lu (s'il l'a lu)...
Pour Erika, le temps est une ressource indispensable pour mener à bien une enquête. Mais, ce temps est conditionné au contexte, au bruit que fait l'affaire, aux ordres que reçoit Marsh... A chaque nouveau crime, le délai se réduit, alors qu'au contraire, il faudrait plus de temps pour recouper les indices et les témoignages. Situation insoluble...
Il va falloir du flegme et de la ténacité pour réussir à découvrir le fin mot de cette affaire. Et aussi quelques risques, mais Erika Foster devient coutumière du fait... Parce que les apparences sont toujours trompeuses, les préjugés aveuglent et les certitudes empêchent de réfléchir. Autant d'obstacles qui nuisent au travail des policiers...
Entre les deux premières enquêtes de Robert Bryndza, un autre élément change, et du tout au tout : le climat. Dans "La Fille sous la glace", l'hiver glacial jouait un rôle important, pour "Oiseau de nuit", c'est cette canicule interminable et arrivée très tôt cet été-là, qui ne facilitent pas les choses. C'est pénible, épuisant et ça aliment la nervosité...
Je n'ai pas encore évoqué la construction du roman, il faut le faire, sans trop entrer dans le détail. L'enquête menée par Erika Foster n'est pas le seul fil que l'on suit. Apparaissent des conversations en ligne, dans lesquelles on découvre le pseudo "Night Owl", qui va donner son titre à la version française du roman.
Et puis, il y a un autre fil narratif que je signale sans en dire plus. Tout simplement parce qu'il arrive sans qu'on sache comment l'interpréter et quel sera sa finalité. Je la laisse donc dans l'ombre, et vous verrez par vous-mêmes comment tout cela s'agencera, comment chaque élément va se placer au coeur de l'intrigue principale.
J'ai évoqué le titre français, mais le titre original apporte d'autres éléments : "the night stalker". Ce dernier mot, les habitués d'internet le connaissent, puisqu'il est entré dans le jargon, c'est un harceleur. Il y a dans "Oiseau de nuit" une dimension voyeuriste très importante, qu'on pourrait rapprocher de pas mal de films d'Alfred Hitchcock ou Brian de Palma.
Il y a ce qu'on montre et ce qu'on cache. Il y a ce qu'on perçoit et il y a ce qu'on déniche lorsqu'on observe d'un peu plus près... Lorsque les policiers découvrent la première scène de crime, Erika Foster a l'impression de passer à côté de quelque chose. L'enquête de personnalité ne donne pas grand-chose, en tout cas rien de très pertinent.
Se pourrait-il que l'assassin connaisse mieux sa victime, ses victimes, que tout leur entourage ou bien ce mode opératoire n'est-il qu'une affreuse mise en scène, chargée de mettre les enquêteurs sur de fausses pistes, tout en choquant les bien-pensants ? Oui, il y a ce qu'on voit, ce qu'on nous donne à voir et la vérité... Et tout ça ne coïncide pas toujours...
Dernier point que je voulais aborder, c'est une espèce de petit jeu à l'intérieur du livre, un clin d'oeil que Robert Bryndza fait à son personnage, Erika Foster, en la mettant en scène dans un jeu de miroirs taquin. Isaac Strong, le médecin légiste, sans doute le meilleur ami d'Erika Foster, peut-être le seul, en fait, vit en couple avec un écrivain, Stephen Linley.
Ce dernier est l'auteur d'une série de polar mettant en scène le DCI Bartholomew, "un anti-héros, un génie imparfait", dit Stephen, un personnage "plus complexe et plus intéressant" que Erika Foster, et vlan ! Autour de cette série dans la série, se met en place un parallèle entre Foster et Bartholomew, que semble surtout séparer le mépris avec lequel Stephen considère Erika...
En retour, les livres de Linley font l'objet de critiques acerbes, en particulier sur son écriture apparemment très complaisante envers la violence. Des descriptions détaillées de ce que subissent les victimes, comme s'il y prenait un certain plaisir... Re-vlan, mais dans l'autre sens, cette fois, comme un retour de manivelle...
Le jeu se poursuit avec les titres des romans de Linley, qui font penser à ceux de Bryndza (vous me suivez toujours ?) en une espèce de mise en abyme qui peut, de prime abord, paraître anecdotique, mais va jouer un rôle dans cette histoire, en particulier dans l'influence que cela va avoir sur le lecteur. Cet aspect-là m'a amusé et m'a planté, aussi !
"Oiseau de nuit" est un polar sur la vanité, qui nous anime tous dans notre société de l'image, où chacun peut, grâce aux réseaux sociaux, se mettre en avant, avec plus ou moins de succès. C'est une réflexion sur la notoriété, parfois trompeuse ou construite sur des bases malsaines, et sur le quart d'heure de gloire warholien.
C'est une deuxième enquête qui confirme que cette série est à suivre, pour qui aime le polar anglais. Robert Bryndza ne révolutionne pas le genre, mais il trace son sillon à travers ce personnage attachant d'Erika Foster, si douée pour débusquer les meurtriers, mais si décalée dans ce monde, esseulée et peinant à trouver sa place.
Confirmation de tout cela dans quelques jours, puisque les éditions Belfond annoncent la parution de la troisième enquête de la DCI Erika Foster pour le début du mois de septembre. Cela va s'appeler "Liquide inflammable" et la quatrième de couverture laisse envisager une nouvelle histoire difficile, dans laquelle Erika Foster va s'impliquer... Peut-être trop... Affaire à suivre !
mercredi 28 août 2019
"On ne peut faire confiance à personne. Ils racontent tous des bobards, tous autant qu'ils sont. Il y a Eux et il y a Nous. Eux, ils sont là pour Nous embobiner et Nous faire du mal. Ceux qui ne sont pas Nous sont contre Nous".
Après le sud de l'Irlande, le nord de l'île, après le comté de Cork, la province d'Ulster, après Cobh, Belfast... On passe la frontière pour un polar très différent de ce que l'on a vu avec "Katie Maguire". Mais une enquête tendue, douloureuse, poignante, beaucoup plus intimiste, avec les secrets et les non-dits du passé qui resurgissent, tandis que le présent est loin d'être stable et tranquille. Première enquête de la DCI Serena Flanagan, "Ceux que nous avons abandonnés", de Stuart Neville (en grand format aux éditions Rivages ; traduction de Fabienne Duvigneau) est un roman riche en émotion, une tragédie lancée de manière inexorable dont on redoute la fin, dont on redoute aussi le fin mot... Une histoire portée par deux duos : le premier est féminin, avec Serena Fmanagan et la psy Paula Cunningham ; le second est masculin, les frères Devine, fratrie fusionnelle, abîmée, mais aussi terriblement ambiguë...
Paula Cunningham est psy et travaille pour le service d'insertion et de probation à Belfast. Elle est même l'un des meilleurs éléments de ce service, ce qui explique qu'on lui confie un dossier dont elle se serait bien passée si elle avait eu le choix : s'occuper de Ciaran (prononcez Kironne) Devine, qui doit être libéré après 7 années derrière les barreaux.
Les années ont passé, mais l'affaire défraie encore et toujours la chronique, au point que les journaux font leur une sur cette libération. Il faut dire que le cas de Ciaran Devine est loin d'être ordinaire. Le genre de fait divers dont le public parle longtemps et qui alimente les chroniques judiciaires et les émissions spécialisées.
Ciaran n'avait que 12 ans quand il a été condamné pour avoir tué son beau-père. Il a avoué son crime lors d'un interrogatoire mené à l'époque par Serena Flanagan et ce sont en grande partie ces aveux qui ont motivé la condamnation de ce garçon frêle, timide, perdu... Absolument pas le profil d'un assassin, même par vengeance. Même pour faire payer des maltraitances.
Âgé de 19 ans désormais, il va retrouver la vie à l'extérieur, une existence dont il ignore tout, ou à peu près, et qui va donc nécessiter un encadrement. Il est encore trop tôt pour confier Ciaran à son frère aîné, Thomas, lui aussi condamné, mais à une peine moins lourde et qui est déjà sorti de prison. Il est surtout trop tôt pour ne pas garder un oeil attentif sur lui.
Paula Cunningham, qui fait ce boulot depuis 12 ans, sait parfaitement que le retour au monde réel est loin d'être simple, y compris pour des adultes. Mais pour Ciaran, elle craint vraiment ce retour dans la société, car le garçon n'a pas pu acquérir ces dernières années la maturité nécessaire pour l'appréhender en adulte et se réinsérer aisément.
Ajoutons à cela que la justice a refusé aux deux frères le droit de changer d'identité pour reprendre leur vie dans l'anonymat. Il est donc à craindre que les journalistes traquent Ciaran un moment, ce qui n'arrangera sûrement pas son retour à l'air libre. Et risque de copieusement énerver Thomas, qui pourrait se dresser en protecteur de son petit frère.
Bref, cette mission de confiance est une galère sans nom pour Paula Cunningham, qui va essayer de s'en acquitter de son mieux, évidemment, mais avec une petite angoisse. Une réelle inquiétude pour ce môme, lourdement puni. Sa première mission sera d'aller le chercher à la prison, de régler les questions administratives et de le conduire au foyer où il passera sa première nuit d'homme libre.
Au même moment, Serena Flanagan fait son retour au commissariat de Lisburn, au sud-ouest de Belfast. Retour, car elle a dû quitter ses fonctions pendant plusieurs mois pour soigner un cancer du sein. Après une radiothérapie, elle est bien décidée à reprendre son poste au plus vite et à retrouver le stress et l'excitation du quotidien de flic.
Si elle a eu le temps de se faire (mais pas de s'habituer) au regard des autres, à cette pitié et cette bonne volonté pleine de maladresse que l'on réserve aux malades, ce qu'elle va découvrir en arrivant à son bureau va lui donner un méchant coup au moral : jusqu'à nouvel ordre, elle est consignée à son bureau pour s'occuper exclusivement de la paperasse...
Pourtant, une visite va se charger de remettre illico Serena dans le grand bain : Paula Cunningham a souhaité rencontrer la DCI (Detective Chief Inspector) pour parler avec elle de Ciaran Devine. La psy sait que c'est Serena qui a obtenu les aveux de l'enfant et que les circonstances de cet interrogatoire ont été particulières.
Et c'est une raison supplémentaire pour elle de s'adresser à Serena. Car Paula doute. Elle doute que les événements se soient déroulés exactement comme l'a avoué Ciaran. Elle doute qu'il soit un assassin, elle doute que toute la vérité ait été faite sur ce drame. Et elle voudrait avoir l'avis de l'inspectrice-chef sur ces questions...
D'emblée, va donc se poser la question de la vérité. Une quête qui va devenir quasiment obsessionnelle pour ces femmes, mas qui va aussi se révéler dangereuse. Non, tout n'a pas été révélé dans cette affaire, et la vérité pourrait être bien plus insupportable et douloureuse que ce qui a été raconté des années auparavant...
D'un côté, deux femmes. D'abord Serena, la policière, fragilisée par la maladie, désarçonnée, ayant besoin de retrouver sa place, son autorité, son rythme de vie et de travail. Depuis les aveux de Ciaran, tout s'est compliqué dans son existence, aussi bien sur le plan privé que professionnel et elle peine à remettre tout en ordre.
Ensuite Paula, la psy, une femme désespérément seule, qui s'accroche à un boulot auquel elle ne croit plus vraiment, si tant est qu'elle y ait jamais cru... Le doute majeur qui l'habite, c'est de se dire qu'elle n'a jamais été utile à personne en 12 années au service de probation. Et là, Ciaran Devine, c'est un énorme morceau. Mais un gamin terriblement touchant, en qui elle ne peut voir un assassin.
Et puis, il y a les frères Devine. Car, s'ils sont séparés par la force des choses depuis des années lorsque s'ouvre le roman, ils sont indissociables l'un de l'autre, inséparables en temps normal. Un duo fusionnel, au point d'en devenir ambigu, et le lecteur s'en rend compte dès le prologue, avec une scène très particulière, qui met d'emblée mal à l'aise.
La relation entre Thomas, l'aîné, et Ciaran, le cadet, est au coeur du roman de Stuart Neville, c'est sans doute là que réside la vérité, que Paula, et Serena dans son sillage, vont se jurer de découvrir. Mais comment entrer dans cette intimité fraternelle, quand on n'appartient pas à la famille, quand les frères voient le monde entier comme un ennemi potentiel. Nous et Eux...
Thomas a quelques années de plus que Ciaran, mais ce n'est pas tout. Il est plus grand, plus fort, plus beau, plus quasiment tout que Ciaran, qu'il protège avec abnégation et non sans une certaine brutalité, quelquefois. Ciaran, c'est un oisillon tombé du nid, timide, largué, introverti, effacé surtout lorsque Thomas est dans les parages.
Petit à petit, on s'interroge sur les rôles respectifs des deux frères, sur l'influence de l'aîné sur le cadet, sur ce qui a pu se passer toutes ces années auparavant... Il semble si peu probable, même pour se venger, même pour se protéger, que Ciaran ait tué, ou ait agi seul pour parvenir à ce résultat. Bref, le lecteur qui observe ces deux personnages, est gagné par le même doute que Paula et Serena...
Je ne connaissais pas Stuart Neville avant d'attaquer la lecture de "Ceux que nous avons abandonnés" (quel titre !), mais j'ai découvert un auteur de polar de grande qualité. Je ne lis pas forcément de romans policier ou de thrillers pour y trouver des émotions aussi fortes que lors de cette lecture. Je ne parle pas du suspense, même s'il existe évidemment dans le livre, mais d'autre chose.
Comment ne pas être touché par Ciaran ? Oui, il a tué, ou plutôt il a été condamné pour cela, mais c'est vraiment un môme déboussolé, sans repère autre que son frère aîné, remis en liberté dans un monde où tout est trop grand, trop difficile pour lui. C'est un inadapté, mais plus à ranger dans la catégorie proie que prédateur...
Et forcément, la quête de vérité dans laquelle vont se lancer Serena et Paula (qui, sans être un personnage secondaire, est tout de même en retrait par rapport à la policière) devient rapidement la nôtre. Et comme elles, on se heurte aux murailles dressées entre eux et le reste du monde par les énigmatiques frères Devine...
"Ceux que nous avons abandonnés" est véritablement un roman sur la vérité, bien plus que sur la justice, par exemple. La justice ne découlera, si l'on démontre qu'elle a mal été rendue sept ans plus tôt, de la vérité et de rien d'autre. Reste à savoir quelle vérité on recherche : Ciaran a-t-il caché des choses ou carrément travesti la réalité ? L'a-t-il fait sciemment ou a-t-il été influencé ?
En parallèle de l'intrigue principale, on va découvrir ce qui s'est passé en mars 2007, par le biais de chapitres en flash-back. Le premier arrive très tôt dans le roman, mais là encore, vous vous doutez bien qu'on ne nous dit pas tout, qu'on nous montre un échantillon de ce qui s'est passé à ce moment-là et que, là aussi, il faudra creuser pour appréhender l'ensemble des faits ayant abouti aux aveux.
Avec une notable différence : si la vérité du crime, qu'il s'agisse de la version officielle ou d'un autre déroulement des faits, n'est connue que des deux frères, il n'en va pas de même pour cette partie interrogatoire. Ciaran est toujours au coeur de cette partie, mais Thomas en est absent, remplacé par Serena Flanagan...
Il y a donc aussi des secrets, des non-dits, peut-être des mensonges, même, qui unissent la DCI au jeune homme. Sans doute faudra-t-il également les percer, les révéler afin de savoir si la condamnation de Ciaran était juste. Si Serena a bien fait son boulot... Autant dire que, dans sa position actuelle, fragile et instable, la DCI Flanagan est sur la sellette...
Dès le début du roman, on sent qu'on plonge dans une histoire très noire, très douloureuse. Et l'on a l'espoir que l'intrigue puisse mener à la lumière, à la résilience. Pourtant, assez vite, les choses se compliquent et on commence à se dire que "Ceux que nous avons abandonnés" a tout d'une tragédie. Que les événements de 2007 sont un premier acte, que la libération de Ciaran ouvre le deuxième...
Il y a dans la mécanique installée par Stuart Neville quelque chose d'inexorable, on voudrait mettre sur pause, dire stop, chercher l'aiguillage qui pourrait conduire les personnages dans une autre direction, mais c'est évidemment impossible : nous sommes des lecteurs, nous ne pouvons influer sur ce que nous lisons...
Alors, on va droit à ce qu'on redoute. On espère se tromper, se dire que la raison peut l'emporter finalement. Le dénouement de ce roman, en plus de suivre un mouvement crescendo, qu'il s'agisse du rythme ou de la montée de la violence, est haletant et bouleversant. Oui, ce dernier mot est fort, mais j'ai été sérieusement remué par cette lecture.
Par la beauté vénéneuse de tout cela, par ce qu'on apprend, ce qu'on découvre, à tous les niveaux, par la solitude qui imprègne toute cette histoire, par Ciaran, encore et toujours lui, magnifique personnage, parce qu'il attire la compassion, l'empathie, et ce, sans rien faire pour cela. Simplement parce qu'il incarne un malheur dont on ne peut que deviner les contours...
Stuart Neville met en scène des personnages proche de la rupture, qui s'appuient les uns sur les autres pour ne pas tomber. Mais que se passe-t-il si l'équilibre se rompt ? On parle de polar pour qualifier "Ceux que nous avons abandonnés", mais il ne serait pas déraisonnable de le qualifier de thriller psychologique, tant les liens entre les quatre principaux personnages sous-tendent tout le reste.
Oui, il y a quelque chose de beau, presque de poétique, en particulier dans cette dernière partie, qui va se dérouler dans un cadre bien précis, donnant à la tragédie en cours une dimension quasiment romantique. Ce final est très visuel, troublant par la violence qui s'en dégage, mais pas uniquement à cause de cela.
J'ai donc découvert Stuart Neville avec ce roman et cela m'a donné envie de poursuivre l'aventure. Non seulement avec Serena Flanagan (une deuxième enquête est déjà publié en anglais, une troisième est semble-t-il programmée), mais aussi avec l'auteur, qui a signé d'autres séries, mais aussi un one-shot sur un sujet très différent, comme "Ratlines".
Mais aucune de ces futures lectures, qu'elles soient proches ou plus lointaines, ne pourront effacer le souvenir de Ciaran, qui pour moi est le personnage majeur de "Ceux que nous avons abandonnés". Parce que son histoire est chaotique avant même qu'on la connaisse toute entière. "La vérité est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde", lit-on dans le roman. En est-on si sûr ?
Paula Cunningham est psy et travaille pour le service d'insertion et de probation à Belfast. Elle est même l'un des meilleurs éléments de ce service, ce qui explique qu'on lui confie un dossier dont elle se serait bien passée si elle avait eu le choix : s'occuper de Ciaran (prononcez Kironne) Devine, qui doit être libéré après 7 années derrière les barreaux.
Les années ont passé, mais l'affaire défraie encore et toujours la chronique, au point que les journaux font leur une sur cette libération. Il faut dire que le cas de Ciaran Devine est loin d'être ordinaire. Le genre de fait divers dont le public parle longtemps et qui alimente les chroniques judiciaires et les émissions spécialisées.
Ciaran n'avait que 12 ans quand il a été condamné pour avoir tué son beau-père. Il a avoué son crime lors d'un interrogatoire mené à l'époque par Serena Flanagan et ce sont en grande partie ces aveux qui ont motivé la condamnation de ce garçon frêle, timide, perdu... Absolument pas le profil d'un assassin, même par vengeance. Même pour faire payer des maltraitances.
Âgé de 19 ans désormais, il va retrouver la vie à l'extérieur, une existence dont il ignore tout, ou à peu près, et qui va donc nécessiter un encadrement. Il est encore trop tôt pour confier Ciaran à son frère aîné, Thomas, lui aussi condamné, mais à une peine moins lourde et qui est déjà sorti de prison. Il est surtout trop tôt pour ne pas garder un oeil attentif sur lui.
Paula Cunningham, qui fait ce boulot depuis 12 ans, sait parfaitement que le retour au monde réel est loin d'être simple, y compris pour des adultes. Mais pour Ciaran, elle craint vraiment ce retour dans la société, car le garçon n'a pas pu acquérir ces dernières années la maturité nécessaire pour l'appréhender en adulte et se réinsérer aisément.
Ajoutons à cela que la justice a refusé aux deux frères le droit de changer d'identité pour reprendre leur vie dans l'anonymat. Il est donc à craindre que les journalistes traquent Ciaran un moment, ce qui n'arrangera sûrement pas son retour à l'air libre. Et risque de copieusement énerver Thomas, qui pourrait se dresser en protecteur de son petit frère.
Bref, cette mission de confiance est une galère sans nom pour Paula Cunningham, qui va essayer de s'en acquitter de son mieux, évidemment, mais avec une petite angoisse. Une réelle inquiétude pour ce môme, lourdement puni. Sa première mission sera d'aller le chercher à la prison, de régler les questions administratives et de le conduire au foyer où il passera sa première nuit d'homme libre.
Au même moment, Serena Flanagan fait son retour au commissariat de Lisburn, au sud-ouest de Belfast. Retour, car elle a dû quitter ses fonctions pendant plusieurs mois pour soigner un cancer du sein. Après une radiothérapie, elle est bien décidée à reprendre son poste au plus vite et à retrouver le stress et l'excitation du quotidien de flic.
Si elle a eu le temps de se faire (mais pas de s'habituer) au regard des autres, à cette pitié et cette bonne volonté pleine de maladresse que l'on réserve aux malades, ce qu'elle va découvrir en arrivant à son bureau va lui donner un méchant coup au moral : jusqu'à nouvel ordre, elle est consignée à son bureau pour s'occuper exclusivement de la paperasse...
Pourtant, une visite va se charger de remettre illico Serena dans le grand bain : Paula Cunningham a souhaité rencontrer la DCI (Detective Chief Inspector) pour parler avec elle de Ciaran Devine. La psy sait que c'est Serena qui a obtenu les aveux de l'enfant et que les circonstances de cet interrogatoire ont été particulières.
Et c'est une raison supplémentaire pour elle de s'adresser à Serena. Car Paula doute. Elle doute que les événements se soient déroulés exactement comme l'a avoué Ciaran. Elle doute qu'il soit un assassin, elle doute que toute la vérité ait été faite sur ce drame. Et elle voudrait avoir l'avis de l'inspectrice-chef sur ces questions...
D'emblée, va donc se poser la question de la vérité. Une quête qui va devenir quasiment obsessionnelle pour ces femmes, mas qui va aussi se révéler dangereuse. Non, tout n'a pas été révélé dans cette affaire, et la vérité pourrait être bien plus insupportable et douloureuse que ce qui a été raconté des années auparavant...
D'un côté, deux femmes. D'abord Serena, la policière, fragilisée par la maladie, désarçonnée, ayant besoin de retrouver sa place, son autorité, son rythme de vie et de travail. Depuis les aveux de Ciaran, tout s'est compliqué dans son existence, aussi bien sur le plan privé que professionnel et elle peine à remettre tout en ordre.
Ensuite Paula, la psy, une femme désespérément seule, qui s'accroche à un boulot auquel elle ne croit plus vraiment, si tant est qu'elle y ait jamais cru... Le doute majeur qui l'habite, c'est de se dire qu'elle n'a jamais été utile à personne en 12 années au service de probation. Et là, Ciaran Devine, c'est un énorme morceau. Mais un gamin terriblement touchant, en qui elle ne peut voir un assassin.
Et puis, il y a les frères Devine. Car, s'ils sont séparés par la force des choses depuis des années lorsque s'ouvre le roman, ils sont indissociables l'un de l'autre, inséparables en temps normal. Un duo fusionnel, au point d'en devenir ambigu, et le lecteur s'en rend compte dès le prologue, avec une scène très particulière, qui met d'emblée mal à l'aise.
La relation entre Thomas, l'aîné, et Ciaran, le cadet, est au coeur du roman de Stuart Neville, c'est sans doute là que réside la vérité, que Paula, et Serena dans son sillage, vont se jurer de découvrir. Mais comment entrer dans cette intimité fraternelle, quand on n'appartient pas à la famille, quand les frères voient le monde entier comme un ennemi potentiel. Nous et Eux...
Thomas a quelques années de plus que Ciaran, mais ce n'est pas tout. Il est plus grand, plus fort, plus beau, plus quasiment tout que Ciaran, qu'il protège avec abnégation et non sans une certaine brutalité, quelquefois. Ciaran, c'est un oisillon tombé du nid, timide, largué, introverti, effacé surtout lorsque Thomas est dans les parages.
Petit à petit, on s'interroge sur les rôles respectifs des deux frères, sur l'influence de l'aîné sur le cadet, sur ce qui a pu se passer toutes ces années auparavant... Il semble si peu probable, même pour se venger, même pour se protéger, que Ciaran ait tué, ou ait agi seul pour parvenir à ce résultat. Bref, le lecteur qui observe ces deux personnages, est gagné par le même doute que Paula et Serena...
Je ne connaissais pas Stuart Neville avant d'attaquer la lecture de "Ceux que nous avons abandonnés" (quel titre !), mais j'ai découvert un auteur de polar de grande qualité. Je ne lis pas forcément de romans policier ou de thrillers pour y trouver des émotions aussi fortes que lors de cette lecture. Je ne parle pas du suspense, même s'il existe évidemment dans le livre, mais d'autre chose.
Comment ne pas être touché par Ciaran ? Oui, il a tué, ou plutôt il a été condamné pour cela, mais c'est vraiment un môme déboussolé, sans repère autre que son frère aîné, remis en liberté dans un monde où tout est trop grand, trop difficile pour lui. C'est un inadapté, mais plus à ranger dans la catégorie proie que prédateur...
Et forcément, la quête de vérité dans laquelle vont se lancer Serena et Paula (qui, sans être un personnage secondaire, est tout de même en retrait par rapport à la policière) devient rapidement la nôtre. Et comme elles, on se heurte aux murailles dressées entre eux et le reste du monde par les énigmatiques frères Devine...
"Ceux que nous avons abandonnés" est véritablement un roman sur la vérité, bien plus que sur la justice, par exemple. La justice ne découlera, si l'on démontre qu'elle a mal été rendue sept ans plus tôt, de la vérité et de rien d'autre. Reste à savoir quelle vérité on recherche : Ciaran a-t-il caché des choses ou carrément travesti la réalité ? L'a-t-il fait sciemment ou a-t-il été influencé ?
En parallèle de l'intrigue principale, on va découvrir ce qui s'est passé en mars 2007, par le biais de chapitres en flash-back. Le premier arrive très tôt dans le roman, mais là encore, vous vous doutez bien qu'on ne nous dit pas tout, qu'on nous montre un échantillon de ce qui s'est passé à ce moment-là et que, là aussi, il faudra creuser pour appréhender l'ensemble des faits ayant abouti aux aveux.
Avec une notable différence : si la vérité du crime, qu'il s'agisse de la version officielle ou d'un autre déroulement des faits, n'est connue que des deux frères, il n'en va pas de même pour cette partie interrogatoire. Ciaran est toujours au coeur de cette partie, mais Thomas en est absent, remplacé par Serena Flanagan...
Il y a donc aussi des secrets, des non-dits, peut-être des mensonges, même, qui unissent la DCI au jeune homme. Sans doute faudra-t-il également les percer, les révéler afin de savoir si la condamnation de Ciaran était juste. Si Serena a bien fait son boulot... Autant dire que, dans sa position actuelle, fragile et instable, la DCI Flanagan est sur la sellette...
Dès le début du roman, on sent qu'on plonge dans une histoire très noire, très douloureuse. Et l'on a l'espoir que l'intrigue puisse mener à la lumière, à la résilience. Pourtant, assez vite, les choses se compliquent et on commence à se dire que "Ceux que nous avons abandonnés" a tout d'une tragédie. Que les événements de 2007 sont un premier acte, que la libération de Ciaran ouvre le deuxième...
Il y a dans la mécanique installée par Stuart Neville quelque chose d'inexorable, on voudrait mettre sur pause, dire stop, chercher l'aiguillage qui pourrait conduire les personnages dans une autre direction, mais c'est évidemment impossible : nous sommes des lecteurs, nous ne pouvons influer sur ce que nous lisons...
Alors, on va droit à ce qu'on redoute. On espère se tromper, se dire que la raison peut l'emporter finalement. Le dénouement de ce roman, en plus de suivre un mouvement crescendo, qu'il s'agisse du rythme ou de la montée de la violence, est haletant et bouleversant. Oui, ce dernier mot est fort, mais j'ai été sérieusement remué par cette lecture.
Par la beauté vénéneuse de tout cela, par ce qu'on apprend, ce qu'on découvre, à tous les niveaux, par la solitude qui imprègne toute cette histoire, par Ciaran, encore et toujours lui, magnifique personnage, parce qu'il attire la compassion, l'empathie, et ce, sans rien faire pour cela. Simplement parce qu'il incarne un malheur dont on ne peut que deviner les contours...
Stuart Neville met en scène des personnages proche de la rupture, qui s'appuient les uns sur les autres pour ne pas tomber. Mais que se passe-t-il si l'équilibre se rompt ? On parle de polar pour qualifier "Ceux que nous avons abandonnés", mais il ne serait pas déraisonnable de le qualifier de thriller psychologique, tant les liens entre les quatre principaux personnages sous-tendent tout le reste.
Oui, il y a quelque chose de beau, presque de poétique, en particulier dans cette dernière partie, qui va se dérouler dans un cadre bien précis, donnant à la tragédie en cours une dimension quasiment romantique. Ce final est très visuel, troublant par la violence qui s'en dégage, mais pas uniquement à cause de cela.
J'ai donc découvert Stuart Neville avec ce roman et cela m'a donné envie de poursuivre l'aventure. Non seulement avec Serena Flanagan (une deuxième enquête est déjà publié en anglais, une troisième est semble-t-il programmée), mais aussi avec l'auteur, qui a signé d'autres séries, mais aussi un one-shot sur un sujet très différent, comme "Ratlines".
Mais aucune de ces futures lectures, qu'elles soient proches ou plus lointaines, ne pourront effacer le souvenir de Ciaran, qui pour moi est le personnage majeur de "Ceux que nous avons abandonnés". Parce que son histoire est chaotique avant même qu'on la connaisse toute entière. "La vérité est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde", lit-on dans le roman. En est-on si sûr ?
"Cnoc na Daoine Liath, la Colline des Êtres gris".
Je suis content de ne pas devoir prononcer ce titre, quant à la traduction, j'ai reprise celle du roman. C'est bien en Irlande que nous allons nous rendre pour le billet du jour, dans une petite ville portuaire du sud de l'île, Cobh. Un port dont le nom est inscrit dans l'histoire dramatique du XXe siècle et qui devient ici le cadre d'une histoire macabre possédant une dimension surnaturelle... Graham Masterton, auteur écossais, a vécu un temps à Cork, le chef-lieu du comté dans lequel se trouve Cobh, et c'est à ce moment qu'il a imaginé cette intrigue et le personnage qui allait devoir s'en charger. Ce personnage s'appelle Katie Maguire (qui est également le titre de ce roman, paru chez Bragelonne, réédité en poche l'an passé, dans la traduction de François Truchaud) et elle est la première femme à atteindre le grade de commissaire au sein de la police irlandaise. Une professionnelle compétente et respectée, dont la vie privée s'avère nettement plus chaotique. La voilà face à une enquête très étrange, qui aura bien des répercussions sur son existence...
Près de Cobh, sur une exploitation agricole, des fermiers font une découverte effroyable en creusant des fondations pour un nouveau bâtiment : des os. Des os humains, ça en a tout l'air, et en grande quantité. Très grande quantité, même... Manifestement, ce sont plusieurs personnes qu'on a enterrées là, et ce n'était certainement pas l'emplacement officiel d'un cimetière.
Pourrait-il s'agir d'un charnier de victimes de l'IRA, à qui on pense toujours en premier dans cette région quand il y a des morts ? Pour John Meagher, revenu des Etats-Unis un an plus tôt pour reprendre la ferme familial, sans grand succès, il faut le reconnaître, le coup est dur à encaisser. Et il ne voit qu'une solution : appeler la Garda (en fait Garda Siochana), la police irlandaise.
Katie Maguire, première femme commissaire au sein de la Garda, arrive sur les lieux sous une pluie battante. Mais elle oublie bien vite la météo en découvrant une scène comme elle n'en a encore jamais vue : une véritable fosse commune remplie d'ossements ! Voilà qui promet une enquête difficile et une sacrée pression pour la résoudre...
Les Meagher vivent là depuis près de 70 ans et John imagine mal son père être au courant de cette sinistre histoire. Encore moins y avoir participé... Mais cette déclaration ne prouve rien, à ce stade, Katie Maguire ne veut rien écarter. D'autant qu'il paraît peut probable qu'aucune des personnes enterrées là n'ait été déclarée disparue... Il y a du pain sur la planche.
Mais l'affaire prend un tour encore plus bizarre quand les policiers découvrent un élément effroyable : un fémur percé à l'une de ses extrémités pour y accrocher une espèce de poupée de chiffon. Et la poupée elle-même est criblée d'hameçons et de clous... Vérification faite, il en va de même pour les autres fémurs retrouvés sur place...
Au total, après une journée de fouilles, on dénombre onze squelettes et tous ont au moins un fémur orné de la mystérieuse et effrayante poupée. Avant même que les restes soient autopsiés, l'esprit de Katie Maguire tourne pour chercher des réponses. Quel être assez ignoble parmi les criminels connus pourrait être à l'origine de ce carnage ?
L'autopsie va parfaitement remplir son rôle : donner des informations. Oui, mais voilà, à part accroître le sentiment d'horreur devant ce qu'on subit les victimes, cela ne fait que compliquer encore les choses. Ou peut-être les simplifier, allez savoir. Car il semble que ces os aient dormi là pendant des décennies. Sans doute 80 ans, voire plus...
Pourtant, au même moment, un événement va changer la donne. Une touriste américaine venue passer des vacances en Irlande, est enlevée alors qu'elle faisait du stop. Elle se retrouve séquestrée quelque part par son ravisseur qui lui inflige un bien curieux traitement. Et possède surtout une étrange poupée criblée d'hameçons et de clous...
La ville de Cobh, qui compte aujourd'hui moins de 15000 habitants, possède pourtant une riche histoire, en particulier grâce à son activité portuaire. Dès le XIXe, c'est une étape incontournable entre l'Angleterre et l'Amérique, alors que les navires à vapeur sont en plein essor. Quelques décennies plus tard, Cobh va même connaître une renommée... bien malgré elle !
En effet, en avril 1912, le Titanic fait escale à Queenstown (rebaptisée Cobh en 1922, après l'indépendance de la République d'Irlande) au lendemain de son départ de Southampton pour sa traversée inaugurale. C'est le dernier arrêt prévu avant New York, où le bateau, comme chacun le sait, n'arrivera jamais.
Trois ans plus tard, c'est à Queenstown que le Lusitania devait accoster quand il a été torpillé par un sous-marin allemand et envoyé par le fond. Lorsqu'on visite Cobh de nos jours, cette histoire tragique est visible dans la ville à travers des monuments rappelant ces drames, le plus spectaculaire étant incontestablement celui rappelant le torpillage du Lusitania...
Tiens, il fait du remplissage, doivent se dire certains, d'autres soupirent en pensant que, pfff, la culture générale, c'est pas pour ça qu'on lit... Je rassure les uns et les autres, tout cela n'est pas anodin, ce sont des élément que l'on trouve dans "Katie Maguire" et qui ne sont pas juste un contexte ou un décor. C'est aussi en partie là que l'inspiration de Graham Masterton est venue.
Eh oui, ce n'est pas juste un roman écrit en Irlande, c'est un roman irlandais, la nuance est de taille. Vous le verrez, et le titre de ce billet en est d'ailleurs une preuve, la culture irlandaise, mais aussi l'histoire de l'île, font partie intégrante de ce thriller. Et c'est certainement une manière d'hommage que le romancier rend ainsi au comté de Cork, où il a vécu au début des années 2000.
Et je dois dire que l'auteur de "Manitou" propose avec "Katie Maguire" un roman qui réserve bien des surprises. Les crimes atroces découverts dans le premier chapitre laissent présager d'un roman d'horreur, dont Graham Masterton s'est fait une spécialité. Dès l'apparition des squelettes et les constations médico-légales, on se prépare au pire...
Et voilà que, petit à petit, alors que Katie Maguire doit mener une enquête au combien délicate, apparaissent de nouveaux éléments qui laissent penser qu'il ne s'agit pas "juste" d'un thriller ou "juste" d'un roman d'horreur, mais qu'il pourrait y avoir une dimension fantastique très importante... Graham Masterton joue avec nous, et ce n'est pas désagréable d'être dans le doute.
En n'affichant pas directement ses intentions, le romancier installe un climat particulier, angoissant, à cause duquel le lecteur, même en possédant des informations qu'ignorent les enquêteurs, s'interroge : et si Katie Maguire recherchait un tueur aux caractéristiques extraordinaires, surnaturelles, capable de tuer à près d'un siècle d'écart ?
Le cocktail est appétissant, on sait de quoi Graham Masterton est capable, en particulier lorsqu'il nous plonge dans des descriptions effroyables, mais aussi lorsqu'il peut, et je reviens à "Manitou", son premier roman et son oeuvre la plus célèbre, déchaîner des forces incontrôlables, aux effets effroyablement spectaculaires.
Alors, où ranger "Katie Maguire" ? Ce n'est pas dans ce billet que vous l'apprendrez, et pour cause : c'est l'un des enjeux de ce roman, qui reste incertain jusqu'au dénouement, jusqu'à ce que la réponse nous soit donnée à travers les événements relatés. Mais cette ambiguïté, habilement entretenue, est un des éléments forts de cette lecture.
Et puis, il y a Katie Maguire elle-même. Je le répète, elle n'est pas n'importe qui : pour la première fois, une femme est devenue commissaire au sein de la Garda, ça en impose. On pourrait alors s'attendre à ce qu'elle soit mise à rude épreuve, qu'elle peine dans son boulot, comme Renée Ballard, évoquée précédemment, ou comme Erika Foster, dont nous reparlerons bientôt...
Mais ce n'est pas le cas du tout : la commissaire Katie Maguire est respectée et fait l'unanimité au sein de la Garda. Si quelqu'un doit se charger de l'affaire des squelettes aux poupées, c'est elle et personne d'autre et tous ces subalternes vont se mobiliser pour l'aider dans cette tâche qui se complique minute après minute...
Katie Maguire n'est pas seulement compétente, c'est aussi un bourreau de travail qui ne compte pas ses heures et qui vit pour son métier, 24h sur 24, même lorsqu'elle dort. Et, s'il faut chercher un défaut à la cuirasse de ce personnage, c'est sans doute là qu'il faut chercher : non pas dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie privée.
Et là, c'est beaucoup moins solide. L'image impassible et pleine d'une autorité naturelle qu'elle affiche dans son milieu professionnelle se lézarde. Je ne vais pas tout dévoiler ici des fragilités de Katie Maguire, mais parler de l'élément qui tient la place la plus importante dans le roman : en l'occurrence son époux, Paul.
Comment imaginer couple plus mal assorti ? Elle, la policière modèle, lui, le minable escroc, toujours entre deux coups foireux qui lui rapporteront surtout des ennuis... Être commissaire de la Garda doit être un métier stressant, mais c'est encore plus le cas quand on redoute, au quotidien, de retrouver le nom de son époux dans un des dossiers à traiter...
Oui, Paul est un problème, pour Katie Maguire, car il pourrait lui coûter sa carrière un jour ou l'autre, parce qu'il se sera fait prendre la main dans le sac... Entre les deux époux, la tension est à son comble, et on a l'impression qu'ils s'évitent le plus possible : Katie rentre de plus en plus tard à la maison, et Paul vaque à ses douteuses occupations sans que la commissaire sache où le trouver.
Les histoires de familles ou privées des flics des polars (encore plus quand ce sont des séries), cela ne me fascine pas, ça m'agace même quelquefois. C'est quelque chose qui peut vite parasiter les intrigues et casser le rythme. Bref, c'est souvent, je trouve, un peu artificiel et dispensable. Mais pas ici, car la relation entre Katie et Paul va devenir un élément important du récit.
Il y a une information que je n'ai pas encore donnée, et c'est le moment de la livrer. "Katie Maguire" est le premier tome d'une série. Et pourtant, ce qui se déroule dans ce livre pourrait faire penser à un one-shot tant la situation du personnage principal évolue entre le début et la fin. C'est même plus qu'une évolution, c'est un... nan, pas une révolution, ça va, j'allais dire un bouleversement.
Vous allez découvrir au fil du récit que ce premier tome ressemble en fait à ce qu'on pourrait appeler un épisode pilote, pour reprendre une expression télévisuelle. On pose un cadre, mais on y installe une histoire qui pourrait tenir seule debout. Et ensuite, on avisera. Et pour la suite, eh bien le contexte dans lequel évoluera Katie Maguire aura beaucoup changé...
Ce nouveau contexte, on ne le connaît pas, nous, lecteurs français, à moins d'être parfaitement bilingues et capables de lire les romans en version originale. On ne le connaît pas, car "Katie Maguire" est le seul volume de cette série (qui compte actuellement près d'une dizaine de titres) qui a été traduit en français...
Publié en 2003 en anglais, traduit et édité en France par le Fleuve Noir, "Katie Maguire" a ensuite été repris par Bragelonne, comme une grande partie du catalogue des titres de Graham Masterton. Le titre vient de reparaître l'an passé dans une éditions de poche et en numérique. Mais il n'est apparemment pas prévu de faire traduire et de nous proposer les enquêtes suivantes.
C'est vraiment dommage, même si je peux tout à fait comprendre les raisons avancées par Bragelonne. Dommage, car ce premier volet est vraiment bien fichu et prometteur et le personnage de Katie Maguire est intéressant à suivre. on voudrait découvrir comment il va évoluer, surtout après les événements qui interviennent au cours de cette enquête.
On verra prochainement (si tout va bien) que le romancier écossais est désormais publié par une jeune maison belge, pour une autre série policière, celle-là clairement fantastique, il y aurait donc peut-être quelque chose à creuser pour nous permettre, à nous, pauvres lecteurs incultes qui n'entravons que dalle à l'anglais écrit, de poursuivre la découverte des enquêtes de Katie Maguire...
Près de Cobh, sur une exploitation agricole, des fermiers font une découverte effroyable en creusant des fondations pour un nouveau bâtiment : des os. Des os humains, ça en a tout l'air, et en grande quantité. Très grande quantité, même... Manifestement, ce sont plusieurs personnes qu'on a enterrées là, et ce n'était certainement pas l'emplacement officiel d'un cimetière.
Pourrait-il s'agir d'un charnier de victimes de l'IRA, à qui on pense toujours en premier dans cette région quand il y a des morts ? Pour John Meagher, revenu des Etats-Unis un an plus tôt pour reprendre la ferme familial, sans grand succès, il faut le reconnaître, le coup est dur à encaisser. Et il ne voit qu'une solution : appeler la Garda (en fait Garda Siochana), la police irlandaise.
Katie Maguire, première femme commissaire au sein de la Garda, arrive sur les lieux sous une pluie battante. Mais elle oublie bien vite la météo en découvrant une scène comme elle n'en a encore jamais vue : une véritable fosse commune remplie d'ossements ! Voilà qui promet une enquête difficile et une sacrée pression pour la résoudre...
Les Meagher vivent là depuis près de 70 ans et John imagine mal son père être au courant de cette sinistre histoire. Encore moins y avoir participé... Mais cette déclaration ne prouve rien, à ce stade, Katie Maguire ne veut rien écarter. D'autant qu'il paraît peut probable qu'aucune des personnes enterrées là n'ait été déclarée disparue... Il y a du pain sur la planche.
Mais l'affaire prend un tour encore plus bizarre quand les policiers découvrent un élément effroyable : un fémur percé à l'une de ses extrémités pour y accrocher une espèce de poupée de chiffon. Et la poupée elle-même est criblée d'hameçons et de clous... Vérification faite, il en va de même pour les autres fémurs retrouvés sur place...
Au total, après une journée de fouilles, on dénombre onze squelettes et tous ont au moins un fémur orné de la mystérieuse et effrayante poupée. Avant même que les restes soient autopsiés, l'esprit de Katie Maguire tourne pour chercher des réponses. Quel être assez ignoble parmi les criminels connus pourrait être à l'origine de ce carnage ?
L'autopsie va parfaitement remplir son rôle : donner des informations. Oui, mais voilà, à part accroître le sentiment d'horreur devant ce qu'on subit les victimes, cela ne fait que compliquer encore les choses. Ou peut-être les simplifier, allez savoir. Car il semble que ces os aient dormi là pendant des décennies. Sans doute 80 ans, voire plus...
Pourtant, au même moment, un événement va changer la donne. Une touriste américaine venue passer des vacances en Irlande, est enlevée alors qu'elle faisait du stop. Elle se retrouve séquestrée quelque part par son ravisseur qui lui inflige un bien curieux traitement. Et possède surtout une étrange poupée criblée d'hameçons et de clous...
La ville de Cobh, qui compte aujourd'hui moins de 15000 habitants, possède pourtant une riche histoire, en particulier grâce à son activité portuaire. Dès le XIXe, c'est une étape incontournable entre l'Angleterre et l'Amérique, alors que les navires à vapeur sont en plein essor. Quelques décennies plus tard, Cobh va même connaître une renommée... bien malgré elle !
En effet, en avril 1912, le Titanic fait escale à Queenstown (rebaptisée Cobh en 1922, après l'indépendance de la République d'Irlande) au lendemain de son départ de Southampton pour sa traversée inaugurale. C'est le dernier arrêt prévu avant New York, où le bateau, comme chacun le sait, n'arrivera jamais.
Trois ans plus tard, c'est à Queenstown que le Lusitania devait accoster quand il a été torpillé par un sous-marin allemand et envoyé par le fond. Lorsqu'on visite Cobh de nos jours, cette histoire tragique est visible dans la ville à travers des monuments rappelant ces drames, le plus spectaculaire étant incontestablement celui rappelant le torpillage du Lusitania...
Tiens, il fait du remplissage, doivent se dire certains, d'autres soupirent en pensant que, pfff, la culture générale, c'est pas pour ça qu'on lit... Je rassure les uns et les autres, tout cela n'est pas anodin, ce sont des élément que l'on trouve dans "Katie Maguire" et qui ne sont pas juste un contexte ou un décor. C'est aussi en partie là que l'inspiration de Graham Masterton est venue.
Eh oui, ce n'est pas juste un roman écrit en Irlande, c'est un roman irlandais, la nuance est de taille. Vous le verrez, et le titre de ce billet en est d'ailleurs une preuve, la culture irlandaise, mais aussi l'histoire de l'île, font partie intégrante de ce thriller. Et c'est certainement une manière d'hommage que le romancier rend ainsi au comté de Cork, où il a vécu au début des années 2000.
Et je dois dire que l'auteur de "Manitou" propose avec "Katie Maguire" un roman qui réserve bien des surprises. Les crimes atroces découverts dans le premier chapitre laissent présager d'un roman d'horreur, dont Graham Masterton s'est fait une spécialité. Dès l'apparition des squelettes et les constations médico-légales, on se prépare au pire...
Et voilà que, petit à petit, alors que Katie Maguire doit mener une enquête au combien délicate, apparaissent de nouveaux éléments qui laissent penser qu'il ne s'agit pas "juste" d'un thriller ou "juste" d'un roman d'horreur, mais qu'il pourrait y avoir une dimension fantastique très importante... Graham Masterton joue avec nous, et ce n'est pas désagréable d'être dans le doute.
En n'affichant pas directement ses intentions, le romancier installe un climat particulier, angoissant, à cause duquel le lecteur, même en possédant des informations qu'ignorent les enquêteurs, s'interroge : et si Katie Maguire recherchait un tueur aux caractéristiques extraordinaires, surnaturelles, capable de tuer à près d'un siècle d'écart ?
Le cocktail est appétissant, on sait de quoi Graham Masterton est capable, en particulier lorsqu'il nous plonge dans des descriptions effroyables, mais aussi lorsqu'il peut, et je reviens à "Manitou", son premier roman et son oeuvre la plus célèbre, déchaîner des forces incontrôlables, aux effets effroyablement spectaculaires.
Alors, où ranger "Katie Maguire" ? Ce n'est pas dans ce billet que vous l'apprendrez, et pour cause : c'est l'un des enjeux de ce roman, qui reste incertain jusqu'au dénouement, jusqu'à ce que la réponse nous soit donnée à travers les événements relatés. Mais cette ambiguïté, habilement entretenue, est un des éléments forts de cette lecture.
Et puis, il y a Katie Maguire elle-même. Je le répète, elle n'est pas n'importe qui : pour la première fois, une femme est devenue commissaire au sein de la Garda, ça en impose. On pourrait alors s'attendre à ce qu'elle soit mise à rude épreuve, qu'elle peine dans son boulot, comme Renée Ballard, évoquée précédemment, ou comme Erika Foster, dont nous reparlerons bientôt...
Mais ce n'est pas le cas du tout : la commissaire Katie Maguire est respectée et fait l'unanimité au sein de la Garda. Si quelqu'un doit se charger de l'affaire des squelettes aux poupées, c'est elle et personne d'autre et tous ces subalternes vont se mobiliser pour l'aider dans cette tâche qui se complique minute après minute...
Katie Maguire n'est pas seulement compétente, c'est aussi un bourreau de travail qui ne compte pas ses heures et qui vit pour son métier, 24h sur 24, même lorsqu'elle dort. Et, s'il faut chercher un défaut à la cuirasse de ce personnage, c'est sans doute là qu'il faut chercher : non pas dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie privée.
Et là, c'est beaucoup moins solide. L'image impassible et pleine d'une autorité naturelle qu'elle affiche dans son milieu professionnelle se lézarde. Je ne vais pas tout dévoiler ici des fragilités de Katie Maguire, mais parler de l'élément qui tient la place la plus importante dans le roman : en l'occurrence son époux, Paul.
Comment imaginer couple plus mal assorti ? Elle, la policière modèle, lui, le minable escroc, toujours entre deux coups foireux qui lui rapporteront surtout des ennuis... Être commissaire de la Garda doit être un métier stressant, mais c'est encore plus le cas quand on redoute, au quotidien, de retrouver le nom de son époux dans un des dossiers à traiter...
Oui, Paul est un problème, pour Katie Maguire, car il pourrait lui coûter sa carrière un jour ou l'autre, parce qu'il se sera fait prendre la main dans le sac... Entre les deux époux, la tension est à son comble, et on a l'impression qu'ils s'évitent le plus possible : Katie rentre de plus en plus tard à la maison, et Paul vaque à ses douteuses occupations sans que la commissaire sache où le trouver.
Les histoires de familles ou privées des flics des polars (encore plus quand ce sont des séries), cela ne me fascine pas, ça m'agace même quelquefois. C'est quelque chose qui peut vite parasiter les intrigues et casser le rythme. Bref, c'est souvent, je trouve, un peu artificiel et dispensable. Mais pas ici, car la relation entre Katie et Paul va devenir un élément important du récit.
Il y a une information que je n'ai pas encore donnée, et c'est le moment de la livrer. "Katie Maguire" est le premier tome d'une série. Et pourtant, ce qui se déroule dans ce livre pourrait faire penser à un one-shot tant la situation du personnage principal évolue entre le début et la fin. C'est même plus qu'une évolution, c'est un... nan, pas une révolution, ça va, j'allais dire un bouleversement.
Vous allez découvrir au fil du récit que ce premier tome ressemble en fait à ce qu'on pourrait appeler un épisode pilote, pour reprendre une expression télévisuelle. On pose un cadre, mais on y installe une histoire qui pourrait tenir seule debout. Et ensuite, on avisera. Et pour la suite, eh bien le contexte dans lequel évoluera Katie Maguire aura beaucoup changé...
Ce nouveau contexte, on ne le connaît pas, nous, lecteurs français, à moins d'être parfaitement bilingues et capables de lire les romans en version originale. On ne le connaît pas, car "Katie Maguire" est le seul volume de cette série (qui compte actuellement près d'une dizaine de titres) qui a été traduit en français...
Publié en 2003 en anglais, traduit et édité en France par le Fleuve Noir, "Katie Maguire" a ensuite été repris par Bragelonne, comme une grande partie du catalogue des titres de Graham Masterton. Le titre vient de reparaître l'an passé dans une éditions de poche et en numérique. Mais il n'est apparemment pas prévu de faire traduire et de nous proposer les enquêtes suivantes.
C'est vraiment dommage, même si je peux tout à fait comprendre les raisons avancées par Bragelonne. Dommage, car ce premier volet est vraiment bien fichu et prometteur et le personnage de Katie Maguire est intéressant à suivre. on voudrait découvrir comment il va évoluer, surtout après les événements qui interviennent au cours de cette enquête.
On verra prochainement (si tout va bien) que le romancier écossais est désormais publié par une jeune maison belge, pour une autre série policière, celle-là clairement fantastique, il y aurait donc peut-être quelque chose à creuser pour nous permettre, à nous, pauvres lecteurs incultes qui n'entravons que dalle à l'anglais écrit, de poursuivre la découverte des enquêtes de Katie Maguire...
"Rien n'égale l'intensité du moment où l'on sait. C'est le Saint Graal du travail d'enquête".
C'est un événement, oh, relatif, n'exagérons rien, mais dans le petit monde du polar, c'est vraiment un événement : le dernier roman en date de Michael Connelly ne met pas en scène Harry Bosch. C'est déjà arrivé, c'est vrai, avec les romans consacrés à Mickey Haller, mais ce dernier est lié à Bosch. Là, c'est le début d'une nouvelle série, avec un flic, qui n'est pas Bosch et qui n'a aucun lien avec lui. Et plus remarquable encore, c'est une femme ! Bienvenue, donc, à Renée Ballard, héroïne de "En attendant le jour" (en grand format chez Calmann-Lévy ; traduction de Robert Pépin), flic au parcours assez chaotique, que l'on va découvrir tout au long de ce tome initial, mais flic pleine de détermination, d'un sentiment de revanche et, aussi, d'ambition. Un personnage intéressant, qu'on a envie de voir "grandir", d'autant que sa situation, lorsqu'on fait sa connaissance, est loin d'être idéale et qu'elle pourrait bien démontrer à tous qu'elle mérite mieux...
C'est un service qui commence comme tant d'autres pour les agents du commissariat d'Hollywood faisant le quart de nuit, par un appel pour un cambriolage sur El Camino Avenue. Jenkins et Ballard sont appelés sur place et interroge la plaignante, une femme âgée qui déplore le vol de sa carte de crédit. Le voleur s'en est déjà servi pour acheter sur un grand site de vente en ligne (oui, celui-là).
Au moment de rentrer au commissariat, nouvel appel : direction l'hôpital, où l'on vient d'amener une victime d'une agression extrêmement violente. Jenkins et Ballard vont faire les premières constatations, récolter les premiers indices, s'il y en a, essayer d'en savoir plus sur la victime, etc. Le B.A.-ba de l'enquête de police.
A la différence près que, une fois ces renseignements rassemblés, ils devront transmettre le dossier au service compétent, qui se chargera de retrouver le coupable. C'est le lot des flics du quartier de nuit (23h-7h) : ils ne mènent jamais les enquêtes jusqu'à leur terme. Et pour beaucoup, à commencer par Renée Ballard, cette situation équivaut à une mise au placard.
Comme souvent, Ballard ressent cette impuissance et cette injustice lorsqu'elle se retrouve à l'hôpital, auprès de cette femme laissée pour morte en pleine rue par son agresseur... Elle voudrait prendre en main les choses et retrouver le monstre qui a fait ça. D'autant qu'un élément inattendu va donner un nouvel point de vue sur cette affaire...
En effet... Ah, non, pardon, c'est le lot du quart de nuit, une affaire chasse l'autre. Il faut dire que cette fois, c'est du lourd : une fusillade dans un club sur Sunset Boulevard, on dénombre quatre victimes et une blessée très grave qui arrive justement à l'hôpital où sont déjà Ballard et son équipier. A eux de jouer, pendant qu'on s'affaire déjà sur la scène de crime.
Mais la jeune serveuse amenée en urgence absolue ne va pas s'en sortir. Ballard va donc effectuer son inspection sur le cadavre et les affaires qu'elle avait sur elle... Ensuite, elle se rend sur les lieux du drame pour y apporter son aide. Mais là-bas, mauvaise surprise : elle connaît bien les flics qui sont en charge de la fusillade ; elle leur doit sa mutation, deux ans plus tôt, au quart de nuit...
Il s'agit du lieutenant Olivas et de l'inspecteur Ken Chastain, respectivement ex-supérieur et ex-équipier de Renée Ballard... Que s'est-il passé entre eux ? On ne le sait pas encore, mais à voir la moutarde monter aussitôt au nez de la policière, la blessure est loin d'être cicatrisée... Et même si elle ne se sent pas vraiment la bienvenue, elle se montre consciencieuse. Et attentive, aussi.
Ce n'est pas parce qu'on l'a mise sur la touche qu'elle a perdu ses réflexes et ses compétences. Et, cette nuit-là, entre ce cambriolage, cette si lâche agression et ce massacre, sa détermination à redevenir un flic comme les autres, un flic qui prend en charge une affaire de A jusqu'à Z, un flic qui cherche, démasque et arrête un coupable, la rattrape. Quoi qu'il lui en coûte...
Pour cela, il va lui falloir la jouer fine et prendre sur son temps de sommeil pour travailler clandestinement sur ces affaires, alors qu'elle n'a aucun droit d'agir ainsi. Jenkins, volontaire pour le quart de nuit, pour d'excellentes raisons d'ailleurs, va la laisser faire, mais surtout, surtout, ne veut pas que quoi que ce soit lui retombe dessus. Et Renée va s'y mettre sérieusement...
Il y aurait beaucoup à dire sur ce nouveau personnage. Je parle sur un plan factuel : qui est-elle, d'où vient-elle, quel est son rés... euh son parcours, pourquoi, après quinze années de maison est-elle dans cette impasse professionnelle ? Les réponses sont bien sûr dans "En attendant le jour", apparaissant ponctuellement en fonction des moments et des situations.
Alors, oui, je pourrais vous faire un portrait chiadé de ce personnage qu'on a d'ores et déjà envie de suivre, j'y ai même réfléchi depuis que j'ai refermé le roman. Toutefois, au moment d'écrire ce billet, je me dis que ce ne serait pas très malin. Parce que justement, c'est un nouveau personnage et que le plaisir du lecteur, c'est de la découvrir en lisant le roman, et pas ce blog.
Je ne vais donc pas vous faire le CV de Renée Ballard, même si elle a un parcours peu ordinaire, une vocation tardive pour la carrière policière, un mode de vie bien spécial et une histoire familiale très particulière. De même, pas un mot sur les raisons qui lui valent d'être au quart de nuit, où elle ne peut rien faire... On les comprend assez vite, et cela donne une bonne idée de son caractère...
Et là, à ce point du billet, arrive le moment que l'on voudrait éviter, mais qui est inévitable : et Bosch, dans tout ça ? Eh oui, forcément, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là, le bon vieux Hyéronymus, qu'on ne pense pas à lui, c'est presque obligé, c'est humain ! D'ailleurs, Michael Connelly lui-même s'en amuse, en faisant un clin d'oeil à son personnage, et à la série (il faut bien faire la promo de la franchise).
Entre Renée et Harry, aucun lien, du moins pour le moment. Renée ne le connaît pas, elle ne l'a jamais rencontré. Mais l'attente du lecteur est ailleurs : allez, disons les choses clairement, on se demande tous si Renée Ballard a quelque chose de Harry Bosch (car... hum... musique... On a tous quelque chose de Harry Boooosch... Désolé...).
Plus sérieusement, oui, forcément, on compare. Et force est de constater qu'il y a des traits communs entre les deux personnages. A commencer par ce caractère affirmé qui en fait des fortes têtes et les pousse à souvent défier leurs supérieurs, à la jouer en solo, quoi que cela puisse coûter et à se forger des inimitiés puissantes.
Il y a un autre point qu'on retrouve chez Bosch, mais sans doute est-elle répandu chez beaucoup de flics de terrain : la même méfiance envers les policiers qui oublient d'où ils viennent pour se construire une carrière politique, quitte à jouer leur carte personnelle contre leurs collègues. Envers ceux qui ont oublié leur sang bleu...
Mais, il y a un élément qui distingue irrémédiablement Renée Ballard de Harry Bosch : elle est une femme. Tiens, voilà qu'il fait dans la tautologie, disent les moqueurs (des moqueurs qui ont du vocabulaire !), riez donc, mais c'est essentiel, car cet aspect tient une place très importante dans ce roman, à différents moments et dans différentes situations.
Parce que cela influe sur sa vie, sa carrière, son boulot, sur tout, en définitive. Et Michael Connelly en profite pour mettre en évidence un certain nombre de défauts de nos sociétés qui visent directement les femmes, n'oubliant donc pas la dimension critique de son travail de romancier. Et c'est aussi cela qui donne envie de voir comment cette nouvelle série va se développer autour de ce personnage.
Un mot sur le titre de ce livre. En version originale, le roman s'intitule "The Late Show", titre sans doute assez ironique, puisqu'il fait référence à ces émissions de télévision de fin de soirée, qui ont souvent une dimension satirique, alors qu'en réalité, le spectacle auquel assiste les policiers du quartier de nuit n'a souvent rien de bien passionnant, ou alors est vite évacué une fois transmis.
En français, on ajoute quelques nuances, avec ce titre, "En attendant le jour". On peut le prendre au pied de la lettre : le service du quartier de nuit se déroule de 23h à 7h, il ne se passe parfois pas grand-chose, ou des histoires mineures, et de toute manière, on n'enquête pas, donc ça ne doit pas passer très vite, parfois...
On peut aussi le voir à travers le prisme de ce roman précisément : Renée enquête le jour, puisqu'elle n'y a pas droit la nuit (et sans doute aussi parce qu'il est plus facile de trouver des témoins et des informations pendant la journée). Elle est donc impatiente que le jour arrive, puisque la nuit, elle a les mains liées...
Et puis, j'y vois une dernière acception, qui mériterait presque qu'on y ajoute des points de suspension, ou un "où", ou les deux. En attendant le jour où... Où Renée Ballard aura démontré à ses détracteurs qu'elle est un flic à part entière, capable d'enquêter, de bien enquêter, et de résoudre des affaires complexes, dangereuses, même.
Parce que c'est bien ce qu'on attend d'elle, nous, lecteurs. Et c'est bien ce qu'elle espère elle aussi, même si elle ne le formule pas aussi clairement. Elle rêve de retrouver le goût si particulier de l'élucidation, comme l'explique la citation en titre de ce billet. Je l'ai réduite à sa plus simple expression, mais tout le passage où elle se trouve évoque ce plaisir spécifique dont elle est privée.
On retrouve là cette intégrité, ce sens de la justice qui caractérisent les personnages de Michael Connelly (enfin, moins Mickey Haller, évidemment...), et qui concerne aussi bien le simple délit que le crime le plus grave. Il faut également ajouter que, dans ce roman, on verra pour la suite, il y a une implication personnelle très forte, sans doute même trop.
Renée Ballard n'apparaît pas seulement comme un électron libre, elle est aussi une tête brûlée qui ne mesure sans doute pas elle-même les risques qu'elle prend. Elle oublie le respect des procédures, et se le fait même vertement rappeler, mais elle a aussi des intuitions décisives, dont l'une va permettre au lecteur fan des "Experts" de découvrir une impressionnantes (et hors de prix) technique.
Bon, ça doit se ressentir un peu, j'ai apprécié cette rencontre avec Renée Ballard et j'espère la retrouver vite (là, quand j'écris ça, j'ouvre le moteur de recherches et je vais voir les publications de Michael Connelly non encore traduites ; gros curieux je suis). J'ai envie de voir comment Michael Connelly va la développer et la faire évoluer (ma recherche m'a donné un indice, tiens).
Il faut dire que "En attendant le jour" se termine sur une décision forte de Renée Ballard, une manière de s'affirmer et de prendre sa revanche, après deux années à ruminer. On peut y voir une manière de reprendre la main, mais il sera intéressant de voir comment cette décision influera sur le prochain volet de cette nouvelle série.
Au-delà du personnage de Renée Ballard, les habitués du travail de Michael Connelly trouveront là un roman de facture assez classique, sans véritable surprise dans le fond, mais très efficace, jusqu'au coup de théâtre final, bien amené pour jouer avec le lecteur et le faire douter du scénario qu'il a pu échafauder. Le surprendre, peut-être aussi.
De l'action, pas mal de suspense, et une héroïne qui n'a pas froid aux yeux. Ce dernier élément est peut-être d'ailleurs ce qui manquait à la bibliographie de Michael Connelly : une femme dans un rôle principal. J'avais parié qu'il s'agirait de Maddy, la fille de Bosch, puis sur Lucia Soto... Je suis vraiment le pire des pronostiqueurs, et tant mieux pour Renée Ballard, qui porte bien ce costume.
C'est un service qui commence comme tant d'autres pour les agents du commissariat d'Hollywood faisant le quart de nuit, par un appel pour un cambriolage sur El Camino Avenue. Jenkins et Ballard sont appelés sur place et interroge la plaignante, une femme âgée qui déplore le vol de sa carte de crédit. Le voleur s'en est déjà servi pour acheter sur un grand site de vente en ligne (oui, celui-là).
Au moment de rentrer au commissariat, nouvel appel : direction l'hôpital, où l'on vient d'amener une victime d'une agression extrêmement violente. Jenkins et Ballard vont faire les premières constatations, récolter les premiers indices, s'il y en a, essayer d'en savoir plus sur la victime, etc. Le B.A.-ba de l'enquête de police.
A la différence près que, une fois ces renseignements rassemblés, ils devront transmettre le dossier au service compétent, qui se chargera de retrouver le coupable. C'est le lot des flics du quartier de nuit (23h-7h) : ils ne mènent jamais les enquêtes jusqu'à leur terme. Et pour beaucoup, à commencer par Renée Ballard, cette situation équivaut à une mise au placard.
Comme souvent, Ballard ressent cette impuissance et cette injustice lorsqu'elle se retrouve à l'hôpital, auprès de cette femme laissée pour morte en pleine rue par son agresseur... Elle voudrait prendre en main les choses et retrouver le monstre qui a fait ça. D'autant qu'un élément inattendu va donner un nouvel point de vue sur cette affaire...
En effet... Ah, non, pardon, c'est le lot du quart de nuit, une affaire chasse l'autre. Il faut dire que cette fois, c'est du lourd : une fusillade dans un club sur Sunset Boulevard, on dénombre quatre victimes et une blessée très grave qui arrive justement à l'hôpital où sont déjà Ballard et son équipier. A eux de jouer, pendant qu'on s'affaire déjà sur la scène de crime.
Mais la jeune serveuse amenée en urgence absolue ne va pas s'en sortir. Ballard va donc effectuer son inspection sur le cadavre et les affaires qu'elle avait sur elle... Ensuite, elle se rend sur les lieux du drame pour y apporter son aide. Mais là-bas, mauvaise surprise : elle connaît bien les flics qui sont en charge de la fusillade ; elle leur doit sa mutation, deux ans plus tôt, au quart de nuit...
Il s'agit du lieutenant Olivas et de l'inspecteur Ken Chastain, respectivement ex-supérieur et ex-équipier de Renée Ballard... Que s'est-il passé entre eux ? On ne le sait pas encore, mais à voir la moutarde monter aussitôt au nez de la policière, la blessure est loin d'être cicatrisée... Et même si elle ne se sent pas vraiment la bienvenue, elle se montre consciencieuse. Et attentive, aussi.
Ce n'est pas parce qu'on l'a mise sur la touche qu'elle a perdu ses réflexes et ses compétences. Et, cette nuit-là, entre ce cambriolage, cette si lâche agression et ce massacre, sa détermination à redevenir un flic comme les autres, un flic qui prend en charge une affaire de A jusqu'à Z, un flic qui cherche, démasque et arrête un coupable, la rattrape. Quoi qu'il lui en coûte...
Pour cela, il va lui falloir la jouer fine et prendre sur son temps de sommeil pour travailler clandestinement sur ces affaires, alors qu'elle n'a aucun droit d'agir ainsi. Jenkins, volontaire pour le quart de nuit, pour d'excellentes raisons d'ailleurs, va la laisser faire, mais surtout, surtout, ne veut pas que quoi que ce soit lui retombe dessus. Et Renée va s'y mettre sérieusement...
Il y aurait beaucoup à dire sur ce nouveau personnage. Je parle sur un plan factuel : qui est-elle, d'où vient-elle, quel est son rés... euh son parcours, pourquoi, après quinze années de maison est-elle dans cette impasse professionnelle ? Les réponses sont bien sûr dans "En attendant le jour", apparaissant ponctuellement en fonction des moments et des situations.
Alors, oui, je pourrais vous faire un portrait chiadé de ce personnage qu'on a d'ores et déjà envie de suivre, j'y ai même réfléchi depuis que j'ai refermé le roman. Toutefois, au moment d'écrire ce billet, je me dis que ce ne serait pas très malin. Parce que justement, c'est un nouveau personnage et que le plaisir du lecteur, c'est de la découvrir en lisant le roman, et pas ce blog.
Je ne vais donc pas vous faire le CV de Renée Ballard, même si elle a un parcours peu ordinaire, une vocation tardive pour la carrière policière, un mode de vie bien spécial et une histoire familiale très particulière. De même, pas un mot sur les raisons qui lui valent d'être au quart de nuit, où elle ne peut rien faire... On les comprend assez vite, et cela donne une bonne idée de son caractère...
Et là, à ce point du billet, arrive le moment que l'on voudrait éviter, mais qui est inévitable : et Bosch, dans tout ça ? Eh oui, forcément, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là, le bon vieux Hyéronymus, qu'on ne pense pas à lui, c'est presque obligé, c'est humain ! D'ailleurs, Michael Connelly lui-même s'en amuse, en faisant un clin d'oeil à son personnage, et à la série (il faut bien faire la promo de la franchise).
Entre Renée et Harry, aucun lien, du moins pour le moment. Renée ne le connaît pas, elle ne l'a jamais rencontré. Mais l'attente du lecteur est ailleurs : allez, disons les choses clairement, on se demande tous si Renée Ballard a quelque chose de Harry Bosch (car... hum... musique... On a tous quelque chose de Harry Boooosch... Désolé...).
Plus sérieusement, oui, forcément, on compare. Et force est de constater qu'il y a des traits communs entre les deux personnages. A commencer par ce caractère affirmé qui en fait des fortes têtes et les pousse à souvent défier leurs supérieurs, à la jouer en solo, quoi que cela puisse coûter et à se forger des inimitiés puissantes.
Il y a un autre point qu'on retrouve chez Bosch, mais sans doute est-elle répandu chez beaucoup de flics de terrain : la même méfiance envers les policiers qui oublient d'où ils viennent pour se construire une carrière politique, quitte à jouer leur carte personnelle contre leurs collègues. Envers ceux qui ont oublié leur sang bleu...
Mais, il y a un élément qui distingue irrémédiablement Renée Ballard de Harry Bosch : elle est une femme. Tiens, voilà qu'il fait dans la tautologie, disent les moqueurs (des moqueurs qui ont du vocabulaire !), riez donc, mais c'est essentiel, car cet aspect tient une place très importante dans ce roman, à différents moments et dans différentes situations.
Parce que cela influe sur sa vie, sa carrière, son boulot, sur tout, en définitive. Et Michael Connelly en profite pour mettre en évidence un certain nombre de défauts de nos sociétés qui visent directement les femmes, n'oubliant donc pas la dimension critique de son travail de romancier. Et c'est aussi cela qui donne envie de voir comment cette nouvelle série va se développer autour de ce personnage.
Un mot sur le titre de ce livre. En version originale, le roman s'intitule "The Late Show", titre sans doute assez ironique, puisqu'il fait référence à ces émissions de télévision de fin de soirée, qui ont souvent une dimension satirique, alors qu'en réalité, le spectacle auquel assiste les policiers du quartier de nuit n'a souvent rien de bien passionnant, ou alors est vite évacué une fois transmis.
En français, on ajoute quelques nuances, avec ce titre, "En attendant le jour". On peut le prendre au pied de la lettre : le service du quartier de nuit se déroule de 23h à 7h, il ne se passe parfois pas grand-chose, ou des histoires mineures, et de toute manière, on n'enquête pas, donc ça ne doit pas passer très vite, parfois...
On peut aussi le voir à travers le prisme de ce roman précisément : Renée enquête le jour, puisqu'elle n'y a pas droit la nuit (et sans doute aussi parce qu'il est plus facile de trouver des témoins et des informations pendant la journée). Elle est donc impatiente que le jour arrive, puisque la nuit, elle a les mains liées...
Et puis, j'y vois une dernière acception, qui mériterait presque qu'on y ajoute des points de suspension, ou un "où", ou les deux. En attendant le jour où... Où Renée Ballard aura démontré à ses détracteurs qu'elle est un flic à part entière, capable d'enquêter, de bien enquêter, et de résoudre des affaires complexes, dangereuses, même.
Parce que c'est bien ce qu'on attend d'elle, nous, lecteurs. Et c'est bien ce qu'elle espère elle aussi, même si elle ne le formule pas aussi clairement. Elle rêve de retrouver le goût si particulier de l'élucidation, comme l'explique la citation en titre de ce billet. Je l'ai réduite à sa plus simple expression, mais tout le passage où elle se trouve évoque ce plaisir spécifique dont elle est privée.
On retrouve là cette intégrité, ce sens de la justice qui caractérisent les personnages de Michael Connelly (enfin, moins Mickey Haller, évidemment...), et qui concerne aussi bien le simple délit que le crime le plus grave. Il faut également ajouter que, dans ce roman, on verra pour la suite, il y a une implication personnelle très forte, sans doute même trop.
Renée Ballard n'apparaît pas seulement comme un électron libre, elle est aussi une tête brûlée qui ne mesure sans doute pas elle-même les risques qu'elle prend. Elle oublie le respect des procédures, et se le fait même vertement rappeler, mais elle a aussi des intuitions décisives, dont l'une va permettre au lecteur fan des "Experts" de découvrir une impressionnantes (et hors de prix) technique.
Bon, ça doit se ressentir un peu, j'ai apprécié cette rencontre avec Renée Ballard et j'espère la retrouver vite (là, quand j'écris ça, j'ouvre le moteur de recherches et je vais voir les publications de Michael Connelly non encore traduites ; gros curieux je suis). J'ai envie de voir comment Michael Connelly va la développer et la faire évoluer (ma recherche m'a donné un indice, tiens).
Il faut dire que "En attendant le jour" se termine sur une décision forte de Renée Ballard, une manière de s'affirmer et de prendre sa revanche, après deux années à ruminer. On peut y voir une manière de reprendre la main, mais il sera intéressant de voir comment cette décision influera sur le prochain volet de cette nouvelle série.
Au-delà du personnage de Renée Ballard, les habitués du travail de Michael Connelly trouveront là un roman de facture assez classique, sans véritable surprise dans le fond, mais très efficace, jusqu'au coup de théâtre final, bien amené pour jouer avec le lecteur et le faire douter du scénario qu'il a pu échafauder. Le surprendre, peut-être aussi.
De l'action, pas mal de suspense, et une héroïne qui n'a pas froid aux yeux. Ce dernier élément est peut-être d'ailleurs ce qui manquait à la bibliographie de Michael Connelly : une femme dans un rôle principal. J'avais parié qu'il s'agirait de Maddy, la fille de Bosch, puis sur Lucia Soto... Je suis vraiment le pire des pronostiqueurs, et tant mieux pour Renée Ballard, qui porte bien ce costume.
mardi 27 août 2019
"Quoi qu'il en soit, on en revient toujours au point central, cet homme est un tueur, il doit tuer. Un comédien doit jouer la comédie".
Ces dernières années, une volonté que je qualifierais de patrimoniale est apparue dans l'édition. Autrement dit, on réédite ou on retraduit ou les deux à la fois des romans anciens, souvent épuisés ou oubliés. En imaginaire ou en polar, nombreuses sont les maisons d'éditions à faire une place dans leur catalogue à ces nouveautés qui n'en sont pas tout à fait. En voici un bel exemple, paru chez Rivages, avec "Un homme dans la brume", de Dorothy B. Hughes (nouvelle traduction de Simon Baril). Un pur roman noir dans la grande tradition du "hard boiled", paru à l'origine en 1947, du moins en apparence. Car, lorsqu'on se plonge dans cette histoire, qui préfigure les romans de serial killers, on se rend compte que la romancière s'est emparé des codes du roman noir pour mieux les détourner et en proposer une vision sensiblement différente, en particulier parce qu'elle renverse les notions de genres (au sens du sexe des personnages), très codifiées dans ce genre (au sens littéraire... Vous êtes encore là ?).
Un soir à Santa Monica, un homme se tient face à l'océan, alors que le brouillard commence à monter. Il semble s'enivrer des sensations que procurent l'air marin et la vue de cette étendue d'eau qui paraît sans limité. Une impression de liberté que semble rechercher l'individu, arrivé là presque par hasard, après être simplement monté dans un bus.
Justement un autre bus de la même ligne arrive à ce moment-là et en descend une jeune femme, sans doute une employée qui vient de quitter son bureau et rentre chez elle. L'homme attend que le bus reparte et commence à suivre la femme alors que la brume devient de plus en plus dense...
Mais soudain, des voitures passent, et l'homme change d'avis. Il monte dans le premier bus qui arrive, sans même savoir quelle direction il prend. Finalement, il échoue dans un bar assez chic où un éclat de voix va provoquer une association d'idée. Il a entendu un mot, quelque chose comme "Brub", or un Brub, il en connaît un, et il habite justement Santa Monica.
Il appelle cet ami depuis la cabine téléphonique du bar et, peu après ces retrouvailles à distance, il arrive chez Brub Nicolai, une belle maison où ce dernier vit avec Sylvia, son épouse. La conversation s'engage autour d'un verre et l'on comprend que Brub et l'homme sorti du brouillard se connaissent depuis quelques années.
L'homme s'appelle Dix Steele et, comme Brub, il a fait la guerre dans l'Armée de l'Air. Ils ont été stationnés en Europe et sont devenus amis. Mais, depuis qu'il a quitté l'uniforme, Dix Steele peine à retrouver le cours normal de son existence, d'où ces errances nocturnes au cours desquelles il essaye de retrouver les sensations qu'il avait lorsqu'il volait.
Au contraire, Brub semble avoir juste refermé la parenthèse et avoir retrouvé ses marques dès son retour en Californie. Cette maison, une ravissante épouse, un métier... Ah oui, un métier... Dix tique en entendant que son ami a troqué un uniforme pour un autre, de l'Armée de l'Air à la police. En fait, il ne porte plus d'uniforme, Brub est un jeune et prometteur inspecteur de la police de Los Angeles.
Ces derniers temps, Brub et tous ses collègues doivent faire des journées à rallonge, car la police de Los Angeles traque un tueur. Un homme qui étrangle des femmes et leur dame le pion depuis trop longtemps. Tous les moyens à disposition sont déployés pour essayer de coincer cet assassin insaisissable qui semble les narguer à chaque nouveau crime...
Dix passe un moment avec ses amis, puis repart marcher dans la nuit et le brouillard avant de rentrer chez lui. Dans une résidence où vit aussi une actrice, enfin, un de ces jeunes femmes qui vient à Los Angeles en rêvant de le devenir. Elle s'appelle Laurel Gray et bientôt, l'esprit de Dix ne parvient plus à se détacher de l'image de ces deux femmes : Sylvia et Laurel...
Comme souvent, j'ai essayé d'être le plus fidèle au début du roman, mais c'est très imparfait. Il manque une foule de détails, certains pour ne pas surcharger ce résumé, d'autres parce qu'ils servent directement l'intrigue. Mais, grosso modo, voilà donc le sujet d' "Un homme dans la brume", dont l'histoire repose en grande partie sur l'ambiguïté qui entoure le personnage de Dix Steele.
Dès les premières lignes, avec cette scène inquiétante le long de la plage de Santa Monica, on s'interroge : qui est donc cet homme ? Que fait-il là, alors qu'il n'a manifestement rien à y faire ? Pourquoi suit-il cette femme ? Autant de petits trucs qui prennent soudain une autre dimension quand on découvre que Los Angeles est le terrain de chasse d'un tueur, qu'on ne dit pas encore "en série".
Alors, Dix est-il cet assassin que tout le monde recherche, à commencer par Brub Nicolai ? C'est évidemment l'un des enjeux du roman. Dorothy B. Hughes alimente ces interrogations en distillant petit à petit des informations sur cet homme étrange. Le lecteur, qui se sent suspicieux depuis cette impressionnante scène d'ouverture, a tendance à y voir de nouveaux indices.
Des indices qui manquent justement à la police, car le tueur se montre fort habile pour ne laisser aucune trace sur les lieux de ses crimes... Mais, cette impression première que l'on nourrit d'entrée pour Dix, alors qu'on ne sait même pas encore son nom, alors qu'on ne sait même pas encore qu'un tueur est recherché, tout cela suffit-il à faire de Dix cet assassin ?
A ce propos, petite parenthèse. Comme souvent, lorsqu'un roman connaît un beau succès, Hollywood s'en approche et s'en empare. "Un homme dans la brume" est donc devenu un film, réalisé par Nicholas Ray, avec Humphrey Bogart dans le rôle de Dix Steele, un rôle quasiment à contre-emploi pour l'acteur.
Mais, attention, si le film porte le même titre que le roman, "In a lonely place" (en français, le titre du film deviendra "le Violent"), les deux histoires diffèrent sensiblement. A commencer par la manière dont les scénaristes ont exploité la fameuse ambiguïté du personnage de Dix Steele, qui n'aboutit pas au même dénouement que dans le roman de Dorothy B. Hughes (ouf, je n'ai rien trahi !).
Parenthèse cinématographique, revenons au roman, ou plus exactement à la romancière. Dorothy B. Hugues est née en 1904 et sa carrière de romancière est curieusement courte, alors qu'elle a vécu près de 90 ans. En effet, sa bibliographie compte moins d'une quinzaine de titres, la plupart publiés entre 1940 et 1952, en plein âge d'or du roman noir.
Elle a surtout fait carrière comme critique, pendant près de 40 années dans différents journaux américains. Une critique spécialisée, eh oui, forcément, dans le roman policier. Il n'empêche que "Un homme dans la brume" reste encore aujourd'hui considéré comme un classique du roman noir, mais pas uniquement.
Nouvelle digression, mille excuses ! "In a lonely place" a été publié en France dès le début des années 1950, avant d'être réédité dans cette même traduction à la fin des années 1970. Comme souvent avec les traductions de cette époque, et particulièrement celles des romans noirs ou policier (cf les premières années de la Série Noire, par exemple), sont loin d'être parfaites.
Cette version, parue au printemps, bénéficie donc d'une nouvelle traduction qui se présente comme plus fidèle et respectueuse de la version originale. Je vais être franc, je suis parfaitement incompétent pour juger de la qualité d'une traduction, je ne vais donc pas vous dire si c'est bien, mieux, ou autre (rayez les mentions inutiles), mais juste parler du roman.
Mais c'est bien son statut de roman devenu un classique qui explique certainement le choix des éditions Rivages, un de nos labels noirs les plus fameux et reconnus, de proposer cette nouvelle édition dans une nouvelle traduction. Et l'un des aspects très importants d' "Un homme dans la brume", outre son atmosphère très inquiétante, c'est sa manière de réinterpréter les codes du noir.
Comme pour "Les Furies", évoqué récemment sur ce blog, je ne vais pas paraphraser dans ce billet la postface du livre de Dorothy B. Hughes. On la doit à une autre romancière spécialisée dans ce que les anglo-saxons appellent le "mystery", Megan Abbott, qui revendique avoir été énormément influencée par l'âge d'or du roman et du cinéma noirs.
Il est pourtant difficile de passer à côté de ce que Megan Abbott souligne avec une grande justesse dans sa postface. Si Dorothy B. Hughes s'intègrent parfaitement dans le contexte du roman noir, si elle accepte les règles très codifiées de ce genre, elle va pourtant s'en emparer pour les renverser, littéralement. Pour y inverser les rôles.
Le schéma classique du roman noir, c'est le détective blasé qui enquête sur une affaire qui le dépasse, touchant à des enjeux énormes et impliquant des personnalités puissantes et influentes. Au cours de son enquête, il tombe sur une femme qui va chambouler son esprit, lui faire un peu perdre le fil, de son enquête, mais aussi de sa vie, et pas toujours avec les meilleures intentions. La femme fatale...
Or, dans "Un homme dans la brume", on retrouve un schéma assez proche, mais ce sont les femmes qui mènent l'enquête, en parallèle de l'enquête officielle qui piétine. Parce qu'elles ont croisé un homme et qu'elles le soupçonne. Eh oui, Dorothy B. Hughes a inventé... l'homme fatal. Et le fait de voir Humphrey Bogart incarner ce personnage à l'écran, même dans une histoire retouchée, est plein d'ironie.
Les personnages de Sylvia et de Laurel ne sont pas des manipulatrices, comme l'archétype de la femme fatale, ou des victimes. Ce sont des femmes fortes et courageuses. Il est évidemment difficile de parler de cet aspect sans trop en dire de l'intrigue, d'autant que cela ne se déroule pas tout à fait comme on pourrait l'imaginer.
La construction narrative d' "Un homme dans la brume" est fascinante. Dès ses premières lignes, comme si l'on suivait un inconnu évoluant dans la brume comme un poisson dans l'eau, le climat, la tonalité générale sont plantés. Et le brouillard, c'est aussi ce qui entoure le lecteur un moment, le laissant incapable de savoir si Dix est ou n'est pas un assassin.
La manière dont Dorothy B. Hughes mène sont histoire, le point de vue adopté, les événements qui se produisent et ce qu'ils entraînent, tout cela est réglé au millimètre pour que le lecteur ne cesse de se poser des questions et veuille avancer pour découvrir le fin mot de cette histoire. C'est une sorte d'entonnoir, partant de l'extrémité la plus étroite, pour remonter vers la plus large.
Quant à l'atmosphère, je l'ai évoquée plusieurs fois, elle est prenante, inquiétante d'un bout à l'autre, elle s'appuie sur les doutes que la romancière à mis dans le crâne du lecteur, mais aussi sur le comportement lunatique de Dix Steele. Car il faut bien dire que la personnalité pour le moins tourmentée de cet homme est l'un des moteurs du roman.
A travers Dix Steele, Dorothy B. Hughes utilise un aspect assez original dans les années 1940, qui sera beaucoup plus utilisé par la suite : le retour d'un soldat à la vie civile après la guerre. On connaît Rambo, dont le retour au pays se passe particulièrement mal, mais le contexte post-Vietnam est différent de celui de l'après IIe Guerre mondiale.
Et pourtant, Dix se sent perdu, abandonné, peut-être même rejeté. Il peine clairement à trouver sa place, à reprendre le cours d'une vie normale. Il est tout le contraire de son ami Brub : celui-ci a un emploi fixe, une épouse, une maison... L'image idéale de l'Américain typique, bien dans sa peau et sûr de lui...
Dix, lui, est seul et conserve une terrible nostalgie de l'air... On comprend très tôt qu'il ne s'est jamais senti aussi bien qu'aux commandes de son avion, alors que les vols qu'il a effectués ne devaient pourtant pas être très sereins... En l'air, Dix se sentait libre, revenu à terre, il est comme prisonnier, comme écrasé par la pesanteur...
Ces errances nocturnes, dont le lecteur est témoin lors de la scène d'ouverture, sont le seul moyen que Dix a trouvé pour essayer de retrouver ces sensations de bien-être qu'il a perdues lorsqu'il s'est retrouvé cloué au sol une fois démobilisé, livré à lui-même après avoir été pris en charge et cadré par l'institution militaire...
Comme on ne parlait pas encore, à la fin des années 1940, de tueur en série, on ne parlait pas non plus de syndrome post-traumatique, et pourtant, Dix Steele pourrait correspondre à ce diagnostic, un soldat tellement marqué par ce qu'il a vu, ce qu'il a fait à la guerre, qu'il ne parvient pas à s'en remettre. A moins qu'il y ait autre chose, qu'il faudrait découvrir...
Si les personnages féminins de ce roman sont à mettre en avant pour leurs prises d'initiatives et leur intuition, Dix Steele, personnage central du livre, est d'une belle complexité, quasiment double, entre l'image qu'il renvoie aux autres et ce que le lecteur découvre de lui dès qu'il se retrouve seul. Un menteur, c'est une certitude, mais cela suffit-il pour faire de lui un meurtrier ?
Un soir à Santa Monica, un homme se tient face à l'océan, alors que le brouillard commence à monter. Il semble s'enivrer des sensations que procurent l'air marin et la vue de cette étendue d'eau qui paraît sans limité. Une impression de liberté que semble rechercher l'individu, arrivé là presque par hasard, après être simplement monté dans un bus.
Justement un autre bus de la même ligne arrive à ce moment-là et en descend une jeune femme, sans doute une employée qui vient de quitter son bureau et rentre chez elle. L'homme attend que le bus reparte et commence à suivre la femme alors que la brume devient de plus en plus dense...
Mais soudain, des voitures passent, et l'homme change d'avis. Il monte dans le premier bus qui arrive, sans même savoir quelle direction il prend. Finalement, il échoue dans un bar assez chic où un éclat de voix va provoquer une association d'idée. Il a entendu un mot, quelque chose comme "Brub", or un Brub, il en connaît un, et il habite justement Santa Monica.
Il appelle cet ami depuis la cabine téléphonique du bar et, peu après ces retrouvailles à distance, il arrive chez Brub Nicolai, une belle maison où ce dernier vit avec Sylvia, son épouse. La conversation s'engage autour d'un verre et l'on comprend que Brub et l'homme sorti du brouillard se connaissent depuis quelques années.
L'homme s'appelle Dix Steele et, comme Brub, il a fait la guerre dans l'Armée de l'Air. Ils ont été stationnés en Europe et sont devenus amis. Mais, depuis qu'il a quitté l'uniforme, Dix Steele peine à retrouver le cours normal de son existence, d'où ces errances nocturnes au cours desquelles il essaye de retrouver les sensations qu'il avait lorsqu'il volait.
Au contraire, Brub semble avoir juste refermé la parenthèse et avoir retrouvé ses marques dès son retour en Californie. Cette maison, une ravissante épouse, un métier... Ah oui, un métier... Dix tique en entendant que son ami a troqué un uniforme pour un autre, de l'Armée de l'Air à la police. En fait, il ne porte plus d'uniforme, Brub est un jeune et prometteur inspecteur de la police de Los Angeles.
Ces derniers temps, Brub et tous ses collègues doivent faire des journées à rallonge, car la police de Los Angeles traque un tueur. Un homme qui étrangle des femmes et leur dame le pion depuis trop longtemps. Tous les moyens à disposition sont déployés pour essayer de coincer cet assassin insaisissable qui semble les narguer à chaque nouveau crime...
Dix passe un moment avec ses amis, puis repart marcher dans la nuit et le brouillard avant de rentrer chez lui. Dans une résidence où vit aussi une actrice, enfin, un de ces jeunes femmes qui vient à Los Angeles en rêvant de le devenir. Elle s'appelle Laurel Gray et bientôt, l'esprit de Dix ne parvient plus à se détacher de l'image de ces deux femmes : Sylvia et Laurel...
Comme souvent, j'ai essayé d'être le plus fidèle au début du roman, mais c'est très imparfait. Il manque une foule de détails, certains pour ne pas surcharger ce résumé, d'autres parce qu'ils servent directement l'intrigue. Mais, grosso modo, voilà donc le sujet d' "Un homme dans la brume", dont l'histoire repose en grande partie sur l'ambiguïté qui entoure le personnage de Dix Steele.
Dès les premières lignes, avec cette scène inquiétante le long de la plage de Santa Monica, on s'interroge : qui est donc cet homme ? Que fait-il là, alors qu'il n'a manifestement rien à y faire ? Pourquoi suit-il cette femme ? Autant de petits trucs qui prennent soudain une autre dimension quand on découvre que Los Angeles est le terrain de chasse d'un tueur, qu'on ne dit pas encore "en série".
Alors, Dix est-il cet assassin que tout le monde recherche, à commencer par Brub Nicolai ? C'est évidemment l'un des enjeux du roman. Dorothy B. Hughes alimente ces interrogations en distillant petit à petit des informations sur cet homme étrange. Le lecteur, qui se sent suspicieux depuis cette impressionnante scène d'ouverture, a tendance à y voir de nouveaux indices.
Des indices qui manquent justement à la police, car le tueur se montre fort habile pour ne laisser aucune trace sur les lieux de ses crimes... Mais, cette impression première que l'on nourrit d'entrée pour Dix, alors qu'on ne sait même pas encore son nom, alors qu'on ne sait même pas encore qu'un tueur est recherché, tout cela suffit-il à faire de Dix cet assassin ?
A ce propos, petite parenthèse. Comme souvent, lorsqu'un roman connaît un beau succès, Hollywood s'en approche et s'en empare. "Un homme dans la brume" est donc devenu un film, réalisé par Nicholas Ray, avec Humphrey Bogart dans le rôle de Dix Steele, un rôle quasiment à contre-emploi pour l'acteur.
Mais, attention, si le film porte le même titre que le roman, "In a lonely place" (en français, le titre du film deviendra "le Violent"), les deux histoires diffèrent sensiblement. A commencer par la manière dont les scénaristes ont exploité la fameuse ambiguïté du personnage de Dix Steele, qui n'aboutit pas au même dénouement que dans le roman de Dorothy B. Hughes (ouf, je n'ai rien trahi !).
Parenthèse cinématographique, revenons au roman, ou plus exactement à la romancière. Dorothy B. Hugues est née en 1904 et sa carrière de romancière est curieusement courte, alors qu'elle a vécu près de 90 ans. En effet, sa bibliographie compte moins d'une quinzaine de titres, la plupart publiés entre 1940 et 1952, en plein âge d'or du roman noir.
Elle a surtout fait carrière comme critique, pendant près de 40 années dans différents journaux américains. Une critique spécialisée, eh oui, forcément, dans le roman policier. Il n'empêche que "Un homme dans la brume" reste encore aujourd'hui considéré comme un classique du roman noir, mais pas uniquement.
Nouvelle digression, mille excuses ! "In a lonely place" a été publié en France dès le début des années 1950, avant d'être réédité dans cette même traduction à la fin des années 1970. Comme souvent avec les traductions de cette époque, et particulièrement celles des romans noirs ou policier (cf les premières années de la Série Noire, par exemple), sont loin d'être parfaites.
Cette version, parue au printemps, bénéficie donc d'une nouvelle traduction qui se présente comme plus fidèle et respectueuse de la version originale. Je vais être franc, je suis parfaitement incompétent pour juger de la qualité d'une traduction, je ne vais donc pas vous dire si c'est bien, mieux, ou autre (rayez les mentions inutiles), mais juste parler du roman.
Mais c'est bien son statut de roman devenu un classique qui explique certainement le choix des éditions Rivages, un de nos labels noirs les plus fameux et reconnus, de proposer cette nouvelle édition dans une nouvelle traduction. Et l'un des aspects très importants d' "Un homme dans la brume", outre son atmosphère très inquiétante, c'est sa manière de réinterpréter les codes du noir.
Comme pour "Les Furies", évoqué récemment sur ce blog, je ne vais pas paraphraser dans ce billet la postface du livre de Dorothy B. Hughes. On la doit à une autre romancière spécialisée dans ce que les anglo-saxons appellent le "mystery", Megan Abbott, qui revendique avoir été énormément influencée par l'âge d'or du roman et du cinéma noirs.
Il est pourtant difficile de passer à côté de ce que Megan Abbott souligne avec une grande justesse dans sa postface. Si Dorothy B. Hughes s'intègrent parfaitement dans le contexte du roman noir, si elle accepte les règles très codifiées de ce genre, elle va pourtant s'en emparer pour les renverser, littéralement. Pour y inverser les rôles.
Le schéma classique du roman noir, c'est le détective blasé qui enquête sur une affaire qui le dépasse, touchant à des enjeux énormes et impliquant des personnalités puissantes et influentes. Au cours de son enquête, il tombe sur une femme qui va chambouler son esprit, lui faire un peu perdre le fil, de son enquête, mais aussi de sa vie, et pas toujours avec les meilleures intentions. La femme fatale...
Or, dans "Un homme dans la brume", on retrouve un schéma assez proche, mais ce sont les femmes qui mènent l'enquête, en parallèle de l'enquête officielle qui piétine. Parce qu'elles ont croisé un homme et qu'elles le soupçonne. Eh oui, Dorothy B. Hughes a inventé... l'homme fatal. Et le fait de voir Humphrey Bogart incarner ce personnage à l'écran, même dans une histoire retouchée, est plein d'ironie.
Les personnages de Sylvia et de Laurel ne sont pas des manipulatrices, comme l'archétype de la femme fatale, ou des victimes. Ce sont des femmes fortes et courageuses. Il est évidemment difficile de parler de cet aspect sans trop en dire de l'intrigue, d'autant que cela ne se déroule pas tout à fait comme on pourrait l'imaginer.
La construction narrative d' "Un homme dans la brume" est fascinante. Dès ses premières lignes, comme si l'on suivait un inconnu évoluant dans la brume comme un poisson dans l'eau, le climat, la tonalité générale sont plantés. Et le brouillard, c'est aussi ce qui entoure le lecteur un moment, le laissant incapable de savoir si Dix est ou n'est pas un assassin.
La manière dont Dorothy B. Hughes mène sont histoire, le point de vue adopté, les événements qui se produisent et ce qu'ils entraînent, tout cela est réglé au millimètre pour que le lecteur ne cesse de se poser des questions et veuille avancer pour découvrir le fin mot de cette histoire. C'est une sorte d'entonnoir, partant de l'extrémité la plus étroite, pour remonter vers la plus large.
Quant à l'atmosphère, je l'ai évoquée plusieurs fois, elle est prenante, inquiétante d'un bout à l'autre, elle s'appuie sur les doutes que la romancière à mis dans le crâne du lecteur, mais aussi sur le comportement lunatique de Dix Steele. Car il faut bien dire que la personnalité pour le moins tourmentée de cet homme est l'un des moteurs du roman.
A travers Dix Steele, Dorothy B. Hughes utilise un aspect assez original dans les années 1940, qui sera beaucoup plus utilisé par la suite : le retour d'un soldat à la vie civile après la guerre. On connaît Rambo, dont le retour au pays se passe particulièrement mal, mais le contexte post-Vietnam est différent de celui de l'après IIe Guerre mondiale.
Et pourtant, Dix se sent perdu, abandonné, peut-être même rejeté. Il peine clairement à trouver sa place, à reprendre le cours d'une vie normale. Il est tout le contraire de son ami Brub : celui-ci a un emploi fixe, une épouse, une maison... L'image idéale de l'Américain typique, bien dans sa peau et sûr de lui...
Dix, lui, est seul et conserve une terrible nostalgie de l'air... On comprend très tôt qu'il ne s'est jamais senti aussi bien qu'aux commandes de son avion, alors que les vols qu'il a effectués ne devaient pourtant pas être très sereins... En l'air, Dix se sentait libre, revenu à terre, il est comme prisonnier, comme écrasé par la pesanteur...
Ces errances nocturnes, dont le lecteur est témoin lors de la scène d'ouverture, sont le seul moyen que Dix a trouvé pour essayer de retrouver ces sensations de bien-être qu'il a perdues lorsqu'il s'est retrouvé cloué au sol une fois démobilisé, livré à lui-même après avoir été pris en charge et cadré par l'institution militaire...
Comme on ne parlait pas encore, à la fin des années 1940, de tueur en série, on ne parlait pas non plus de syndrome post-traumatique, et pourtant, Dix Steele pourrait correspondre à ce diagnostic, un soldat tellement marqué par ce qu'il a vu, ce qu'il a fait à la guerre, qu'il ne parvient pas à s'en remettre. A moins qu'il y ait autre chose, qu'il faudrait découvrir...
Si les personnages féminins de ce roman sont à mettre en avant pour leurs prises d'initiatives et leur intuition, Dix Steele, personnage central du livre, est d'une belle complexité, quasiment double, entre l'image qu'il renvoie aux autres et ce que le lecteur découvre de lui dès qu'il se retrouve seul. Un menteur, c'est une certitude, mais cela suffit-il pour faire de lui un meurtrier ?
lundi 26 août 2019
"Prenez garde (...) Vous serez peut-être amenée à choisir votre bord. Celui de Dulcie... Ou le nôtre".
La citation placée en titre de ce billet n'est guère claire, j'en conviens, elle ne donne pas beaucoup d'indice sur le roman lui-même, et pourtant, elle met en évidence un des thèmes forts non seulement de ce polar historique, mais certainement de la série dont il fait partie : la notion de classes sociales très marquée et le gouffre impossible à combler entre elles. Un an après "L'Assassin du train", voilà la nouvelle enquête des Soeurs Mitford, "Le Gang de la Tamise" (en grand format aux éditions du Masque ; traduction de Valérie Rosier), deuxième volet de la série imaginée par Jessica Fellowes, construite autour de cette grande famille aristocratique, dont les six filles ont connu des destins mémorables... Un deuxième tome qui précise les probables intentions de la romancière, après une première enquête assez surprenante, puisque les Soeurs y étaient très jeunes, seule Nancy pouvant enquêter (je mettrais bien des guillemets à ce mot). Un deuxième tome qui pourrait aussi marquer un tournant entre les personnages principaux de cette série...
A la fin du mois de novembre 1925, Pamela Mitford célébrera ses 18 ans, âge qui marquera son entrée dans le monde. Mais, si Nancy, sa soeur aînée, était très impatiente, quelques années plus tôt, de franchir ce cap, elle qui est exubérante, portée sur la fête, fière d'appartenir à la jeunesse dorée d'Angleterre, il n'en va pas de même pour sa cadette.
Pamela est beaucoup plus réservée, timide, même, elle fréquente peu la ville et les soirées, préférant la nature, les animaux, le calme et la solitude. D'ailleurs, les tentatives de Nancy pour aider Pamela à se faire des connaissances et à se faire connaître du "Grand Monde" n'ont guère de succès. L'adolescente ne se sent pas du tout à sa place dans ce milieu.
Nancy ne se soucie guère des états d'âme de sa soeur. Au contraire, son anniversaire lui a donné une idée : organiser une fête à Asthall Manor, la demeure de la famille Mitford, propriété de Lord et Lady Redesdale. Une demeure tranquille, bien trop tranquille pour Nancy, qui s'y ennuie terriblement, et où on ne lui permet pas de mener sa vie comme elle voudrait.
Mais là, comment refuser à Pamela cette fête ? Un bal masqué, voilà une formidable idée ! Et Nancy d'imaginer déjà les activités qu'on pourra organiser dans et autour du manoir, mais aussi la liste des invités... En fait, cette dernière est très courte, si on y inscrit les amis de Pamela. En fait, elle n'a pas d'amis. Mais Nancy, en revanche, en a plein, et c'est donc eux qu'on conviera !
C'est peu dire qu'à Asthall Manor, on regimbe à l'idée de cette soirée... Mais il semble difficile de dire non, pour une fois... Alors, on lance les invitations et on se prépare fébrilement à accueillir ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, tous issus d'excellentes familles, mais turbulents, fêtards et, le redoute-t-on, un peu trop libres dans leur manière de s'amuser...
Le grand jour arrive, Nancy est comme un poisson dans l'eau en maîtresse de cérémonie, tandis que Pamela ne semble avoir qu'une hâte : que cette soirée passe. Après dîner, les adultes se retirent et la jeunesse commence à s'amuser. Une chasse au trésor est lancée, soigneusement mise au point par Nancy. Voilà les invités lancés dans la maison, et même dehors.
Juste à côté d'Asthall Manor se trouve une église et son cimetière attenant. Pas tout à fait l'endroit le plus attirant par une froide et sombre soirée d'hiver, comme celle-ci. Et pourtant, c'est là que va se produire un drame terrible, mettant un brutal coup d'arrêt à la fête. Le jeune Adrian Curtis est victime d'une chute mortelle depuis le clocher de l'église...
Accident, suicide ou... meurtre ? Une fois la police appelée sur place, une idée va vite s'imposer : à côté du corps, lorsqu'il a été découvert, se tenait une jeune femme, appelée Dulcie Long. Au contraire des invités, elle n'appartient pas à une des grandes familles du royaume. Au contraire, elle n'est que servante, ce qui fait d'elle immédiatement la coupable idéale de ce meurtre...
Une décision hâtive, qui scandalise Louisa Cannon, la bonne d'enfants des Mitford, qui jouait un peu le rôle de chaperonne lors de cette soirée. Pour la jeune femme, qui a trouvé sa place au sein de la maison Redesdale, cette arrestation est abusive, elle ne repose sur aucun élément concret, simplement sur le fait que Dulcie est une domestique et pas une aristocrate !
Un lien de classe s'est noué entre les deux femmes, qui s'étaient rencontrées lors de la sortie de Pamela à Londres. Louise avait même accompagné Dulcie dans un bar d'un quartier assez mal famé, où elle avait appris un certain nombre de choses sur celle qu'elle ne peut encore considérer comme une amie, plus comme une collègue.
Mais, à l'occasion de cette sortie, Louisa a appris quelque chose sur Dulcie qui ne peut qu'aggraver sa situation : avant de devenir domestique, Dulcie a appartenu à une célèbre bande, dont la réputation ne fait que croître à Londres et met la police métropolitaine sur les dents : les Quarante Voleuses, dont la principale figure s'appelle Alice Diamond...
Pourtant, Louisa est persuadée que Dulcie est innocente et victime de préjugés de classes. Elle décide donc de mener l'enquête, malgré les avertissements de Nancy en particulier, qui lui rappelle que défendre Dulcie, c'est choisir un camp, un camp qui n'est pas celui des Mitford... Sans être une menace, ces mots frappent Louisa, qui commence à cogiter sur sa situation...
Avant d'aller plus loin, quelques éléments rapides : si vous ne connaissez pas les soeurs Mitford, je vous encourage à vous renseigner, j'avais évoqué leur histoire dans le billet sur "L'Assassin du train", je ne vais pas le refaire, ce serait redondant. Ces six soeurs sont les fils conducteurs de cette série, dont commence à se dessiner certains principes.
En effet, les soeurs restent très jeunes. Nancy est la seule adulte, elle qui était encore adolescente dans le premier tome. Les dernières sont encore toutes jeunes et "Le Gang de la Tamise" est centré sur Pamela, la deuxième des soeurs, même si sa personnalité assez effacée n'en fait pas tout à fait le moteur de cette histoire.
Mais, cela pourrait nous indiquer que Jessica Fellowes va faire de chaque soeur à son tour le point de départ de ses intrigues. Des intrigues où la fiction se mêlent aux faits historiques. Dans "L'Assassin du train", c'était l'un des plus anciens "cold cases" du Royaume-Uni, dans celui-ci, la romancière évoque l'un des plus fameux gangs ayant sévi, et pendant un long moment, à Londres.
On les appelle les "Quarante voleuses", donc, et la référence est claire ; on les surnommait aussi les Forty Elephants, en référence au carrefour d'Elephant ans Castle, quartier du sud de Londres où ce gang s'est formé. Outre la longueur de la période au cours desquels ses membres ont agi, ce gang a une particularité très intéressante : il était exclusivement composé de femmes...
On est dans les années 1920, et dans le sillage de la Ie Guerre mondiale, les femmes essayent de s'émanciper de l'écrasante tutelle masculine. Les Quarante voleuses en sont un exemple, pour les classes les plus populaires de la société, qui n'avaient guère d'autres possibilités de se sortir du déterminisme imposé par la société britannique.
Jessica Fellowes intègre ce gang et ses activités dans son roman, on y reviendra plus loin, nous raconte ainsi cette étonnante histoire, ou du moins nous incite à nous y intéresser de plus près. Et puis, on croise, brièvement, c'est vrai, la fameuse Alice Diamond, légendaire cheffe du gang et femme d'exception dont la vie, le caractère, le charisme feraient de parfaits sujets pour un roman.
Mais il existe, parmi de nombreuses autres certainement, une manifestation différente d'émancipation que l'on croise dans "Le Gang de la Tamise" : la garçonne. Ces femmes s'affirment par leur style vestimentaire, leur coiffure, leur maquillage, ou encore le fait de fumer. Mais elles revendiquent surtout haut et fort ne plus avoir de compte à rendre à personne et vouloir être les égales des hommes.
Dans le livre de Jessica Fellowes, Nancy a déjà adopté un style à la garçonne, mais dans son cas, c'est plus par effet de mode. On voit, à un moment, Louisa changer de coiffure et adopter la coupe à la garçonne, choix fait sur un coup de tête, pour s'affirmer au moment où ses réflexions sur sa position sociale deviennent de plus en plus forte.
Au-delà de l'enquête elle-même et de sa résolution, Louisa s'embarque tout au long du roman dans une réflexion sociale très ambivalente. D'une part, elle se souvient d'où elle vient, de cette misère crasse dans laquelle elle a grandi et dont l'embauche chez les Mitford l'a sortie ; d'autre part, elle est mieux placée que quiconque pour se rendre compte que jamais elle ne pourra s'élever à cette hauteur.
La société britannique est alors une société de castes, et Louisa s'en rend plus que jamais compte suite à la rencontre de Dulcie. Ce qui la frappe, c'est qu'elle se reconnaît en Dulcie, elle voit celle qu'elle aurait pu devenir si elle avait glisser du mauvais côté de la misère. Elle se dit qu'elle aurait parfaitement pu devenir une des Quarante Voleuses et qu'elle pourrait être accusée elle aussi.
L'injustice que vit Dulcie, Louisa la ressent de plein fouet, au point de s'interroger sur sa situation. Sur son emploi au sein d'Asthall Manor. Est-ce vraiment sa place ? Plus les soeurs grandissent et plus elle ressent sa position d'infériorité, ce qu'elle vit mal, sans doute pas "programmée", comme les autres membres de la livrée.
Quand je parle de tournant, c'est là qu'il se situe, en vue de la suite de la série. Louisa va certainement faire des choix, va aussi évoluer en s'affirmant et en recherchant un idéal qui cadre mal avec le conservatisme aristocratique des Mitford. On est, d'une certaine manière, à un tournant aussi de la société britannique, qui va subir de vraies mutations dans cette période.
Louisa est dans une position intermédiaire : les Mitford sont inaccessibles, elle ne sera jamais comme eux, même si elle rencontrait un homme riche, un aristocrate, pourquoi pas, et qu'il l'épousait. Mais elle a su s'élever par rapport à Dulcie et laisser derrière elle la pauvreté. Et de cela, elle culpabilise, lorsqu'elle assiste à l'enquête à charge contre Dulcie.
Elle se sent redevable envers elle et cette phrase dite par la jeune servante, "c'est toujours nous qu'on soupçonne en premier" lui tourne en boucle dans la tête. Découvrir la vérité, ou plus exactement apporter la preuve de l'innocence de Dulcie, les deux étant indissociables, elle en est sûre, devient une mission, une manière de rembourser sa dette envers Dulcie. De se rédimer, aussi.
Si vous avez lu "L'Assassin du train" ou le billet consacré à ce premier tome, vous aurez noté qu'il manque un personnage dans le billet sur "Le Gang de la Tamise". Ce personnage, c'est Guy Sullivan, qui ne travaille plus pour une compagnie de chemin de fer, mais a réussi à obtenir sa mutation au sein de la police métropolitaine, réalisant ainsi son rêve.
Un rêve qui a pourtant tourné court... Est-ce sa mauvaise vue, ou le manque de confiance que lui accorde son supérieur, Guy n'est pas devenu l'agent de terrain, l'enquêteur hors pair qu'il voudrait être. Non, on le cantonne à l'accueil, où il ronge son frein, et la patience commence à lui manquer... Il voudrait qu'on lui laisse faire ses preuves, juste une fois...
Or, en cette année 1925, les Quarante Voleuses multiplient les vols à l'étalage dans les grands magasins de Londres. Ses membres sont insaisissables et la police est sérieusement critiquée. Aussi décide-t-on de lancer toutes les forces vives dans cette bataille contre ces femmes pleines de culot qui les nargue et connaissent tous les trucs pour déjouer les plans de la Métropolitaine.
Guy va sauter sur l'occasion, en compagnie de l'agent Moon. Mary Moon, oui, une femme, sans doute une des rares femmes policières à l'époque, ce qui lui vaut de subir à peu près le même sort que Guy. Alors, entre parias, ils vont s'y coller, se lancer dans cette enquête qui peut leur permettre de sortir de leur placard professionnel.
Guy et Louisa sont restés en contact, même si leur relation est restée essentiellement épistolaire, mais cette histoire va leur permettre de se croiser une nouvelle fois. Et Guy va même tenir un rôle important dans l'enquête qui est au coeur du "Gang de la Tamise", un rôle qu'on pourrait croire tout droit sorti d'un roman d'Agatha Christie.
Dans "Le Gang de la Tamise", Jessica Fellowes nous plonge au coeur d'une jeunesse dorée dont les membres savent quelle place ils sont appelés à occuper dans la société et en jouent. Ils sont assez insupportables, imbus d'eux-mêmes, vaniteux et affichent leur supériorité à chaque occasion. On comprend presque les craintes de Lord et Lady Redesdale à voir Nancy trop fréquenter ce monde-là.
Mais il faut bien que jeunesse se passe, et il n'y aurait pas eu de mal si l'un d'entre eux n'avait pas chuter du haut d'un clocher. Reste à savoir qui est l'assassin et son mobile. Est-il, comme le pense la police, le fruit d'une jalousie de classe ou la vengeance d'une domestique envers un maître qui aurait abusé se sa position ? Ou bien faut-il chercher ailleurs les causes de ce drame ?
Vous l'avez compris, l'enjeu de cette enquête va au-delà de la simple recherche de la vérité, car la classe à laquelle appartient ou appartiennent le, la ou les coupables, les conséquences seront bien différentes. Néanmoins, quelle que soit cette vérité, elle aura déjà influencé la vie, la manière de penser et les choix de Louisa, qui a goûté pour la première fois, du bout des lèvres, à la rébellion.
A la fin du mois de novembre 1925, Pamela Mitford célébrera ses 18 ans, âge qui marquera son entrée dans le monde. Mais, si Nancy, sa soeur aînée, était très impatiente, quelques années plus tôt, de franchir ce cap, elle qui est exubérante, portée sur la fête, fière d'appartenir à la jeunesse dorée d'Angleterre, il n'en va pas de même pour sa cadette.
Pamela est beaucoup plus réservée, timide, même, elle fréquente peu la ville et les soirées, préférant la nature, les animaux, le calme et la solitude. D'ailleurs, les tentatives de Nancy pour aider Pamela à se faire des connaissances et à se faire connaître du "Grand Monde" n'ont guère de succès. L'adolescente ne se sent pas du tout à sa place dans ce milieu.
Nancy ne se soucie guère des états d'âme de sa soeur. Au contraire, son anniversaire lui a donné une idée : organiser une fête à Asthall Manor, la demeure de la famille Mitford, propriété de Lord et Lady Redesdale. Une demeure tranquille, bien trop tranquille pour Nancy, qui s'y ennuie terriblement, et où on ne lui permet pas de mener sa vie comme elle voudrait.
Mais là, comment refuser à Pamela cette fête ? Un bal masqué, voilà une formidable idée ! Et Nancy d'imaginer déjà les activités qu'on pourra organiser dans et autour du manoir, mais aussi la liste des invités... En fait, cette dernière est très courte, si on y inscrit les amis de Pamela. En fait, elle n'a pas d'amis. Mais Nancy, en revanche, en a plein, et c'est donc eux qu'on conviera !
C'est peu dire qu'à Asthall Manor, on regimbe à l'idée de cette soirée... Mais il semble difficile de dire non, pour une fois... Alors, on lance les invitations et on se prépare fébrilement à accueillir ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, tous issus d'excellentes familles, mais turbulents, fêtards et, le redoute-t-on, un peu trop libres dans leur manière de s'amuser...
Le grand jour arrive, Nancy est comme un poisson dans l'eau en maîtresse de cérémonie, tandis que Pamela ne semble avoir qu'une hâte : que cette soirée passe. Après dîner, les adultes se retirent et la jeunesse commence à s'amuser. Une chasse au trésor est lancée, soigneusement mise au point par Nancy. Voilà les invités lancés dans la maison, et même dehors.
Juste à côté d'Asthall Manor se trouve une église et son cimetière attenant. Pas tout à fait l'endroit le plus attirant par une froide et sombre soirée d'hiver, comme celle-ci. Et pourtant, c'est là que va se produire un drame terrible, mettant un brutal coup d'arrêt à la fête. Le jeune Adrian Curtis est victime d'une chute mortelle depuis le clocher de l'église...
Accident, suicide ou... meurtre ? Une fois la police appelée sur place, une idée va vite s'imposer : à côté du corps, lorsqu'il a été découvert, se tenait une jeune femme, appelée Dulcie Long. Au contraire des invités, elle n'appartient pas à une des grandes familles du royaume. Au contraire, elle n'est que servante, ce qui fait d'elle immédiatement la coupable idéale de ce meurtre...
Une décision hâtive, qui scandalise Louisa Cannon, la bonne d'enfants des Mitford, qui jouait un peu le rôle de chaperonne lors de cette soirée. Pour la jeune femme, qui a trouvé sa place au sein de la maison Redesdale, cette arrestation est abusive, elle ne repose sur aucun élément concret, simplement sur le fait que Dulcie est une domestique et pas une aristocrate !
Un lien de classe s'est noué entre les deux femmes, qui s'étaient rencontrées lors de la sortie de Pamela à Londres. Louise avait même accompagné Dulcie dans un bar d'un quartier assez mal famé, où elle avait appris un certain nombre de choses sur celle qu'elle ne peut encore considérer comme une amie, plus comme une collègue.
Mais, à l'occasion de cette sortie, Louisa a appris quelque chose sur Dulcie qui ne peut qu'aggraver sa situation : avant de devenir domestique, Dulcie a appartenu à une célèbre bande, dont la réputation ne fait que croître à Londres et met la police métropolitaine sur les dents : les Quarante Voleuses, dont la principale figure s'appelle Alice Diamond...
Pourtant, Louisa est persuadée que Dulcie est innocente et victime de préjugés de classes. Elle décide donc de mener l'enquête, malgré les avertissements de Nancy en particulier, qui lui rappelle que défendre Dulcie, c'est choisir un camp, un camp qui n'est pas celui des Mitford... Sans être une menace, ces mots frappent Louisa, qui commence à cogiter sur sa situation...
Avant d'aller plus loin, quelques éléments rapides : si vous ne connaissez pas les soeurs Mitford, je vous encourage à vous renseigner, j'avais évoqué leur histoire dans le billet sur "L'Assassin du train", je ne vais pas le refaire, ce serait redondant. Ces six soeurs sont les fils conducteurs de cette série, dont commence à se dessiner certains principes.
En effet, les soeurs restent très jeunes. Nancy est la seule adulte, elle qui était encore adolescente dans le premier tome. Les dernières sont encore toutes jeunes et "Le Gang de la Tamise" est centré sur Pamela, la deuxième des soeurs, même si sa personnalité assez effacée n'en fait pas tout à fait le moteur de cette histoire.
Mais, cela pourrait nous indiquer que Jessica Fellowes va faire de chaque soeur à son tour le point de départ de ses intrigues. Des intrigues où la fiction se mêlent aux faits historiques. Dans "L'Assassin du train", c'était l'un des plus anciens "cold cases" du Royaume-Uni, dans celui-ci, la romancière évoque l'un des plus fameux gangs ayant sévi, et pendant un long moment, à Londres.
On les appelle les "Quarante voleuses", donc, et la référence est claire ; on les surnommait aussi les Forty Elephants, en référence au carrefour d'Elephant ans Castle, quartier du sud de Londres où ce gang s'est formé. Outre la longueur de la période au cours desquels ses membres ont agi, ce gang a une particularité très intéressante : il était exclusivement composé de femmes...
On est dans les années 1920, et dans le sillage de la Ie Guerre mondiale, les femmes essayent de s'émanciper de l'écrasante tutelle masculine. Les Quarante voleuses en sont un exemple, pour les classes les plus populaires de la société, qui n'avaient guère d'autres possibilités de se sortir du déterminisme imposé par la société britannique.
Jessica Fellowes intègre ce gang et ses activités dans son roman, on y reviendra plus loin, nous raconte ainsi cette étonnante histoire, ou du moins nous incite à nous y intéresser de plus près. Et puis, on croise, brièvement, c'est vrai, la fameuse Alice Diamond, légendaire cheffe du gang et femme d'exception dont la vie, le caractère, le charisme feraient de parfaits sujets pour un roman.
Mais il existe, parmi de nombreuses autres certainement, une manifestation différente d'émancipation que l'on croise dans "Le Gang de la Tamise" : la garçonne. Ces femmes s'affirment par leur style vestimentaire, leur coiffure, leur maquillage, ou encore le fait de fumer. Mais elles revendiquent surtout haut et fort ne plus avoir de compte à rendre à personne et vouloir être les égales des hommes.
Dans le livre de Jessica Fellowes, Nancy a déjà adopté un style à la garçonne, mais dans son cas, c'est plus par effet de mode. On voit, à un moment, Louisa changer de coiffure et adopter la coupe à la garçonne, choix fait sur un coup de tête, pour s'affirmer au moment où ses réflexions sur sa position sociale deviennent de plus en plus forte.
Au-delà de l'enquête elle-même et de sa résolution, Louisa s'embarque tout au long du roman dans une réflexion sociale très ambivalente. D'une part, elle se souvient d'où elle vient, de cette misère crasse dans laquelle elle a grandi et dont l'embauche chez les Mitford l'a sortie ; d'autre part, elle est mieux placée que quiconque pour se rendre compte que jamais elle ne pourra s'élever à cette hauteur.
La société britannique est alors une société de castes, et Louisa s'en rend plus que jamais compte suite à la rencontre de Dulcie. Ce qui la frappe, c'est qu'elle se reconnaît en Dulcie, elle voit celle qu'elle aurait pu devenir si elle avait glisser du mauvais côté de la misère. Elle se dit qu'elle aurait parfaitement pu devenir une des Quarante Voleuses et qu'elle pourrait être accusée elle aussi.
L'injustice que vit Dulcie, Louisa la ressent de plein fouet, au point de s'interroger sur sa situation. Sur son emploi au sein d'Asthall Manor. Est-ce vraiment sa place ? Plus les soeurs grandissent et plus elle ressent sa position d'infériorité, ce qu'elle vit mal, sans doute pas "programmée", comme les autres membres de la livrée.
Quand je parle de tournant, c'est là qu'il se situe, en vue de la suite de la série. Louisa va certainement faire des choix, va aussi évoluer en s'affirmant et en recherchant un idéal qui cadre mal avec le conservatisme aristocratique des Mitford. On est, d'une certaine manière, à un tournant aussi de la société britannique, qui va subir de vraies mutations dans cette période.
Louisa est dans une position intermédiaire : les Mitford sont inaccessibles, elle ne sera jamais comme eux, même si elle rencontrait un homme riche, un aristocrate, pourquoi pas, et qu'il l'épousait. Mais elle a su s'élever par rapport à Dulcie et laisser derrière elle la pauvreté. Et de cela, elle culpabilise, lorsqu'elle assiste à l'enquête à charge contre Dulcie.
Elle se sent redevable envers elle et cette phrase dite par la jeune servante, "c'est toujours nous qu'on soupçonne en premier" lui tourne en boucle dans la tête. Découvrir la vérité, ou plus exactement apporter la preuve de l'innocence de Dulcie, les deux étant indissociables, elle en est sûre, devient une mission, une manière de rembourser sa dette envers Dulcie. De se rédimer, aussi.
Si vous avez lu "L'Assassin du train" ou le billet consacré à ce premier tome, vous aurez noté qu'il manque un personnage dans le billet sur "Le Gang de la Tamise". Ce personnage, c'est Guy Sullivan, qui ne travaille plus pour une compagnie de chemin de fer, mais a réussi à obtenir sa mutation au sein de la police métropolitaine, réalisant ainsi son rêve.
Un rêve qui a pourtant tourné court... Est-ce sa mauvaise vue, ou le manque de confiance que lui accorde son supérieur, Guy n'est pas devenu l'agent de terrain, l'enquêteur hors pair qu'il voudrait être. Non, on le cantonne à l'accueil, où il ronge son frein, et la patience commence à lui manquer... Il voudrait qu'on lui laisse faire ses preuves, juste une fois...
Or, en cette année 1925, les Quarante Voleuses multiplient les vols à l'étalage dans les grands magasins de Londres. Ses membres sont insaisissables et la police est sérieusement critiquée. Aussi décide-t-on de lancer toutes les forces vives dans cette bataille contre ces femmes pleines de culot qui les nargue et connaissent tous les trucs pour déjouer les plans de la Métropolitaine.
Guy va sauter sur l'occasion, en compagnie de l'agent Moon. Mary Moon, oui, une femme, sans doute une des rares femmes policières à l'époque, ce qui lui vaut de subir à peu près le même sort que Guy. Alors, entre parias, ils vont s'y coller, se lancer dans cette enquête qui peut leur permettre de sortir de leur placard professionnel.
Guy et Louisa sont restés en contact, même si leur relation est restée essentiellement épistolaire, mais cette histoire va leur permettre de se croiser une nouvelle fois. Et Guy va même tenir un rôle important dans l'enquête qui est au coeur du "Gang de la Tamise", un rôle qu'on pourrait croire tout droit sorti d'un roman d'Agatha Christie.
Dans "Le Gang de la Tamise", Jessica Fellowes nous plonge au coeur d'une jeunesse dorée dont les membres savent quelle place ils sont appelés à occuper dans la société et en jouent. Ils sont assez insupportables, imbus d'eux-mêmes, vaniteux et affichent leur supériorité à chaque occasion. On comprend presque les craintes de Lord et Lady Redesdale à voir Nancy trop fréquenter ce monde-là.
Mais il faut bien que jeunesse se passe, et il n'y aurait pas eu de mal si l'un d'entre eux n'avait pas chuter du haut d'un clocher. Reste à savoir qui est l'assassin et son mobile. Est-il, comme le pense la police, le fruit d'une jalousie de classe ou la vengeance d'une domestique envers un maître qui aurait abusé se sa position ? Ou bien faut-il chercher ailleurs les causes de ce drame ?
Vous l'avez compris, l'enjeu de cette enquête va au-delà de la simple recherche de la vérité, car la classe à laquelle appartient ou appartiennent le, la ou les coupables, les conséquences seront bien différentes. Néanmoins, quelle que soit cette vérité, elle aura déjà influencé la vie, la manière de penser et les choix de Louisa, qui a goûté pour la première fois, du bout des lèvres, à la rébellion.
‹‹ Quand les gens parlaient des Jefford, ils ne pensaient ni à Dan (...), ni à Clay (...) : non, quand on disait "les Jefford", ça voulait dire : "Temple et Vance" ››.
Un petit tour dans "L'Ouest, le vrai", pour reprendre le nom de la collection western des éditions Actes Sud, dans laquelle la maison d'édition arlésienne réédite des classiques du genre, sous la houlette de Bertrand Tavernier. Et la récente mouture concerne un roman de la fin des années 1940, dont l'une des particularités remarquables est de donner le rôle principal à un personnage féminin. Un drame familial sur fond d'argent et de pouvoir où l'adage devient "Tel père, telle fille". "Les Furies", de Niven Busch (traduction de José André Lacour et Gilles Dantin) est un western à l'action implacable, où la succession annoncée et souhaitée ne va pourtant pas du tout se passer comme prévue et va entraîner un duel sans merci entre un père et sa fille préférée. C'est âpre, sans pitié, violent et porté par des personnages très intéressants...
Pour avoir participé à la guerre de libération du Texas, le père de Temple Jefford a été récompensé par la jeune république née de cette révolution. Pas en argent sonnant et trébuchant, les dirigeants du nouvel Etat n'en possédaient pas suffisamment, mais en terres. Dan Jefford est donc devenu un propriétaire terrien et un éleveur prospère. Jusqu'à ce qu'une nouvelle guerre ne lui coûte la vie.
Son fils Temple a pris la relève, mais plus au Texas : il a fondé un ranch au Nouveau-Mexique (qui n'est alors qu'un "territoire organisé" et ne deviendra le 47e Etat des Etats-Unis qu'en 1912) dont il a non seulement su faire un des ranchs les plus riches de la région, mais aussi le coeur d'une enclave entièrement régentée par Temple.
Signes visibles de cette puissance, la gare qui dessert le ranch et porte le nom de "Jefford's", avec ce possessif qui en dit long, mais aussi le fait que le maître des lieux frappe sa propre monnaie... Temple Jefford est une espèce d'empereur, qui ne laisse à personne la direction des affaires permettant à cette machine de tourner.
Pourtant, depuis la mort de sa femme, Temple a délaissé Birdfoot. Voilà même un long moment qu'il n'y a plus mis les pieds, laissant la gestion à ses enfants, Dan et Clay, ses deux garçons, et Vance, sa fille, âgée de 19 ans, la prunelle de ses yeux. Les mauvaises langues disent qu'il s'est installé chez une maîtresse, l'une des nombreuses maîtresses qu'il a eues au cours de sa vie.
En cette journée de 1889, Birdfoot est en ébullition : le maître des lieux a annoncé son retour. On remet rapidement les choses en ordre et l'on se prépare à accueillir ce père, si longtemps absent. Vance est particulièrement impatiente de retrouver Temple, dont elle a toujours été très proche. Elle est sa préférée, et elle le sait.
Au contraire, elle n'a jamais été en phase avec sa mère, qui couvait ses deux garçons. Au sein du clan Jefford, les lignes de fracture sont donc clairement définies, et la mort prématurée de Catharine a donné l'avantage à Temple et Vance : le père ne fait aucune confiance à ses fils, qu'il juge faibles et manquant d'étoffe, et il est évident pour lui que c'est sa fille qui lui succédera à la tête du domaine.
Mais Vance va sérieusement déchanter, car lors de ce retour du père prodigue, elle va sentir que la volonté de son père a fléchi... Temple semble avoir changé de point de vue et certains éléments intriguent la jeune femme. Il y a quelque chose de changé au royaume des Jefford, et cela ne va pas dans le sens de cette ambitieuse demoiselle, qui a hérité (déjà !) du caractère de son père.
Et bientôt, Vance va comprendre d'où vient le problème ; il s'appelle Flo. Flo Burnett, ou plus exactement, d'ici peu, Flo Jefford... Temple est de nouveau amoureux et il a décidé de se remarier... Stupeur chez Vance, qui va encore s'accroître quand elle va rencontrer sa future belle-mère. Une aventurière, elle en est certaine, qui n'en veut qu'à l'argent de la famille...
Vexée, fâchée, Vance va alors déclarer la guerre à son père, avec l'idée clairement énoncée de le renverser et de prendre sa place. Coûte que coûte. Si tout le monde, à Birdfoot et aux alentours, sait depuis toujours que Vance est l'enfant de Temple qui ressemble le plus à Temple, dure, déterminée et prête à tout, cela présage d'un terrible bras de fer pour prendre les rênes de l'empire Jefford...
Il est à la fois amusant et un peu stressant de parler des romans de la collection "L'Ouest, le Vrai", car les postfaces de Bertrand Tavernier sont des mines d'informations, des supports passionnants et érudits à la lecture. Mais, évidemment, il y évoque les grandes lignes et les thèmes majeurs que l'auteur y développe et le blogueur risque de paraphraser...
Mais je vous encourage vraiment à lire ces pages qui vont non seulement replacer "Les Furies" dans son contexte, mais aussi offrir quelques moments de gloire, en particulier un portrait bien peu flatteur, féroce même, d'un des pontes de cet âge d'or hollywoodien, le producteur David O. Selznick, celui qui fit venir Hitchcock aux Etats-Unis, par exemple.
Il y évoque aussi Niven Busch, auteur de ce western tragique, à l'intrigue de tragédie antique, dont le nom n'est pas forcément très connu. Et pourtant, sa carrière littéraire et cinématographique est assez remarquable, citons le scénario du "Facteur sonne toujours deux fois" (première version, celle de 1946) ou encore le roman "Duel au soleil", acheté et adapté par Selznick, avec un casting de rêve.
"Les Furies" également a eu le droit aux honneurs du cinéma, avec une réalisation d'Anthony Mann et Barbara Stanwyck dans le rôle de Vance Jefford (en cherchant un peu, on doit le trouver assez facilement sur le net). Et je n'en dirai pas plus, pour l'encyclopédie vivante du cinéma, voyez avec Bertrand Tavernier, nettement mieux placé que moi...
Revenons au roman, avec cette histoire aux allures de tragédie antique, disais-je plus haut, jusque dans ce titre, "les Furies", qui a plusieurs sens... On peut le prendre au pied de la lettre, et c'est vrai que le trio Catharine (la mère, qu'on ne voit pas mais qu'on devine peu commode), Vance (la fille) et Flo (la belle-mère) correspond assez bien à ce mot : mieux vaut ne pas encourir leur colère !
Et puis, il y a la mythologique latine, dans laquelle les Furies sont des divinités persécutrices, rien que ça... Il y a Alecto, l'implacable, Tisiphone, la vengeance, et sans doute la plus connue, puisque son nom est entré dans le langage courant, Mégère, la haine... Je vous laisse répartir les rôles ! Mais il est certain que cela colle bien au roman de Niven Busch...
Laissons la mère et la belle-mère, car le personnage central, et ce n'est pas si ordinaire pour un western écrit dans les années 1940 (on avait déjà évoqué cette question dans le billet sur "Femme de feu", autre roman de cette même collection), c'est Vance. Elle n'a donc pas encore 20 ans quand s'ouvre le livre, mais elle affiche déjà une impressionnante maturité.
Disons les choses clairement : en l'absence de son père, c'est elle qui commande, et les hommes, ses frères, mais pas qu'eux, marchent au pas devant son autorité naturelle. Dès la scène d'ouverture, elle congédie son amant, un jeune homme d'origine mexicaine, bien consciente que sa présence à ses côtés ne plairait pas à son père. Les sentiments ? Oh, peut-être, mais après les affaires, alors !
C'est là qu'on voit qu'elle connaît remarquablement son père... En effet, une des premières annonces que va faire Temple à son retour à Birdfoot consiste à interdire à Vance de se marier, sous peine de tout perdre... Première entorse à la complicité entre le père et la fille, premier acte de ce qui va dégénérer en une lutte sans pitié...
En ne tenant pas les promesses qu'il lui a faites, Temple ouvre les hostilités sans forcément se rendre compte de son erreur. Il a beau savoir que sa fille tient beaucoup de lui (on surnomme Vance "la Temple en jupon", en son absence, évidemment), son amour pour Flo lui fait oublier l'évidence : remettre en question la succession promise ne peut pas faire plaisir à Vance...
Face à cette demoiselle au caractère volcanique, c'est peu de le dire, un père qui est un self-made-man, qui a construit un véritable empire. Le mot n'est pas choisi au hasard : Vance est fasciné par Napoléon Ier, qui est le sujet de ses lectures, un véritable modèle. Je ne sais pas si René Goscinny connaissait "les Furies", mais il y a chez Temple Jefford un petit côté "Empereur Smith"...
Pourtant, au fil des événements racontés dans le livre, on va découvrir une information très importante, qui va placer la rivalité père/fille sur un autre plan, nettement plus personnel. Deux orgueils démesurés qui s'affrontent violemment, En effet, on comprend bientôt que l'empire Jeffrey a tout d'un colosse aux pieds d'argile. En résumé : la puissance n'est pas la richesse...
Il y a dans ce duel presque oedipien entre Temple et Vance l'impression d'une véritable passation de pouvoir, même si cela va se faire au prix fort. Lorsque je parlais de bras de fer, il y a véritablement de cela, car on a la sensation que Vance fait plier son père, il se ratatine quand Vance met en évidence ce qu'on doit pouvoir qualifier d'imposture.
Et soudain, le Vance impitoyable, homme d'affaire intraitable, l'empereur inflexible apparaît, comme la plupart des personnages masculins, en retrait par rapport aux personnages féminins (et cela vaut pour les personnages secondaires également). Et si la guerre déclarée par Vance à son père était surtout une guerre déclarée à Flo ?
Il faut dire que, à partir de l'apparition de la future belle-mère, la violence se déchaîne, les Furies se réveillent, et c'est impressionnant. Une scène, en particulier, me revient à l'esprit, un lynchage en bonne et due forme qui symbolise parfaitement le passage d'un point de non-retour. La guerre ne s'arrêtera pas au premier sang, il n'y aura pas de quartier !
Outre la question familiale et la place donnée aux femmes dans ce livre, Niven Busch aborde d'autres sujets qui font de la trame de ce roman une histoire très actuelle. A commencer par la question raciale, avec la place donnée aux personnages hispaniques, mais aussi au regard porté sur eux. Niven Busch en fait des personnages à part entière, pas des silhouettes ou des caricatures.
Cela ne veut pas dire que les personnages du roman sont bien traités. Du moins, le sont-il avant que la guerre n'éclate. Ensuite, ils vont devenir des victimes collatérales de cette vendetta opposant un père à sa fille. Mais, cela ne grandit pas Temple ou Vance, au contraire, cela leur donne un côté lâche et mesquin, à l'image de la résistance de la grand-mère Herrera, moment fort des "Furies".
Et voilà, j'ai cédé à la paraphrase de Bertrand Tavernier (enfin presque !). Puisque c'est ainsi, allons jusqu'au bout : cette question raciale s'étend aux Indiens et même aux Chinois qui, à l'époque, sont exploités pour construire le chemin de fer. Des mentions qui n'occupent pas une place énorme, mais ne sont ni anodines, ni courante à l'époque où Niven Busch écrit son roman.
Bon, puisque j'ai craqué, mais le moins possible, promis, je ne peux que terminer en vous conseillant une dernière fois de ne pas zapper la postface de Bertrand Tavernier, on y apprend plein de choses et on appréhende sa lecture autrement, avec plus de billes en poche, plus de hauteur. C'est clairement, en plus de la qualité des romans choisis, le vrai plus de la collection "L'Ouest, le Vrai".
Pour avoir participé à la guerre de libération du Texas, le père de Temple Jefford a été récompensé par la jeune république née de cette révolution. Pas en argent sonnant et trébuchant, les dirigeants du nouvel Etat n'en possédaient pas suffisamment, mais en terres. Dan Jefford est donc devenu un propriétaire terrien et un éleveur prospère. Jusqu'à ce qu'une nouvelle guerre ne lui coûte la vie.
Son fils Temple a pris la relève, mais plus au Texas : il a fondé un ranch au Nouveau-Mexique (qui n'est alors qu'un "territoire organisé" et ne deviendra le 47e Etat des Etats-Unis qu'en 1912) dont il a non seulement su faire un des ranchs les plus riches de la région, mais aussi le coeur d'une enclave entièrement régentée par Temple.
Signes visibles de cette puissance, la gare qui dessert le ranch et porte le nom de "Jefford's", avec ce possessif qui en dit long, mais aussi le fait que le maître des lieux frappe sa propre monnaie... Temple Jefford est une espèce d'empereur, qui ne laisse à personne la direction des affaires permettant à cette machine de tourner.
Pourtant, depuis la mort de sa femme, Temple a délaissé Birdfoot. Voilà même un long moment qu'il n'y a plus mis les pieds, laissant la gestion à ses enfants, Dan et Clay, ses deux garçons, et Vance, sa fille, âgée de 19 ans, la prunelle de ses yeux. Les mauvaises langues disent qu'il s'est installé chez une maîtresse, l'une des nombreuses maîtresses qu'il a eues au cours de sa vie.
En cette journée de 1889, Birdfoot est en ébullition : le maître des lieux a annoncé son retour. On remet rapidement les choses en ordre et l'on se prépare à accueillir ce père, si longtemps absent. Vance est particulièrement impatiente de retrouver Temple, dont elle a toujours été très proche. Elle est sa préférée, et elle le sait.
Au contraire, elle n'a jamais été en phase avec sa mère, qui couvait ses deux garçons. Au sein du clan Jefford, les lignes de fracture sont donc clairement définies, et la mort prématurée de Catharine a donné l'avantage à Temple et Vance : le père ne fait aucune confiance à ses fils, qu'il juge faibles et manquant d'étoffe, et il est évident pour lui que c'est sa fille qui lui succédera à la tête du domaine.
Mais Vance va sérieusement déchanter, car lors de ce retour du père prodigue, elle va sentir que la volonté de son père a fléchi... Temple semble avoir changé de point de vue et certains éléments intriguent la jeune femme. Il y a quelque chose de changé au royaume des Jefford, et cela ne va pas dans le sens de cette ambitieuse demoiselle, qui a hérité (déjà !) du caractère de son père.
Et bientôt, Vance va comprendre d'où vient le problème ; il s'appelle Flo. Flo Burnett, ou plus exactement, d'ici peu, Flo Jefford... Temple est de nouveau amoureux et il a décidé de se remarier... Stupeur chez Vance, qui va encore s'accroître quand elle va rencontrer sa future belle-mère. Une aventurière, elle en est certaine, qui n'en veut qu'à l'argent de la famille...
Vexée, fâchée, Vance va alors déclarer la guerre à son père, avec l'idée clairement énoncée de le renverser et de prendre sa place. Coûte que coûte. Si tout le monde, à Birdfoot et aux alentours, sait depuis toujours que Vance est l'enfant de Temple qui ressemble le plus à Temple, dure, déterminée et prête à tout, cela présage d'un terrible bras de fer pour prendre les rênes de l'empire Jefford...
Il est à la fois amusant et un peu stressant de parler des romans de la collection "L'Ouest, le Vrai", car les postfaces de Bertrand Tavernier sont des mines d'informations, des supports passionnants et érudits à la lecture. Mais, évidemment, il y évoque les grandes lignes et les thèmes majeurs que l'auteur y développe et le blogueur risque de paraphraser...
Mais je vous encourage vraiment à lire ces pages qui vont non seulement replacer "Les Furies" dans son contexte, mais aussi offrir quelques moments de gloire, en particulier un portrait bien peu flatteur, féroce même, d'un des pontes de cet âge d'or hollywoodien, le producteur David O. Selznick, celui qui fit venir Hitchcock aux Etats-Unis, par exemple.
Il y évoque aussi Niven Busch, auteur de ce western tragique, à l'intrigue de tragédie antique, dont le nom n'est pas forcément très connu. Et pourtant, sa carrière littéraire et cinématographique est assez remarquable, citons le scénario du "Facteur sonne toujours deux fois" (première version, celle de 1946) ou encore le roman "Duel au soleil", acheté et adapté par Selznick, avec un casting de rêve.
"Les Furies" également a eu le droit aux honneurs du cinéma, avec une réalisation d'Anthony Mann et Barbara Stanwyck dans le rôle de Vance Jefford (en cherchant un peu, on doit le trouver assez facilement sur le net). Et je n'en dirai pas plus, pour l'encyclopédie vivante du cinéma, voyez avec Bertrand Tavernier, nettement mieux placé que moi...
Revenons au roman, avec cette histoire aux allures de tragédie antique, disais-je plus haut, jusque dans ce titre, "les Furies", qui a plusieurs sens... On peut le prendre au pied de la lettre, et c'est vrai que le trio Catharine (la mère, qu'on ne voit pas mais qu'on devine peu commode), Vance (la fille) et Flo (la belle-mère) correspond assez bien à ce mot : mieux vaut ne pas encourir leur colère !
Et puis, il y a la mythologique latine, dans laquelle les Furies sont des divinités persécutrices, rien que ça... Il y a Alecto, l'implacable, Tisiphone, la vengeance, et sans doute la plus connue, puisque son nom est entré dans le langage courant, Mégère, la haine... Je vous laisse répartir les rôles ! Mais il est certain que cela colle bien au roman de Niven Busch...
Laissons la mère et la belle-mère, car le personnage central, et ce n'est pas si ordinaire pour un western écrit dans les années 1940 (on avait déjà évoqué cette question dans le billet sur "Femme de feu", autre roman de cette même collection), c'est Vance. Elle n'a donc pas encore 20 ans quand s'ouvre le livre, mais elle affiche déjà une impressionnante maturité.
Disons les choses clairement : en l'absence de son père, c'est elle qui commande, et les hommes, ses frères, mais pas qu'eux, marchent au pas devant son autorité naturelle. Dès la scène d'ouverture, elle congédie son amant, un jeune homme d'origine mexicaine, bien consciente que sa présence à ses côtés ne plairait pas à son père. Les sentiments ? Oh, peut-être, mais après les affaires, alors !
C'est là qu'on voit qu'elle connaît remarquablement son père... En effet, une des premières annonces que va faire Temple à son retour à Birdfoot consiste à interdire à Vance de se marier, sous peine de tout perdre... Première entorse à la complicité entre le père et la fille, premier acte de ce qui va dégénérer en une lutte sans pitié...
En ne tenant pas les promesses qu'il lui a faites, Temple ouvre les hostilités sans forcément se rendre compte de son erreur. Il a beau savoir que sa fille tient beaucoup de lui (on surnomme Vance "la Temple en jupon", en son absence, évidemment), son amour pour Flo lui fait oublier l'évidence : remettre en question la succession promise ne peut pas faire plaisir à Vance...
Face à cette demoiselle au caractère volcanique, c'est peu de le dire, un père qui est un self-made-man, qui a construit un véritable empire. Le mot n'est pas choisi au hasard : Vance est fasciné par Napoléon Ier, qui est le sujet de ses lectures, un véritable modèle. Je ne sais pas si René Goscinny connaissait "les Furies", mais il y a chez Temple Jefford un petit côté "Empereur Smith"...
Pourtant, au fil des événements racontés dans le livre, on va découvrir une information très importante, qui va placer la rivalité père/fille sur un autre plan, nettement plus personnel. Deux orgueils démesurés qui s'affrontent violemment, En effet, on comprend bientôt que l'empire Jeffrey a tout d'un colosse aux pieds d'argile. En résumé : la puissance n'est pas la richesse...
Il y a dans ce duel presque oedipien entre Temple et Vance l'impression d'une véritable passation de pouvoir, même si cela va se faire au prix fort. Lorsque je parlais de bras de fer, il y a véritablement de cela, car on a la sensation que Vance fait plier son père, il se ratatine quand Vance met en évidence ce qu'on doit pouvoir qualifier d'imposture.
Et soudain, le Vance impitoyable, homme d'affaire intraitable, l'empereur inflexible apparaît, comme la plupart des personnages masculins, en retrait par rapport aux personnages féminins (et cela vaut pour les personnages secondaires également). Et si la guerre déclarée par Vance à son père était surtout une guerre déclarée à Flo ?
Il faut dire que, à partir de l'apparition de la future belle-mère, la violence se déchaîne, les Furies se réveillent, et c'est impressionnant. Une scène, en particulier, me revient à l'esprit, un lynchage en bonne et due forme qui symbolise parfaitement le passage d'un point de non-retour. La guerre ne s'arrêtera pas au premier sang, il n'y aura pas de quartier !
Outre la question familiale et la place donnée aux femmes dans ce livre, Niven Busch aborde d'autres sujets qui font de la trame de ce roman une histoire très actuelle. A commencer par la question raciale, avec la place donnée aux personnages hispaniques, mais aussi au regard porté sur eux. Niven Busch en fait des personnages à part entière, pas des silhouettes ou des caricatures.
Cela ne veut pas dire que les personnages du roman sont bien traités. Du moins, le sont-il avant que la guerre n'éclate. Ensuite, ils vont devenir des victimes collatérales de cette vendetta opposant un père à sa fille. Mais, cela ne grandit pas Temple ou Vance, au contraire, cela leur donne un côté lâche et mesquin, à l'image de la résistance de la grand-mère Herrera, moment fort des "Furies".
Et voilà, j'ai cédé à la paraphrase de Bertrand Tavernier (enfin presque !). Puisque c'est ainsi, allons jusqu'au bout : cette question raciale s'étend aux Indiens et même aux Chinois qui, à l'époque, sont exploités pour construire le chemin de fer. Des mentions qui n'occupent pas une place énorme, mais ne sont ni anodines, ni courante à l'époque où Niven Busch écrit son roman.
Bon, puisque j'ai craqué, mais le moins possible, promis, je ne peux que terminer en vous conseillant une dernière fois de ne pas zapper la postface de Bertrand Tavernier, on y apprend plein de choses et on appréhende sa lecture autrement, avec plus de billes en poche, plus de hauteur. C'est clairement, en plus de la qualité des romans choisis, le vrai plus de la collection "L'Ouest, le Vrai".
Inscription à :
Articles (Atom)