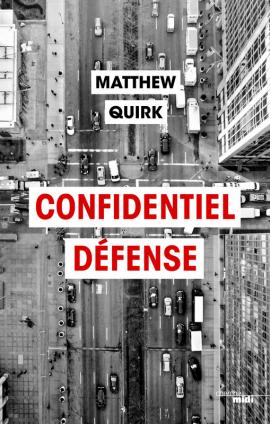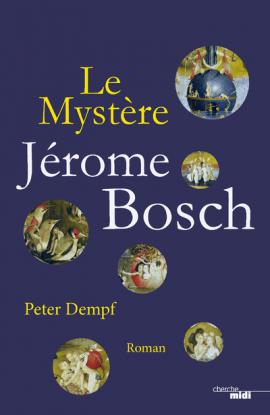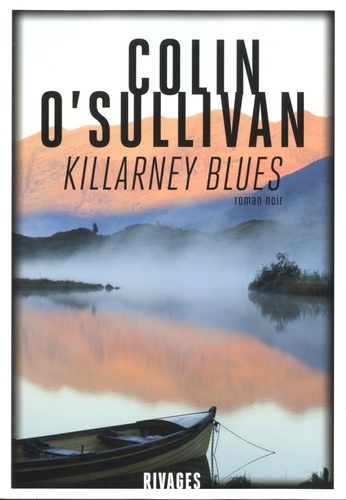Ah, oui, d'entrée, ça calme un peu, c'est sûr. Pourtant, difficile d'éviter le sujet qui est au coeur de notre roman du soir. En témoignent deux citations, qui apparaissent dans le livre : "il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux : le suicide" (Albert Camus) et "Tout être humain naît avec le gène du suicide. Chez la plupart d'entre nous ce gène demeure latent" (Raymond Katz). Oui, on va parler de suicide, ce soir, mais pas uniquement, car "Fin de ronde" (en grand format chez Albin Michel ; traduction de Nadine Gassie et Océane Bies) achève le triptyque que Stephen King a entamé avec "Mr. Mercedes" et poursuivit avec "Carnets noirs" (désormais tous les deux disponibles au Livre de Poche). Mais, pour achever cette série, après deux premiers volets qui étaient des romans noirs, Stephen King revient au fantastique et confronte ses personnages à l'irrationnel. Et, en trame, il poursuit sa chronique de l'Amérique contemporaine et s'attaque aux phénomènes de groupe qu'entraîne la vie 2.0.
Nous sommes au début de l'année 2016. Près de sept années on passé depuis la tuerie provoquée par celui qu'on a surnommé Mr. Mercedes et depuis sa tentative d'attentat avortée. Peu à peu, la vie de la petite ville du Midwest où se sont déroulés ces drames, a retrouvé son cours paisible et les enfants qui étaient visés sont devenus des adolescents. Mais, des traces subsistent.
Ce matin-là, lorsque le téléphone de Bill Hodges, flic à la retraite désormais à la tête d'une agence de détective privé, se met à sonner, c'est pour lui annoncer une terrible nouvelle. Son ex-coéquipier, qui s'apprête à son tour à quitter la police, l'informe d'un meurtre et d'un suicide : Janice Ellerton, vieille dame de près de 80 ans, a apparemment tué sa fille, Martine Stover, avant de mettre fin à ses jours.
Martine avait 50 ans en 2009, quand elle a été victime de la folie de Mr. Mercedes. A la recherche d'un job, elle voulait assister à un salon pour l'emploi organisé au City Center et, parce que les postes proposés étaient en nombre limité, elle avait choisi d'y arriver avant l'aube. Comme tant d'autres personne. Lorsque la voiture allemande a foncé sur la foule, elle a été violemment renversée.
Huit personnes ont eu moins de chance qu'elle, car elle a survécu. Mais, Martine Stover ne s'est jamais relevée : tétraplégique à 95%, il fallait s'occuper d'elle en permanence. Sa mère, qui l'avait accueillie chez elle, a-t-elle trouvé que la charge devenait trop lourde, malgré la présence d'auxiliaires pour les tâches les plus complexes ? A-t-elle jugé que le calvaire de sa fille avait trop duré ?
Pour Pete et Izzy, sa coéquipière, le scénario ne fait aucun doute : c'est Janice Ellerton qui a tout organisé, sans doute avec l'aval de sa fille. Mais, sur place, Bill Hodges et Holly Gibney, désormais son associée au sein de l'agence Finders Keepers, remarquent des petites choses qui ne collent pas. Et en particulier ce Z, tracé avec un marqueur près d'une prise de courant.
En fait, pour Holly, dont les phobies sociales se sont atténuées, mais qui reste bizarre aux yeux de beaucoup, à commencer par Izzy, puis pour Hodges, la thèse d'une euthanasie suivie d'un suicide est bancale. Ils souhaiteraient une enquête un peu plus approfondie pour en avoir le coeur net, mais pour les flics, la cause est entendue, pas le temps de s'occuper d'une affaire qui n'en est pas une.
Alors, Holly et Hodges décident de passer outre et de comprendre ce qui a pu se passer dans ce quartier résidentiel sans histoire. Et, bientôt, ils se demandent si le cauchemar n'est pas en train de recommencer. Si Mr. Mercedes n'est pas en train de reprendre sa macabre mission là où elle a pris fin sept an plus tôt, quand Holly lui a défoncé le crâne avant qu'il ne fasse sauter une salle de concert.
Mais, Brady Hartsfield, celui qu'on a surnommé Mr. Mercedes, est toujours à l'hôpital, réduit à l'état de légume. Hodges s'en est assuré lui-même en lui rendant régulièrement visite. Et il en est certain : il n'y a aucun risque de voir cet homme, qui se rêvait tueur de masse, reprendre ses sinistres activités de sitôt. Jamais il ne retrouvera ses capacités physiques et mentales.
Vraiment ?
La fin de ronde, end of watch pour la version originale, c'est l'expression qui désigne la fin du service quotidien des policiers, mais dans leur argot, c'est aussi celle qu'on emploie pour parler de la fin de carrière, d'un départ à la retraite qui approche. La quille, quoi, la fin d'activité. Un titre logique, puisqu'il s'agit d'un dernier tome.
Mais, on va bientôt comprendre que ces trois mots ne concernent pas seulement Pete, l'ancien coéquipier de Bill Hodges, qui prépare en ce moment son prochain pot de départ. Cette fin de ronde, c'est vraiment une dernière danse, macabre, forcément, celle que vont entamer les personnages de ce triptyque, et bien sûr, plus particulièrement Bill Hodges et Brady Hartsfield.
Il flotte dès les premières pages de ce roman un parfum de mort. Désolé, c'est un fait. Et l'on se prépare surtout à une espèce de duel final entre les deux principaux protagonistes, parce que, si on revient à Mr. Mercedes, cela ne peut pas se terminer autrement. Quelle forme prendra-t-il ? C'est évidemment là l'enjeu de ce dernier volet.
Finalement, ce roman bénéficie d'une construction narrative assez classique : deux personnages qui s'affrontent à distance depuis longtemps, la soif de vengeance contre l'appétit de justice, le bon vieux thème de la Némésis jusqu'à l'affrontement final, crépusculaire comme il se doit. Mais, avant cela, chaque partie va devoir rassembler ses forces, et c'est là que ça se corse...
D'un côté, Bill Hodges, qui approche des 70 ans et a connu des jours meilleurs, et Holly Gibney, qui n'a rien d'une super-héroïne, en tout cas qui a d'autres qualités que celle de combattante. De l'autre, Brady Hartsfield, allongé sur le lit d'une chambre d'hôpital, les yeux dans le vague et le cerveau hors service... Sur le papier, on a connu plus excitant, comme forces en présence...
Et pourtant...
Au coeur de cette histoire; se trouve un thème qui occupe une bonne partie du livre : le suicide. Ce n'est pas un hasard, la trilogie Bill Hodges porte un regard critique sur la société américaine, sur ses dysfonctionnements, ses difficultés. "Mr. Mercedes évoquait une vision de la culture toujours plus standardisée et tirant vers le bas, "Carnets noirs" parlait littérature, du grand roman américain.
"Fin de ronde" évoque une des dix premières causes de mortalité aux Etats-Unis : le suicide. Il pourrait briguer une place sur un bien triste podium si certains décès apparemment naturels ou accidentels étaient, à la suite d'investigations, reclassés en suicide. Cet état de fait ne concerne d'ailleurs pas que les Etats-Unis, c'est un sujet qui concerne nombre de pays industrialisés.
Pour être franc, il ne faut pas limiter cette question du suicide à ce dernier volet, elle est déjà présente d'entrée de jeu dans "Mr. Mercedes", puisque Bill Hodges, lorsqu'on fait sa connaissance, est au bord du passage à l'acte et les projets funestes de Brady comportent également une dimension suicidaire clairement affichée.
Mais, dans ce dernier tome, Stephen King va utiliser ce ressort d'une manière très différente. Il n'en fait pas qu'une question contextuelle, mais un sujet central, au coeur de son intrigue. Le corollaire de tout cela, c'est l'envie de vivre, qui va, qui vient, qui peut disparaître lorsque les difficultés s'amoncellent ou, au contraire, s'amplifier parce qu'on redoute de la perdre...
Oui, je sais, ce n'est pas vraiment un phénomène qu'on peut qualifier de culturel, c'est plutôt sociologique, mais on va voir comment Stephen King raccroche cela à la culture contemporaine et aux évolutions de la société américaine (et, là encore, on peut clairement étendre le raisonnement à l'Europe, à notre propre quotidien).
En 2006, Stephen King avait publié "Cellulaire", roman qu'on peut juger pas complètement réussi, en tout cas pas un des meilleurs de l'auteur, mais qui était en avance à la fois sur la mode des zombies, et sur l'arrivée des smartphones. Son titre original, "Cell", était clairement un jeu de mots entre le téléphone cellulaire, la cellule de prison et l'enfermement dans lequel les personnages se retrouvaient.
Avant que nous nous retrouvions tous avec un sans fil à la patte capable de nous laisser connectés n'importe où, n'importe quand à la toile. Connectés à nos amis, au monde tel qu'il va ou tel qu'on nous le raconte. Connectés aussi à ceux qui voudraient en savoir un maximum sur nous, pour des raisons plus ou moins avouables : le commerce ou... le contrôle (mot très important dans "Fin de ronde".
Dans "Fin de ronde", il utilise une idée de départ assez proche et s'intéresse aux phénomènes de groupes que la vie 2.0 peut entraîner. Avec de très bons côtés, il ne s'agit pas de tout voir en noir, mais d'autres qui le sont beaucoup moins. Comme lorsque les internautes se font harceleurs et dévoient internet pour en faire une arme.
C'est là que le fantastique intervient, mais je ne vais évidemment pas en dire beaucoup plus, il vous faudra lire ce roman pour voir comment tout cela s'organise. En mêlant des thèmes assez classiques de SF et de fantastique, des peurs anciennes qui évoluent mais perdurent et des thématiques d'actualité, elle aussi transposées à ce début de XXIe siècle, Stephen King fait monter la tension.
Mais, le suspense, ce n'est pas tout. L'auteur utilise son histoire et la fiction pour faire passer quelques messages. D'abord, sur la terrible diversité des formes d'intolérance à la disposition des êtres humains : racisme, sexisme, orientation sexuelle, obésité, complexes variés... La litanie est troublante, mais bien réelle, et le constat derrière la fiction affreusement plausible.
Je glisse au passage la critique sous-jacente de l'évolution de la société américaine actuelle. Allez, lâchons les mots : l'Amérique de Trump. On sait que Stephen King ne ménage pas ses critiques envers le nouveau président sur Twitter, il profite de ce roman pour glisser également quelques piques. Mais, on ressent une certaine inquiétude quant à la possible désagrégation de cette société.
A tout cela, il faut rajouter, comme pour le premier événement de ce roman, des causes de désespoir hélas très compréhensibles : le handicap et l'invalidité, les maladies incurables, la dépression, jusqu'aux échecs, amoureux, professionnels, personnels... Bref, si on se suicide beaucoup, c'est aussi parce qu'il existe beaucoup de motifs qui nous y poussent et une pente naturelle, pour reprendre la citation de Richard Katz.
Une question que le lecteur va se poser aussi au sujet des deux principaux protagonistes, vous le verrez, assez tôt dans l'histoire et jusqu'à un dénouement qui fait également vibrer cette corde. Ah, oui, c'est pas une thématique très marrante, c'est clair, mais on retrouve tout de même les éléments de l'humour, du suspense et une enquête au long cours pour essayer d'expliquer et comprendre ce qui se passe.
"Fin de ronde" repose aussi beaucoup sur ses personnages. Son méchant, évidemment, parce qu'un bon méchant, c'est souvent essentiel, et celui-là a de la ressource. Mais aussi le tandem improbable que forment Bill et Holly. Au fil des épisodes, cette relation s'est affinée et l'on sent bien qu'elle a profité à l'un comme à l'autre.
Une relation paternelle ? Oui, on peut trouver qu'il y a de ça, mais je ne le vois pas forcément ainsi. Bill offre à Holly la confiance, l'apaisement dont cette âme tourmentée a besoin et qu'on ne lui avait jamais offerts jusque-là ; Holly apporte à Bill sa connaissance d'un monde moderne qui dépasse un peu le vieux flic et lui permet de ne pas sombrer dans une vie d'inactivité qu'il ne supporte pas.
Jerome est également présent, mais en retrait tout de même par rapport aux deux autres. Holly et Bill sont étroitement liés, comme s'ils se soutenaient l'un l'autre, comme s'ils risquaient de s'effondrer si l'autre venait à ne plus être là. Et même si Holly n'est plus une enfant, en tout cas pour l'état civil, socialement c'est le cas, il y a à travers eux une belle allégorie de la relation entre générations.
Un dernier mot, pour un élément qui m'a troublé, je dois dire. Bill Hodges a peu ou prou le même âge que son créateur, qui vient de fêter ses 70 ans. On sait quel lien Stephen King peut parfois entretenir avec ses personnages, les questions qu'il se pose à lui-même à travers eux. Avec "Fin de ronde", et les précédents tomes aussi, d'ailleurs, ne s'interroge-t-il pas sur le vieillissement ?
Pour un romancier qui a tant traité de l'enfance et de la nostalgie qui découle du temps qui passe, ici, il aborde la vie différemment, comme un regard vers un avenir en forme de dernière ligne droite. Mais, si ces choses le travaillent sans doute, pas question d'en rester là, rassurez-vous, amateurs du King, ce roman ne marque certainement pas la fin de ronde pour lui.
"Il va falloir un jour qu'enfin je me décide à lire les livres que, depuis trente ans, je conseille à mes amis de lire". (Sacha Guitry)
dimanche 29 octobre 2017
vendredi 27 octobre 2017
"J'avais bien l'intention de plonger la tête la première au coeur de l'intervention de ces fils de putes et de la faire littéralement imploser".
Désolé pour la vulgarité, mais en lisant cette phrase, qui arrive assez tôt dans le cours du livre, je me suis dit que ça ferait un pu... euh, un super bon titre pour le billet. Et, une fois ce thriller achevé, je n'ai pas hésité longtemps avant de rechercher cette phrase (que j'ai un peu élaguée, mais sans en changer le sens) pour la placer en tête de cette chronique. Il y a cinq ans (bon, un peu moins en ce qui me concerne, je ne l'avais pas lu à la sortie), les lecteurs français découvraient Mike Ford, étudiant en droit à Harvard qui faisait ses premières armes dans le petit monde du lobbying de la capitale fédérale, Washington. Le roman portait un titre de péplum, "les 500" (désormais disponible en poche chez Pocket), mais c'était un pur thriller dans un monde très peu abordé par les romanciers, en tout cas pas de cette façon. Revoilà Mike Ford embarqué dans une nouvelle aventure, dans le nouveau roman de Matthew Quirk, "Confidentiel défense" (sorti au printemps dernier aux Cherche-Midi ; traduction de Diniz Galhos). Avec un thème qu'on croit d'abord vu et revu, le casse du siècle, mais dans une version tout à fait étonnante...
Après ses mésaventures dans le milieu du lobbying, Mike Ford a choisi de revenir à une existence et une carrière plus calme. Il travaille donc comme simple avocat à son propre compte, il gagne bien moins que s'il avait postulé pour un grand cabinet de la capitale fédérale, mais peu lui importe, il a failli y rester, il a dû commettre des actes qui le hantent encore, alors, pas de regret.
Aujourd'hui, il respire mieux et s'apprête à se marier ! S'il ne doit garder qu'une seule chose positive de ce qui lui est arrivé, c'est cette rencontre avec Annie. Et même si, lorsque débute "Confidentiel défense", Mike n'a pas l'air très ravi de faire les magasins pour élaborer sa liste de mariage, c'est un homme heureux, apaisé, rasséréné, que l'on retrouve.
Et peu importe l'accueil que lui réserve sa belle-famille. Son futur beau-père, sir Lawrence "Appelez-moi-Larry" Clark, un ancien rugbyman britannique reconverti dans la finance de haut vol, n'apprécie pas son gendre et ne s'en cache pas. Pour lui, ce mariage est une sorte de déchéance. Pas à cause de Mike en tant que tel, quoi que, mais à cause de la famille de Mike...
En effet, Mike Ford est le mouton blanc de la famille, celui qui a choisi la voie de la légalité et de l'honnêteté... Mais son père vient de sortir de prison après avoir purgé une longue peine, et son frère, Jack, a pris depuis la relève... Chez les Ford, on est escrocs de père en fils et Mike a lui aussi bénéficié d'un apprentissage des ficelles du... métier, même s'il a préféré une autre carrière.
Longtemps, Jack a été le héros de son cadet, avant de le décevoir terriblement. Longtemps, Mike a évité son frère ; il est le premier à ne lui faire aucune confiance. Mais, depuis que leur père a retrouvé la liberté, celui-ci a insisté pour que les deux frères renouent. Et Mike pense avoir trouvé la hache de guerre idéale à enterrer : proposer à Jack d'être son témoin.
Lorsqu'il se rend chez Jack, Mike a l'impression de découvrir un autre homme : maison coquette, voiture puissante, tous les signes extérieurs d'une carrière qui prospère, et honnêtement, en plus ! Jack se présente comme quelqu'un qui s'est rangé des voitures et s'est lancé dans des affaires tout ce qu'il y a de plus légal. Et Mike doute...
Et quand Mike doute, Mike fouille. Quelques instants suffisent à faire tomber le décor et comprendre que Jack n'a pas changé. Sauf que... Ce que Jack lui explique, c'est qu'il est dans une galère pas possible : un coup qui s'est retourné contre lui. Ses commanditaires l'ont piégé et veulent lui faire porter le chapeau.
Les retrouvailles tournent court, et Mike tombe nez à nez avec ces fameux commanditaires, à la tête desquels se trouve un certain Lynch (certainement un nom d'emprunt). Le temps de comprendre que ces gars-là ne plaisantent pas, qu'ils savent tout de lui et qu'ils sont tout à fait capables de tuer, et voilà Mike à son tour embringué dans une sale histoire...
Car Lynch a besoin des talents cachés de Mike pour mener à bien un plan machiavélique et réaliser un coup gigantesque. Les deux frères devront prendre tous les risques, trinqueront seuls si ça foire et seront bien encombrants s'ils réussissent, mais comment faire autrement ? La seule chance de survivre, c'est de jouer le jeu, ou du moins, de faire semblant...
Vous l'aurez compris, l'idée de Mike c'est de renverser le rapport de force en piégeant à son tour ceux qui l'ont mis dans ces sales draps. Il doit donc afficher sa bonne volonté et, tout en préparant consciencieusement le plan qu'on lui a demandé d'élaborer, en imaginer une version alternative dans laquelle il fera tomber Lynch et ses complices.
Mais, au fait, quel est-ce coup exceptionnel que doit préparer Mike ? Eh bien, tout simplement, braquer une banque. Oh, pas n'importe laquelle, non, juste la banque de la Réserve Fédérale, l'équivalent de notre Banque centrale, l'établissement qui donne le la de l'une des plus puissantes économies mondiales, l'économie américaine.
A ce point du billet, je vous entends soupirer, si, si, ne niez pas : encoooore un casse du siècle ! Entre les romans, le cinéma, les faits divers et mes agios, il y en a un nouveau tous les quinze jours, de casse du siècle ! Certes, je le conçois, c'est un sujet battu et rebattu, de Goldfinger au train Glasgow-Londres, de la série des braquage de Daniel Ocean à celui de Toni Musulin...
La liste est évidemment non-exhaustive, et je reconnais volontiers que j'ai pensé la même chose. Mais... Matthew Quirk, dès son premier roman, "les 500", a montré qu'il savait utiliser des recettes assez classiques dans le domaine du thriller pour raconter des histoires au contexte plus original. Le lobbying était le cadre des "500", pour son casse, il voit aussi très grand.
Dans mes exemples de "casses du siècles", j'ai cité en premier "Goldfinger", et ce n'est pas un hasard : souvenez-vous, Auric Goldfinger, dont l'obsession est l'or, voulait s'attaquer à Fort Knox, la base militaire qui abrite la réserve d'or américaine. Mike Ford, dans "Confidentiel Défense", se retrouve dans une situation voisine : la Federal Reserve Bank of New York est considérée comme la plus grande réserve d'or, justement devant Fort Knox...
Mais, comme Goldfinger envisageait un plan aussi machiavélique que surprenant (si vous ne vous souvenez pas du scénario, je n'en dis pas plus), Mike Ford doit aussi mener à bien une initiative à laquelle on ne s'attend pas. Et pour cause : ce n'est pas l'or de la Federal Reserve Bank of New York qu'il convoite, pas plus que les billets qu'on y rassemble pour destruction.
Non, ce que doit voler Mike Ford pour ses menaçants commanditaires, c'est l'un des secrets les mieux gardés au monde, objet d'un rituel immuable et attendu comme un message divin : la directive. C'est d'ailleurs le titre original de ce roman ("The Directive"), qui n'a pas été conservé par l'éditeur français. Est-ce de peur qu'on croit que le roman parlait des débats du parlement européen ?
Cette directive, je ne vais pas vous expliquer de quoi il s'agit exactement, c'est un des éléments forts du livre. Un enjeu bien spécial qui, d'une certaine façon, symbolise les mutations profondes de nos économies modernes, de la haute finance et de leur fonctionnement. L'or de Goldfinger ? Mais c'est soooo 1960's, mon pauvre !
Autour de cette directive, se construit donc une intrigue qui oscille de façon assez surprenante entre techniques ultra-moderne et savoir faire presque artisanal. Internet tient une place aussi importante dans le plan de Mike Ford que les bon vieux outils de crochetage que son père utilisait (et même fabriquait) dans sa jeunesse.
Il y a d'ailleurs un petit côté "Family Business" (encore Sean Connery !), dans "Confidentiel défense", même si on n'a pas trois générations. On a le père, qui veille avec fierté sur ses deux fils, les encourage, leur apporte un soutien dans cette situation particulière. La prison l'a calmé, mais il garde la même roublardise, les mêmes talents qu'avant de se retrouver à l'ombre.
Et puis, il y a les deux frères, et non le père et le fils, comme dans le film de Sidney Lumet (d'ailleurs adapté d'un roman). Mike pourrait être le personnage joué par Dustin Hoffmann, le membre honnête de la famille qui accepte de participer au casse pour aider son fils. Ici, Mike accepte pour sortir son frère de l'ornière (et aussi parce qu'on ne lui laisse pas trop le choix).
Mais, là où "Confidentiel défense" diverge, c'est donc que l'idée de Mike est de prendre ses commanditaires à leur propre jeu pour espérer se tirer sans trop de mal de ce guêpier... S'il échoue, ce sera au mieux la prison, et pour un long moment, au pire, la mort ; mais, s'il parvient à mettre en place son projet, rien n'indique que les chances de survie soient plus élevées...
La tension réside là : pas seulement dans les risques pris pour voler la directive, mais parce que ce n'est qu'un rouage de la terrible machine qui menace de l'écraser. La menace réelle, ce n'est pas l'autorité, même si (et j'ai fait l'impasse sur quelques rebondissements importants dans le résumé) Mike Ford pourrait bien se retrouver ennemi public n°1.
Non, la menace réelle, ce sont Lynch et ses complices. Un Lynch omniprésent, qui semble avoir sans arrêt plusieurs coups d'avance sur Ford, qui s'amuse avec l'avocat, alternant la menace et les railleries, comme un chat jouant avec la souris qu'il s'apprête à croquer. Un Lynch entouré de mystère : initiateur du projet ou homme de main et homme de confiance de quelqu'un d'autre ?
Matthew Quirk goupille bien son affaire, d'ailleurs comme dans "les 500", en instillant dans son thriller une bonne dose de paranoïa : à qui Mike peut-il se fier ? Quels alliés a-t-il ? Peut-il chercher de l'aide sans mettre tout son entourage en danger ? Mike Ford est un joueur de poker prêt à miser son tapis sur une petite paire. Et un tapis qui ne se compose pas juste de jetons, mais de tout sa vie.
Pour un jeune avocat qui aspire au calme, qui veut oublier ses mésaventures passées, qui veut se marier, vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants, le voilà reparti pour une nouvelle galère. Mike Ford, qu'on se le dise, rejoint la grande famille des héros martyrisés par leur créateur avec un sadisme revendiqué. Je ne sais pas si la série se poursuivra, mais, si c'est le cas, j'ai peur pour lui !
Mike Ford doit se mettre dans un état d'esprit très particulier : celui qui doit agir seul contre tous. Peu importe qu'il ait raison ou tort, dans les faits, qu'il se protège parce qu'il ne fait confiance à personne, ou qu'il protège les siens, et Annie en particulier, tout cela l'oblige à mentir, tromper, jouer au plus fin, avec les risques que cela comporte.
"Confidentiel défense" reste très classique dans sa structure, dans les techniques narratives utilisées, mais c'est redoutablement efficace. Le choix de la première personne du singulier pour raconter l'histoire ajoute au côté haletant des choses. On vit dans une position privilégiée les émotions, les montagnes russes émotionnelles, les doutes ou les inquiétudes du personnage.
Mike Ford, ce n'est pas le Bruce Willis de "Die Hard", mais il ne ménage pas ses efforts et il faut reconnaître qu'il prend des coups, et pas des petits. Antihéros capable de se surpasser pour survivre, sachant qu'il ne retirera rien de tout ça, si ce n'est des emmerdes, Mike Ford est un funambule qui marche sur les bords de l'abîme en permanence.
Matthew Quirk a ce truc qu'ont les auteurs de page-turner qui vous attrapent à la première page et ne vous lâchent plus jusqu'à la dernière. Je viens de faire un tour sur son site, pour regarder sa bibliographie ("Les 500" et "Confidentiel défense" ont été publiés en France plusieurs années après leur parution aux Etats-Unis), je n'y ai pas vu d'autres romans mettant en scène Mike Ford.
En revanche, j'y ai vu deux autres romans, dans des genres différents, que je serais curieux de lire (ah, si seulement j'étais capable de lire en VO !). Mais, je crois que Matthew Quirk reste encore largement méconnu du public français, et c'est bien dommage, à mon humble avis, son travail étant largement au niveau d'autres auteurs de thrillers bien plus mis en avant. Alors, hop, petit coup de pouce !
Après ses mésaventures dans le milieu du lobbying, Mike Ford a choisi de revenir à une existence et une carrière plus calme. Il travaille donc comme simple avocat à son propre compte, il gagne bien moins que s'il avait postulé pour un grand cabinet de la capitale fédérale, mais peu lui importe, il a failli y rester, il a dû commettre des actes qui le hantent encore, alors, pas de regret.
Aujourd'hui, il respire mieux et s'apprête à se marier ! S'il ne doit garder qu'une seule chose positive de ce qui lui est arrivé, c'est cette rencontre avec Annie. Et même si, lorsque débute "Confidentiel défense", Mike n'a pas l'air très ravi de faire les magasins pour élaborer sa liste de mariage, c'est un homme heureux, apaisé, rasséréné, que l'on retrouve.
Et peu importe l'accueil que lui réserve sa belle-famille. Son futur beau-père, sir Lawrence "Appelez-moi-Larry" Clark, un ancien rugbyman britannique reconverti dans la finance de haut vol, n'apprécie pas son gendre et ne s'en cache pas. Pour lui, ce mariage est une sorte de déchéance. Pas à cause de Mike en tant que tel, quoi que, mais à cause de la famille de Mike...
En effet, Mike Ford est le mouton blanc de la famille, celui qui a choisi la voie de la légalité et de l'honnêteté... Mais son père vient de sortir de prison après avoir purgé une longue peine, et son frère, Jack, a pris depuis la relève... Chez les Ford, on est escrocs de père en fils et Mike a lui aussi bénéficié d'un apprentissage des ficelles du... métier, même s'il a préféré une autre carrière.
Longtemps, Jack a été le héros de son cadet, avant de le décevoir terriblement. Longtemps, Mike a évité son frère ; il est le premier à ne lui faire aucune confiance. Mais, depuis que leur père a retrouvé la liberté, celui-ci a insisté pour que les deux frères renouent. Et Mike pense avoir trouvé la hache de guerre idéale à enterrer : proposer à Jack d'être son témoin.
Lorsqu'il se rend chez Jack, Mike a l'impression de découvrir un autre homme : maison coquette, voiture puissante, tous les signes extérieurs d'une carrière qui prospère, et honnêtement, en plus ! Jack se présente comme quelqu'un qui s'est rangé des voitures et s'est lancé dans des affaires tout ce qu'il y a de plus légal. Et Mike doute...
Et quand Mike doute, Mike fouille. Quelques instants suffisent à faire tomber le décor et comprendre que Jack n'a pas changé. Sauf que... Ce que Jack lui explique, c'est qu'il est dans une galère pas possible : un coup qui s'est retourné contre lui. Ses commanditaires l'ont piégé et veulent lui faire porter le chapeau.
Les retrouvailles tournent court, et Mike tombe nez à nez avec ces fameux commanditaires, à la tête desquels se trouve un certain Lynch (certainement un nom d'emprunt). Le temps de comprendre que ces gars-là ne plaisantent pas, qu'ils savent tout de lui et qu'ils sont tout à fait capables de tuer, et voilà Mike à son tour embringué dans une sale histoire...
Car Lynch a besoin des talents cachés de Mike pour mener à bien un plan machiavélique et réaliser un coup gigantesque. Les deux frères devront prendre tous les risques, trinqueront seuls si ça foire et seront bien encombrants s'ils réussissent, mais comment faire autrement ? La seule chance de survivre, c'est de jouer le jeu, ou du moins, de faire semblant...
Vous l'aurez compris, l'idée de Mike c'est de renverser le rapport de force en piégeant à son tour ceux qui l'ont mis dans ces sales draps. Il doit donc afficher sa bonne volonté et, tout en préparant consciencieusement le plan qu'on lui a demandé d'élaborer, en imaginer une version alternative dans laquelle il fera tomber Lynch et ses complices.
Mais, au fait, quel est-ce coup exceptionnel que doit préparer Mike ? Eh bien, tout simplement, braquer une banque. Oh, pas n'importe laquelle, non, juste la banque de la Réserve Fédérale, l'équivalent de notre Banque centrale, l'établissement qui donne le la de l'une des plus puissantes économies mondiales, l'économie américaine.
A ce point du billet, je vous entends soupirer, si, si, ne niez pas : encoooore un casse du siècle ! Entre les romans, le cinéma, les faits divers et mes agios, il y en a un nouveau tous les quinze jours, de casse du siècle ! Certes, je le conçois, c'est un sujet battu et rebattu, de Goldfinger au train Glasgow-Londres, de la série des braquage de Daniel Ocean à celui de Toni Musulin...
La liste est évidemment non-exhaustive, et je reconnais volontiers que j'ai pensé la même chose. Mais... Matthew Quirk, dès son premier roman, "les 500", a montré qu'il savait utiliser des recettes assez classiques dans le domaine du thriller pour raconter des histoires au contexte plus original. Le lobbying était le cadre des "500", pour son casse, il voit aussi très grand.
Dans mes exemples de "casses du siècles", j'ai cité en premier "Goldfinger", et ce n'est pas un hasard : souvenez-vous, Auric Goldfinger, dont l'obsession est l'or, voulait s'attaquer à Fort Knox, la base militaire qui abrite la réserve d'or américaine. Mike Ford, dans "Confidentiel Défense", se retrouve dans une situation voisine : la Federal Reserve Bank of New York est considérée comme la plus grande réserve d'or, justement devant Fort Knox...
Mais, comme Goldfinger envisageait un plan aussi machiavélique que surprenant (si vous ne vous souvenez pas du scénario, je n'en dis pas plus), Mike Ford doit aussi mener à bien une initiative à laquelle on ne s'attend pas. Et pour cause : ce n'est pas l'or de la Federal Reserve Bank of New York qu'il convoite, pas plus que les billets qu'on y rassemble pour destruction.
Non, ce que doit voler Mike Ford pour ses menaçants commanditaires, c'est l'un des secrets les mieux gardés au monde, objet d'un rituel immuable et attendu comme un message divin : la directive. C'est d'ailleurs le titre original de ce roman ("The Directive"), qui n'a pas été conservé par l'éditeur français. Est-ce de peur qu'on croit que le roman parlait des débats du parlement européen ?
Cette directive, je ne vais pas vous expliquer de quoi il s'agit exactement, c'est un des éléments forts du livre. Un enjeu bien spécial qui, d'une certaine façon, symbolise les mutations profondes de nos économies modernes, de la haute finance et de leur fonctionnement. L'or de Goldfinger ? Mais c'est soooo 1960's, mon pauvre !
Autour de cette directive, se construit donc une intrigue qui oscille de façon assez surprenante entre techniques ultra-moderne et savoir faire presque artisanal. Internet tient une place aussi importante dans le plan de Mike Ford que les bon vieux outils de crochetage que son père utilisait (et même fabriquait) dans sa jeunesse.
Il y a d'ailleurs un petit côté "Family Business" (encore Sean Connery !), dans "Confidentiel défense", même si on n'a pas trois générations. On a le père, qui veille avec fierté sur ses deux fils, les encourage, leur apporte un soutien dans cette situation particulière. La prison l'a calmé, mais il garde la même roublardise, les mêmes talents qu'avant de se retrouver à l'ombre.
Et puis, il y a les deux frères, et non le père et le fils, comme dans le film de Sidney Lumet (d'ailleurs adapté d'un roman). Mike pourrait être le personnage joué par Dustin Hoffmann, le membre honnête de la famille qui accepte de participer au casse pour aider son fils. Ici, Mike accepte pour sortir son frère de l'ornière (et aussi parce qu'on ne lui laisse pas trop le choix).
Mais, là où "Confidentiel défense" diverge, c'est donc que l'idée de Mike est de prendre ses commanditaires à leur propre jeu pour espérer se tirer sans trop de mal de ce guêpier... S'il échoue, ce sera au mieux la prison, et pour un long moment, au pire, la mort ; mais, s'il parvient à mettre en place son projet, rien n'indique que les chances de survie soient plus élevées...
La tension réside là : pas seulement dans les risques pris pour voler la directive, mais parce que ce n'est qu'un rouage de la terrible machine qui menace de l'écraser. La menace réelle, ce n'est pas l'autorité, même si (et j'ai fait l'impasse sur quelques rebondissements importants dans le résumé) Mike Ford pourrait bien se retrouver ennemi public n°1.
Non, la menace réelle, ce sont Lynch et ses complices. Un Lynch omniprésent, qui semble avoir sans arrêt plusieurs coups d'avance sur Ford, qui s'amuse avec l'avocat, alternant la menace et les railleries, comme un chat jouant avec la souris qu'il s'apprête à croquer. Un Lynch entouré de mystère : initiateur du projet ou homme de main et homme de confiance de quelqu'un d'autre ?
Matthew Quirk goupille bien son affaire, d'ailleurs comme dans "les 500", en instillant dans son thriller une bonne dose de paranoïa : à qui Mike peut-il se fier ? Quels alliés a-t-il ? Peut-il chercher de l'aide sans mettre tout son entourage en danger ? Mike Ford est un joueur de poker prêt à miser son tapis sur une petite paire. Et un tapis qui ne se compose pas juste de jetons, mais de tout sa vie.
Pour un jeune avocat qui aspire au calme, qui veut oublier ses mésaventures passées, qui veut se marier, vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants, le voilà reparti pour une nouvelle galère. Mike Ford, qu'on se le dise, rejoint la grande famille des héros martyrisés par leur créateur avec un sadisme revendiqué. Je ne sais pas si la série se poursuivra, mais, si c'est le cas, j'ai peur pour lui !
Mike Ford doit se mettre dans un état d'esprit très particulier : celui qui doit agir seul contre tous. Peu importe qu'il ait raison ou tort, dans les faits, qu'il se protège parce qu'il ne fait confiance à personne, ou qu'il protège les siens, et Annie en particulier, tout cela l'oblige à mentir, tromper, jouer au plus fin, avec les risques que cela comporte.
"Confidentiel défense" reste très classique dans sa structure, dans les techniques narratives utilisées, mais c'est redoutablement efficace. Le choix de la première personne du singulier pour raconter l'histoire ajoute au côté haletant des choses. On vit dans une position privilégiée les émotions, les montagnes russes émotionnelles, les doutes ou les inquiétudes du personnage.
Mike Ford, ce n'est pas le Bruce Willis de "Die Hard", mais il ne ménage pas ses efforts et il faut reconnaître qu'il prend des coups, et pas des petits. Antihéros capable de se surpasser pour survivre, sachant qu'il ne retirera rien de tout ça, si ce n'est des emmerdes, Mike Ford est un funambule qui marche sur les bords de l'abîme en permanence.
Matthew Quirk a ce truc qu'ont les auteurs de page-turner qui vous attrapent à la première page et ne vous lâchent plus jusqu'à la dernière. Je viens de faire un tour sur son site, pour regarder sa bibliographie ("Les 500" et "Confidentiel défense" ont été publiés en France plusieurs années après leur parution aux Etats-Unis), je n'y ai pas vu d'autres romans mettant en scène Mike Ford.
En revanche, j'y ai vu deux autres romans, dans des genres différents, que je serais curieux de lire (ah, si seulement j'étais capable de lire en VO !). Mais, je crois que Matthew Quirk reste encore largement méconnu du public français, et c'est bien dommage, à mon humble avis, son travail étant largement au niveau d'autres auteurs de thrillers bien plus mis en avant. Alors, hop, petit coup de pouce !
"Concentration, humilité, maîtrise du geste, répétition et précision".
Le titre de ce billet peut sembler sibyllin, à première vue, mais si vous lisez notre roman du jour, vous mesurerez son importance. Parce que c'est plus qu'une devise, c'est un véritable mantra. Et c'est surtout un élément central de la très fine construction de ce polar original à plus d'un titre, qui nous emmène au Japon, mais nous ouvre également les portes d'un univers très spécial. Deux auteurs se sont associés pour signer ce roman, une romancière, habituée des polars, même si sa trilogie se passait loin du Japon et de notre époque, et un chef cuisinier, connu, reconnu et médiatique. "On ne meurt pas la bouche pleine", d'Odile Bouhier et Thierry Marx, vient de sortir aux éditions Plon, dans la nouvelle collection Sang Neuf, est une histoire dépaysante, qui met à l'épreuve tous les sens du lecteur, le frustre terriblement en lui mettant sous le nez d'irrésistibles tentations et, au-delà de son intrigue, nous propose de suivre des personnages qui ont finalement bien plus en commun qu'il n'y paraît...
Le commandant Achille Simmeo est un vieux de la vieille du 36, quai des Orfèvres, un flic à l'ancienne qui la joue en solitaire depuis un moment. Contre toutes les règles, il fait ce qui lui chante, choisit les enquêtes qui l'intriguent plutôt que celle que ses chefs lui assignent. Et, depuis la mort de sa femme, encore récente, cette indépendance s'est encore accrue.
Comme si Achile Simmeo se foutait bien de la suite, lui qui se demande si le moment de raccrocher ne serait pas venu, alors que le déménagement du mythique "36" approche. D'ailleurs, ses supérieurs aussi voudraient bien le pousser à la retraite, car il est devenu ingérable et nuit aux statistiques en dénichant toujours des affaires qu'on voudrait envoyer aux oubliettes...
Et ce petit jeu recommence lorsque Simmeo reçoit l'ordre de se rendre dans un palace parisien où vient d'être découvert un corps sans vie. Tout semble indiquer, à commencer par la combinaison en latex de la victime, un jeu sexuel qui a mal tourné. Pourtant, les premières constations pourrait indiquer une mise en scène : les flics seraient en présence d'un assassinat.
Mais, aussi extraordinaire soit-elle, cette situation ne fait pas vibrer Simmeo, qui préfère partir en vadrouille dans les couloirs de l'hôtel. C'est alors qu'il tombe sur une scène troublante : des ambulanciers prenant en charge une femme très mal en point. Le policier est surpris de la reconnaître, il a croisé cette femme lors d'une vente aux enchères à Drouot quelques jours plus tôt.
Lorsqu'il découvre peu après dans les habituels télégrammes recensant les affaires prises en charge par les services de la DPJ qu'un ressortissant japonais est mort dans un accident de la route, il tique. Mais lorsqu'il reconnaît l'homme qui accompagnait la femme malade du palace à Drouot, son instinct de flic se déclenche.
Alors, il prend des nouvelles de cette femme, toujours hospitalisée, et apprend qu'elle est dans un état désespéré, frappé par un cancer foudroyant qui sidère les médecins. Un accident de la route, une maladie... Rien qui puisse intéresser un policier. Pourtant, en découvrant que ces deux personnes sont liées aux yakuzas, terribles mafieux japonais, Simmeo sait qu'il tient quelque chose.
Il se lance dans une enquête qui semble bien vaine, étant donné les éléments dont il dispose. C'est en tout cas l'avis des supérieurs du commandant qui refusent de le laisser poursuivre ses investigations. Alors, sur un coup de tête, Achille Simmeo décide de prendre des vacances. Il est persuadé que la clé de ces décès bizarres se trouve au Japon et il a justement envie de découvrir ce pays...
Voilà un résumé tout à fait subjectif, qui donne des éléments, mais en laisse volontairement d'autres de côté, qui va droit au but et n'évoque finalement pas grand-chose, qui donne l'impression d'avoir un polar traditionnel entre les mains... Pourtant, croyez-moi, "On ne meurt pas la bouche pleine" se démarque très vite des polars qu'on lit habituellement.
D'abord, par son rythme, assez lent, qui rappelle certaines séries télévisées actuelles, où l'on mise sur autre chose que la vitesse, les effets spéciaux, la violence ou les poussées d'adrénaline. Le lecteur se met au rythme du personnage principal, Achille Simmeo, qui n'a rien d'un super-flic, mais nous apparaît comme une sorte de flâneur...
En témoigne une première scène (en fait, la seconde, mais j'ai mis de côté le prologue) qui nous propose une espèce de travelling depuis la Comédie française jusqu'à l'Hôtel Drouot, en passant par les jardins du Palais Royal. Une scène qu'on pourrait croire sortie tout droit d'un film de Gus Van Sandt, par exemple.
Oui, c'est exactement ça : Achille Simmeo est à un moment de sa carrière, de sa vie, même, où il a décidé de ne plus se plier au rythme du monde, mais d'imposer au monde son propre rythme. Et, par ricochet, c'est également sur ce tempo que se déroulera ce roman, faisant fi des canons en vigueur, des règles établies et, peut-être même, des attentes des lecteurs.
Il est ainsi, Achille Simmeo, il n'en fait plus qu'à sa tête, personnage presque lunaire, perdu dans ses pensées, un digne émule de Maigret, mais qui aurait perdu son soutien le plus fidèle, cette épouse qui lui permettait de garder les pieds sur terre. Le commandant Simmeo est un électron libre, qui n'est pas mû par l'orgueil, mais simplement par une insatiable curiosité...
Le Japon... C'est bien sûr un élément fort du roman d'Odile Bouhier et Thierry Marx. En jouant, éléments assez classique, sur les différences culturelles entre nos deux pays, nos deux civilisations. D'ailleurs, une fois à Tokyo, s'il ne perd jamais de vue son enquête, Achille Simmeo se conduit comme un touriste et nous offre une visite alléchante de la capitale nippone.
Ces différences passent aussi par la présence des yakuzas, ces familles mafieuses extrêmement puissantes et possédant pignon sur rue, car leurs activités sont partagés entre affaires tout à fait légales et trafics bien moins avouables. Ne voyez pas en eux des descendants de samouraïs, entre le Bushido et le code des yakuzas, il y a un univers. C'est même tout le contraire...
L'influence japonaise est également présente dans l'écriture, qui varie d'un fil narratif à l'autre. Certains passages, ceux d'ailleurs, dans lesquels on retrouve le titre de ce billet, sont directement inspirés de l'écriture du haïku, dont on trouve au passage quelques magnifiques exemples en têtes de certains chapitres.
Simmeo va confronter son expérience (et elle est longue) de policier à la française aux méthodes de ses homologues nippons, forcément très différentes. Sans tirer la couverture à lui, mais avec confiance, il va aider sur des affaires en cours n'ayant rien à voir avec la sienne, un simple coup de main en attendant de trouver le fin mot de la seule enquête qui vaille à ses yeux...
Car, enquête il y a, sur la mort de ces deux Japonais en France. Simmeo ne croit pas au hasard ni aux coïncidences. Le lecteur, qui possède quelques avantages sur le policier, sait qu'il n'a encore vu qu'une petite partie de l'iceberg, que seule son incroyable intuition a su repérer. Mais, comprendre ce qui se passe exactement, c'est une autre paire de manches, vous l'imaginez bien.
Ah, il reste encore un élément très important dont je n'ai pas encore beaucoup parlé. En tout cas, pas directement. Quand j'ai indiqué sur les réseaux sociaux que j'avais entamé la lecture d' "On ne meurt pas la bouche pleine", j'ai eu un retour surpris de voir le nom de Thierry Marx, chef du "Sur Mesure", à Paris, et ancien juré de l'émission "Top Chef", sur la couverture de ce polar.
Mais parce qu'il y est question de cuisine, tout simplement. Et d'une forme de cuisine très particulière, que Thierry Marx promeut dès qu'il le peut : la cuisine moléculaire. Je ne vais pas entrer dans le détail, il vous faudra lire le livre pour découvrir comment cette gastronomie innovante et inventive intervient dans cette histoire.
Je vais tout de même préciser qu'on n'est pas tout à fait dans ce que Michèle Barrière appelle le polar gastronomique : la cuisine tient une place très importante, mais surtout dans la deuxième moitié du livre. Là, on croise des recettes, des plats, quelques spécialités japonaises qui mettent l'eau à la bouche, ou au moins, intriguent...
On est mis en appétit, mais Odile Bouhier et Thierry Marx ne font pas de la cuisine un élément de contexte de leur intrigue, mais un véritable personnage. Et, lorsqu'on entre dans le vif du sujet, on comprend pourquoi Thierry Marx co-signe ce livre : il est parfaitement dans son élément, pas seulement sur le plan technique, mais dans la philosophie même qui préside à son art.
Cette philosophie, c'est de faire se rencontrer les traditions culinaires avec la modernité, renouveler les classiques, leur redonner une nouvelle existence, les sublimer par des techniques tout à fait surprenantes pour des résultats qui le sont encore plus (euh, là, je me base sur ce que je lis et vois sur la cuisine moléculaire, je n'ai pas eu la chance de faire cette expérience).
Mais ce n'est pas tout. Revenons à notre titre : concentration, humilité, maîtrise du geste, répétition et précision. Une devise qui s'applique aux cuisiniers, par exemple à ces chefs nippons qui découpent les poissons de mille façons différentes, une coupe par espèce. Une technique qui n'est pas qu'un spectacle, mais une nécessité, quand il faut découper le fugu sans libérer sa toxine et empoisonner ses clients...
Or, on découvre que cette devise peut parfaitement s'appliquer à d'autres professions, à commencer par celle de policier. Et, petit à petit, derrière l'intrigue policière, on voit apparaître une formidable construction narrative, un jeu de miroirs très impressionnant, des parallélismes qu'on n'imaginait pas rencontrer, une symétrie digne d'un origami.
La fusion entre la tradition et la modernité, la rencontre entre des cultures tellement différentes (on est loin du conflit permanent évoqué il y a quelques semaines à propos du dernier roman de Morgan Sportès), le mariage des deux qui permet un enrichissement réciproque et non un mélange indigeste, tout cela est aussi présent dans la construction du livre.
J'étais très curieux de lire ce livre depuis que j'ai appris sa publication, je me suis laissé prendre au jeu, sans savoir où j'allais vraiment. J'ai suivi Achille Simmeo dans son enquête, mais aussi dans une quête beaucoup plus personnelle. Car "On ne meurt pas la bouche pleine" est aussi un roman dans lequel la question de la famille, du sang et de l'héritage tient une grande place.
C'est d'ailleurs pour cela que j'ai laissé de côté (hormis son veuvage) les éléments concernant Achille Simmeo : ses interrogations, que l'on découvre rapidement dans le livre, ses cas de conscience et les décisions qu'il prend, pourraient n'apparaître que comme une banale caractérisation. Un artifice de narration pour lui permettre, aussi, de s'envoler pour le Japon à ses frais.
Mais, une fois la dernière page tournée, on mesure le travail d'horloger réalisé par les auteurs pour que tout coïncide si précisément et lier ensemble ce qui paraissait inconciliable. La romancière et le chef travaillent le thème de la vengeance, l'assaisonne à leur façon, avec une variété de saveurs très diverses, et démontrent qu'elle n'est pas uniquement un plat qui se mange froid.
Enfin, "On ne meurt pas la bouche pleine" est aussi un roman qui parle d'accomplissement, sous différentes formes. Chacun à leur manière, les personnages dont on fait la connaissance ont soit atteint cette étape de leur vie, soit font tout pour y parvenir. Avec pour corollaire que cela les rapprochent de la fin d'une ère. Et pourquoi pas de la fin tout court.
La fin du roman en surprendra beaucoup, par son côté très ouvert, un peu abrupt, mais là encore, elle est annoncée finement dans les dernières pages et elle est en phase avec l'état d'esprit des personnages. Avec l'état d'esprit de Simmeo, en particulier, un beau personnage, au désespoir élégant, à la curiosité vivante et à l'intuition inépuisable.
Je ne sais pas si cette association entre Odile Bouhier et Thierry Marx sera éphémère, si elle aura une suite (sans doute pas dans le même contexte) ou si Marc Fernandez, qui dirige la collection Sang Neuf chez Plon, voudra poursuivre l'expérience, pourquoi pas en associant d'autres auteurs avec d'autres chefs, mais il y a une idée à creuser.
Et, tout modestement, je me permettrai alors de proposer un titre pour une possible collection de polars ayant pour ingrédient principal la cuisine et la gastronomie : "La cuisine est une arme de destruction lascive". Oh, je n'ai pas de mérite, c'est une citation trouvée dans "On ne meurt pas la bouche pleine", mais j'aurais tellement, tellement aimé en être l'auteur...
Le commandant Achille Simmeo est un vieux de la vieille du 36, quai des Orfèvres, un flic à l'ancienne qui la joue en solitaire depuis un moment. Contre toutes les règles, il fait ce qui lui chante, choisit les enquêtes qui l'intriguent plutôt que celle que ses chefs lui assignent. Et, depuis la mort de sa femme, encore récente, cette indépendance s'est encore accrue.
Comme si Achile Simmeo se foutait bien de la suite, lui qui se demande si le moment de raccrocher ne serait pas venu, alors que le déménagement du mythique "36" approche. D'ailleurs, ses supérieurs aussi voudraient bien le pousser à la retraite, car il est devenu ingérable et nuit aux statistiques en dénichant toujours des affaires qu'on voudrait envoyer aux oubliettes...
Et ce petit jeu recommence lorsque Simmeo reçoit l'ordre de se rendre dans un palace parisien où vient d'être découvert un corps sans vie. Tout semble indiquer, à commencer par la combinaison en latex de la victime, un jeu sexuel qui a mal tourné. Pourtant, les premières constations pourrait indiquer une mise en scène : les flics seraient en présence d'un assassinat.
Mais, aussi extraordinaire soit-elle, cette situation ne fait pas vibrer Simmeo, qui préfère partir en vadrouille dans les couloirs de l'hôtel. C'est alors qu'il tombe sur une scène troublante : des ambulanciers prenant en charge une femme très mal en point. Le policier est surpris de la reconnaître, il a croisé cette femme lors d'une vente aux enchères à Drouot quelques jours plus tôt.
Lorsqu'il découvre peu après dans les habituels télégrammes recensant les affaires prises en charge par les services de la DPJ qu'un ressortissant japonais est mort dans un accident de la route, il tique. Mais lorsqu'il reconnaît l'homme qui accompagnait la femme malade du palace à Drouot, son instinct de flic se déclenche.
Alors, il prend des nouvelles de cette femme, toujours hospitalisée, et apprend qu'elle est dans un état désespéré, frappé par un cancer foudroyant qui sidère les médecins. Un accident de la route, une maladie... Rien qui puisse intéresser un policier. Pourtant, en découvrant que ces deux personnes sont liées aux yakuzas, terribles mafieux japonais, Simmeo sait qu'il tient quelque chose.
Il se lance dans une enquête qui semble bien vaine, étant donné les éléments dont il dispose. C'est en tout cas l'avis des supérieurs du commandant qui refusent de le laisser poursuivre ses investigations. Alors, sur un coup de tête, Achille Simmeo décide de prendre des vacances. Il est persuadé que la clé de ces décès bizarres se trouve au Japon et il a justement envie de découvrir ce pays...
Voilà un résumé tout à fait subjectif, qui donne des éléments, mais en laisse volontairement d'autres de côté, qui va droit au but et n'évoque finalement pas grand-chose, qui donne l'impression d'avoir un polar traditionnel entre les mains... Pourtant, croyez-moi, "On ne meurt pas la bouche pleine" se démarque très vite des polars qu'on lit habituellement.
D'abord, par son rythme, assez lent, qui rappelle certaines séries télévisées actuelles, où l'on mise sur autre chose que la vitesse, les effets spéciaux, la violence ou les poussées d'adrénaline. Le lecteur se met au rythme du personnage principal, Achille Simmeo, qui n'a rien d'un super-flic, mais nous apparaît comme une sorte de flâneur...
En témoigne une première scène (en fait, la seconde, mais j'ai mis de côté le prologue) qui nous propose une espèce de travelling depuis la Comédie française jusqu'à l'Hôtel Drouot, en passant par les jardins du Palais Royal. Une scène qu'on pourrait croire sortie tout droit d'un film de Gus Van Sandt, par exemple.
Oui, c'est exactement ça : Achille Simmeo est à un moment de sa carrière, de sa vie, même, où il a décidé de ne plus se plier au rythme du monde, mais d'imposer au monde son propre rythme. Et, par ricochet, c'est également sur ce tempo que se déroulera ce roman, faisant fi des canons en vigueur, des règles établies et, peut-être même, des attentes des lecteurs.
Il est ainsi, Achille Simmeo, il n'en fait plus qu'à sa tête, personnage presque lunaire, perdu dans ses pensées, un digne émule de Maigret, mais qui aurait perdu son soutien le plus fidèle, cette épouse qui lui permettait de garder les pieds sur terre. Le commandant Simmeo est un électron libre, qui n'est pas mû par l'orgueil, mais simplement par une insatiable curiosité...
Le Japon... C'est bien sûr un élément fort du roman d'Odile Bouhier et Thierry Marx. En jouant, éléments assez classique, sur les différences culturelles entre nos deux pays, nos deux civilisations. D'ailleurs, une fois à Tokyo, s'il ne perd jamais de vue son enquête, Achille Simmeo se conduit comme un touriste et nous offre une visite alléchante de la capitale nippone.
Ces différences passent aussi par la présence des yakuzas, ces familles mafieuses extrêmement puissantes et possédant pignon sur rue, car leurs activités sont partagés entre affaires tout à fait légales et trafics bien moins avouables. Ne voyez pas en eux des descendants de samouraïs, entre le Bushido et le code des yakuzas, il y a un univers. C'est même tout le contraire...
L'influence japonaise est également présente dans l'écriture, qui varie d'un fil narratif à l'autre. Certains passages, ceux d'ailleurs, dans lesquels on retrouve le titre de ce billet, sont directement inspirés de l'écriture du haïku, dont on trouve au passage quelques magnifiques exemples en têtes de certains chapitres.
Simmeo va confronter son expérience (et elle est longue) de policier à la française aux méthodes de ses homologues nippons, forcément très différentes. Sans tirer la couverture à lui, mais avec confiance, il va aider sur des affaires en cours n'ayant rien à voir avec la sienne, un simple coup de main en attendant de trouver le fin mot de la seule enquête qui vaille à ses yeux...
Car, enquête il y a, sur la mort de ces deux Japonais en France. Simmeo ne croit pas au hasard ni aux coïncidences. Le lecteur, qui possède quelques avantages sur le policier, sait qu'il n'a encore vu qu'une petite partie de l'iceberg, que seule son incroyable intuition a su repérer. Mais, comprendre ce qui se passe exactement, c'est une autre paire de manches, vous l'imaginez bien.
Ah, il reste encore un élément très important dont je n'ai pas encore beaucoup parlé. En tout cas, pas directement. Quand j'ai indiqué sur les réseaux sociaux que j'avais entamé la lecture d' "On ne meurt pas la bouche pleine", j'ai eu un retour surpris de voir le nom de Thierry Marx, chef du "Sur Mesure", à Paris, et ancien juré de l'émission "Top Chef", sur la couverture de ce polar.
Mais parce qu'il y est question de cuisine, tout simplement. Et d'une forme de cuisine très particulière, que Thierry Marx promeut dès qu'il le peut : la cuisine moléculaire. Je ne vais pas entrer dans le détail, il vous faudra lire le livre pour découvrir comment cette gastronomie innovante et inventive intervient dans cette histoire.
Je vais tout de même préciser qu'on n'est pas tout à fait dans ce que Michèle Barrière appelle le polar gastronomique : la cuisine tient une place très importante, mais surtout dans la deuxième moitié du livre. Là, on croise des recettes, des plats, quelques spécialités japonaises qui mettent l'eau à la bouche, ou au moins, intriguent...
On est mis en appétit, mais Odile Bouhier et Thierry Marx ne font pas de la cuisine un élément de contexte de leur intrigue, mais un véritable personnage. Et, lorsqu'on entre dans le vif du sujet, on comprend pourquoi Thierry Marx co-signe ce livre : il est parfaitement dans son élément, pas seulement sur le plan technique, mais dans la philosophie même qui préside à son art.
Cette philosophie, c'est de faire se rencontrer les traditions culinaires avec la modernité, renouveler les classiques, leur redonner une nouvelle existence, les sublimer par des techniques tout à fait surprenantes pour des résultats qui le sont encore plus (euh, là, je me base sur ce que je lis et vois sur la cuisine moléculaire, je n'ai pas eu la chance de faire cette expérience).
Mais ce n'est pas tout. Revenons à notre titre : concentration, humilité, maîtrise du geste, répétition et précision. Une devise qui s'applique aux cuisiniers, par exemple à ces chefs nippons qui découpent les poissons de mille façons différentes, une coupe par espèce. Une technique qui n'est pas qu'un spectacle, mais une nécessité, quand il faut découper le fugu sans libérer sa toxine et empoisonner ses clients...
Or, on découvre que cette devise peut parfaitement s'appliquer à d'autres professions, à commencer par celle de policier. Et, petit à petit, derrière l'intrigue policière, on voit apparaître une formidable construction narrative, un jeu de miroirs très impressionnant, des parallélismes qu'on n'imaginait pas rencontrer, une symétrie digne d'un origami.
La fusion entre la tradition et la modernité, la rencontre entre des cultures tellement différentes (on est loin du conflit permanent évoqué il y a quelques semaines à propos du dernier roman de Morgan Sportès), le mariage des deux qui permet un enrichissement réciproque et non un mélange indigeste, tout cela est aussi présent dans la construction du livre.
J'étais très curieux de lire ce livre depuis que j'ai appris sa publication, je me suis laissé prendre au jeu, sans savoir où j'allais vraiment. J'ai suivi Achille Simmeo dans son enquête, mais aussi dans une quête beaucoup plus personnelle. Car "On ne meurt pas la bouche pleine" est aussi un roman dans lequel la question de la famille, du sang et de l'héritage tient une grande place.
C'est d'ailleurs pour cela que j'ai laissé de côté (hormis son veuvage) les éléments concernant Achille Simmeo : ses interrogations, que l'on découvre rapidement dans le livre, ses cas de conscience et les décisions qu'il prend, pourraient n'apparaître que comme une banale caractérisation. Un artifice de narration pour lui permettre, aussi, de s'envoler pour le Japon à ses frais.
Mais, une fois la dernière page tournée, on mesure le travail d'horloger réalisé par les auteurs pour que tout coïncide si précisément et lier ensemble ce qui paraissait inconciliable. La romancière et le chef travaillent le thème de la vengeance, l'assaisonne à leur façon, avec une variété de saveurs très diverses, et démontrent qu'elle n'est pas uniquement un plat qui se mange froid.
Enfin, "On ne meurt pas la bouche pleine" est aussi un roman qui parle d'accomplissement, sous différentes formes. Chacun à leur manière, les personnages dont on fait la connaissance ont soit atteint cette étape de leur vie, soit font tout pour y parvenir. Avec pour corollaire que cela les rapprochent de la fin d'une ère. Et pourquoi pas de la fin tout court.
La fin du roman en surprendra beaucoup, par son côté très ouvert, un peu abrupt, mais là encore, elle est annoncée finement dans les dernières pages et elle est en phase avec l'état d'esprit des personnages. Avec l'état d'esprit de Simmeo, en particulier, un beau personnage, au désespoir élégant, à la curiosité vivante et à l'intuition inépuisable.
Je ne sais pas si cette association entre Odile Bouhier et Thierry Marx sera éphémère, si elle aura une suite (sans doute pas dans le même contexte) ou si Marc Fernandez, qui dirige la collection Sang Neuf chez Plon, voudra poursuivre l'expérience, pourquoi pas en associant d'autres auteurs avec d'autres chefs, mais il y a une idée à creuser.
Et, tout modestement, je me permettrai alors de proposer un titre pour une possible collection de polars ayant pour ingrédient principal la cuisine et la gastronomie : "La cuisine est une arme de destruction lascive". Oh, je n'ai pas de mérite, c'est une citation trouvée dans "On ne meurt pas la bouche pleine", mais j'aurais tellement, tellement aimé en être l'auteur...
mercredi 25 octobre 2017
"Le joueur, lui, n'a plus qu'à espérer battre au rythme du hasard et surfer sur les émotions, au moins pendant les quelques instants qui lui donneront l'illusion d'être enfin adoubé, touché par la grâce, réchauffé dans sa nuit et sa solitude glaciales, le jeu est le roi de l'illusion, un prestidigitateur, le serpent tentateur" (Pierre Bordage).
Lorsqu'on parle d'addiction, le jeu n'est sans doute pas la première réponse qui vient à l'esprit. Et pourtant, s'il ne s'agit pas d'une dépendance liée à un produit que l'on ingère, elle fait d'importants dégâts. Le jeu, au coeur du dernier roman de Pierre Bordage ("Tout sur le zéro", au Diable Vauvert, dont est tiré la citation en titre de ce billet), est aussi un des sujets centraux d'un polar qui vient de sortir : "la Chance du perdant", de Christophe Guillaumot (en grand format aux éditions Liana Levi). Près de dix ans après avoir reçu le fameux prix du Quai des Orfèvres (en 2009, pour "Chasses à l'homme", ce capitaine de police nous emmène à Toulouse, cadre d'une série mettant en scène un flic hors norme : Renato Donatelli, surnommé le Kanak. C'est surtout une plongée dans le travail quotidien d'un service méconnu, la brigade des courses et jeux, qui dépend de la police judiciaire, mais qui est loin d'être l'affectation reine... Un polar qui réussit à allier noirceur et humour, pour une série que l'on a envie de voir se poursuivre.
Au SRPJ de Toulouse, le service des courses et jeux est un placard. Même pas doré. Sanctionnés pour des raisons différentes, Renato Donatelli, alias le Kanak, et Jérôme Cussac, surnommé Six, doivent donc prendre leur mal en patience et s'habituer à leurs nouvelles missions, pas toujours exaltantes, comme le montre leur première scène : le démantèlement d'un loto-bouse (si, si, ça existe).
Ce duo est assez mal assorti : Cussac, l'officier, est encore sous le choc de l'affaire qui lui a valu son transfert dans la brigade, ce qui n'est pas une promotion et il semble bien frêle à côté de son subordonné. Donatelli, lui, est une montagne : originaire de Nouvelle-Calédonie, il mesure presque deux mètres, possède une stature de colosse et un caractère franc et nature.
Renato possède une candeur (à moins qu'il ne la joue avec habileté ?) qui fait qu'on ne se méfie pas trop de lui. Appelant tous ceux qu'il croise "Gros chameau", sa manière de sympathiser, distribuant des "gifles amicales" à ceux qui ne lui reviennent pas (le genre de gifles qui rappellent celle qu'Obélix balance aux Romains), il ne paraît pas toujours très malin, et c'est ce qui fait sa force : on le sous-estime.
Mais, il a aussi le gros défaut de ne pas savoir se faire discret. Or, c'est justement ce qu'on lui demande. Un énième coup d'éclat, lors du fameux loto-bouse, vaut aux deux punis de nouvelles réprimandes. La commissaire Bachelier ne veut plus entendre parler d'eux, sinon ça bardera encore plus pour leur matricule.
Alors, ils décident de se tenir tranquille, de se limiter à la mission de base de la brigade des courses et jeux : contrôler que tout se passe bien dans les lieux dédiés à ces activités. Et particulièrement les casinos. Il s'agit de veiller au respect des lois en vigueur, mais aussi de repérer d'éventuels tricheurs. Rien de bien passionnant, a priori, mais ils n'ont pas le choix.
Pendant ce temps, le capitaine Trichet, de la Criminelle, l'ancien équipier de Cussac, qui bosse en solo depuis que son collègue a été muté, est sur un tout autre genre d'affaire. Une drôle d'histoire, à vrai dire, enfin, drôle, pas vraiment. C'est même assez dramatique. La mort d'un homme retrouvé dans le compacteur d'ordures de la station locale de tri...
Rien n'indique qu'il s'agisse d'un homicide, au grand dam du flic, qui rêve d'enquêtes prestigieuses, de crimes médiatiques et d'arrestations à grand spectacle. Au lieu de ça, il se retrouve par une journée pourrie dans cet endroit qui pue terriblement. Et vérifications faites, l'intuition première se confirme : la vidéosurveillance montre qu'il s'agit d'un suicide. Affaire classée !
Affaire classée, vraiment ? Trichet est un bon flic et même si cette affaire ne semble pas vouloir aller plus loin, le choix de cet homme de se jeter sciemment dans un compacteur pour y connaître une mort horrible l'intrigue. Alors, sans vraiment savoir pourquoi, il mène l'enquête. Et découvre des éléments laissant penser que la victime était accro au jeu. Un vrai motif de suicide. Affaire classée !
Affaire classée, vraiment ?
Avant d'aller plus loin, je précise que "la Chance du perdant" est le deuxième roman mettant en scène le personnage de Renato Donatelli. Le premier, "Abattez les grands arbres", paru d'abord aux éditions Cairn, reparaît en même temps que "la Chance des perdants", dans une nouvelle édition également chez Liana Levi.
Je n'ai pas lu cette première enquête, mais les histoires sont indépendantes, donc ce n'est pas si grave. En revanche, on y trouve des éléments personnels importants pour comprendre comment les deux personnages principaux se retrouvent aux courses et jeux, plutôt que dans leurs précédents services. Une situation qui concerne plus Cussac que le très placide Renato.
Malgré tout, on a l'impression de démarrer vraiment la série avec leur mutation, leur prise de marque, leur apprentissage du travail en commun. Cussac est un bon flic qui a commis des erreurs et les paye au prix cher, mais il se rend compte aussi au contact de Renato qu'il lui manque un sens pratique au quotidien que le Kanak possède, apparemment de manière innée.
Dans "la Chance du perdant", un événement va plonger Cussac, déjà pas bien vaillant au départ, dans une dépression qui va l'entraîner dans une descente aux enfers dont on se demande jusqu'où elle ira. A cette occasion, on le voit se faire la remarque que le meneur de leur brigade, c'est le gardien de la paix Donatelli et non lui, l'officier. Une complicité naît, qui devrait grandir au fil de leurs enquêtes.
Renato, lui aussi, est aux prises avec des soucis personnels dans "la Chance du perdant". Ils concernent Grand Mama, chez qui vit Renato depuis son arrivée en métropole. Aujourd'hui très âgée, cette ancienne danseuse qui a connu son heure de gloire il y a bien longtemps a perdu son autonomie. Renato va devoir faire des choix douloureux...
Reste que les personnalités très différentes des deux policiers est aussi une facette importante du livre, où le noir et l'humour s'entrecroisent. Il y a de forts moments de tension, que ce soit dans les scènes les touchant personnellement ou dans celle concernant l'intrigue centrale, mais il y a aussi des scènes de comédie et du comique de situation, comme la Fiat 500 de fonction dans laquelle doit monter le géant Kanak.
Voilà pour les personnages principaux, auxquels vont venir s'ajouter deux autres personnages, mais je vous laisse découvrir qui ils sont, comment ils vont rejoindre la brigade et comment va se passer leur intégration... C'est aussi un des aspects amusants de cette série : on sort du cadre très classique des polars, avec un service où tout n'est pas permis, mais pas loin...
Bon, j'ai choisi d'attaquer ce billet en présentant les éléments qui devraient servir de fondations à la série en priorité. J'ai finalement très peu parlé de l'intrigue de "la Chance du perdant", mais on va pouvoir y venir, en essayant de ne pas trop en dire, car la construction de cette histoire est très bien fichue, se dévoilant peu à peu. On est vraiment dans une série de polars à la française.
Forcément, puisqu'on imagine bien qu'à un moment Six et le Kanak vont se retrouver impliqués dans l'enquête, il va être question du jeu. Du jeu, de l'addiction qu'il entraîne et des conséquences funestes que cela peut avoir pour ceux qui en souffrent. Mais, rapidement, on a la puce à l'oreille : se suicider pour fuir cette addiction, on le comprend aisément, mais pourquoi une telle mise en scène ?
Comme Trichet, qui a quand même un nom prédestiné pour se retrouver sur une enquête qui touche au jeu, le lecteur s'interroge sur ce suicide si particulier, dans un endroit où l'on accède pas facilement, avec pour résultat une souffrance qui doit être abominable. Il y a des limites à la culpabilité, s'infliger ça, ce n'est pas anodin.
L'habileté de Christophe Guillaumot, c'est de jouer justement sur le pouvoir de l'addiction, de mettre en scène un personnage qui n'a plus rien à perdre, expression bien malheureuse quand on sait qu'il lui reste effectivement quelque chose à perdre : sa vie. Sans oublier qu'il existe une autre addiction peut-être plus dangereuse encore, celle du pouvoir et de la domination...
Ironie du sort, c'est le hasard qui va aiguiller Renato sur cette histoire. A cause d'une fresque murale. Du street art représentant le visage du suicidé du compacteur. Une coïncidence qui ne peut pas en être vraiment une. Excellent limier, Renato va se démener pour remonter cette piste et faire avancer une enquête qui va soudain prendre de bien plus grandes proportions.
J'ai évoqué la construction du roman, vous verrez qu'elle est assez atomisé, avec différents fils narratifs dont on ne comprend pas tout de suite comment ils vont pouvoir se réunir. Quel est le rôle exact des personnages qu'on va qualifier de secondaires (même si le mot est un peu inadéquat) et où tout cela va-t-il nous mener ?
C'est efficace, addictif, alternant agréablement les pics de tension et les scènes plus détendues, voire intimiste. On apprend à connaître les deux flics que l'on devrait suivre dans de nouvelles aventures, et on s'attache à eux. Le lecteur que je suis adorerait se faire appeler gros chameau par Renato et la situation de Cussac fait mal au coeur, même si son comportement, compréhensible, peut agacer.
Quant à l'intrigue, elle ne se développe pas sur un rythme de thriller, mais les engrenages s'assemblent petit à petit pour arriver à la révélation de ce qui se passe réellement à Toulouse. On a la sensation de lire un roman qui pourrait être le scénario d'une série télévisée, avec ses intrigues secondaires (dont un clin d'oeil à "The Shield") entourant son intrigue principal, ses états d'âme et ses affaires personnelles.
J'ai vraiment envie de retrouver Renato et Cussac (la fin de "la Chance du perdant" ouvre d'ailleurs la porte à une suite directe), de les voir s'installer dans leur nouveau rôle, de faire de leur placard un service capable de quelques exploits retentissants. Le duo tient vraiment la route, dans leurs différences autant que dans leur complémentarité, et une amitié pleine de pudeur et de sincérité.
Cela tient sans doute à la personnalité de l'auteur : il est flic lui-même, capitaine au SRPJ de Toulouse et responsable de cette fameuse section courses et jeux, dont il ne donne pourtant pas l'image la plus flatteuse dans ce roman. Décidément, les policiers qui se lancent dans l'écriture sont légion en ce moment, mais leurs points de vue divers offrent une palette de contextes et d'histoires très large.
On se doute que Christophe Guillaumot s'inspire de son expérience professionnelle pour élaborer ses histoires, mais il y puise aussi pour ses personnages. A commencer par Renato Donatelli, directement inspiré d'un de ses anciens collègues, originaire de Wallis mais possédant la même carrure, la même bonhomie et le même franc parler que son alter ego de papier.
Oui, je suis curieux de découvrir la suite de cette série, car elle touche aussi à un sujet, le jeu, qui est finalement assez peu traité, alors qu'on se dit qu'il pourrait inspirer bien des histoires. Le Seuil avait publié deux romans de James Swain, ancien joueur professionnel. Cette série mettait en scène Tony Valentine, un ancien flic chargé de démanteler les arnaques visant des casinos. Sans suite, hélas.
Le point de vue de Swain est sensiblement différent de celui de Guillaumot, même si la brigade toulousaine s'étoffe au cours de "la Chance du perdant", apportant des, disons, compétences nouvelles qui pourraient, à l'avenir, permettre de mener des enquêtes qui pourraient rappeler celles écrites par James Swain.
Et, en attendant de retrouver une nouvelle enquête du Kanak et d'un Six, espérons-le, dans une meilleure forme, physique comme morale, il est fort possible que je patiente en lisant "Abattez les grands arbres", ne serait-ce que pour comprendre ce qui se cache derrière ce magnifique titre. Et que Christophe Guillaumot s'installe durablement dans mes envies de lecture...
"Votre peintre, il divise le monde en deux : il y a ceux qui l'idolâtrent, et ceux qui aimeraient le voir rôtir en enfer".
Je ne suis pas un grand connaisseur d'art, et de peinture en particulier, mais j'ai toujours aimé les livres qui en parlent. Et cet intérêt a encore grandi avec l'arrivée d'internet, car cela offre quelque chose qui m'a longtemps manqué (je pense à la lecture de "la Course à l'abîme", de Dominique Fernandez) : pouvoir regarder les tableaux évoqués dans ces histoires. Notre roman du jour a pour origine un des plus grands chefs d'oeuvre, mais aussi l'un des plus controversés : "la Jardin des Délices", de Jérôme Bosch. Pour le reste, on se dit qu'on va encore tomber sur une histoire de message caché dans un tableau, et c'est le cas, mais, dans "le Mystère Jérôme Bosch" (en grand format au Cherche-Midi éditeur ; traduction de Joël Falcoz), le romancier allemand Peter Dempf joue, exactement comme le peintre, sur la dichotomie entre réalité et imaginaire, entre ce que l'on voit et ce que l'on interprète, entre les sujets peints et leur symbolique. Un récit marqué par la même frénésie et le même foisonnement que l'on ressent lorsqu'on regarde les tableaux de Bosch...
C'est la consternation au Musée du Prado, à Madrid. Un visiteur a cherché à détruire une oeuvre en jetant de l'acide sur la toile. Et il n'a pas choisi de vandaliser n'importe quel tableau : il a délibérément visé "Le Jardin des délices", de Jérôme Bosch, chef d'oeuvre du début du XVe siècle, un triptyque aussi fascinant que dérangeant.
Michael Keie, restaurateur de tableaux originaire de Berlin, s'est vu confier la tâche de réparer les dégâts, heureusement minimes, occasionné par cette attaque. Pour l'aider, il peut compter sur l'aide d'Antonio de Nebrija, lui aussi restaurateur, mais également un érudit, qui travaille depuis 40 ans au décryptage de ce tableau plein de mystères.
Les deux hommes se mettent rapidement au travail. Et, rapidement, Antonio de Nebrija pense avoir découvert quelque chose : des signes, que l'action du produit jeté sur la toile a fait apparaître... très excité, il imagine déjà tout ce que cela va révéler. Plus modéré, mais également moins pointu quant à l'histoire de Bosch et de son oeuvre, Keie ne s'enflamme pas.
Mais, avant d'avoir pu échangé sur cette découverte, les deux hommes sont interrompus par une visite inattendue. La jeune femme s'appelle Grit Vanderwerf, elle se présente comme psychologue et psychothérapeute. C'est elle qu'on a chargée d'examiner l'homme qui a profané "le Jardin des délices". Et, pour mener à bien son examen, elle voudrait connaître l'ampleur des dégâts.
Un peu méfiant, Michael accepte de discuter avec Grit, tout en lui cachant les éléments principaux, et particulièrement la possible découverte d'Antonio. Lui-même espère en savoir un peu plus sur ce fou (il ne peut être que fou, de son point de vue) qui a voulu détruire un chef d'oeuvre vieux de 500 ans. Et il ne va pas être déçu...
Grit lui révèle en effet que l'homme s'avère être un prêtre dominicain, le père Baerle, venu de Salamanque avec la ferme intention de s'en prendre à ce tableau, et celui-là en particulier. Un prêtre qui a été exclu de son ordre : son geste sur "le Jardin des délices" n'est pas le premier, mais c'est la cinquième fois qu'il essaye de détruire un tableau...
En outre, il a également détruit des documents datant de la fin du Moyen-Âge et des débuts de la Renaissance... Leur point commun : avoir pour sujet les femmes. Le père Baerle semble être un fieffé misogyne. Et cela pose problème : il refuse de parler à Grit. Et s'il ne s'explique pas, impossible pour elle de mener son expertise à bien.
La jeune femme demande alors à Michael de l'aider : pourrait-il l'accompagner et rencontrer Baerle ? A lui, le prêtre déchu se confierait peut-être. S'il expliquait plus clairement les raisons de son geste, cela simplifierait les choses. Le restaurateur accepte, malgré ses doutes, ses interrogations. Sa curiosité l'emporte...
Et, lorsqu'il se retrouve face au père Baerle, celui-ci, en effet, rompt le silence. Il se lance même dans une histoire complètement folle, qui va projeter ses interlocuteurs 500 ans en arrière. L'histoire de Petronius Oris, jeune peintre originaire d'Augsbourg venu à Bois-le-Duc pour demander à Jérôme Bosch de le prendre sous son aile...
Nous sommes en 1510 et la ville néerlandaise de Den Bosch (Bois-le-Duc, en français ; Bosch, de son vrai nom Jérôme Van Aken, a choisi ce pseudonyme pour signer ses toiles) est en effervescence. L'Inquisition, menée par les Dominicains, a décidé de faire régner l'ordre et la morale chrétienne la plus stricte dans cette ville qui, à leurs yeux, a pris trop de libertés.
Et l'un des principaux boucs émissaires du père Jean, inquisiteur en chef, s'appelle justement Jérôme Bosch, dont les tableaux fantasmagoriques sont jugés irrationnels et immoraux. Petronius Oris, naïf et bien plus concerné par son art que par ces questions religieuses, débarque dans une ville où règne la peur, où les bûchers se multiplient et où chacun redoute d'être arrêté et passé à la question...
Face à cet arbitraire, Bosch et ses partisans. Le peintre appartient à une confrérie, une société oecuménique chargée d'organiser différentes manifestations en rapport avec le calendrier liturgiques, des mystères, des processions pour célébrer les grandes fêtes. Bosch, qui est l'un des membres les plus actifs de la confrérie, réalise les décors et les costumes pour ces festivités.
Mais, la confrérie elle aussi est dans le collimateur de l'Inquisiteur, qui lui prête d'autres intentions bien moins avouables. Petronius Oris, découvre avec un certain effarement cette violente lutte entre deux institutions, et doit trouver ses marques. Il faut s'habituer au caractère autoritaire, presque revêche, de maître Bosch, autant qu'au harcèlement du père Jean...
L'apprenti va aussi faire la connaissance d'autres personnages qui vont devenir important : la belle serveuse, Zita, le Grand Zuid, un mendiant toujours prêt à dépanner, Pieter, lui aussi compagnon travaillant pour Bosch, ou encore l'érudit Jacob Van Almaengien, un proche du peintre. Et, bien sûr, il doit faire ses preuves pour espérer rester aux côtés de Bosch.
Bientôt, Petronius Oris se retrouve coincé entre le marteau et l'enclume, entre Bosch, qui semble avoir bien des secrets, certains concernant une ambitieuse oeuvre en cours de réalisation, et l'inquisiteur, qui voudrait bien faire du jeune homme son agent au sein de la confrérie, afin de démasquer le peintre et de réunir les preuves suffisantes pour le condamner au bûcher...
Pardon, cette entrée en matière est un peu longue. Mais, ces éléments sont nécessaires pour savoir de quoi on parle dans ce roman. Ce qui frappe, d'emblée, c'est l'incroyable charisme du père Baerle, dont l'histoire semble plus vrai que nature. C'est comme si ses interlocuteurs s'étaient vraiment retrouvé projetés depuis Madrid de nos jours vers Den Bosch au début du XVIe siècle...
Un pouvoir quasi hypnotique, presque surnaturel, qui va prendre, pour les lecteur, des allures de mise en abyme. En effet, on imagine, en lisant "le Mystère Jérôme Bosch", une mise en scène qui rappelle les techniques utilisées par certains scénaristes de séries télévisées qui racontent une histoire passée en y immergeant leurs personnages habituels, transposés dans d'autres époques. A vous de découvrir qui est qui...
Il y a vraiment quelque chose de troublant dans le récit du Dominicain, à plus d'un titre (j'ai volontairement laissé dans l'ombre quelques éléments qui vont dans ce sens). Et en particulier son rythme effréné, une fois que Petronius Oris est installé à Bois-le-Duc. Peter Dempf donne à son récit la cadence d'une sarabande endiablée (c'est le cas de le dire) qui ne retombe jamais...
En introduction, j'ai utilisé le mot de frénésie, et c'est véritablement ce que j'ai ressenti. On n'a jamais le temps de souffler, les chapitres sont brefs, mais, de l'un à l'autre, on tombe dans un nouveau rebondissement, une nouvelle situation précaire, un nouveau danger... Et de nouvelles interrogations. Car, bientôt, le lecteur se retrouve dans la même situation de Petronius Oris : pris de paranoïa.
Petronius Oris débarque à Bois-le-Duc, il n'est pas au fait des forces en présence, c'est un garçon candide, dévoué à son art et peu préparé à se retrouvé prisonnier de terribles luttes de pouvoir. Autour de lui, les autres personnages semblent se trouver sur son passage de manière presque fantastique, parfois pour l'aider, parfois pour l'intimider.
Rapidement, il ne sait plus du tout à qui faire confiance, il redoute d'être trahi par ceux qui l'entourent... Il découvre des éléments troublants, comme la disparition de l'apprenti dont il a pris la place dans la maison Bosch. Ne sachant qui croire, qui écouter, il redoute aussi bien la tyrannie du père Jean que les cachotteries du peintre.
L'Inquisition d'un côté, la confrérie, dont les activités lui semblent de plus en plus mystérieuses, de l'autre, Petronius Oris est un chien dans un jeu de quilles. La cible de tous, la proie de tous... A moins qu'il ne se fasse des idées ? De portes qui claquent en impressions d'être épié, de situations ambiguës en pièges évités de justesse, Petronius Oris se débat, comme prisonnier d'une toile d'araignée.
Voilà pour la forme. Un récit échevelé, qu'on ne lâche pas, car il se passe sans cesse quelque chose. Mais, une histoire qui laisse une impression étrange, dérangeante : ce qu'on nous raconte, est-ce un récit fidèle des événements ou une espèce de fiction dont le but est de semer le trouble chez celui qui l'écoute ? En tout cas, on a l'impression de faire un cauchemar bien tourmenté, à l'image d'une toile de Bosch...
C'est la force de ce roman, cette cohérence entre l'univers du peintre, dont la personne et l'oeuvre sont au centre de l'histoire, et la façon de raconter ce récit parallèle, qui finit par devenir la trame principale, celle occupant la majeure partie du livre. Ca ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans la partie contemporaine, mais ces événements-là découlent de ce qu'ils apprennent du passé.
C'est en tout cas très efficace, Peter Dempf nous immerge dans cette histoire folle, pleine de dangers, et d'autant plus périlleuse qu'on ne sait ni qui mène la danse, ni d'où peuvent venir les coups. Au fil des pages, la parano devient contagieuse : on se met à la place du pauvre Petronius Oris, qui semble sincère et qui risque sa vie à chaque pas ou presque.
Mais, on se demande ce que tout cela pourrait provoquer dans la période contemporaine. Car, on sent bien que, si les forces en présence ont forcément un peu changé en cinq siècles, les rapports de forces, eux, ont certainement traversé les âges. Mais alors, si Michael Keie succède à Petronius Oris, doit-il à son tour se méfier de tous, à commencer par Grit et le père Baerle ?
Reste à parler du fond. Car c'est un point très important. Rassurez-vous, je ne vais pas développer autant, car cela nous amènerait à dévoiler certains éléments qui sont au coeur de l'intrigue. Il est toutefois intéressant d'observer que Peter Dempf a utilisé des faits avérés, malgré le peu de choses qu'on sait de la vie de Bosch, et des éléments qui ont, depuis longtemps, intrigué les historiens.
Au coeur du "Mystère Jérôme Bosch", une thèse très intéressante, même si, il faut le dire, elle est désormais réfutée par la majeure partie des chercheurs qui se sont penchés sur la question. Pourtant, on ne peut nier les liens qui apparaissent entre cette hypothèse et les différents aspects symboliques disséminés par Bosch dans son foisonnant "Jardin des délices".
Au fil de son récit, tout cela est présenté au lecteur, que ce soit dans la partie se déroulant en 1510, comme dans les conversations entre les restaurateurs ou avec Grif. C'est passionnant, mais l'on ne peut se demander qui a l'imagination la plus fertile, entre celui qui a élaboré et peint de telles toiles et ceux qui en tirent des interprétations extrêmement complexes.
Oui, ces histoires m'ont passionné. D'abord, parce qu'on mesure le travail herculéen que représente la réalisation d'un triptyque comme "le Jardin des délices". Dans son inspiration, d'abord, dans sa composition, ensuite, sa construction extrêmement précise malgré l'impression que ça part dans tous les sens. Enfin, dans la mise en forme finale, jusqu'aux plus infimes détails.
Et puis, on se rend compte qu'on tombe en plein dans les débats du moment, concernant la dénonciation d'un patriarcat triomphant et le statut des femmes dans cette société. Là encore, difficile de développer sans trop en dire, mais les théories présentées par Peter Dempf, dans le sillage de la misogynie effrayante du père Baerle, sont tout à fait intéressantes.
Les jeux de pouvoirs qui traversent ce double récit changent alors d'aspect. Ou est-ce le lecteur qui les appréhende soudain sous un autre angle ? En tout cas, il y a, de manière assez surprenante, derrière le terrible bras de fer entre le peintre et l'inquisiteur, une bataille épique au rôle clé dans ce qu'on appelle la Guerre des sexes. Une guerre qui a bien lieu, et se poursuit...
Qui ne s'est jamais demandé, en visitant le Prado ou en tombant sur une reproduction de ce triptyque, d'où venait l'imagination débridée de Jérôme Bosch ? Etait-il complètement fou ? Accédait-il à une forme de mysticisme bien différente de celle qu'on croise habituellement ? Là encore, Peter Dempf apporte quelques réponses assez intéressantes, amusantes, même, mais assez troublantes, aussi.
Evidemment, quand on se retrouve face à un livre dont l'histoire repose sur des symboles cachés dans un tableau de maître, on pense immédiatement à Dan Brown et à son "Da Vinci Code". Le réflexe est naturel, mais le lien est certainement erroné. D'abord, parce que la première version du "Mystère Jérôme Bosch" est sortie en Allemagne en 1999, donc plusieurs années avant le roman de Brown.
Ensuite, parce que chez Dempf, il y a un élément fondamental qu'on ne trouve jamais dans les enquêtes de Robert Langdon : le doute. Les hypothèses que manie Peter Dempf ne sont pas présentées comme des certitudes, comme des faits à prendre pour argent comptant. Non, les personnages du "Mystère Jérôme Bosch" soulève ces interrogations, elles sont même un élément fort du livre.
En effet, d'une certaine manière, tout repose sur le doute. Jusqu'à une fin assez spéciale, car elle paraît paradoxalement à la fois très ouverte et finalement assez fermée. Là, vous devez regretter que je ne puisse en dire plus, mais cette fin couronne tout le reste, laissant le lecteur dans son malaise, son inconfort, son questionnement. Et si... ?
Si l'on devait prendre une référence littéraire récente pour évoquer le roman de Peter Dempf, ce serait donc plutôt vers l'excellentissime "Tableau du maître flamand", d'Arturo Perez-Reverte. Avec énormément de différences, bien sûr. De même, la quatrième de couverture évoque la série de polars artistiques d'Iain Pears mettant en scène le personnage de Jonathan Argyll.
On pourrait évoquer également la série du duo Jacques Ravenne et Eric Giacometti, mettant en scène Antoine Marcas, flic et franc-maçon. On retrouve dans ces thrillers la même mise en parallèle d'une trame contemporaine et d'une autre se déroulant dans le passé, les deux dialoguant, en tout cas aux yeux du lecteur. On retrouve aussi une dimension ésotérique, toutefois différente de celle de Dempf.
On a en tout cas une belle alliance, celle d'un thriller efficace, rapide, mouvementé, même si, je le redis, on se demande si on est pas plus dans un cauchemar, le délire d'un être pris de folie, ou de peur, que dans un récit très construit, et de réflexions très contemporaine et profondes. De la même façon que Dempf joue sur le doute dans le fond et les ambiguïtés dans les faits, il y ajoute un certain flou pour le trouble.
Lorsque l'on regarde les oeuvres de Bosch, on a tendance à vouloir le placer automatiquement du côté des créateurs de dystopies. Et pourtant... Aurions-nous sous les yeux, lorsque l'on regarde en détails "le Jardin des délices" (ses trois battants sans oublier leur envers) la plus éclatante et folle représentation d'une utopie qui, en son temps, aurait pu remettre en cause la vision dominante du monde ?
Vous avez... le temps de lire le livre de Peter Dempf !
C'est la consternation au Musée du Prado, à Madrid. Un visiteur a cherché à détruire une oeuvre en jetant de l'acide sur la toile. Et il n'a pas choisi de vandaliser n'importe quel tableau : il a délibérément visé "Le Jardin des délices", de Jérôme Bosch, chef d'oeuvre du début du XVe siècle, un triptyque aussi fascinant que dérangeant.
Michael Keie, restaurateur de tableaux originaire de Berlin, s'est vu confier la tâche de réparer les dégâts, heureusement minimes, occasionné par cette attaque. Pour l'aider, il peut compter sur l'aide d'Antonio de Nebrija, lui aussi restaurateur, mais également un érudit, qui travaille depuis 40 ans au décryptage de ce tableau plein de mystères.
Les deux hommes se mettent rapidement au travail. Et, rapidement, Antonio de Nebrija pense avoir découvert quelque chose : des signes, que l'action du produit jeté sur la toile a fait apparaître... très excité, il imagine déjà tout ce que cela va révéler. Plus modéré, mais également moins pointu quant à l'histoire de Bosch et de son oeuvre, Keie ne s'enflamme pas.
Mais, avant d'avoir pu échangé sur cette découverte, les deux hommes sont interrompus par une visite inattendue. La jeune femme s'appelle Grit Vanderwerf, elle se présente comme psychologue et psychothérapeute. C'est elle qu'on a chargée d'examiner l'homme qui a profané "le Jardin des délices". Et, pour mener à bien son examen, elle voudrait connaître l'ampleur des dégâts.
Un peu méfiant, Michael accepte de discuter avec Grit, tout en lui cachant les éléments principaux, et particulièrement la possible découverte d'Antonio. Lui-même espère en savoir un peu plus sur ce fou (il ne peut être que fou, de son point de vue) qui a voulu détruire un chef d'oeuvre vieux de 500 ans. Et il ne va pas être déçu...
Grit lui révèle en effet que l'homme s'avère être un prêtre dominicain, le père Baerle, venu de Salamanque avec la ferme intention de s'en prendre à ce tableau, et celui-là en particulier. Un prêtre qui a été exclu de son ordre : son geste sur "le Jardin des délices" n'est pas le premier, mais c'est la cinquième fois qu'il essaye de détruire un tableau...
En outre, il a également détruit des documents datant de la fin du Moyen-Âge et des débuts de la Renaissance... Leur point commun : avoir pour sujet les femmes. Le père Baerle semble être un fieffé misogyne. Et cela pose problème : il refuse de parler à Grit. Et s'il ne s'explique pas, impossible pour elle de mener son expertise à bien.
La jeune femme demande alors à Michael de l'aider : pourrait-il l'accompagner et rencontrer Baerle ? A lui, le prêtre déchu se confierait peut-être. S'il expliquait plus clairement les raisons de son geste, cela simplifierait les choses. Le restaurateur accepte, malgré ses doutes, ses interrogations. Sa curiosité l'emporte...
Et, lorsqu'il se retrouve face au père Baerle, celui-ci, en effet, rompt le silence. Il se lance même dans une histoire complètement folle, qui va projeter ses interlocuteurs 500 ans en arrière. L'histoire de Petronius Oris, jeune peintre originaire d'Augsbourg venu à Bois-le-Duc pour demander à Jérôme Bosch de le prendre sous son aile...
Nous sommes en 1510 et la ville néerlandaise de Den Bosch (Bois-le-Duc, en français ; Bosch, de son vrai nom Jérôme Van Aken, a choisi ce pseudonyme pour signer ses toiles) est en effervescence. L'Inquisition, menée par les Dominicains, a décidé de faire régner l'ordre et la morale chrétienne la plus stricte dans cette ville qui, à leurs yeux, a pris trop de libertés.
Et l'un des principaux boucs émissaires du père Jean, inquisiteur en chef, s'appelle justement Jérôme Bosch, dont les tableaux fantasmagoriques sont jugés irrationnels et immoraux. Petronius Oris, naïf et bien plus concerné par son art que par ces questions religieuses, débarque dans une ville où règne la peur, où les bûchers se multiplient et où chacun redoute d'être arrêté et passé à la question...
Face à cet arbitraire, Bosch et ses partisans. Le peintre appartient à une confrérie, une société oecuménique chargée d'organiser différentes manifestations en rapport avec le calendrier liturgiques, des mystères, des processions pour célébrer les grandes fêtes. Bosch, qui est l'un des membres les plus actifs de la confrérie, réalise les décors et les costumes pour ces festivités.
Mais, la confrérie elle aussi est dans le collimateur de l'Inquisiteur, qui lui prête d'autres intentions bien moins avouables. Petronius Oris, découvre avec un certain effarement cette violente lutte entre deux institutions, et doit trouver ses marques. Il faut s'habituer au caractère autoritaire, presque revêche, de maître Bosch, autant qu'au harcèlement du père Jean...
L'apprenti va aussi faire la connaissance d'autres personnages qui vont devenir important : la belle serveuse, Zita, le Grand Zuid, un mendiant toujours prêt à dépanner, Pieter, lui aussi compagnon travaillant pour Bosch, ou encore l'érudit Jacob Van Almaengien, un proche du peintre. Et, bien sûr, il doit faire ses preuves pour espérer rester aux côtés de Bosch.
Bientôt, Petronius Oris se retrouve coincé entre le marteau et l'enclume, entre Bosch, qui semble avoir bien des secrets, certains concernant une ambitieuse oeuvre en cours de réalisation, et l'inquisiteur, qui voudrait bien faire du jeune homme son agent au sein de la confrérie, afin de démasquer le peintre et de réunir les preuves suffisantes pour le condamner au bûcher...
Pardon, cette entrée en matière est un peu longue. Mais, ces éléments sont nécessaires pour savoir de quoi on parle dans ce roman. Ce qui frappe, d'emblée, c'est l'incroyable charisme du père Baerle, dont l'histoire semble plus vrai que nature. C'est comme si ses interlocuteurs s'étaient vraiment retrouvé projetés depuis Madrid de nos jours vers Den Bosch au début du XVIe siècle...
Un pouvoir quasi hypnotique, presque surnaturel, qui va prendre, pour les lecteur, des allures de mise en abyme. En effet, on imagine, en lisant "le Mystère Jérôme Bosch", une mise en scène qui rappelle les techniques utilisées par certains scénaristes de séries télévisées qui racontent une histoire passée en y immergeant leurs personnages habituels, transposés dans d'autres époques. A vous de découvrir qui est qui...
Il y a vraiment quelque chose de troublant dans le récit du Dominicain, à plus d'un titre (j'ai volontairement laissé dans l'ombre quelques éléments qui vont dans ce sens). Et en particulier son rythme effréné, une fois que Petronius Oris est installé à Bois-le-Duc. Peter Dempf donne à son récit la cadence d'une sarabande endiablée (c'est le cas de le dire) qui ne retombe jamais...
En introduction, j'ai utilisé le mot de frénésie, et c'est véritablement ce que j'ai ressenti. On n'a jamais le temps de souffler, les chapitres sont brefs, mais, de l'un à l'autre, on tombe dans un nouveau rebondissement, une nouvelle situation précaire, un nouveau danger... Et de nouvelles interrogations. Car, bientôt, le lecteur se retrouve dans la même situation de Petronius Oris : pris de paranoïa.
Petronius Oris débarque à Bois-le-Duc, il n'est pas au fait des forces en présence, c'est un garçon candide, dévoué à son art et peu préparé à se retrouvé prisonnier de terribles luttes de pouvoir. Autour de lui, les autres personnages semblent se trouver sur son passage de manière presque fantastique, parfois pour l'aider, parfois pour l'intimider.
Rapidement, il ne sait plus du tout à qui faire confiance, il redoute d'être trahi par ceux qui l'entourent... Il découvre des éléments troublants, comme la disparition de l'apprenti dont il a pris la place dans la maison Bosch. Ne sachant qui croire, qui écouter, il redoute aussi bien la tyrannie du père Jean que les cachotteries du peintre.
L'Inquisition d'un côté, la confrérie, dont les activités lui semblent de plus en plus mystérieuses, de l'autre, Petronius Oris est un chien dans un jeu de quilles. La cible de tous, la proie de tous... A moins qu'il ne se fasse des idées ? De portes qui claquent en impressions d'être épié, de situations ambiguës en pièges évités de justesse, Petronius Oris se débat, comme prisonnier d'une toile d'araignée.
Voilà pour la forme. Un récit échevelé, qu'on ne lâche pas, car il se passe sans cesse quelque chose. Mais, une histoire qui laisse une impression étrange, dérangeante : ce qu'on nous raconte, est-ce un récit fidèle des événements ou une espèce de fiction dont le but est de semer le trouble chez celui qui l'écoute ? En tout cas, on a l'impression de faire un cauchemar bien tourmenté, à l'image d'une toile de Bosch...
C'est la force de ce roman, cette cohérence entre l'univers du peintre, dont la personne et l'oeuvre sont au centre de l'histoire, et la façon de raconter ce récit parallèle, qui finit par devenir la trame principale, celle occupant la majeure partie du livre. Ca ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans la partie contemporaine, mais ces événements-là découlent de ce qu'ils apprennent du passé.
C'est en tout cas très efficace, Peter Dempf nous immerge dans cette histoire folle, pleine de dangers, et d'autant plus périlleuse qu'on ne sait ni qui mène la danse, ni d'où peuvent venir les coups. Au fil des pages, la parano devient contagieuse : on se met à la place du pauvre Petronius Oris, qui semble sincère et qui risque sa vie à chaque pas ou presque.
Mais, on se demande ce que tout cela pourrait provoquer dans la période contemporaine. Car, on sent bien que, si les forces en présence ont forcément un peu changé en cinq siècles, les rapports de forces, eux, ont certainement traversé les âges. Mais alors, si Michael Keie succède à Petronius Oris, doit-il à son tour se méfier de tous, à commencer par Grit et le père Baerle ?
Reste à parler du fond. Car c'est un point très important. Rassurez-vous, je ne vais pas développer autant, car cela nous amènerait à dévoiler certains éléments qui sont au coeur de l'intrigue. Il est toutefois intéressant d'observer que Peter Dempf a utilisé des faits avérés, malgré le peu de choses qu'on sait de la vie de Bosch, et des éléments qui ont, depuis longtemps, intrigué les historiens.
Au coeur du "Mystère Jérôme Bosch", une thèse très intéressante, même si, il faut le dire, elle est désormais réfutée par la majeure partie des chercheurs qui se sont penchés sur la question. Pourtant, on ne peut nier les liens qui apparaissent entre cette hypothèse et les différents aspects symboliques disséminés par Bosch dans son foisonnant "Jardin des délices".
Au fil de son récit, tout cela est présenté au lecteur, que ce soit dans la partie se déroulant en 1510, comme dans les conversations entre les restaurateurs ou avec Grif. C'est passionnant, mais l'on ne peut se demander qui a l'imagination la plus fertile, entre celui qui a élaboré et peint de telles toiles et ceux qui en tirent des interprétations extrêmement complexes.
Oui, ces histoires m'ont passionné. D'abord, parce qu'on mesure le travail herculéen que représente la réalisation d'un triptyque comme "le Jardin des délices". Dans son inspiration, d'abord, dans sa composition, ensuite, sa construction extrêmement précise malgré l'impression que ça part dans tous les sens. Enfin, dans la mise en forme finale, jusqu'aux plus infimes détails.
Et puis, on se rend compte qu'on tombe en plein dans les débats du moment, concernant la dénonciation d'un patriarcat triomphant et le statut des femmes dans cette société. Là encore, difficile de développer sans trop en dire, mais les théories présentées par Peter Dempf, dans le sillage de la misogynie effrayante du père Baerle, sont tout à fait intéressantes.
Les jeux de pouvoirs qui traversent ce double récit changent alors d'aspect. Ou est-ce le lecteur qui les appréhende soudain sous un autre angle ? En tout cas, il y a, de manière assez surprenante, derrière le terrible bras de fer entre le peintre et l'inquisiteur, une bataille épique au rôle clé dans ce qu'on appelle la Guerre des sexes. Une guerre qui a bien lieu, et se poursuit...
Qui ne s'est jamais demandé, en visitant le Prado ou en tombant sur une reproduction de ce triptyque, d'où venait l'imagination débridée de Jérôme Bosch ? Etait-il complètement fou ? Accédait-il à une forme de mysticisme bien différente de celle qu'on croise habituellement ? Là encore, Peter Dempf apporte quelques réponses assez intéressantes, amusantes, même, mais assez troublantes, aussi.
Evidemment, quand on se retrouve face à un livre dont l'histoire repose sur des symboles cachés dans un tableau de maître, on pense immédiatement à Dan Brown et à son "Da Vinci Code". Le réflexe est naturel, mais le lien est certainement erroné. D'abord, parce que la première version du "Mystère Jérôme Bosch" est sortie en Allemagne en 1999, donc plusieurs années avant le roman de Brown.
Ensuite, parce que chez Dempf, il y a un élément fondamental qu'on ne trouve jamais dans les enquêtes de Robert Langdon : le doute. Les hypothèses que manie Peter Dempf ne sont pas présentées comme des certitudes, comme des faits à prendre pour argent comptant. Non, les personnages du "Mystère Jérôme Bosch" soulève ces interrogations, elles sont même un élément fort du livre.
En effet, d'une certaine manière, tout repose sur le doute. Jusqu'à une fin assez spéciale, car elle paraît paradoxalement à la fois très ouverte et finalement assez fermée. Là, vous devez regretter que je ne puisse en dire plus, mais cette fin couronne tout le reste, laissant le lecteur dans son malaise, son inconfort, son questionnement. Et si... ?
Si l'on devait prendre une référence littéraire récente pour évoquer le roman de Peter Dempf, ce serait donc plutôt vers l'excellentissime "Tableau du maître flamand", d'Arturo Perez-Reverte. Avec énormément de différences, bien sûr. De même, la quatrième de couverture évoque la série de polars artistiques d'Iain Pears mettant en scène le personnage de Jonathan Argyll.
On pourrait évoquer également la série du duo Jacques Ravenne et Eric Giacometti, mettant en scène Antoine Marcas, flic et franc-maçon. On retrouve dans ces thrillers la même mise en parallèle d'une trame contemporaine et d'une autre se déroulant dans le passé, les deux dialoguant, en tout cas aux yeux du lecteur. On retrouve aussi une dimension ésotérique, toutefois différente de celle de Dempf.
On a en tout cas une belle alliance, celle d'un thriller efficace, rapide, mouvementé, même si, je le redis, on se demande si on est pas plus dans un cauchemar, le délire d'un être pris de folie, ou de peur, que dans un récit très construit, et de réflexions très contemporaine et profondes. De la même façon que Dempf joue sur le doute dans le fond et les ambiguïtés dans les faits, il y ajoute un certain flou pour le trouble.
Lorsque l'on regarde les oeuvres de Bosch, on a tendance à vouloir le placer automatiquement du côté des créateurs de dystopies. Et pourtant... Aurions-nous sous les yeux, lorsque l'on regarde en détails "le Jardin des délices" (ses trois battants sans oublier leur envers) la plus éclatante et folle représentation d'une utopie qui, en son temps, aurait pu remettre en cause la vision dominante du monde ?
Vous avez... le temps de lire le livre de Peter Dempf !
mardi 24 octobre 2017
"Faut arrêter, Kloé ! (...) Arrêter de chercher, de fouiller ! Faut arrêter votre enquête, oubliez votre père..."
Il est des sujets éternels, comme la quête d'identité et la quête des origines. Hélas, pour beaucoup d'enfants abandonnés ou nés sous X, la réalité rattrape souvent la fiction. Mais, cette dernière, dans ce domaine, peut offrir une gamme de genres très différents pour traiter cette questions. Voici un polar qui met en scène une jeune femme, déterminée à savoir qui sont ses parents. Polar, parce que ce qu'elle va découvrir va l'envoyer plutôt à la chronique faits-divers qu'au carnet rose... "Privé d'origine", de Jérémy Bouquin (en format de poche aux éditions French Pulp), nous replonge dans la période agitée des "Années de plomb" et ce tournant des années 1970-80, marqué par le recours à la violence des mouvances révolutionnaires. Des thèmes assez classiques, mais une histoire prenante qui se développe à travers deux époques, servi par une écriture sèche, presque lapidaire, et rendant un hommage appuyé au néo-polar.
Kloé est bassiste dans un groupe punk rock qui connaît un joli succès. Elle est la dernière arrivée au sein du groupe, mais a déjà bien trouvé ses marques et s'éclate. Cette tournée s'achève par un concert sur la mythique scène du Printemps de Bourges, devant 5000 personnes déchaînées. Ensuite, place à quelques vacances bien méritées, avant de retrouver le studio pour enregistrer un nouvel album.
A l'issue de cette mémorable soirée, Kloé reçoit un message d'un dénommé Jasper. La jeune musicienne a embauché ce détective privé pour qu'il l'aide à retrouver la trace de ses parents, qu'elle n'a jamais connus. Elle sait depuis longtemps qu'elle a été adoptée et considère le couple qui l'a élevée comme ses parents, mais elle voudrait savoir d'où elle vient...
Jasper n'est pas du genre rigolo, ni très causant, mais il est efficace. Au prix où Kloé le paye, il peut. Et pourtant, il semble peiner à trouver des éléments concernant la jeune femme. Cette fois, cependant, il a du concret : un acte de naissance, dont Kloé se moque, car elle connaît déjà ce qu'il y a sur ce document. Mais le privé y joint une lettre, une lettre que lui a écrite sa mère...
Mieux encore, il aurait déniché des informations sur le père de la bassiste. Mais, Jasper semble mal à l'aise, hésitant... La piste mise au jour mène à un dossier classé "secret défense". Le père de Kloé serait recherché pour faits de terrorisme, une histoire remontant à plus de 30 ans. Un crime qui s'est déroulé en Italie, durant cette période qu'on appelle "les Années de plomb"...
1979, à Milan. Marco s'est engagé par idéalisme dans des groupuscules révolutionnaires. Il y a les Brigades rouges, bien sûr, le mouvement le plus fameux de cette époque d'une violence extrême. Et puis, il y a toute une nébuleuse de petits groupes plus ou moins bien structurés, plus ou moins bien préparés, dont certains ont tendance à glisser de l'action révolutionnaire vers le grand banditisme...
Ce coup-là, le braquage d'une bijouterie, ce n'est pas vraiment ce à quoi rêve Marco. Mais, il est là, une arme lourde à la main, faisant le guet... Quand tout dérape. La fusillade éclate, tout le monde tire, même Marco. Le bijoutier qui n'a pas voulu se laisser faire tombe, mais avant, il riposte. Et Marco est touché, grièvement...
Quand la police arrive sur la scène, ils ont l'impression d'être sur un champ de bataille. Les traces de la fusillade sont partout. Et, parmi elles, le sang de Marco, qui devient un indice capital. Une preuve qui peut l'envoyer à perpétuité derrière les barreaux. A peine conscient, le jeune homme est pris en charge par ses complices, qui l'évacuent.
Commence alors une longue cavale, qui va devenir un long exil. Impossible de rester en Italie, et même s'il l'avait voulu, il n'est pas en état de décider. Une nouvelle identité l'attend, une nouvelle vie, aussi, à condition de se remettre de cette sale blessure... Il doit laisser derrière lui ses idéaux, ses combats, faire profil bas et se faire oublier...
Les deux histoires, celle de Kloé et cette de Marco, vont s'entremêler, une parfaite alternance, un chapitre sur les recherches de la jeune femme, un chapitre sur la nouvelle existence de Marco. On se doute bien que ces deux-là sont liés, mais il reste encore à comprendre beaucoup de choses, pourquoi plus de 30 ans après sa naissance, Kloé a tant de mal à retrouver la trace de ses parents biologiques.
Ces raisons, on va les découvrir peu à peu, dans un récit qui ne va pas nous emmener tout à fait là où on l'imaginait. Ou, plus exactement, parce que les événements de Milan ne sont qu'un point de départ et pas la seule explication de tout cela. L'autre élément important, ce sont les difficultés auxquelles Kloé doit faire face dans ses recherches...
Tout cela est somme toute assez classique, dans le fond comme dans la forme, mais "Privé d'origine" reste un polar qui sait captivé son lecteur. D'abord, parce que ses deux personnages centraux sont attachants. Pour Kloé, pas besoin d'entrer dans le détail : elle cherche ses parents, elle est prête à tout, pour cela, même à se mettre en danger...
Quant à Marco, il est typiquement le genre de mec idéaliste qui, brutalement, s'est retrouvé confronté à la réalité. Il pensait oeuvrer pour un monde meilleur, pour renverser un système pourri qui exploite les êtres humains pour le profit. Et le voilà braqueur malgré lui. C'est cette naïveté qui le rend attachant, parce qu'on va découvrir qu'il n'a pas retenu la leçon...
Jérémy Bouquin s'appuie sur des événements réels pour construire son polar. Je ne vais pas tout détailler, car certains de ces événements sont au coeur de l'intrigue. Mais, je peux le faire concernant le braquage de Milan. Cette scène rappelle, avec quelques différences notables, certains faits qui ont valu sa condamnation par contumace à Cesare Battisti.
Soyons précis : Marco n'est pas Battisti, ni même un personnage pouvant y faire directement penser, l'histoire de "Privé d'origine" s'inspire simplement d'événements marquants de cette période, d'abord en Italie, puis en France, afin d'illustrer les dérives de mouvements de gauche radicale ayant opté pour le recours à la violence.
Une lutte clandestine à laquelle les Etats répondent de la même manière, avec le même genre de méthodes, le même côté violent, aussi. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette facette du roman de Jérémy Bouquin, car, là encore, on touche à des points névralgiques de l'intrigue. Et en particulier, à certains personnages qui vont apparaître, dans la trame passée comme dans la trame présente.
Ces personnages, il faut vous laisser les découvrir, parce que l'auteur joue habilement avec certaines dimensions très noires de son histoire. En particulier, "Privé d'origine" repose sur un jeu d'ambiguïtés très bien mené, qui débute avec la rencontre entre Kloé et Jasper, évoqué en début de résumé. L'attitude du privé est un premier élément fort.
Jasper, ce n'est pas le genre de mec à se laisser intimider. Alors, pour qu'on le sente aussi hésitant, aussi mal à l'aise face aux informations qu'il a su dénicher, c'est que c'est du sérieux. Mais, de qui a-t-il peur, pour se conduire de cette façon et conseiller (c'est le titre de notre billet) à Kloé de renoncer à ses recherches ?
En parallèle, il y a le parcours de Marco. Bien sûr, l'histoire de Milan justifierait à elle seule qu'il se fasse très discret depuis si longtemps, d'autant que ce qu'on appelle la "doctrine Mitterrand", c'est-à-dire la décision présidentielle de ne pas extrader vers l'Italie les anciens activistes installés en France, n'est plus d'actualité.
Mais, on se doute bien que l'histoire d'un homme rangé des voitures ne peut pas suffire pour tenir sur 300 pages, un chapitre sur deux. Le fugitif va donc devoir affronter de nouvelles péripéties qui vont confirmer et son idéalisme, et sa terrible naïveté. Le reste, c'est le noeud du roman, un écheveau, même, que Kloé va, petit à petit, avec un culot monstre, démêler.
Il y a beaucoup de noirceur, dans "Privé d'origine", beaucoup d'interrogations, aussi. Le lecteur est aux prises avec des personnages dont il ignore quel jeu ils jouent exactement. Les apparences sont trompeuses, les évidences sont à bannir, et la traditionnel séparation entre bien et mal, entre gentils et méchants n'est qu'un leurre.
L'écriture de Jérémy Bouquin est sèche, sans chichi, sans gras. Des successions de phrases très courtes, sans grandes envolées, sans grandes descriptions. On va à l'essentiel, on avance, on attrape le lecteur, on ne le lâche pas. Je ne suis pas contre un peu plus de chair, de moelleux, mais il faut reconnaître que ce style sert le propos. On avance presque sans s'en rendre compte.
Jérémy Bouquin ne cache pas que ses influences viennent de ce mouvement littéraire qu'on a appelé le néo-polar, dont les fers de lance furent Jean-Patrick Manchette, Didier Daeninckx, Frédéric H. Fajardie, Thierry Jonquet, Jean-Bernard Pouy, Jean Vautrin ou encore Hervé Prudon, qui vient de disparaître.
Autant d'auteurs très engagés à gauche, mais sans angélisme et sachant se montrer aussi critiques sur les dérives de ces mouvements que sur cette société contemporaine qu'ils exècrent, amateurs d'ambiances très noires, de personnages marginaux... Autant d'éléments que l'on retrouve dans "Privé d'origine", jusque dans la partie contemporaine qui reproduit sans cesse les mêmes erreurs.
Né en 1975, Jérémy Bouquin est encore loin de la maîtrise de ses inspirateurs, tant dans l'élaboration de ses intrigues que dans le maniement de la langue, mais "Privé d'origine" est un polar qui atteint son but : piéger le lecteur, jouer au chat et à la souris avec lui, l'emmener vers des fausses pistes, instiller le doute...
La violence de son récit ne l'empêche tout de même pas de garder espoir. En choisissant de raconter cette histoire en partant de la volonté de Kloé de retrouver ses parents, il s'offre ce côté certes douloureux, mais exempt de tout autre type de questionnement. A la jeune femme, peu importent le passé, la politique, la violence, les trahisons, c'est son coeur qui prime sur tout.
Son pavé dans la mare va faire remonter la vase, va réveiller les poissons, plus ou moins gros, qui y dormaient depuis des années. Elle va devoir faire face à des obstacles, à des intimidations, à des fin de non-recevoir. Reste à savoir si elle pourrait se retrouver embringuée dans une histoire dangereuse où elle serait une proie, comme dans certains thrillers américains, style Morrell, Cobain ou Sackey.
Les éditions French Pulp affichent ouvertement leur volonté de renouer avec la tradition de la littérature populaire et même du genre dit "de gare", qu'on regarde souvent avec un certain mépris. En rééditant des livres qui ont connu le succès dans les années 1970-80 et en éditant de jeunes romanciers qui reprennent ce créneau, cette jeune maison entend renouveler ce genre à bout de souffle.
Avec Jérémy Bouquin, le contrat est parfaitement rempli. "Privé d'origine" correspond exactement à ce que l'on peut attendre : un roman noir qui offre à la fois un bon divertissement, sans oublier de donner au lecteur du grain à moudre et de quoi réfléchir. En particulier aux placards de notre Ve République, où l'on continue d'entasser de vilains petits secrets...
Kloé est bassiste dans un groupe punk rock qui connaît un joli succès. Elle est la dernière arrivée au sein du groupe, mais a déjà bien trouvé ses marques et s'éclate. Cette tournée s'achève par un concert sur la mythique scène du Printemps de Bourges, devant 5000 personnes déchaînées. Ensuite, place à quelques vacances bien méritées, avant de retrouver le studio pour enregistrer un nouvel album.
A l'issue de cette mémorable soirée, Kloé reçoit un message d'un dénommé Jasper. La jeune musicienne a embauché ce détective privé pour qu'il l'aide à retrouver la trace de ses parents, qu'elle n'a jamais connus. Elle sait depuis longtemps qu'elle a été adoptée et considère le couple qui l'a élevée comme ses parents, mais elle voudrait savoir d'où elle vient...
Jasper n'est pas du genre rigolo, ni très causant, mais il est efficace. Au prix où Kloé le paye, il peut. Et pourtant, il semble peiner à trouver des éléments concernant la jeune femme. Cette fois, cependant, il a du concret : un acte de naissance, dont Kloé se moque, car elle connaît déjà ce qu'il y a sur ce document. Mais le privé y joint une lettre, une lettre que lui a écrite sa mère...
Mieux encore, il aurait déniché des informations sur le père de la bassiste. Mais, Jasper semble mal à l'aise, hésitant... La piste mise au jour mène à un dossier classé "secret défense". Le père de Kloé serait recherché pour faits de terrorisme, une histoire remontant à plus de 30 ans. Un crime qui s'est déroulé en Italie, durant cette période qu'on appelle "les Années de plomb"...
1979, à Milan. Marco s'est engagé par idéalisme dans des groupuscules révolutionnaires. Il y a les Brigades rouges, bien sûr, le mouvement le plus fameux de cette époque d'une violence extrême. Et puis, il y a toute une nébuleuse de petits groupes plus ou moins bien structurés, plus ou moins bien préparés, dont certains ont tendance à glisser de l'action révolutionnaire vers le grand banditisme...
Ce coup-là, le braquage d'une bijouterie, ce n'est pas vraiment ce à quoi rêve Marco. Mais, il est là, une arme lourde à la main, faisant le guet... Quand tout dérape. La fusillade éclate, tout le monde tire, même Marco. Le bijoutier qui n'a pas voulu se laisser faire tombe, mais avant, il riposte. Et Marco est touché, grièvement...
Quand la police arrive sur la scène, ils ont l'impression d'être sur un champ de bataille. Les traces de la fusillade sont partout. Et, parmi elles, le sang de Marco, qui devient un indice capital. Une preuve qui peut l'envoyer à perpétuité derrière les barreaux. A peine conscient, le jeune homme est pris en charge par ses complices, qui l'évacuent.
Commence alors une longue cavale, qui va devenir un long exil. Impossible de rester en Italie, et même s'il l'avait voulu, il n'est pas en état de décider. Une nouvelle identité l'attend, une nouvelle vie, aussi, à condition de se remettre de cette sale blessure... Il doit laisser derrière lui ses idéaux, ses combats, faire profil bas et se faire oublier...
Les deux histoires, celle de Kloé et cette de Marco, vont s'entremêler, une parfaite alternance, un chapitre sur les recherches de la jeune femme, un chapitre sur la nouvelle existence de Marco. On se doute bien que ces deux-là sont liés, mais il reste encore à comprendre beaucoup de choses, pourquoi plus de 30 ans après sa naissance, Kloé a tant de mal à retrouver la trace de ses parents biologiques.
Ces raisons, on va les découvrir peu à peu, dans un récit qui ne va pas nous emmener tout à fait là où on l'imaginait. Ou, plus exactement, parce que les événements de Milan ne sont qu'un point de départ et pas la seule explication de tout cela. L'autre élément important, ce sont les difficultés auxquelles Kloé doit faire face dans ses recherches...
Tout cela est somme toute assez classique, dans le fond comme dans la forme, mais "Privé d'origine" reste un polar qui sait captivé son lecteur. D'abord, parce que ses deux personnages centraux sont attachants. Pour Kloé, pas besoin d'entrer dans le détail : elle cherche ses parents, elle est prête à tout, pour cela, même à se mettre en danger...
Quant à Marco, il est typiquement le genre de mec idéaliste qui, brutalement, s'est retrouvé confronté à la réalité. Il pensait oeuvrer pour un monde meilleur, pour renverser un système pourri qui exploite les êtres humains pour le profit. Et le voilà braqueur malgré lui. C'est cette naïveté qui le rend attachant, parce qu'on va découvrir qu'il n'a pas retenu la leçon...
Jérémy Bouquin s'appuie sur des événements réels pour construire son polar. Je ne vais pas tout détailler, car certains de ces événements sont au coeur de l'intrigue. Mais, je peux le faire concernant le braquage de Milan. Cette scène rappelle, avec quelques différences notables, certains faits qui ont valu sa condamnation par contumace à Cesare Battisti.
Soyons précis : Marco n'est pas Battisti, ni même un personnage pouvant y faire directement penser, l'histoire de "Privé d'origine" s'inspire simplement d'événements marquants de cette période, d'abord en Italie, puis en France, afin d'illustrer les dérives de mouvements de gauche radicale ayant opté pour le recours à la violence.
Une lutte clandestine à laquelle les Etats répondent de la même manière, avec le même genre de méthodes, le même côté violent, aussi. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette facette du roman de Jérémy Bouquin, car, là encore, on touche à des points névralgiques de l'intrigue. Et en particulier, à certains personnages qui vont apparaître, dans la trame passée comme dans la trame présente.
Ces personnages, il faut vous laisser les découvrir, parce que l'auteur joue habilement avec certaines dimensions très noires de son histoire. En particulier, "Privé d'origine" repose sur un jeu d'ambiguïtés très bien mené, qui débute avec la rencontre entre Kloé et Jasper, évoqué en début de résumé. L'attitude du privé est un premier élément fort.
Jasper, ce n'est pas le genre de mec à se laisser intimider. Alors, pour qu'on le sente aussi hésitant, aussi mal à l'aise face aux informations qu'il a su dénicher, c'est que c'est du sérieux. Mais, de qui a-t-il peur, pour se conduire de cette façon et conseiller (c'est le titre de notre billet) à Kloé de renoncer à ses recherches ?
En parallèle, il y a le parcours de Marco. Bien sûr, l'histoire de Milan justifierait à elle seule qu'il se fasse très discret depuis si longtemps, d'autant que ce qu'on appelle la "doctrine Mitterrand", c'est-à-dire la décision présidentielle de ne pas extrader vers l'Italie les anciens activistes installés en France, n'est plus d'actualité.
Mais, on se doute bien que l'histoire d'un homme rangé des voitures ne peut pas suffire pour tenir sur 300 pages, un chapitre sur deux. Le fugitif va donc devoir affronter de nouvelles péripéties qui vont confirmer et son idéalisme, et sa terrible naïveté. Le reste, c'est le noeud du roman, un écheveau, même, que Kloé va, petit à petit, avec un culot monstre, démêler.
Il y a beaucoup de noirceur, dans "Privé d'origine", beaucoup d'interrogations, aussi. Le lecteur est aux prises avec des personnages dont il ignore quel jeu ils jouent exactement. Les apparences sont trompeuses, les évidences sont à bannir, et la traditionnel séparation entre bien et mal, entre gentils et méchants n'est qu'un leurre.
L'écriture de Jérémy Bouquin est sèche, sans chichi, sans gras. Des successions de phrases très courtes, sans grandes envolées, sans grandes descriptions. On va à l'essentiel, on avance, on attrape le lecteur, on ne le lâche pas. Je ne suis pas contre un peu plus de chair, de moelleux, mais il faut reconnaître que ce style sert le propos. On avance presque sans s'en rendre compte.
Jérémy Bouquin ne cache pas que ses influences viennent de ce mouvement littéraire qu'on a appelé le néo-polar, dont les fers de lance furent Jean-Patrick Manchette, Didier Daeninckx, Frédéric H. Fajardie, Thierry Jonquet, Jean-Bernard Pouy, Jean Vautrin ou encore Hervé Prudon, qui vient de disparaître.
Autant d'auteurs très engagés à gauche, mais sans angélisme et sachant se montrer aussi critiques sur les dérives de ces mouvements que sur cette société contemporaine qu'ils exècrent, amateurs d'ambiances très noires, de personnages marginaux... Autant d'éléments que l'on retrouve dans "Privé d'origine", jusque dans la partie contemporaine qui reproduit sans cesse les mêmes erreurs.
Né en 1975, Jérémy Bouquin est encore loin de la maîtrise de ses inspirateurs, tant dans l'élaboration de ses intrigues que dans le maniement de la langue, mais "Privé d'origine" est un polar qui atteint son but : piéger le lecteur, jouer au chat et à la souris avec lui, l'emmener vers des fausses pistes, instiller le doute...
La violence de son récit ne l'empêche tout de même pas de garder espoir. En choisissant de raconter cette histoire en partant de la volonté de Kloé de retrouver ses parents, il s'offre ce côté certes douloureux, mais exempt de tout autre type de questionnement. A la jeune femme, peu importent le passé, la politique, la violence, les trahisons, c'est son coeur qui prime sur tout.
Son pavé dans la mare va faire remonter la vase, va réveiller les poissons, plus ou moins gros, qui y dormaient depuis des années. Elle va devoir faire face à des obstacles, à des intimidations, à des fin de non-recevoir. Reste à savoir si elle pourrait se retrouver embringuée dans une histoire dangereuse où elle serait une proie, comme dans certains thrillers américains, style Morrell, Cobain ou Sackey.
Les éditions French Pulp affichent ouvertement leur volonté de renouer avec la tradition de la littérature populaire et même du genre dit "de gare", qu'on regarde souvent avec un certain mépris. En rééditant des livres qui ont connu le succès dans les années 1970-80 et en éditant de jeunes romanciers qui reprennent ce créneau, cette jeune maison entend renouveler ce genre à bout de souffle.
Avec Jérémy Bouquin, le contrat est parfaitement rempli. "Privé d'origine" correspond exactement à ce que l'on peut attendre : un roman noir qui offre à la fois un bon divertissement, sans oublier de donner au lecteur du grain à moudre et de quoi réfléchir. En particulier aux placards de notre Ve République, où l'on continue d'entasser de vilains petits secrets...
samedi 21 octobre 2017
"Le blues contient tout à ses yeux (...) Ce rythme est celui du coeur de Bernard".
Lorsqu'on se lance dans la lecture d'un roman qui se déroule en Irlande, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il soit rythmé, et même construit comme un blues. C'est pourtant ce que nous offre notre roman du soir, roman noir assez atypique, assez différent, malgré son ambiance musicale, des romans noirs venus d'Amérique. Mais, ce premier roman, signé par Colin O'Sullivan, comédien et poète, préfère à la violence et à la tension psychologique, la chronique d'une paisible ville irlandaise. "Killarney blues", de Colin O'Sullivan (en grand format aux éditions Rivages ; traduction de Ludivine Bouton-Kelly), rend certes hommage à la ville et la région d'origine de l'auteur, aux splendides paysages, mais met surtout en scène une galerie de personnages, des presque trentenaires qui peinent à entrer dans l'âge adulte et à se responsabiliser, et les familles de certains d'entre eux. En quelques jours, certains événements vont se charger de sceller leurs destins...
Killarney est une petite ville d'environ 12 000 habitants, nichée dans un parc national au sud-ouest de l'Irlande. Rassurez-vous, ce billet ne sera pas un guide touristique, mais le contexte est loin d'être anodin. Killarney, par sa position, les chemins de randonnée dont elle est le centre et les paysages magnifiques qui l'entourent, est une destination privés des touristes.
Et l'une des attractions qui fait la renommée de Killarney, ce sont ces calèches qui emmènent les touristes le long des chemins, des lacs et des jardins qui abondent. Ces calèches, tirées par un cheval, sont conduites par ceux qu'on appelle les "jarveys", dont le boulot n'est pas seulement de tenir les rênes, mais aussi de jouer les guides.
Parmi eux, se trouve Bernard Dunphy. Il a repris le travail de son père, décédé quand il était plus jeune, et s'en acquitte avec joie. Ninny, sa jument, a beau vieillir et fatiguer, Bernard conserve le même enthousiasme à mener les visiteurs autour de Killarney. En fait, on pourrait presque dire que Bernard est à lui seul une attraction.
Vêtu d'un manteau qu'il ne quitte jamais, même par forte chaleur, fumeur invétéré et joueur de blues amateur (une autre passion héritée de son défunt père), il ne passe pas inaperçu. A Killarney, tout le monde le connaît et, il faut le reconnaître, tout le monde, ou presque, se moque de lui plus ou moins gentiment. Certains le considèrent comme l'idiot du village.
Mais, Bernard ne fait pas rire tout le monde, comme en témoigne le passage à tabac en règle qui lui a récemment été infligé, un soir, par deux brutes épaisses... Tout ça parce que Bernard a le béguin pour Marian, la cousine d'un de ses deux assaillants... Marian, si belle, si prévenante, qui l'aime bien, qui l'écoute. A qui il envoie régulièrement les cassettes de blues qu'il enregistre...
Comme toutes ses amies, Marian trouve aussi Bernard bizarre, mais sa maladresse et le fait qu'on se moque de lui la touche. Lorsqu'elle retrouve Mags et Cathy au pub, elle essaye de défendre le jarvey comme elle peut. Les trois demoiselles approchent de la trentaine, leurs principaux hobbys, ce sont les sorties shopping et les soirées au pub, un horizon assez limité. Un avenir, aussi.
Bernard est un solitaire, malgré lui. Il n'a guère qu'un seul autre ami, Jack, son ami d'enfance. En grandissant, ils se sont un peu éloigné, mais Jack reste un des rares à considérer Bernard avec bienveillance. Pourtant, Jack n'a rien en commun avec le Jarvey : beau, sportif, séduisant, séducteur... Mais, c'est aussi un garçon volontiers brutal, sur les terrains comme avec ses conquêtes...
Si Bernard ne remarque pas les moqueries dont il fait l'objet, une autre personne, elle, veille sur lui avec autant de soin que d'inquiétude. Brigid est la mère de Bernard. Elle s'inquiète de plus en plus car elle vieillit et redoute le moment où Bernard devra se débrouiller seul dans la vie. Elle sait ce qui fait de Bernard un garçon si... spécial : il souffre du syndrome d'Asperger...
A près de trente ans, il est un grand enfant... Et pourtant, Brigid est impressionné par les progrès qu'a fait son fils depuis quelques années. Il est devenu bien plus sociable. Mais, il reste naïf, et Brigid n'a aucune confiance dans les jeunes du même âge, dont elle redoute qu'ils blessent Bernard et le poussent à se replier sur lui-même...
Entre Brigid et Bernard, le souvenir de John, l'époux et père défunt. Cet homme qui a su séduire Birgid, à la fin des années 1960, en lui parlant d'une musique qu'elle trouvait sans intérêt : le blues. Aujourd'hui, c'est Bernard qui joue de la guitare, écrit quelques textes, reprend des standards, mais sa passion n'intéresse pas plus les gens de son âge qu'elle n'intéressait Brigid...
Pourtant, le blues est bel et bien au coeur du livre, pas juste comme un fond musical ou la passion stérile d'un gentil garçon complètement décalé. "Killarney Blues", ce pourrait tout à fait être le titre d'une chanson racontant l'histoire de Bernard, le jarvey amoureux, qui doit affronter un destin pas commode et des congénères peu portés sur l'empathie.
Le lecteur, lui, ne peut que sentir de l'affection pour ce garçon, toujours souriant, affable et qui prend toujours la vie du bon côté. Mais qui ne se rend pas vraiment compte que son existence arrive à un tournant. Le passage à tabac n'a laissé que quelques traces, une dent en moins qui se voit dès qu'il sourit et quelques bleus, mais rien qui lui fasse renoncer à son amour pour Marian...
Autour de lui, les drames vont imperceptiblement se lier. Certains sont des drames personnels, d'autres seront d'une toute autre nature. Une série d'événements a priori sans lien entre eux, mais Killarney n'est pas une si grande ville pour que tout ce qui s'y passe soit indépendant... Passé et présent vont s'entremêler jusqu'à une journée décisive pour tous ces personnages...
J'ai dit en introduction que "Killarney blues" était un roman noir plutôt atypique. Et pour cause : son personnage central n'a pas grand-chose d'un personnage de roman noir. Sa gentillesse et sa candeur le rendent quasiment imperméables à ce qui se passe autour de lui. Il échappe à la cruauté de ce monde, dont il est d'ailleurs une victime, mais pour combien de temps ?
C'est d'ailleurs paradoxal pour un fondu de blues comme lui. Le blues, musique qui exprime tant de malheur, tant de douleur, tant de peine, une musique également teintée de sexualité, de sensualité, jugée immorale par beaucoup, la musique du diable, dit même la légende... Bernard a plutôt le profil d'un ange, au milieu de tout cela.
Ne prenez pas mes mots pour de la commisération, non, Bernard est un merveilleux personnage qu'on aimerait rencontrer, avec qui on souhaiterait devenir ami. Outre sa maladie, on va comprendre qu'il est aussi surprotégé, mais qu'il n'est sans doute pas dupe de ce qui se passe autour de lui. Bernard, c'est un papillon qui attend de sortir de son cocon, si on veut bien le lui permettre...
Alors, oui, "Killarney blues", avec son personnage central si particulier, est un roman noir atypique. Autour de lui, évolue une génération pas encore perdue mais qui peine vraiment à devenir raisonnable, responsable et mature. Marian, Mags et Cathy ne semblent envisager la vie qu'à court terme, belles au bois dormant n'attendant même pas de prince charmant.
On profite de la vie tant qu'on peut, on la croque à pleines dents, mais elle n'a pas vraiment de goût. L'ennui ronge ces demoiselles qui essayent de tuer le temps comme elles peuvent, sans grandes ambitions. Sans grande détermination. Et finalement, on va le découvrir, assez mesquines, même entre elles.
Quant à Jack, sous ses apparences d'homme à qui tout réussit, on découvre des fêlures. Et une brutalité qui se manifeste de plus en plus souvent. Lors des rencontres de foot gaélique auxquelles il participe comme avec ses nombreuses conquêtes féminines, il se montre volontiers violent et égoïste, se préoccupant d'abord de lui, provocateur et dominateur...
Et puis, soudain, vers le milieu du livre, Killarney, la belle assoupie, va connaître un terrible soubresaut. Une journée qui va bouleverser le destin de tous ces personnages, pour diverses raisons et à différents degrés. La deuxième partie du livre change alors d'âme, mais aussi de rythme, en particulier avec un passage très vif, où les changements de plans se succèdent.
Sans tomber dans la comparaison absolue, il y a une manière de présenter les différents fils narratifs simultanés qui pourrait rappeler le split-screen, l'écran partagé cher aux scénaristes de la série "24 heures". Pour moi, ce passage est le climax de "Killarney Blues", ces pages où tout se passe, où tout se décide. Brutalement.
Le bien et le mal s'unissent pour engendrer quelques heures de folie et de drame, aux conséquences bien particulières. Comment dit-on, déjà ? Mais oui ! Une catharsis ! Pacte avec le diable, amour, désillusion, violence, embellies, tragédies et épanouissement, vie et mort... Autant de thèmes chers aux musiciens de blues qui vont s'entrelacer dans le final de ce livre.
Colin O'Sullivan, aujourd'hui, ne vit plus en Irlande, mais au Japon. Peut-être est-ce pour cela qu'on ressent une certaine nostalgie dans la manière dont il présente Killarney et ses environs. On visite, à la vitesse du pas du cheval, le parc national, on a la vision, même brève, de la plupart des sites remarquables qui entourent la ville, dès qu'on veut bien se donner la peine de quitter le pub.
C'est d'ailleurs une des nombreuses différences qu'il y a entre Bernard et les autres : son boulot de jarvey fait qu'il parcourt la région, la respire sans se lasser. Les autres, Cathy, Mags, Jack, y compris Marian, semblent étouffer dans cet endroit. Je le redis, l'ennui est l'un des éléments importants de cette histoire, rappelant qu'on apprécie surtout sa terre natale quand on s'en éloigne...
S'il y a des thématiques de romans noirs plus traditionnels, c'est là qu'il faut les chercher, dans le regard et le recul de Colin O'Sullivan. Ce désenchantement d'une jeunesse qui peine à se forger un avenir n'est pas le seul aspect qui ressort. Ses corollaires : la tendance à boire trop et les violences qui en découlent.
On évoque aussi brièvement les problèmes liés à des gangs et à divers trafics, sans doute lucratifs, la montée du racisme et d'autres phénomènes qui vont jouer un rôle important dans l'intrigue et qui font apparaître un certain sentiment d'insécurité dans ce joli coin d'Irlande, petit paradis terrestre qu'on imaginerait à l'abri de ces débordements.
Alors, amateurs de romans noirs, très noirs, de cynisme blasé et de pessimisme de bon aloi, passez votre chemin. "Killarney blues" n'entre pas dans ces codes-là. On pourrait d'ailleurs titrer ce billet : "il y a toujours un mal pour un bien", même si, ça, se serait peut-être un peu cynique. C'est un roman lumineux que signe Colin O'Sullivan, dissipant les ténèbres.
C'est un livre plein d'émotions fortes, des émotions très positives, le plus souvent portées par le personnage de Bernard. On peut penser qu'il est le plus fragile des personnages impliqués dans le roman. On se demande comment il va réagir aux événements de cette fameuse journée, quel impact toute cette tourmente aura sur lui...
Mais, comme le blues n'exprime pas que la tristesse, mais sait communiquer aussi la joie et l'espoir à ceux qui l'écoutent, il en sera peut-être de même pour Bernard Dunphy, le jarvey amoureux... Tous les personnages de "Killarney blues" sont à un carrefour et, à ce Crossroads, certains rencontreront le diable en personne, d'autres découvriront le chemin d'une existence nouvelle...
Killarney est une petite ville d'environ 12 000 habitants, nichée dans un parc national au sud-ouest de l'Irlande. Rassurez-vous, ce billet ne sera pas un guide touristique, mais le contexte est loin d'être anodin. Killarney, par sa position, les chemins de randonnée dont elle est le centre et les paysages magnifiques qui l'entourent, est une destination privés des touristes.
Et l'une des attractions qui fait la renommée de Killarney, ce sont ces calèches qui emmènent les touristes le long des chemins, des lacs et des jardins qui abondent. Ces calèches, tirées par un cheval, sont conduites par ceux qu'on appelle les "jarveys", dont le boulot n'est pas seulement de tenir les rênes, mais aussi de jouer les guides.
Parmi eux, se trouve Bernard Dunphy. Il a repris le travail de son père, décédé quand il était plus jeune, et s'en acquitte avec joie. Ninny, sa jument, a beau vieillir et fatiguer, Bernard conserve le même enthousiasme à mener les visiteurs autour de Killarney. En fait, on pourrait presque dire que Bernard est à lui seul une attraction.
Vêtu d'un manteau qu'il ne quitte jamais, même par forte chaleur, fumeur invétéré et joueur de blues amateur (une autre passion héritée de son défunt père), il ne passe pas inaperçu. A Killarney, tout le monde le connaît et, il faut le reconnaître, tout le monde, ou presque, se moque de lui plus ou moins gentiment. Certains le considèrent comme l'idiot du village.
Mais, Bernard ne fait pas rire tout le monde, comme en témoigne le passage à tabac en règle qui lui a récemment été infligé, un soir, par deux brutes épaisses... Tout ça parce que Bernard a le béguin pour Marian, la cousine d'un de ses deux assaillants... Marian, si belle, si prévenante, qui l'aime bien, qui l'écoute. A qui il envoie régulièrement les cassettes de blues qu'il enregistre...
Comme toutes ses amies, Marian trouve aussi Bernard bizarre, mais sa maladresse et le fait qu'on se moque de lui la touche. Lorsqu'elle retrouve Mags et Cathy au pub, elle essaye de défendre le jarvey comme elle peut. Les trois demoiselles approchent de la trentaine, leurs principaux hobbys, ce sont les sorties shopping et les soirées au pub, un horizon assez limité. Un avenir, aussi.
Bernard est un solitaire, malgré lui. Il n'a guère qu'un seul autre ami, Jack, son ami d'enfance. En grandissant, ils se sont un peu éloigné, mais Jack reste un des rares à considérer Bernard avec bienveillance. Pourtant, Jack n'a rien en commun avec le Jarvey : beau, sportif, séduisant, séducteur... Mais, c'est aussi un garçon volontiers brutal, sur les terrains comme avec ses conquêtes...
Si Bernard ne remarque pas les moqueries dont il fait l'objet, une autre personne, elle, veille sur lui avec autant de soin que d'inquiétude. Brigid est la mère de Bernard. Elle s'inquiète de plus en plus car elle vieillit et redoute le moment où Bernard devra se débrouiller seul dans la vie. Elle sait ce qui fait de Bernard un garçon si... spécial : il souffre du syndrome d'Asperger...
A près de trente ans, il est un grand enfant... Et pourtant, Brigid est impressionné par les progrès qu'a fait son fils depuis quelques années. Il est devenu bien plus sociable. Mais, il reste naïf, et Brigid n'a aucune confiance dans les jeunes du même âge, dont elle redoute qu'ils blessent Bernard et le poussent à se replier sur lui-même...
Entre Brigid et Bernard, le souvenir de John, l'époux et père défunt. Cet homme qui a su séduire Birgid, à la fin des années 1960, en lui parlant d'une musique qu'elle trouvait sans intérêt : le blues. Aujourd'hui, c'est Bernard qui joue de la guitare, écrit quelques textes, reprend des standards, mais sa passion n'intéresse pas plus les gens de son âge qu'elle n'intéressait Brigid...
Pourtant, le blues est bel et bien au coeur du livre, pas juste comme un fond musical ou la passion stérile d'un gentil garçon complètement décalé. "Killarney Blues", ce pourrait tout à fait être le titre d'une chanson racontant l'histoire de Bernard, le jarvey amoureux, qui doit affronter un destin pas commode et des congénères peu portés sur l'empathie.
Le lecteur, lui, ne peut que sentir de l'affection pour ce garçon, toujours souriant, affable et qui prend toujours la vie du bon côté. Mais qui ne se rend pas vraiment compte que son existence arrive à un tournant. Le passage à tabac n'a laissé que quelques traces, une dent en moins qui se voit dès qu'il sourit et quelques bleus, mais rien qui lui fasse renoncer à son amour pour Marian...
Autour de lui, les drames vont imperceptiblement se lier. Certains sont des drames personnels, d'autres seront d'une toute autre nature. Une série d'événements a priori sans lien entre eux, mais Killarney n'est pas une si grande ville pour que tout ce qui s'y passe soit indépendant... Passé et présent vont s'entremêler jusqu'à une journée décisive pour tous ces personnages...
J'ai dit en introduction que "Killarney blues" était un roman noir plutôt atypique. Et pour cause : son personnage central n'a pas grand-chose d'un personnage de roman noir. Sa gentillesse et sa candeur le rendent quasiment imperméables à ce qui se passe autour de lui. Il échappe à la cruauté de ce monde, dont il est d'ailleurs une victime, mais pour combien de temps ?
C'est d'ailleurs paradoxal pour un fondu de blues comme lui. Le blues, musique qui exprime tant de malheur, tant de douleur, tant de peine, une musique également teintée de sexualité, de sensualité, jugée immorale par beaucoup, la musique du diable, dit même la légende... Bernard a plutôt le profil d'un ange, au milieu de tout cela.
Ne prenez pas mes mots pour de la commisération, non, Bernard est un merveilleux personnage qu'on aimerait rencontrer, avec qui on souhaiterait devenir ami. Outre sa maladie, on va comprendre qu'il est aussi surprotégé, mais qu'il n'est sans doute pas dupe de ce qui se passe autour de lui. Bernard, c'est un papillon qui attend de sortir de son cocon, si on veut bien le lui permettre...
Alors, oui, "Killarney blues", avec son personnage central si particulier, est un roman noir atypique. Autour de lui, évolue une génération pas encore perdue mais qui peine vraiment à devenir raisonnable, responsable et mature. Marian, Mags et Cathy ne semblent envisager la vie qu'à court terme, belles au bois dormant n'attendant même pas de prince charmant.
On profite de la vie tant qu'on peut, on la croque à pleines dents, mais elle n'a pas vraiment de goût. L'ennui ronge ces demoiselles qui essayent de tuer le temps comme elles peuvent, sans grandes ambitions. Sans grande détermination. Et finalement, on va le découvrir, assez mesquines, même entre elles.
Quant à Jack, sous ses apparences d'homme à qui tout réussit, on découvre des fêlures. Et une brutalité qui se manifeste de plus en plus souvent. Lors des rencontres de foot gaélique auxquelles il participe comme avec ses nombreuses conquêtes féminines, il se montre volontiers violent et égoïste, se préoccupant d'abord de lui, provocateur et dominateur...
Et puis, soudain, vers le milieu du livre, Killarney, la belle assoupie, va connaître un terrible soubresaut. Une journée qui va bouleverser le destin de tous ces personnages, pour diverses raisons et à différents degrés. La deuxième partie du livre change alors d'âme, mais aussi de rythme, en particulier avec un passage très vif, où les changements de plans se succèdent.
Sans tomber dans la comparaison absolue, il y a une manière de présenter les différents fils narratifs simultanés qui pourrait rappeler le split-screen, l'écran partagé cher aux scénaristes de la série "24 heures". Pour moi, ce passage est le climax de "Killarney Blues", ces pages où tout se passe, où tout se décide. Brutalement.
Le bien et le mal s'unissent pour engendrer quelques heures de folie et de drame, aux conséquences bien particulières. Comment dit-on, déjà ? Mais oui ! Une catharsis ! Pacte avec le diable, amour, désillusion, violence, embellies, tragédies et épanouissement, vie et mort... Autant de thèmes chers aux musiciens de blues qui vont s'entrelacer dans le final de ce livre.
Colin O'Sullivan, aujourd'hui, ne vit plus en Irlande, mais au Japon. Peut-être est-ce pour cela qu'on ressent une certaine nostalgie dans la manière dont il présente Killarney et ses environs. On visite, à la vitesse du pas du cheval, le parc national, on a la vision, même brève, de la plupart des sites remarquables qui entourent la ville, dès qu'on veut bien se donner la peine de quitter le pub.
C'est d'ailleurs une des nombreuses différences qu'il y a entre Bernard et les autres : son boulot de jarvey fait qu'il parcourt la région, la respire sans se lasser. Les autres, Cathy, Mags, Jack, y compris Marian, semblent étouffer dans cet endroit. Je le redis, l'ennui est l'un des éléments importants de cette histoire, rappelant qu'on apprécie surtout sa terre natale quand on s'en éloigne...
S'il y a des thématiques de romans noirs plus traditionnels, c'est là qu'il faut les chercher, dans le regard et le recul de Colin O'Sullivan. Ce désenchantement d'une jeunesse qui peine à se forger un avenir n'est pas le seul aspect qui ressort. Ses corollaires : la tendance à boire trop et les violences qui en découlent.
On évoque aussi brièvement les problèmes liés à des gangs et à divers trafics, sans doute lucratifs, la montée du racisme et d'autres phénomènes qui vont jouer un rôle important dans l'intrigue et qui font apparaître un certain sentiment d'insécurité dans ce joli coin d'Irlande, petit paradis terrestre qu'on imaginerait à l'abri de ces débordements.
Alors, amateurs de romans noirs, très noirs, de cynisme blasé et de pessimisme de bon aloi, passez votre chemin. "Killarney blues" n'entre pas dans ces codes-là. On pourrait d'ailleurs titrer ce billet : "il y a toujours un mal pour un bien", même si, ça, se serait peut-être un peu cynique. C'est un roman lumineux que signe Colin O'Sullivan, dissipant les ténèbres.
C'est un livre plein d'émotions fortes, des émotions très positives, le plus souvent portées par le personnage de Bernard. On peut penser qu'il est le plus fragile des personnages impliqués dans le roman. On se demande comment il va réagir aux événements de cette fameuse journée, quel impact toute cette tourmente aura sur lui...
Mais, comme le blues n'exprime pas que la tristesse, mais sait communiquer aussi la joie et l'espoir à ceux qui l'écoutent, il en sera peut-être de même pour Bernard Dunphy, le jarvey amoureux... Tous les personnages de "Killarney blues" sont à un carrefour et, à ce Crossroads, certains rencontreront le diable en personne, d'autres découvriront le chemin d'une existence nouvelle...
"Il suffit de la présence de l'homme pour que l'horreur arrive, une brise légère de présence humaine la réveille, nous traînons cela de façon congénitale".
Si vous n'aimez pas le froid, si vous avez le mal de mer, si les milieux confinés vous mettent mal à l'aise, alors, notre roman du jour n'est sans doute pas fait pour vous. Dommage, parce que cette histoire à la construction originale tient le lecteur en haleine parce qu'il nous manque un élément essentiel : pourquoi ? Pourquoi les personnages sont-ils réunis, pourquoi cet interrogatoire ? En fait, on ne se pose pas seulement des questions, il faut reconstruire tout le contexte afin de comprendre ce qui se passe sous nos yeux. "Polaris", de Fernando Clemot (paru aux éditions Actes Sud, traduction de Claude Bleton), est un huis clos oppressant, d'autant plus oppressant qu'on comprend qu'il s'est passé des choses graves, mais dont on ignore tout ou presque. Oppressant aussi pour son contexte général, au milieu de nulle part, isolé du monde et du temps, dirait-on. Et pourtant, quand tout va apparaître, ces impressions seront bien peu de choses...
Une salle, trois hommes. D'un côté, Vatne, qui mène la danse et pose les questions, et Dodt, qui attend dans l'ombre ; de l'autre, le docteur Christian, qui raconte une histoire. Un instant, on pourrait penser au film "Garde à vue", de Claude Miller, avec le trio Ventura/Serrault/Marchant, mais, dans les faits, la situation est bien différente.
Car nous ne sommes pas au 36, quai des Orfèvres ou dans la salle d'interrogatoire d'un commissariat, quelque part dans le monde. Non, nous sommes dans le mess des officiers d'un navire, transformé en salle d'interrogatoire. Et l'on comprend, entre les lignes, que l'Eridanus, le bateau en question, est devenu une prison flottante.
Mais que s'est-il passé sur ce bateau ? Eh bien, justement, on n'en sait rien... On n'en sait même sans doute moins que les trois principaux acteurs, puisqu'on n'a aucune indication expliquant pourquoi Vatne et Dodt interrogent le docteur Christian et pourquoi une bonne partie de l'équipage de l'Eridanus est aux arrêts dans les cabines, faute de places suffisantes aux fers.
On doit donc se contenter de suivre la conversation et le récit du docteur Christian pour reconstituer non seulement les événements, mais aussi le contexte général dans lequel se déroule cette histoire. Et Fernando Clemot joue avec nous : rien n'est tout à fait clairement indiqué, par de didascalies, peu de repères, et uniquement géographiques, on va y revenir.
L'Eridanus est affrété par une mystérieuse compagnie qui s'appelle la Centrale. Ce navire voguait initialement à destination de Nuuk, la capitale du Groenland, avant de prendre la direction du continent américain, Terre-Neuve ou l'île de Sable. Voilà ce que la cinquantaine d'hommes qui compose l'équipage sait de sa nouvelle mission.
Mais, lors d'une escale en Islande, changement de programme. Plus question du Groenland, du Canada, mais cap vers l'île norvégienne de Jan Mayen, caillou perdu au-delà du cercle polaire, à l'écart de toutes les routes commerciales traditionnelles, mais où la Centrale voudrait procéder à des forages en haut profonde.
Or, entre cette escale islandaise et l'arrivée à Jan Mayen, l'équipage de l'Eridanus, très cosmopolite, avec ses atomes crochus et ses affinités plus ou moins affirmées, comme n'importe quel groupe humain, a été comme frappé de folie... Le détail des événements, on ne le connaîtra qu'au fil du témoignage du docteur Christian.
Mais, l'immobilisation du navire, la mise aux arrêts d'une partie de l'équipage et l'intervention de ces deux membres de la Centrale pour interroger les principaux acteurs, tout cela semble montrer que ce qui s'est passé sur l'Eridanus est grave. Très grave. A Vatne et Dodt d'obtenir des témoignages suffisants pour définir les responsabilités du drame qui s'est déroulé sur le navire...
Voilà pour l'idée principale. Mais... Si on en reste là, il va manquer bien des éléments de compréhension. Et en particulier, l'époque à laquelle tout cela se déroule. Jusqu'ici, on se dit que l'histoire de l'Eridanus pourrait se produire n'importe quand. C'est sans doute vrai, mais, en l'occurrence, ici, ce n'est pas anodin.
Sur la quatrième de couverture du livre, on lit la date suivante : 1960. A aucun moment, sauf erreur de ma part, cette indication n'apparaît dans le cours du texte. Il faut se raccrocher à d'autres indices pour se situer. Mais, ce n'est donc pas une histoire contemporaine qui va nous être contée au fil des 240 pages que compte "Polaris".
Le jeu de piste continue donc, avec un indice supplémentaire, mais toujours insuffisant pour embrasser la globalité de ce qui prend clairement la forme d'une intrigue. Polar, roman noir ? Comme l'île Jan Mayen, on est un peu au croisement de tout, avec "Polaris", mais permettez-moi de ne pas trop entrer dans le détail, la construction du récit obligeant à être très discret.
Alors de quoi allons-nous parler ? Eh bien, de l'ambiance, car c'est l'un des éléments très forts de ce livre. Et en plus, là, on peut développer ! Il y a le huis clos, bien sûr, puisque l'action se limite au mess et à ce long interrogatoire. Ajouter l'insistance des questions d'un Vatne souvent sarcastique, mais aussi la discrète pression physique de Dodt, et vous vous sentirez à l'étroit...
Mais, si on sortait de là, où irait-on ? L'Eridanus mouille au large de Jan Mayen, une île qui n'a rien de très accueillant, pas tout à fait déserte, mais pas loin, et qu'il faudrait de toute façon rejoindre à la rame... Le fond de l'air, vu la latitude, doit être frisquet, alors, un petit tour sur le pont pour respirer et on retourne à l'intérieur. On est bien coincé...
Le seul lien avec le monde est ténu : une radio, qui semble fonctionner 24 heures sur 24, un son étouffé, lancinant, des morceaux de musique datant de plusieurs décennies, pas d'animateur, juste une musique... Une présence qui n'en est pas vraiment une, un ligne de vie qui n'en est pas vraiment une, mais qui a le mérité de briser le silence... Un silence comme une chape de plomb qui écraserait tout.
Et comme on ne sait rien des faits, forcément, on laisse son imagination courir... L'Eridanus n'est pas le Hollandais volant, mais on songe vite à un équipage pris de folie, se déchaînant, perpétrant une espèce de sabbat, d'orgie ou de massacre... Car la rumeur enfle, depuis l'Islande, l'ambiance parmi les marins s'est sérieusement dégradée et la violence s'est invitée à bord.
Mais tout cela, c'est finalement encore assez abstrait. Des bagarres d'ivrognes, des rivalités qui se révèlent, l'ennui qui engourdit et dégénère... Ce sont la fréquence et les proportions de ces anicroches qui n'ont rien de rassurant. Et puis, on comprend qu'il y a eu un événement plus grave... Et que Vatne et Dodt ne sont pas juste venu jusque-là pour s'occuper de quelques rixes...
Voilà tout ce qui concourt à l'atmosphère étouffante de ce roman qui nous cache tout, ne nous dit rien. Une intrigue dont on comprend qu'elle ne se dévoilera que petit à petit, situation après situation, élément après élément... Comme le pensent sans doute Vatne et Dodt, on se dit qu'il va falloir se montrer patient.
Parce qu'il reste un élément très important, dont nous n'avons pas encore vraiment parlé : la personnalité de celui qu'on interroge. Le docteur Christian, le médecin de bord de l'Eridanus. Un gage de sérieux. Et pourtant, là encore, apparaissent bien vite quelques informations parcellaires et donc troublantes.
Quelle est la mission que lui a assignée la Centrale dans une lettre de mission reçue au moment du passage en Islande ? On l'ignore, mais cela ne semble pas enchanter le médecin, un homme apparemment austère, qui peine à trouver le sommeil et gobe des comprimés, apparemment des anxiolytiques, comme si c'était des bonbons...
Son récit est à son image : une histoire décousue, où se mêlent le portrait des membre de l'équipage de l'Eridanus, les événements de cette dernière semaine, ses précédentes affectations, ses souvenirs personnels et familiaux... Ce témoignage, c'est autant le récit de la vie du docteur Christian que des épisodes de violence qui ont touché le navire.
Un compte-rendu désordonné, vagabond, qui n'a pas l'air de déranger Vatne et Dodt : ils semblent très attentifs aux propos du médecin... Vatne se charge de le relancer, de le faire revenir à l'essentiel, mais toutes ces digressions leur sont utiles. Pour cerner l'homme, autant que pour comprendre ce qui est arrivé sur ce rafiot.
J'espère avoir été assez clair : "Polaris" est un roman qui repose sur une somme de questions et d'ambiguïtés. Il faut accepter l'idée de ne rien comprendre, de ne partir de rien, contrairement à un polar classique où le crime précède l'enquête. Ici, tout commence après les faits, et on ne les connaîtra qu'à la fin...
Le pari est hardi, mais réussi. Si on adhère au postulat, si on se laisse porter par ce témoignage qui part, parfois, dans des directions inattendues. Christian est finalement celui qui nous offre des respirations, comme si, par son récit, il cherchait lui-même à briser l'impression de réclusion ambiante, à s'évader de ce mess et de cet interrogatoire.
Un mot sur le titre, "Polaris" : son explication est dans le livre et, vous l'aurez sans doute compris, elle fait partie de ces éléments qui vont apparaître au fil du témoignage du docteur Christian. Je ne vais donc pas vous l'expliquer dans ce billet, mais c'est un des aspects les plus troublants de ce roman, car reposent sur lui bien des ambiguïtés...
Alors, bien sûr, "Polaris", pour un roman qui se passe dans l'Arctique, ça n'a rien de vraiment surprenant en soi. Mais, je me demande jusqu'à quel point ce titre, et tout le roman avec lui, pourrait faire référence au "Solaris", de Stanislas Lem, classique de la SF ayant inspiré les films d'Andreï Tarkovski et Steven Soderbergh.
Je ne veux pas être trop affirmatif, mais il me semble qu'il y a pas mal d'éléments en commun entre "Polaris" et "Solaris". Il y a aussi un bon nombre de divergences, et pas seulement en termes contextuels. Il est tout à fait possible que je raconte n'importe quoi, qu'on me démente. Si c'est le cas, mille excuses par avance, mais j'espère ne pas m'être noyé avec cette idée-là...
"Solaris" repose sur des thèmes très philosophiques, Fernando Clemot inscrit pour sa part son roman dans une époque, avec des questions historiques fortes qui le traversent. On a le sentiment de lire un livre qui nous parle d'un changement d'ère, d'une page qui s'est tournée, et d'une autre période qui s'est ouverte, avec des enjeux très différents.
L'isolement de l'Eridanus, comme suspendu au milieu de nulle part, dans une sorte d'éther, tant géographiquement que temporellement, donne l'impression d'une espèce de sas dans lequel s'effectuerait la transition et la Centrale, dans un rôle de démiurge décidant finalement du sort des uns et des autres, tout-puissante et indépendante de toute autre autorité, assurerait ce passage sans retour.
Il est des histoires déroutantes, "Polaris" en fait certainement partie, dans la forme, évidemment, mais sans doute aussi dans le fond. Et je n'oublie pas cette fin, troublante, un long plan séquence dans ce décor aussi majestueux qu'austère, aussi majestueux qu'hostile... Avec à la clé, comme un apaisement, comme un lent, très lent engourdissement...
Une salle, trois hommes. D'un côté, Vatne, qui mène la danse et pose les questions, et Dodt, qui attend dans l'ombre ; de l'autre, le docteur Christian, qui raconte une histoire. Un instant, on pourrait penser au film "Garde à vue", de Claude Miller, avec le trio Ventura/Serrault/Marchant, mais, dans les faits, la situation est bien différente.
Car nous ne sommes pas au 36, quai des Orfèvres ou dans la salle d'interrogatoire d'un commissariat, quelque part dans le monde. Non, nous sommes dans le mess des officiers d'un navire, transformé en salle d'interrogatoire. Et l'on comprend, entre les lignes, que l'Eridanus, le bateau en question, est devenu une prison flottante.
Mais que s'est-il passé sur ce bateau ? Eh bien, justement, on n'en sait rien... On n'en sait même sans doute moins que les trois principaux acteurs, puisqu'on n'a aucune indication expliquant pourquoi Vatne et Dodt interrogent le docteur Christian et pourquoi une bonne partie de l'équipage de l'Eridanus est aux arrêts dans les cabines, faute de places suffisantes aux fers.
On doit donc se contenter de suivre la conversation et le récit du docteur Christian pour reconstituer non seulement les événements, mais aussi le contexte général dans lequel se déroule cette histoire. Et Fernando Clemot joue avec nous : rien n'est tout à fait clairement indiqué, par de didascalies, peu de repères, et uniquement géographiques, on va y revenir.
L'Eridanus est affrété par une mystérieuse compagnie qui s'appelle la Centrale. Ce navire voguait initialement à destination de Nuuk, la capitale du Groenland, avant de prendre la direction du continent américain, Terre-Neuve ou l'île de Sable. Voilà ce que la cinquantaine d'hommes qui compose l'équipage sait de sa nouvelle mission.
Mais, lors d'une escale en Islande, changement de programme. Plus question du Groenland, du Canada, mais cap vers l'île norvégienne de Jan Mayen, caillou perdu au-delà du cercle polaire, à l'écart de toutes les routes commerciales traditionnelles, mais où la Centrale voudrait procéder à des forages en haut profonde.
Or, entre cette escale islandaise et l'arrivée à Jan Mayen, l'équipage de l'Eridanus, très cosmopolite, avec ses atomes crochus et ses affinités plus ou moins affirmées, comme n'importe quel groupe humain, a été comme frappé de folie... Le détail des événements, on ne le connaîtra qu'au fil du témoignage du docteur Christian.
Mais, l'immobilisation du navire, la mise aux arrêts d'une partie de l'équipage et l'intervention de ces deux membres de la Centrale pour interroger les principaux acteurs, tout cela semble montrer que ce qui s'est passé sur l'Eridanus est grave. Très grave. A Vatne et Dodt d'obtenir des témoignages suffisants pour définir les responsabilités du drame qui s'est déroulé sur le navire...
Voilà pour l'idée principale. Mais... Si on en reste là, il va manquer bien des éléments de compréhension. Et en particulier, l'époque à laquelle tout cela se déroule. Jusqu'ici, on se dit que l'histoire de l'Eridanus pourrait se produire n'importe quand. C'est sans doute vrai, mais, en l'occurrence, ici, ce n'est pas anodin.
Sur la quatrième de couverture du livre, on lit la date suivante : 1960. A aucun moment, sauf erreur de ma part, cette indication n'apparaît dans le cours du texte. Il faut se raccrocher à d'autres indices pour se situer. Mais, ce n'est donc pas une histoire contemporaine qui va nous être contée au fil des 240 pages que compte "Polaris".
Le jeu de piste continue donc, avec un indice supplémentaire, mais toujours insuffisant pour embrasser la globalité de ce qui prend clairement la forme d'une intrigue. Polar, roman noir ? Comme l'île Jan Mayen, on est un peu au croisement de tout, avec "Polaris", mais permettez-moi de ne pas trop entrer dans le détail, la construction du récit obligeant à être très discret.
Alors de quoi allons-nous parler ? Eh bien, de l'ambiance, car c'est l'un des éléments très forts de ce livre. Et en plus, là, on peut développer ! Il y a le huis clos, bien sûr, puisque l'action se limite au mess et à ce long interrogatoire. Ajouter l'insistance des questions d'un Vatne souvent sarcastique, mais aussi la discrète pression physique de Dodt, et vous vous sentirez à l'étroit...
Mais, si on sortait de là, où irait-on ? L'Eridanus mouille au large de Jan Mayen, une île qui n'a rien de très accueillant, pas tout à fait déserte, mais pas loin, et qu'il faudrait de toute façon rejoindre à la rame... Le fond de l'air, vu la latitude, doit être frisquet, alors, un petit tour sur le pont pour respirer et on retourne à l'intérieur. On est bien coincé...
Le seul lien avec le monde est ténu : une radio, qui semble fonctionner 24 heures sur 24, un son étouffé, lancinant, des morceaux de musique datant de plusieurs décennies, pas d'animateur, juste une musique... Une présence qui n'en est pas vraiment une, un ligne de vie qui n'en est pas vraiment une, mais qui a le mérité de briser le silence... Un silence comme une chape de plomb qui écraserait tout.
Et comme on ne sait rien des faits, forcément, on laisse son imagination courir... L'Eridanus n'est pas le Hollandais volant, mais on songe vite à un équipage pris de folie, se déchaînant, perpétrant une espèce de sabbat, d'orgie ou de massacre... Car la rumeur enfle, depuis l'Islande, l'ambiance parmi les marins s'est sérieusement dégradée et la violence s'est invitée à bord.
Mais tout cela, c'est finalement encore assez abstrait. Des bagarres d'ivrognes, des rivalités qui se révèlent, l'ennui qui engourdit et dégénère... Ce sont la fréquence et les proportions de ces anicroches qui n'ont rien de rassurant. Et puis, on comprend qu'il y a eu un événement plus grave... Et que Vatne et Dodt ne sont pas juste venu jusque-là pour s'occuper de quelques rixes...
Voilà tout ce qui concourt à l'atmosphère étouffante de ce roman qui nous cache tout, ne nous dit rien. Une intrigue dont on comprend qu'elle ne se dévoilera que petit à petit, situation après situation, élément après élément... Comme le pensent sans doute Vatne et Dodt, on se dit qu'il va falloir se montrer patient.
Parce qu'il reste un élément très important, dont nous n'avons pas encore vraiment parlé : la personnalité de celui qu'on interroge. Le docteur Christian, le médecin de bord de l'Eridanus. Un gage de sérieux. Et pourtant, là encore, apparaissent bien vite quelques informations parcellaires et donc troublantes.
Quelle est la mission que lui a assignée la Centrale dans une lettre de mission reçue au moment du passage en Islande ? On l'ignore, mais cela ne semble pas enchanter le médecin, un homme apparemment austère, qui peine à trouver le sommeil et gobe des comprimés, apparemment des anxiolytiques, comme si c'était des bonbons...
Son récit est à son image : une histoire décousue, où se mêlent le portrait des membre de l'équipage de l'Eridanus, les événements de cette dernière semaine, ses précédentes affectations, ses souvenirs personnels et familiaux... Ce témoignage, c'est autant le récit de la vie du docteur Christian que des épisodes de violence qui ont touché le navire.
Un compte-rendu désordonné, vagabond, qui n'a pas l'air de déranger Vatne et Dodt : ils semblent très attentifs aux propos du médecin... Vatne se charge de le relancer, de le faire revenir à l'essentiel, mais toutes ces digressions leur sont utiles. Pour cerner l'homme, autant que pour comprendre ce qui est arrivé sur ce rafiot.
J'espère avoir été assez clair : "Polaris" est un roman qui repose sur une somme de questions et d'ambiguïtés. Il faut accepter l'idée de ne rien comprendre, de ne partir de rien, contrairement à un polar classique où le crime précède l'enquête. Ici, tout commence après les faits, et on ne les connaîtra qu'à la fin...
Le pari est hardi, mais réussi. Si on adhère au postulat, si on se laisse porter par ce témoignage qui part, parfois, dans des directions inattendues. Christian est finalement celui qui nous offre des respirations, comme si, par son récit, il cherchait lui-même à briser l'impression de réclusion ambiante, à s'évader de ce mess et de cet interrogatoire.
Un mot sur le titre, "Polaris" : son explication est dans le livre et, vous l'aurez sans doute compris, elle fait partie de ces éléments qui vont apparaître au fil du témoignage du docteur Christian. Je ne vais donc pas vous l'expliquer dans ce billet, mais c'est un des aspects les plus troublants de ce roman, car reposent sur lui bien des ambiguïtés...
Alors, bien sûr, "Polaris", pour un roman qui se passe dans l'Arctique, ça n'a rien de vraiment surprenant en soi. Mais, je me demande jusqu'à quel point ce titre, et tout le roman avec lui, pourrait faire référence au "Solaris", de Stanislas Lem, classique de la SF ayant inspiré les films d'Andreï Tarkovski et Steven Soderbergh.
Je ne veux pas être trop affirmatif, mais il me semble qu'il y a pas mal d'éléments en commun entre "Polaris" et "Solaris". Il y a aussi un bon nombre de divergences, et pas seulement en termes contextuels. Il est tout à fait possible que je raconte n'importe quoi, qu'on me démente. Si c'est le cas, mille excuses par avance, mais j'espère ne pas m'être noyé avec cette idée-là...
"Solaris" repose sur des thèmes très philosophiques, Fernando Clemot inscrit pour sa part son roman dans une époque, avec des questions historiques fortes qui le traversent. On a le sentiment de lire un livre qui nous parle d'un changement d'ère, d'une page qui s'est tournée, et d'une autre période qui s'est ouverte, avec des enjeux très différents.
L'isolement de l'Eridanus, comme suspendu au milieu de nulle part, dans une sorte d'éther, tant géographiquement que temporellement, donne l'impression d'une espèce de sas dans lequel s'effectuerait la transition et la Centrale, dans un rôle de démiurge décidant finalement du sort des uns et des autres, tout-puissante et indépendante de toute autre autorité, assurerait ce passage sans retour.
Il est des histoires déroutantes, "Polaris" en fait certainement partie, dans la forme, évidemment, mais sans doute aussi dans le fond. Et je n'oublie pas cette fin, troublante, un long plan séquence dans ce décor aussi majestueux qu'austère, aussi majestueux qu'hostile... Avec à la clé, comme un apaisement, comme un lent, très lent engourdissement...
Inscription à :
Articles (Atom)