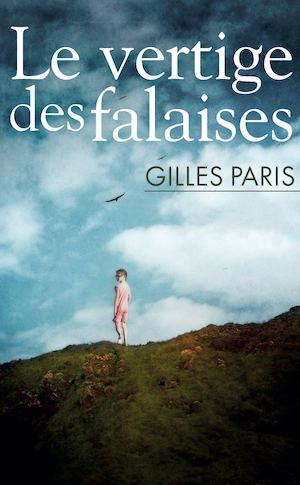Il y a quelques mois, une mystérieuse et rutilante couverture, apparaissait sur l'encart de une de Livres Hebdo, le magazine professionnel de référence (bon, en même temps, il n'y en a pas d'autre) de la chaîne du livre. Quelques semaines passent et je découvre que l'auteure de ce roman sera présente aux Imaginales. Et qu'elle participera à une des tables rondes que j'aurai à animer... Voilà comment je me suis retrouvé avec, entre les mains, "Le projet Starpoint, tome 1 : la fille aux cheveux rouges", de Marie-Lorna Vaconsin (en grand format sous le label "la Belle Colère" des éditions Anne Carrière). J'étais curieux de découvrir ce qui pouvait se cacher derrière cette couverture qu'on remarque forcément, je m'y suis donc plongé sans a priori, en faisant fi des doutes que je ressens toujours lorsqu'il s'agit de littérature jeunesse. Et j'ai plongé dans l'angle mort pour découvrir un monde tout à fait étrange et quelque peu dangereux...
A 15 ans, Pythagore est un adolescent ordinaire (si l'on excepte qu'il pratique le saut à la perche). Fils d'une prof de maths (qui sera d'ailleurs sa prof cette année pour la première fois) et d'un scientifique, tombé dans le coma trois ans plus tôt après avoir été tabassé par des inconnus. Une vilaine gastro l'a privé des deux premières semaines de cours, il débarque donc dans la classe bien après tout le monde.
Pythagore retrouve doucement ses marques. Jordanie, la camarade de classe qu'il a embrassée quelques mois plus tôt, à la fin de la précédente année scolaire, lui préfère manifestement Maxence, le gros dur de la classe. Bon... L'autre mauvaise surprise, c'est l'absence de sa meilleure amie, Louise. Bizarre, puisqu'elle est la fille du concierge de l'établissement et habite donc dans le bâtiment...
D'autant plus bizarre que Louise n'a jamais raté un cours, encore moins séché... La voilà qui arrive, en retard, flanquée d'une autre élève que Pythagore n'a encore jamais vue. Une nouvelle, sans doute. Il a entendu son nom, lors de l'appel : Foresta Erivan. Mais, ce qui frappe tout le monde quand Foresta entre en classe, c'est sa chevelure, d'un rouge qu'on ne peut pas ne pas remarquer.
Et la nouvelle venue va vite marquer son territoire : lorsque Maxence se moque de Louise, elle le soufflette, pas une, mais deux fois, et lui ferme son claquem... euh, pardonnez-moi, son caquet de la plus brillante des façons. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a réussi son entrée dans la classe et qu'on ne devrait plus lui chercher noise, et à Louise non plus...
En à peine deux semaines, Louise et la fille aux cheveux rouges sont donc devenues inséparables. Pythagore est un peu dépassé, il ne voit plus Louise aussi souvent que d'habitude, car, dès qu'elle le peut, la jeune fille disparaît avec Foresta. Que font-elles exactement ? Pythagore n'en a pas la moindre idée, mais il les trouve très affairées.
Et puis, un soir, après la fête du Carnaval des Pêcheurs, une vieille tradition à Loiret-en-Retz, alors que Pythagore se remet de ses émotions (on lui avait confié les platines, il a mixé toute la soirée), Foresta vient le trouver. Elle lui annonce que Louise a disparu et lui demande son aide pour la retrouver.
Secoué, Pythagore accepte aussitôt : Louise reste sa meilleure amie, il ne va pas la laisser tomber si elle est en danger. Mais, il ne comprend pas trop ce qui s'est passé, où et dans quelles circonstances Louise a disparu. Il suit Foresta qui l'emmène dans un coin de la cour, lui demande d'avaler un morceau de quelque chose de bizarre et de regarder dans les vitres du bâtiment.
Foresta recherche ce qu'elle appelle l'angle mort. Il apparaît lorsqu'on met deux miroirs en vis-à-vis pour qu'ils se reflètent l'un dans l'autre. Ca marche aussi avec les vitres. Et, lorsqu'il suit la fille aux cheveux rouges dans cet angle mort, il se retrouve soudain... ailleurs... Dans un monde bien différent qu'il va lui falloir découvrir, car c'est dans ce monde-là que Louise a été enlevée...
Pythagore... Le pauvre, je le plains... Le cancre en maths que je fus, qui mit si longtemps à digérer ce théorème, son triangle rectangle, son carré de l'hypoténuse, tout ce saint-frusquin qui me semblait inaccessible, a soudain revécu ses cauchemars adolescents dans lesquels flottaient, ricanants et sardoniques, des zéros pointés...
Heureusement pour lui, le jeune personnage central du "Projet Starpoint" vit mieux cela que moi. Et, s'il ne devait pas se rendre dans une impersonnelle chambre d'hôpital pour voir son père, s'il ne devait pas s'adresser à lui sans savoir s'il l'entend, s'il le comprend, alors, oui, il serait un ado très ordinaire, ayant les préoccupations de tous les jeunes gens de son âge.
Et puis, voilà que l'arrivée de Foresta chamboule son quotidien bien tranquille. Louise sèche, se fait plus rare, lui cache des choses... Et puis, elle disparaît dans un monde parallèle dans lequel elle a suivi une mystérieuse fille à la chevelure de feu... Elle est en danger, un danger mortel, comme va vite s'en rendre compte Pythagore.
Car, dans ce monde qu'il découvre, il s'en passe de belles : cela ne ressemble en rien à celui dans lequel a grandi Pythagore. Les couleurs, les lieux, les personnes, certaines valeurs et centre d'intérêt, même la physique, tout est différent dans ce monde-là. Et le jeune garçon, à l'instar de Louise, pourrait bien y être considéré comme un intrus s'il n'y prend pas garde. Mais le temps presse...
Je ne vais pas trop en dire sur cet univers assez déroutant que Marie-Lorna Vaconsin nous propose. Il vous faut le découvrir et vous interroger, comme ce fut mon cas. Oui, ce premier tome pose bien des questions. Dont une est très évidente : mais qu'est-ce donc que le projet Starpoint, qui donne son nom à ce qui sera une trilogie ?
Eh bien... Vous vous doutez que je ne vais pas vous répondre. Le voudrais-je, que je ne pourrais de toute façon pas, moi aussi, après ce premier tome, je me pose encore plein de questions sur ce sujet. Il apparaît, fugacement dans un premier temps. Puis, quelques révélations nous sont faites dans la dernière partie. Mais rien sur sa raison d'être. Rien sur ce qu'est vraiment le Projet Starpoint.
En revanche, on fait pas mal d'allers-retours entre les deux mondes situés de chaque côté de l'angle mort. Le nôtre, ça va, on le connaît, je passe vite ; l'autre, on commence à le découvrir un peu plus en profondeur et on comprend qu'il s'y passe des choses pas jolies-jolies... On est plus proche de la série "Fringe" que des livres de Lewis Carroll, auxquels on pourrait penser en passant de l'autre côté de l'angle mort.
A Pythagore de se montrer débrouillard et téméraire pour affronter ce mystérieux univers et les dangers constants qui menacent. A lui de sortir de son confort d'adolescent tranquille et effacé pour prendre les choses en main. En cela, ce premier tome entre parfaitement dans le côté initiatique qu'on retrouve souvent dans la littérature jeunesse, et plus encore lorsqu'il s'agit d'imaginaire.
Pythagore, incontestablement, franchit déjà un pas, quitte l'enfance dans ce premier tome. Il n'est pas encore adulte lorsqu'on le laisse, mais il sera très intéressant, lorsque les trois tomes seront parus, de mesurer l'évolution du personnage. Il y aura forcément gagné en maturité, en confiance en lui, aussi, et ça a déjà commencé, dans les deux mondes, d'ailleurs.
Il faut dire qu'à côté de la fulminante et flamboyante Foresta, Pythagore fait petit garçon, dans la première partie du livre. Il m'a rappelé un garçon de 15 ans que j'ai bien connu, en fait. Ni le plus populaire de la classe, ni le paria, le mec dans la moyenne en tout, le genre d'élève qui gagnerait à s'affirmer, surtout face à un Maxence et à son assurance de grosse brute.
En fait, il faudrait qu'il suive l'exemple de Louise, que la rencontre avec Foresta a métamorphosé, semble-t-il. Au point de prendre un peu trop de risques... Et, peu à peu, on va le voir prendre des initiatives, des décisions importantes pour son avenir et celui de Louise, prendre des risques, aussi. Bref, oser, découvrir le goût de l'aventure...
Je me suis bien amusé à lire "la Fille aux cheveux rouges", c'est rythmé, plein de mystères et de rebondissements, d'idées rigolotes et bien foutues (si vous vous demandez pourquoi j'ai parlé du saut à la perche dès le début de ce billet, vous comprendrez pourquoi en le lisant). J'ai retrouvé un plaisir de gamin, le même que celui que j'avais quand je lisais "le Club des 5" ou d'autres romans dans ce genre.
Reste un thème à aborder, qui touche au titre de ce billet. Pour les cheveux rouges, je pense que c'est clair, et sauf daltonisme sévère, la couverture du livre parle d'elle-même. Mais la barbe bleue... Il y aurait plusieurs raisons d'évoquer ces questions pileuses, assez présentes dans le livre, mais vous le découvrirez là encore en lisant ce premier tome.
Il y a surtout une figure qui traverse le roman. Une double figure, même, à la fois historique et légendaire : celle de Gilles de Retz. Cette trilogie se déroule dans une commune (imaginaire, me semble-t-il) qui s'appelle Loiret-en-Retz et qu'on devine située en Loire-Atlantique, près de Nantes. On y trouve une sorte de musée, la Maison des Légendes qui, dit-on, aurait appartenu à Gilles de Retz.
Si vous ne connaissez pas ce personnage, penchez-vous sur son cas, il est... incroyable. Ancien compagnon de Jeanne d'Arc, l'un des plus fidèles et dévoués, il est, quelques années plus tard, condamnés pour les meurtres (et autres détails sordides) de plus de 140 enfants ! Condamné à être pendu puis brûlé, Gilles de Retz, ogre ou serial killer avant l'heure, est exécuté en 1440.
Voilà pour l'histoire, sur laquelle, je pense qu'on sera d'accord, planent beaucoup de questions qui ne seront sans doute jamais éclaircies. Et puis, au fil des siècles, cette figure est devenue légendaire. On a même fini par l'identifier au personnage de Barbe Bleue... Beaucoup de contes et de récits l'ont mis en scène, la version qu'on connaît le mieux est, comme souvent, celle de Perrault.
Pourtant, dans ce conte-là (auquel Marie-Lorna Vaconsin fait d'ailleurs ouvertement référence dans une des scènes de "la Fille aux cheveux rouges"), Barbe Bleue fait plus référence au roi d'Angleterre Henry VIII et à sa vie conjugale qu'à Gilles de Rais... Les légendes se croisent, s'entremêlent, se marient, se confondent, mais toujours se transmettent et c'est encore un bel exemple.
En revisitant cette histoire, Marie-Lorna Vaconsin contribuera certainement à faire découvrir ou redécouvrir cette double figure Rais/Barbe Bleue à ses jeunes lecteurs. Et ainsi se poursuivra la transmission, à travers une histoire fantastique captivante dont on attend désormais avec impatience la suite de cette trilogie pleine d'inventivité.
"Il va falloir un jour qu'enfin je me décide à lire les livres que, depuis trente ans, je conseille à mes amis de lire". (Sacha Guitry)
mercredi 31 mai 2017
mardi 30 mai 2017
"La lumière existe en chacun de vous".
Soyons francs, depuis les succès de "Divergente" ou "Hunger Games", la dystopie est mise à toutes les sauces. Et, de plus en plus, on se demande pourquoi les auteurs choisissent de placer leurs histoires dans un monde dystopique, car ça ne paraît pas toujours ni évident ni pertinent. Pourtant, c'est un bel exercice lorsqu'il est pratiqué dans l'esprit. C'est-à-dire non pas pour des raisons commerciales qui accompagnent souvent les modes, mais pour utiliser ce principe d'un monde qui va mal pour exposer des thématiques fortes et surtout très actuelles. Alors, militons pour les dystopies qui respectent le genre et parlons de "Sang-de-Lune", de Charlotte Bousquet, paru aux éditions Gulf Stream. Autour de sujets chers à l'auteure, un univers riche, inquiétant, douloureux, à déconseiller aux claustrophobes, une galerie de personnages attachants et secrets, une quête qui n'est pas juste initiatique mais presque, non, ce n'est pas paradoxal, utopique, portée par un espoir apparemment insensé mais source de détermination.
A Alta, filles et garçons ne sont pas du tout logés à la même enseigne. Disons les choses clairement : dans cette ville, la société est ouvertement patriarcale et les inégalités entre hommes et femmes sont plus qu'un usage, elles sont une règle. Les hommes sont les Fils-du-Soleil et ont droit de vie et de mort sur les femmes, qu'on appelle les Sang-de-Lune.
Gia est donc une Sang-de-Lune et, comme tous les citoyens d'Alta, son destin s'est écrit à la naissance. Depuis toujours, on lui a inculqué les règles très strictes qui régentent Alta. Et elle sait parfaitement que celle qui les enfreint connaîtra une fin douloureuse : de longues réclusions, loin des siens, ou, dans les cas les plus extrêmes, la condamnation à mort...
Même si son père va entrer au conseil des Sept, l'instance qui fait régner l'ordre patriarcal sur Alta, cela n'améliore guère le sort de Gia : bientôt, lorsqu'elle deviendra pubère, on la mariera à un Fils-du-Soleil qu'elle n'aura pas choisi et sa vie se résumera ensuite à la maternité et aux devoirs domestiques. Ce que Gia ne peut accepter.
Très tôt, elle a manifesté un esprit assez rebelle. En grandissant, elle a affirmé ce caractère, ce qui lui a déjà valu des ennuis. Dans son entourage, on la considère comme un esprit un peu trop libre et son père, du haut de son statut de notable, voit d'un oeil mauvais les écarts de conduite de sa fille aînée. Mais Gia a soif de liberté.
Un événement, terrible, cruel, va alors se produire et faire basculer le destin de Gia. Je ne le raconte pas ici, vous le découvrirez en lisant "Sang-de-Lune". Mais, après ces événements, la volonté de Gia de rompre avec l'oppression imposée aux femmes à Alta s'est encore renforcée. Elle ne peut plus tolérer cette vie. Pour elle, passe encore, mais pour Arienn, c'est impossible...
Que faire ? Alta est une sorte de vase clos, même libre, elle n'aurait guère d'endroit où aller. Paradoxalement, c'est une sanction, lourde, injuste, qui va lui permettre d'échafauder un plan. Condamnée à une réclusion d'un mois auquel elle n'aura pour seule activité que l'étude des textes fondateurs d'Alta, elle découvre un texte qui attire son attention.
Ils ont été écrits par une certaine Rovina et laissent entendre qu'un autre monde bien différent existe en dehors d'Alta. Rovina a été considérée et condamnée pour hérésie, mais se pourrait-il que ce qu'elle décrit existe ? Se pourrait-il que la carte, découverte par hasard par Arienn peu de temps avant ces événements, soit liée à ces textes et contienne le moyen de fuir enfin Alta ?
Gia ne sait pas vraiment où tout cela va la mener : la liberté (très hypothétique, légendaire, peut-être) se trouve au-delà des Régions Libres, au nom trompeur. A ce qu'on en dit, ce sont des lieux terribles, dangereux, livrés à la loi du plus fort. Mais, Gia n'a plus rien à perdre : elle a appris que la date de son mariage avait été fixée. Il est temps de partir, et d'emmener Arienn avec elle...
Gia, Arienn... Deux personnages aux prises avec le destin. Un destin dont elles n'ont jamais eu les rênes en main, puisqu'elle ne sont rien. Elles sont quantité négligeable parce que nées filles. Tout juste bonnes à mettre les enfants au monde et à faire le ménage, je ne caricature même pas les fondements de la société d'Alta.
Alors, rapidement, on se retrouve du côté de Gia qui veut reprendre sa vie en main et, peut-être plus encore, éviter à sa soeur de connaître, dans les années à venir, un sort identique à celui qui lui est promis. Et, si cela ne suffisait pas, Charlotte Bousquet impose au lecteur (enfin, d'abord à ses personnages, bien sûr) une épreuve d'une cruauté telle qu'elle devrait convaincre les plus bouchés.
J'ai évoqué cette scène plus haut, je ne vais pas plus la détailler ici, mais j'imagine que cette scène en particulier va marquer bien des mémoires. Elle ne sera pas la seule. Une autre, un peu plus loin dans le récit, devrait vous serrer la gorge et les tripes, vous faire monter les larmes. Non, on en restera au teasing, je n'en dirai pas plus.
Mais tout cela a le mérite de planter le décor : "Sang-de-Lune" est un roman rude qui malmène les personnages, mais bouscule aussi le lecteur. Ici, on appelle un chat un chat et on montre l'horreur telle qu'elle est. Pas de voile, pas de non-dit, pas d'ellipse, la vérité entière, crue et violente, pour que l'on assimile bien le sort qui attend Gia si elle ne se rebelle pas.
Ainsi débute la quête de Gia et d'Arienn, une quête de liberté qu'on peut voir sous plusieurs dimensions : évidemment l'émancipation de ce système inique qui les écrasait, mais aussi une certaine allégorie de l'adolescence, chemin semé d'embûches qui mène à l'âge adulte. Oh, il y a sans doute encore bien des dimensions à ce voyage.
Toutefois, j'ai envie de vous parler de l'univers qu'elles prévoient de traverser pour atteindre la liberté, ou l'image qu'elles se font d'une vie libre. Ces fameuses Régions Libres... Comment dire... Libre, oui, puisque ne s'y appliquent pas les lois d'Alta, mais sinon, c'est une certaine image de l'enfer... Un enfer qui ressemble comme deux gouttes d'eau (très sale, certes) à des égouts...
"Sang-de-Lune" est un roman qui joue sans cesse sur l'opposition entre lumière et ténèbres. Il y a l'opposition clairement définie entre soleil et lune, et donc, entre jour et nuit. Les premiers, attachés à la masculinité, avec la puissance que cela représente ; les seconds symbolisant la féminité, mais avec une dimension péjorative clairement exprimé.
Cette opposition vaut également pour l'univers, puisque à la lumineuse Alta, s'opposent les ténébreuses Régions Libres, avec leurs miasmes et leurs dangers. Aux règles strictes imposées dans la ville, s'oppose la loi du plus fort qui règne dans ces territoires (je force peut-être un peu le trait, mais pas tant que ça).
On pourrait trouver paradoxal que la liberté soit attaché aux ténèbres et la tyrannie à la lumière, mais n'est-ce pas le meilleur signe qu'on est bien dans une dystopie et que ce terme n'est pas galvaudé ? En tout cas, on plonge (et ce n'est pas qu'une figure de style) dans ces souterrains pas toujours très bien fréquentés, où il faut gagner sa croûte comme on peut.
Une nouvelle vie qu'il faut appréhender, bien loin du confort, certes relatif, de la vie à Alta. Une manière de tomber de Charybde en Scylla, pourrait-on dire, car la vie est rude dans les Régions Libres, mais un passage obligé vers la liberté. Et l'occasion de faire des rencontres loin des carcans sociaux de la société très encadrée d'Alta.
Je ne vous les présente pas, ces personnages, vous les rencontrerez à la suite de Gia, narratrice du roman et son moteur, également. Je ne parle pas de ces filles et de ces garçons qui hante les sous-sols d'Alta pour plusieurs raisons : parce qu'il vont être au coeur de l'intrigue de "Sang-de-Lune" et permettre à Gia de comprendre pas mal de choses et de se révéler aussi.
Et puis, parce que ces Régions Libres sont une véritable société en marge de tout le reste, avec ses règles, ses codes, ses antagonismes, ses secrets, aussi. Il s'en passe, des choses, là-dessous, croyez-moi, avec des conditions de vie pas franchement agréables et un sentiment quasi permanent de crainte, car qui sait ce qui peut se trouver au coin d'un tunnel insalubre ?
"Sang-de-Lune", c'est bien sûr un roman sur la condition féminine, sur les sociétés patriarcales qui ne sont, hélas, pas que des instruments romanesques pour construire des dystopies. Le monde imaginaire conçu par Charlotte Bousquet nous parle du nôtre, de monde, celui où, à poste et compétences égaux, une femme touchera un salaire inférieur, pour ne donner qu'un exemple.
Comme dans "Là où tombent les anges", son précédent roman, paru dans la même collection "Electrogène", chez Gulf Stream, comme dans la plupart des livres de Charlotte Bousquet, on retrouve dans "Sang-de-Lune" cette profonde revendication à l'émancipation, au refus du patriarcat, à l'égalité entre les sexes.
Mais cela ne plombe pas l'histoire, non, c'est son ADN, mais ce n'est pas un boulet que traîne les personnages. Au contraire, et c'est sans doute tout l'intérêt de l'installer dans un contexte dystopique, cela permet de proposer des personnages féminins très forts, qui ne se laissent pas malmener par les hommes ni par le destin et de rappeler au lectorat jeune adulte à qui est dédié ce roman qu'il ne doit pas y avoir de Sang-de-Lune hors de ces pages.
Au passage, Charlotte Bousquet aborde un autre sujet qui lui importe (et il y en a forcément d'autres, les billets ne sont jamais exhaustifs) : l'orientation sexuelle, la découverte de l'homosexualité et comment vivre cette révélation. De prime abord, cela ne semble pas être un thème central du roman, mais j'en parle parce que je trouve qu'il est abordé avec beaucoup de sensibilité et d'intelligence.
Et puis, on avance, et on comprend qu'on s'est trompé et que cette question joue un rôle bien moins anecdotique qu'on le croyait dans cette histoire. Voilà aussi ce que j'aime chez Charlotte Bousquet, la façon dont ses convictions nourrissent ses histoires mais sans les écraser. Un grand soin dans la pédagogie qui en fait une auteure à suivre et à lire attentivement.
Un dernier mot, parce que je classe "Sang-de-Lune" en dystopie. Mais, durant une bonne partie de ma lecture, et encore ce soir en écrivant ce billet, je me demande si je ne fais pas fausse route. Oh, bien sûr, tous les éléments sont là pour que Alta, les Régions Libres et cet univers dans sa globalité soit considéré comme dystopique.
Mais, n'assiste-t-on pas pour autant au fil des pages à la naissance d'une utopie ? On approche de la date du bac philo, z'allez plancher aussi, il n'y a pas de raison ! Je suis sérieux, car le but de la quête de Gia a tout d'un rêve, d'un projet utopique et le dénouement, je dois dire assez surprenant, presque déroutant par ce qu'il révèle, vient à l'appui de cette idée.
La fin de "Sang-de-Lune" est très ouverte et c'est très bien ainsi. Je trouve même que cela vient entretenir le côté utopique des choses. A chaque lecteur de laisser vagabonder son imagination pour construire à sa façon le futur de Gia... En lui souhaitant de réussir, car elle laisse derrière elle bien des difficultés, mais d'autres seront encore certainement à venir...
A moins que cette fin ouverte ne laisse la possibilité à Charlotte Bousquet de revenir dans cet univers... Qui sait ?
A Alta, filles et garçons ne sont pas du tout logés à la même enseigne. Disons les choses clairement : dans cette ville, la société est ouvertement patriarcale et les inégalités entre hommes et femmes sont plus qu'un usage, elles sont une règle. Les hommes sont les Fils-du-Soleil et ont droit de vie et de mort sur les femmes, qu'on appelle les Sang-de-Lune.
Gia est donc une Sang-de-Lune et, comme tous les citoyens d'Alta, son destin s'est écrit à la naissance. Depuis toujours, on lui a inculqué les règles très strictes qui régentent Alta. Et elle sait parfaitement que celle qui les enfreint connaîtra une fin douloureuse : de longues réclusions, loin des siens, ou, dans les cas les plus extrêmes, la condamnation à mort...
Même si son père va entrer au conseil des Sept, l'instance qui fait régner l'ordre patriarcal sur Alta, cela n'améliore guère le sort de Gia : bientôt, lorsqu'elle deviendra pubère, on la mariera à un Fils-du-Soleil qu'elle n'aura pas choisi et sa vie se résumera ensuite à la maternité et aux devoirs domestiques. Ce que Gia ne peut accepter.
Très tôt, elle a manifesté un esprit assez rebelle. En grandissant, elle a affirmé ce caractère, ce qui lui a déjà valu des ennuis. Dans son entourage, on la considère comme un esprit un peu trop libre et son père, du haut de son statut de notable, voit d'un oeil mauvais les écarts de conduite de sa fille aînée. Mais Gia a soif de liberté.
Un événement, terrible, cruel, va alors se produire et faire basculer le destin de Gia. Je ne le raconte pas ici, vous le découvrirez en lisant "Sang-de-Lune". Mais, après ces événements, la volonté de Gia de rompre avec l'oppression imposée aux femmes à Alta s'est encore renforcée. Elle ne peut plus tolérer cette vie. Pour elle, passe encore, mais pour Arienn, c'est impossible...
Que faire ? Alta est une sorte de vase clos, même libre, elle n'aurait guère d'endroit où aller. Paradoxalement, c'est une sanction, lourde, injuste, qui va lui permettre d'échafauder un plan. Condamnée à une réclusion d'un mois auquel elle n'aura pour seule activité que l'étude des textes fondateurs d'Alta, elle découvre un texte qui attire son attention.
Ils ont été écrits par une certaine Rovina et laissent entendre qu'un autre monde bien différent existe en dehors d'Alta. Rovina a été considérée et condamnée pour hérésie, mais se pourrait-il que ce qu'elle décrit existe ? Se pourrait-il que la carte, découverte par hasard par Arienn peu de temps avant ces événements, soit liée à ces textes et contienne le moyen de fuir enfin Alta ?
Gia ne sait pas vraiment où tout cela va la mener : la liberté (très hypothétique, légendaire, peut-être) se trouve au-delà des Régions Libres, au nom trompeur. A ce qu'on en dit, ce sont des lieux terribles, dangereux, livrés à la loi du plus fort. Mais, Gia n'a plus rien à perdre : elle a appris que la date de son mariage avait été fixée. Il est temps de partir, et d'emmener Arienn avec elle...
Gia, Arienn... Deux personnages aux prises avec le destin. Un destin dont elles n'ont jamais eu les rênes en main, puisqu'elle ne sont rien. Elles sont quantité négligeable parce que nées filles. Tout juste bonnes à mettre les enfants au monde et à faire le ménage, je ne caricature même pas les fondements de la société d'Alta.
Alors, rapidement, on se retrouve du côté de Gia qui veut reprendre sa vie en main et, peut-être plus encore, éviter à sa soeur de connaître, dans les années à venir, un sort identique à celui qui lui est promis. Et, si cela ne suffisait pas, Charlotte Bousquet impose au lecteur (enfin, d'abord à ses personnages, bien sûr) une épreuve d'une cruauté telle qu'elle devrait convaincre les plus bouchés.
J'ai évoqué cette scène plus haut, je ne vais pas plus la détailler ici, mais j'imagine que cette scène en particulier va marquer bien des mémoires. Elle ne sera pas la seule. Une autre, un peu plus loin dans le récit, devrait vous serrer la gorge et les tripes, vous faire monter les larmes. Non, on en restera au teasing, je n'en dirai pas plus.
Mais tout cela a le mérite de planter le décor : "Sang-de-Lune" est un roman rude qui malmène les personnages, mais bouscule aussi le lecteur. Ici, on appelle un chat un chat et on montre l'horreur telle qu'elle est. Pas de voile, pas de non-dit, pas d'ellipse, la vérité entière, crue et violente, pour que l'on assimile bien le sort qui attend Gia si elle ne se rebelle pas.
Ainsi débute la quête de Gia et d'Arienn, une quête de liberté qu'on peut voir sous plusieurs dimensions : évidemment l'émancipation de ce système inique qui les écrasait, mais aussi une certaine allégorie de l'adolescence, chemin semé d'embûches qui mène à l'âge adulte. Oh, il y a sans doute encore bien des dimensions à ce voyage.
Toutefois, j'ai envie de vous parler de l'univers qu'elles prévoient de traverser pour atteindre la liberté, ou l'image qu'elles se font d'une vie libre. Ces fameuses Régions Libres... Comment dire... Libre, oui, puisque ne s'y appliquent pas les lois d'Alta, mais sinon, c'est une certaine image de l'enfer... Un enfer qui ressemble comme deux gouttes d'eau (très sale, certes) à des égouts...
"Sang-de-Lune" est un roman qui joue sans cesse sur l'opposition entre lumière et ténèbres. Il y a l'opposition clairement définie entre soleil et lune, et donc, entre jour et nuit. Les premiers, attachés à la masculinité, avec la puissance que cela représente ; les seconds symbolisant la féminité, mais avec une dimension péjorative clairement exprimé.
Cette opposition vaut également pour l'univers, puisque à la lumineuse Alta, s'opposent les ténébreuses Régions Libres, avec leurs miasmes et leurs dangers. Aux règles strictes imposées dans la ville, s'oppose la loi du plus fort qui règne dans ces territoires (je force peut-être un peu le trait, mais pas tant que ça).
On pourrait trouver paradoxal que la liberté soit attaché aux ténèbres et la tyrannie à la lumière, mais n'est-ce pas le meilleur signe qu'on est bien dans une dystopie et que ce terme n'est pas galvaudé ? En tout cas, on plonge (et ce n'est pas qu'une figure de style) dans ces souterrains pas toujours très bien fréquentés, où il faut gagner sa croûte comme on peut.
Une nouvelle vie qu'il faut appréhender, bien loin du confort, certes relatif, de la vie à Alta. Une manière de tomber de Charybde en Scylla, pourrait-on dire, car la vie est rude dans les Régions Libres, mais un passage obligé vers la liberté. Et l'occasion de faire des rencontres loin des carcans sociaux de la société très encadrée d'Alta.
Je ne vous les présente pas, ces personnages, vous les rencontrerez à la suite de Gia, narratrice du roman et son moteur, également. Je ne parle pas de ces filles et de ces garçons qui hante les sous-sols d'Alta pour plusieurs raisons : parce qu'il vont être au coeur de l'intrigue de "Sang-de-Lune" et permettre à Gia de comprendre pas mal de choses et de se révéler aussi.
Et puis, parce que ces Régions Libres sont une véritable société en marge de tout le reste, avec ses règles, ses codes, ses antagonismes, ses secrets, aussi. Il s'en passe, des choses, là-dessous, croyez-moi, avec des conditions de vie pas franchement agréables et un sentiment quasi permanent de crainte, car qui sait ce qui peut se trouver au coin d'un tunnel insalubre ?
"Sang-de-Lune", c'est bien sûr un roman sur la condition féminine, sur les sociétés patriarcales qui ne sont, hélas, pas que des instruments romanesques pour construire des dystopies. Le monde imaginaire conçu par Charlotte Bousquet nous parle du nôtre, de monde, celui où, à poste et compétences égaux, une femme touchera un salaire inférieur, pour ne donner qu'un exemple.
Comme dans "Là où tombent les anges", son précédent roman, paru dans la même collection "Electrogène", chez Gulf Stream, comme dans la plupart des livres de Charlotte Bousquet, on retrouve dans "Sang-de-Lune" cette profonde revendication à l'émancipation, au refus du patriarcat, à l'égalité entre les sexes.
Mais cela ne plombe pas l'histoire, non, c'est son ADN, mais ce n'est pas un boulet que traîne les personnages. Au contraire, et c'est sans doute tout l'intérêt de l'installer dans un contexte dystopique, cela permet de proposer des personnages féminins très forts, qui ne se laissent pas malmener par les hommes ni par le destin et de rappeler au lectorat jeune adulte à qui est dédié ce roman qu'il ne doit pas y avoir de Sang-de-Lune hors de ces pages.
Au passage, Charlotte Bousquet aborde un autre sujet qui lui importe (et il y en a forcément d'autres, les billets ne sont jamais exhaustifs) : l'orientation sexuelle, la découverte de l'homosexualité et comment vivre cette révélation. De prime abord, cela ne semble pas être un thème central du roman, mais j'en parle parce que je trouve qu'il est abordé avec beaucoup de sensibilité et d'intelligence.
Et puis, on avance, et on comprend qu'on s'est trompé et que cette question joue un rôle bien moins anecdotique qu'on le croyait dans cette histoire. Voilà aussi ce que j'aime chez Charlotte Bousquet, la façon dont ses convictions nourrissent ses histoires mais sans les écraser. Un grand soin dans la pédagogie qui en fait une auteure à suivre et à lire attentivement.
Un dernier mot, parce que je classe "Sang-de-Lune" en dystopie. Mais, durant une bonne partie de ma lecture, et encore ce soir en écrivant ce billet, je me demande si je ne fais pas fausse route. Oh, bien sûr, tous les éléments sont là pour que Alta, les Régions Libres et cet univers dans sa globalité soit considéré comme dystopique.
Mais, n'assiste-t-on pas pour autant au fil des pages à la naissance d'une utopie ? On approche de la date du bac philo, z'allez plancher aussi, il n'y a pas de raison ! Je suis sérieux, car le but de la quête de Gia a tout d'un rêve, d'un projet utopique et le dénouement, je dois dire assez surprenant, presque déroutant par ce qu'il révèle, vient à l'appui de cette idée.
La fin de "Sang-de-Lune" est très ouverte et c'est très bien ainsi. Je trouve même que cela vient entretenir le côté utopique des choses. A chaque lecteur de laisser vagabonder son imagination pour construire à sa façon le futur de Gia... En lui souhaitant de réussir, car elle laisse derrière elle bien des difficultés, mais d'autres seront encore certainement à venir...
A moins que cette fin ouverte ne laisse la possibilité à Charlotte Bousquet de revenir dans cet univers... Qui sait ?
lundi 29 mai 2017
La somme de toutes les Callista.
Fin de la parenthèse enchantée des Imaginales, quelques jours de repos pour remettre les pieds sur terre et reprise progressive désormais de la lecture et du blog. Euh, très progressive, en ce qui concerne la lecture, mais j'ai tant accumulé de retard que ce n'est pas grave. Et, pour la reprise, place à une sortie qui était très attendue : "la Mort du Temps", nouveau roman d'Aurélie Wellenstein, coup de coeur de l'édition 2017 des Imaginales (en grand format aux éditions Scrineo). "Le Roi des Fauves" et "Les Loups chantants" étaient deux excellents romans, avec une atmosphère très particulière, sombre, envoûtante, et des thématiques fortes. Avec un titre à la fois audacieux, intrigant et prometteur comme cette "Mort du Temps", l'envie de retrouver l'univers si spécial de la romancière était forte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet... Attachez vos ceintures et accrochez-vous bien, ça va secouer !
Lorsque Callista se réveille, elle peine à comprendre où elle se trouve. C'est son père, présent à son chevet, qui lui apprend qu'elle a eu un grave accident et qu'elle est dans un hôpital. Encore ensuquée, l'adolescente (Callista a 16 ans) doit digérer ces premières informations, mais aussi certains autres détails qu'elle n'identifie pas encore.
Et puis, soudain, quelques bribes de mémoire... Comment va Emma, sa meilleure amie ? Pourquoi sa mère n'est elle pas présente à ses côtés elle aussi ? Les réponses de son père sont parcellaires, teintées d'émotion. Mais, il n'a pas le temps de les approfondir : soudain, tout se met à trembler, le sol, les murs, comme si un séisme se produisait...
Il leur faut fuir, fuir ce bâtiment qui risque de s'effondrer sur eux... Ils sortent, courent, au milieu des décombres, des passants qui fuient, des automobilistes affolés. Un tremblement de terre en plein Paris, qui aurait pu croire ça ? Callista, encore faible, a du mal à suivre son père, dont elle ressent pourtant l'agacement, l'inquiétude, la peur et ce sentiment d'urgence qui se dégage de lui.
Et puis, alors que le séisme semble redoubler de puissance destructrice, le père de Callista s'effondre. Déboussolée, effarée, l'adolescente assiste à la mort soudaine de son père dans des conditions étranges, atroces, bouleversantes. La voilà seule au milieu d'un indescriptible chaos, avec la promesse faite à son père de rester vivante...
Si elle reste là, elle finira sans doute écraser par quelque mur ou façade effondrée. Alors, elle doit reprendre sa route. Mais où aller ? La capitale semble subir un cataclysme hors norme, pas un simple séisme mais un phénomène bien plus surprenant, incroyable, sidérant, même. Pas le temps de chercher à comprendre ce qui se passe, il faut s'en aller au plus vite...
Une seule idée : rejoindre Emma. Son père lui a dit à son réveil que son amie était rentrée chez ses parents, à Xertigny, dans le sud des Vosges. Une trotte, surtout à pied, mais le seul objectif que puisse se fixer Callista dans ces conditions. Alors, advienne que pourra, démunie, perdue, mais déterminée, elle se lance dans cette aventure forcément mouvementée.
Mais les dangers sont partout. Le phénomène se déplace, semble même la suivre, par moments. Les traces qu'il laisse sur son passage sont effrayantes et menaçantes. Difficile pour Callista d'avancer aussi vite qu'elle le voudrait, de trouver de quoi manger et boire, de trouver le temps de se reposer dans des endroits propices...
Et puis, il y a les rencontres... Comment savoir s'il s'agit d'ami ou d'ennemi, dans ce monde effondré, chaotique, anarchique ? Comment savoir même si ceux que l'on croise sont encore humains, car on peut effectivement parfois en douter ? A Callista de savoir s'entourer et éviter les pièges et les mauvais coups pour arriver à ses fins : retrouver Emma. Et peut-être, comprendre.
Tout de suite, une première chose : entrer dans "La Mort du Temps", c'est prendre le risque de rester un moment scotché à son siège. Rarement on tombe sur des livres qui entrent aussi rapidement dans le vif du sujet que celui-là. Les 60 premières pages, dans ce monde violemment ébranlé par cet étrange phénomène, vous obligent à vous accrocher solidement à votre siège.
Wow, ça dépote, rien que d'y repenser, j'ai l'impression de retrouver ces tremblements, ces bruits, ce chaos... Comme Callista, on a quelques éléments, quelques pièces d'un puzzle dont on sent bien qu'il faudra le reconstituer, mais on est éberlué, perdu, paniqué... Que se passe-t-il, soudainement ? C'est incroyablement retranscris et transmis.
Et puis, une fois que tout se calme (provisoirement), on commence à voir transparaître certains des thèmes favoris d'Aurélie Wellenstein. Le plus évident, c'est la métamorphose, l'hybridation humain/animal. Eh oui, encore, j'en entends déjà certains qui râlent... Mais ce qu'elle imagine, ce côté contrefait, cauchemardesque, est tout à fait réussi.
A côté de cela, j'ai curieusement trouvé l'univers moins sombre, en tout cas dans la première moitié, les deux premiers tiers, même. Comment dire ? On est obnubilé par le phénomène, qui se manifeste aussi par une lumière qui brise le côté ténébreux de ce que fait d'habitude l'auteure. Mais, dans le final, on replonge dans quelque chose de très noir et inquiétant.
D'autres thèmes présents chez Aurélie Wellenstein, dans les romans qu'elle a publiés chez Scrineo, sont présents dans "la Mort du Temps", mais c'est un peu délicat d'en parler, au risque d'en dévoiler un peu trop sur l'histoire. Mais, il y a encore une fois un sentiment d'inconfort, de malaise, de doute, une manière d'évoquer l'adolescence et ses difficultés inhérentes qui sont très intéressantes.
Mais venons-en au thème central de ce roman : le temps. Un sujet qui revient souvent ces derniers temps, on peut penser au dernier tome en date des aventures de Jean-Philippe Lasser, le détective des dieux, au premier roman de Lou Jan, "Sale temps", mais aussi à "22/11/1963", dans lequel Stephen King fait du temps un monstre s'opposant à son personnage principal.
C'est même à ce dernier que j'ai pensé immédiatement : le temps comme monstre, comme méchant d'une histoire, ça me plaît ! On retrouve d'ailleurs dans les deux romans le côté sismique du temps en action, mais chez Aurélie Wellenstein, il est nettement plus violent. Et surtout, elle a une idée que j'ai trouvé absolument géniale.
Je vais essayer d'en parler sans trop en révéler, là encore. Mais j'ai adoré le côté compression à la César que produisent les soubresauts du temps dans le roman d'Aurélie Wellenstein. Ils concassent, écrabouillent, ils déforment et contrefont... Le résultat, sur les lieux comme sur les êtres, est tout à fait impressionnant.
J'ai trouvé très malin ce réveil du temps, espèce de Léviathan qui se cabre et se rebelle contre un ordre des choses, espèce de monstre souterrain venus des profondeurs tel un dragon endormi qu'on est venu sortir de son hibernation et qui fait savoir son mécontentement. Celui-là ne crache pas du feu, mais son côté broyeuse de casse automobile n'est guère plus rassurant...
Cela colle aussi parfaitement avec le titre du roman, car ce phénomène pourrait parfaitement ressembler aux convulsions d'agonie d'un monstre légendaire qui aurait été frappé par un chevalier, un saint Georges resurgi du fond des âges... Oh, ça alors, mais que vois-je sur la couverture (dit-il, avec un ton digne de la Comédie Française pour ménager son effet) ? Un bien curieux chevalier !
N'en disons pas plus. Pour le reste, Aurélie Wellenstein joue avec le temps de façon assez classique, des situations chères à la SF depuis Wells et sa machine à explorer le temps. Mais, n'oublions pas que c'est un roman qui s'adresse à de jeunes lecteurs, même si je trouve que son univers peut parfaitement plaire aux adultes. Et cette variation sur les questions temporelles est intéressante et efficace.
Et puis, il y a une référence un peu curieuse, a priori, qui m'est venu au fil des pages et des chapitres. Et si Callista était une Dorothy qu'un mystérieux phénomène avait emmené dans un pays d'Oz infernal, fracassé, apocalyptique ? Au fil de son odyssée vers les Vosges (décidément terre d'imaginaire de plus en plus affirmée, youpi !), les rencontres que fait Callista construisent une fière équipée.
Franchement, je suis à peu près sûr d'être le seul à faire ce lien. On n'est certainement pas dans une relecture du classique de Frank L. Baum, mais j'assume, je revendique ce parallèle, jusque dans le dénouement de cette histoire. Et j'ai trouvé ça drôlement bien, de bousculer les repères, de les maltraiter un peu et d'offrir un univers une nouvelle fois riche et surprenant au lecteur.
Un dernier mot, en forme de conseil. Il y a quelques jours, Aurélie Wellenstein était donc le coup de coeur des Imaginales, un salon que j'aime particulièrement, qui se déroule à Epinal et est devenu, en 15 ans, un des plus grands événements de France autour des littératures de l'imaginaire. Lorsqu'on est coup de coeur, on a le droit de passer sur le gril.
Un entretien en tête-à-tête avec Stéphanie Nicot, la directrice artistique de l'événement. Je n'ai pas pu assister à cette rencontre (mon planning de modérateur ne l'a pas permis), mais j'en ai eu quelques échos. Le site ActuSF enregistre les tables rondes des Imaginales puis les met en ligne. Celle d'Aurélie, je crois, ne s'y trouve pas encore.
Mais, lorsqu'elle s'y trouvera, je vous encourage à l'écouter, je suis certain qu'elle vous apportera des éclairages intéressants sur son travail d'écrivain et sur cet univers que j'apprécie particulièrement, aussi sombre qu'il est profond. "La Mort du Temps" prolonge son travail assez varié, de la fantasy à la science-fiction, avec un talent certain, un style toujours aussi fort et visuel et des atmosphères qui ne peuvent laisser indifférent.
EDIT : Et voilà, quelques jours après la parution de ce billet, la table ronde autour d'Aurélie Wellenstein a été mise en ligne par ActuSF : http://www.actusf.com/spip/Imaginales-2017-Le-coup-de-coeur.html
Lorsque Callista se réveille, elle peine à comprendre où elle se trouve. C'est son père, présent à son chevet, qui lui apprend qu'elle a eu un grave accident et qu'elle est dans un hôpital. Encore ensuquée, l'adolescente (Callista a 16 ans) doit digérer ces premières informations, mais aussi certains autres détails qu'elle n'identifie pas encore.
Et puis, soudain, quelques bribes de mémoire... Comment va Emma, sa meilleure amie ? Pourquoi sa mère n'est elle pas présente à ses côtés elle aussi ? Les réponses de son père sont parcellaires, teintées d'émotion. Mais, il n'a pas le temps de les approfondir : soudain, tout se met à trembler, le sol, les murs, comme si un séisme se produisait...
Il leur faut fuir, fuir ce bâtiment qui risque de s'effondrer sur eux... Ils sortent, courent, au milieu des décombres, des passants qui fuient, des automobilistes affolés. Un tremblement de terre en plein Paris, qui aurait pu croire ça ? Callista, encore faible, a du mal à suivre son père, dont elle ressent pourtant l'agacement, l'inquiétude, la peur et ce sentiment d'urgence qui se dégage de lui.
Et puis, alors que le séisme semble redoubler de puissance destructrice, le père de Callista s'effondre. Déboussolée, effarée, l'adolescente assiste à la mort soudaine de son père dans des conditions étranges, atroces, bouleversantes. La voilà seule au milieu d'un indescriptible chaos, avec la promesse faite à son père de rester vivante...
Si elle reste là, elle finira sans doute écraser par quelque mur ou façade effondrée. Alors, elle doit reprendre sa route. Mais où aller ? La capitale semble subir un cataclysme hors norme, pas un simple séisme mais un phénomène bien plus surprenant, incroyable, sidérant, même. Pas le temps de chercher à comprendre ce qui se passe, il faut s'en aller au plus vite...
Une seule idée : rejoindre Emma. Son père lui a dit à son réveil que son amie était rentrée chez ses parents, à Xertigny, dans le sud des Vosges. Une trotte, surtout à pied, mais le seul objectif que puisse se fixer Callista dans ces conditions. Alors, advienne que pourra, démunie, perdue, mais déterminée, elle se lance dans cette aventure forcément mouvementée.
Mais les dangers sont partout. Le phénomène se déplace, semble même la suivre, par moments. Les traces qu'il laisse sur son passage sont effrayantes et menaçantes. Difficile pour Callista d'avancer aussi vite qu'elle le voudrait, de trouver de quoi manger et boire, de trouver le temps de se reposer dans des endroits propices...
Et puis, il y a les rencontres... Comment savoir s'il s'agit d'ami ou d'ennemi, dans ce monde effondré, chaotique, anarchique ? Comment savoir même si ceux que l'on croise sont encore humains, car on peut effectivement parfois en douter ? A Callista de savoir s'entourer et éviter les pièges et les mauvais coups pour arriver à ses fins : retrouver Emma. Et peut-être, comprendre.
Tout de suite, une première chose : entrer dans "La Mort du Temps", c'est prendre le risque de rester un moment scotché à son siège. Rarement on tombe sur des livres qui entrent aussi rapidement dans le vif du sujet que celui-là. Les 60 premières pages, dans ce monde violemment ébranlé par cet étrange phénomène, vous obligent à vous accrocher solidement à votre siège.
Wow, ça dépote, rien que d'y repenser, j'ai l'impression de retrouver ces tremblements, ces bruits, ce chaos... Comme Callista, on a quelques éléments, quelques pièces d'un puzzle dont on sent bien qu'il faudra le reconstituer, mais on est éberlué, perdu, paniqué... Que se passe-t-il, soudainement ? C'est incroyablement retranscris et transmis.
Et puis, une fois que tout se calme (provisoirement), on commence à voir transparaître certains des thèmes favoris d'Aurélie Wellenstein. Le plus évident, c'est la métamorphose, l'hybridation humain/animal. Eh oui, encore, j'en entends déjà certains qui râlent... Mais ce qu'elle imagine, ce côté contrefait, cauchemardesque, est tout à fait réussi.
A côté de cela, j'ai curieusement trouvé l'univers moins sombre, en tout cas dans la première moitié, les deux premiers tiers, même. Comment dire ? On est obnubilé par le phénomène, qui se manifeste aussi par une lumière qui brise le côté ténébreux de ce que fait d'habitude l'auteure. Mais, dans le final, on replonge dans quelque chose de très noir et inquiétant.
D'autres thèmes présents chez Aurélie Wellenstein, dans les romans qu'elle a publiés chez Scrineo, sont présents dans "la Mort du Temps", mais c'est un peu délicat d'en parler, au risque d'en dévoiler un peu trop sur l'histoire. Mais, il y a encore une fois un sentiment d'inconfort, de malaise, de doute, une manière d'évoquer l'adolescence et ses difficultés inhérentes qui sont très intéressantes.
Mais venons-en au thème central de ce roman : le temps. Un sujet qui revient souvent ces derniers temps, on peut penser au dernier tome en date des aventures de Jean-Philippe Lasser, le détective des dieux, au premier roman de Lou Jan, "Sale temps", mais aussi à "22/11/1963", dans lequel Stephen King fait du temps un monstre s'opposant à son personnage principal.
C'est même à ce dernier que j'ai pensé immédiatement : le temps comme monstre, comme méchant d'une histoire, ça me plaît ! On retrouve d'ailleurs dans les deux romans le côté sismique du temps en action, mais chez Aurélie Wellenstein, il est nettement plus violent. Et surtout, elle a une idée que j'ai trouvé absolument géniale.
Je vais essayer d'en parler sans trop en révéler, là encore. Mais j'ai adoré le côté compression à la César que produisent les soubresauts du temps dans le roman d'Aurélie Wellenstein. Ils concassent, écrabouillent, ils déforment et contrefont... Le résultat, sur les lieux comme sur les êtres, est tout à fait impressionnant.
J'ai trouvé très malin ce réveil du temps, espèce de Léviathan qui se cabre et se rebelle contre un ordre des choses, espèce de monstre souterrain venus des profondeurs tel un dragon endormi qu'on est venu sortir de son hibernation et qui fait savoir son mécontentement. Celui-là ne crache pas du feu, mais son côté broyeuse de casse automobile n'est guère plus rassurant...
Cela colle aussi parfaitement avec le titre du roman, car ce phénomène pourrait parfaitement ressembler aux convulsions d'agonie d'un monstre légendaire qui aurait été frappé par un chevalier, un saint Georges resurgi du fond des âges... Oh, ça alors, mais que vois-je sur la couverture (dit-il, avec un ton digne de la Comédie Française pour ménager son effet) ? Un bien curieux chevalier !
N'en disons pas plus. Pour le reste, Aurélie Wellenstein joue avec le temps de façon assez classique, des situations chères à la SF depuis Wells et sa machine à explorer le temps. Mais, n'oublions pas que c'est un roman qui s'adresse à de jeunes lecteurs, même si je trouve que son univers peut parfaitement plaire aux adultes. Et cette variation sur les questions temporelles est intéressante et efficace.
Et puis, il y a une référence un peu curieuse, a priori, qui m'est venu au fil des pages et des chapitres. Et si Callista était une Dorothy qu'un mystérieux phénomène avait emmené dans un pays d'Oz infernal, fracassé, apocalyptique ? Au fil de son odyssée vers les Vosges (décidément terre d'imaginaire de plus en plus affirmée, youpi !), les rencontres que fait Callista construisent une fière équipée.
Franchement, je suis à peu près sûr d'être le seul à faire ce lien. On n'est certainement pas dans une relecture du classique de Frank L. Baum, mais j'assume, je revendique ce parallèle, jusque dans le dénouement de cette histoire. Et j'ai trouvé ça drôlement bien, de bousculer les repères, de les maltraiter un peu et d'offrir un univers une nouvelle fois riche et surprenant au lecteur.
Un dernier mot, en forme de conseil. Il y a quelques jours, Aurélie Wellenstein était donc le coup de coeur des Imaginales, un salon que j'aime particulièrement, qui se déroule à Epinal et est devenu, en 15 ans, un des plus grands événements de France autour des littératures de l'imaginaire. Lorsqu'on est coup de coeur, on a le droit de passer sur le gril.
Un entretien en tête-à-tête avec Stéphanie Nicot, la directrice artistique de l'événement. Je n'ai pas pu assister à cette rencontre (mon planning de modérateur ne l'a pas permis), mais j'en ai eu quelques échos. Le site ActuSF enregistre les tables rondes des Imaginales puis les met en ligne. Celle d'Aurélie, je crois, ne s'y trouve pas encore.
Mais, lorsqu'elle s'y trouvera, je vous encourage à l'écouter, je suis certain qu'elle vous apportera des éclairages intéressants sur son travail d'écrivain et sur cet univers que j'apprécie particulièrement, aussi sombre qu'il est profond. "La Mort du Temps" prolonge son travail assez varié, de la fantasy à la science-fiction, avec un talent certain, un style toujours aussi fort et visuel et des atmosphères qui ne peuvent laisser indifférent.
EDIT : Et voilà, quelques jours après la parution de ce billet, la table ronde autour d'Aurélie Wellenstein a été mise en ligne par ActuSF : http://www.actusf.com/spip/Imaginales-2017-Le-coup-de-coeur.html
samedi 13 mai 2017
"Cette voiture n'a aucun secret pour nous ; elle est un fait scientifique".
Je n'ai pas de permis de conduire. Quelques heures de conduite (et la pédagogie rudimentaire d'un moniteur) ont suffi à me faire comprendre que je n'étais pas fait pour la conduite. Alors, les voitures, je les regarde passer et si je peux éviter de monter dedans, tant mieux. Mais, quand les livres parlent de voitures, ça m'intrigue, ça m'intéresse. Car, la relation de l'être humain à sa voiture est une source inépuisable pour l'imagination des écrivains, et particulièrement ceux qui oeuvrent dans les genres comme la SF ou le fantastique. Une nouvelle preuve avec "Suréquipée", court roman en forme de fable cruelle signé Grégoire Courtois. paru en grand format dans une maison montréalaise en 2015 et qui sort donc enfin en France en format de poche chez Folio. Un livre à la construction audacieuse, un peu déroutante, mais porté par une ironie mordante qui s'attaque aussi bien aux scientifiques et autres apprentis sorciers, aux constructeurs automobiles et à leurs stratégies commerciales, mais aussi aux automobilistes eux-mêmes. Courtois va loin, fait mouche et le lecteur rira certainement autant qu'il ressentira un certain malaise...
En 2093, le professeur Fransen a révolutionné l'automobile avec un prototype tout à fait extraordinaire : la Blackjag. Le mot prototype est important, car l'expérience, comme souvent avec les pionniers, n'a pas forcément débouché sur un succès commercial. En revanche, elle a ouvert la voie aux constructeurs qui se sont empressés de perfectionner le projet.
Oui, grâce à Fransen, l'automobile a changé et pris une nouvelle voie à la fin de ce XXIe siècle. Mais, huit ans après sa présentation officielle, la Blackjag est déjà un modèle dépassé, obsolète. Presque une voiture de collection. Et la première Blackjag, celle qui a servi aux présentations à la presse et dans les salons internationaux, est désormais à vendre.
Antoine s'en est porté acquéreur. Le jeune homme, époux et père, a voulu cette voiture, pensant qu'elle serait parfaite pour sa petite famille : sécurité, confort, performance et même lutte contre la pollution et le gaspillage. La Blackjag est la voiture idéale aux yeux d'Antoine et sa valeur symbolique renforce cette certitude.
Pourtant, peu de temps après, la Blackjag est renvoyée là où elle a été conçue et fabriquée. Doit-on parler d'atelier ou de laboratoire, c'est sans doute un peu des deux. La raison de ce retour au paddock ? Antoine a disparu... Et, pour essayer de comprendre ce qui a pu lui arriver, Fransen doit se plonger dans la mémoire de la voiture.
Car, oui, la Blackjag a de la mémoire. Mieux : elle est vivante !
Vous remarquerez que, pour une fois, je vous propose un résumé concis du livre. Avec toutes les options, euh, pardon, tous les éléments importants qui posent l'intrigue, mais rien de plus. Et pour cause, "Suréquipée" est un court roman, 160 pages dans cette édition Folio, et son auteur, Grégoire Courtois, ménage ses effets par un important travail narratif.
Ce que j'ai raconté en quelques paragraphes, de manière très linéaire, n'est pas du tout présenté ainsi dans le livre. Je me demande même si on ne va pas m'accuser de spoiler... Mais bon, j'assume, il faut bien présenter cette histoire et son coeur, c'est ça : la disparition du propriétaire d'une voiture révolutionnaire sur le plan technologique.
Les chapitres de "Suréquipée" sont très courts, présentées comme des enregistrements, on s'imagine quelque chose du genre boîte noire, mais c'est sans doute plus complexe que cela. L'auteur, lui, a choisi de brouiller les pistes en faisant alterner les chapitres qui relatent ce retour à l'atelier et les événements qui ont précédé.
Comme un puzzle, chaque pièce apporte son lot d'informations et, petit à petit, toute l'histoire prend forme. L'intrigue principale, bien sûr, mais aussi l'histoire de la Blackjag et le travail de Fransen. Un travail qui a aboutit à la construction de cette voiture comme les autres, mais qui doit désormais comprendre ce qui a pu se produire afin d'éviter de lourdes et coûteuses procédures d'assurance.
Et, s'il fallait une preuve que la Blackjag est bel et bien vivante, c'est elle qui est la narratrice du roman. Après tout, elle est la mieux placée pour cela, puisque c'est elle qui est au centre de l'histoire et c'est vers elle que tout converge. Une position de témoin privilégiée qui, en d'autres circonstances, ferait dire qu'il ne lui manque que la parole. Mais qui sait si, à sa manière, elle ne serait pas capable de s'exprimer ?
Vivante... C'est vrai que lorsqu'on dit cela, l'imagination se met en action : qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? On pense à "Christine", la Plymouth Fury 1958 au coeur du roman de Stephen King, jalouse et possessive (à laquelle Grégoire Courtois rend un hommage particulièrement tordu dans "Suréquipée"), mais ici, les choses sont différentes.
Je ne vais pas l'expliquer ici, pour la bonne et simple raison que c'est l'un des fils conducteurs de l'histoire : la conception de la Blackjag est l'un des points forts du livre, ce qui en fait, en grande partie aussi, un roman de SF, et ce qui est le socle de la fable macabre qui se joue sous nos yeux au fil des pages.
Alors, motus ! Mais, ce qu'on peut en dire, c'est que cette voiture révolutionnaire répond aux fameux critères évoquées plus haut : sécurité, confort, performance et même lutte contre la pollution et le gaspillage. Eh non, ce ne sont plus des éléments scientifiques, mais bien des thèmes à rapprocher d'un argumentaire commercial et publicitaire.
Fransen a appliqué la science au marketing pour répondre au mieux aux attentes des consommateurs. N'est-ce pas l'essence du capitalisme de créer des besoins pour y apporter ensuite les réponses les mieux adaptées ? Courtois s'amuse de cette industrie automobile qui cherche à fabriquer des véhicules toujours plus sûrs, toujours plus beaux, toujours plus confortables, toujours plus économiques...
De véritables maisons sur roues ! Des endroits où l'on puisse se sentir aussi bien que chez soi. Et si en plus, elles roulent toutes seules, alors, c'est encore mieux. Grégoire Courtois s'engouffre dans la voie ouverte par Google ou par Elon Musk, qui rêvent de voir un jour sur les routes évoluer des voitures sans conducteur...
"Suréquipée", comme beaucoup de romans de SF actuels, se penche sur la question des intelligences artificielles, en jouant avec cette thématique, en la détournant un peu des traditionnelles manières d'en parler. On tourne autour des thèmes classiques qui étaient, auparavant, dévolus aux machines, aux robots. Alors, oui ou non, une voiture peut-elle être vivante ?
Vivante, avec tout ce que ce mot implique. Et ça en implique, des choses ! Il suffit de nous regarder, nous, êtres humains, allez, élargissons, nous, animaux, mais aussi les plantes, les écosystèmes... Bref, tout ce qui fait que notre jolie planète bleue n'est pas un simple caillou tout vide, tout mort. Reste à savoir comment une voiture vivante peut alors trouver sa place.
Je dois dire que c'est sans doute ce qui m'a le plus amusé dans "Suréquipée" : la place donnée à la Blackjag. Là encore, il est délicat d'entrer dans les détails ici, il faut ménager les effets et les surprises qui émaillent le récit. Pour moi, c'est le coeur de la fable et de sa dimension férocement satirique : quelle place sommes-nous prêts à donner à notre voiture dans nos existences ?
En à peine plus d'un siècle (deux, si je me place à la même époque que celle du livre), la voiture est devenue un objet incontournable. Au point que, parfois, on a l'impression que ce sont nos existences qui tournent autour d'elle et non l'inverse... Grégoire Courtois pousse ce curseur-là à fond, et pour notre plus grand plaisir.
Ah, j'aimerais en dire plus, parce qu'un de ces aspects liés au comportement de l'être humain vis-à-vis de sa voiture serait très intéressant à développer, mais j'ai peur qu'en l'évoquant, je n'aille trop loin, alors, tant pis, restons en là et conseillons simplement au lecteur d'apprécier l'évolution de cette relation, loufoque, glauque, dérangeante et pleine de cynisme.
Cette fois, c'est à Ballard que l'on pense, et à son fameux "Crash !", qui fit scandale aussi bien lorsque le livre parut (on raconte qu'un éditeur, après lecture du manuscrit, déconseilla fortement la publication en ajoutant qu'il fallait envoyer l'auteur chez un psychiatre...) que lorsque son adaptation cinématographique par le non moins sulfureux David Cronenberg fut présenté à Cannes...
Il faut dire qu'il y est question d'une perversion pas banale : une addiction aux accidents de voiture débouchant sur une exacerbation du désir sexuel... Qu'en termes choisis ces choses-là sont dites... Bien ! Et, en écrivant ces lignes, j'ai une musique qui tourne en boucle dans ma tête, une chanson du groupe Queen, si vous voulez tout savoir... Mais vous ne saurez pas tout, na !
Comme King, Ballard est évoqué en quatrième de couverture, je ne vais pas chercher midi à quatorze heures, questions références, mais l'une comme l'autre, pour des raisons différentes, en lien avec des situations différentes, sont incontournables. Grégoire Courtois s'est certainement amusé à jouer avec ces codes particuliers pour rédiger son roman.
J'ai évoqué une fable, oui, sans doute, mais le mot satire est peut-être plus juste, car l'histoire ne se termine pas vraiment par une morale, mais plus par une pirouette qui parachève le travail. En tout cas, "Suréquipée" remet en perspective nos usages en matière d'automobile, notre relation à la voiture et sans doute aussi, notre comportement global dans ce domaine.
Et si l'on sourit et si l'on rit (mon mauvais esprit a adoré une scène en particulier, qu'on voit arriver gros comme une maison et j'ai ri, j'ai ri !), on se retrouve aussi fort mal à l'aise devant cette histoire qui transgresse pas mal de tabous et pose des questions éthiques bien plus sérieuses que ce qu'on pouvait penser au départ.
En 2093, le professeur Fransen a révolutionné l'automobile avec un prototype tout à fait extraordinaire : la Blackjag. Le mot prototype est important, car l'expérience, comme souvent avec les pionniers, n'a pas forcément débouché sur un succès commercial. En revanche, elle a ouvert la voie aux constructeurs qui se sont empressés de perfectionner le projet.
Oui, grâce à Fransen, l'automobile a changé et pris une nouvelle voie à la fin de ce XXIe siècle. Mais, huit ans après sa présentation officielle, la Blackjag est déjà un modèle dépassé, obsolète. Presque une voiture de collection. Et la première Blackjag, celle qui a servi aux présentations à la presse et dans les salons internationaux, est désormais à vendre.
Antoine s'en est porté acquéreur. Le jeune homme, époux et père, a voulu cette voiture, pensant qu'elle serait parfaite pour sa petite famille : sécurité, confort, performance et même lutte contre la pollution et le gaspillage. La Blackjag est la voiture idéale aux yeux d'Antoine et sa valeur symbolique renforce cette certitude.
Pourtant, peu de temps après, la Blackjag est renvoyée là où elle a été conçue et fabriquée. Doit-on parler d'atelier ou de laboratoire, c'est sans doute un peu des deux. La raison de ce retour au paddock ? Antoine a disparu... Et, pour essayer de comprendre ce qui a pu lui arriver, Fransen doit se plonger dans la mémoire de la voiture.
Car, oui, la Blackjag a de la mémoire. Mieux : elle est vivante !
Vous remarquerez que, pour une fois, je vous propose un résumé concis du livre. Avec toutes les options, euh, pardon, tous les éléments importants qui posent l'intrigue, mais rien de plus. Et pour cause, "Suréquipée" est un court roman, 160 pages dans cette édition Folio, et son auteur, Grégoire Courtois, ménage ses effets par un important travail narratif.
Ce que j'ai raconté en quelques paragraphes, de manière très linéaire, n'est pas du tout présenté ainsi dans le livre. Je me demande même si on ne va pas m'accuser de spoiler... Mais bon, j'assume, il faut bien présenter cette histoire et son coeur, c'est ça : la disparition du propriétaire d'une voiture révolutionnaire sur le plan technologique.
Les chapitres de "Suréquipée" sont très courts, présentées comme des enregistrements, on s'imagine quelque chose du genre boîte noire, mais c'est sans doute plus complexe que cela. L'auteur, lui, a choisi de brouiller les pistes en faisant alterner les chapitres qui relatent ce retour à l'atelier et les événements qui ont précédé.
Comme un puzzle, chaque pièce apporte son lot d'informations et, petit à petit, toute l'histoire prend forme. L'intrigue principale, bien sûr, mais aussi l'histoire de la Blackjag et le travail de Fransen. Un travail qui a aboutit à la construction de cette voiture comme les autres, mais qui doit désormais comprendre ce qui a pu se produire afin d'éviter de lourdes et coûteuses procédures d'assurance.
Et, s'il fallait une preuve que la Blackjag est bel et bien vivante, c'est elle qui est la narratrice du roman. Après tout, elle est la mieux placée pour cela, puisque c'est elle qui est au centre de l'histoire et c'est vers elle que tout converge. Une position de témoin privilégiée qui, en d'autres circonstances, ferait dire qu'il ne lui manque que la parole. Mais qui sait si, à sa manière, elle ne serait pas capable de s'exprimer ?
Vivante... C'est vrai que lorsqu'on dit cela, l'imagination se met en action : qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? On pense à "Christine", la Plymouth Fury 1958 au coeur du roman de Stephen King, jalouse et possessive (à laquelle Grégoire Courtois rend un hommage particulièrement tordu dans "Suréquipée"), mais ici, les choses sont différentes.
Je ne vais pas l'expliquer ici, pour la bonne et simple raison que c'est l'un des fils conducteurs de l'histoire : la conception de la Blackjag est l'un des points forts du livre, ce qui en fait, en grande partie aussi, un roman de SF, et ce qui est le socle de la fable macabre qui se joue sous nos yeux au fil des pages.
Alors, motus ! Mais, ce qu'on peut en dire, c'est que cette voiture révolutionnaire répond aux fameux critères évoquées plus haut : sécurité, confort, performance et même lutte contre la pollution et le gaspillage. Eh non, ce ne sont plus des éléments scientifiques, mais bien des thèmes à rapprocher d'un argumentaire commercial et publicitaire.
Fransen a appliqué la science au marketing pour répondre au mieux aux attentes des consommateurs. N'est-ce pas l'essence du capitalisme de créer des besoins pour y apporter ensuite les réponses les mieux adaptées ? Courtois s'amuse de cette industrie automobile qui cherche à fabriquer des véhicules toujours plus sûrs, toujours plus beaux, toujours plus confortables, toujours plus économiques...
De véritables maisons sur roues ! Des endroits où l'on puisse se sentir aussi bien que chez soi. Et si en plus, elles roulent toutes seules, alors, c'est encore mieux. Grégoire Courtois s'engouffre dans la voie ouverte par Google ou par Elon Musk, qui rêvent de voir un jour sur les routes évoluer des voitures sans conducteur...
"Suréquipée", comme beaucoup de romans de SF actuels, se penche sur la question des intelligences artificielles, en jouant avec cette thématique, en la détournant un peu des traditionnelles manières d'en parler. On tourne autour des thèmes classiques qui étaient, auparavant, dévolus aux machines, aux robots. Alors, oui ou non, une voiture peut-elle être vivante ?
Vivante, avec tout ce que ce mot implique. Et ça en implique, des choses ! Il suffit de nous regarder, nous, êtres humains, allez, élargissons, nous, animaux, mais aussi les plantes, les écosystèmes... Bref, tout ce qui fait que notre jolie planète bleue n'est pas un simple caillou tout vide, tout mort. Reste à savoir comment une voiture vivante peut alors trouver sa place.
Je dois dire que c'est sans doute ce qui m'a le plus amusé dans "Suréquipée" : la place donnée à la Blackjag. Là encore, il est délicat d'entrer dans les détails ici, il faut ménager les effets et les surprises qui émaillent le récit. Pour moi, c'est le coeur de la fable et de sa dimension férocement satirique : quelle place sommes-nous prêts à donner à notre voiture dans nos existences ?
En à peine plus d'un siècle (deux, si je me place à la même époque que celle du livre), la voiture est devenue un objet incontournable. Au point que, parfois, on a l'impression que ce sont nos existences qui tournent autour d'elle et non l'inverse... Grégoire Courtois pousse ce curseur-là à fond, et pour notre plus grand plaisir.
Ah, j'aimerais en dire plus, parce qu'un de ces aspects liés au comportement de l'être humain vis-à-vis de sa voiture serait très intéressant à développer, mais j'ai peur qu'en l'évoquant, je n'aille trop loin, alors, tant pis, restons en là et conseillons simplement au lecteur d'apprécier l'évolution de cette relation, loufoque, glauque, dérangeante et pleine de cynisme.
Cette fois, c'est à Ballard que l'on pense, et à son fameux "Crash !", qui fit scandale aussi bien lorsque le livre parut (on raconte qu'un éditeur, après lecture du manuscrit, déconseilla fortement la publication en ajoutant qu'il fallait envoyer l'auteur chez un psychiatre...) que lorsque son adaptation cinématographique par le non moins sulfureux David Cronenberg fut présenté à Cannes...
Il faut dire qu'il y est question d'une perversion pas banale : une addiction aux accidents de voiture débouchant sur une exacerbation du désir sexuel... Qu'en termes choisis ces choses-là sont dites... Bien ! Et, en écrivant ces lignes, j'ai une musique qui tourne en boucle dans ma tête, une chanson du groupe Queen, si vous voulez tout savoir... Mais vous ne saurez pas tout, na !
Comme King, Ballard est évoqué en quatrième de couverture, je ne vais pas chercher midi à quatorze heures, questions références, mais l'une comme l'autre, pour des raisons différentes, en lien avec des situations différentes, sont incontournables. Grégoire Courtois s'est certainement amusé à jouer avec ces codes particuliers pour rédiger son roman.
J'ai évoqué une fable, oui, sans doute, mais le mot satire est peut-être plus juste, car l'histoire ne se termine pas vraiment par une morale, mais plus par une pirouette qui parachève le travail. En tout cas, "Suréquipée" remet en perspective nos usages en matière d'automobile, notre relation à la voiture et sans doute aussi, notre comportement global dans ce domaine.
Et si l'on sourit et si l'on rit (mon mauvais esprit a adoré une scène en particulier, qu'on voit arriver gros comme une maison et j'ai ri, j'ai ri !), on se retrouve aussi fort mal à l'aise devant cette histoire qui transgresse pas mal de tabous et pose des questions éthiques bien plus sérieuses que ce qu'on pouvait penser au départ.
mercredi 10 mai 2017
"Entre une action prévisible et une action insensée, choisit la seconde. L'ennemi a prévu ce qui est prévisible. Il ne s'attend pas à ce que tu sois fou".
Bon, je ne suis pas certain, par les temps qui courent, qu'il faille faire de ce titre une règle de vie... Et, vu le contexte du roman, encore moins. Je suis, depuis longtemps, un amateur de politique fiction et d'anticipation, que ce soit en littérature, au cinéma et, de plus en plus, à la télévision, grâce à quelques séries marquantes. J'avais déjà évoqué sur ce blog les qualités de Jean-Marc Ligny pour nous transporter dans un futur proche... et un tantinet catastrophique... C'était avec l'imposant "Aqua™", autour de l'épineuse question de l'eau. Cette fois, c'est un roman qui, de par son contexte, est un thriller d'anticipation, mais qui se trouve en prise directe, hélas, avec notre actualité présente. Publié à l'origine en 1998 chez Denoël, "Jihad" (formidable titre qui va nous valoir d'être fiché et surveillé par tous les services du monde ou presque, merci, Jean-Marc Ligny !) vient d'être réédité dans une version "mise à jour par l'auteur" à l'Atalante. Dans un genre où brille les auteurs américains mais, plus rarement, les Français, voici un livre qui va à toute vitesse, sans temps mort et propose un univers qu'on pourrait qualifier de dystopie, flippant à souhait, surtout quand on a l'idée saugrenue de lire ce livre entre les deux tours d'une présidentielle aussi bizarre que celle qui vient de se dérouler...
Djamal Saadi a longtemps lutté dans la résistance kabyle avant de raccrocher pour aller travailler dans une exploitation pétrolière, à Hassi Messaoud. Il a renoncé à la lutte armée, devenue trop dangereuse, pour aller gagner de l'argent afin d'aider sa mère et sa soeur, restées dans leur village d'Aït-Idja.
En ce début de XXIe siècle, l'Algérie est devenue une dictature islamiste très violente, aux mains d'impitoyables factions qui multiplient les razzias dans les villages les plus reculés. Un jour, c'est justement Aït-Idja qui est dans le viseur. Une milice débarque en hélicoptère, bien décidée à ne faire aucun quartier.
Malgré la résistance courageuse de Fatima, la soeur de Djamal, une jeune femme libre qui essaye de se défaire des carcans multiples imposés aux femmes dans cette société théocratique et extrémiste, le village est rapidement balayé. Un vrai massacre qui aurait été suivi d'un pillage en règle sans l'irruption d'une kamikaze.
Mais, en dépit d'un départ précipité, les assaillants ne laissent derrière eux que des cadavres, dont la mère de Djamal. Quant à Fatima, sa rébellion a été punie par un viol sordide avant qu'on laisse son corps dévasté à même le sol... Une scène d'une violence inouïe qui n'a pas échappé à l'oeil attentif mais catastrophé d'un témoin, oublié par les meurtriers.
C'est lui qui va prévenir Djamal du drame auquel il a assisté de loin. C'est lui qui va apprendre au jeune homme que sa mère et sa soeur ont été assassinées, comme tous les autres habitants de son village. Mais, surtout, il lui donne une information qui va changer le destin de Djamal : à la tête des pillards, il y avait un homme blanc...
Renseignements pris, il s'agit d'un certain Max Tannart, un mercenaire français venu prodiguer quelques conseils à ses amis islamistes et mettre la main à la pâte en guise d'au revoir. En effet, après le massacre d'Aït-Idja, Tannart a quitté l'Algérie pour rentrer en France. Fini, le baroud, place à une mission plus tranquille, une retraite dorée, en quelque sorte.
Désormais, Tannart travaille dans l'ombre du pouvoir, en France. C'est le Parti National qui est au pouvoir et qui s'est empressé de mettre en place un régime poussant au maximum le concept d'identité nationale. La France est devenue en très peu de temps un pays soumis à un véritable apartheid. Les populations d'origine étrangère sont reléguées au bas de l'échelle sociale.
Et elles subissent des violences régulières, orchestrées par des milices institutionnalisées, comme le CAID, que dirige justement Max Tannart. A un fascisme répond un autre fascisme : la résistance s'est organisée autour des groupes islamistes qui recourent au terrorisme pour contester le pouvoir du Parti National. Situation sinistrement ironique, quand on connaît les activités récentes de Tannart...
Djamal s'en fout, de tout ça. Depuis qu'il a appris la mort de ses proches, et en particulier de Fatima, avec qui il entretenait une relation fusionnelle, ambiguë, presque, il n'a plus qu'une idée en tête : se venger. Faire payer à Tannart ce viol, ces crimes, et peu importe ce qu'il lui en coûtera. Débarrasser ce monde de l'ordure qu'est Tannart, voilà ce que sera l'objectif du jihad de Djamal.
On va donc suivre le jeune Kabyle dans sa quête, de Hassi Mesaoud à Paris. Pas une sinécure, mais un trajet semé d'embûches et de danger. Seul contre tous, peut-être, mais ayant aussi des alliés de circonstances, Djamal va faire des rencontres, certaines qui lui laisseront un goût amer ou qui l'obligeront à se défendre, d'autres, au contraire, qui lui fourniront un havre et la patience qui lui manque.
Je n'en dis pas plus sur l'histoire à proprement parler. Mais on peut parler de cet univers, ce monde qui est le nôtre et, pire encore, qui pourrait un jour véritablement être le nôtre. Des deux côtés de la Méditerranée, des pouvoirs d'une violence inouïe. Rappelons que "Jihad" a été publié une première fois en 1998, à une époque où imaginer l'Algérie tomber aux mains des religieux les plus radicaux était une sérieuse possibilité.
En revanche, côté français, l'idée de voir l'extrême droite arriver au pouvoir était alors une hypothèse des plus fumeuses. Et puis, il y a eu 2002. Et puis, il vient d'y avoir 2017... Et l'on se dit soudain que tout cela n'est peut-être plus si loin de nous, et c'est carrément effrayant... Ou comment, paradoxe terrifiant, la démocratie peut enfanter sa propre destruction...
On pourra toujours objecter que cette prise de pouvoir n'aboutirait pas forcément à ce que décrit Jean-Marc Ligny dans son livre. Certes, mais ce pourrait aussi tout à fait être le cas, certaines parties du programme du FN pouvant le laisser redouter. Quant à la violence, elle est déjà bien présente actuellement, la France a pris l'allure d'une poudrière et ce n'est pas le plus rassurant...
Ligny pousse le curseur à fond, mais c'est le jeu d'un thriller d'anticipation qui se teinte clairement de dystopie. On joue à se faire peur, ce qui est bien souvent le propre de la politique fiction, de l'anticipation et, évidemment, de la dystopie (pour ceux qui ont du mal avec ce mot, c'est le contraire de l'utopie), mais tout cela est terriblement plausible, surtout si l'on ne tire aucune leçon de ces dernières semaines...
A cette critique politique musclée, Ligny ajoute une vraie satire des médias, et c'est sans doute un des points sur lequel il a le plus insisté dans sa révision du roman. En effet, en 1998, l'information continue était encore embryonnaire en France, bien loin de ce que l'on connaît depuis quelques années (même si on peut se rappeler que le détournement d'un avion d'Air France en 1994 avait déjà permis d'en observer les prémices.
La chaîne qui est dans le collimateur de Jean-Marc Ligny, c'est BFM (on tire sur une ambulance ?), mais il est certain que ce pourrait tout à fait être une concurrente directe, une chaîne de télévision généraliste ou une radio nationale... Mais, il est vrai que BFM incarne les excès de l'information (quelle information ?) d'aujourd'hui.
En parallèle, on voit évoluer deux journalistes, Péritelle et Jack, duo qui consacre sa vie à l'information dans des conditions extrêmement difficiles. Parce que le pays est sens dessus dessous, en proie à des violences permanentes et qu'on peut se retrouver rapidement dans une situation qui dégénère sans rien pouvoir y faire.
Mais, l'autre versant de ces difficultés, c'est le fait de travailler dans un pays écrasé par la poigne de fer d'un pouvoir totalitaire qui a mis les grands médias à sa botte. Les mauvaises langues (mais le sont-elles tant que ça ?) diront qu'il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup menacer pour obtenir cette soumission... A voir.
L'indépendance des médias, questions très présentes dans notre société actuelle, est ici une illusion, un souvenir. Des journalistes comme Péritelle et Jack n'ont jamais la main sur le "final cut" de leurs reportages. S'ils chassent les scoops au péril de leurs vies parfois, ils le font souvent en sachant que leurs découvertes seront sabrées, enterrées ou remontées pour aller dans le sens du vent...
Ne restent alors que les médias en ligne, qui conservent tant bien que mal leur liberté de mouvement. Mais, les conditions, là encore, sont impossibles : on cherche à les faire taire sans cesse, on les brouille, on réduit la possibilité de les recevoir au maximum. Ce sont des médias clandestins et l'on risque de gros ennuis à frayer avec eux. Quant à gagner sa vie de cette façon, là, c'est de l'utopie...
J'insiste sur cet aspect parce que le rôle de Péritelle et de Jack s'installe au fil des chapitres pour devenir très important dans l'intrigue. Et parce que, à travers eux, se posent aussi la question de la défiance envers les médias, ceux qu'on appelaient "le quatrième pouvoir" et qui, désormais, sont regardés avec méfiance et désavoués par beaucoup, y compris par les ennemis politiques.
Je ne vais pas faire un cours de théologie sur le thème du Jihad, ses différentes acceptions, les différentes interprétations de ce mot. Je n'en ai pas les compétences. Pourtant, je trouve intéressant de m'y intéresser brièvement en espérant ne pas dire de bêtise. Aujourd'hui, ce mot fait peur et on le restreint souvent à la dimension que lui impose les radicaux et les terroristes.
Dans le contexte du roman, on retrouve évidemment cette vision-là, que ce soit dans les parties se déroulant an Algérie que lors du voyage de Djamal pour se rendre à Paris. Ligny le condamne d'ailleurs autant que le fascisme à la française et les renvoie dos à dos, leur préférant une troisième voie, dont j'ai choisi de ne pas parler dans ce billet, elle fait partie de ce qu'on doit découvrir au fil de la lecture.
Mais, le jihad est aussi un combat personnel, intime. Contre son orgueil, ses propres démons, là encore, il y a différentes interprétations... Djamal en instaure un autre, un combat personnel qu'ailleurs, on appellerait vendetta, par exemple. Le jihad de Djamal est d'ailleurs assez paradoxal, puisqu'il s'émancipe de toute dimension religieuse, sa foi ayant péri avec sa famille, mais se nourrit d'une détermination pleine d'inconscience.
Djamal, ce n'est pas Jason Bourne. Ce n'est pas un héros hollywoodien capable de résister au pouvoir qui veut l'écraser avec ses petits bras musclés et un arsenal inépuisable dont on se demande d'où il sort. On pourrait même dire que c'est un antihéros, un fou qui va défier une puissance qui lui serait naturellement hostile, avec les mains presque vides et aucun contact.
C'est un peu un des reproches à faire à l'intrigue : par moments, on se dit que c'est un peu trop facile, que Djamal progresse bien trop aisément et qu'il réussit tout ce qu'il entreprend de manière quasi surnaturelle. Bon, vous me direz, il faut qu'il y ait une histoire. Certes, mais, sans le transformer en Rambo, il pourrait y avoir un juste milieu.
Et puis, en préparant ce billet, en retrouvant cette phrase que j'ai placée en titre de ce billet, je suis tombé sur un élément qui pourrait justifier cela. Cette phrase, Djamal l'a reçue comme un enseignement de la part de celui qui a fait de lui un combattant. Or, à ces mots, il avait ajouté : "Guette le souffle de la baraka". Djamal surfe carrément sur cette baraka, mais gare à lui si son souffle cesse...
Ces remarques, qui en freineront certains, n'empêchent pas Jihad d'être mené tambour battant, porté par son lot de rebondissements. Certains, là encore, pourront être soumis à critique. Il y a quelques ficelles narratives, quelquefois un peu grosses, mais je comprends aussi la démarche de Jean-Marc Ligny et l'ensemble reste cohérent malgré tout, de mon point de vue.
Ce n'est donc pas un roman parfait, mais c'est un vrai thriller, bien foutu, bien rythmé, avec une galerie de personnages secondaires qui valent le coup d'oeil, même les plus accessoires (je pense aux habitants du squat dans lequel atterrit Djamal, par exemple, mais pas uniquement) Certains auraient pu être un peu plus creusés, voire un peu plus utilisés (mais c'est mon coeur d'artichaut qui parle...).
Indépendamment de l'intrigue, c'est cet univers très flippant, et encore plus parce qu'il est plausible, qui est intéressant. Les questions posées, j'en ai abordé certaines dans ce billet, font réfléchir et nous appellent à une vigilance de tous les instants contre tous les extrémismes. On ressent les engagements forts de Jean-Marc Ligny à travers ce livre et cela lui donne du punch.
Je n'avais pas lu la première mouture, sortie chez Denoël, puis en poche chez J'ai Lu, et il serait évidemment intéressant de regarder ce qui a évolué entre ces deux versions. Avis aux amateurs, aux bibliophiles fous qui auraient un exemplaire de la première mouture de "Jihad" dans leur bibliothèque. Pour les autres, ceux qui aiment jouer à se faire peur, à vous de jouer !
Djamal Saadi a longtemps lutté dans la résistance kabyle avant de raccrocher pour aller travailler dans une exploitation pétrolière, à Hassi Messaoud. Il a renoncé à la lutte armée, devenue trop dangereuse, pour aller gagner de l'argent afin d'aider sa mère et sa soeur, restées dans leur village d'Aït-Idja.
En ce début de XXIe siècle, l'Algérie est devenue une dictature islamiste très violente, aux mains d'impitoyables factions qui multiplient les razzias dans les villages les plus reculés. Un jour, c'est justement Aït-Idja qui est dans le viseur. Une milice débarque en hélicoptère, bien décidée à ne faire aucun quartier.
Malgré la résistance courageuse de Fatima, la soeur de Djamal, une jeune femme libre qui essaye de se défaire des carcans multiples imposés aux femmes dans cette société théocratique et extrémiste, le village est rapidement balayé. Un vrai massacre qui aurait été suivi d'un pillage en règle sans l'irruption d'une kamikaze.
Mais, en dépit d'un départ précipité, les assaillants ne laissent derrière eux que des cadavres, dont la mère de Djamal. Quant à Fatima, sa rébellion a été punie par un viol sordide avant qu'on laisse son corps dévasté à même le sol... Une scène d'une violence inouïe qui n'a pas échappé à l'oeil attentif mais catastrophé d'un témoin, oublié par les meurtriers.
C'est lui qui va prévenir Djamal du drame auquel il a assisté de loin. C'est lui qui va apprendre au jeune homme que sa mère et sa soeur ont été assassinées, comme tous les autres habitants de son village. Mais, surtout, il lui donne une information qui va changer le destin de Djamal : à la tête des pillards, il y avait un homme blanc...
Renseignements pris, il s'agit d'un certain Max Tannart, un mercenaire français venu prodiguer quelques conseils à ses amis islamistes et mettre la main à la pâte en guise d'au revoir. En effet, après le massacre d'Aït-Idja, Tannart a quitté l'Algérie pour rentrer en France. Fini, le baroud, place à une mission plus tranquille, une retraite dorée, en quelque sorte.
Désormais, Tannart travaille dans l'ombre du pouvoir, en France. C'est le Parti National qui est au pouvoir et qui s'est empressé de mettre en place un régime poussant au maximum le concept d'identité nationale. La France est devenue en très peu de temps un pays soumis à un véritable apartheid. Les populations d'origine étrangère sont reléguées au bas de l'échelle sociale.
Et elles subissent des violences régulières, orchestrées par des milices institutionnalisées, comme le CAID, que dirige justement Max Tannart. A un fascisme répond un autre fascisme : la résistance s'est organisée autour des groupes islamistes qui recourent au terrorisme pour contester le pouvoir du Parti National. Situation sinistrement ironique, quand on connaît les activités récentes de Tannart...
Djamal s'en fout, de tout ça. Depuis qu'il a appris la mort de ses proches, et en particulier de Fatima, avec qui il entretenait une relation fusionnelle, ambiguë, presque, il n'a plus qu'une idée en tête : se venger. Faire payer à Tannart ce viol, ces crimes, et peu importe ce qu'il lui en coûtera. Débarrasser ce monde de l'ordure qu'est Tannart, voilà ce que sera l'objectif du jihad de Djamal.
On va donc suivre le jeune Kabyle dans sa quête, de Hassi Mesaoud à Paris. Pas une sinécure, mais un trajet semé d'embûches et de danger. Seul contre tous, peut-être, mais ayant aussi des alliés de circonstances, Djamal va faire des rencontres, certaines qui lui laisseront un goût amer ou qui l'obligeront à se défendre, d'autres, au contraire, qui lui fourniront un havre et la patience qui lui manque.
Je n'en dis pas plus sur l'histoire à proprement parler. Mais on peut parler de cet univers, ce monde qui est le nôtre et, pire encore, qui pourrait un jour véritablement être le nôtre. Des deux côtés de la Méditerranée, des pouvoirs d'une violence inouïe. Rappelons que "Jihad" a été publié une première fois en 1998, à une époque où imaginer l'Algérie tomber aux mains des religieux les plus radicaux était une sérieuse possibilité.
En revanche, côté français, l'idée de voir l'extrême droite arriver au pouvoir était alors une hypothèse des plus fumeuses. Et puis, il y a eu 2002. Et puis, il vient d'y avoir 2017... Et l'on se dit soudain que tout cela n'est peut-être plus si loin de nous, et c'est carrément effrayant... Ou comment, paradoxe terrifiant, la démocratie peut enfanter sa propre destruction...
On pourra toujours objecter que cette prise de pouvoir n'aboutirait pas forcément à ce que décrit Jean-Marc Ligny dans son livre. Certes, mais ce pourrait aussi tout à fait être le cas, certaines parties du programme du FN pouvant le laisser redouter. Quant à la violence, elle est déjà bien présente actuellement, la France a pris l'allure d'une poudrière et ce n'est pas le plus rassurant...
Ligny pousse le curseur à fond, mais c'est le jeu d'un thriller d'anticipation qui se teinte clairement de dystopie. On joue à se faire peur, ce qui est bien souvent le propre de la politique fiction, de l'anticipation et, évidemment, de la dystopie (pour ceux qui ont du mal avec ce mot, c'est le contraire de l'utopie), mais tout cela est terriblement plausible, surtout si l'on ne tire aucune leçon de ces dernières semaines...
A cette critique politique musclée, Ligny ajoute une vraie satire des médias, et c'est sans doute un des points sur lequel il a le plus insisté dans sa révision du roman. En effet, en 1998, l'information continue était encore embryonnaire en France, bien loin de ce que l'on connaît depuis quelques années (même si on peut se rappeler que le détournement d'un avion d'Air France en 1994 avait déjà permis d'en observer les prémices.
La chaîne qui est dans le collimateur de Jean-Marc Ligny, c'est BFM (on tire sur une ambulance ?), mais il est certain que ce pourrait tout à fait être une concurrente directe, une chaîne de télévision généraliste ou une radio nationale... Mais, il est vrai que BFM incarne les excès de l'information (quelle information ?) d'aujourd'hui.
En parallèle, on voit évoluer deux journalistes, Péritelle et Jack, duo qui consacre sa vie à l'information dans des conditions extrêmement difficiles. Parce que le pays est sens dessus dessous, en proie à des violences permanentes et qu'on peut se retrouver rapidement dans une situation qui dégénère sans rien pouvoir y faire.
Mais, l'autre versant de ces difficultés, c'est le fait de travailler dans un pays écrasé par la poigne de fer d'un pouvoir totalitaire qui a mis les grands médias à sa botte. Les mauvaises langues (mais le sont-elles tant que ça ?) diront qu'il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup menacer pour obtenir cette soumission... A voir.
L'indépendance des médias, questions très présentes dans notre société actuelle, est ici une illusion, un souvenir. Des journalistes comme Péritelle et Jack n'ont jamais la main sur le "final cut" de leurs reportages. S'ils chassent les scoops au péril de leurs vies parfois, ils le font souvent en sachant que leurs découvertes seront sabrées, enterrées ou remontées pour aller dans le sens du vent...
Ne restent alors que les médias en ligne, qui conservent tant bien que mal leur liberté de mouvement. Mais, les conditions, là encore, sont impossibles : on cherche à les faire taire sans cesse, on les brouille, on réduit la possibilité de les recevoir au maximum. Ce sont des médias clandestins et l'on risque de gros ennuis à frayer avec eux. Quant à gagner sa vie de cette façon, là, c'est de l'utopie...
J'insiste sur cet aspect parce que le rôle de Péritelle et de Jack s'installe au fil des chapitres pour devenir très important dans l'intrigue. Et parce que, à travers eux, se posent aussi la question de la défiance envers les médias, ceux qu'on appelaient "le quatrième pouvoir" et qui, désormais, sont regardés avec méfiance et désavoués par beaucoup, y compris par les ennemis politiques.
Je ne vais pas faire un cours de théologie sur le thème du Jihad, ses différentes acceptions, les différentes interprétations de ce mot. Je n'en ai pas les compétences. Pourtant, je trouve intéressant de m'y intéresser brièvement en espérant ne pas dire de bêtise. Aujourd'hui, ce mot fait peur et on le restreint souvent à la dimension que lui impose les radicaux et les terroristes.
Dans le contexte du roman, on retrouve évidemment cette vision-là, que ce soit dans les parties se déroulant an Algérie que lors du voyage de Djamal pour se rendre à Paris. Ligny le condamne d'ailleurs autant que le fascisme à la française et les renvoie dos à dos, leur préférant une troisième voie, dont j'ai choisi de ne pas parler dans ce billet, elle fait partie de ce qu'on doit découvrir au fil de la lecture.
Mais, le jihad est aussi un combat personnel, intime. Contre son orgueil, ses propres démons, là encore, il y a différentes interprétations... Djamal en instaure un autre, un combat personnel qu'ailleurs, on appellerait vendetta, par exemple. Le jihad de Djamal est d'ailleurs assez paradoxal, puisqu'il s'émancipe de toute dimension religieuse, sa foi ayant péri avec sa famille, mais se nourrit d'une détermination pleine d'inconscience.
Djamal, ce n'est pas Jason Bourne. Ce n'est pas un héros hollywoodien capable de résister au pouvoir qui veut l'écraser avec ses petits bras musclés et un arsenal inépuisable dont on se demande d'où il sort. On pourrait même dire que c'est un antihéros, un fou qui va défier une puissance qui lui serait naturellement hostile, avec les mains presque vides et aucun contact.
C'est un peu un des reproches à faire à l'intrigue : par moments, on se dit que c'est un peu trop facile, que Djamal progresse bien trop aisément et qu'il réussit tout ce qu'il entreprend de manière quasi surnaturelle. Bon, vous me direz, il faut qu'il y ait une histoire. Certes, mais, sans le transformer en Rambo, il pourrait y avoir un juste milieu.
Et puis, en préparant ce billet, en retrouvant cette phrase que j'ai placée en titre de ce billet, je suis tombé sur un élément qui pourrait justifier cela. Cette phrase, Djamal l'a reçue comme un enseignement de la part de celui qui a fait de lui un combattant. Or, à ces mots, il avait ajouté : "Guette le souffle de la baraka". Djamal surfe carrément sur cette baraka, mais gare à lui si son souffle cesse...
Ces remarques, qui en freineront certains, n'empêchent pas Jihad d'être mené tambour battant, porté par son lot de rebondissements. Certains, là encore, pourront être soumis à critique. Il y a quelques ficelles narratives, quelquefois un peu grosses, mais je comprends aussi la démarche de Jean-Marc Ligny et l'ensemble reste cohérent malgré tout, de mon point de vue.
Ce n'est donc pas un roman parfait, mais c'est un vrai thriller, bien foutu, bien rythmé, avec une galerie de personnages secondaires qui valent le coup d'oeil, même les plus accessoires (je pense aux habitants du squat dans lequel atterrit Djamal, par exemple, mais pas uniquement) Certains auraient pu être un peu plus creusés, voire un peu plus utilisés (mais c'est mon coeur d'artichaut qui parle...).
Indépendamment de l'intrigue, c'est cet univers très flippant, et encore plus parce qu'il est plausible, qui est intéressant. Les questions posées, j'en ai abordé certaines dans ce billet, font réfléchir et nous appellent à une vigilance de tous les instants contre tous les extrémismes. On ressent les engagements forts de Jean-Marc Ligny à travers ce livre et cela lui donne du punch.
Je n'avais pas lu la première mouture, sortie chez Denoël, puis en poche chez J'ai Lu, et il serait évidemment intéressant de regarder ce qui a évolué entre ces deux versions. Avis aux amateurs, aux bibliophiles fous qui auraient un exemplaire de la première mouture de "Jihad" dans leur bibliothèque. Pour les autres, ceux qui aiment jouer à se faire peur, à vous de jouer !
lundi 8 mai 2017
"L'Amérique est un pays moderne et civilisé qui ne peut s'accommoder de ces pratiques rétrogrades (...) S'ils veulent être reconnus comme de bons Américains, les mormons doivent rentrer dans le rang. Et s'ils ne le font pas d'eux-mêmes, nous les y forceront".
Oh, rassurez-vous, j'assume parfaitement le côté très provocateur de ce titre. Mais, vous le verrez, il colle parfaitement à notre livre du jour une fois remis dans son contexte. Un contexte bien particulier, puisque nous allons remonter dans le temps, à la fin du XIXe siècle, pour une histoire qui marie fiction et événements réels. Et la fiction prend la forme d'un genre qu'il est toujours sympa de retrouver : le western. Avec "les Captives de la vallée de Zion" (en grand format aux éditions Héloïse d'Ormesson), Norman Ginzberg retrouve les deux personnages principaux de son premier roman, "Arizona Tom", le shérif Ocean Miller et le jeune Tom, personnage inquiétant et ambigu qui a grandi mais demeure assez insaisissable. Autour d'eux, un festival de gueules tout droit sorties d'un western spaghetti, et du plomb, beaucoup de plomb. Un roman hanté par la Guerre de Sécession dans un pays qui essaye, tant bien que mal, de se construire et d'établir des règles communes. Mais qui pose aussi les bases de ce que sera l'Amérique des XXe et XXIe siècles, une puissance prête à tout pour imposer ses vues...
Quelques années ont passé depuis les événements racontés dans "Arizona Tom". Tom, justement, a grandi et est devenu un adulte au corps solide et au mystère entier. Sourd et muet, il a développé un réel talent pour le dessin mais reste, Ocean Miller en a conscience, un véritable danger pour qui se dresse en travers de son chemin. Un garçon dénué de tout état d'âme.
Ocean Miller, lui, a vieilli et il le sait. Il n'a jamais été le shérif le plus courageux de l'ouest. Il n'est ni Wyatt Earp, ni Will Kane, ni John T. Chance. Aussi, quand des puissants ont commencé à lui chercher des noises dans l'Arizona, il s'est dit qu'un changement d'air ne lui ferait pas de mal. L'occasion s'est présenté et voilà le shérif Miller dans l'Utah.
A ses côtés, Tom, bien sûr, qui est devenu son fils adoptif, mais aussi quelques hommes qui lui sont restés fidèles : Hank Wendling, son second, un gars fiable et costaud, Jonathan Rockwell, un cow-boy qui a fait ses preuves contre les voleurs de bétail, et Abner Drinkwater, le mal nommé, poivrot et trouillard, mais tout le monde a ses petits défauts...
Bref, ce ne sont pas les Sept Mercenaires, loin de là. Et pourtant, ils ont suivi Ocean Miller lorsqu'il a décidé de répondre à l'appel du shérif John Faraday, en poste à Saint George, dans l'Utah. Entre Miller et Faraday, la relation remonte à la Guerre de Sécession. Mais, on ne parlera pas d'amitié entre eux, oh non. Ca fait même 20 ans qu'ils ne se sont plus vus.
Seulement, la solde proposée est bonne et le boulot ne semble pas insurmontable : il s'agit de faire appliquer la loi qui, depuis quelques années déjà, interdit la polygamie sur le sol américain. En cette année 1888, le répression envers les mormons, en particulier, s'est accélérée. On traque les maris ayant plusieurs épouses, on les arrête, on les condamne à de lourdes peines...
Ce n'est pas que ça réjouisse particulièrement Ocean Miller, mais la polygamie ne rentre pas franchement dans ses valeurs morales, heureusement supérieures à celle de Faraday, grosse brute profitant de son étoile et de son autorité pour se comporter en véritable seigneur et maître sur son territoire.
Et, s'il fait appel à des renforts, c'est pour de bonnes raisons (de son point de vue, en tout cas) : les mormons on gagné les montagnes, plus difficiles d'accès pour les autorités, et il faut aller les déloger. Or, il semblerait que la résistance soit plus forte que prévue. Et qu'on risque sa peau à aller du côté de cette vallée de Zion. Faraday a déjà donné, il préfère déléguer.
Il compte sur Miller pour prendre la tête d'une troupe capable d'aller mettre un terme aux agissements contre-nature des mormons. Un groupe de moins de trente personnes, en comptant les alliés de Miller, et tous à peu près du même niveau. Autrement dit, certainement pas une troupe d'élite. Mais le pompon, c'est quand Faraday décide de le flanquer de deux adjoints, sans lui laisser le choix.
Le premier, c'est un serpent, un fourbe, le propre adjoint de Faraday, Al Van Doorne, un type dangereux à qui Miller se dit qu'il ne doit pas falloir tourner le dos. Une animosité réciproque qui s'est manifestée dès leur rencontre. Miller n'a aucun doute : Van Doorne est là, au mieux, pour le surveiller, au pire, pour lui compliquer la tâche.
Et puis, son autre adjoint, c'est... une femme ! Julia Wibaux, une éleveuse, elle-même ancienne membre de l'église mormonne. Un sacré caractère, certes, mais une femme ! Miller doit avaler cette couleuvre, tandis qu'il fait la connaissance de sa nouvelle adjointe, qui n'est pas sans rappeler une certaine Calamity Jane. Entre le shérif et elle, l'ambiance devient rapidement électrique...
Miller ne décide de rien, serre les dents (et sans doute autre chose) et doit se lancer dans cette campagne avec cette équipe qu'il sent moyennement... Pourtant, au début, tout se passe plutôt bien, une première famille polygame est mise aux arrêts sans souci. Mais, rapidement, la situation part gentiment en vrille et échappe complètement à Ocean...
Non, décidément, la campagne de la vallée de Zion ne sera pas de tout repos...
La première chose, c'est un point d'histoire : en 1882, le Congrès des Etats-Unis vote la loi Edmunds qui interdit la polygamie dans le pays. Ce texte menace de fortes amende et même de peines de prison allant jusqu'à 5 ans les contrevenants. Et, dans le collimateur, évidemment, les mormons... Pourtant, ça ne suffit pas, alors, le Législateur frappe encore plus fort.
En 1887, un an avant l'histoire racontée dans le roman de Norman Ginzberg, est promulguée la loi Edmunds-Tucker qui, cette fois, affiche clairement la couleur : l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, nom officiel de l'église mormonne, est ouvertement menacée de dissolution si ses fidèles ne renoncent pas à la polygamie.
Une mesure qui s'accompagne de la confiscation des biens appartenant à l'église. Et d'une pression renforcée des US Marshalls, mandatés pour appliquer ces lois. Au point que, en 1890, les mormons renonceront officiellement à cette pratique pour ne pas être écrasés sous la botte brutale d'un Etat fédéral plus remonté que jamais.
Au premier abord, on peut se dire que cette mesure est logique, souhaitable, que la polygamie, c'est une forme d'asservissement pour les femmes, etc. C'est d'ailleurs dans ce sens que les deux textes ci-dessus ont été présentés. Oui, mais... N'y aurait-il pas d'autres motivations moins avouables à cette campagne de chasse aux polygames ?
L'Utah est un territoire américain depuis 1848. Mais l'église mormonne, qui a façonné cet Etat, renâcle à accepter de devenir un Etat fédéré. A Washington, on redoute une nouvelle sécession et la création d'un Utah indépendant et théocratique. Impossible, inacceptable, avec un risque de contagion non négligeable, car les mormons savent se montrer convaincants...
En fait, on est bien face à une lutte de pouvoir, un bras de faire entre le pouvoir fédéral et l'église mormonne, qui aboutira donc au rejet de la polygamie en 1890 et à l'entrée de l'Utah dans la fédération en 1896. Pour cela, il aura fallu quelques expéditions (j'emploie le mot à dessein) pour faire revenir à la raison les Mormons. Y compris, donc, par la force...
Mais "les Captives de la vallée de Zion" est aussi un roman qui plonge ses racines dans la très sombre période de la guerre civile américaine, la Guerre de Sécession. Un quart de siècle a passé, mais les plaies ne sont pas refermées, loin de là. A l'image de la relation assez bizarre entre Miller et Faraday, mais vous le découvrirez par vous-mêmes.
Sans cesse, on en revient à cet événement, que de nombreux personnages ont vécu, jamais sans que ça laisse des traces, physiques ou morales. Et on pourrait tenir le même discours pour ce pays, immense et difficilement contrôlable, qui demeure morcelé, travaillé par des haines tenaces, des haines géographiques, entre nord et sud, des haines raciales, des haines religieuses, également.
Oui, on a un western sous la main et un livre qui est un excellent divertissement, mais cela n'empêche pas d'aborder des questions graves, des questions autour de ce qui est l'ADN de l'Amérique. Un pays où le meilleur moyen d'arriver à ses fins est la loi du plus fort, qu'il s'agisse de question de voisinage, de politique locale, domestique ou étrangère. On flingue d'abord, on discute après.
Ne voyez pas dans ces mots un antiaméricanisme primaire, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture de ce roman de Norman Ginzberg. Cet Américain vit en France, dans le Sud-Ouest, cong !, depuis longtemps maintenant, il écrit d'ailleurs en français, et le regard qu'il porte sur son pays natal est pour le moins critique. Un pays qui reste fondamentalement un pays de cow-boys...
Mais ne soyons pas non plus trop sérieux. Comme je l'ai dit en introduction, "les Captives de la vallée de Zion" est un véritable western spaghetti, je suis certain que Sergio Leone aurait adoré faire le casting des sales tronches que l'on croise d'un bout à l'autre du roman. Oui, ils sont tous affreux et sales, et bien souvent méchants, et c'est un bonheur de suivre cette horde moyennement sauvage.
Je remonte jusqu'à Sergio Leone, mais, plus proche de nous, Quentin Tarantino, fervent admirateur du premier nommé, a lui aussi utilisé ces procédés, ces castings soignés et le recours aux "gueules" pour faire du western, "les Captives de la vallée de Zion" sont bien dans cette lignée. Et en plus, on y défouraille sec, ce qui colle bien aussi au cinéma de Mr. Quentin.
Au milieu de tout cela, il y a Julia... Ah, Julia... L'idée de mettre face-à-face un homme et une femme que tout oppose est classique, mais c'est vrai qu'ici, ça prend des proportions assez intéressantes, puisque le prudent (c'est un euphémisme) Ocean doit faire avec sa va-t-en-guerre d'adjointe. Une tête brûlée, déterminée à venir en aide à ses soeurs, à ces femmes mormonnes bien mal embarquées.
Elle aussi contribue au côté décalé de son roman, par sa très forte personnalité, son courage, qui frôle l'inconscience parfois, mais aussi parce qu'elle est femme au milieu de tous ces hommes. Calamity Jane, oui, sans doute, par certains côtés, mais en jupes, toujours, même en plein milieu des déserts montagneux de l'Utah. Et que personne ne s'avise de lui faire une remarque !
Allez, un dernier point avant de clore ce billet : lorsque j'ai vu que ce roman parlait des Mormons et à la mise hors la loi de la polygamie, j'ai pensé à la série "Big Love". Comme ça, sans plus... Avant de remarquer que je n'étais pas le seul à avoir fait le lien. Norman Ginzberg aussi, j'ai l'impression. Amusez-vous à rechercher les clins d'oeil et ayez une pensée pour Bill Paxton, récemment disparu.
Je me suis bien amusé avec ce livre, à la fois parce que j'aime bien les westerns, y compris lorsque qu'ils s'accompagnent de spaghettis, mais aussi parce que c'est enlevé, à la fois violent et drôle, une drôlerie féroce, même. Dommage que Tom soit un peu trop en retrait, mais ça, c'est la remarque d'un lecteur ayant lu "Arizona Tom" et rien ne dit qu'on ne le retrouvera pas un de ces quatre.
Un bémol à tout cela, tout de même, et, curieusement, je crois me souvenir que j'avais émis exactement le même pour "Arizona Tom" : il y a un souci dans la construction du roman, un enchaînement qui se fait mal pour entrer dans la dernière partie du livre. En fait, on manque d'explications pour comprendre un événement-clé du livre concernant Ocean Miller.
En soit, rien de choquant a priori, au contraire, on a un twist très sympa (enfin, parce qu'on est lecteur et pas le personnage), mais, alors qu'on se dit qu'on nous expliquera le comment (le pourquoi, ça, ça va), ça n'arrive jamais et on se retrouve avec une espèce de Deus (enfin de diabolus) ex-machina qui laisse un peu sur sa faim.
Ces explications auraient mérité d'être explicitées, même a posteriori, mais proposer une version très elliptique de cette épisode ne me semble pas être la meilleure des idées. Bon, j'ai raccroché les wagons mais il m'a manqué ce petit truc pour que tout s'enchaîne au mieux. Après, ce qui arrive à Ocean Miller, ce sera à chacun de se faire son idée.
Le final, et particulièrement l'épilogue, peut sembler un peu étrange, mais je l'ai lu et relu et il est finalement assez cohérent et plein de cynisme. Comme si tout avait changé, mais seulement en apparence. La preuve, encore une fois, que l'être humain est décidément indécrottable et foncièrement immoral. Et que business is business (autre gène dominant de l'Amérique)...
Quelques années ont passé depuis les événements racontés dans "Arizona Tom". Tom, justement, a grandi et est devenu un adulte au corps solide et au mystère entier. Sourd et muet, il a développé un réel talent pour le dessin mais reste, Ocean Miller en a conscience, un véritable danger pour qui se dresse en travers de son chemin. Un garçon dénué de tout état d'âme.
Ocean Miller, lui, a vieilli et il le sait. Il n'a jamais été le shérif le plus courageux de l'ouest. Il n'est ni Wyatt Earp, ni Will Kane, ni John T. Chance. Aussi, quand des puissants ont commencé à lui chercher des noises dans l'Arizona, il s'est dit qu'un changement d'air ne lui ferait pas de mal. L'occasion s'est présenté et voilà le shérif Miller dans l'Utah.
A ses côtés, Tom, bien sûr, qui est devenu son fils adoptif, mais aussi quelques hommes qui lui sont restés fidèles : Hank Wendling, son second, un gars fiable et costaud, Jonathan Rockwell, un cow-boy qui a fait ses preuves contre les voleurs de bétail, et Abner Drinkwater, le mal nommé, poivrot et trouillard, mais tout le monde a ses petits défauts...
Bref, ce ne sont pas les Sept Mercenaires, loin de là. Et pourtant, ils ont suivi Ocean Miller lorsqu'il a décidé de répondre à l'appel du shérif John Faraday, en poste à Saint George, dans l'Utah. Entre Miller et Faraday, la relation remonte à la Guerre de Sécession. Mais, on ne parlera pas d'amitié entre eux, oh non. Ca fait même 20 ans qu'ils ne se sont plus vus.
Seulement, la solde proposée est bonne et le boulot ne semble pas insurmontable : il s'agit de faire appliquer la loi qui, depuis quelques années déjà, interdit la polygamie sur le sol américain. En cette année 1888, le répression envers les mormons, en particulier, s'est accélérée. On traque les maris ayant plusieurs épouses, on les arrête, on les condamne à de lourdes peines...
Ce n'est pas que ça réjouisse particulièrement Ocean Miller, mais la polygamie ne rentre pas franchement dans ses valeurs morales, heureusement supérieures à celle de Faraday, grosse brute profitant de son étoile et de son autorité pour se comporter en véritable seigneur et maître sur son territoire.
Et, s'il fait appel à des renforts, c'est pour de bonnes raisons (de son point de vue, en tout cas) : les mormons on gagné les montagnes, plus difficiles d'accès pour les autorités, et il faut aller les déloger. Or, il semblerait que la résistance soit plus forte que prévue. Et qu'on risque sa peau à aller du côté de cette vallée de Zion. Faraday a déjà donné, il préfère déléguer.
Il compte sur Miller pour prendre la tête d'une troupe capable d'aller mettre un terme aux agissements contre-nature des mormons. Un groupe de moins de trente personnes, en comptant les alliés de Miller, et tous à peu près du même niveau. Autrement dit, certainement pas une troupe d'élite. Mais le pompon, c'est quand Faraday décide de le flanquer de deux adjoints, sans lui laisser le choix.
Le premier, c'est un serpent, un fourbe, le propre adjoint de Faraday, Al Van Doorne, un type dangereux à qui Miller se dit qu'il ne doit pas falloir tourner le dos. Une animosité réciproque qui s'est manifestée dès leur rencontre. Miller n'a aucun doute : Van Doorne est là, au mieux, pour le surveiller, au pire, pour lui compliquer la tâche.
Et puis, son autre adjoint, c'est... une femme ! Julia Wibaux, une éleveuse, elle-même ancienne membre de l'église mormonne. Un sacré caractère, certes, mais une femme ! Miller doit avaler cette couleuvre, tandis qu'il fait la connaissance de sa nouvelle adjointe, qui n'est pas sans rappeler une certaine Calamity Jane. Entre le shérif et elle, l'ambiance devient rapidement électrique...
Miller ne décide de rien, serre les dents (et sans doute autre chose) et doit se lancer dans cette campagne avec cette équipe qu'il sent moyennement... Pourtant, au début, tout se passe plutôt bien, une première famille polygame est mise aux arrêts sans souci. Mais, rapidement, la situation part gentiment en vrille et échappe complètement à Ocean...
Non, décidément, la campagne de la vallée de Zion ne sera pas de tout repos...
La première chose, c'est un point d'histoire : en 1882, le Congrès des Etats-Unis vote la loi Edmunds qui interdit la polygamie dans le pays. Ce texte menace de fortes amende et même de peines de prison allant jusqu'à 5 ans les contrevenants. Et, dans le collimateur, évidemment, les mormons... Pourtant, ça ne suffit pas, alors, le Législateur frappe encore plus fort.
En 1887, un an avant l'histoire racontée dans le roman de Norman Ginzberg, est promulguée la loi Edmunds-Tucker qui, cette fois, affiche clairement la couleur : l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, nom officiel de l'église mormonne, est ouvertement menacée de dissolution si ses fidèles ne renoncent pas à la polygamie.
Une mesure qui s'accompagne de la confiscation des biens appartenant à l'église. Et d'une pression renforcée des US Marshalls, mandatés pour appliquer ces lois. Au point que, en 1890, les mormons renonceront officiellement à cette pratique pour ne pas être écrasés sous la botte brutale d'un Etat fédéral plus remonté que jamais.
Au premier abord, on peut se dire que cette mesure est logique, souhaitable, que la polygamie, c'est une forme d'asservissement pour les femmes, etc. C'est d'ailleurs dans ce sens que les deux textes ci-dessus ont été présentés. Oui, mais... N'y aurait-il pas d'autres motivations moins avouables à cette campagne de chasse aux polygames ?
L'Utah est un territoire américain depuis 1848. Mais l'église mormonne, qui a façonné cet Etat, renâcle à accepter de devenir un Etat fédéré. A Washington, on redoute une nouvelle sécession et la création d'un Utah indépendant et théocratique. Impossible, inacceptable, avec un risque de contagion non négligeable, car les mormons savent se montrer convaincants...
En fait, on est bien face à une lutte de pouvoir, un bras de faire entre le pouvoir fédéral et l'église mormonne, qui aboutira donc au rejet de la polygamie en 1890 et à l'entrée de l'Utah dans la fédération en 1896. Pour cela, il aura fallu quelques expéditions (j'emploie le mot à dessein) pour faire revenir à la raison les Mormons. Y compris, donc, par la force...
Mais "les Captives de la vallée de Zion" est aussi un roman qui plonge ses racines dans la très sombre période de la guerre civile américaine, la Guerre de Sécession. Un quart de siècle a passé, mais les plaies ne sont pas refermées, loin de là. A l'image de la relation assez bizarre entre Miller et Faraday, mais vous le découvrirez par vous-mêmes.
Sans cesse, on en revient à cet événement, que de nombreux personnages ont vécu, jamais sans que ça laisse des traces, physiques ou morales. Et on pourrait tenir le même discours pour ce pays, immense et difficilement contrôlable, qui demeure morcelé, travaillé par des haines tenaces, des haines géographiques, entre nord et sud, des haines raciales, des haines religieuses, également.
Oui, on a un western sous la main et un livre qui est un excellent divertissement, mais cela n'empêche pas d'aborder des questions graves, des questions autour de ce qui est l'ADN de l'Amérique. Un pays où le meilleur moyen d'arriver à ses fins est la loi du plus fort, qu'il s'agisse de question de voisinage, de politique locale, domestique ou étrangère. On flingue d'abord, on discute après.
Ne voyez pas dans ces mots un antiaméricanisme primaire, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture de ce roman de Norman Ginzberg. Cet Américain vit en France, dans le Sud-Ouest, cong !, depuis longtemps maintenant, il écrit d'ailleurs en français, et le regard qu'il porte sur son pays natal est pour le moins critique. Un pays qui reste fondamentalement un pays de cow-boys...
Mais ne soyons pas non plus trop sérieux. Comme je l'ai dit en introduction, "les Captives de la vallée de Zion" est un véritable western spaghetti, je suis certain que Sergio Leone aurait adoré faire le casting des sales tronches que l'on croise d'un bout à l'autre du roman. Oui, ils sont tous affreux et sales, et bien souvent méchants, et c'est un bonheur de suivre cette horde moyennement sauvage.
Je remonte jusqu'à Sergio Leone, mais, plus proche de nous, Quentin Tarantino, fervent admirateur du premier nommé, a lui aussi utilisé ces procédés, ces castings soignés et le recours aux "gueules" pour faire du western, "les Captives de la vallée de Zion" sont bien dans cette lignée. Et en plus, on y défouraille sec, ce qui colle bien aussi au cinéma de Mr. Quentin.
Au milieu de tout cela, il y a Julia... Ah, Julia... L'idée de mettre face-à-face un homme et une femme que tout oppose est classique, mais c'est vrai qu'ici, ça prend des proportions assez intéressantes, puisque le prudent (c'est un euphémisme) Ocean doit faire avec sa va-t-en-guerre d'adjointe. Une tête brûlée, déterminée à venir en aide à ses soeurs, à ces femmes mormonnes bien mal embarquées.
Elle aussi contribue au côté décalé de son roman, par sa très forte personnalité, son courage, qui frôle l'inconscience parfois, mais aussi parce qu'elle est femme au milieu de tous ces hommes. Calamity Jane, oui, sans doute, par certains côtés, mais en jupes, toujours, même en plein milieu des déserts montagneux de l'Utah. Et que personne ne s'avise de lui faire une remarque !
Allez, un dernier point avant de clore ce billet : lorsque j'ai vu que ce roman parlait des Mormons et à la mise hors la loi de la polygamie, j'ai pensé à la série "Big Love". Comme ça, sans plus... Avant de remarquer que je n'étais pas le seul à avoir fait le lien. Norman Ginzberg aussi, j'ai l'impression. Amusez-vous à rechercher les clins d'oeil et ayez une pensée pour Bill Paxton, récemment disparu.
Je me suis bien amusé avec ce livre, à la fois parce que j'aime bien les westerns, y compris lorsque qu'ils s'accompagnent de spaghettis, mais aussi parce que c'est enlevé, à la fois violent et drôle, une drôlerie féroce, même. Dommage que Tom soit un peu trop en retrait, mais ça, c'est la remarque d'un lecteur ayant lu "Arizona Tom" et rien ne dit qu'on ne le retrouvera pas un de ces quatre.
Un bémol à tout cela, tout de même, et, curieusement, je crois me souvenir que j'avais émis exactement le même pour "Arizona Tom" : il y a un souci dans la construction du roman, un enchaînement qui se fait mal pour entrer dans la dernière partie du livre. En fait, on manque d'explications pour comprendre un événement-clé du livre concernant Ocean Miller.
En soit, rien de choquant a priori, au contraire, on a un twist très sympa (enfin, parce qu'on est lecteur et pas le personnage), mais, alors qu'on se dit qu'on nous expliquera le comment (le pourquoi, ça, ça va), ça n'arrive jamais et on se retrouve avec une espèce de Deus (enfin de diabolus) ex-machina qui laisse un peu sur sa faim.
Ces explications auraient mérité d'être explicitées, même a posteriori, mais proposer une version très elliptique de cette épisode ne me semble pas être la meilleure des idées. Bon, j'ai raccroché les wagons mais il m'a manqué ce petit truc pour que tout s'enchaîne au mieux. Après, ce qui arrive à Ocean Miller, ce sera à chacun de se faire son idée.
Le final, et particulièrement l'épilogue, peut sembler un peu étrange, mais je l'ai lu et relu et il est finalement assez cohérent et plein de cynisme. Comme si tout avait changé, mais seulement en apparence. La preuve, encore une fois, que l'être humain est décidément indécrottable et foncièrement immoral. Et que business is business (autre gène dominant de l'Amérique)...
samedi 6 mai 2017
"Toute femme est l'architecte de son propre destin".
L'imaginaire... Il peut prendre bien des formes et aboutir à des livres très différents. Mais, ici, c'est aussi à la source, au stimulus qui met en action l'imagination d'un auteur pour aboutir à une histoire envoûtante, troublante, tragique... En fait, notre roman du jour est un tout : une idée formidable, un lieu qui parle à notre imaginaire collectif, une époque dure mais peut-être pas si différente de la nôtre, à la réflexion, des personnages certainement imparfaits mais auxquels on s'attache pourtant, et un soupçon de mystère... Quelques lignes à peine, et vous devez sentir le plaisir que j'ai à parler de ce roman. Oh, je ne suis pas le premier, je me joins aux nombreux lecteurs qui l'ont aimé avant moi, puisque j'ai attendu sa sortie poche pour le lire, le dévorer. Premier roman plus que prometteur, "Miniaturiste", de Jessie Burton (désormais disponible chez Folio, traduction de Dominique Letellier), est un roman historique aux allures de tableau flamand, abordant la question de la condition féminine au XVIIe siècle, alors que les Provinces-Unies (les actuels Pays-Bas) sont une République des plus prospères... Fascinant !
En cette mi-octobre 1686, Nella n'a que 18 ans quand elle arrive à Amsterdam. Elle a quitté sa maison natale, dans une région plus rurale des Provinces-Unies, pour rejoindre la plus grande ville de la République. Jeune mariée, elle rejoint son époux, Johannes Brandt, qui a plus de deux fois son âge et est l'un des plus riches marchands amstellodamois.
Johannes a fait fortune, comme beaucoup de Hollandais à cette époque, en naviguant sur toutes les mers du monde pour rapporter au pays des produits introuvables sous nos latitudes, épices, sucres, étoffes particulières... En prenant de l'âge, il est moins souvent absent, mais il consacre toujours l'essentiel de son temps à son métier, en étant au service de la VOC, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales.
D'ailleurs, quand Nella débarque, si j'ose dire, dans la grande maison de Johannes, située dans la fameuse "Courbure d'or", sur le canal du Herengracht, un des lieux les plus prisés de la ville, Johannes n'est pas là pour l'accueillir. A sa place, Nella découvre une femme d'une grande austérité et bien peu amène : Marin, la soeur de Johannes.
Vivent également là Cornelia, une orpheline qui a su se sortir de cette terrible condition pour devenir la servante des Brandt, et Otto, ancien esclave racheté par Johannes lors d'une expédition en Afrique, homme à tout faire dont la peau noire ne passe pas inaperçue le long des canaux d'Amsterdam. C'est parmi eux que Nella va devoir trouver sa place.
Encore bien naïve, malgré un caractère affirmé, elle doit faire avec un mari absent le plus clair du temps et avec une belle-soeur qui se conduit comme la véritable maîtresse de maison. Marin est l'incarnation du puritanisme calviniste, d'une sévérité morale sans faille et d'une rectitude qui confine à la rigidité.
Malgré ses efforts, Nella sent vite que la tâche s'annonce herculéenne (pour ne pas évoquer un autre personnage mythologique, Sisyphe, tant chaque minuscule avancée semble se solder par une reculade immédiate). Son nouvel époux ne s'intéresse guère à elle, en fait, il ne semble s'intéresser qu'à son travail, et Marin la considère avec hauteur et dédain...
Et puis, quelques semaines après son arrivée, Johannes fait enfin un geste envers Nella. Sans doute pas celui qu'elle attendait, c'est vrai, mais ce n'est pas rien. C'est un cadeau. Un très beau cadeau. Comprenez : un cadeau très cher. Un cadeau qui n'est pas dénué d'ambiguïté aussi : la prendrait-il encore pour une petite fille qu'elle n'est plus ?
En effet, ce cadeau, c'est une magnifique maison de poupée. Un jouet, oui, peut-être, mais bien plus que cela aussi, tant sa facture est soignée. Et, plus encore, parce que cette maison de poupée reproduit en fait la propre maison des Brandt, celle où Nella vient d'emménager récemment. Sa maison, désormais, quoi qu'en pense Marin, et malgré toutes ses difficultés à y trouver sa place.
Marin s'étrangle devant ce cadeau. Sa religion proscrit les reproductions religieuses uniquement, mais cet objet heurte ses convictions. Et peut-être se sent-elle ainsi dépossédée, remise à sa place, ou tout du moins, au même niveau de cette Nella qu'elle méprise. Mais, pour cette dernière, c'est le jardin secret qu'elle attendait, l'opportunité de desserrer le carcan, d'avoir quelque chose à elle...
Aussitôt, elle décide de la meubler. Mais, elle ne connaît pas Amsterdam, à qui s'adresser ? Elle va trouver la réponse dans la "Liste de Smit", un recueil de références, ancêtre de nos pages jaunes, si je puis faire un raccourci. Au milieu des commerçants et des artisans, Nella découvre l'existence d'un miniaturiste auquel elle décide aussitôt de s'adresser.
Bientôt, les premières pièces arrivent. Elles sont magnifiques, les meubles comme les personnages sont d'une minutie remarquable, un travail de première qualité. Mais, ces pièces sont aussi terriblement troublantes. Et vont l'être de plus en plus, au fur et à mesure des livraisons... Au point d'effrayer Nella...
Je n'en dis pas plus, il faut conserver le mystère de cette histoire absolument étonnante. On se lance dans ce livre en s'attendant à un roman historique classique pour découvrir peu à peu une véritable tragédie à l'antique. Mais, ne mettons pas la charrue avant les boeufs, commençons, si vous le voulez bien, par le début, et le début, c'est ceci :
La fameuse maison de poupée de Petronella Oortman, qui est exposée dans l'un des plus célèbres musées au monde : le Rijksmuseum, à Amsterdam. Le voilà, le point de départ, le stimulus qui a mis le feu à l'imagination de Jessie Burton ! Alors comédienne, la jeune femme qui n'a pas encore 30 ans, découvre cette maison de poupée lors d'une visite du musée, en 2009.
Et c'est parti pour une incroyable aventure littéraire, un manuscrit que se disputent près d'une quinzaine de maisons d'édition britannique, plus de 400 000 exemplaires vendus outre-Manche, des traductions dans plus d'une trentaine de langues... N'en jetez plus ! Avec "Miniaturiste", Jessie Burton a frappé fort, redonnant vie à Petronella Oortman, devenue Nella dans le livre.
Soyons bien clair, "Miniaturiste" est une pure fiction, qui imagine a vie des habitants de cette maison. Il ne s'agit pas de romancer un témoignage, une biographie de Petronella Oortman. Mais simplement de partir de cette maison de poupée, construite pour elle, meublée par elle puis transmise de génération en génération, pour raconter la vie d'une riche famille dans le siècle d'or hollandais.
Voilà, le décor est planté et le talent de Jessie Burton, c'est justement avant tout le reste de redonner vie à une époque, à une ville, à une société. On se retrouve vraiment plongés dans Amsterdam à la fin du XVIIe, au coeur d'une société tout à fait paradoxale, écartelée entre la richesse immense produite par la VOC et son puritanisme, son austérité calviniste.
"Miniaturiste", c'est une fresque historique parce qu'il y a ce décor qui est plus qu'un décor, en fait. Cette ville est une actrice-clé du roman, car c'est elle qui impose son mode de vie aux personnages : religion, j'en ai déjà parlé, classes sociales et opulence, mais aussi la condition féminine, qui est l'un des sujets centraux du livre, à travers Nella, bien sûr, mais aussi Marin et même Cornelia.
Nella au premier chef, bien sûr, puisqu'elle est le moteur et le détonateur de cette histoire. Parce que l'on croit qu'avec son mariage, auquel elle n'a pu se dérober, elle a signé pour un destin dont elle n'aura jamais le contrôle, puisqu'elle sera entièrement soumise à cet époux qui décide de tout. Oui, mais, chez les Brandt, tout cela va devenir bien plus compliqué.
Et, malgré les difficultés, les épreuves, les drames, aussi, qui vont bouleverser l'existence de cette riche famille, Nella va avoir l'opportunité de reprendre la main, de devenir maîtresse d'elle-même et de son sort. A quel prix ? Face à quelles avanies ? Ah, oui, ce ne sera pas facile du tout, mais, en quelques mois, la jeune et candide Nella va mûrir brusquement pour devenir adulte et éclairée.
D'ailleurs, on aimerait aller au-delà de la fin du livre, même s'il est ainsi parfaitement cohérent. On voudrait que la saga familiale nous soit contée, qu'on voit évoluer les Brandt pendant bien plus longtemps pour constater son évolution. Et plus particulièrement voir ce que Nella va devenir, quelle femme elle sera dans un univers patriarcal aussi solide.
Elle a un exemple parfait sous les yeux, d'ailleurs : Marin, à sa façon, a brisé les codes, refusé les conventions sociales dictées par les hommes pour les hommes. Exemple, contre-exemple... Chacun se fera son idée, mais sous ses airs revêches, Marin est un formidable personnage qu'on croirait sorti d'un roman de Hawthorne ou des soeurs Brontë.
A cela, il faut ajouter, évidemment ce qu'on appelle le siècle d'or hollandais (on le notera, parallèle au siècle d'or français, alors que, en cette même époque, Français et Hollandais se sont souvent fait la guerre, des guerres à forte connotation religieuse, puisque Louis XIV vient de révoquer l'édit de Nantes), l'essor du commerce maritime, mais aussi ses corollaires moins glorieux, comme l'esclavage.
Voilà pour le contexte. Mais, "Miniaturiste", c'est, j'ai présenté ainsi ce livre plus haut, une vraie tragédie à l'antique : le destin va s'emmêler pour venir bousculer la prospère famille Brandt. Nella va découvrir petit à petit tous les secrets qui se cachent dans cette maison, la vraie, pas sa reproduction, et les conséquences de ces révélations vont frapper toute la maisonnée.
Oui, il y a vraiment ce côté antique, ces personnages aux prises avec une existence qu'ils ne maîtrisent plus, qu'on leur dicte malgré eux, et des aléas forcément douloureux qu'il va falloir surmonter, ou bien périr... La fresque historique est bien là, mais elle prend vite une tournure qu'on n'attendait pas vraiment.
Amsterdam est l'unité de lieu, certes un peu plus vaste qu'une traditionnelle scène de théâtre ; l'unité de temps, elle aussi, est plutôt respectée car, alors qu'on imagine une saga familiale sur des années, voire des générations, on découvre une intrigue ramassé en quelques mois à peine, pour ne pas dire quelques semaines ; enfin, l'unité d'action, c'est cette famille aux allures presque carcérales dans laquelle Nella a atterri.
Et puis, il y a ce mystère, que j'évoque depuis le début ou presque. Je tourne autour sans m'y arrêter. Ce mystère, c'est la formidable mise en abyme que crée Jessie Burton entre l'auteure qu'elle est, ses personnages et ceux de la maison de poupée. Je n'entrerai pas dans le détail, évidemment, il faut vous laisser découvrir cela par vous-même.
Mais, il y a quelque chose d'absolument génial et qui rejoint, d'une certaine façon, tout ce que l'on vient d'évoquer jusqu'ici, l'impression que l'on joue à la poupée, que Jessie Burton manipule ses personnages exactement comme Nella le fait de ses miniatures. Exactement comme Petronella le fit, lorsqu'elle meubla sa propre maison de poupée.
Oh, je sais que ça semble peu clair expliqué ainsi, mais je suis certain que, ceux qui ont déjà lu "Miniaturiste" voient parfaitement ce que je veux dire. Le travail narratif de Jessie Burton est d'autant plus impressionnant qu'elle n'avait encore jamais publié. Sa maîtrise est stupéfiante et son travail absolument remarquable, parce qu'elle sait créer une atmosphère oppressante et la rendre plus étouffante encore de manière très simple.
J'ai adoré ce côté étrange, on pourrait presque dire fantastique, d'ailleurs, en tout cas, on est à la limite de basculer dans ce genre-là. C'est une vraie réussite et une formidable trouvaille qui apporte un vrai plus à un roman qui avait déjà tout pour être remarqué. Mais, cette idée-là, c'est ce qui lui permet de passer dans la catégorie supérieure, celle des romans qui vous marquent longtemps.
Un dernier mot, parce qu'on ne peut évoquer un livre dont l'idée est née au Rijksmuseum sans parler peinture. Certes, Rembrandt et Vermeer sont déjà morts depuis des années lorsque débute l'action de "Miniaturiste", mais Jessie Burton a, pour moi, saisi ce qu'il y a dans cette peinture baroque flamande pour donner de la couleur et de la matière à son roman.
La maison et ses clairs-obscurs, qui font écho directement aux zones d'ombre des différents personnages, rappellent directement le travail de Rembrandt, qui aurait parfaitement pu représenter cette maison de poupée, voire carrément, la maison des Brandt. Mais Vermeer aurait parfaitement pu peindre Cornelia ou Marin, Johannes dans sa splendeur... Un monde un peu trop parfait, en trompe-l'oeil, en parfait accord avec ce que découvre Nella à son arrivée...
Mon billet, lui, n'est pas miniature, comme vous le voyez. L'enthousiasme fait courir les doigts sur le clavier... Au fil des pages, je me suis pris à regretter que Stanley Kubrick ne puisse plus porter son regard sur "Miniaturiste" et en réaliser une adaptation. Il y aura certainement une adaptation, ce roman la vaut largement, mais quelle âme, quel souffle le réalisateur de "Barry Lyndon" aurait pu y apporter !
Je ne suis encore jamais allé à Amsterdam, autrement qu'à travers la lecture ou des reportages, des films. Si j'ai un jour la chance d'y aller, la visite du Rijksmuseum sera une étape obligatoire. Et je suis certain que, au milieu de tous les chefs-d'oeuvre qu'on peut y voir, je ferai une longue pause devant la maison de poupée de Petronella Oortman. En espérant y entendre la voix de Nella.
Et y apercevoir la main du Miniaturiste...
En cette mi-octobre 1686, Nella n'a que 18 ans quand elle arrive à Amsterdam. Elle a quitté sa maison natale, dans une région plus rurale des Provinces-Unies, pour rejoindre la plus grande ville de la République. Jeune mariée, elle rejoint son époux, Johannes Brandt, qui a plus de deux fois son âge et est l'un des plus riches marchands amstellodamois.
Johannes a fait fortune, comme beaucoup de Hollandais à cette époque, en naviguant sur toutes les mers du monde pour rapporter au pays des produits introuvables sous nos latitudes, épices, sucres, étoffes particulières... En prenant de l'âge, il est moins souvent absent, mais il consacre toujours l'essentiel de son temps à son métier, en étant au service de la VOC, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales.
D'ailleurs, quand Nella débarque, si j'ose dire, dans la grande maison de Johannes, située dans la fameuse "Courbure d'or", sur le canal du Herengracht, un des lieux les plus prisés de la ville, Johannes n'est pas là pour l'accueillir. A sa place, Nella découvre une femme d'une grande austérité et bien peu amène : Marin, la soeur de Johannes.
Vivent également là Cornelia, une orpheline qui a su se sortir de cette terrible condition pour devenir la servante des Brandt, et Otto, ancien esclave racheté par Johannes lors d'une expédition en Afrique, homme à tout faire dont la peau noire ne passe pas inaperçue le long des canaux d'Amsterdam. C'est parmi eux que Nella va devoir trouver sa place.
Encore bien naïve, malgré un caractère affirmé, elle doit faire avec un mari absent le plus clair du temps et avec une belle-soeur qui se conduit comme la véritable maîtresse de maison. Marin est l'incarnation du puritanisme calviniste, d'une sévérité morale sans faille et d'une rectitude qui confine à la rigidité.
Malgré ses efforts, Nella sent vite que la tâche s'annonce herculéenne (pour ne pas évoquer un autre personnage mythologique, Sisyphe, tant chaque minuscule avancée semble se solder par une reculade immédiate). Son nouvel époux ne s'intéresse guère à elle, en fait, il ne semble s'intéresser qu'à son travail, et Marin la considère avec hauteur et dédain...
Et puis, quelques semaines après son arrivée, Johannes fait enfin un geste envers Nella. Sans doute pas celui qu'elle attendait, c'est vrai, mais ce n'est pas rien. C'est un cadeau. Un très beau cadeau. Comprenez : un cadeau très cher. Un cadeau qui n'est pas dénué d'ambiguïté aussi : la prendrait-il encore pour une petite fille qu'elle n'est plus ?
En effet, ce cadeau, c'est une magnifique maison de poupée. Un jouet, oui, peut-être, mais bien plus que cela aussi, tant sa facture est soignée. Et, plus encore, parce que cette maison de poupée reproduit en fait la propre maison des Brandt, celle où Nella vient d'emménager récemment. Sa maison, désormais, quoi qu'en pense Marin, et malgré toutes ses difficultés à y trouver sa place.
Marin s'étrangle devant ce cadeau. Sa religion proscrit les reproductions religieuses uniquement, mais cet objet heurte ses convictions. Et peut-être se sent-elle ainsi dépossédée, remise à sa place, ou tout du moins, au même niveau de cette Nella qu'elle méprise. Mais, pour cette dernière, c'est le jardin secret qu'elle attendait, l'opportunité de desserrer le carcan, d'avoir quelque chose à elle...
Aussitôt, elle décide de la meubler. Mais, elle ne connaît pas Amsterdam, à qui s'adresser ? Elle va trouver la réponse dans la "Liste de Smit", un recueil de références, ancêtre de nos pages jaunes, si je puis faire un raccourci. Au milieu des commerçants et des artisans, Nella découvre l'existence d'un miniaturiste auquel elle décide aussitôt de s'adresser.
Bientôt, les premières pièces arrivent. Elles sont magnifiques, les meubles comme les personnages sont d'une minutie remarquable, un travail de première qualité. Mais, ces pièces sont aussi terriblement troublantes. Et vont l'être de plus en plus, au fur et à mesure des livraisons... Au point d'effrayer Nella...
Je n'en dis pas plus, il faut conserver le mystère de cette histoire absolument étonnante. On se lance dans ce livre en s'attendant à un roman historique classique pour découvrir peu à peu une véritable tragédie à l'antique. Mais, ne mettons pas la charrue avant les boeufs, commençons, si vous le voulez bien, par le début, et le début, c'est ceci :
La fameuse maison de poupée de Petronella Oortman, qui est exposée dans l'un des plus célèbres musées au monde : le Rijksmuseum, à Amsterdam. Le voilà, le point de départ, le stimulus qui a mis le feu à l'imagination de Jessie Burton ! Alors comédienne, la jeune femme qui n'a pas encore 30 ans, découvre cette maison de poupée lors d'une visite du musée, en 2009.
Et c'est parti pour une incroyable aventure littéraire, un manuscrit que se disputent près d'une quinzaine de maisons d'édition britannique, plus de 400 000 exemplaires vendus outre-Manche, des traductions dans plus d'une trentaine de langues... N'en jetez plus ! Avec "Miniaturiste", Jessie Burton a frappé fort, redonnant vie à Petronella Oortman, devenue Nella dans le livre.
Soyons bien clair, "Miniaturiste" est une pure fiction, qui imagine a vie des habitants de cette maison. Il ne s'agit pas de romancer un témoignage, une biographie de Petronella Oortman. Mais simplement de partir de cette maison de poupée, construite pour elle, meublée par elle puis transmise de génération en génération, pour raconter la vie d'une riche famille dans le siècle d'or hollandais.
Voilà, le décor est planté et le talent de Jessie Burton, c'est justement avant tout le reste de redonner vie à une époque, à une ville, à une société. On se retrouve vraiment plongés dans Amsterdam à la fin du XVIIe, au coeur d'une société tout à fait paradoxale, écartelée entre la richesse immense produite par la VOC et son puritanisme, son austérité calviniste.
"Miniaturiste", c'est une fresque historique parce qu'il y a ce décor qui est plus qu'un décor, en fait. Cette ville est une actrice-clé du roman, car c'est elle qui impose son mode de vie aux personnages : religion, j'en ai déjà parlé, classes sociales et opulence, mais aussi la condition féminine, qui est l'un des sujets centraux du livre, à travers Nella, bien sûr, mais aussi Marin et même Cornelia.
Nella au premier chef, bien sûr, puisqu'elle est le moteur et le détonateur de cette histoire. Parce que l'on croit qu'avec son mariage, auquel elle n'a pu se dérober, elle a signé pour un destin dont elle n'aura jamais le contrôle, puisqu'elle sera entièrement soumise à cet époux qui décide de tout. Oui, mais, chez les Brandt, tout cela va devenir bien plus compliqué.
Et, malgré les difficultés, les épreuves, les drames, aussi, qui vont bouleverser l'existence de cette riche famille, Nella va avoir l'opportunité de reprendre la main, de devenir maîtresse d'elle-même et de son sort. A quel prix ? Face à quelles avanies ? Ah, oui, ce ne sera pas facile du tout, mais, en quelques mois, la jeune et candide Nella va mûrir brusquement pour devenir adulte et éclairée.
D'ailleurs, on aimerait aller au-delà de la fin du livre, même s'il est ainsi parfaitement cohérent. On voudrait que la saga familiale nous soit contée, qu'on voit évoluer les Brandt pendant bien plus longtemps pour constater son évolution. Et plus particulièrement voir ce que Nella va devenir, quelle femme elle sera dans un univers patriarcal aussi solide.
Elle a un exemple parfait sous les yeux, d'ailleurs : Marin, à sa façon, a brisé les codes, refusé les conventions sociales dictées par les hommes pour les hommes. Exemple, contre-exemple... Chacun se fera son idée, mais sous ses airs revêches, Marin est un formidable personnage qu'on croirait sorti d'un roman de Hawthorne ou des soeurs Brontë.
A cela, il faut ajouter, évidemment ce qu'on appelle le siècle d'or hollandais (on le notera, parallèle au siècle d'or français, alors que, en cette même époque, Français et Hollandais se sont souvent fait la guerre, des guerres à forte connotation religieuse, puisque Louis XIV vient de révoquer l'édit de Nantes), l'essor du commerce maritime, mais aussi ses corollaires moins glorieux, comme l'esclavage.
Voilà pour le contexte. Mais, "Miniaturiste", c'est, j'ai présenté ainsi ce livre plus haut, une vraie tragédie à l'antique : le destin va s'emmêler pour venir bousculer la prospère famille Brandt. Nella va découvrir petit à petit tous les secrets qui se cachent dans cette maison, la vraie, pas sa reproduction, et les conséquences de ces révélations vont frapper toute la maisonnée.
Oui, il y a vraiment ce côté antique, ces personnages aux prises avec une existence qu'ils ne maîtrisent plus, qu'on leur dicte malgré eux, et des aléas forcément douloureux qu'il va falloir surmonter, ou bien périr... La fresque historique est bien là, mais elle prend vite une tournure qu'on n'attendait pas vraiment.
Amsterdam est l'unité de lieu, certes un peu plus vaste qu'une traditionnelle scène de théâtre ; l'unité de temps, elle aussi, est plutôt respectée car, alors qu'on imagine une saga familiale sur des années, voire des générations, on découvre une intrigue ramassé en quelques mois à peine, pour ne pas dire quelques semaines ; enfin, l'unité d'action, c'est cette famille aux allures presque carcérales dans laquelle Nella a atterri.
Et puis, il y a ce mystère, que j'évoque depuis le début ou presque. Je tourne autour sans m'y arrêter. Ce mystère, c'est la formidable mise en abyme que crée Jessie Burton entre l'auteure qu'elle est, ses personnages et ceux de la maison de poupée. Je n'entrerai pas dans le détail, évidemment, il faut vous laisser découvrir cela par vous-même.
Mais, il y a quelque chose d'absolument génial et qui rejoint, d'une certaine façon, tout ce que l'on vient d'évoquer jusqu'ici, l'impression que l'on joue à la poupée, que Jessie Burton manipule ses personnages exactement comme Nella le fait de ses miniatures. Exactement comme Petronella le fit, lorsqu'elle meubla sa propre maison de poupée.
Oh, je sais que ça semble peu clair expliqué ainsi, mais je suis certain que, ceux qui ont déjà lu "Miniaturiste" voient parfaitement ce que je veux dire. Le travail narratif de Jessie Burton est d'autant plus impressionnant qu'elle n'avait encore jamais publié. Sa maîtrise est stupéfiante et son travail absolument remarquable, parce qu'elle sait créer une atmosphère oppressante et la rendre plus étouffante encore de manière très simple.
J'ai adoré ce côté étrange, on pourrait presque dire fantastique, d'ailleurs, en tout cas, on est à la limite de basculer dans ce genre-là. C'est une vraie réussite et une formidable trouvaille qui apporte un vrai plus à un roman qui avait déjà tout pour être remarqué. Mais, cette idée-là, c'est ce qui lui permet de passer dans la catégorie supérieure, celle des romans qui vous marquent longtemps.
Un dernier mot, parce qu'on ne peut évoquer un livre dont l'idée est née au Rijksmuseum sans parler peinture. Certes, Rembrandt et Vermeer sont déjà morts depuis des années lorsque débute l'action de "Miniaturiste", mais Jessie Burton a, pour moi, saisi ce qu'il y a dans cette peinture baroque flamande pour donner de la couleur et de la matière à son roman.
La maison et ses clairs-obscurs, qui font écho directement aux zones d'ombre des différents personnages, rappellent directement le travail de Rembrandt, qui aurait parfaitement pu représenter cette maison de poupée, voire carrément, la maison des Brandt. Mais Vermeer aurait parfaitement pu peindre Cornelia ou Marin, Johannes dans sa splendeur... Un monde un peu trop parfait, en trompe-l'oeil, en parfait accord avec ce que découvre Nella à son arrivée...
Mon billet, lui, n'est pas miniature, comme vous le voyez. L'enthousiasme fait courir les doigts sur le clavier... Au fil des pages, je me suis pris à regretter que Stanley Kubrick ne puisse plus porter son regard sur "Miniaturiste" et en réaliser une adaptation. Il y aura certainement une adaptation, ce roman la vaut largement, mais quelle âme, quel souffle le réalisateur de "Barry Lyndon" aurait pu y apporter !
Je ne suis encore jamais allé à Amsterdam, autrement qu'à travers la lecture ou des reportages, des films. Si j'ai un jour la chance d'y aller, la visite du Rijksmuseum sera une étape obligatoire. Et je suis certain que, au milieu de tous les chefs-d'oeuvre qu'on peut y voir, je ferai une longue pause devant la maison de poupée de Petronella Oortman. En espérant y entendre la voix de Nella.
Et y apercevoir la main du Miniaturiste...
"Amsterdam, la Courbure d'or dans le Herengracht", tableau de Gerrit Berckheyde, autre peintre du Siècle d'or hollandais.
vendredi 5 mai 2017
"Dans la vie, rien n'est jamais plus beau que les accidents".
On pourrait croire cette citation pleine de cynisme, au mieux d'une douce ironie, mais je crois que, concernant notre livre du jour, il faut la prendre simplement, au premier degré. Mais, que de chemin à parcourir avant de parvenir à ce constat, que de douleurs subies ! Et combien de personnes réussissent-elles à surmonter les aléas de l'existence pour en faire un bonheur et non un malheur ? Delphine Bertholon a fait de ces accidents de la vie le socle de son travail de romancière et elle le démontre une nouvelle fois avec "Coeur-naufrage" (en grand format aux éditions Jean-Claude Lattès). Encore une fois, la famille, ses relations souvent compliquées et ses vilains petits secrets, est au centre de ce roman plein de mélancolie et de tendresse, mais surtout d'espoir. L'espoir de ne pas passer à côté de son existence et de la vivre pleinement.
Lyla (avec un y) a la trentaine et une vie tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Traductrice pour une maison d'édition, elle est l'une des rares personnes dans cette boîte à rendre son travail en temps et en heure. Et même, en avance, chose quasiment inconcevable dans ce secteur... Elle est comme ça, Lyla, respectueuse des délais, discrète et même carrément effacée.
Lyla a la trentaine et, en dehors de ce boulot qu'elle accomplit avec efficacité mais sans passion, il n'y a pas grand-chose dans sa vie. Il y a Zoé, sa meilleure (sa seule ?) amie, aussi exubérante et décomplexée que Lyla est introvertie et manquant de confiance en elle. Il y a un amant, marié, comme il se doit, et qui ne quittera jamais sa femme, comme il se doit. Il y a le vin, quand les soirées sont un peu trop dures.
Il y a un grand vide...
Un de ces fameux soirs où le blues menace de la submerger, Lyla découvre qu'on lui a laissé un message. Cette voix, elle ne pensait plus jamais l'entendre. Cette voix appartient au passé, ce passé où Lyla était encore une adolescente, avec des problèmes d'adolescente et des relations difficiles avec sa mère. Mais, elle était encore pleine de vie, pleine d'envie.
Cette voix, c'est celle de Joris, rencontré 17 ans plus tôt lors de vacances sur la côte landaise. Une vélo de location, la chaîne qui casse et la nécessité de trouver un moyen de regagner la maison. Lyla était alors tombée sur trois surfeurs, attablés devant un food-truck. Des garçons plus vieux qu'elle, deux ou trois ans, mais à cet âge-là, c'est une sacrée différence.
Une rencontre qui, elle ne le sait pas encore, va bouleverser sa vie. Faire de l'adolescente en conflit avec sa mère, une photographe de renom qui ne se comporte justement jamais comme une mère, cette adulte transparente, incapable de croquer la vie à pleines dents. Une jeune femme qui, toute sa vie, a fait diversion, comme le dit le message sur le bandeau.
Que s'est-il donc passé à la fin des années 1990 pour transformer ainsi Lyla, la vider de toute substance, la laisser avancer dans l'existence comme une coquille vide ? C'est évidemment l'enjeu de ce roman où Lyla va enfin devoir affronter son passé, faire resurgir ce qu'elle a refoulé au plus profond de son être depuis toutes ces années.
En utilisant le flash-back, alternant l'époque actuelle et le récit des événements qui se sont déroulés des années auparavant, mais aussi en nous offrant non seulement le point de vue de Lyla, celui de Joris, apportant ainsi un éclairage différent, Delphine Bertholon pointe les erreurs, les malentendus, les non-dits, les secrets qui ont abîmé trop longtemps Lyla. Mais pas seulement elle.
A noter, c'est un détail, mais sans doute pas anodin, que les chapitres se déroulant de nos jours sont rédigés à la première personne, alors que les épisodes du passé sont racontés à la troisième personne. Comme si, là également, on changeait d'angle, de regard. Une sorte de recul sur les faits, examinés forcément différemment, après toutes ces années.
Lyla... Elle rejoint la famille des héroïnes bertholoniennes, Madison, Nola, la Petite, Clémence, frappées par le sort, aux prises avec des vies dont elles peinent à prendre les rennes. Elles sont des héroïnes tragiques, en ce sens, puisque le destin s'est montré rude avec elles. Lyla n'échappe pas à la règle, mais il reste à comprendre ce qu'elle a traversé.
La première chose, c'est cette relation à sa mère, l'insupportable Elaine. Quand elle parle d'Elaine, Delphine Bertholon évoque Irina Ionesco et la relation toxique qu'elle entretint avec sa fille, Eva (sur le sujet, lire "Eva", de Simon Liberati). L'artiste talentueuse dépourvue de tout instinct maternel et considérant sa fille comme un sujet, une sorte de jouet.
Timide et pudique comme on peut l'être à l'adolescence, Lyla doit faire avec les lubies de sa mère, capable de débarquer dans la salle de bains pendant qu'elle se douche (elle a d'ailleurs fait retirer la serrure de la porte), de prendre de sa fille une série de clichés qui sera la base d'une future exposition à succès... On ne reconnaîtra pas Lyla sur ces photos, mais il lui suffit de savoir que c'est elle pour se sentir mal.
En août 1998, alors que la France se remet de sa victoire en Coupe du Monde de foot, Lyla approche de la majorité et sa décision est prise : dès qu'elle pourra, elle partira faire sa vie loin d'Elaine. Surtout ne pas finir comme son père, homme effacé, soumis, sans révolte, un mâle dévoré par une mante religieuse à l'appétit féroce.
Qui peut dire si, avec une vie familiale plus ordinaire, plus tranquille, la vie de Lyla et ses choix auraient été différents ? En tout cas, la voix de Joris a également réveillé le souvenir d'Elaine, que Lyla a rayé de sa vie, radicalement, peut-être sa dernière décision pleine d'autorité avant de devenir la Lyla sans substance que l'on rencontre en attaquant le roman.
La relation de Lyla à ses parents n'est pas la seule à être compliqué. On découvrira que Joris, lui aussi, n'a pas eu une enfance facile. Mais il a su surmonter le mal que son père lui a fait pour mener sa barque et se construire en opposition une fois adulte : il a réussi professionnellement et familialement. Jusqu'à ce que...
Ah, voilà, difficile d'en dire plus, à ce point. Avouez que ce billet a un côté intriguant, qu'on se demande ce qui s'est passé, en 1998... Eh bien, voilà, vous êtes au même point que le lecteur qui découvre "Coeur-naufrage" et échafaude hypothèse après hypothèse. Qui cherche à percer ce qui unit Lyla et Joris, ce qui peut, aussi brusquement, replonger la jeune femme dans ce passé dont elle a voulu faire table rase.
Attention, spoiler en approche.
Delphine Bertholon aborde dans "Coeur-naufrage" une question qui est assez rarement abordé par la littérature, et sans doute encore moins sous cet angle. Ce sujet, c'est le choix d'accoucher sous X. Décision au combien difficile, avec des conséquences forcément difficile. Ici, la romancière opte pour le regard de la mère, contrainte à cette décision extrême.
Je n'en dis pas plus, le reste, il faut le découvrir en lisant ce roman. En apprenant à mieux connaître Lyla, mais aussi Joris. A mesurer l'impact de leurs parcours personnels respectifs sur leur évolution dans la vie. Ils sont tellement différents et pourtant, si proches par bien des points. Ils sont profondément touchants et humains. Avec leurs qualités et leurs défauts, leurs erreurs et leur possible rédemption.
Parmi les points communs, là encore, cela peut sembler anecdotique, mais ça ne l'est pas, il y a Charles Bukowski et ses livres. Dans "Coeur-naufrage", on est loin des outrances de cet écrivain américain (souvenez-vous de son mémorable passage à "Apostrophes", à une époque où fumer et surtout boire sur un plateau de télé n'effarouchait personne), mais son écriture a renforcé les liens entre Lyla et Joris.
Ces lectures adolescentes ont sans doute suscité la vocation de Lyla, cette carrière de traductrice, seule chose qui la fasse exister. On est sur un blog où l'on parle de livres, et voilà une occasion de parler d'un écrivain qui, plus de 20 ans après sa mort, demeure culte pour beaucoup. Tiens, il faudrait moi aussi que je m'y intéresse...
Delphine Bertholon n'a pas l'habitude de ménager ses personnages, elle les confronte à des drames, à ces fameux "accidents", pour en revenir au titre de ce billet. Mais, toujours, elle les envisage avec bienveillance et tendresse. Elle n'est pas l'écrivaine des descentes aux enfers, non, au contraire, elle est l'écrivaine du coup de talon qu'on donne lorsqu'on touche le fond pour remonter vers la lumière.
Il y a toujours de l'espoir dans les romans de cette auteure, et "Coeur-naufrage" n'échappe pas à cette règle. Mais, avant la lumière, il va falloir que Lyla entame et achève sa résilience, et, pour cela, il n'y a rien d'un mieux qu'un petit coup de main des amis, comme le chantaient les Beatles. Une chiquenaude pour se lancer dans le vide, mais ensuite, c'est sans filet. Et sans retour en arrière possible.
Une chose est sûre, lorsqu'on referme "Coeur-naufrage", on se dit qu'il faut prendre garde aux risques de non-dits, de petits secrets qu'on croit, à tort ou à raison, inavouables et qu'on enfouit jusqu'à ce qu'ils s'enkystent et créent de douloureux abcès. Oh, cette bonne résolution relève certainement plus du voeu pieux, on le sait bien, mais on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu, des risques et des conséquences.
Lyla, en cela, comme les autres héroïnes bertholoniennes (ça sonne bien, non ?) qui l'ont précédée, est un repère, un jalon, une flamme qui éclaire notre propre route. Nul n'est à l'abri d'un accident au cours de sa vie. A chacun de savoir les sublimer pour en faire quelque chose de beau, et non pas un terrible frein capable de flétrir toute une existence.
Lyla (avec un y) a la trentaine et une vie tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Traductrice pour une maison d'édition, elle est l'une des rares personnes dans cette boîte à rendre son travail en temps et en heure. Et même, en avance, chose quasiment inconcevable dans ce secteur... Elle est comme ça, Lyla, respectueuse des délais, discrète et même carrément effacée.
Lyla a la trentaine et, en dehors de ce boulot qu'elle accomplit avec efficacité mais sans passion, il n'y a pas grand-chose dans sa vie. Il y a Zoé, sa meilleure (sa seule ?) amie, aussi exubérante et décomplexée que Lyla est introvertie et manquant de confiance en elle. Il y a un amant, marié, comme il se doit, et qui ne quittera jamais sa femme, comme il se doit. Il y a le vin, quand les soirées sont un peu trop dures.
Il y a un grand vide...
Un de ces fameux soirs où le blues menace de la submerger, Lyla découvre qu'on lui a laissé un message. Cette voix, elle ne pensait plus jamais l'entendre. Cette voix appartient au passé, ce passé où Lyla était encore une adolescente, avec des problèmes d'adolescente et des relations difficiles avec sa mère. Mais, elle était encore pleine de vie, pleine d'envie.
Cette voix, c'est celle de Joris, rencontré 17 ans plus tôt lors de vacances sur la côte landaise. Une vélo de location, la chaîne qui casse et la nécessité de trouver un moyen de regagner la maison. Lyla était alors tombée sur trois surfeurs, attablés devant un food-truck. Des garçons plus vieux qu'elle, deux ou trois ans, mais à cet âge-là, c'est une sacrée différence.
Une rencontre qui, elle ne le sait pas encore, va bouleverser sa vie. Faire de l'adolescente en conflit avec sa mère, une photographe de renom qui ne se comporte justement jamais comme une mère, cette adulte transparente, incapable de croquer la vie à pleines dents. Une jeune femme qui, toute sa vie, a fait diversion, comme le dit le message sur le bandeau.
Que s'est-il donc passé à la fin des années 1990 pour transformer ainsi Lyla, la vider de toute substance, la laisser avancer dans l'existence comme une coquille vide ? C'est évidemment l'enjeu de ce roman où Lyla va enfin devoir affronter son passé, faire resurgir ce qu'elle a refoulé au plus profond de son être depuis toutes ces années.
En utilisant le flash-back, alternant l'époque actuelle et le récit des événements qui se sont déroulés des années auparavant, mais aussi en nous offrant non seulement le point de vue de Lyla, celui de Joris, apportant ainsi un éclairage différent, Delphine Bertholon pointe les erreurs, les malentendus, les non-dits, les secrets qui ont abîmé trop longtemps Lyla. Mais pas seulement elle.
A noter, c'est un détail, mais sans doute pas anodin, que les chapitres se déroulant de nos jours sont rédigés à la première personne, alors que les épisodes du passé sont racontés à la troisième personne. Comme si, là également, on changeait d'angle, de regard. Une sorte de recul sur les faits, examinés forcément différemment, après toutes ces années.
Lyla... Elle rejoint la famille des héroïnes bertholoniennes, Madison, Nola, la Petite, Clémence, frappées par le sort, aux prises avec des vies dont elles peinent à prendre les rennes. Elles sont des héroïnes tragiques, en ce sens, puisque le destin s'est montré rude avec elles. Lyla n'échappe pas à la règle, mais il reste à comprendre ce qu'elle a traversé.
La première chose, c'est cette relation à sa mère, l'insupportable Elaine. Quand elle parle d'Elaine, Delphine Bertholon évoque Irina Ionesco et la relation toxique qu'elle entretint avec sa fille, Eva (sur le sujet, lire "Eva", de Simon Liberati). L'artiste talentueuse dépourvue de tout instinct maternel et considérant sa fille comme un sujet, une sorte de jouet.
Timide et pudique comme on peut l'être à l'adolescence, Lyla doit faire avec les lubies de sa mère, capable de débarquer dans la salle de bains pendant qu'elle se douche (elle a d'ailleurs fait retirer la serrure de la porte), de prendre de sa fille une série de clichés qui sera la base d'une future exposition à succès... On ne reconnaîtra pas Lyla sur ces photos, mais il lui suffit de savoir que c'est elle pour se sentir mal.
En août 1998, alors que la France se remet de sa victoire en Coupe du Monde de foot, Lyla approche de la majorité et sa décision est prise : dès qu'elle pourra, elle partira faire sa vie loin d'Elaine. Surtout ne pas finir comme son père, homme effacé, soumis, sans révolte, un mâle dévoré par une mante religieuse à l'appétit féroce.
Qui peut dire si, avec une vie familiale plus ordinaire, plus tranquille, la vie de Lyla et ses choix auraient été différents ? En tout cas, la voix de Joris a également réveillé le souvenir d'Elaine, que Lyla a rayé de sa vie, radicalement, peut-être sa dernière décision pleine d'autorité avant de devenir la Lyla sans substance que l'on rencontre en attaquant le roman.
La relation de Lyla à ses parents n'est pas la seule à être compliqué. On découvrira que Joris, lui aussi, n'a pas eu une enfance facile. Mais il a su surmonter le mal que son père lui a fait pour mener sa barque et se construire en opposition une fois adulte : il a réussi professionnellement et familialement. Jusqu'à ce que...
Ah, voilà, difficile d'en dire plus, à ce point. Avouez que ce billet a un côté intriguant, qu'on se demande ce qui s'est passé, en 1998... Eh bien, voilà, vous êtes au même point que le lecteur qui découvre "Coeur-naufrage" et échafaude hypothèse après hypothèse. Qui cherche à percer ce qui unit Lyla et Joris, ce qui peut, aussi brusquement, replonger la jeune femme dans ce passé dont elle a voulu faire table rase.
Attention, spoiler en approche.
Delphine Bertholon aborde dans "Coeur-naufrage" une question qui est assez rarement abordé par la littérature, et sans doute encore moins sous cet angle. Ce sujet, c'est le choix d'accoucher sous X. Décision au combien difficile, avec des conséquences forcément difficile. Ici, la romancière opte pour le regard de la mère, contrainte à cette décision extrême.
Je n'en dis pas plus, le reste, il faut le découvrir en lisant ce roman. En apprenant à mieux connaître Lyla, mais aussi Joris. A mesurer l'impact de leurs parcours personnels respectifs sur leur évolution dans la vie. Ils sont tellement différents et pourtant, si proches par bien des points. Ils sont profondément touchants et humains. Avec leurs qualités et leurs défauts, leurs erreurs et leur possible rédemption.
Parmi les points communs, là encore, cela peut sembler anecdotique, mais ça ne l'est pas, il y a Charles Bukowski et ses livres. Dans "Coeur-naufrage", on est loin des outrances de cet écrivain américain (souvenez-vous de son mémorable passage à "Apostrophes", à une époque où fumer et surtout boire sur un plateau de télé n'effarouchait personne), mais son écriture a renforcé les liens entre Lyla et Joris.
Ces lectures adolescentes ont sans doute suscité la vocation de Lyla, cette carrière de traductrice, seule chose qui la fasse exister. On est sur un blog où l'on parle de livres, et voilà une occasion de parler d'un écrivain qui, plus de 20 ans après sa mort, demeure culte pour beaucoup. Tiens, il faudrait moi aussi que je m'y intéresse...
Delphine Bertholon n'a pas l'habitude de ménager ses personnages, elle les confronte à des drames, à ces fameux "accidents", pour en revenir au titre de ce billet. Mais, toujours, elle les envisage avec bienveillance et tendresse. Elle n'est pas l'écrivaine des descentes aux enfers, non, au contraire, elle est l'écrivaine du coup de talon qu'on donne lorsqu'on touche le fond pour remonter vers la lumière.
Il y a toujours de l'espoir dans les romans de cette auteure, et "Coeur-naufrage" n'échappe pas à cette règle. Mais, avant la lumière, il va falloir que Lyla entame et achève sa résilience, et, pour cela, il n'y a rien d'un mieux qu'un petit coup de main des amis, comme le chantaient les Beatles. Une chiquenaude pour se lancer dans le vide, mais ensuite, c'est sans filet. Et sans retour en arrière possible.
Une chose est sûre, lorsqu'on referme "Coeur-naufrage", on se dit qu'il faut prendre garde aux risques de non-dits, de petits secrets qu'on croit, à tort ou à raison, inavouables et qu'on enfouit jusqu'à ce qu'ils s'enkystent et créent de douloureux abcès. Oh, cette bonne résolution relève certainement plus du voeu pieux, on le sait bien, mais on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu, des risques et des conséquences.
Lyla, en cela, comme les autres héroïnes bertholoniennes (ça sonne bien, non ?) qui l'ont précédée, est un repère, un jalon, une flamme qui éclaire notre propre route. Nul n'est à l'abri d'un accident au cours de sa vie. A chacun de savoir les sublimer pour en faire quelque chose de beau, et non pas un terrible frein capable de flétrir toute une existence.
mardi 2 mai 2017
"On n'a pas besoin des hommes. Ils n'apportent que du malheur".
Plus de quinze ans après la publication d' "Autobiographie d'une Courgette", dont l'adaptation en film d'animation a connu récemment un immense succès tant critique que public, Gilles Paris fait son retour aux éditions Plon avec un nouveau roman à l'atmosphère inquiétante, "Le Vertige des falaises". Un roman choral plein de mystères et de non-dits qui se dissipent peu à peu au gré des témoignages des différents personnages, centraux ou plus secondaires. Un roman qui flirte avec les codes du noir et même du thriller, dans une ambiance qui n'est pas sans faire penser à des univers littéraires et cinématographiques bien connus. L'histoire tourmentée de trois femmes appartenant à trois générations différentes liées entre elles pour le meilleur et certainement pour le pire. Le tout, à huis clos, ou presque, sur un étrange caillou couronné d'un bien plus étrange maison encore...
Les Mortemer règne, le mot semble parfaitement adéquat, sur une île pas plus grosse qu'un caillou, le genre qui n'apparaît même pas sur les cartes. Où se situe-t-elle exactement ? On l'ignore, le seul repère est la ligne de ferry qui la relie au continent en un peu plus d'une heure. Pour le reste, cette île minuscule et sans nom est donc le royaume des Mortemer.
Jusqu'à sa mort, un an plus tôt, c'est Aristide, le patriarche, qui portait la couronne, si je puis m'exprimer ainsi. Architecte, il avait, à son arrivée quelques décennies plus tôt, rasée la maison de famille de son épouse, Olivia, pour y faire construire une étonnante maison de verre et d'acier, sobrement nommée Glass, qui a rapidement réussi à faire l'unanimité contre elle sur l'île.
C'est là qu'Aristide et Olivia ont fondé une famille : ils ont eu un garçon, Luc, qui, une fois devenu adulte, a épousé Rose, une jeune femme rencontrée sur le continent. Ensemble, ils ont donné naissance à une fille, désormais adolescente, et qu'ils ont baptisée Marnie. A voir cet arbre généalogique, on pourrait croire que les Mortemer ont tout pour être heureux.
Et pourtant...
Désormais, alors que le rocher se dépeuple peu à peu et redevient "inculte, un peu comme une insulte", pour reprendre les paroles de la chanson de Serge Lama, Seules les trois femmes demeurent à Glass. Marnie, 14 ans, a conquis une totale indépendance, agissant à sa guise, découchant pour aller dormir dans des granges ou plantant son compas dans le ventre d'un garçon qui lui plaît...
Une jeune terreur en devenir qui n'envisage pas une seconde de partir de cette île sauvage aux falaises abruptes. C'est d'ailleurs là, en surplomb du vide et de l'océan déchaîné, qu'elle se sent enfin sereine et confiante. C'est au vent qu'elle confie ses joies et ses peines, ses doutes et ses envies. Bien plus qu') sa meilleure amie, Jane, qui l'accompagne pourtant dans ces promenades risquées.
Comment cerner exactement Marnie ? C'est sans doute impossible. Sa mère, malade, n'en est pas capable. Sa grand-mère, elle, s'attendrit de voir cette jeune fille briser toutes les convenances et toutes les étiquettes, imposant sa jeune autorité à tous et se fichant comme d'une guigne de ce qu'on peut penser d'elle...
Olivia, Rose, Marnie... Trois femmes que tout pourrait séparer mais qui sont inextricablement liées, comme recluses dans cette maison aux transparences trompeuses. Olivia, héritière des Mortemer, est une femme vieillissante qui conserve toute son autorité, toute sa rigidité morale et sociale. Une espèce d'anachronisme, comme tout, ou presque, sur cette île, qui, par moments, paraît désuète.
On pourrait croire l'aînée des Mortemer inflexible, une sorte de statue du Commandeur, et pourtant, peu à peu, on va découvrir ses faiblesses, ses doutes, son attachement inattendu à sa bru et son inconditionnel amour pour sa petite fille. Parce que ces trois femmes ne sont pas juste des recluses : elles se serrent les coudes. Contre vents et marées. Contre les autres. Contre les hommes.
"Le Vertige des falaises" est un roman choral. Différents personnages s'expriment dans les courts chapitres qui composent l'histoire. Marnie et Olivia sont celles que l'on croise le plus, mais, à leurs côtés, on a aussi le regard de personnages qui n'appartiennent pas au clan Mortemer. Certains y sont liés, comme Pudence, la gouvernante, le médecin ou le prêtre de l'île, d'autres ne sont que des témoins extérieurs.
Il flotte sur cette île, sur cette maison une bien étrange ambiance, mais difficile de comprendre pourquoi exactement. Oh, on a bien des soupçons, qui enflent peu à peu au fil des récits, mais sans jamais vraiment nous apporter de certitudes. Les faits se dévoileront lentement, au rythme de la vie sur l'île des Mortemer...
Dans la note que Gilles Paris a placée en fin de roman, il explique que l'inspiration pour écrire "le Vertige des falaises" lui est venu en partie de la lecture d'un roman d'Agatha Christie : "la Maison biscornue" (disponible au Masque, dans une traduction récemment revue). C'est loin d'être le plus connu des livres de la romancière anglaise, et pourtant, c'était un de ceux qu'elle préférait.
Que vous ayez lu ou que vous ayez envie de lire "le Vertige des falaises", il est intéressant de s'attaquer aussi à ce roman christien, publié après la IIe Guerre mondiale. Une intrigue à la fois classique pour l'auteure (tout le monde est un coupable potentiel) et pourtant assez atypique : on est à Londres, enfermé dans une maison qui n'a rien des habituels cottages où enquêtent Poirot ou Miss Marple.
Agatha Christie s'y parodie même, affirmant avec une ironie mordante que les femmes ne sont pas faites pour enquêter, et propose une intrigue d'une grande modernité. Je serais assez curieux, d'ailleurs, de savoir comment il fut accueilli à sa sortie. Bref, si "le Vertige des falaises" n'est pas une réécriture de "la Maison biscornue", il y a d'amusants parallèles à faire et ses deux lectures se nourrissent l'une l'autre.
En ce qui me concerne, j'ai commencé par le livre de Gilles Paris puis celui d'Agatha Christie. Or, avant de découvrir cette référence en fin de lecture du "Vertige des falaises", j'avais envisagé une autre référence : je trouvais qu'il flottait sur cette île une ambiance à la Daphné du Maurier ( ce qui m'a fait sourire, puisque c'est Tatiana de Rosnay, auteure d'une récente biographie, qui signe la phrase écrite sur le bandeau).
Oui, Glass a des faux airs de Manderley, on imaginerait même un jour Marnie, devenue adulte, prononcer la mythique phrase d'ouverture : "la nuit dernière, j'ai rêvé que je retrounais à Glass"... Olivia pourrait être la cousine de Rebecca de Winter et Prudence fait furieusement pensé à la fidèle Mrs Danvers, air revêche compris.
Si l'on ne retrouve pas devant la maison de verre et d'acier le même parc luxuriant que devant la propriété des De Winter, il y a en revanche sur l'île des Mortemer ces fameuses falaises qui semblent attirer Marnie comme un aimant, et qui rappellent certaines scènes de "Rebecca", des scènes-clés de ce récit, puisque c'est par elles qu'on aboutira à la vérité.
Oui, il y a dans le roman de Gilles Paris ce genre d'ambiance un peu surannée, et je n'emploie pas ce mot de façon péjorative, au contraire. On ne sait pas vraiment quand se déroule cette histoire, et cette ambiguïté m'a beaucoup plu. Elle rappelle un peu ce que les scénaristes de la série "Bates Motel" ont fait, en utilisant une esthétique très fifties tout en resituant l'histoire de nos jours.
"Rebecca", "Psychose"... Encore un dénominateur commun, et il n'est pas innocent. Eh oui, "le Vertige des falaises" est un roman hitchcockien, par bien des points. A commencer par le prénom de sa jeune héroïne, Marnie, qui n'a pas la blondeur de Tippi Hedren, mais qui est auréolée d'un certain mystère (pour ne pas dire un mystère certain).
A l'inverse de son homonyme sur pellicule, la Marnie de Gilles Paris semble tout à fait maîtriser la situation et présider à son destin avec une assurance qui n'est pas sans rappeler la Pénélope de "la Maison biscornue". On se dit surtout que, sous l'indépendance qu'elle affiche, se cache une attention pleine d'acuité. En clair, si quelqu'un connait tout ce qui se passe sur l'île, c'est bien Marnie.
Tout ce qui se passe, et donc tous les secrets de ses habitants, tous les non-dits... Et il y en a énormément, sur cette île ! Difficile d'instaurer une intimité parfaite lorsqu'on vit sur une si petite île, au sein d'une si petite communauté, où tout le monde connaît tout le monde depuis longtemps (les nouveaux arrivants étant bien plus rares que les partants).
Un vrai paradoxe lorsqu'on regarde Glass, cette maison dont le nom dit autant la transparence que sa structure. Or, derrière ces murs de verre, se cachent bien des secrets inavouables. Les secrets des Mortemer, dont Olivia et plus encore Marnie, qui a l'avenir devant elle, sont les dépositaires. Tout ce qui se passe sur l'île des Mortemer doit rester sur l'île des Mortemer...
Au coeur du "Vertige des falaises", on a ces deux magnifiques personnages que sont Marnie et Olivia. Impossible d'entrer plus dans la psychologie de ces deux êtres ici, car ce sont évidemment les principaux ressorts de l'intrigue. Mais, il faut noter que Gilles Paris a abandonné l'enfance de ses narrateurs précédents pour entrer dans l'adolescence, et offrir d'autres perspectives.
Bien sûr, Marnie conserve une certaine candeur, l'ingénuité de celle qui a encore tout à découvrir dans l'existence, qui ne sait rien du monde qui l'entoure, je parle du monde au sens large, car il y a cette île, qu'elle connaît dans ses moindres recoins. C'est son monde, elle en est l'héritière et elle le sait. Pour reprendre la métaphore initiale, c'est elle qui y régnera.
Restera ou partira faire sa vie ailleurs ? Ce choix se présentera à elle un jour, il dépendra certainement de sa relation avec Vincy, ce garçon dans le ventre duquel elle a planté la pointe de son compas. Mais sera-t-elle aussi libre sur le continent que sur l'île ? Conservera-t-elle cette totale indépendance d'esprit et de comportement si elle intègre la société ? Restera-t-elle Marnie ?
Elle est terriblement attachante, Marnie, si seule, si solide mais ayant tant de raison d'être malheureuse. Jamais elle ne le reconnaîtra, au contraire, elle lutte contre le fatalisme à sa façon, avec le même aplomb qu'elle déploie lorsqu'elle défie les falaises, le vent, les vagues. Attachante, oui, mais énigmatique, aussi. Jusqu'à quel point ?
Gilles Paris orchestre de main de maître cette histoire, créant cette atmosphère pesante, inquiétante, hors du temps et du monde, comme si le vent soufflant sur les falaises abruptes de l'île étourdissait le lecteur. Il y a de nombreux voiles qui empêchent de tout voir, de tout comprendre de la réalité de l'île. Il vont se déchirer progressivement pour faire apparaître la vérité.
La vérité des Mortemer.
Les Mortemer règne, le mot semble parfaitement adéquat, sur une île pas plus grosse qu'un caillou, le genre qui n'apparaît même pas sur les cartes. Où se situe-t-elle exactement ? On l'ignore, le seul repère est la ligne de ferry qui la relie au continent en un peu plus d'une heure. Pour le reste, cette île minuscule et sans nom est donc le royaume des Mortemer.
Jusqu'à sa mort, un an plus tôt, c'est Aristide, le patriarche, qui portait la couronne, si je puis m'exprimer ainsi. Architecte, il avait, à son arrivée quelques décennies plus tôt, rasée la maison de famille de son épouse, Olivia, pour y faire construire une étonnante maison de verre et d'acier, sobrement nommée Glass, qui a rapidement réussi à faire l'unanimité contre elle sur l'île.
C'est là qu'Aristide et Olivia ont fondé une famille : ils ont eu un garçon, Luc, qui, une fois devenu adulte, a épousé Rose, une jeune femme rencontrée sur le continent. Ensemble, ils ont donné naissance à une fille, désormais adolescente, et qu'ils ont baptisée Marnie. A voir cet arbre généalogique, on pourrait croire que les Mortemer ont tout pour être heureux.
Et pourtant...
Désormais, alors que le rocher se dépeuple peu à peu et redevient "inculte, un peu comme une insulte", pour reprendre les paroles de la chanson de Serge Lama, Seules les trois femmes demeurent à Glass. Marnie, 14 ans, a conquis une totale indépendance, agissant à sa guise, découchant pour aller dormir dans des granges ou plantant son compas dans le ventre d'un garçon qui lui plaît...
Une jeune terreur en devenir qui n'envisage pas une seconde de partir de cette île sauvage aux falaises abruptes. C'est d'ailleurs là, en surplomb du vide et de l'océan déchaîné, qu'elle se sent enfin sereine et confiante. C'est au vent qu'elle confie ses joies et ses peines, ses doutes et ses envies. Bien plus qu') sa meilleure amie, Jane, qui l'accompagne pourtant dans ces promenades risquées.
Comment cerner exactement Marnie ? C'est sans doute impossible. Sa mère, malade, n'en est pas capable. Sa grand-mère, elle, s'attendrit de voir cette jeune fille briser toutes les convenances et toutes les étiquettes, imposant sa jeune autorité à tous et se fichant comme d'une guigne de ce qu'on peut penser d'elle...
Olivia, Rose, Marnie... Trois femmes que tout pourrait séparer mais qui sont inextricablement liées, comme recluses dans cette maison aux transparences trompeuses. Olivia, héritière des Mortemer, est une femme vieillissante qui conserve toute son autorité, toute sa rigidité morale et sociale. Une espèce d'anachronisme, comme tout, ou presque, sur cette île, qui, par moments, paraît désuète.
On pourrait croire l'aînée des Mortemer inflexible, une sorte de statue du Commandeur, et pourtant, peu à peu, on va découvrir ses faiblesses, ses doutes, son attachement inattendu à sa bru et son inconditionnel amour pour sa petite fille. Parce que ces trois femmes ne sont pas juste des recluses : elles se serrent les coudes. Contre vents et marées. Contre les autres. Contre les hommes.
"Le Vertige des falaises" est un roman choral. Différents personnages s'expriment dans les courts chapitres qui composent l'histoire. Marnie et Olivia sont celles que l'on croise le plus, mais, à leurs côtés, on a aussi le regard de personnages qui n'appartiennent pas au clan Mortemer. Certains y sont liés, comme Pudence, la gouvernante, le médecin ou le prêtre de l'île, d'autres ne sont que des témoins extérieurs.
Il flotte sur cette île, sur cette maison une bien étrange ambiance, mais difficile de comprendre pourquoi exactement. Oh, on a bien des soupçons, qui enflent peu à peu au fil des récits, mais sans jamais vraiment nous apporter de certitudes. Les faits se dévoileront lentement, au rythme de la vie sur l'île des Mortemer...
Dans la note que Gilles Paris a placée en fin de roman, il explique que l'inspiration pour écrire "le Vertige des falaises" lui est venu en partie de la lecture d'un roman d'Agatha Christie : "la Maison biscornue" (disponible au Masque, dans une traduction récemment revue). C'est loin d'être le plus connu des livres de la romancière anglaise, et pourtant, c'était un de ceux qu'elle préférait.
Que vous ayez lu ou que vous ayez envie de lire "le Vertige des falaises", il est intéressant de s'attaquer aussi à ce roman christien, publié après la IIe Guerre mondiale. Une intrigue à la fois classique pour l'auteure (tout le monde est un coupable potentiel) et pourtant assez atypique : on est à Londres, enfermé dans une maison qui n'a rien des habituels cottages où enquêtent Poirot ou Miss Marple.
Agatha Christie s'y parodie même, affirmant avec une ironie mordante que les femmes ne sont pas faites pour enquêter, et propose une intrigue d'une grande modernité. Je serais assez curieux, d'ailleurs, de savoir comment il fut accueilli à sa sortie. Bref, si "le Vertige des falaises" n'est pas une réécriture de "la Maison biscornue", il y a d'amusants parallèles à faire et ses deux lectures se nourrissent l'une l'autre.
En ce qui me concerne, j'ai commencé par le livre de Gilles Paris puis celui d'Agatha Christie. Or, avant de découvrir cette référence en fin de lecture du "Vertige des falaises", j'avais envisagé une autre référence : je trouvais qu'il flottait sur cette île une ambiance à la Daphné du Maurier ( ce qui m'a fait sourire, puisque c'est Tatiana de Rosnay, auteure d'une récente biographie, qui signe la phrase écrite sur le bandeau).
Oui, Glass a des faux airs de Manderley, on imaginerait même un jour Marnie, devenue adulte, prononcer la mythique phrase d'ouverture : "la nuit dernière, j'ai rêvé que je retrounais à Glass"... Olivia pourrait être la cousine de Rebecca de Winter et Prudence fait furieusement pensé à la fidèle Mrs Danvers, air revêche compris.
Si l'on ne retrouve pas devant la maison de verre et d'acier le même parc luxuriant que devant la propriété des De Winter, il y a en revanche sur l'île des Mortemer ces fameuses falaises qui semblent attirer Marnie comme un aimant, et qui rappellent certaines scènes de "Rebecca", des scènes-clés de ce récit, puisque c'est par elles qu'on aboutira à la vérité.
Oui, il y a dans le roman de Gilles Paris ce genre d'ambiance un peu surannée, et je n'emploie pas ce mot de façon péjorative, au contraire. On ne sait pas vraiment quand se déroule cette histoire, et cette ambiguïté m'a beaucoup plu. Elle rappelle un peu ce que les scénaristes de la série "Bates Motel" ont fait, en utilisant une esthétique très fifties tout en resituant l'histoire de nos jours.
"Rebecca", "Psychose"... Encore un dénominateur commun, et il n'est pas innocent. Eh oui, "le Vertige des falaises" est un roman hitchcockien, par bien des points. A commencer par le prénom de sa jeune héroïne, Marnie, qui n'a pas la blondeur de Tippi Hedren, mais qui est auréolée d'un certain mystère (pour ne pas dire un mystère certain).
A l'inverse de son homonyme sur pellicule, la Marnie de Gilles Paris semble tout à fait maîtriser la situation et présider à son destin avec une assurance qui n'est pas sans rappeler la Pénélope de "la Maison biscornue". On se dit surtout que, sous l'indépendance qu'elle affiche, se cache une attention pleine d'acuité. En clair, si quelqu'un connait tout ce qui se passe sur l'île, c'est bien Marnie.
Tout ce qui se passe, et donc tous les secrets de ses habitants, tous les non-dits... Et il y en a énormément, sur cette île ! Difficile d'instaurer une intimité parfaite lorsqu'on vit sur une si petite île, au sein d'une si petite communauté, où tout le monde connaît tout le monde depuis longtemps (les nouveaux arrivants étant bien plus rares que les partants).
Un vrai paradoxe lorsqu'on regarde Glass, cette maison dont le nom dit autant la transparence que sa structure. Or, derrière ces murs de verre, se cachent bien des secrets inavouables. Les secrets des Mortemer, dont Olivia et plus encore Marnie, qui a l'avenir devant elle, sont les dépositaires. Tout ce qui se passe sur l'île des Mortemer doit rester sur l'île des Mortemer...
Au coeur du "Vertige des falaises", on a ces deux magnifiques personnages que sont Marnie et Olivia. Impossible d'entrer plus dans la psychologie de ces deux êtres ici, car ce sont évidemment les principaux ressorts de l'intrigue. Mais, il faut noter que Gilles Paris a abandonné l'enfance de ses narrateurs précédents pour entrer dans l'adolescence, et offrir d'autres perspectives.
Bien sûr, Marnie conserve une certaine candeur, l'ingénuité de celle qui a encore tout à découvrir dans l'existence, qui ne sait rien du monde qui l'entoure, je parle du monde au sens large, car il y a cette île, qu'elle connaît dans ses moindres recoins. C'est son monde, elle en est l'héritière et elle le sait. Pour reprendre la métaphore initiale, c'est elle qui y régnera.
Restera ou partira faire sa vie ailleurs ? Ce choix se présentera à elle un jour, il dépendra certainement de sa relation avec Vincy, ce garçon dans le ventre duquel elle a planté la pointe de son compas. Mais sera-t-elle aussi libre sur le continent que sur l'île ? Conservera-t-elle cette totale indépendance d'esprit et de comportement si elle intègre la société ? Restera-t-elle Marnie ?
Elle est terriblement attachante, Marnie, si seule, si solide mais ayant tant de raison d'être malheureuse. Jamais elle ne le reconnaîtra, au contraire, elle lutte contre le fatalisme à sa façon, avec le même aplomb qu'elle déploie lorsqu'elle défie les falaises, le vent, les vagues. Attachante, oui, mais énigmatique, aussi. Jusqu'à quel point ?
Gilles Paris orchestre de main de maître cette histoire, créant cette atmosphère pesante, inquiétante, hors du temps et du monde, comme si le vent soufflant sur les falaises abruptes de l'île étourdissait le lecteur. Il y a de nombreux voiles qui empêchent de tout voir, de tout comprendre de la réalité de l'île. Il vont se déchirer progressivement pour faire apparaître la vérité.
La vérité des Mortemer.
Inscription à :
Articles (Atom)
.jpg/1024px-Gerrit_Adriaensz._Berckheyde_De_bocht_van_de_Herengracht_(1671-1672).jpg)