S'il semble désormais que les écrivains nombrilistes dont l'imaginaire se limite à leur cercle proche se taillent une part importante du marché du livre et de l'attention des médias, il reste, et heureusement, encore de véritables romanciers que le souffle du voyage, parfois immobile, appelle, exalte. Oui, j'aime ces écrivains voyageurs qui nous emmènent avec eux dans leurs pérégrinations aux quatre coins du monde et Olivier Bleys fait partie de ceux-là. Passionné de marche à pied, il a arpenté ces dernières années de très nombreux pays, profitant de cela pour observer le monde tel qu'il va et écrire des romans, toujours sensiblement différents les uns des autres. Son dernier ouvrage, fugacement apparu sur la première liste du Goncourt, nous emmène en Chine. "Discours d'un arbre sur le fragilité des hommes" (en grand format chez Albin Michel) tient à la fois du recueil de contes asiatiques, du roman social et de la satire. Malgré la gravité des questions abordées, c'est plein d'humour et de légèreté. Mais, c'est aussi un regard acéré sur la transition de la Chine maoïste vers une Chine ultra-capitaliste, où l'humain ne pèse pas plus lourd face aux intérêts énormes qui se dégagent qu'il ne pesait face à l'arbitraire du Grand Timonier.
La famille Zhang vit à Shenyang, une ville industrielle du nord-est de la Chine. Depuis toujours, elle est installée là et Wei, le chef de famille, n'entend pas, malgré les aléas, changer de lieu. Zhang Wei est pourtant au chômage depuis plusieurs années, après avoir été licencié de l'usine qui l'employait et il devient de plus en plus difficile de faire bouillir la marmite pour toute sa petite famille.
Car, à ses côtés, Wei a son épouse, Yun, leur fille adolescente, Meifen, mais aussi ses beaux-parents, Hou-Chi, que tout le monde appelle "l'oncle", alors qu'il ne l'a jamais été, et Cui, sa femme. Ces deux derniers ont atteint un âge canonique et leur capacité à donner un coup de main à la famille est de moins en moins évidente : Cui n'y voit plus guère et Hou-Chi, sourd comme un pot, ne se passionne plus que pour sa télévision...
Les parents de Wei, eux, sont morts quelques années plus tôt, ensemble, dans des conditions qu'on pourrait trouver très romantique. Depuis, Wei n'a cesse de leur rendre hommage. Et le plus magnifique qu'il aimerait leur rendre, c'est de tenir la promesse qu'ils s'étaient faite de leur vivant : mettre de coté assez d'argent pour racheter leur maison et le terrain qui l'entoure.
Oui, chez les Zhang, le rêve de devenir un jour propriétaire de sa modeste demeure est chevillé au corps. Yuan après yuan, même depuis qu'il ne touche plus un salaire régulier et doit faire appel au système D pour nourrir, chauffer, habiller tout le monde, il thésaurise, comme un gamin remplirait une tirelire de pièce de quelques centimes à la fois.
La maison des Zhang n'est pourtant pas bien folichonne. Minuscule, on s'y entasse tant bien que mal, on n'y bénéficie d'une intimité toute relative et d'un espace vital fort restreint. Mais, la fierté de Wei est ailleurs. A l'extérieur de la bicoque. Il s'agit d'un arbre, un sumac, "un arbre qui pleure", que l'homme défend becs et ongles, alors que, régulièrement, on lui demande de l'abattre.
Wei y a songé, bien sûr, surtout lorsque le froid tenaille la maisonnée et que le bois du sumac permettrait de faire une bonne flambée. Mais, jamais il ne s'y est résolu, considérant l'arbre comme un membre de sa famille et l'honorant de diverses façons, y compris les plus surprenantes... Un respect qui semble lui valoir quelques remerciements en retour...
En effet, à plusieurs reprises, c'est de l'arbre que viennent des signes positifs, permettant à Zhang Wei de trouver un moyen non seulement de faire vivre sa famille, mais aussi de grappiller quelques billet supplémentaires en vue du rachat de la maison à son actuel propriétaire, un milliardaire local, Fan, qui se fout bien de cette baraque branlante, mais ne saura refuser la vente du terrain, Wei en est sûr.
La vie des Zhang n'est pas rose, ce n'est pas un conte de fée, pas plus à l'occidentale qu'à la chinoise, non, mais Wei est porté par sa promesse et un enthousiasme presque juvénile qui, malgré les efforts que ça lui demande, lui permettent de rapporter de quoi améliorer un peu l'ordinaire et de se rapprocher de ce rêve qui l'habite.
Or, tout à sa course pour trouver de quoi se chauffer mais aussi, de quoi vendre au noir, Wei ne fait pas vraiment attention aux indices qui se multiplie dans le quartier où il habite. Un quartier qui s'est clairement dépeuplé ces dernières années, un quartier que populations et usines ont progressivement abandonné.
Oui, il y a du changement dans l'air à Shenyang, du changement en profondeur. Car la Chine du XXIe siècle est entrée dans la course folle au capital, cherchant par tous les moyens à doper PNB et PIB, sans vraiment se soucier de grand-chose d'autre, à commencer par sa nombreuse population qui ne bénéficie pas toujours de cette mutation qui enrichit une nouvelle classe dirigeante.
En fait, désormais, le symbole de la Chine n'est plus, comme au temps de Mao, le brave ouvrier oeuvrant pour un destin commun, que, en son temps, Wei aurait parfaitement pu incarner. Non, en 2015, celui que la Chine met en avant et fait grandir, c'est l'homme d'affaires. Ceux, peu nombreux, capables de s'enrichir à milliards, tant par leurs activités sur le territoire national qu'à travers le monde.
Fan, le propriétaire du terrain où se dresse la maison des Zhang et le fameux Sumac, appartient à cette clique, qui vit entre elle, dans une opulence presque obscène, coupée des réalités de ceux qui n'ont pas la chance d'être comme eux, vivant dans une tour qui n'est plus d'ivoire mais de marbres et d'ors, avec un résultat identique au final.
Fan, on le croise, dans le roman, dans une scène qui est sans doute la plus violente de ce roman. On peut le juger un peu caricatural, mais il doit incarner cette caste tenant en ses mains un pouvoir économique qui s'accompagne aussi d'une certaine occidentalisation des moeurs et des comportements.
Curieux système de vases communicants, qui voit la Chine étendre son empire économique sur les cinq continents, s'emparant avec discrétion mais efficacité, de nombreux avoirs-clés, comme les dettes occidentales ou les aides au développement en Afrique. Mais, dans le même temps, elle voit sa culture millénaire rognée par le miroir aux alouettes occidental, américain, en particulier...
Cette scène où apparaît Fan, dans toute sa démesure, fait d'ailleurs penser à toute une imagerie très occidentale. On est loin des triades chinoises, on verrait plus Al Capone ou Don Corleone, à ses côtés. Le whisky coule à flots, plutôt que les alcools traditionnels chinois, et tant pis si on n'aime pas vraiment cela, c'est d'abord l'image qui compte et le symbole de réussite que représente le liquide ambré.
Face à cette réalité dont il n'a pas conscience, Wei, qui a déjà développé toutes sortes de façon de s'adapter et de survivre, va une nouvelle fois devoir trouver la parade. Et cet homme ordinaire, un peu falot, qui n'aspire finalement qu'à la tranquillité dans cette baraque branlante habitée par ses souvenirs, va choisir de résister...
Oui, "Discours d'un arbre sur la fragilité des hommes", c'est bien cela, un roman sur la résistance au rouleau compresseur d'une économie en marche qui écrase tout, y compris ceux qui devraient être chargés de la faire fonctionner. Une énorme abstraction qui écrabouille le réel et fonce, fonce, sans qu'on sache si quelqu'un contrôle encore la machine, manifestement emballée.
Olivier Bleys joue de toutes ces oppositions, en particulier celle qui oppose, et peut-être plus brutalement encore qu'ailleurs, la tradition millénaire et la modernité destructrice. Ainsi, chaque chapitre de son roman porte un titre de conte et, malgré le contexte très contemporain dans lequel il s'inscrit, on retrouve quelques échos des contes asiatiques.
Les membres de la famille Zhang, parfois attachants, parfois agaçants, Wei compris, sont au coeur de cette histoire dont ils ne sont pas les moteurs, mais dont ils sont prisonniers. L'évolution se fait sans eux, contre eux et, s'ils plient, ils refusent de rompre. La volonté de ces gens modestes, cette aspiration au rêve de propriété, premier pas vers une forme de statut social supérieur, sont leurs meilleurs atouts dans cette lutte.
Ils ont aussi ce côté inflexible, qui n'est pas celui d'une rébellion motivée par une quelconque idéologie. Non, il y a toujours cet objectif, aussi profondément enraciné en Wei que ne l'est le sumac sur son bout de terrain. C'est d'abord l'envie d'avoir sa maison, son terrain à lui qui le pousse à agir et à refuser l'inévitable, quand d'autres choisissent de s'adapter au changement, et en tirent d'ailleurs parfois de nouveaux avantages.
Olivier Bleys s'inspire d'une actualité qui, par la grâce des réseaux sociaux et de ce monde où a moindre image frappe plus que le contexte qui l'entoure, où l'on est facilement touché par une photo, sans forcément se soucier de ce qu'il y a autour, est arrivée jusqu'à nous. Un phénomène qui a tendance à se multiplier en Chine, comme une représentation nouvelle de la lutte de David contre Goliath.
Et puis, il y a l'arbre... Présence discrète mais vénérable, modeste en apparence et pourtant d'une vigueur incarnant elle-même une forme de résistance aux éléments, il est au coeur de ce roman. Là encore, on pourrait y voir la transformation d'une culture qui était tellement en symbiose avec la nature pendant des siècles et qui, désormais, cherche à la dominer, impitoyablement.
Le rôle de cet arbre est fort, il concentre finalement autant que la maison, la lutte des Zhang. Dès les premières pages, on demande à Wei de l'abattre et il ne peut s'y résoudre. Entre l'homme et le sumac, la relation est assez étrange, presque hypnotique. C'est comme si l'arbre murmurait à l'oreille de l'homme et, allez savoir, ce n'est peut-être pas qu'une illusion...
En lisant le roman d'Olivier Bleys, un souvenir m'est venu en tête... A priori, pas grand-chose à voir, mais j'avais vu, il y a une douzaine d'années, un film d'horreur sud-coréen qui s'appelait "Acacia". Pourquoi cette association d'idées ? Ah... Pour certains éléments communs que j'ai choisi de ne pas évoquer ici... Et aussi, parce qu'on a un arbre qui influe dans l'existence des hommes.
Mais, le romancier n'a pas choisi de nous faire trembler, avec son histoire, comme Park Ki-Hyung Park, le réalisateur d' "Acacia". Non, l'arbre, ici, agit en patriarche, veillant sur les siens et assistant, hautain, détaché, à tout ce qui se trame autour de lui. Depuis quand est-il là ? Sans doute bien avant que ne naissent ceux qui voudraient le voir abattu... Et il se dressera là longtemps encore après eux.
Dans ce décor assez sordide, entre usines fumantes et cités ouvrières en décrépitude, qu'on croirait presque sortis d'un roman sur la Révolution industrielle en Europe, l'arbre et la famille Zhang constituent une oasis pleine de douceur et de poésie, affrontant la violence du monde en marche sans se laisser submerger par le découragement.
Et, au-delà du côté conte asiatique et de l'éloignement géographique, cette histoire doit nous interpeller, car elle nous concerne tous. La globalisation de l'économie mondiale, la soif permanente de profits en faisant abstraction de toute raison, tout cela n'est pas l'apanage d'une Chine qui s'est éveillée. Et l'humain, comme la nature, est bel et bien secondaire...
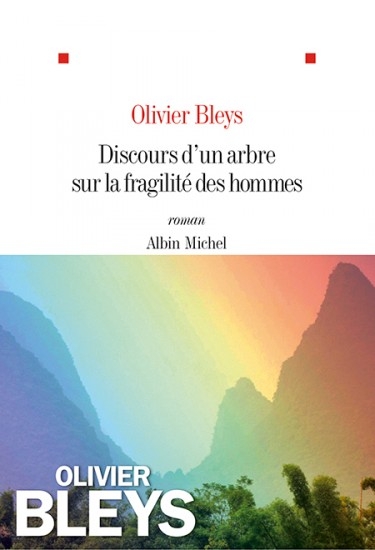
j'aime beaucoup cet auteur depuis Le Colonel désaccordé puis Concerto pour la main morte. Il a une facilité pour nous transporter dans d'autres cultures. Hâte de lire celui-ci
RépondreSupprimer